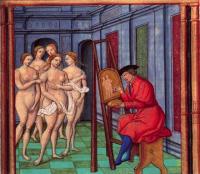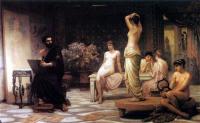Zeuxis, Hélène et les cinq vierges de Crotone
Bibliographie
Images
Le Maître Hospitalier, Zeuxis prépare une image d’Hélène pour le temple de Junon (Pas d'information sur l'artiste)
Medium : miniature
Pas de fichier image pour cette oeuvre
Zeuxis choisissant ses modèles, illustration de la Rhétorique de Cicéron Gand (Pas d'information sur l'artiste)
Medium : enluminure sur vélin
Pas de fichier image pour cette oeuvre
Zeuxis peignant Vénus, d'après Francisco Solimena SOLIMENA Francesco
Pas de fichier image pour cette oeuvre
Zeuxis composant un tableau de Junon, d’après Angelica Kauffman KAUFFMAN Angelica BARTOLOZZI Francesco
Medium : gravure
Zeuxis choisissant les plus belles femmes de Cortone pour modèles VINCENT François André
Medium : huile sur toile
Commentaires : signé et daté, il existe une réduction, 1791, collection privée.
Zeuxis choisissant ses modèles VIEN Joseph-marie
Medium : plume et encre noire, lavis de gris
Commentaires : signé et daté
Nicomaque admirant la peinture de Zeuxis VIEN Joseph-marie
Medium : plume et encre noire, lavis de gris
Commentaires : signé et daté
Apelle extrayant les beautés de divers modèles ROWLANDSON Thomas
Medium : dessin à l’encre et à l’aquarelle
Le triomphe de la peinture ou Zeuxis choisissant ses modèles MOTTEZ Victor-louis
Medium : peinture sur bois
Discours des passions humaines de la joye et de la tristesse, et quelle est la plus vehemente, discours prononcé devant Henri III(publi: 1887, redac: 1574:1589), p. 249 (fran)
Zeuxis, ce tant renommé peintre de la ville de Héraclée dont il estoit natif, qui avecques cette curiosité peignit son Hélène, tant estimée en laquelle il recueillit, accomplit et parfit une beauté d'une infinité de beautés choisies et tirées des plus belles, assemblant ce qui estoit de beau en plusieurs joint et mis en une seule semblance [...]
Lorris, Guillaume de ; Meung, Jean de, Le Roman de la rose(redac: :(1305)), p. 848-852, v. 16169-16252 (fran)
Bien vous la vousisse descrire
Mais mi sens n’i porroit souffire.
Mi sens ? K’ai-je dit ? C’est du mains !
Non feroit voir nus sens humains
Ne par voiz vives ne par notes,
Et fust Platons ou Aristotes,
Algus, Ouclides, Tholomees,
Qui tant orent granz rennommes,
D’avoir esté bon escrivain.
Leur enging seroient si vain
S’ils osoient la chose enprendre,
Qu’ils ne la porroient entendre,
Ne Pàymalion entaillier ;
Parasius, voire Apelles,
Que mout bon paintre apel, les
Biautez de li jamais descrire
Ne porroit, tant eüst a vivre ;
Ne Myro ne Policletus
Jamais ne savroient cest us.
Zeusys neïs par son biau paindre
Ne porroit a tel forme ataindre,
Qui pour faire l’ymage ou tample
De V puceles prist example,
Les plus beles que l’en pot querre
Et trouver en toute la terre,
Qui devant lui se sont tenues
Tout en estant trestoutes nues,
Pour soi prendre garde à chascune
S’il trouvoit nul defaut en l’une
Ou fust sus cors ou fust sor menbre,
Si com tulles le nous menbre
Ou livre de sa rethorique
Qui mout est science autentique.
Mais ci ne peüst il riens faire,
Zeusys, tant seüst bien portraire
Ne colorer sa portraiture,
Tant est de grant biauté nature.
Zeusys ? Non pas, mais tuit li mestre
Que nature fist onques nestre,
Car or soit que bien entendissent
Sa biauté toute et tuit vousissent
A tel portraiture muser,
Ainz porroient lor mains user
Que si tres grant biauté portraire.
Nus fors Dieu ne le porroit faire.
Et pour ce que, se je pouisse,
Volentiers au mains l’entendisse,
Voire escripte la vous eüsse
Se je pouisse et je seüsse,
Je meïsmes i ai musé
Tant que tout mon sens i usé
Comme fous et outrecuidiez,
C. tanz plus que vous ne cuidiez,
Car trop fis grant presumpcion
Quant onques mis m’entencion
A si tres haute oevre achever,
K’ainz me peüst li cuers crever,
Tant trouvai noble et de grant pris
La grant biauté que je tant pris,
Que par penser la compreïsse
Par nul travail que j’i meïsse,
Ne que seulement en osasse
I. mot tinter, tant i pensasse.
Si sui dou penser recreüz,
Por ce me sui atant teüz,
Et quant je plus i ai pensé,
Tant est bele que plus n’en sé.
Car Dieu, li biaus outre mesure,
Quant il biauté mist en nature,
Il en i fist une fontaine
Touz jors corant et touz jorz plaine,
De qui toute biauté desdrive,
Mais nus n’en set ne fonz ne rive.
Pour e n’est froiz que conte face
Ne de son cors ne de sa face
Qui tant est avenanz et bele
Que flor de lis en may nouvele,
Rose sor rain ne noif sor branche,
N’est si vermeille ne si blanche.
Si devroie je comparer,
Quant je l’os a riens comparer,
Puis que sa biautez ne son pris
Ne puet estre d’omne compris.
Lorris, Guillaume de ; Meung, Jean de, Le Roman de la rose, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Je voudrais bien vous la décrire, mais mes capacités intellectuelles n'y pourraient suffire. Mes capacités? Qu'ai-je dit là? Cela va de soi! En vérité, aucune intelligence humaine n'en serait capable, ni de vive voix ni par écrit, fût-ce Platon ou Aristote, Algus, Euclide, Ptolémée, qui eurent si grande renommée d'avoir été bons écrivains. Leur intelligence serait à ce point impuissante, s'ils avaient l'audace d'entreprendre la chose, qu'ils ne sauraient même pas la comprendre; Pygmalion n'arriverait pas à en faire une statue; c'est en vain que parasius pourrait s'y évertuer, et même Apelle que j'appelle un bon peintre, ne serait jamais en mesure de décrire ses beautés, si longtemps qu'il vive; Myron non plus ni Polyclète n'atteindraient jamais cette manière de faire.
Zeuxis même, par son beau talent de peintre ne pourrait arriver à représenter une telle beauté, lui qui pour faire dans le temple l'image de la déesse prit comme modèle cinq jeunes filles, les plus belles que l'on put chercher et découvrir en toute la terre, qui ont posé devant lui, en pied, toutes nues pour qu'il puisse faire attention, en les regardant chacune, s'il trouvait quelque défaut en l'une, sur le corps ou sur un membre, comme nous le rappelle Cicéron dans son livre intitulé Rhétorique, qui contient un savoir tout à fait authentique. Mais en la circonstance il n'eût rien pu faire, Zeuxis, quel que fût son talent à peindre des portraits et à les colorer, tant est grande la beauté de Nature. Zeuxis? Pas uniquement lui, mais tous les maîtres que Nature ait jamais fait naître, car, à supposer qu'ils aient parfaitement compris toute sa beauté et qu'ils aient tous voulu employer leur temps à en faire le portrait, ils auraient cependant pu user leurs mains avant d'arriver à faire le portrait d'une si éminente beauté. Personne sauf Dieu n'en est capable. Et parce que, si je l'avais pu, j'aurais volontiers au moins compris cette beauté, et que je vous l'aurais même exposée par écrit si j'avais pu et su le faire, moi-même j'y ai passé du temps, au point que j'y ai usé tout mon esprit; ce fut folie et outrecuidance, cent fois plus que vous ne l'imaginez, car j'ai fait preuve d'une trop grande présomption en mettant mes efforts à l'accomplissement d'une œuvre si considérable; mon cœur, en effet, aurait pu éclater, tant je la trouvai noble et précieuse, cette grande beauté que tant j'apprécie, avant que ma pensée n'arrive à la comprendre, quels que fussent mes efforts, ou avant que je n'ose seulement proférer une parole, quelle que fût l'intensité de ma méditation. Aussi suis-je las de penser et c'est pourquoi je me suis, dès lors, tu; et quand j'y pensais, et plus j'y ai pensé, moins j'en sais, tant elle est belle.
Le Maître Hospitalier, Zeuxis prépare une image d’Hélène pour le temple de Junon (1280:1300) miniature
La nature plutôt que les cinq vierges de Zeuxis (15e siècle)
Zeuxis peignant cinq nus ((1520)) enluminure
Aristote (Ἀριστοτέλης), ᾿Εν τοῖς πολιτικοῖς (redac: (-375):(-350), trad: 1960:1989) (III, 11, 3-4, 1281b ), t. II, p. 75 (grecque)
πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ' αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. Ἀλλὰ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ σπουδαῖοι τῶν ἀνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν μὴ καλῶν τοὺς καλούς φασι, καὶ τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης τῶν ἀληθινῶν, τῷ συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν, ἐπεὶ κεχωρισμένων γε κάλλιον ἔχειν τοῦ γεγραμμένου τουδὶ μὲν τὸν ὀφθαλμὸν ἑτέρου δέ τινος ἕτερον μόριον.
Aristote (Ἀριστοτέλης), ᾿Εν τοῖς πολιτικοῖς , (trad: 1960:1989) (III, 11, 3-4, 1281b)(trad: "Politique " par Aubonnet, Jean en 1960:1989)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse ; et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie ; celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l’assemblée entière juge l’ensemble de l’ouvrage. L’homme distingué, pris individuellement, diffère de la foule, comme la beauté, dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l’art produit diffère de la réalité, par l’assemblage en un seul corps de beaux traits épars ailleurs ; ce qui n’empêche pas que, si l’on analyse les choses, on ne puisse trouver mieux encore que le tableau, et que tel homme puisse avoir les yeux plus beaux, tel l’emporter par toute autre partie du corps.
Xénophon (Ξενοφῶν), ᾿Απομνημονευμάτων (redac: (-375):(-350), trad: 2000:2011) (III, X, 1-2 (Reinach, 261)), p. 96-97 (grecque)
1. Εἰσελθὼν μὲν γάρ ποτε πρὸς Παρράσιον τὸν ζωγράφον καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, Ἆρα, ἔφη, ὦ Παρράσιε, γραφική ἐστιν εἰκασία τῶν ὁρωμένων; Τὰ γοῦν κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ φωτεινὰ καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ λεῖα καὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμεῖσθε. 2. — Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη. — Καὶ μὴν τά γε καλὰ εἴδη ἀφομοιοῦντες, ἐπειδὴ οὐ ῥᾴδιον ἑνὶ ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολλῶν συνάγοντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι. — Ποιοῦμεν γάρ, ἔφη, οὕτως.
Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Entrant un jour dans l’atelier du peintre Parrhasios et s’entretenant avec lui : « Dis-moi, Parrhasios, dit-il, la peinture n’est-elle pas une représentation des objets visibles ? Ainsi les enfoncements et les saillies, le clair et l’obscur, la dureté et la noblesse, la rudesse et le poli, la fraîcheur de l’âge et sa décrépitude, vous les imitez à l’aide de couleurs ? — Tu dis vrai. — Et si vous voulez représenter des formes parfaitement belles, comme il n’est pas facile de trouver un homme qui n’ait aucune imperfection, vous rassemblez plusieurs modèles, vous prenez à chacun ce qu’il a de plus beau, et vous composez ainsi un ensemble d’une beauté parfaite ? — C’est ainsi que nous faisons.
Xénophon (Ξενοφῶν), ᾿Απομνημονευμάτων , (trad: 2000:2011) (III, X, 1-2), p. 96 (trad: "Mémorables " par Bandini, Michele; Dorion, Louis-André en 2000:2011)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
1. Un jour qu’il était entré chez le peintre Parrhasios et qu’il s’entretenait avec lui, il lui demanda : « Parrhasios, la peinture est-elle la reproduction de ce que l’on voit ? Vous cherchez à imiter, en les représentant à l’aide de couleurs, les différents corps, qu’ils soient creux ou en relief, sombres ou lumineux, durs ou mous, rugueux ou lisses, jeunes ou vieux. — 2. Tu dis vrai, dit-il. — Et lorsque vous reproduisez de belles formes, comme il n’est pas facile de tomber sur un seul homme dont toutes les parties sont irréprochables, c’est en rassemblant les plus belles parties que vous avez prélevées sur de nombreux modèles que vous faites paraître beau l’ensemble du corps. — C’est en effet ainsi que nous procédons, reconnut-il.
Denys d’Halicarnasse (Διονύσιος), Περὶ μιμήσεως (redac: (-100):(-50), trad: 1992), Επιτομη , p. 31-32 (grecque)
Οὔτω καὶ λόγων μιμήσει ὁμοιότης τίκτεται, ἐπὰν ζηλώσῃ τις τὸ παρ’ἑκάστῳ τῶν παλαιῶν βέλτιον εἶναι δοκοῦν, καὶ καθάπερ ἐκ πολλῶν ναμἀτων ἔν τε σθγκομίσας ῥεῦμα τοῦτ' εἰς τὴν ψυχὴν μετοχετεύσῃ. καί μοι παρίσταται πιστώσασθαι τὸν λόγον τοῦτον ἔργῳ· Ζεῦξις ἦν ζωγράϕος, καὶ παρὰ Κροτωνιατῶν ἐθαυμάζετο· καὶ αὐτῷ τὴν ‘Ελένην γράϕοντι γυμνὴν γυμνὰς ἰδεῖν τὰς παρ' αὐτοῖς ἐπέτρεψαν παρθένους· οὐκ ἐπειδή περ ἦσαν ἅπασαι καλαί, ἀλλ’ οὐκ εἰκὸς ἦν ὡς παντάπασιν ἦσαν αἰσχραί· ὃ δ’ ἦν ἄξιον παρ’ ἑκάστῃ γραφῆς ἐς ἠθροίσθη σώματος εἰκόνα κἀκ πολλῶν μερῶν συλλογῆς ἓν τι συνέθηκεν ἡ τέχνη έλειον εἶδος. τοιγαροῦν πάρεστι καὶ σοὶ καθάπερ ἐν θεάτρῳ καλῶν σωμάτων ἰδέας ἐξιστορεῖν καὶ τῆς ἐκείνων ψυχῆς ἀπανθίζεσθαι τὸ κρεῖττον καὶ τὸν τῆς πολυμαθείας ἔρανον συλλέγοντι οὐκ ἐξίτηλον χρόνῳ γενησομένην εἰκόνα τυποῦν ἀλλ’ ἀθάνατον τέχνης κάλλος.
Denys d’Halicarnasse (Διονύσιος), Περὶ μιμήσεως , (trad: 1992), p. 31-32 (trad: "L’imitation : fragments, épitomé " par Aujac, Germaine en 1992)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
3. C’est de la même manière qu’en littérature naît la ressemblance par imitation, lorsque, piqués d’émulation pour ce que nous jugeons de meilleur chez tel ou tel des anciens, nous réunissons pour ainsi dire plusieurs ruisseaux en un seul courant, et le dérivons sur notre âme. 4. L’idée me vient de confirmer mon propos par un fait : Zeuxis était un peintre fort admiré à Crotone ; un jour qu’il avait à peindre Hélène nue, les Crotoniates lui envoyèrent les jeunes filles de la ville pour qu’il les vît nues, non qu’elles soient toutes belles, mais parce qu’il était peu vraisemblable qu’elles soient totalement laides ; ce qui, chez chacune, méritait d’être reproduit en peinture fut ainsi concentré sur un seul portrait ; de la réunion de beaucoup d’éléments, l’art a composé une seule image, parfaite. 5. Aussi t’appartient-il à toi aussi de te mettre en quête, comme au théâtre, de beaux modèles humains, de recueillir le meilleur de leur âme, et puis, mettant à contribution ta large culture, de façonner, au lieu d’une image éphémère, un bel objet d’art qui atteindra l’immortalité.
Cicéron (Marcus Tullius Cicero), De inventione (redac: (-84), trad: 1994) (II, 1), p. 142-144 (latin)
1. Crotoniatae quondam, cum florerent omnibus copiis et in Italia cum primis beati numerarentur, templum Iunonis, quod religiosissime colebant, egregiis picturis locupletare uoluerunt. Itaque Heracleoten Zeuxin, qui tum longe ceteris excellere pictoribus existimabatur, magno pretio conductum adhibuerunt. Is et ceteras conplures tabulas pinxit, quarum nonnulla pars usque ad nostram memoriam propter fani religionem remansit, et, ut excellentem muliebris formae pulchritudinem muta in se imago contineret, Helenae pingere simulacrum uelle dixit; quod Crotoniatae, qui eum muliebri in corpore pingendo plurimum aliis praestare saepe accepissent, libenter audierunt. Putauerunt enim, si, quo in genere plurimum posset, in eo magno opere elaborasset, egregium sibi opus illo in fano relicturum.
2. Neque tum eos illa opinio fefellit. Nam Zeuxis ilico quaesiuit ab iis quasnam uirgines formosas haberent. Illi autem statim hominem deduxerunt in palaestram atque ei pueros ostenderunt multos, magna praeditos dignitate. Etenim quodam tempore Crotoniatae multum omnibus corporum uiribus et dignitatibus antisteterunt atque honestissimas ex gymnico certamine uictorias domum cum laude maxima retulerunt. Cum puerorum igitur formas et corpora magno hic opere miraretur: « Horum, inquiunt illi, sorores sunt apud nos uirgines. Quare, qua sint illae dignitate, potes ex his suspicari. » « Praebete igitur mihi, quaeso, inquit, ex istis uirginibus formonsissimas, dum pingo id quod pollicitus sum uobis, ut mutum in simulacrum ex animali exemplo ueritas transferatur. »
3. Tum Crotoniatae publico de consilio uirgines unum in locum conduxerunt et pictori quam uellet eligendi potestatem dederunt. Ille autem quinque delegit ; quarum nomina multi poetae memoriae prodiderunt, quod eius essent iudicio probatae, qui pulcritudinis habere uerissimum iudicium debuisset. Neque enim putauit omnia, quae quaereret ad uenustatem, uno se in corpore reperire posse ideo, quod nihil simplici in genere omnibus ex partibus perfectum natura expoliuit. Itaque, tamquam ceteris non sit habitura quod largiatur, si uni cuncta concesserit, aliud alii commodi aliquo adiuncto incommodo muneratur.
4. Quod quoniam nobis quoque uoluntatis accidit, ut artem dicendi perscriberemus, non unum aliquod proposuimus exemplum, cuius omnes partes, quocumque essent in genere, exprimendae nobis necessarie uiderentur ; sed omnibus unum in locum coactis scriptoribus, quod quisque commodissime praecipere uidebatur, excerpsimus et ex uariis ingeniis excellentissima quaeque libauimus. Ex iis enim, qui nomine et memoria digni sunt, nec nihil optime nec omnia praeclarissime quisquam dicere nobis uidebatur. Quapropter stultitia uisa est aut a bene inuentis alicuius recedere, si quo in uitio eius offenderemur, aut ad uitia eius quoque accedere, cuius aliquo bene praecepto duceremur.
5. Quodsi in ceteris quoque studiis a multis eligere homines commodissimum quodque quam sese uni alicui certe uellent addicere, minus in arrogantiam offenderent ; non tanto opere in uitiis perseuerarent ; aliquanto leuius ex inscientia laborarent. Ac si par in nobis huius artis atque in illo picturae scientia fuisset, fortasse magis hoc in suo genere opus nostrum quam illius in suo pictura nobilis eniteret. Ex maiore enim copia nobis quam illi fuit exemplorum eligendi potestas. Ille una ex urbe et ex eo numero uirginum, quae tum erant, eligere potuit; nobis omnium, quicumque fuerunt ab ultimo principio huius praeceptionis usque ad hoc tempus, expositis copiis, quodcumque placeret eligendi potestas fuit.
Cicéron (Marcus Tullius Cicero), De inventione, (trad: 1869) (II, 1)(trad: "De l'invention" par Nisard, Désiré en 1869)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
1. Crotone, célèbre par son opulence, et regardée comme une des plus heureuses villes d’Italie, voulut jadis orner de peintures excellentes le temple de Junon, sa divinité tutélaire. On fit venir à grands frais Zeuxis d’Héraclée, regardé comme le premier peintre de son siècle. Après avoir peint plusieurs tableaux, dont le respect des peuples pour ce temple a conservé une partie jusqu’à nos jours, l’artiste, pour donner dans un tableau le modèle d'une beauté parfaite, résolut de faire le portrait d’Hélène. Ce projet flatta les Crotoniates qui avaient entendu vanter le talent singulier de Zeuxis pour peindre les femmes ; et ils pensèrent que s’il voulait développer tous ses moyens et tout son talent, dans un genre où il excellait, il ne pouvait manquer d'enrichir leur temple d'un chef-d’œuvre.
Leur attente ne fut point trompée. D’abord Zeuxis demanda s’ils avaient de jeunes vierges remarquables par leur beauté. On le conduisit aussitôt au gymnase, où il vit, dans un grand nombre de jeunes gens, la figure la plus noble et les plus belles proportions : car il fut un temps où les Crotoniates se distinguèrent par leur vigueur, par l’élégance et la beauté de leurs formes, et remportèrent les victoires les plus éclatantes et les plus glorieuses dans les combats gymniques. Comme il admirait les grâces et la beauté de toute cette jeunesse : Nous avons leurs sœurs, vierges encore, lui dit-on; ce que vous voyez peut vous donner une idée de leurs charmes. — Que l'on me donne les plus belles pour modèles dans le tableau que je vous ai promis, s'écria l'artiste, et l'on trouvera dans une image muette toute la vérité de la nature.
Alors un décret du peuple rassembla dans un même lieu toutes les jeunes vierges, et donna au peintre la liberté de choisir parmi elles. Il en choisit cinq ; les poètes se sont empressés de nous transmettre les noms de celles qui obtinrent le prix de la beauté, au jugement d’un artiste qui devait savoir si bien l’apprécier. Zeuxis ne crut donc pas pouvoir trouver réunies dans une seule femme toutes les perfections qu’il voulait donner à son Hélène. En effet, la nature en aucun genre ne produit rien de parfait : elle semble craindre d’épuiser ses perfections en les prodiguant à un seul individu, et fait toujours acheter ses faveurs par quelque disgrâce.
II. Et nous aussi, dans le dessein que nous avons formé d’écrire sur l’éloquence, nous ne nous sommes point proposé un modèle unique, pour nous faire un devoir d’en calquer servilement tous les traits, mais nous avons réuni et rassemblé tous les écrivains, pour puiser dans leurs ouvrages ce qu’ils renferment de plus parfait, pour en prendre en quelque sorte la fleur. Car si, parmi les écrivains dont le nom mérite d'être conservé, il n’en est aucun qui n’offre quelque chose d’excellent, il n’en est aucun aussi qui nous semble réunir toutes les parties. Il nous a donc paru que ce serait une folie de rejeter ce qu’il y a de bon dans un écrivain, à cause de quelques défauts, ou de le suivre dans ses erreurs, quand nous avons reçu de lui d’utiles préceptes.
Que si l’on voulait suivre cette marche dans les autres arts ; si, au lieu de s’asservir opiniâtrement à un seul maître, on voulait prendre de chacun ce qu’il a de meilleur, on verrait parmi les hommes moins de présomption, moins d'entêtement dans leurs erreurs et moins d’ignorance. Si j’avais pour l’éloquence le même talent que Zeuxis pour la peinture, peut-être mon ouvrage serait-il dans son genre supérieur au chef-d’œuvre sorti de son pinceau ; car j’ai eu à choisir parmi un plus grand nombre de modèles. Il n’a pu choisir, lui, que parmi les vierges d’une seule ville, et parmi celles qui vivaient à cette époque ; et moi, j’avais à ma disposition tous les écrivains qui, depuis l’origine de l’éloquence jusqu’à nos jours, ont donné des préceptes sur la rhétorique.
Cicéron (Marcus Tullius Cicero), De inventione , (trad: 1994) (II, 1), p. 142-144 (trad: "L’Invention " par Achard, Guy en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
1. Jadis, les citoyens de Crotone, qui possédaient tout en abondance et qui étaient comptés parmi les plus riches d’Italie, décidèrent d’orner de peintures exceptionnelles le temple de Junon, temple auquel ils vouaient une très grande vénération. Ils s’assurèrent donc à grands frais le concours de Zeuxis d’Héraclée qui était considéré alors comme le peintre de loin le meilleur. Il peignit de très nombreux tableaux dont une partie a subsisté jusqu’à notre époque en raison de la vénération attachée à ce sanctuaire et, pour fixer dans une image muette un modèle de beauté féminine parfaite, il dit vouloir peindre Hélène. Les Crotoniates, qui avaient souvent entendu dire que, pour peindre le corps féminin, il dépassait largement les autres, accueillirent volontiers cette idée. Ils pensaient en effet que, s’il se surpassait dans le genre où il était le plus fort, il leur laisserait dans ce beau temple un chef-d’œuvre.
2. Leur attente ne fut pas trompée. En effet Zeuxis leur demanda aussitôt quelles belles jeunes filles ils avaient. Ils conduisirent immédiatement l’homme à la palestre et lui montrèrent de nombreux jeunes hommes, dotés d’une grande beauté. En effet il y eut un temps où les Crotoniates étaient de loin les premiers en force et en beauté physiques et ils remportèrent dans les combats gymniques de très honorables et glorieuses victoires. Il admira donc vivement la beauté corporelle de ces jeunes gens : ses interlocuteurs lui dirent alors : « Nous avons chez nous de jeunes filles, les sœurs de ces jeunes gens. Tu peux, d’après leurs frères, juger de leur beauté. » Il leur répond : « Amenez-moi donc, je vous prie, les plus belles de vos filles, le temps que je peigne ce que je vous ai promis, pour que la vraie beauté passe de ces modèles vivants à un tableau muet. » 3. Alors les Crotoniates, par un décret public, firent venir les jeunes filles en un même endroit et donnèrent au peintre la possibilité de choisir celle qu’il voudrait.
Il en choisit cinq. Bien des poètes ont transmis leurs noms, parce qu’à leurs yeux elles avaient été distinguées par le jugement d’un homme qui avait dû avoir un sentiment très sûr de la beauté. Il en choisit cinq parce qu’il pensait que tout ce qu’il recherchait pour faire un beau portrait, il ne pouvait le rencontrer dans un seul corps. C’est que la nature n’a pas placé l’absolue perfection dans une seule créature. Aussi, comme redoutant de ne pas avoir de quoi donner aux autres, si elle accordait tout à une seule femme, elle offre des attraits différents à chacune, en y joignant quelque disgrâce.
4. Puisque nous aussi, nous avons eu l’intention de donner des préceptes complets en matière d’éloquence, nous ne nous sommes pas proposé un seul modèle dont il nous aurait fallu reproduire tous les détails, dans quelque domaine que ce fût ; mais, après avoir rassemblé tous les auteurs, nous en avons tiré ce que chacun semblait offrir de plus utile comme précepte, cueillant la fleur de ces talents divers. En effet parmi ceux qui méritent d’être célèbres et de n’être pas oubliés, il nous apparaissait que chacun donnait quelque excellent conseil mais que personne n’en donnait de remarquables sur tous les points. C’est pourquoi il nous a paru stupide de laisser de côté une bonne trouvaille chez quelqu’un, parce que celui-ci nous rebutait par un défaut, ou de suivre jusqu’aux erreurs d’un autre, parce qu’il donnait un bon conseil qui nous plaisait. 5. Et si, dans tous les autres arts pareillement, les gens consentaient à emprunter à de nombreux maîtres leurs leçons les plus utiles plutôt que de se vouer à un seul, quel qu’il soit, ils choqueraient moins par leur arrogance, ne persévéreraient pas tant dans l’erreur et souffriraient nettement moins de leur ignorance.
Et si ma connaissance de l’art oratoire égalait celle de la peinture chez Zeuxis, peut-être notre ouvrage serait-il plus célèbre dans son genre que la peinture de Zeuxis. En effet nous avons eu la possibilité de choisir parmi un plus grand nombre de modèles que lui. Celui-ci n’a pu choisir que parmi les jeunes filles qui vivaient à une époque donnée dans une seule ville. Nous, nous avons eu à notre disposition toutes les ressources fournies par tous les maîtres qui ont existé dè !s le début de l’enseignement de la rhétorique jusqu’à notre époque et nous avons pu choisir tout ce que nous voulions.
Valère Maxime (Valerius Maximus), Factorum dictorumque memorabilium libri IX (redac: 1:50, trad: 1935), "De fiducia sui", ext. 3 (numéro III, 7 (Reinach 219)) , p. 269-270 (latin)
Zeuxis autem, cum Helenam pinxisset, quid de eo opere homines sensuri essent expectandum non putauit, sed protinus hos uersus adiecit : οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ εὐκνήμιδας Ἀχαιοὺς
Τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν[Note contexte]
Adeone dextrae suae multum pictor adrogauit, ut ea tantum formae comprehensum crederet, quantum aut Leda caelesti partu edere aut Homerus diuino ingenio exprimere potuit ?
Valère Maxime (Valerius Maximus), Factorum dictorumque memorabilium libri IX , (trad: 1935) (n°219)(trad: "Faits et dits mémorables " par Constant, Pierre en 1935)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Le peintre Zeuxis, ayant achevé son Hélène, ne crut pas devoir attendre le jugement du public, mais, le devançant, il ajouta à son tableau ces vers : « Il n’y a pas à s’indigner si les Troyens et les Achéens aux belles cnémides, pour une telle femme, endurent de si longues souffrances ». Ainsi l’artiste se flattait que sa main avait réalisé un type de beauté aussi parfait que celui qu’avait mis au monde Léda, visitée par un dieu, ou qu’avait créé le divin génie d’Homère.
Valère Maxime (Valerius Maximus), Facta et dicta memorabilia, (trad: 1995:) (III, 7, ext. 3), p. 169-170 (trad: "Faits et dits mémorables" par Combès, Robert en 1995:)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Et Zeuxis, quand il eut fait le tableau représentant Hélène, n’a pas cru devoir attendre l’appréciation qu’on porterait sur cette œuvre et il y a ajouté immédiatement les vers suivants : « Non,il n’y a pas lieu de blâmer les Troyens et les Achéens aux bonnes jambières, si, pour une telle femme, ils souffrent de si longs maux. » Est-ce que le peintre a attribué tant de capacité à sa main qu’il pensait qu’elle avait réalisé autant de beautés que Léda put en créer en enfantant un être céleste ou Homère en traduire avec son divin génie ?
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (64)(latin)
Alioqui tantus diligentia, ut Agragantinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Laciniae publice dicarent, inspexerit uirgines eorum nudas et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset pictura redderet.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (64)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Son souci de la précision était si fort que, devant exécuter pour les Agrigentins un tableau destiné à être dédié aux frais de l’État dans le temple de Junon Lacinienne, il passa en revue les jeunes filles de la cité, nues et en choisit cinq, afin de reproduire dans sa peinture ce qu’il y avait de plus louable en chacune d’elles.
Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ma per altro di tanta diligentia che havendo a dipignere al populo d’Agrigento una tavola laquale publicamente havevono a dedicare nel tempio di Iunone lacinia volse vedere le loro vergini unde (sic) e di tute ne elesse cinque per potere con la pictura exprimere quelle parti lequali in ciascuna fussino piu excellenti.
Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 987 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
altrimenti tanto diligente, che havendo à fare una tavola agli Agrigentini, laquale publicamente dedicassino nel tempio di Iunone Lacinia, risguardassi le loro vergini nude, e ne elesse cinque, accioché quello che in ciascuna fusse laudatissimo, potesse esprimere nelle pitture.
Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1095 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
- [1] Vedi M. Tulio nel prohemio del li. 2 del inventione
[…] ma per altro usava tanta diligentia, ch’essendo egli per fare una tavola a gli Agrigentini, laquale essi erano per dedicare publicamente nel tempio di Giunone Laciniana, volle vedere le lore vergini ignude, et ne scelse cinque, per potere colla pittura rappresentare quelle parti, lequali in ciascuna d’esse fossero piu eccellenti. [1]
Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 943 (fran)
- [1] Agrigentum
- [2] Lacinium promont.
mais au reste il estoit si curieux de suivre le naturel, que voulant faire un tableau pour ceux de Girgenti [1], qui en avoyent voué un au temple de Juno, qui est au cap [2] de colomnes en la Calabre en dehors, il voulut voir toutes les filles de Girgenti nues : entre lesquelles il en choisit cinq, pour amasser en son pourtrait toutes les marques de beauté qu’elles avoyent.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 235-237 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Au surplus, il étoit d’une exactitude admirable dans l’imitation du vrai : et pour qu’on ne doute point de cette exactitude, j’observerai, à l’égard de sa Junon Lacinienne[1], dédiée par les Agrigentins au temple de cette déesse, qu’avant d’y travailler, il obtint, de voir leurs filles nues, parmi lesquelles il en choisit cinq[2], pour en extraire et rassembler dans sa Junon ce qu’il jugea de plus beau en chacune.
- [1] Il est fait mention de l’autel de Junon Lacinienne au l. 2, ch. 107.
- [2] Selon Cicéron, de Invent. l. 2, n°1, Zeuxis fit les mêmes conditions avec les Crotoniates, pour l’Hélene qu’ils dédierent dans ce même temple de Junon.
Victorinus Afer, Gaius Marius, Explanationes in Rhetoricam M. Tullii Ciceronis(redac: 300:400), p. 146-147 (latin)
Hic, ad quod ducitur praefatio, illud est, ex multis artium scriptoribus electa multa et ad unam quam scripsit artem, quo pulchrior redderetur, praecepta ex multis multa collecta. Huic igitur rei praefatio illa est, Zeuxin, pictorem nobilem, Helenae simulacrum pinxisse, sed cum conductis et in unum uocatis quinque virginibus quidquid esset pulcherrimum delegisset. Hoc, ut perspici licet, in summa conuenit, quia hic et ille multa de multis. Verum praefert Tullius opus suum, quod magis multa ipse, si quidem praeteriti temporis scriptores et praesentis in iudicio habuit, et non unius ciuitatis nec unius linguae, quippe cum et Graecos et Latinos ; at uero Zeuxis ex una ciuitate et ipsius temporis eligendi habuit facultatem.
Crotoniatae qvondam cvm florerent. Si partibus conductis tota conueniunt, pulchra semper et praecipua dicetur esse prefatio. Crotoniatae Romani sunt ; cum florerent omnibus copiis Romanis conuenit : item conuenit et in Italia cum primis beati numerarentur. Iunonis uero templum, quod locupletare egregiis picturis uoluerunt : sic et eloquentiae uel facundiae templum. Zeuxis Tullius. Cum multa dicendi genera sint, ut inter picturas multas Helena, ita inter ceteras dictiones eminet semper oratoria, et ut Zeuxis in femineis pingendis uultibus summus, ita in orationibus Tullius. Pinxit Zeuxis multa, quae usque ad nostram memoriam manent: saecula posteriora tenent, quidquid pinxit oratio Tulliana. Zeuxis Helenae se simulacrum pingere uelle dixit ; non enim Helenam, sed simulacrum fuerat traditurus. Ita Tullius scribendo artes, non orationes, non ipsam eloquentiam, sed simulacrum eloquentiae fuerat traditurus. Huic conuenit et illa sententia : quod ex animali exemplo mutum in simulacrum ueritas transferebatur. Mutum enim simulacrum eloquentiae ars eius, ipsa autem eloquentia quasi animal. Ita pro parte poterit ei rei, ad quam confertur praefatio, conuenire, relicto eo, quod postea praeponitur, quod, cum Tullius ex omnibus multa quaesierit et omni tempore, Zeuxis ex una ciuitate et uno tempore conparauit.
Victorinus Afer, Gaius Marius, Explanationes in Rhetoricam M. Tullii Ciceronis, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Toute cette introduction est une sorte de comparaison pour ce qui sera dit plus loin [...] Ce à quoi tend l’introduction, c’est à montrer que beaucoup de choses ont été choisies dans beaucoup d’auteurs de traités, et que, rien que pour un des traités que Cicéron écrivit, ont été rassemblés, afin de le rendre plus beau, de nombreux préceptes tirés de nombreuses sources. Pour cela, l’introduction traite donc du noble peintre Zeuxis qui peignit un simulacre d’Hélène, mais cela seulement après que cinq jeunes filles ayant été conduites et rassemblées dans un même lieu, il eut choisi tout ce qu’elles avaient de plus beau. Comme on peut le remarquer, cela convient bien dans l’ensemble, parce que l’orateur et le peintre ont beaucoup emprunté à beaucoup, mais Cicéron donne l’avantage à sa propre œuvre parce qu’il a emprunté plus de choses, dans la mesure où il a pris en considération les auteurs du temps passé et présent, et non ceux d’une seule cité ou d’une seule langue, puisqu’il englobe les Grecs et les Latins, tandis que Zeuxis n’a eu le moyen de choisir que dans une seule cité et à sa propre époque. Si de la confrontation de ses parties il ressort que toute convient dans la comparaison, on considérera que c’est là une belle introduction. Ainsi, « les Crotoniates » sont les Romains, puisque l’expression « comme les Crotoniates étaient florissants en ressources de toutes sortes » convient aux Romains, de même que « et qu’on les comptait parmi les peuples les plus heureux en Italie ». Quant au « temple de Junon qu’ils voulaient enrichir de peintures sans pareilles », il correspond au temple de l’éloquence et du beau parler. « Zeuxis », c’est Cicéron. Alors qu’il y a de nombreuses façons de parler, de même qu’Hélène domine parmi de nombreux tableaux, de même l’art oratoire domine toujours parmi toutes les autres formes de parole, et, de même que Zeuxis n’avait pas son pareil pour preindre les visages de femmes, de même Cicéron pour les discours. Zeuxis peignit beaucoup de tableaux dont le souvenir s’est transmis jusqu’à nous ; les siècles ultérieurs conservent tout ce qu’a peint le discours de Cicéron. Zeuxis déclara qu’il voulait peindre un simulacre d’Hélène, et ce qu’il entendait transmettre à la postérité, c’était, non pas Hélène, mais son simulacre ; de même Cicéron, quand il écrivait des traités, entendait transmettre, non pas des discours, ni l’éloquence elle-même, mais un simulacre de l’éloquence. À cela convient également l’expression « à partir d’un modèle animé, faire passer la vérité dans un simulacre muet ». Un traité sur l’éloquence est en effet un simulacre muet de celle-ci, alors que l’éloquence est en elle-même une sorte d’être animé. Ainsi donc, l’introduction pourra convenir en partie à la chose à laquelle elle est comparée ; la seule différence, qui est exposée plus loin, c’est que, alors que Cicéron va chercher beaucoup de choses dans tous les pays et à toute époque, Zeuxis compara beaucoup de choses dans une seule cité et à une seule époque.
Boccaccio, Giovanni, De mulieribus claris(publi: 1374, redac: 1361-1362), p. 146 (latin)
Ad illam pinniculo formandam, ingenium omne artisque vires exposuit ; et cum, preter Homeri carmen et magnam undique famam, nullum aliud haberet exemplum, ut per hec duo de facie et cetero persone statu potuerat mente concipere, excogitavit se ex aliis plurium pulcherrimis formis divinam illam Helene effigiem posse percipere et aliis poscentibus designatam ostendere ; et ostensis postulanti a Crotoniatibus, primo formosissimis pueris et inde sororibus, ex formosioribus quinque precipuo decore spectabiles selegit ; et collecta secum ex pulcritudine omnium forma una, totis ex ingenio celebri emunctis viribus, vix creditum est satis plene quod optabat arte potuisse percipere. […] Fecit ergo quod potuit ; et quod pinxerat, tanquam celeste simulacri decus, posteritati reliquit.
Boccaccio, Giovanni, Il commento alla Divina Comedia(redac: 1373:1374), t. II, p. 128-129 (italien)
Fù la bellezza di costei tanto oltre ad ogni altra maravigliosa, che ella non solamente a discriversi con la penna faticò il divino ingegno d’Omero, ma ella ancora molti solenni dipintori e più intagliatori per maestero famosissimi stancò : e intra gli altri, sì come Tullio nel secondo dell’Arte vecchia scrive, fu Zeusi eracleate, il quale per ingegno e per arte tutti i suoi contemporanei e molti de’ predecessori trapassò. Questi, condotto con grandissimo prezzo da’ crotoniesi a dover la sua effigie col pennello dimostrare, ogni vigilanza pose, premendo con gran fatica d’animo tutte le forze dell’ingegno suo ; e, non avendo alcun altro esemplo, a tanta operazione, che i versi d’Omero e la fama universale che della bellezza di costea correa, aggiunse a questi due un esemplo assai discreto : percioché primieramente si fece mostrare tutti i be’ fanciulli di Crotone, e poi le belle fanciulle, e di tutti questi elesse cinque, e delle bellezze de’ visi loro e della statura e abitudine de’ corpi, aiutato da’ versi d’Omero, formò nella mente sua una vergine di perfetta bellezza, e quella, quanto l’arte poté seguire l’ingegno, dipinse, lasciandola, sì come celestiale simulacro, alla posterità per vera effigie d’Elena. Nel quale artificio forse si poté abbattere l’industrioso maestro alle lineature del viso, al colore e alla statura del corpo ; ma come possiam noi credere che il pennello e lo scarpello possano effigiare la letizia degli occhi, la piacevolezza di tutto il viso, e l’affabilità, e il celeste riso, e i movimenti vari della faccia, e la decenza delle parole, e la qualità degli atti ? Il che adoperare è solamente officio della natura.
Boccaccio, Giovanni, Il commento alla Divina Comedia, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
La beauté de cette femme était une merveille à ce point supérieure à toute autre, que non seulement, à décrire par la plume, elle donna du mal à l’ingegno divin d’Homère, mais encore qu’elle lassa bon nombre de peintres majestueux et plus encore de graveurs très réputés pour leur maîtrise. Parmi ceux-là, il y eu, entre autres, comme le dit Cicéron dans le second livre de l’Arte vecchia, le cas de Zeuxis d’Héraclée, dont l’ingegno et l’arte surpassaient tous ses contemporains et nombre de ses prédecesseurs. Celui-ci, que les Crotoniates avaient amené, moyennant une très forte somme, à devoir montrer du pinceau son effigie, concentra toute son attention, mobilisant, au prix d’une grande contention d’esprit, toutes les forces de son ingegno ; comme il n’y avait, pour élaborer une telle œuvre, d’autre modèle exemplaire que les vers d’Homère et la renommée universelle qui courait de la beauté de cette femme, il leur en ajouta un troisième, très judicieux : il commença par se faire montrer les beaux garçons de Crotone, puis les belles filles, et, sur l’ensemble, il en choisit cinq, et, à partir des beautés de leurs visages et des statures et attitudes de leurs corps, s’aidant des vers d’Homère, il forma dans son esprit une vierge d’une beauté parfaite, et, dans la mesure où son arte parvint à suivre son ingegno, c’est celle-là qu’il peignit et qu’il laissa à la postérité, tel un simulacre d’origine céleste, comme la véritable effigie d’Hélène. Grâce à cet artifice, le maître industrieux réussit peut-être à attraper les linéaments du visage, la couleur et la stature du corps, mais comment pourrions-nous croire que le pinceau ou le ciseau puissent effigier l’allégresse des yeux, l’agrément de l’ensemble du visage, l’affabilité, le rire céleste, les mouvements variés de la face, la décence des paroles et la qualité des actes ? Les mettre en œuvre est l’office exclusif de la nature.
Chaucer, Geoffrey, Canterbury Tales(redac: (1400)), p. 427, lignes 1-16 (anglais)
Ther was, as telleth Titus Liuvius,
A knyght that called was Virginius […]
This knyght a doghter hadde by his wif :
No children hadde he mo in al his lif.
Fair was this mayde in excellent beautee
Abouen every wight that man may see,
For nature hath with sovereyn diligence
Yformed hir in so greet excellence
As thogh she wolde seyn : “Lo, I, nature,
Thus kan I forme and peynte a creature
Whan that me list. Who kan me contrefete?
Pigmalion noght, thought he ay forge and bête
Or grave or peynte. For I dar wel seyn
Apelles, Zanzis sholde werche in veyn.”
Alberti, Leon Battista, De pictura(publi: 1540, redac: 1435, trad: 2004) (III, 56), p. 186-188 (latin)
Sed quo sit studium non futile et cassum, fugienda est illa consuetudo nonnullorum qui suopte ingenio ad picturae laudem contendunt, nullam naturalem faciem eius rei oculis aut mente coram sequentes. Hi enim non recte pingere discunt sed erroribus assuefiunt. Fugit enim imperitos ea pulchritudinis idea quam peritissimi vix discernunt. Zeuxis, praestantissimus et omnium doctissimus et peritissimus pictor, facturus tabulam quam in tempio Lucinae apud Crotoniates publice dicaret, non suo confisus ingenio temere, ut fere omnes hac aetate pictores, ad pingendum accessit, sed quod putabat omnia quae ad venustatem quaereret, ea non modo proprio ingenio non posse, sed ne a natura quidem petita uno posse in corpore reperiri, idcirco ex omni eius urbis iuventute delegit virgines quinque forma praestantiores, ut quod in quaque esset formae muliebris laudatissimum, id in pictura referret. Prudenter is quidem, nam pictoribus nullo proposito exemplari quod imitentur, ubi ingenio tantum pulchritudinis laudes captare enituntur, facile evenit ut eo labore non quam debent aut quaerunt pulchritudinem assequantur, sed plane in malos, quos vel volentes vix possunt dimittere, pingendi usus dilabantur. Qui vero ab ipsa natura omnia suscipere consueverit, is manum ita exercitatam reddet ut semper quicquid conetur naturam ipsam sapiat. Quae res in picturis quam sit optanda videmus, nam in historia si adsit facies cogniti alicuius hominis, tametsi aliae nonnullae praestantioris artificii emineant, cognitus tamen vultus omnium spectantium oculos ad se rapit, tantam in se, quod sit a natura sumptum, et gratiam et vim habet. Ergo semper quae picturi sumus, ea a natura sumamus, semperque ex his quaeque pulcherrima et dignissima deligamus.
Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 56), p. 187-189 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Mais pour que l’étude ne soit pas futile et vaine, il faut perdre cette habitude qu’ont certains de se fier à leur seul talent pour attirer les éloges sur leur peinture, sans se mettre devant les yeux ou l’esprit aucune chose dont ils suivent l’aspect naturel. Car ceux-là n’apprennent pas à peindre correctement, mais s’habituent à leurs erreurs. Elle échappe en effet aux peintres sans expérience, cette idée de la beauté que les peintres accomplis distinguent à peine. L’incomparable Zeuxis, le plus savant et le plus accompli de tous, devant faire un tableau à consacrer publiquement dans le temple de Lucine chez les Crotoniates, entreprit de le peindre sans se fier étourdiment à son propre talent, comme le font presque tous les peintres de notre époque ; au contraire, estimant que non seulement tout ce qu’il recherchait pour atteindre la vénusté ne pouvait lui être acquis par son talent, mais que, même en le demandant à la nature, il ne pourrait le trouver en un seul corps, il chosit dans toute la jeunesse de cette ville cinq jeunes filles particulièrement belles, afin de reporter dans sa peinture ce qui de la forme féminine était en chacune le plus digne d’éloges. Il fit preuve de sagesse, car lorsque les peintres n’ont devant eux aucun modèle à imiter et tentent, en s’appuyant sur leur seul talent, d’attirer les éloges dus à la beauté, il arrive facilement que ces efforts ne les conduisent pas à la beauté nécessaire ou recherchée et qu’ils tombent dans de mauvaises habitudes de peindre, dont ils ont peine à se défaire alors même qu’ils le veulent. Au contraire, celui qui se sera accoutumé à tout prendre de la nature aura la main si exercée que, dans toutes ses tentatives, on sentira le goût de la nature même.
Alberti, Leon Battista, De pictura , (trad: 1536), p. 259 (trad: "[Della pittura]" en 1536)(italien)(traduction ancienne de l'auteur)
Ma per non perdere studio e fatica si vuole fuggire quella consuetudine d’alcuni sciocchi, i quali presuntuosi di suo ingegno, senza avere essemplo alcuno dalla natura quale con occhi o mente seguano, studiano da sé a sé acquistare lode di dipignere. Questi non imparano dipignere bene, ma assuefanno sé a’ suoi errori. Fugge gl’ingegni non periti quella idea delle bellezze, quale i bene essercitatissimi appena discernono. Zeusis, prestantissimo e fra gli altri essercitatissimo pittore, per fare una tavola qual pubblico pose nel tempio di Lucina appresso de’ Crotoniati, non fidandosi pazzamente, quanto oggi ciascuno pittore, del suo ingegno, ma perché pensava non potere in uno solo corpo trovare quante bellezze egli ricercava, perché dalla natura non erano ad uno solo date, pertanto di tutta la gioventù di quella terra elesse cinque fanciulle le più belle, per torre da queste qualunque bellezza lodata in una femmina. Savio pittore, se conobbe che ad i pittori, ove loro sia niuno essemplo della natura quale elli seguitino, ma pure vogliono con suoi ingegni giugnere le lode della bellezza, ivi facile loro avverrà che non quale cercano bellezza con tanta fatica troveranno, ma certo piglieranno sue pratiche non buone, quali poi ben volendo mai potranno lassare. Ma chi da essa natura s’auserà prendere qualunque facci cosa, costui renderà sua mano sì essercitata che sempre qualunque cosa farà parrà tratta dal naturale.
Palmieri, Matteo, Della Vita Civile(publi: 1439), p. 121-122 (italien)
Seguitando in questo esempio di Zeusis sommo pittore, in quale, condotto con gran prezzo à Cutrone, che in que’ tempi abbondava d’ogni bene più che altra città italica, e volendo in un loro celebrato e degnissimo tempio dipingere la immagine di Elena, la quale era famosa sopra tutte le belle mai in terra vedute, e vedendo le donne di Cutrone belle sopra ogni altre di Italia, domandò volere, mentre dipignea, vedere la forma, e le dilicate fattezze che le più belle vergini aveano, et così per pubblica provisione gli furono nude mostre tutte le vergini loro, e di quelle elesse cinque, la cui fama ancora nel mondo dura come di belle nel numero delle belle, elette per più belle, da sommo maestro, e giudice vero della bene formata bellezza.
Così non potendo in un solo corpo trovare pulito dalla natura ogni parte che cercava alla perfetta bellezza, da ciascuna prese la parte in che più fioriva e di tutte formò una immagine tanto pulitamente in ogni parte perfetta, che di tutto il mondo concorrevano nobilissimi pittori a vederla come cosa mirabile, che piuttosto di cielo venuta che in terra fatta si confermava. Noi similmente, seguitando i temperati modi, l’ordine, ed approvati costumi del lodato vivere, da ciascuno virtuoso piglieremo quello in che più gli altri avanza, e così seguitando molti il migliore sempre prima, c’ingegneremo divenire quanto più potremo in ogni buono costume limati ; e per meno potere errare, quando dubitassimo, ci consiglieremo con gli antichi intendenti, e per lungo uso maestri di vivere.
Palmieri, Matteo, Della Vita Civile(publi: 1439), p. 121-122 (italien)
Seguitando in questo esempio di Zeusis sommo pittore, in quale, condotto con gran prezzo à Cutrone, che in que’ tempi abbondava d’ogni bene più che altra città italica, e volendo in un loro celebrato e degnissimo tempio dipingere la immagine di Elena, la quale era famosa sopra tutte le belle mai in terra vedute, e vedendo le donne di Cutrone belle sopra ogni altre di Italia, domandò volere, mentre dipignea, vedere la forma, e le dilicate fattezze che le più belle vergini aveano, et così per pubblica provisione gli furono nude mostre tutte le vergini loro, e di quelle elesse cinque, la cui fama ancora nel mondo dura come di belle nel numero delle belle, elette per più belle, da sommo maestro, e giudice vero della bene formata bellezza.
Così non potendo in un solo corpo trovare pulito dalla natura ogni parte che cercava alla perfetta bellezza, da ciascuna prese la parte in che più fioriva e di tutte formò una immagine tanto pulitamente in ogni parte perfetta, che di tutto il mondo concorrevano nobilissimi pittori a vederla come cosa mirabile, che piuttosto di cielo venuta che in terra fatta si confermava. Noi similmente, seguitando i temperati modi, l’ordine, ed approvati costumi del lodato vivere, da ciascuno virtuoso piglieremo quello in che più gli altri avanza, e così seguitando molti il migliore sempre prima, c’ingegneremo divenire quanto più potremo in ogni buono costume limati ; e per meno potere errare, quando dubitassimo, ci consiglieremo con gli antichi intendenti, e per lungo uso maestri di vivere.
Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 69 (italien)
E di tanta excellentia e diligentia fu nell’arti, che avendo a ·ffare una tavola agli Agrigentini, la quale essi aveano consecrata publicamente di Iunone Lacinia, egli scrisse vergini ignude delli Argentini, accioché egli di ciaschuna piglasse qualche bella parte per conducere a perfectione l’opera sua, la quale fu disegnata in una tavola biancha con maraviglose arti.
Alberti, Leon Battista, De statua(redac: (1450), trad: 2001), p. 81-82 (latin)
Ergo non unius istius aut illius corporis tantum, sed quoad licuit, eximiam a natura pluribus corporibus, quasi ratis portionibus dono distributam puchritudinem, adnotare et mandare litteris prosecuti sumus, illum imitati, qui apud Crotoniates, facturus simulacrum Deae, pluribus a virginibus praestantioribus insignes elegantesque omnes formae pulchritudines delegit, suumque in opus transtulit. Sic nos plurima quae apud peritos pulcherrima haberentur corpora, delegimus et a quibusque suas desumpsimus dimensiones, quas, postea cum alteras alteris comparassemus, spretis extremorum excessibus, si qua excederent consensus comprobasset.
Alberti, Leon Battista, De statua, (trad: 2001)(trad: "La Statue" par Bätschmann, Oskar, et Arbib, Dan en 2001)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Nous nous sommes donc mis à relever et coucher par écrit non pas seulement la beauté de ce corps-ci ou de ce corps-là, mais, autant que possible, la plus extraordinaire, donnée en partage par la nature à plusieurs corps comme selon des proportions déterminées; imitant celui qui, chez les Crotoniates, sur le point de faire une image de déesse, choisit toutes les beautés de forme insignes et élégantes à partir de plusieurs vierges remarquables et les transféra en son ouvrage. Quant à nous, de la même manière, nous avons choisi plusieurs corps tenus pour très beaux chez les experts, nous en avons pris les dimensions que nous avons ensuite comparées les unes avec les autres, et, en rejetant les extrêmes, dans un sens ou dans l’autre, nous en avons tiré les moyennes, qua l’accord de plusieurs exempèdes[Explication : mensurations.] a validées.
Gaurico, Pomponio, De sculptura(publi: 1504), « De animatione » (numéro ch. V) , p. 205 (latin)
Nos quoque hortamur, admonefacimusque identidem omnes quei Corinthii, non thuscanici esse cupiunt, ubi corporis circumscriptionem fecerint, remque ad gestus symmetriamque perduxerint, naturam ipsam diligenter inspiciant, habeantque et elegantissima et pulcherrima corpora, nam, quod Zeusis Crotoniatas docuit, perfectam in uno corpore pulcritatem (sic) haud facile inuenias, Si nudos inquam fecerint, nuda, et quos uoluerint gestus aptissime imitantia, unde singulorum membrorum iunctuarum, neruorum, uenarum, rugarumque paritionem ad suum opus deducere possint.
Gaurico, Pomponio, De sculptura, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Nous aussi, nous exhortons et nous invitons également tous ceux qui désirent être des Corinthiens et non des Toscans à regarder avec attention la nature même, en considérant des corps élégants et très beaux, lorsqu’ils tracent le contour d’un corps et animent l’œuvre par l’attitude et l’harmonie. Car, ainsi que l’a enseigné Zeuxis aux Crotoniates, on ne trouvera pas facilement la beauté parfaite en un seul corps. S’ils font des nus, dis-je, il leur faut imiter très correctement les corps et les gestes, pour pouvoir traduire dans leurs œuvres l’aspect des articulations de chaque membre, des tendons, des veines, des rides.
Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XX), fol. CCXIIIIr (latin)
Diligentia alioquin tanta, vt picturus Venerem Agrigentinis quam in templo Iunonis Laciniae locarent, virgines eorum voluit nudas inspicere, vt quod in quaque laudatissimum esset redderet.
Pico della Mirandola, Giovanfrancesco ; Bembo, Pietro, Le epistole « De imitatione » di Giovanfrancesco Pico della Mirandola e di Pietro Bembo(redac: 1512:1513), lettre du 19 septembre 1512 à Pietro Bembo, p. 27-28 (latin)
Antiqui enim illi praeclarissimi viri nunquam aliquorum imitationi studebant ita, ut in eroum verba, membra, circuitus iurarent, quasi semper infantes, quasi alitibus postponendi, quibus a parentibus extra nidum eductis satis est si ter vel quater volanteis illos aspexerint. Carpebant ex unoquoque quantum satis esse videbatur ad phrasim vel constituendam, vel ornandam : quae tamen essent vel propriae cognata naturae, vel accommoda materiae quae tractaretur ; sic et Celsus et Columella clari, nitidi, pressi et elegantes : in altero tamen egregia mundicies, in altero flosculi fortasse crebriores ; imitationem in illis nihilominus vel nullam, vel certe parvam es deprehensurus : genium propensionemque naturae eorum quisque sequebatur […] Itaque cum nostro in animo Idea quaedam et tanquam radix insit aliqua, cuius vi ad quodpiam muneris obeundum animamur, et tanquam ducimur manu, atque ab aliis quibusdam abducimur : colere illam potiusquam incidere, amplecti quam abalienare operae precium est ; nihil enim nostrae consulens felicitati, aut a virtute alienum, aut noxium nobis impertiit ipsa natura. Ideam igitur ut aliarum virtutum, ita et recte loquendi subministrat, eiusque pulchritudinis affingit animo simulachrum : ad quod respicientes identidem et aliena iudicemus et nostra. Nequem enim eam quisquam adhuc perfecte attigit, ut hac in re illud etiam possit dicere, nihil omni ex parte beatum ; quandoquidem non uni tantum, sed omnibus et universis distribuit praeclara sua munera : ut ex ipsa varietate totius universi pulchritudo constituatur. An putas frustra prudentem illum pictorem censuisse omnia se uno in foemineo corpore reperire non posse ad venustatem ? et incassum putas prudentissimum oratorem eius industriam secutum, longe etiam illum praeterisse iudicio ? qui ut imaginem illam pulcherrimi eloquentiae corporis effingeret, omneis delegit viros facundia praestantes : cum ille quinque solum Crotoniatas selegisset virgines pulchritudine celebratas : nec satis illis fidens, formam ipsam seu speciem absolutam imitari itaque eam debemus, quam animo scilicet gerimus dicendi perfectam facultatem : qua et aliorum et nostra cum errata in obeundo loquendi munere, tum virtutes etiam metiamur : sive ea ipsa penitus innata sit idea, atque ab ipsa origine perfecta, sive tempore procedente multorum autorum lectione consumata.
Pico della Mirandola, Giovanfrancesco ; Bembo, Pietro, Le epistole « De imitatione » di Giovanfrancesco Pico della Mirandola e di Pietro Bembo(redac: 1512:1513), réponse non datée à la lettre de Bembo du 1er janvier 1513, p. 67-68 (latin)
Ergo sequi debemus proprium animi instinctum, et inditam innatamque propensionem : deinde variis aliorum virtutibus unum quiddam quasi corpus coagmentare ; sic pictor ille celebratus, populum se dixit habuisse magistrum ; sic ille alius quinque non unam virgines adhibuit ad simulacrum in Crotonis phano pingendum : quoniam uno in corpore non poterant, quae excellentem pulchritudinem omnino praesentarent, reperiri.
Castiglione, Baldassare, Il libro del Cortegiano(publi: 1528, redac: 1513-1524) (I, 53), 110 (italien)
Non avete voi letto che quelle cinque fanciulle da Crotone, le quali tra l’altre di quel populo elesse Zeusi pittore per far de tutte cinque una sola figura eccellentissima di bellezza, furono celebrate da molti poeti, come quelle che per belle erano state approvate da colui, che perfettissimo giudicio di bellezza aver dovea ?
Castiglione, Baldassar; Raphaël (Rafaello Sanzio, dit), Lettre à Léon X(redac: 1514)(italien)
Le dico, che per dipingere una bella, mi bisogneria veder più belle, con questa condizione : che Vostra Signoria si trovasse meco a far scelta del meglio. Ma essendo carestia de buoni giudici e di belle donne, io mi servo di una certa idea che mi viene nella mente.
Ariosto, Ludovico, Orlando furioso(publi: 1516) (XI, 71)(italien)
E se fosse costei stata a Crotone
Quando Zeusi l’immagine far volse,
Che por dovea nel tempio di Giunone,
E tante belle nude insieme accolse;
E che per farne una in perfezione,
Da chi una parte, e da chi un’altra tolse,
Non avea da torr’ altra che costei,
Che tutte le bellezze erano in lei.
Ariosto, Ludovico, Orlando furioso, (trad: 1544), fol. 48 (trad: "Roland Furieux, composé premièrement en ryme thuscane par messire Loys Arioste, noble Ferraroys, et maintenant traduict en prose Françoyse" par Martin, Jehan en 1544)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ie diray en somme, que des la teste iusques aux piedz toute beaulté se voit en elle aultant, que peult estre. Et si doubte assavoir si Venus veuë du pasteur Phrigien (encores qu’elle vainquit ces troys Déesses) en eust emporté le pris de beaulté ; ne Paris (possible) s’en fust allé aux contrées Amyclées a violer le sainct logis : mais bien eust dict : Demeure Helayne avec ton Menelays, car ie ne veulx autre, que ceste cy. Et si ceste eust esté à Crotone, quand Zeusis voulut faire l’imaige, qu’il debvoit mettre au temple de Iuno, ou tant de belles femmes nues assembla, et ou pour en faire une en perfection, print de l’une une partie, de l’altre une aultre, il n’en eust certes choysi d’aultre, que ceste cy, puisque toutes les beaultez estoient en elle.
Ariosto, Ludovico, Orlando furioso, (trad: 1544), fol. 48 (trad: "Roland Furieux, composé premièrement en ryme thuscane par messire Loys Arioste, noble Ferraroys, et maintenant traduict en prose Françoyse" par Martin, Jehan en 1544)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ie diray en somme, que des la teste iusques aux piedz toute beaulté se voit en elle aultant, que peult estre. Et si doubte assavoir si Venus veuë du pasteur Phrigien (encores qu’elle vainquit ces troys Déesses) en eust emporté le pris de beaulté ; ne Paris (possible) s’en fust allé aux contrées Amyclées a violer le sainct logis : mais bien eust dict : Demeure Helayne avec ton Menelays, car ie ne veulx autre, que ceste cy. Et si ceste eust esté à Crotone, quand Zeusis voulut faire l’imaige, qu’il debvoit mettre au temple de Iuno, ou tant de belles femmes nues assembla, et ou pour en faire une en perfection, print de l’une une partie, de l’altre une aultre, il n’en eust certes choysi d’aultre, que ceste cy, puisque toutes les beaultez estoient en elle.
Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), p. 353-354 (latin)
Tanta fuit diligentia, vt Agrigentinis facturus tabulam (quam in templo Iunonis Laciniæ dicarent) virgines eorum nudas inspexerit, et quinque elegerit, vt quod in quaque laudatissimum esset, pictura redderet.
Trissino, Giovanni Giorgio, I Ritratti(publi: 1524), (non pag.) (italien)
Cosi ancor io queste opere elette da la natura a le’mie parole daro; le quali imparando da Zeuxi, con più convenevole giuntura, che saperanno, faranno uno ritratto, il quale le parti excellenti di ciascuna di queste haverà.
Equicola, Mario, Libro di natura d’amore(publi: 1525, trad: 1584), fol. 74 (italien)
Veramente quanto ella[Explication : la bellezza.] sia difficile a ritrovarse in un sol corpo, Zeusi pittore il conobbe. Di costui sino al tempo di M. Tulio se vedeano molte tavole dipinte. Per la eccellenzia ai Crotoniati piacque che pingesse loro alcuna cosa, e la imagine di Elena. Disseli che volea vedere alcune lor virginelle; Crotoniati, per conoscerlo eccellente pittore di donne, volontieri li consentirno, e monstrateli (ché così consultaro) le più belle scelse; per dimostrar la singular grazia in una non ritrovarse, tolse da ciascuna la più egregia parte, ché beltà compitamente non se vede in una sola. Così finì la sua leggiadra opera e tante bellezze vive in una figura accolse. Licino di varie statue di eccellentissimi artefici e pitture formò una bellezza di tutte parti, di correspondenti membra e convenienti colori. Sapea Zeusi la natura non aver perfettamente espolita da ogni banda una cosa semplice per aver a ciascuno da dare; l’altro vedea quanto era difficile esprimere in parole una vera bellezza e quanta fatiga è imitare la natura scrivendo.
Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus Ciceronianus sive De optimo dicendi genere(publi: 1528), p. 48-50 (latin)
BULEPHORUS — Age, quid igitur sentis de Zeuside Heraclotea ?
NOSOPONUS — Quid aliud, quam quod excellentissimo graphices artefice dignum est ?
BULEPHORUS — Num et ingenio iudicioque ualuisse putas ?
NOSOPONUS — Qui potuit ars tanta carere iudicio ?
BULEPHORUS — Commode respondes. Quid igitur illi ueniebat in mentem, quod, cum Crotoniatis picturus Helenae simulacrum, in quo decreuerat quicquid artis suae uiribus posset explicare et absolutum formae muliebris (nam in hoc argumento ceteris antecelluisse legitur) exemplar uiuae simillimum aedere, in quo nulla uenustatis portio desiderari ualeret ; non unam quampiam omnium pulcherrimam adhibuit, sed ex omnibus oblatis aliquot ceteris praestantiores elegerit, ut ex singulis decerperet quod in quaque decentissimum esset, itaque demum admirandum illud artis suae monumentum absoluerit ?
NOSOPONUS — Diligentissimi pictoris officio functus est.
BULEPHORUS — Vide igitur num recto consilio ducamur, qui eloquentiae simulacrum ab uno Cicerone, quamuis praestantissimo, petendum arbitramur.
NOSOPONUS — Si tali forma uirginem Zeusis esset nactus, qualis est in eloquentia M. Tullius, fortassis unius corporis exemplo fuisset contentus.
BULEPHORUS — Atqui hoc ipsum quo pacto iudicare potuisset, nisi multis corporibus diligenter inspectis ?
NOSOPONUS — Finge persuasum fuisse.
BULEPHORUS — In hac igitur es sententia, nullam in aliis oratoribus esse uirtutem imitatu dignam, quae non eximia sit in M. Tullio ?
NOSOPONUS — Ita censeo.
BULEPHORUS — Nec ullum in hoc esse neuum, qui non maior sit in caeteris ?
NOSOPONUS — Ita prorsus.
Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus Ciceronianus sive De optimo dicendi genere, (latin)(traduction récente d'un autre auteur)
BULEPHORUS — Continuons. Que penses-tu de Zeuxis d’Héraclée ?
NOSOPONUS — Qu’en penser, qui soit digne du plus excellent artiste peintre ?
NOSOPONUS — Crois-tu qu’il a été grand à la fois par son génie et par son jugement ?
BULEPHORUS — Comment un art aussi grand aurait-il pu manquer de jugement ?
BULEPHORUS — Tu réponds bien. Qu’avait-il donc en tête, quand, devant faire le portrait d’Hélène pour les citoyens de Crotone, décidé à y déployer toute la puissance de son art et à faire de cette figure féminine (et en la matière, on dit qu’il surpassa les autres) un exemplaire parfaitement ressemblant à une femme vivante, où ne manquât aucune partie de la beauté, il ne se servit pas d’une quelconque jeune fille plus belle que les autres, mais parmi toutes celles qu’on lui présenta, il en choisit quelques-unes, plus belles que les autres, pour choisir en chacune ce qu’elle avait de plus gracieux ; et accomplit accomplit ce merveilleux chef-d’œuvre de son art ?
NOSOPONUS — Il s’acquitta très scrupuleusement de son devoir de peintre.
BULEPHORUS — Vois donc si nous sommes guidés par un bon critère, quand nous estimons devoir rechercher le portrait de l’éloquence dans le seul Cicéron, si excellent soit-il.
NOSOPONUS — Si Zeuxis avait rencontré une jeune fille douée d’une telle beauté que l’éloquence de Cicéron, il se serait peut-être contenté d’un seul corps féminin pour modèle.
BULEPHORUS — Mais comment aurait-il pu juger ce corps, sinon en en examinant attentivement plusieurs ?
BULEPHORUS — Fais comme si que je n’en étais pas convaincu.
NOSOPONUS — Tu es donc d’avis qu’il n’y a chez les autres orateurs aucune qualité digne d’imitation, qui ne se trouve au suprême degré chez Marcus Tullius ?
BULEPHORUS — C’est mon avis.
NOSOPONUS — Et que chez lui on ne trouve aucun défaut qui ne soit plus grand chez tous les autres ?
BULEPHORUS — J’en suis persuadé.
Commentaires : Érasme, Dialogus ciceronianus, 1528, éd. 1995 Trad. E. Hénin.
Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus Ciceronianus sive De optimo dicendi genere(publi: 1528), p. 64 (latin)
BULEPHORUS — […] Et ne de singulis commemorem, nonne sumeres a singulis, in quo caeteris antestarent ?
HYPOL. — Quis non eligeret potiora, nisi qui uel non diiudicaret, uel sibi inuideret ?
BULEPHORUS — Itaque mihi probatur Zeusidis exemplum, quod secutus etiam Quintilianus imitatori praecipit, nec unum esse legendum, nec omnes, nec quoslibet, sed ex praecipuis deligendos aliquot eximios, inter quos Ciceroni primas tribuit, non solitudinem. Summum enim esse uult inter proceres, non solitarium exclusis ceteris.
Érasme (Desiderius Erasmus), Dialogus cui titulus Ciceronianus sive De optimo dicendi genere, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
BULEPHORUS — Et pour ne pas passer en revue tous les auteurs, ne pourrait-on pas emprunter à chacun les qualités qu’il possède mieux que les autres ?
HYPOL. — Et qui ne choisirait le meilleur, à moins d’être privé de discernement ou jaloux de soi-même ?
BULEPHORUS — C’est pourquoi j’approuve l’exemple de Zeuxis, que suit également Quintilien quand il conseille à l’imitateur de lire non pas un seul auteur, ni tous indistinctement, ni n’importe lesquels, mais parmi les principaux auteurs, d’en choisir quelques excellents, parmi lesquels Cicéron occupe une place primordiale, mais non solitaire. Il veut en effet que Cicéron soit le plus grand parmi les grands, et non l’unique à l’exclusion des autres.
Commentaires : Érasme, Dialogus ciceronianus, 1528, éd. 1995, p. 48-50 Trad. E. Hénin.
Camillo Delminio, Giulio, Trattato dell’imitazione(redac: (1530)), t. I, p. 176 (italien)
Adunque, colui che imita un perfetto, imita la perfezzion di mille raunata in uno, e tanto meglio quanto in quell’uno essa perfezzione appar continuata, non in una sola parte della composizion composta, sì come in alcun di que’ primi autori veder si potea. Debbiamo ancor pensar che, non imitando noi alcun perfetto, ma noi medesimi, in noi medesimi non possa esser se non quel poco di bello che la natura e’l caso può dar a uno. Debbiamo ancora pensar che non imitando noi alcun perfetto ma noi medesimi, in noi medesimi non possa esser s non quel poco di bello che la natura e’l caso può dar ad uno. Et in questa buona opinion ci dee confermar la nobilissima arte del disegno, sotto la qual cade la pittura e la scoltura; imperò che nissuna di queste giunse alla sua sommità perché alcun pittore o scultore del solo suo ingegno si contentasse o perché, volendo lasciar alcuna opera perfetta, esso pigliasse la similitudine solamente di alcuna particolar persona: perché i cieli non diedero mai ad alcuno individuo tutte le perfezioni. Anzi il giudicio di Zeusi fu di più vergini coglier le parti più belle; e quelle accompagnò alla bellezza che egli si aveva formato nella mente, perfettissima disegnatrice di quei secreti a’ quali né la natura né l’arte può pervenire. Né dal giudicio di Zeusi debbiamo noi divenir presontuosi nel levar da molti le parti più belle, sì come fece Cicerone o alcuno altro perfetto. Perché questa fatica in tutte le generazioni dello stilo, esso di avercela adombrata promette che Zeusi non fece se non in quella che una bellissima giovane rappresentar potea.
Camillo Delminio, Giulio, L’idea della eloquenza(redac: (1530):(1535)), p. 115-116 (italien)
Sia nel cospetto di Zeusi Elena non in carne, che consummata dal tempo tutto dì si andrebbe alterando, ma Elena ne la più fiorita età, formata da alcun perito scoltore in un bel lavorato marmore. Ed esso Zeusi sia giovine, e viva 60 anni, e negli anni giovinetti abbia ne la mente tutta quell’arte compresa che potesse esser concetta pertinente a la detta statua di Elena, ed esso non volesse in tutta la sua vita far altro che col pennello ritrar in pittura l’Elena marmorea tante volte quante potesse. Dico ch’esso sempre avrebbe quella medesima Elena ne la mente, ma d’anno in anno andrebbe più sempre migliorando ne lo exprimerla in pittura, perché la mano d’anno in anno diventerebbe più exercitata. Posta adunque la perfetta colocazion ne la mente, il miglioramente (sic) non sarebbe da la parte de la idea, ma da la parte dell’artifice. Ma noi, che non abbiamo avuto né da giovinetti né da attempati documento certo e chiaro per il qual abbiamo possuto concepir questa idea, ci convien d’anno in anno perfino a la vecchiezza andarla concependo per gradi e rappresentarla or in un modo, or in un altro, perciocché non l’abbiamo ricevuta ad un tempo tutta. E molti sono come alcuni o fanciulli o rozzi, che senza saper le forme de le lettere menano la penna tinta per la carta e fanno alcuni strani caratteri, perché la mano non è governata da la mente. Di qui si può comprender quanta utilità io sia per dar a chi mi ascolta, se ne la loro mente collocherò tale idea quale possa bastarci a le composizioni. Ma entriamo in un più bel dubbio: quando Zeusi dipinse Elena tenendo avanti a sé lo exempio di cinque bellissime vergini, credette voi che prima ch’egli vedesse le vergini avesse ne la mente la bellissima forma di Elena, o dopoi che vide le vergini se la formasse nella mente ? Se direte ch’egli l’avesse prima perfettamente, adunque egli non avea ne la mente alcuna perfetta idea di donna giovane, perché ben sapete ch’egli non vide mai Elena. Adunque le nostre menti non possono concepir cosa perfetta? Adunque gli individui sono più perfetti che gli universali, volendo socorso dagli individui? So ben, eloquenti padri, risponderete che Zeusi essendo excellentissimo di necessità tenea ne la mente la idea perfettissima d’una giovine, o fosse quella che portò dal cielo, o quella che apprese dai maestri o da’ libri, né per dar perfezion a questa de la mente volse lo exempio degli individui, ma solo perché gl’individui gli dessero strada da tirar quella de la mente al senso amico degli individui. Adunque volendo condur al senso quella idea ch’egli avea ne la mente, prese le vergini sensibili, acciocché quelle li mostrassero la via di far sensibile quella idea ch’egli avea dentro insensibile. Il perché hanno in costume gli excellenti pittori, quando vogliono far per grazia di exempio un cavallo, prima di dissegnarlo tale qual lo intendono dentro, e poi vogliono veder il vivo per pigliar quasi una viva via di farlo tale qual il senso lo suol vedere ; ed i nobili eloquenti far così dovrebbono : prima comporre ed informar la materia ad imitazion di quella idea che dentro hanno, poi pareggiarla a la particolare di alcun perfetto auttore, ed anco farla sentir a li giudiciosi per potersi consigliare se la sua arte è amica de la natura e paia naturalmente fatta. Né mi rimarrò di dire che in due modi avrebbe possuto aver Zeusi l’imagine di Helena (sic) nella mente: in un modo se egli avesse veduto Elena viva, e questa imagine sarebbe d’un particolare, ne l’altro modo formandosi una perfettissima ida ne la mente, al indirizzo de la quale egli avesse possuto dissegnar col pennello mille bellissime giovani, e questa sarebbe stata, si come fu in Zeusi, idea universale. E la detta idea d’un particolare potrebbe per aventura esser stata tale ne la mente d’un rustico, d’un rozzo, e lontano dall’arte della pittura, tale ancora in uno specchio ed in una fonte, se Elena le si fusse opposta, quale avrebbe possuto rilucer ne la mente di Zeusi, ma con questa differentia, che quella che fusse stata ne la mente di Zeusi, per cognizion de la pittura egli avrebbe ancor conosciuto le parti perfette ed imperfette di lei di dentro, ma quella che fusse stata ne la mente di Zeusi, non altrimenti non le avrebbe possuto aggiunger la cognizion de le cose perfette ed imperfette, che si farebbe uno specchio ed una fonte priva non pur di cognizion, ma di senso. È ancor un’altra differentia, che la mano di Zeusi exercitata ed accompagnata con la detta cognizion l’avrebbe possuto rappresentar di fuori ne la pittura quale egli dentro la vedea, il che la mano de l’ignorante far non potrebbe per non aver né abito, né società con la cognizione. La mente adunque d’uno ignorante perché ha natura di rappresentar le imagini, tali le rappresenta dentro a gli occhi de la mente quali fanno li specchi e le fonti a gli occhi corporali, per la loro propria natura e perché sono materie lucide ed accommodate a rappresentar imagini, per le quali cose si può comprender che quantunque ancor ne le menti di tre dissegnatori rilucesse la medesima idea d’un particolare, e che ciascuno di loro avesse e cognizion de l’arte e mano exercitata, nondimeno ciascun ne la cognizion de la sua arte per volerla rappresentar fuori, avrebbe alcune cose che avrebbero riguardo a l’imagine, ed alcune a la loro particolar arte.
Nifo, Agostino, Libri duo. De pulchro primus. De amore secundus(publi: 1531), « Quod simpliciter pulchrum sit in rerum natura, ex illustr. Ioannæ pulchritudine hic probatur », (numéro cap. V) , 3 (latin)
Quod autem omni ex parte, ac simpliciter in rerum ipsa natura pulchrum sit, argumento nobis est illustrissima Ioanna, quæ tum animo, tum corpore omni ex parte pulchra est. Animo quidem, est enim ea Heroines morum praestantia, ac suauitas (quæ animi ipsa est quidem pulchritudo) ut non humano, sed diuino semine nata esse censeatur. Corpore uero, quandoquidem forma, quæ corporis est pulchritudo, est tanta, ut nec Zeusis cum Helenæ speciem effingere decreuisset, apud Crotoniatas tot puellarum partes, ut unam Helenae effigiem describeret, perquisiuisset, sola illius inspecta ac peruestigata excellentia.
Dolet, Étienne, Erasmus sive Ciceronianus, Dialogus de Imitatione ciceroniana adversus Desiderium Erasmum(publi: 1535), p. 115-117 (latin)
Nunc ad Zeusidis exemplum : quod Quintilianus imitandum proponit. Ille cum Helenæ pingere simulacrum uellet, muliebris formæ pulchritudine excellens, ut non putauit, omnia, quæ quæreret ad uenustatem, uno in corpore se reperire posse, quare plures uirgines pulchritudine spectabili unum in locum conduxit, ut certius et elegantius lineas duceret : eo quidem modo, si elegantem aliquam uelimus eloquentiæ speciem effingere, non unum aliquem auctorem nobis proponamus, cuius omnes partes, quocunque sint in genere, exprimendas nobis necessario arbitremur. Tuam sententiam non antea sequar, quam hoc dissolueris. Si post exactum illud, et ad tot elegantes formas effictum Zeusidis opus, aliud quisquam muliebre simulacrum pingere uoluisset, an collectum Zeusidis iudicium ex tot uirginum pulchritudine, in lineis ducendis et imitandis sequi tuto non potuisset ? an de integro conducendæ fuissent forma æque præstanti uirgines ? an non facile, qua quiduis parte in corpore muliebri pulchrum et uenustum sit, in Zeusidis exemplo non perplexisset ? an omnia diligenter a Zeuside obseruata et comprehensa, non etiam obseruasset ? Ita in Cicerone, qui ex Græcis oratoribus quicquid ad ornate dicendum pertinet, sedulo et accurate collegit, an omnia artis oratoriæ lineamenta contemplari, obseruare, notare, deligere, et quasi manu tractare comprehendereque difficile sit, aut operosum ? Vilius est et abiectius Zeusidis exemplum, qui unam tantum mulieris formam expressit. Amplior Cicero ad imitationem et copiosior, qui nullum dicendi genus, nullam causæ speciem omnium sit, qua ingeniose et pene diuine non sit usus. Quamobrem non eum solum legendum, sed solum in dicendo imitandum monebo, solum ad uim eloquentiæ exprimendam, et pueris et natu grandioribus proponam, id modo meminerint, uarietati studendum, sicque tegendam et artis et uerborum imitationem, ut nequaquam appareat, sed nobis occulto uiam eleganter scribendi, et sapienter dicendi ostendat. Nempe non ferendus sit Zeusidis imitator, qui Pirrham picturus, eos in senilem uultum colores immittat, qui ad iuuenilem Helenæ faciem sint appositi, tantum uideat, ne quid tortum, ne quid mancum, ne quis mutilum efferat, ne quid a communi membrorum compositione et ordine discrepans, ne quid ridiculum faciat, nec sic Zeusidem imitetur, ut in uitium imitatio dilabatur, non imitantem iuuet. Linearum ductus in Helenæ simulachro sic obseruet, ut in Pirrha pingenda non eos sine mutatione referat, sed ita ad rem suam componat, ut nihil deforme sit, et minus decens. Ciceronem itidem qui sequatur, diligenter caueat, ne, quæ Cicero suo loco amplificabat, præpostere extenuet, aut pressius explicet : quæ deprimit, ne attollat, et latius in similibus diuagetur, ac uim suæ eloquentiæ fundat : denique id semel sit monitus, ne quid inepte, ne quid insulte, ne quid absurde, aut scribat, aut dicat, omnia summo iudicio exequatur.
Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 13-14 (italien)
Dipinse al populo d’Agrigen(t)o una Helena, che fu dedicata nel tempio di Junone Lacin(i)a. Et avantj che niente facessi, tutte le lore verginj nude volse vedere et di quelle tutte cinque ne elesse, che di tutte piu belle giudicò, et da quelle tutte le excellentj partj ritrasse et nella sua pittura raccolse.
Firenzuola, Agnolo, Dialogo delle bellezze delle donne(publi: 1548, redac: 1541), p. 537 (italien)
Di poi, per ché la mente piglia meglio per via dell’esempio la essenza della cosa che si discorre […], in una donna sola si raccolgono tutte le parti che si richiedono ad una perfetta e consumata bellezza.
Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548), p. 334 (portugais)
E querendo pintar ao povo agrigentino uma tavoa de Venus, pedio que lhe mostrasse mas moças d’aquella terra todas nuas, para fazer aquella obra; e assi lhe foram mostradas; de todas as quaes, cinco escolheu para poder na pintura exprimir aquellas partes que em cada uma fossem mais excellentes e proporcionadas.
Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga, p. 178 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Ce même Zeuxis, voulant peindre pour le peuple d’Agrigente la figure de Vénus, demanda, pour faire cette oeuvre, qu’on lui montrât toutes nues les jeunes filles de ce pays. On les lui montra, en effet, et il en choisit cinq pour pouvoir reproduire en sa peinture les parties les plus parfaites et les mieux proportionnées que chacun d’elles avait en son corps.
Commentaires : Trad. Quatre dialogues sur la peinture, 1911, p. 178
Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 98-99 (italien)
FABRIANO — Veramente tutte le fatture naturali patiscono opposizioni. Il che causa l’impotenzia della materia, nella qual essa natura imprime l’opere sue. E per non incorrere nell’imperfezione, imitate Zeusi che, volendo appresso li Crotoniati dipignere una Venere, elesse tra tutte le giovanette della città cinque vergini, la beltà delle quali soppliva all’integrità della sua Venere, raccogliendo da una di quelle gli occhi, dall’altra la bocca e dall’altra il petto, et in tal guisa reduceva a perfezione l’opera sua. LAURO — Vi faccio fede che, s’io fossi stato Zeusi, arrei prima usato con la natura, poscia con l’arte.
Grifoli, Jacopo, Q. Horatii Flaccii liber de arte poetica interpretatione(publi: 1550), p. 98-99 (italien)
FABRIANO — Veramente tutte le fatture naturali patiscono opposizioni. Il che causa l’impotenzia della materia, nella qual essa natura imprime l’opere sue. E per non incorrere nell’imperfezione, imitate Zeusi che, volendo appresso li Crotoniati dipignere una Venere, elesse tra tutte le giovanette della città cinque vergini, la beltà delle quali soppliva all’integrità della sua Venere, raccogliendo da una di quelle gli occhi, dall’altra la bocca e dall’altra il petto, et in tal guisa reduceva a perfezione l’opera sua. LAURO — Vi faccio fede che, s’io fossi stato Zeusi, arrei prima usato con la natura, poscia con l’arte.
Grifoli, Jacopo, Q. Horatii Flaccii liber de arte poetica interpretatione(publi: 1550), p. 96-98 (latin)
Dirigenda est igitur mentis acies ad illas formas, quæ sub oculos non cadunt, ut eas, ueluti in simulachris suis faciunt pictores, ueritatis imitatione, quantum licet exprimamus. Neque enim Phidias, ut scribit M. Tul. cum faceret Iouis formam, aut Mineruæ, contemplabatur aliquem, e quo similitudine duceret : sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quædam, quam intuens, in eamque defixus ad illius similitudinem artem et manum dirigebat. Ad formas igitur, et ideas platonicas respiciendum est, ut facere Arist. docet, ubi ait in Poeticis.
Vasari, Giorgio, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri(publi: 1550), "Vita di Andrea Mantegna", t. III, p. 390 (italien)
Ma con tutto ciò ebbe sempre opinione Andrea, che le buone statue antiche fussino più perfette e avessino più belle parti, che non mostra il naturale ; attesochè quegli eccellenti maestri, secondo che e’ giudicava e gli pareva vedere in quelle statue, avevano da molte persone vive cavato tutta la perfezione della natura, la quale di rado in un corpo solo accozza ed accompagna insieme tutta la bellezza ; onde è necessario pigliarne da uno una parte e da un altro un’altra.
Ringhieri, Innocenzio, Cento giuochi liberali, et d'ingegno nuovamente ritrovati, libro IX(publi: 1551), “giuoco della pittura” (numéro libro IX) , f. 146r (italien)
Come Zeusi di molte particolari bellezze, quinci, e quindi sparse, potesse una perfetta e sola formarne, che le naturali eccedesse.
Ringhieri, Innocenzio, Cento giuochi liberali, et d'ingegno nuovamente ritrovati, libro IX, « Le jeu de la peinture » (numéro livre IX) , p. 169 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Comment Zeuse peut de plusieurs parties recueillies former une image qui excedât en beauté toutes les naturelles.
Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551), "De Dedalo" (numéro liber VII, cap. XVI) , p. 419 (latin)
Et opus Helenam vocatum, quod e quinque præstantissimis virginibus delectis Crotoniatarum confecit, obseruatis partibus, quæ visæ sunt præstantiores in singulis.
Ringhieri, Innocenzio, Cento giuochi liberali, et d'ingegno nuovamente ritrovati, libro IX(publi: 1551), “Giuoco della Bellezza”, fol. 97v. (italien)
[...] mi muovo a considerare che la bellezza altro non sia, che un certo oscuro raggio della suprema bellezza, che invisibilmente, e con occulti odori, quasi elettro le pagli a se tiri chiunque a reverirvi, et ad amarvi si pone; e che sia vero, se per tutti i belli sparsi nella natura discorriamo vedersasi, che quello che nell’universo è per cagione di questo superno lume perfettissimo, in questa, e quell’altra cosa singolare, e semplice, qualche poco d’imperfettione favere con la natural bellezza congiunta, cosa che communemente si concede, affermando ciascuno che poche donne o rade sono, in cui l’avvedimento, l’invidia, o il giudicio altrui dove emendarle non truovi, e alle più belle sempre qualche cosa manca, per la quale sono per aventura talhora meno che non sarebbono comendate; il che Zeusi volendo dipingere Elena a i Crotoniati assai bene dimostrò, quando di molte vergini le più belle scielte, delle più venuste loro parti, una sola imagine rarissima fece, assai bene, e tacitamente inferendo, che in un corpo solo per essere inteta a cose molte mai la natura ogni dote, et ogni bellezza non chiudea, e da ogni banda non abbelliva, e pur come già gli antichi si fece, si fa ne i nostri tempi ancora, di molte famose donne.
Ringhieri, Innocenzio, Cento giuochi liberali, et d'ingegno nuovamente ritrovati, libro IX, (trad: 1555), « Le jeu de beauté », p. 129-130 (trad: "Cinquante jeus divers d’honnête entretien, industrieusement inventés par messer Innocent Ringhieri" par Villiers, Hubert-Philippe de en 1555)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ce qui m’incite a considerer votre beauté n’être autre chose qu’un certain rayon de cette celeste et suprême, lequel invisiblement et avec ocultes odeurs tire a soy (comme l’ambre la paille) tous les mortels a vous reverer, pour se ranger sous le joug de votre amytié qui les rend vouluntairement captivés. Et qu’ainsi ne soyt, si nous voulons discourir par tout l’ample pourpris de la seconde Nature, nous trouverons ce qui est tres-parfait en l’univers a l’ocasion de cette supernelle lumiére en cette et celle autre chose singuliére et parfaite, avoyr encore je ne say-quoy d’imperfection conjoint avec la beauté naturelle. Chose qui est comunement concedée par un chaqu’un, qui aferme se trouver peu de femmes, sus lesquelles l’egard l’envie, ou le jugement d’autruy ne trouve a redire : et que les plus excellentes en beauté singuliére n’ayent encore quelque defaut en elles, qui cause par-aventure qu’elles viennent a raporter moindre loüenge de leur perfection qu’elles ne feroyent, et en demeurent, peut être, moins recommandées. Ce que Zeusis demontra assés bien voulant depeindre un tableau de Héléne aus Crotoniens, quand d’entre plusieurs pucelles les plus exquises en beauté eleües, forma une image tres-rare des plus elegantes et singuliéres rarités de leurs plus belles parties : voulant par cela taisiblement inferer, que la Nature pour être ententive a une infinité de choses, ne doüoyt jamais un seul cors et ne l’embellisoyt de tous cotés d’une beauté entiérement parfaite. Et toute-foys le bruit est grand et resonne de toutes pars (comme il couroyt aux siecles passés) de la divine beauté de plusieurs grans Dames, fameuses, et renommées.
Condivi, Ascanio, Vita di Michelagnolo Buonarroti(publi: 1553) (§ LIV)(italien)
Io più volte ho sentito Michelagnolo ragionare e discorrere sopra l’Amore : e udito poi da quelli, che si trovaron presenti, lui non altrimenti dell’Amor parlare, di quel che appresso di Platone scritto si legge. Io per me non so quel che Platone sopra ciò si dica : so bene che avendolo io così lungamente ed intrinsecamente praticato, non senti mai uscir di quella bocca se non parole onestissime, e che avevan forza d’estinguere nella gioventù ogn’incomposto e sfrenato desiderio, che in lei potesse cadere. E che in lui non nascesser laidi pensieri, si può a questo anco cognoscere ch’egli non solamente ha amata la bellezza umana, ma universalmente ogni cosa bella, un bel cavallo, un bel cane, un bel paese, una bella pianta, una bella montagna, una bella selva, ed ogni sito, e cosa bella e rara nel suo genere, ammirandole con maraviglioso affetto ; così il bello dalla natura scegliendo, come l’api raccolgono il mel da’fiori, servendosene poi nelle loro opere : il che sempre han fatto tutti quelli, che nella pittura hanno avuto qualche grido. Quell’antico maestro, per fare una Venere, non si contentò di vedere una sola vergine ; anziché ne volle contemplar molte : e prendendo da ciascuna la più bella e più compita parte, servirsene nella sua Venere. Ed in vero chi si pensa senza questa via (colla quale si può acquistar quella vera teorica) pervenire in quest’arte a qualche grido, di gran lunga s’inganna.
Capriano, Giovan Pietro, Della vera poetica(publi: 1555), p. 317 (italien)
Che egli[Explication : Virgilio.] poi si abbia raccolto un autunno dalle piante d’altrui, e da’ prati stranieri una ghirlanda di allegrissimi et apprezzatissimi fiori, essendosi servito in molte pari delle istesse parti di Omero, non so io qual giudicio perverso sia di costoro diputando a biasimo quello che è cagione di laude chiarissima. Perché, adunque, Zeusi da cinque vergini preclare compose insieme la soperbissima figura di Crotone, si devrà falsamente inferire che ella non fusse di perfetta forma e così inferiore o non superiori di bellezza a qualunque di quelle, e conseguentemente lui di minor laude o ver non di maggiore di un altro che ritratta per arte avesse e per compiuta una di loro o altra simigliante da se stesso? Ma che diranno questi quando lor si mostrasse che le quasi più onorate spoglie riportate da Virgilio nel triunfo sono da altri captivi che da Omero? Come la ruina di Troia, il tradimento et il modo tenuto da Pisandro, e tutto l’amor dolente e tragico nel qual se stessa Elisa traffigendo vendetta di colui ch’aveva vivo nel petto, da scritti argonautici d’Appollonio: questo è stato quasi un superare Omero e tutti i Greci con le lor proprie arme, avendole adoprate sì ben accommodate e rivoltate a fin opposito alla loro intenzione.
Le Caron, Louis, Dialogues(publi: 1556), « Claire ou de la beauté » (numéro Dialogue V) , p. 314 (fran)
Et ne faut penser que les exquises et rares singularitez de la beauté soient toutes entierement enfermées en une seule femme tant soit elle excellente. Ce que Zeuzis sagement monstra voulant dépeindre le tableau d’Helène aux Crotoniens, quand d’entre plusieurs pucelles choisies à l’eslite il forma une tres-accomplie et admirable image des plus elegantes et singulières excellences de leurs plus belles parties.
Dolce, Lodovico, Dialogo di pittura intitolato l’Aretino, nel quale si raggiona della dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie che a perfetto pittore si acconvengono(publi: 1557), p. 172 (italien)
Deve adunque il pittore procacciar non solo d’imitar, ma di superar la natura. Dico superar la natura in una parte ; ché nel resto è miracoloso, non pur se vi arriva, ma quando vi si avicina. Questo è in dimostrar col mezzo dell’arte in un corpo solo tutta quella perfezzion di bellezza che la natura non suol dimostrare a pena in mille; perché non si trova un corpo umano così perfettamente bello, che non gli manchi alcuna parte. Onde abbiamo lo esempio di Zeusi, che, avendo a dipingere Elena nel tempio de’ Crotoniati, elesse di vedere ignude cinque fanciulle e, togliendo quelle parti di bello dall’una, che mancavano all’altra, ridusse la sua Elena a tanta perfezzione, che ancora ne resta viva la fama. Il che può anco servire per ammonizione alla temerità di coloro che fanno tutte le lor cose di pratica. Ma se vogliono i pittori senza fatica trovare un perfetto esempio di bella donna, leggano quelle stanze dell’Ariosto, nelle quali egli descrive mirabilmente quanto i buoni poeti siano ancora essi pittori[Note contexte].
Della Casa, Giovanni, Il Galateo ovvero De costumi(publi: 1558) (ch. XXVI), p. 42-43 (italien)
Ma tu dèi oltre a ciò sapere che gli uomini sono molto vaghi della bellezza e della misura e della convenevolezza, e, per lo contrario, delle sozze cose e contrafatte e difformi sono schifi: e questo è spetial nostro privilegio, ché gli altri animali non sanno conoscere che sia né bellezza né misura alcuna; e perciò, come cose non comuni con le bestie, ma proprie nostre, debbiam noi apprezzarle per sé medesime et averle care assai, e coloro viepiù che maggior sentimento hanno d’uomo, sì come quelli che più acconci sono a conoscerle. E come che malagevolmente isprimere appunto si possa che cosa bellezza sia, non di meno, acciò che tu pure abbi qualche contrasegno dell’esser di lei, voglio che sappi che, dove ha convenevole misura fra le parti verso di sé e fra le parti e ’l tutto, quivi è la bellezza: e quella cosa veramente “bella” si può chiamare, in cui la detta misura si truova. E per quello che io altre volte ne intesi da un dotto e scientiato uomo, vuole essere la bellezza uno quanto si può il più e la bruttezza per lo contrario è molti, sì come tu vedi che sono i visi delle belle e delle leggiadre giovani, perciò che le fattezze di ciascuna di loro paion create pure per uno stesso viso; il che nelle brutte non adiviene, perciò che, avendo elle gli occhi per aventura molto grossi e rilevati, e ’l naso picciolo e le guance paffute, e la bocca piatta e ’l mento in fuori, e la pelle bruna, pare che quel viso non sia di una sola donna, ma sia composto d’i visi di molte e fatto di pezzi. E trovasene di quelle, i membri delle quali sono bellissimi a riguardare ciascuno per sé, ma tutti insieme sono spiacevoli e sozzi, non per altro, se non che sono fattezze di più belle donne e non di questa una, sì che pare che ella le abbia prese in prestanza da questa e da quell’altra: e per aventura che quel dipintore che ebbe ignude dinanzi a sé le fanciulle calabresi, niuna altra cosa fece che riconoscere in molte i membri che elle avevano quasi accattato chi uno e chi un altro da una sola; alla quale fatto restituire da ciascuna il suo, lei si pose a ritrarre, imaginando che tale e così unita dovesse essere la bellezza di Venere. Né voglio io che tu ti pensi che ciò avenga de’ visi e delle membra o de’ corpi solamente, anzi interviene e nel favellare e nell’operare né più né meno, ché, se tu vedessi una nobile donna et ornata posta a lavar suoi stovigli nel rignagnolo della via publica, come che per altro non ti calesse di lei, sì ti dispiacerebbe ella in ciò, che ella non si mostrerebbe pure “una”, ma “più”, perciò che lo esser suo sarebbe di monda e di nobile donna e l’operare sarebbe di vile e di lorda femina; né perciò ti verrebbe di lei né odore né sapore aspero, né suono né colore alcuno spiacevole, né altramente farebbe noia al tuo appetito, ma dispiacerebbeti per sé quello sconcio e sconvenevol modo e diviso atto.
Della Casa, Giovanni, Il Galateo ovvero de'costumi, (trad: 1666), « De la beauté », 158-161 (trad: " Le Galatée, ou l’art de plaire dans la conversation " par Hamel, Jean Baptiste du en 1666)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Quoy qu’il soit bien difficile de dire ce que c’est que la beauté, neantmoins pour vous en donner connoissance, il faut que vous sçachiez que la beauté est une proportion des parties entre elles, et de chaque partie avec le tout. Ainsi les choses où cette proportion se rencontre peuvent estre appellées belles. I’ay quelquefois ouy dire à un scavant homme, que la beauté approche autant qu’elle peut de l’unité, et que la laideur s’en éloigne. Si vous regardez le visage d’une belle fille, vous verrez qu’il n’a de la beauté que parce que toutes ses parties, et tous ses traits semblent n’avoir esté faits que pour un seul visage. Il n’en est pas de mesme de la laideur. Une personne laide aura peut-estre deux gros yeux qui luy sortiront hors de la teste, un nez extrémement petit, deux grosses joües, une bouche platte, le mention avancé, et le tein brun. Enfin on diroit que ce sont les parties de plusieurs visages, ou que c’est un composé de pieces rapportées. Il se trouve mesme des femmes qui ont chaque partie regardée à part, fort belle : mais l’union de toutes ces parties fait un composé laid et desacreable : la veritable raison de cette laideur, est qu’il semble que toutes ces parties ont esté faites pour plusieurs personnes, et non pas pour une seule, et l’on diroit qu’elle les auroit empruntées aux unes, et aux autres. Peut-estre que ce peintre qui pour representer une belle Venus, voulut voir les filles de Calabre toutes nuës, ne faisoit autre chose que de reconnoistre en toutes ces filles les diverses parties, qui avoient plus de proportion entr’elles, et qui sembloient comme avoir esté empruntées d’un mesme corps, et les ayant assemblées dans son portrait, il s’imagina que la beauté de Venus pour estre parfaite devoit ainsi estre une.
Ne vous figurez pas que cette unité soit seulement necessaire dans le visage, dans les membres, et dans le corps. Il faut mesme qu’elle se trouve dans les actions, et dans la conversation. Par exemple si vous voyez une Dame bien parée laver du linge à une fontaine publique, quoy que d’ailleurs elle vous fust indifferente, neantmoins elle vous deplairoit en tant qu’elle s’éloigneroit de l’unité, car elle auroit la façon d’une femme noble, et feroit les actions d’une servante. Et quoy qu’elle ne vous eust rien fait sentir, rien goûter de desagreable, que sa voix ni sa couleur ne choquassent ni vos oreilles, ni vos yeux, et enfin qu’elle n’eust rien qui peust vous rebuter, ne vous déplairoit elle pas, seulement à cause que ces actions n’ont aucun rapport avec ses ajustemens et avec sa condition?
Minturno, Antonio Sebastiano, De poeta(publi: 1559), p. 261 (latin)
Quemadmodum in Aenea pietatis exemplum, impietatis in Mezentio Virgilius effinxit. Itaque illos ad imitandum sibi proponet, qui ea in re, quam expressurus est, cæteris omnibus anteiuverit. Quod sane quidem facere pictores compertum est, cum pulcherrimos homines, ut effigiem uerisimillimam reddant, imitantur. Zeuxis enim speciosissimam tabellam picturus cum esset, Helenam effingendam suscepit. Nec tamen depinxit, antequam uirgines forma insignes, a quibus exemplum pulchritudinis peteret, inspexisset.
Partenio, Bernardino, Dell’imitatione poetica. Libro primo(publi: 1560), p. 529-530 (italien)
Chi può immaginarsi che un Apelle, un Protogene, o qualsivoglia dei pittori antichi o de’nostri acquetati solamente nelle loro menti, senza aversi fissati nelle imagini d’altri nobilissimi artefici ? Sovengaci di Zeusi, il quale nel fare della sua Venere, conoscendo manifestamente che non gli bastava la forma che nell’animo riteneva di bellezza, si rivoltò alla contemplazione di molte leggiadrissime vergini, prudentemente concludendo seco che più felicemente l’opra succedere gli potesse pigliando dall’altrui perfezione e di quella aggiungendo per adornare la sua, che se nella sua sola acquetato si fosse. E se concediamo che le forme, nell’animo ricevute dalla natura, comeché buone siano, hanno bisogno di questa cura, che diremo qual volta men buona e perfetta è la idea ?
Commentaires : éd. 1560, p. 13-14
Vignole (Jacopo Barozzi da Vignola, dit), Regoli delli cinque ordini d’architectura, Rome (publi: 1562), fol. 3 (italien)
A talche non come Zeusi delle Vergini fra Crotoniati, ma come ha portato il mio giudicio ho fatta questa scelta de tutti gli ordini cavandogli puramente da gli antichi tutti insieme, ne vi mescolando cosa di mio se non la distributione delle proportioni fondata in numeri semplici senza havere a fare con braccia, ne piedi, ne palmi di qual si voglia luogo, ma solo ad un misura arbitraria detta modulo divisa in quelle parti che ad ordine per ordine al suo luogo si potrà vedere, e data tal facilità a questa parte d’architettura altrimente difficile ch’ogni mediocre ingegno, purché habbi alquanto di gusto dell’arte, potrà in un’occhiata sola senza gran fastidio di leggere comprendrere il tutto, et opportunamente servirsene.
Lomazzo, Gian Paolo, Il Libro dei Sogni(redac: (1563)), Leonardo Vinci e Fidia, entrambi pittori e scultori (numéro Raggionamento quinto) , p. 88 (italien)
Zeusi eracleote, discepolo di Nesea iasio, col favor di quelli acquistò tante richezze che instituì il donare l’opere sue, dicendo non si poterle vendere per prezzo alcuno che alla dignità loro degno fusse. E tanto la pittura agli Agrigentini piacque, come agli altri populi grandi faceva, che da esso Zeusi suportarono di lasciarsi vedere tutte le lor vergini, delle quali cinque ne elesse, per pingere una tavola che nel tempio di Junone Lacinia esser doveva.
Gilio, Giovanni Andrea, Degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie(publi: 1564), p. 106-107 (italien)
Al tempio di Giunone Lacinia la famosa Venere di Zeusi, ritratta da la cinque vergini crotoniate, come dice Cicerone, Plinio et altri scrittori: e questa non fu statua, ma figura.
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), p. 186 (italien)
Fu con tutto ciò accurato molto, tanto che dovendo fare a nome de’ Crotoniati una bella figura di femmina, dov’e’ pareva che egli molto valesse, la quale si deveva consacrare al tempio di Giunone che egli aveva adornato di molte altre nobili dipinture, chiese di avere comodità di vedere alcune delle loro più belle e meglio formate donzelle (ché in quel tempo si teneva che Crotone, terra di Calavria, avesse la più bella gioventù dell’uno e dell’altro sesso che al mondo si trovasse), di che egli fu tantosto compiaciuto; delle quali egli elesse cinque le più belle, i nomi delle quali non furono poi taciuti da’ poeti come di tutte le altre bellissime, essendo state giudicate cotali da chi ne poteva e sapeva meglio di tutti gli altri uomini giudicare; e delle più belle membra di ciascuna ne formò una figura bellissima, la quale Elena volle che fosse, togliendo da ciascuna quello che in lei giudicò perfettissimo.
Vasari, Giorgio, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti(publi: 1568), t. IV, p. 8 (italien)
La maniera venne poi la più bella dall’avere messo in uso il frequente ritrarre le cose più belle, e da quel più bello o mani o teste o gambe aggiungerle insieme, e fare una figura di tutte quelle bellezze che più si poteva, e metterla in uso in ogni opera per tutte le figure; che per questo si dice esser bella maniera.
Castelvetro, Lodovico, La poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta(publi: 1570) (III, 16), t. I, p. 444-446 (italien)
Ἐπεὶ δὲ μίμησις ἐστιν ἡ τραγῳδία βελτιόνων, ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσθαι τοὺς ἀγαθοὺς εἰκονογράφους. Cominciò Aristotele di sopra a parlare della secunda parte della qualità della tragedia, la quale contiene i costumi ; e avendo detto che quattro cose v’erano da considerare, e come ancora vi si doveva considerare la necessità o la verisimilitudine, passò a raggionare delle soluzioni delle difficultà, e, presa cagione, ha detta alcuna cosa delle cose non ragionevoli. Ora torna a favellare de’ costumi, insegnandoci che per figurargli bene dobbiamo seguitare l’usanza de’ buoni dipintori d’imagini, avendo una idea de’ costumi perfetta nella quale riguardiamo quando vogliamo costumare le persone, si come essi hanno uno esempio di perfetta bellezza nel quale riguardano quando vogliono effigiare una persona bella. E è da por mente che questo insegnamento non è congiunto con le cose dette di sopra, ma posto in questo luogo a caso, siccome molte altre cose sono poste in molti altri luoghi di questo libretto. Adunque a provare che noi dobbiamo fare uno esempio perfetto de’ costumi, usa questa dimostrazione. Così come i dipintori che figurano i belli gli figurano bene perché s’ hanno prima fatto uno esempio perfetto di bellezza nel quale tuttavia riguardono, così il poeta della tragedia, la quale è rassomigliatrice de’ migliori, dee avere uno esempio de’ costumi perfetti, a cui nel costumare le persone miri continuamente. Prima, io dubito che lo insegnamento donatoci da Aristotele non sia vano, o non sia per giovarci molto, se egli non ci ’nsegna ancora quale debba essere e come lo dobbiamo formare. E se si dirà che egli, ragionando de’ costumi adietro, ci ha assai insegnato quale sia e come debba essere fatto, perché adunque di nuovo ci torna a dire quello che già ha detto ? o perché non ci rimette a quello che ha detto ? Ma non è vero che egli voglia che le cose insegnateci de’ costumi possano constituire questo esempio perfetto, avendoci insegnato che dobbiamo riguardare ne’ costumi mezzani, e non ne’ perfetti, in guisa che seguita che egli infino a qui ci abbia insegnato male, o che qui non ci ’nsegni bene. Ma pogniamo che la dottrina insegnataci adietro de’ costumi si confacesse con quella che ci è insegnata qui, e che ci facesse bisogno de’ costumi ottimi, non ci basterà miga uno esempio perfetto d’ottimi costumi, come basta uno esempio di perfetta bellezza, pogniamo d’una donna, al dipintore per figurare le figure donnesche belle ; percioché i costumi, ancora perfetti in qualunque grado, sono più varii che non è la bellezza della donna, la quale è ristretta dentro da’ termini di liniamenti, di misure e di colori temperati. E poteva Perino del Vago, pittore fiorentino di chiarissima fama a’ nostri dì, con la bellezza di sua moglie, la quale s’aveva constituita nella mente per esempio della soprana bellezza, figurare molte figure di donne, e spezialmente quella della Vergine, riconoscendosi in tutte una maniera sola di soprana bellezza. Ma Giotto, dipintore pur fiorentino molto commendato ne’ tempi passati, non poté, né volle con una maniera sola di maraviglioso spavento figurare tutti gli apostoli nel portico della chiesa di san Pietro a Roma, quando, facendo fortuna, apparve loro il Signore caminante sopra l’acqua, ma a ciascuno particolarmente assegnò una maniera di maraviglioso spavento seperata, né sa giudicare chi gli riguarda quale sia più da lodare. E della varietà de’ costumi, e non atta ad essere compresa sotto uno esempio perfetto solo, si vede l’esperienza nel sacrificio d’Ifigenia sacrificata in Aulide dipinto da Timante, tanto commendato da Plinio, da Quintiliano e da altri.
Τοὺς ἀγαθοὺς εἰκονογράφους. Pare che dovesse essere scritto più tosto ἀγαθῶν che ἀγαθούς, accioché la bontà de’ dipinti rispondesse alla bontà de’ rappresentati, sì come si dice altrove : Πολύγνωτος μὲν γὰρ κείττους εἴκαζεν etc. E è da por mente ché altra è la bontà rappresentata dal dipintore e altra è la bontà rappresentata dal poeta, secondo che fu detto di sopra ; percioché il dipintore rappresenta la bontà del corpo, cioè la bellezza, e ’l poeta rappresenta la bontà dell’animo, cioè i buoni costumi. Appresso è da porre mente, come è detto di sopra, che la perfezzione della pittura non consiste più in fare uno perfettamente bello che in fare uno perfettamente brutto o mezzano, ma consiste in fare che paia simile al vivo e al naturale e al rappresentato, o bello o brutto o mezzano che sì sia, ancora che il dipintore debba sapere quali termini di misure e di proporzioni e quali colori si richieggano a fare un bello.
Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν οἰκείαν μορφήν etc. Io non credo che i buoni dipintori che rappresentano le persone abbiano questo esempio in casa o in mente, di che parla qui Aristotele, nel quale riguardino quando effigiano alcuno uomo certo e conosciuto o alcuno incerto e sconosciuto, percioché gli effigierebbono tutti simili ; e questo sarebbe vizio e non virtù, sì come a Perino del Vago era attribuito a vizio che facesse le figure delle donne simili a sua moglie. Né mi pare che si legga d’alcuno simile pittore alcuna cosa. Egli è ben vero che, perché con più agio si può coglier dalle statue e dalle dipinture l’esempio e la similitudine che non si può dalle persone vive, si sogliono a coloro che vogliono imparare a dipingere proporre inanzi pitture o statue da rassomigliare, percioché esse ci si presentano inanzi agli occhi in uno stato, e le possiamo contemplare quanto ci piace senza molestia loro, e in qual parte più ci piace ; altramente non veggo che giovi l’esempio domestico.
Ὁμοίους ποιοῦντες. Intendi οἰκείῃ μορφῇ. Adunque i dipintori, facendo l’imagini simili all’esempio che hanno in casa, le fanno più belle che non farebbono senza esempio, o se rappresentano le persone belle conosciute, le fanno più belle ; ma questo è vizio, conciòsia cosa che virtù dell’arte sia non fare più bello, ma fare simile ; o dipingono i più belli con molta agevolezza ; e intendi i più belli, cioè la schiera de’ più belli, in rispetto de’ mezzani e de’ brutti.
Commentaires : éd 1570, fol. 188v-190
Castelvetro, Lodovico, La poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta(publi: 1570) (V, 5), t. II, p. 328-330 (italien)
Τοιούτους δ’εἶναι οἵους Ζεῦξις ἔγραφεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ βέλτιον. Vuole Aristotele mostrare, con l’essempio di Zeussi dipintore, che è lecito al poeta il dire cose impossibili, purche sieno migliori che non sono le cose possibili ; come impossibile è per natura una donna che abbia in se tutte le bellezze raccolte quali ebbe la figura d’Elena dipinta da Zeussi ad instantia de’ Crotoniati, li quali la posono per ornamento nel tempio di Giunone. Laonde, sì come scrive Cicerone, esso Zeussi « non putavit omnia quæ quæreret ad venustatem uno in corpore se require posse, ideo quod nihil simplici in genere omni ex parte perfectum natura expolivit. Itaque tanquam ceteris non sit habitura quid largiatur, si uni cuncta concesserit aliud alii commodi, aliquo adiuncto incommodo, muneratur. » Et nondimeno quella pittura, perché era quale doveva essere, cioè bellissima, e per conseguente migliore del possibile, è commendata assai, e non punto biasimata per essere impossibile, cioè rassomigliativa di cosa impossibile. Adunque colui che opponesse a Zeussi direbbe : ἀδύνατόν ἐστι, « impossibile è per natura che tali sieno le persone quali di perfetta bellezza dipingeva Zeussi » ; et colui che lo salvasse risponderebbe, secondo Aristotele, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ βέλτιον, « egli è vero che per natura non è possibile che sieno tali, ma Zeussi le dee dipingere tali perché meglio sarebbe se fossero tali, sì come il poeta farà bene se rassomiglierà le cose come steano meglio, ancora che sia impossibile che si truovino tali. »
Τό γὰρ παράδειγμα δεῖ ὑπερέχειν. Alcuni vogliono che questa sia la ragione perché i poeti e i dipintori rassomiglino le cose come deono essere, e le facciano più eccellenti che in verità non sono o non possono essere ; cioè che essi le rassomiglino tali per che sieno essempio, nel quale gli huomini riguardando e proponendoselo nella mente debbano, operando secondo quello, dirizzare le loro azioni, o riguardandolo possano riconoscere quale sia la soprana bellezza. Ora, quantunque non neghiamo che queste parole, τό γὰρ παράδειγμα δεῖ ὑπερέχειν, possano ricevere questo senso e dire ciò, nondimeno perché Aristotele di sopra parlò dell’essempio che i dipintori delle persone belle hanno appo loro, in casa o nella mente, della soprana bellezza, nel quale riguardando quando effigiano alcuna persona bella, e la fanno simile, et appresso consigliava i buoni poeti tragici o di mansuetudine o d’altro costume nel quale tenessono la mente fissa quando assegnassono i costumi alle persone, noi crediamo che Aristotele in questo luogo parli di questi così fatti essempi, e che dica che non è una maraviglia se Zeussi figurava le persone più belle che non sono o non possono essere naturalmente, poiché non riguardava alle persone naturali né le rassomigliava quali erano, ma guardava nell’essempio della perfetta bellezza che egli aveva in casa o nella mente, il quale dee passare la communale bellezza degli uomini, altramente non sarebbe necessario, potendosi rassomigliare gli uomini quali erano. E credo che veramente questa sia la ’ntentione d’Aristotele in queste parole, avegna che appaia per l’historia raccontata da Cicerone nel prolago del secondo libro della ’Nventione retorica che Zeussi non avesse essempio di soprana bellezza niuno nella mente o in casa prima che egli dipingesse la figura d’Elena ad instantia de’ Crotoniati, conciosia cosa che, se egli l’avesse avuto, non avrebbe domandato che si fossero fatte vedere le donzelle della città, ne di loro avrebbe elette le cinque più formose per prendere quello fiore di bellezza che fosse più eccellente in ciascuna, e riponerlo tutto nell’effigie d’Elena. Ora, se sia verisimile che i poeti e i dipintori abbiano simile esempio in casa e nella mente, e torni bene ciò a quelli a poetare, e a questi a dipingere, o se sia verisimile che essi facciano l’opere loro perché le loro opere sieno essempio agli altri per operare virtuosamente, o per riconoscere la perfetta bellezza, altro qui non dico, avendone detto a sufficienza di sopra.
Commentaires : éd. 1570, fol. 367-369
Lily, John, Euphues and His England(publi: 1580), p.211 (anglais)
Touching the beautie of this Prince, hir countenaunce, hir personage, hir majestie, I can-not thinke that it may be sufficiently commended, when it can-not be too much mervailed at: so that I am constrained to saye as Praxitiles did, when hee beganne to paynt Venus and hir sonne, who doubted, whether the worlde could affoorde coulours good enough for two such fayre faces, and I whether our tongue canne yeelde wordes to blase that beautie, the perfection where-of none canne imagine, which seeing it is so, I must doe like those that want a cleere sight, who being not able to disceme the sunne in the skie are inforced to beholde it in the water. Zeuxis having before him fiftie faire virgins of Sparta where by to draw one amiable Venus, said, that fiftie more fayrer then those coulde not minister sufficent beautie to shewe the Godesse of beautie, therefore being in dispaire either by art to shadow hir, or by imagination to comprehend hir, he drew in a table a faire temple, the gates open, and Venus going in, so as nothing coulde be perceiued but hir backe, wherein he used such cunning, that Appelles himselfe seeing this worke, wished yet Venus would tume hir face, saying yet if it were in all partes agreeable to the backe, he woulde become apprentice to Zeuxis and slave to Venus. In the like manner fareth it with me, for having all the ladyes in Italy more then fiftie hundered, whereby to coulour Elizabeth, I must say with Zeuxis, that as many more will not suffise, and therefore in as great an agonie paint hir court with hir back towards you, for yet I cannot by art portraie hir beautie, wherein though I want the skill to doe it as Zeuxis did, yet vewing it narrowly, and comparing it wisely, you all will say yet if hir face be aunswerable to hir backe, you wil like my handi-crafte, and become hir handmaides. In the meane season I leave you gasing untill she turne hir face, imagining hir to be such a one as nature framed, to yet an end that no art should imitate, wherein shee hath proved hir selfe to bee exquisite, and painters to be apes.
Bocchi, Francesco, Eccellenza del San Giorgio di Donatello(publi: 1584), p. 180 (italien)
Oltre a ciò, ne’ corpi umani si dice aver luogo la bellezza, quando ciascuna delle parti, alle altre comparata, per iscambievole rispetto misuratamente risponde e si congiugne; onde si compose insieme un tutto, che in parte nessuna verso di sé è sconcio o difforme, ma convenevole e simile a sé stesso. Questa tale bellezza non è meno rara ne’ corpi umani, che quella altra, di che abbiamo detto che è negli artifizii; perocché o la difficultà che hanno tutte le parti che ottimamente si deono unire, o la natura troppo scarsa in donare una perfezzione cotanto grande, operano, come io avviso, che così di rado ella in alcuna cosa umana e mortale sia veduta. E di questo siaci per segno chiaro quello che fece Zeusi, antico pittore e gentile, in dipignere Elena a’ popoli di Crotone. Questa, perché dovea essere di bellezza mirabile e rara, non giudicò il buono artefice non solamente, imaginando, non poterla trovare, ma né anco da un corpo solo, comecché bello, poterla co’ suoi colori degnamente effigiare. Perloché dal magistrato della terra egli ottenne che davanti le più belle vergini gli fossero condotte; dalle quali, che molte erano, egli cinque elesse, e da quelle prese le migliori parti e le più lodevoli, et in dipignendo ne formò col suo artifizio quella naturale bellezza, di che noi al presente ragioniamo. Ella adunque, che è tanto rara, che con difficultà in un corpo solo per ispazio di molti secoli si è trovata, consiste, oltre alle cose dette, in grandezza, in ordine et in numero.
Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della forma di Giunone, dea dell’aria, e delle sue ninfe » (numéro Libro settimo, cap. XIV) , p. 507 (italien)
Ma chi volesse cercare esattamente tutte le sue forme non ne trovarebbe facilmente il fine, massime se cercar volesse quelle che fecero Dionisio e Policleto di marmo, e quelle che furono nel tempio di Giunone Lacinia, appresso gli Agrigentini, nel quale fu anco quella tavola di Zeusi ch’egli dipinse togliendo le più belle parti di cinque vergini, scelte fra tutte le più belle Agrigentine, di quella di rame fatta da Beda, cosí eccellente che i Romani la posero nel tempio della Concordia.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 269-270 (italien)
Questi dovendo fare una figura a’ Crotoniati per mettere nel tempio di Giunone, volle vedere ignude le più belle fanciulle della città, delle quali ne scelse cinque le meglio formate, e togliendo da ciascuna le più belle parti, ne venne a formare la sua bellissima imagine.
Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), « Commentarius de pictura » (numéro IV) , p. 3 (latin)
Symmetria altera graphices pars est, quae summam venustatem operi conciliat. De hac non semper conuenit inter artifices. Quippe cum natura in symmetria corporum non sibi semper constet, quaerendum fuit, quaenam ex o[mn]ibus maxime probanda esset. Neque enim cuiusque iudicio standum fuit. Vulgus enim quod rectum est probat, sed non desiderat exquisitam illam pulchritudinem, cuius vnius amore flagrat peritus artifex. Itaque vel si nusquam reperiatur, eam sibi nihilominus ob oculos proponit, & eius speciem amat. Tum eius pulchritudinis partes inuicem componit, vt solent virgines hinc inde lectis floribus coronam nectere. Sic olim Zeuxim Agrigentinis facturus tabulam virgines earum nudas inspexit, & ex eis quinque elegit vt quod in singulis laudatissimum esset pictura redderet. Hanc pulchritudinem Lysippi iudicio nemo unquam satis accurate expressit. Aliquando enim interrogatur quem sequeretur antecedentium, dixisse fertur demonstrata hominum multitudine, ipsam naturam imitendam esse, non artificem. Nec tamen naturam in vno laudauit, sed speciem quandam pulchritudinis, quae ex vniuersa multitudine colligi posset. Quocirca dicere solebat, ab aliis homines factos quales essent, a se quales viderentur.
Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), p. 16-17 (latin)
Quocirca fluctuans adhuc cum pulchritudinis speciem nondum animo contemplatus esset, facturus Agrigentinis tabulam, quam in templo Iunonis publice dedicarent, virginibus eorum nudis inspectis, ex ijs quinque elegit, vt quod in quaque laudatissimum esset pictura redderet.
Garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo(publi: 1585), « De’ pittori, e miniatori, et lavoratori di mosaico » (numéro Discorso XCI) , p. 290 (italien)
E fu tanto diligente in essa[Explication : arte.], che dovendo formar l’imagine di Giunone Lacinia, per gli Agrigentini, hebbe gratia di veder le lor giovani nude delle quali cinque n’elesse più belle, per far la figura della Dea compita, e perfetta in ogni parte.
Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Della schiochezza di coloro che sogliono affaticarsi prima che abbino presa maniera buona intorno a studiar le statue, il natural et i modelli; delle molto vere et utili considerazioni, che a ciò fare bisogna et a che fine le s’imitano, e come si riducono e si aiutano da i ritraenti; con quali espedite vie si fa l’uomo in quelle facile e giudizioso » (numéro II, 3) , p. 108-109 (italien)
Ma quanto al modo poi di ritrarre il naturale, ancorche questo deve essere imitato per ogni parte, ed in ogni cosa, io però mi rido di coloro, che approvano ogni naturale per buono, quasi che la natura non erri intorno alle bellezze sue facendole più, e meno si come io dissi altrove, che a fatica se ne trovano ai tempi nostri, e certo è che molti vi si fondano sù talmente, che essi non curano più una cosa, che un’altra, e così schifano il porger loro aiuto con la lor maniera in modo alcuno. Laonde io dirò che se Geusi, il quale tante belle nude accolse per formarne solo una a i Crotoniati, avesse avuto a formar un uomo, io stimo che di molti piú uomini bisogno v’era, che delle donne non ebbe, perciò che altro magistero di muscoli, di nervi e di vene si scruopre in un uomo, che in una donna si vede, poiché il suo bello consiste, dopo le debite proporzioni, nello esser piene di delicate morbidezze. Fuggasi adunque così sciocca opinione, che si hanno imaginata nel capo molti e credasi che se Geusi, oltre la tanta diligenza ch’egli usò, non avesse posseduto da sé singolar maniera, non avrebbe mai accordate insieme le belle membra divise, ch’egli tolse da tante vergini né saria men stata a quella perfezzione, che di prima egli si era imaginato. Concludasi dunque che, oltre il cercar le miglior cose della natura e più perfette, si supplisca dipoi tuttavia con la maniera buona e con essa arrivar tanto oltre, quanto si può giudicar che basti, perché, accordata che sia quella col natural buono, si fa una composizione di eccellente bellezza.
Mazzoni, Jacopo, Della difesa della Comedia di Dante(publi: 1587, 1688, redac: 1587:1598), « Discorso intorno a concetti di scultura, e di pittura, che si trovano in Dante » (numéro V, 16) , t. II, p. 374-375 (italien)
- [1] Lib. 34 Cap. 8
- [2] Lib. 35. Cap. 9
Finge Dante adunque, che il luogo, dove i Superbi vengono puniti vi havesse un pavimento tutto intagliato di figure di varia scultura.
Lassù non eran mossi i piè nostri anco ;
Quand’io conobbi quella ripa intorno,
Che dritto di salita haveva manco,
Esser di marmo candido, & adorno
D’intagli si, che non pur Policleto,
Ma la natura gl’havverebbe scorno.
Dove mostra Dante, che lo scultore non si propose niun’artefice per eccellente, che fosse da imitare, e da vincere, ma la natura istessa, il che fù levato da quel luogo di Plinio [1]. Lysippam Sicyonium Duris negat, Tullius fuisse discipulum affirmat, sed primo ærarium fabrum cudendi rationem cæpisse pictoris Eupompi responso ; eum enim interrogatum, quæ sequeretur antecedentium dixisse demonstrata hominum multitudine, naturam ipsam imitandam esse, non artificem. Cosi anchora Zeusi per dipingere perfettamente una bellissima Donna non volle imitare altro, che la natura, & imitandola, insieme la volle superare, poiche le perfettioni, ch’ella sparse in molti corpi, da lui furono in un solo raccolte, di che parlando medesimamente Plinio, cosi scrive [2] Depræhenditur tamen Zeuxis grandior in capitibus, articulisque : alioquin tantus diligentia, ut Agrigantinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset pictura redderet.
Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), p. 239 (italien)
Ma che dirò io dell’opere dell’eccellentissimo Zeusi, il quale, avendo fatto una figura d’Elena ignuda di soprema bellezza e per esser poco stimata, egli stesso la magnificò con versi composti dal suo felice ingegno? Egli non metteva fuori di sua mano che di quella non scoprisse con parole l’artificio e l’eccellenza che vi era dentro a tutte le genti, il che non è da imputarsi che lo facesse per gloria, ma perché fossero conosciute e perciò a gli uomini fossero gratissime.
Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Di quale virtù, vita e costumi deve essere ornato un pittore eccellente, con gli esempi cavati dalle vite de’ miglior pittori e più celebri che mai siano stati, così antichi come moderni » (numéro III, 15) , p. 235 (italien)
Egli[Explication : Zeuxis.], dovendo fare una imagine dipinta di bellezza estrema, da porsi nel tempio di Giunone dentro la città di Crotone, fece ch’ottennero nel concilio i Crotoniati che li fosse concesso liberamente di poter raccogliere e veder nude quante belle erano nella città loro; dove di quel numero ne scelse cinque a suo giudicio vergini, dalle quali tolse e rappresentò, nella sua imagine, quello ch’in ciascuna era eccellentissimo di donnesca bellezza, il che gli riuscí secondo ch’egli s’avea imaginato.
Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Della dignità e grandezza della pittura ; con quali ragioni e prove si dimostra esser nobilissima e di mirabile artificio ; per quali effetti cosí si tenga e di quali meriti e lode siano degni gli eccellenti pittori » (numéro I, 3) , p. 47 (italien)
Dicono parimente che la imagine, così tenuta cara, dipinta da Geusi a’ Crotoniati, era tanto al vivo prossimana, che nella mente de’più savii di quella città non era creduta altrimenti, se non quando essi la toccavano, che fosse figura di colori.
Paggi, Giovanni Battista, Lettere al fratello Girolamo(redac: 1591), p. 198 (italien)
Nobilissima è la pittura, arte che contraffà tutte le cose fatte dalla natura, con la quale ha molte volte combattuto e vinto, perché dove la natura non forma mai un corpo totalmente perfetto, elle, raccogliendo il bello ed il perfetto, di molti imperfetti ne compone uno perfetto in ogni sua parte in quella tanto celebrata Elena, nella quale dipinse le sparse bellezze che ritrovavansi nelle cinque vergini dal suo giudizio scelte entro il numero di tutte le belle della città ; col quale modo evidentemente vinse la natura. Soleva dire Raffaello di Urbino che il pittore ha obbligo non solo di fare le cose come le fa la natura, ma di farle com’ella le dovrebbe fare. Non sarà dunque vile e meccanica quell’arte che tanto altamente penetra, e che è tanto difficile, anzi impossibile a conseguire nel suo totale.
Tasso, Torquato, Discorsi del poema eroico(publi: 1594) (libro I), p. 62 (italien)
Dico adunque ch’in tutte le cose si dee riguardare all’ultimo, come dice Aristotele ne la Topica; ma l’ultimo è uno, ladonde non si può ritrovare unitamente in molti particolari; ma considerando le bontà nell’eccellenze che sono divise fra molti, si forma l’idea della bontà e dell’eccellenza, come formò Zeusi quelle della bellezza quando volle dipingere Elena in Crotone; e questa differenza è per aventura fra l’idee delle cose naturali che sono nella mente divina, e quella dell’artificiali, delle quali si figura e quasi dipinge l’intelletto umano: ché nell’una l’universale è innanzi le cose stesse, nell’altro dapoi le cose naturali. L’idea dunque delle cose artificiali è formata dopo la considerazione di molte opere fatte artificiosamente; nelle quali tuttavolta non è l’ottimo, ma quella è migliore che più l’avvicina. Dovendo dunque io mostrar l’idea dell’eccellentissimo poema eroico, non debbo preporre per esempio un poema solo, bench’egli fosse più bello de gli altri, ma, raccogliendo le bellezze e le perfezioni di ciascuno, insegnare come egli si possa fare bellissimo e perfettissimo insieme.
Lebey de Batilly, Denys, Regii mediomatricum praesidis Emblemata(publi: 1596), Ad Franciscum Perrotum Maesiereum, Paris. (numéro LIIII) (latin)
"EX OPTIMIS PRAESTANTIORES VITAE MAGISTROS IMITANDOS"
Iunonis, diva divinos dum effingere vultus
Vellet, et exactum reddere pictor opus.
Ex Agrigentinis selectas quinque puellas
Ante oculos fertur proposuisse sibi.
Quarum imitaretur formae, quos nosset, honores,
Vna in quaque magis quodque, nitere decus.
Hinc tu quos supraire alios probitate videbis,
Exemplar vitae sumere disce tuae.
AD EMBL. LIIII
Inter ea quæ Agrigenti erant, fuit et templum Iunoni Laciniæ sacrum, in quo tabula erat eximio divæ ipsius simulachro insignis, quam facturus Zeuxis, qui pulchriora omnia in pingendo exprimere soleret, tumque longe cæteris excellere pictoribus existimabatur, omnes Agrigentinorum virgines nudas inspexisse fertur, e quarum numero delectis quinque forma præstantissimis, reductisque in iudicium singulis singularum membris, quod in unaquaque laudatissimum erat, in effingenda Deæ imagine reddidit. Quam historiam alii de Helena tabula apud Crotoniatas referunt, qui publico de consilio ex virginibus suis formosissimas, quas idem Zeuxis sibi præberi volebat dum tabulam pingeret, ut mutum in simulachrum ex animali exemplo veritatem transferret, in unum locum conduxerunt, et pictori quas vellet eligendi potestatem dederunt. Ille autem quinque delegit, cum non putaret omnia quæ quæreret ad venustatem, uno in corpore se reperire posse, ideo quod nihil simplici in genere omnibus ex partibus perfectum natura expolivit: Itaque tanquam cæteris non sit habitura quod largiatur, si uni cuncta concesserit, aliud alii commodi aliquo adiuncto incommodo minuatur. Atque omnis vitæ ratio sic constat, ut quæ probamus in aliis facere ipsi velimus. Sic pictores opera primorum, rustici probatam experimento culturam in exemplum intuentur. Et hercle necesse est aut similes aut dissimiles bonis simus. Similem raro natura præstat, frequenter imitatio. Et præter id quod prudentis est, quod in quoque optimum est si possit suum facere, tum in tanta rei difficultate unum intuentis, vix aliqua pars sequitur. Ideo cum totum exprimere quem elegeris, pene sit homini inconcessum, plurium bona ponamus ante oculos, ut aliud ex alio hæreat, et quo quidque loco conveniat aptemus: melioribus nos offeramus (et par est melioris esse qui ex melioribus) quæ maxime excellant in eis quos imitabimur, quæ in singulis ad decus laudemque insignia erunt, quæ apud unumquemque ex multis videbuntur esse præstantissima ducentes in animum nostrum derivemus, prosequi conemur. Stultissimum sit ad imitandum non optima quæque proponere.
Commentaires : LIER GRAVURE
Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1597), p. 802 (fran)
Il fit aux Agrigentins un Hercule […] Plus un’Helene qu’il tira sur cinq des plus belles filles de Crotone, prenant de chascune ce qu’il trouvoit de singulier.
Meres, Francis, Palladis Tamia : Wits Treasury, Being the second part of wits Commonwealth(publi: 1598), "Painters", p. 287 (anglais)
[1] Zeuxis was so excellent in painting, that it was easier for anie man to view his pictures, then to imitate them, who to make an excellent table, had five Agrigentine virgins naked by him.
- [1] voir aussi: Zeuxis Athlète
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), « Van Zeuxis van Heraclea, Schilder », fol. 67r (n)
- [1] Zeuxis maeckte te groote hoofden
- [2] Hy sagh al de dochters der Stadt Agrigent naeckt. Verkoos uyt dese vijf, om een Beeldt naer te schilderen
Doch al was desen Zeuxis seer in zijn Const ervaren, soo worde hem nae gegheven, dit ghebreck te hebben gehadt, dat hy te groote hoofden maeckte, oock de vingers en de knockels te dick en te groot, dan was andersins gheheel vlijtich het leven nae te volghen [1]: soo dat doe hy voor den Agrigenten soude maken een tafel, die sy offeren wilden in eenen Tempel van Iuno, welcken stondt te Lacinium. nu Capo di colomni. in Calabrien, hy begeerde naeckt te sien alle de Dochters van hun Stadt Agrigentum. [2] het welck hem toegelaten was: onder al dese verkoos hyer alleen vijve, de schoonste van leden, om in zijn Beeldt van Iuno, oft ander Beelden, alle de schoonste deelen van dese vijve te passe te brenghen. Dese Dochters werden te love veel fraey ghedichten ghemaeckt.
Zuccaro, Federico, L’Idea de’ pittori, scultori ed architetti(publi: 1607), sonnet liminaire à Zuccari, non pag. (latin)
Arserat egregios Helenae depingere vultus,
Qui clarus viva Zeuxis in arte fuit:
Sed voluit pulchras Graecarum cernere formas
Hinc Helenae varium traxit ad ora decus.
Nescia fama tuum celebrat quia Zeusis honorem?
ZUCCARUS aeterno, dignus honore magis.
Mendicas Helenam Zeusis: tu ZUCCARE dives:
Solum Idea tuo pulchra fit ingenio.
Zuccaro, Federico, L’Idea de’ pittori, scultori ed architetti(publi: 1607) (II, 2), p. 9-10 (italien)
E perche quasi tutti gli individui naturali patiscono qualche imperfettione, e rarissimi sono i perfetti, massime il corpo humano, che spesso è manchevole in proportione, e dispositione di qualche membro, è necessario al pittore, et allo scultore acquistare la buona cognitione delle parti, e simmetria del corpo humano, e d’esso corpo scegliere le parti più belle, e le più gratiose per formare una figura di tutta eccellenza ad imitatione pure della natura nelle sue più belle e perfette opere. Così fece Zeusi nel formar alli Crotoniesi la lor Dea, facendo la scelta di sette più gratiose, e formose giovane, e di quelle scels le più belle parti, et unite insieme formò la sua bellissima Venere famosa insino a tempi nostri, che fù poi regola e norma della più bella, e più leggiadra e perfetta proportione, e beltà feminile che si trovasse. Così fecero anco altri eccellenti pittori, e scultori nel formar le statue de i lor dei in diverse proportioni, secondo la natura, e qualità loro: et il tutto pigliarono dalla natura, secondo ch’ella con le complessioni più e meno robuste, o più e meno molli, e delicate, dà spesso le proportioni delle membra del corpo accompagnando l’esterno all’interno. Onde vediamo, che i corpi humani sono varii di forme e di proportioni; altri magri, altri grassi, altri asciutti, altri pastosi, e teneri, altri di proportione di sette teste, altri di otto, altri di nove e mezza, altri di dieci, com’è l’Apollo del Belvedere a Roma.
Bacon, Francis, « Of Beauty »(publi: 1612), essai 43 (anglais)
- [1] beautiful persons have a beautiful autumn
In beauty, that of favor is more than that of color; and that of decent and gracious motion more than that of favor. That is the best part of beauty, which a picture cannot express; no nor the first sight of the life. There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion. A man cannot tell whether Apelles or Albert Durer were the more trifler; whereof the one would make a personage by geometrical proportions; the other, by taking the best parts out of divers faces, to make one excellent. Such personages, I think, would please nobody but the painter that made them. Not but I think a painter may make a better face than ever was; but he must do it by a kind of felicity (as a musician that maketh an excellent air in music, and not by rule). A man shall see faces, that if you examine them part by part, you shall find never a good; and yet altogether do well. If it be true that the principal part of beauty is in decent motion, certainly it is no marvel though persons in years seem many times more amiable; pulchrorum autumnus pulcher [1]; for no youth can be comely but by pardon, and considering the youth as to make up the comeliness. Beauty is as summer fruits, which are easy to corrupt, and cannot last; and for the most part it makes a dissolute youth, and an age a little out of countenance; but yet certainly again, if it light well, it maketh virtue shine, and vices blush.
Beni, Paolo, In Aristotelis poeticam commentarii(publi: 1613), p. 590 (latin)
Vt enim Zeuxis (inquit rursus, atque ita sentientiæ probationem hic quoque subiiciens, qualis sit sententia tota, indicat satis) pulchriores fingebat homines, sic poetæ interdum aliquos effingunt meliores. Denique vt Helenam sic pinxit Zeuxis vt ad miraculum fere excelleret, tantum abest vt quiquam talem ac tantam pulchritudine in vna puella spectasset unquam, sic in epopeia verbigratia poëta ducem vel heroëm aut consiliarium amicumue aut seruum maiore quam quisquam spectarit vnquam, ornat fortitudine (id quod in Pompeio fecit etiam Orator) prudentia, fidelitate, quod multo magis in poëta non dico excusandum sed laudandum est, qui tantam perfectionis ideam in variis vitæ generibus extollit mortalibus.
Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), « Statue, e pitture antiche e moderni » (numéro libro X, cap. XIX) , p. 386 (italien)
Questi fù colui, che chiamato da gli Agrigentini, o come hanno altri voluto da i Protoniati (sic), a fare il ritratto di Giunone, il copio dalle fattezze più belle di cinque vergini da loro elette fra un numero infinito, che ne vide d’ignude.
Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso quarto. En que se prueva, que el arte de la pintura tiene emulacion, y competencia con la gramatica, primera de las fierte artes liberales ; con la historia, con la filosofia, y materia del estado. Que partes aya de tener un pintor para poder llamarselo ; y la dificultad que tiene el conocimiento de la pintura. », fol. 12r-13r (espagnol)
Por ventura la pintura no se compone destos mismos preceptos ? El todo perfecto que ella pretende no le rastrea, y busca de varias ciencias ? de muchas artes ? e todas las historias ? No es esto lo que dixo Socrates, y referimos en el discurso primero : cumque non sit facile ad unum hominem omnia irreprehensibilia habentem, respiciendo imitari, a multis colligentes quidquid optimum quilibet habeat si facitis corpora venusta apparere. Pues es impossible (dize) hazer la pintura una figura perfecta, mirando solo el original de un hombre para que lo sea : veense muchos de los que se toma lo perfecto, y se dexa lo que no lo es tanto ; con que la pintura se haze milagrosa, dexando atras a la naturaleza (si es que se lla ma milagro todo lo que se haze fuera de su acostumbrado curso). Esto es lo que haze Luciano mordiendo siempre lo que le parecio no carecia de primores : en el Dialogo pues que intitula imagines, quiere obrar con la pluma una estatua que exceda a las perfecciones de Fidias, de Polistrato, y demas escultores insignes ; y tomando de cada estatua lo perfecto que en ella hizo su artifice : de una el cabello, de otra el rostro, y pechos, y de las demas a este modo, pinta con licencia poetica el objeto que desea, censurando las imperfecciones que nota en los artifices. Lo mismo haze en la pintura hurtando de Apeles, Eufranor, Homero, Polygnoto, y Ecion las perfecciones que obraron, con que haze el dibuxo mas perfecto que vio el arte, y la naturaleza. Su lugar latino no traslado por ser todo el Dialogo : baste el exemplo de Zeuxis, que refiere Plinio en el lib. 35. cap. 9. Avia de hazer la imagen de Iuno Licina para los de Agrigento, y porque saliesse perfecta le traxeron las mas hermosas donzellas de la provincia, a las quales vio desnudas, y de ellas escogio cinco las mas hermosas, y destos naturales hermosissimos copiò el mas bello retrato que admirò el pincel de la naturaleza : Alioquin tantus diligentia (dize Plinio de Zeuxis en el lugar citado) ut Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Lacciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quid in quaque laudatissimum esset, pictura redderet. Lo cierto es, ser parecidissimas la historia, y la pintura.
Colletet, Guillaume, Discours de l’éloquence et de l’imitation des Anciens(publi: 1626), p. 41 (fran)
- [1] Quelle sorte d’imitation il faut embrasser
[1]. Ce n’est donc pas cette severe & ridicule imitation que ie propose ; celle que ie desire n’a pas pour objet un seul autheur, mais bien tout ce que la Nature et l’Art ont répandu de rare & de beau dans leurs divers ouvrages. Les trois Graces ont autresfois animé trois corps differens, & n’ont iamais éclaté dans un seul corps. Et comme on dit que Zeuxis pour peindre la beauté d’Helene, choisit les plus belles filles de la Grece, & qu’empruntant d’elles ce qu’elles avoient de plus parfait, il en forma un tableau si accomply, que l’on le iugea digne d’estre mis au pus bel endroit du Temple de Iunon ; ainsi pour parvenir au supréme degré de la vraye eloquence, & meriter l’honneur estre mis au plus superbe, & plus precieux endroit du Temple de Memoire, il est à propos de consulter les divers monumens de tous ces grands Genies de l’Antiquité.
Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 116v (espagnol)
Pintò aquella obra que por la insigne hermosura llamaron HELENA, copia de las perfecciones de cinco hermosissimas donzellas.
Puget de la Serre, L’Entretien des bons esprits sur les vanitez du monde(publi: 1630), « De la vanité de la beauté » (numéro ch. XIII) , p. 488-489 (fran)
Puis que ie suis d’humeur de dire la verité, ie ne veux rien celer, il n’y a jamais eu de beauté sans deffaut, fors que celle de la Vierge, mais c’estoit aussi un chef-d’œuvre, où Dieu avoit mis la main, puisque ce devoit estre le premier berceau, où il devoit reposer. Parlons seullement des ouvrages de la Nature, elle n’en a jamais fait, qu’il n’y ait quelque chose à dire. D’où vient que ce grand Peintre, dans le dessein qu’il eut de representer, selon sa fantaisie, la belle Heleine, fit un triage des plus belles filles de la ville, et de chacune son pinceau en desroba quelque chose. Tellement que d’un grand nombre de beaux visages, il n’en fit qu’un. Ce qui nous presche l’impuissance de la Nature, à former une Beauté sans deffaut.
Espinosa y Malo, Felix de Lucio, El pincel, cuyas glorias descrivia Don Felix de Lucio Espinosa y Malo(publi: 1681), p. 22 (espagnol)
- [1] Plinius, libr. 35. cap. 9. Alioquin tantus diligentia, ut Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Lacciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quid in quaque laudatissimum esset, pictura redderet.
Avia de hacer Ceuxis [1] la imagen de Iuno Lavinia para los de Agrigento; y porque saliesse perfecta, à instancia suya, le traxeron las mas peregrinas bellezas de aquella provincia; y viendolas desnudas, escogiò cinco de las que hallò con mayor perfeccion dispuestas, para copiar de todas un milagro admirable de la hermosura: desuerte, que de los varios sucesos de los hombres, escogemos los mejores, para imitar con propiedad en el acierto de las acciones los exemplares de la pintura.
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo tercero, de la difinicio y essencia de la Pintura, y sus diferencias”, fol. 43r (espagnol)
- [1] Zeusis pintò con perfeccion la hermosa Elena.
Y está serà la Pintura practica regular, y cientifica, la cual hasta oi no ha sido bastantemente alabada, ni ha tenido la debida estimacion. [1] Parece que la alcançò sin duda el famoso Zeusis, Pintor Griego, porque mal eligiera las cinco doncellas Agrigentinas entre tantas, ni ejecutàra por ellas el perfectísimo retrato de Elena, si no alcançàara este docto conocimiento. Ni el divino Michaelangelo cerraria los perfiles exteriores de un desnudo, tan perfectamente como lo hizo, sin levantar el lapiz, ò pluma del papel, à no ser tan señor de las proporciones Notomía, y Perspectiva en las cosas hermosas.
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1637) (I, 1, 3), p. 4 (latin)
- [1] Vide Tullium in ipso statim libri secundi de Inventione
Sciebat Zeuxis naturam nihil in simplici genere omni ex parte perfectum esse polivisse [1]. Aliud enim alii commodi aliquo adjuncto incommodo muneratur ; tanquam non sit habitura quod caeteris largiatur, si uni cuncta concesserit. Relicturus itaque Crotoniatis excellentem muliebris formae pulchritudinem, non putavit in uno corpore omnem luculentae venustatis gratiam quaerendam ; sed quinque virgines formosissimas delegit, ut mutum in simulachrum ex animali exemplo veritatem transferret : τὸν τῶν ἄλλων κρείττον ἀπανθίζων : optima quaeque ex aliis decerpens : ut loquitur Dionys. Halicarnass. ; καὶ ἐκεῖνο τὸ ἀκρότατον ζητῶν κάλλος, ὅπερ ἀνάγκη ἓν εἶναι atque excellentissimam illam pulchritudinem quaerens, quam necesse est unicam esse : ut loquar cum Luciano in Hermotimo. Liquet ergo verissimum esse illud Socratis ad Parrhasium, Ἐπειδὴ οὐ ῥᾴδιον ἑνὶ ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολλῶν συναγόντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα, οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι : Quando non facile est unum hominem nancisci, in quo reprehensionis omnia sint expertia, de multis colligentes ea quae in singulis pulcherrima sunt, ita scilicet tota corpora ut pulchra videantur efficitis. Xenoph. lib. III Apomnem.
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (I, 1, 3), p. 6-7 (anglais)
- [1] epist. 19
- [2] In Panegyr. Maxim. et Const. Dicto
- [3] In ipso statim mitio lib. II de Invent.
- [4] In Hermotimo
- [5] Apud Xenophontem lib. III Apomnem.
Such artificers therefore as carry in their mind an uncorrupt image of perfect beautie, do most commonly powre forth into their workes some certain glimmering sparkles of the inward beautie contained in their minds: neither may we thinke this to be very easie; for, according to Apollonius Tyaneus [1] his opinion, that which is best, is alway hard to be found out, hard to be judged. Is is also well observed by an ancient orator [2], that the imitation of a most absolute beautie is never most hard and difficult: and as it is an easie matter to set forth a true similitude of deformitie by her owne markes, so on the contrary the similitude of a perfect beautie is rarely seene as the beautie itself. It was not unknowne unto Zeuxis, says Tullie[3], that Nature would never bestow upon one particular bodie all the perfections of beautie; seeing that nothing is so neatly shaped by Nature, but there will alwayes in one or other part therof some notable disproportion be found; as if nothing more should be left her to distribute unto others if she had once conferred upon one all what is truely beautiful. Wherefore, when this noble artificer intended to leave unto the inhabitants of Crotona a choice patterne of a most beautifull woman, he did not thinke it good to seeke the perfection of a faultlesse formositie in one particular body; but he pick'd out of the whole citie five of the well-favouredst virgins, to the end he might find in them that perfect beautie, which as Lucian speaketh[4], of necessitie must be but one. So does Zenophon very fitly to this purpose bring in Socrates his discourse held with the painter Parrhasius, seeing it is not so easie, sayth Socrates[5], to meet with anyone that does altogether consist of irreprehensible parts, so is it, that you having chosen out of every part of severall bodies what is fittest for your turn, bring to pass that the whole figures made by your Art seeme to be most comely and beautifull.
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (I, 12), t. I, p. 250-252 (espagnol)
Como lo dió a entender Rafael Urbino escribiendo al Conde Baltasar Castellón, que le encareció mucho la hermosura de la Galatea que había pintado a fresco; diciendo desta manera: Ma essendo carestia, e de buoni giudicii, e di belle donne, io mi servo di certa idea, che mi viene nella mente; se questa ha in se alcuna eccellenza d’arte, io non so, ben me affatico di haberla. Quiere decir: “Mas careciendo de buen juicio y de hermosas mujeres, yo me sirvo de cierta idea que se me ofrece a la imaginación; si ésta alguna excelencia en la arte, no lo sé, pero bien me fatigo por alcanzarla.” De manera, que la perfeción consiste en pasar de las ideas a lo natural, y de lo natural a las ideas; buscando siempre lo mejor y mas seguro y perfeto. Así lo hacía tambien su maestro del mismo Rafael, Leonardo de Vinci, varón de sutilísimo ingenio, atendiendo a seguir los antiguos; el cual, primero que se pusiese a inventar cualquier historia, investigaba todos los efetos propios y naturales de cualquier figura, conforme a su idea; y hacía luego diversos rasguños; despues se iba donde sabía que se juntaban personas de la suerte que las había de pintar, y observaba el modo de sus semblantes y vestidos y movimientos del cuerpo; y hallando cosa que le agradase, conforme a su intento, lo debuxaba en el librete, que siempre llevaba consigo (verémos adelante sus palabras conforme a su intento) y, destra manera, acababa sus obras, maravillosamente. Esto es, finalmente, lo que conviene hacer en este último grado, con el exemplo del antiguo Zeusis, que para la bellísima Elena que se le ofreció pintar al pueblo de Agrigento, eligió cinco hermosas doncellas, y de cada una de ellas fué escogiendo lo más perfeto para hacer una figura igualmente acabadísima, aventajando la arte a la mesma naturaleza: pues juntó en un sujeto la hermosura que apenas se hallaba en munchos. Galanamente pintó este caso (aunque atribuido a Protógenes) D. Melchior del Alcázar, florido ingenio sevillano, que murió en la corte de treinta y siete años, el de 1625, en estas coplas castellanas:
Intentó con osadía,
Protógenes, los pinceles
vencer, y l’arte de Apéles
y su ufana valentia.
Para lo cual, sabiamente,
de la Grecia las más bellas
y a puestas cinco doncellas
buscó y halló diligente.
Del ornato las despoja,
y, libres de compostura,
sin dexarles ni una hoja.
Contemplaba su belleza
y admiraba cada parte
atendiendo siempre a l’arte
nunca a la naturaleza.
La gracia y color sacó
desta, y la parte más bella
y artificiosa de aquélla;
y una imágen acabó
ta, que a Vénus, que el hermoso
velo estrellado oscurece,
por trasunto se la ofrece,
de Apéles vitorioso.
Pero si atrevido osara
hoy la luz de mi cuidado
retratar, de ella abrasado,
tabla y pincel arrojara
y de sus rayos rendido,
ufano de padecer,
no cuidara de vencer,
cuidara de ser vencido.
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (I, 5, 2), p. 66-67 (anglais)
As manie therefore as resolve to follow this same contemplation earnestly, doe sometimes purposely take certaine images of things conceived, and turne them many wayes, even as one lumpe of waxe useth to be wrought and altered into a hundred severall fashions and shapes: but principally do they labor to store up in their phantasie the most compleat images of beautie. Such artificers as worke in brasse and colours receive out of the naturall things themselves those notions by the which they do imitate the outward lineaments, light, shadows, risings, fallings; they pick out of every particular body the most excellent marks of true beautie, and bestow them upon someone body : so that they seem not to have learned of Nature, but to have strived with her, or rather to have set her a law. For who is there, I pray you, that can shew us such a compleat beautie of any woman, but a quick-sighted judge will easily find in her somthing wherein she may be esteemed to come short of true perfection?
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (I, 7), p. 411 (espagnol)
Acabada la proporción de la mujer no será fuera de propósito, enseñar el modo que ha de tener el pintor cristiano en la imitación del natural, si se le ofrece alguna figura de mujer desnuda; pues lo prometimos, rifiriendo que Zeuxis sacó de cinco doncellas la figura famosa de Elena.
Bisagno, Francesco, Trattato della pittura(publi: 1642), p. 66-68 (italien)
Ma in quanto al modo poi di ritrarre il naturale, ancorche questo deve essere imitato per ogni parte, ed in ogni cosa, io però mi rido di coloro, che approvano ogni naturale per buono, quasi che la natura per manifestare la sua grandezza, non dimostrasse errare intorno alle bellezze sue facendole più, e meno, che a fatica se ne ritrovano ai tempi nostri, e certo è che molti vi si fondano sù talmente, che essi non curano più una cosa, che un’altra, e così schivano il porger loro aiuto con la lor maniera in modo alcuno, là onde io dirò, che se Zeusi, il quale tante belle nude, accolse per formarne solo una ai Crotoniati, havesse havuto a formare un huomo, io stimo, che di molti più huomini bisogno vi era, che delle donne, non hebbe, percioche altro magistero di muscoli, di nervi, e di vene si scuopre in un homo, che in una donna si vede, poiche il suo bello consiste dopo le debite proportioni nell’esser piene di delicate morbidezze.
Fuggasi dunque così sciocca opinione, che si hanno finto nel capo molti, e credasi che se Zeusi, oltre la tanta diligenza, ch’egli usò, non havesse posseduto da se singolar maniera, non avrebbe mai accordato insieme le belle membra divise, che lui tolse da tante vergini, né meno l’harebbe condotto a quella perfettione, che da principio si giudicò. Concludasi dunque, che oltre al cercar le migliori cose della natura, e più perfette si supplisca dipoi tuttavia con la maniera buona, e con essa si arrivi tanto oltre, quanto si può giudicar che basti, perche accordata che sia quella col natural buono, si fa una compositione di eccellente bellezza.
Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 5 (italien)
- [2] Eliano lib. 4
- [3] lib. 14
- [1] Zeusi
[1] Ritrasse un Elena, della quale ne trasse molti danari, non lasciandola vedere, che per certo prezzo, onde era della da Greci Elena meretrice, per il guadagno, che ne faceva il pittore. [2] Costui fece acquisto di molte ricchezze con l’arte sua, e per decoro, portava nell’Olimpia scritto nel mantello a lettere d’oro il nome suo ; e stimando, che le opere non se gli potessero pagare, donò l’Alchemena à gli Agrigentini, e la figura di Pane ad Archelao, [3] da cui riceve poscia quaranta mine per dipingere la di lui casa, tutto che quello non fosse avezzo à spendere un danaro per il proprio commodo, onde venivano molti di lontane parti, per vedere quelle pitture. E quegli fù, che scelse cinque delle più belle citelle della Grecia, dalle quali trasse la figura di Giunone per i medesimi Agrigentini.
Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650) (§38), p. 79 (latin)
At Olympiade XCV claruit Zeuxis Heracleotes. […] De Helenae simulacro, ab eo Crotoniatis picto, eleganter scribit Cicero, initio secundi de Inventione.
Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), De Graphice (numéro cap. V, §17 ) , p. 69 (latin)
- [1] pictura colit veritatem
Praeterea in pictore requiritur natura scientia. Est enim cum eo comparatum, uti cum historico. Quia, ut in gestis narrandis, nec fingere licet, quod non evenit ; nec praeterire, quod evenit : ita neque pictori concessum vel exprimere falsum; vel omittere verum. Nempe γραφὴ τὴν ἀλήθειαν βημᾷ [1], ut ait Philostratus lib. I Iconum ; ubi de Narcisso. Itaque et Petronius Arbiter in Protogenis rudimentis laudat, quod sic cum naturae veritate certarent, ut non sine quodam horrore tractarentur. Idcirco et ἀνατομὴ, sive incidendi corporis scientia, plurimum confert pictori. Nec, ut puto obscura est ejus ratio. Exactius enim ejus gnarus humani corporis proportionem in singulis servabit membris. Cumque non eadem in omnibus sit proportio ; facilius pulchriorem discernet. Nec enim in uno omnia sunt praestantissima. Ideo Zeuxis Helenam Crotoniatis picturus, ex ingenti multitudine virginum de publico consilio unum in locum conductarum, quinque delegit ; ut ex singulis, quod speciosissimum foret, excerperet. Testis M. Tullius initio secundi de Inventione. Atque eandem rem narrat Plinius lib. XXXV cap. IX. In eo tamen abit, quod non de Crotoniatis, qui in Italia, id referat ; sed de Agrigentinis, qui in Sicilia. Interim convenit iis, quod uterque dicat, Helenam pictam ; non Venerem, quod putabat Caesar Bullingerus lib. II de Pictura cap. XIII.
Leonardo da Vinci, Trattato della pittura di Lionardo da Vinci. Nuovamente dato in luce, con la vita dell’istesso autore, scritta da Rafaelle du Fresne. Si sono giunti i tre libri della pittura, & il trattato della statua di Leon Battista Alberti, con la vita del medesimo(publi: 1651), “Delle elezzione de’ belli visi” (numéro § 137) , t. I, p. 203 (italien)
Parmi non piccola grazia quella di quel pittore, il quale si fa buone arie alle sue figure. La qual grazia chi non l’ha per natura la può pigliare per accidentale studio in questa forma. Guarda a torre le parti buone di molti visi belli, le quali belle parti sieno conformi più per pubblica fama che per tuo giudizio; perché ti potresti ingannare togliendo visi ch’avessino conformità col tuo; perché spesso pare che simil conformità ci piacciono, e se tu fussi brutto eleggeresti visi non belli, e faresti brutti visi come molti pittori, ché spesso le figure somigliano al maestro; sì che piglia le bellezze, come ti dico, e quelle metti in mente.
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), “Dell’officio del pittore, e come lo deve esercitare” (numéro III, 22) , p. 238 (italien)
- [1] l. 4 de doctr. chris. c. 12
- [2] Armenino l. 2 c. 10
- [3] l. 2 de invent.
- [4] l. 35 c. 9
- [5] Carlo Ridolfi nella vita p. 7
E come l’ufficio dell’oratore fu distinto in tre parti da S. Agostino [1], Delectare est suavitatis, docere necessitatis, flectere victoria: così l’officio del pittore da noi si distingue in maniera, che gli conduca l’opere a segno, che consolino col diletto, che illuminino coll’ammaestramento, e che eccitino col moto i riguardanti a vivere secondo il dettame della virtù, e del voler divino. [2] E questo officio egli deve esercitare per giudizio di molti con diligenza, non ostinata, ma almeno bastevole, specialmente per quell’opere, che star deono molti anni al bersaglio de’ riguardanti. Et avverta, che circa il modo di ritrarre al naturale, non s’approva per buono ogni naturale, quasi che la natura non erri mai nel fare le sue bellezze: et in caso, che le facci, o abbia fatte men perfette, può il pittore, e deve con la sua diligenza, e modo aiutarla. Zeusi usò accortezza in raccorre le naturali bellezze sparse in molte vergini, come ho detto, per formarne la bellissima figura a’ Crotoniati, secondo Tullio [3], o a gli Agrigentini, secondo Plinio [4]: ma se non avesse adoperata singolar diligenza, et artificioso modo, non averrebbe accordato insieme, e tanto bene quelle divise bellezze; ne l’immagine sua saria stata di quella perfezione. Anche del Tintoretto scrivessi [5], il che molto più conviene al maraviglioso Raffaello, ad Annibale Carracci, et ad altri eccellentissimi professori, che egli conosceva con la perspicacia dell’ingegno, che per divenir gran pittore, faceva di mestieri assuefar lo stile del disegno sopra scelti rilievi, partendosi dall’imitazione di natura; poiché questa produce per lo più cose imperfette, ne accoppia, che difficilmente insieme tutte le parti d’una compiuta, e perfetta bellezza. Saggiamente osservava, che gli eccellenti artefici ebbero intento di cavar un’estratto del bello dalla natura, et aiutandola nelle parti manchevoli, renderla nell’opere loro per ogni parte perfetta: volle egli mostrar il modo da praticarsi nel ritrarre le cose dal vivo: ma non avrebbe già mai ridotti que’ corpi ad una tanta esquisitezza, se non v’avesse acconcio quello, che vide manchevole nel naturale, facendo espressamente conoscere, che fa di mestieri al buon pittore l’accrescere bellezza alla natura con l’arte.
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « Del diletto sensitivo, e spirituale, che si riceve dalle sacre immagini » (numéro II, 9) , p. 57 (italien)
- [2] l.2. q. 31 a.4. al 1.
- [3] l. 14 var. hist.
[1] San Tommaso insegna conforme al Filosofo [2], quod secundum omnem sensum est delectatio, che si da un diletto, che si chiama sensitivo, cagionato dalla cognizione del senso, e che sta nell’appetito inferiore : e questo nasce dalle sacre immagini, quando il senso dell’occhio conosce in quelle la graziosa varietà de’ colori, la vaghezza de’ lumi, l’artificio del disegno, la gentilezza degli ornamenti, ed il resto, che veduto empie di dolce maraviglia l’animo dello spettatore. Questo diletto ricevono in gran maniera que’ giudiziosi intelligenti, che, avendo occhio buono, si lasciano rapire a mirare con somma attenzione ciascun’opera di valentuomo. Eliano racconta [3] che l’antico pittor Nicostrato, mirando una volta l’Elena dipinta da Zeusi, rimase stupefatto in guisa, che quei che lo viddero come rapito, s’accorsero, ch’egli era tutto pieno d’altissima maraviglia ; onde uno se gli accostò chiedendo : « E perché ammirasse tanto quell’opera di pittura ? » A cui rispose : « Non id me rogares si meos oculos haberes ». E volle dire : se tu avessi buono occhio, come ho io, per mirar questa bellissima pittura, non mi faresti una tal domanda intendendo molto bene, che io meritamente son rapito da diletto grandissimo nel rimirare l’esquisitezza del suo artificio. Così avviene a molti pratici del nostro tempo nel mirare qualche opera eccellente. E vero con tutto ciò, che alle volte per godere cotal diletto, basta lasciarsi consigliar dal senso, senza consultar con la ragione.
- [1] voir aussi Hélène belle et Hélène riche
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « D’alcuni motivi, per li quali molti artefici non eleggono il far solamente opere sacre » (numéro III, 17) , p. 201-202 (italien)
- [1] l. 35 c. 9
E chi non avesse, ne potesse avere, pronte l’opere migliori tra le sacre condotte da’ valentuomini, si sforzi d’imitar le sacre, che può avere; imperoché essendo state fatte da eccellenti artefici, serviranno di buona, e eccellente scuola a’ diligenti imitatori; ovvero imiti le profane, et indifferenti, ma nell’espressione dell’artificio, e bellezza delle figure: e facci di modo comparire nell’opera sua sacra le perfezioni imitate nell’altrui opere trapiantati nel giardino di Dio. E noto l’antico modo tenuto dal famoso Zeusi, quando, come dice Plinio [1], per far un’opera sacra da porsi nel tempio Iunonis Laciniae, prese per via d’imitazione il meglio, che trovò sparso in cinque vergini bellissime, e lo espresse raccolto nella sua pittura. Così può virtuosamente procedere il pittore; notare, quod est laudatissimum, ciò, che di lodevole et eccellente egli ammira nell’opere profane de’ moderni, et esprimerlo nella sua opera sacra per via d’imitazione; per quanto però, e come, il suo sacro soggetto richiede, o comporta. Con questo modo le gioie trovate nell’arene s’incastrano nell’oro.
Sorel, Charles, La Description de l’Isle de portraiture et de la ville des portraits(publi: 1659), « Des femmes qui faisaient des portraits, et premièrement des femmes vaines et ambitieuses », p. 90 (fran)
Quelques-unes de ces dames se volant peindre peignaient quelquefois le visage de quelque belle du siècle, ou bien elles faisaient un portrait de plusieurs beautés ensemble, pour dépeindre la leur ; et puis elles disaient galamment que cela leur devait ressembler autant comme la Junon de la ville d’Agrigente ressemblait à Junon même, après que Zeuxis eut choisi plusieurs filles de la ville, pour tirer d’elles ce qu’elles avaient de plus beau, et en faire le portrait de cette déesse. De quelque façon qu’elles eussent fait leur portrait, elles croyaient qu’il suffisait d’écrire leur nom au-dessus pour faire croire que ce l’était ; que personne n’en pourrait douter, et que principalement ceux qui ne les avaient pas beaucoup vues les tiendraient pour telles qu’elles se représentaient ; et qu’enfin c’était toujours leur portrait, puisqu’il avait été fait à dessein que ce le fût.
[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 27 (fran)
Et pour vous dire quelque chose des plus beaux ouvrages de Zeuxis, on estime particulierement une Atalante, dont il fist present aux Agrigentins en Sicile ; un dieu Pan qu’il donna au Roy Archelaüs ; et cette admirable figure qu’il peignit pour ceux de Crotone, en laquelle il fit paroître ce qu’il y avoit de plus beau dans les plus belles filles de la Grece.
Félibien, André, Le Portrait du Roy(publi: 1663), p. 21 (fran)
Ce ne fut pas un petit avantage au peintre Zeuxis, de rencontrer dans la Grece tant de belles filles pour former sur toutes leurs differentes beautez cette figure si celebre, dont il fit le parfait modèle de la Beauté. Mais combien est-ce un plus grand bonheur à cet excellent peintre d’aujourd’huy, de trouver dans la seule personne de Votre Majesté dequoy faire la peinture d’un Roy qui sera à l’avenir le modèle de tous les autres Rois ?
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Ier Entretien), p. 66 (fran)
Et pour vous dire quelque chose des plus beaux ouvrages de Zeuxis, on estime particulierement une Atalante, dont il fit present aux Agrigentins en Sicile ; un dieu Pan qu’il donna au Roy Archelaüs ; et cette admirable figure qu’il peignit pour ceux de Crotone, en laquelle il fit paroistre ce qu’il y avoit de plus parfait dans les plus belles filles de la Grece.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (IIe Entretien), p. 92 (fran)
Sçavez-vous, me dit-il, que j’ay de la peine à ne pas croire qu’il ne soit de la peinture ainsi que de toutes les autres choses pour lesquelles on a toûjours une haute estime dans les temps où elles sont en crédit ? Car lorsque je regarde tant de rares tableaux que l’on fait aujourd’huy, et que je pense encore à ceux que nous avons veus autrefois à Rome, je ne puis m’imaginer que les Appelles et les Protogenes en ayent fait de plus excellens que ceux-là.
Quand nous n’aurions pas, luy repartis-je, le témoignage des plus savants historiens de l’Antiquité, vous sçavez bien que par les statuës qui sont demeurées entieres jusqu’à present, nous pouvons juger du merite des peintres de ce temps-là qui assurément n’estoient pas moins habiles que les sculpteurs, puisque les uns et les autres prenoient tant de peine à se rendre sçavants. Car si Zeuxis apporta un si grand soin à bien observer dans les filles de la Grece les mieux faites, ce qu’elles avoient de plus parfait et de plus agréable pour representer cette fameuse image d’Helene, il ne faut pas douter que les autres peintres qui étoient alors en grande reputation ne travaillassent de même à rendre leurs ouvrages accomplis. Mais nous pouvons dire que des peintres modernes il n’y en a guere qui se rendent aussi considerables que ces Anciens, parce qu’il y en a peu qui s’adonnent comme ils devroient à l’étude d’un art qui demande une si forte application.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), p. 6-8 (italien)
- [1] XI.
- [2] Cic. L. 2 d. Invenz. in princ. Dionis. Alic. Giud. d. Scrit. Gr. Proem.
- [3] Ariost. Fur. c. 11 st. 71
- [4] Val. Mass. l. 3 c 7. 3. Aristid. T. 3 a 552
- [5] Iliad. l. 3 v. 156.
- [6] XII.
- [7] XIII.
[1] [2] Mossi da si gran fama di questo artefice, che in quell’età avanzava ogn’altro di valore, e di stima, i Crotoniati per la gran copia d’ogni bene reputati i più felici popoli dell’Italia lo chiamarono con largo stipendio ad abbellire con le sue insigni pitture il tempio di Giunone Lacinia da loro tenuta in somma venerazione. Fece adunque Zeusi in detto luogo buon numero di tavole, alcune delle quali vi si conservarono assai, stante la devozione, e il rispetto del tempio. Ma desiderando di farne una che rappresentasse la più perfetta idea della beltà feminile si dichiarò di voler dipignere un’Elena. Volentieri ascoltaron questo i Crotoniati, che ben sapevano quant’egli sopra tutti fosse prode in dipigner femmine; e si diedero a credere che facendo egli uno sforzo in quello, in che egli valeva molto, averebbe lasciata in quel tempio un’opera segnalatissima. Ne s’ingannarono; posciachè Zeusi tosto domandò loro, come avessero belle fanciulle: ed essi conducendolo incontanente alla palestra mostrarongli molti giovanetti dotati di gran bellezza. Conciosiacosachè i Crotoniati in que’ tempi trapassavano tutti nella dispostezza, e avvenenza della persona, e nella robustezza del corpo, onde con molta gloria riportarono alle case loro onoratissime vittorie da’ giuochi più celebri dalla Grecia. Maravigliandosi fortemente Zeusi per la vaghezza de’giovanetti, abbiamo (soggiunsero i Crotoniati) altrettante fanciulle loro sorelle, quanto leggiadre, fa tuo conto dalla bellezza di questi. Datemi adunque (diss’egli) le più belle mentre io vi dipingo la figura promessa, acciocchè io transporti quel più ch’io potrò di vero dall’esemplo animato nell’imagine muta. Allora i Crotoniati condussero per consenso pubblico le fanciulle in un tal luogo, e diedero facoltà d’accommodarsi al pittore. Cinque ne trascelse, i nomi delle quali furon celebri presso i poeti, per esser’ elleno state approvate dal giudicio di colui, che di buona ragione doveva avere un’ ottimo gusto della bellezza. Non pensò pertanto Zeusi di poter trovare in un corpo solo quanto gli abbisognava per la venustà da lui ricercata; imperciocchè la natura non fa mai un suggetto solo in tutto, e per tutto, perfetto, e come se non le restasse che donare agli altri, s’ella a uno desse ogni cosa, a tutti dona del bene con qualche giunta di male. Sciegliendo adunque da tutte quelle donzelle quanto esse aveano di perfetto, e di vago, ne formò con la mano quella bellezza ch’egli s’andava immaginando col pensiero, superiore ad ogni eccezione, e libera da qualsivoglia difetto. Onde cantò il grand’Epico di Ferrara in celebrando la bellissima Olimpia [3]
E se fosse costei stata a Crotone
Quando Zeusi l’immagine far volse,
Che por dovea nel tempio di Giunone,
E tante belle nude insieme accolse;
E che per farne una in perfezione,
Da chi una parte, e da chi un’altra tolse,
Non avea da torr’ altra che costei,
Che tutte le bellezze erano in lei.
[4]. Dopo aver terminata quest’ opera conoscendone l’eccellenza, non aspettò che gli uomini ne giudicassero, ma tosto v’oppose que’ versi d’Omero [5]
Degno ben fù che i Frigi, e i forti Achivi
Soffrirer per tal donna un lungo affanno.
Volto ha simile all’immortali Dee.
Tanto arrogò alla sua mano questo artefice, ch’egli si stimò d’esser giunto a comprendere in quella figura quanto Leda potè partorire nella sua gravidanza celeste, e Omero esprimere col suo ingegno divino. [6] Egli è di più da sapere, che da quest’ opera Zeusi cavò molti denari, perchè oltre al prezzo, che da’ Crotoniati gli fu sborsato, prima d’esporla in pubblico non ammetteva così ognuno a vederla, ne senza qualche mercede. Che però facendo egli (come si dice) bottega sopra questa pittura, i Greci di que’tempi la chiamarono, Elena meretrice. [7] Nicomaco pittore veggendola restò sbalordito per lo stupore: accostossegli un certo goffo, e interrogollo perchè ne facesse tanti miracoli. Non me ne domanderesti, diss’egli, se tu avessi i miei occhi: pigliali, e parratti una dea.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Postille alla vita di Zeusi », p. 28-30 (italien)
XI. Mossi da sì gran fama i Crotoniati.
Cicer. nel princ. del l. 2 dell’Invenzione racconta ciò lungamente. Conferma il medesimo Dionigi Alicarn. nella Censura degli Scrittori Greci più singolari, ma brevemente. Diversifica Plinio nel nome de’popoli l. 35 c. 9. Alioquin tantus diligentia, ut Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis Laciniae publicè dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset, pictura redderet. Gio: Battista Adriani, che sempre seguita Plinio, accostandosi a Cicerone, accortamente in questo luogo l’abbandonò, perchè in verità, o egli errò gravemente, o pure il testo è scorretto. Agrigento, o Gergento è città di Sicilia, e il tempio di Giunone Lacinia era in Calavria poco lontano da Crotone. Del che veggasi il dottissimo Cluverio nel l. 4 dell’Ital. Ant. a f. 1309. alle molte autorità portate del quale aggiungasi Strab. l. 6. a 261, e 262. Furon seguaci di Plinio Lodov. di Mongioioso nel tratt. d. Pittura a 146. e il Volterrano nel l. 19. dell’Antrop. e vi aggiunse di suo, che Zeusi dovea fare per gli Agrigentini una Venere, e non un’Elena. E in questo secondo fallo ebbe compagni Giulio Cesare Buleng. l. 2. c. 13. della Pitt. e Statuar. e M. Gio: della Casa nel Galateo. E per avventura (dic’egli) che quel dipintore, che ebbe ignude dinanzi a se le fanciulle calabresi, niuna altra cosa fece, che riconoscere in molte i membri che elle aveano quasi accattato, chi uno, e chi un’altro da una sola: alla quale fatto restituire da ciascuna il suo, lei si pose a ritrarre, imaginando che tale e così unita dovesse essere la bellezza di Venere. Seguitò parimente ed accrebbe l’error di Plinio il celebre Giusto Lipsio scrivendo nel l. I. c. I. degli Avvertimenti politici, che Zeusi fece agli Agrigentini l’effigie di Giunone: Ita sicut Zeuxis ille pictor olim, Junonem effigiaturus, virgines Agrigentinorum pulcherrimas conduxit, et è singulis aptavit quod praestantissimum in unaquaque esset; ita, inquam, pinceps et politici viri, ab exemplis, factisque illustribus potentiam (ea Iuno est) et prudentiam suam forment. Ne gli sovvenne d’avere scritto l. 3 c. 4. Var. lez. Quod Zeusim illum praestantem artificem in effingenda Helenae eximia pulchritudine fecisse memoriae proditum est, ut virgines omnes, quarum excellens formae dignitas esset, unum in locum conduceret, in easque intuens, uti quodque pulchrum esset, ad eius partis similitudinem, artem, et manum dirigeret: Ita videlicet etc. Dell’industria di Zeusi, e degli altri artefici in effigiare una bellezza perfetta da molti oggetti, veggasi per ora Francesco Giugni l. I. c. I. della Pittur. degli Ant. e leggasi attentamente Mass. Tir. discors. 7 e quanto dice Socrate a Parrasio nel l. 3 de’ Memorabili di Senofonte. Non è per ultimo da tacere, che Zeusi medesimo ritraente Elena dalle fanciulle di Crotone fu eletto per grazioso argomento di sua pittura da Domenico Beccafumi. G. Vasar. Part. 3. Vol. 2 a 374.
XII. Da quest’opera Zeusi cavò molti danari etc.
Raccontò questo Eliano Var. st. l. 4. c. 12 e da lui Poliz. Misc. c. 74. Cel. Rodig. 19. 27. E però da notare che il Volterrano nell’Antropol. l. 19. trascrivendo la stessa cosa, nominò il pittore Serse, e non Zeusi; la pittura Venere, e non Elena; come fece anche altrove.
XIII. Nicomaco pittore vedendo quest’opera etc.
Così lo chiama Plutarco nel Tratt. d’Amore presso Stobeo serm. 61. Elian d. Var. St. l. 14. c. 47 racconta il medesimo con poca diversità, ma nomina il pittore Nicostrato. Ho ritenuto più tosto Nicomaco, pittore insigne, di cui parlerassi nel Catalogo degli Artefici; dove Nicostrato l’ho udito nominare se non da Eliano, che per avventura in questo luogo potrebbe esser corrotto.
Piles, Roger de, L’Art de Peinture de Charles-Alphonse Du Fresnoy, traduit en François, avec des remarques necessaires et tres-amples(publi: 1668), p. 67 (fran)
- [1] Dissert. VII
Ces ouvrages antiques ont toûjours esté depuis leur naissance, la regle de la beauté. Et en effet, leurs auteurs ont pris un tel soin de les mettre dans la perfection où nous les voyons, qu’ils se servoient, non pas d’un seul naturel, mais de plusieurs dont ils prenoient les parties les plus regulieres pour en faire un beau tout : Les sculpteurs (dit Maxime de Tyr) [1] par un admirable artifice, choisissent de plusieurs corps les parties qui leur semblent les plus belles, et ne font de cette diversité qu’une seule statuë ; mais ce mélange est fait avec tant de prudence, et si à propos, qu’ils semblent n’avoir eu pour modele, qu’une seule et parfaite beauté. Et ne vous imaginez pas pouvoir jamais trouver une beauté naturelle qui le dispute aux statuës, l’Art a toûjours quelque chose de plus parfait que la Nature. Il est mesme à presumer que dans le choix qu’ils faisoient de ces parties, ils suivoient le sentiment des medecins, qui estoient pour lors bien capables de leur donner des regles de la beauté ; puisque la beauté et la santé se doivent ordinairement suivre l’une l’autre.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669) (vol. 3), p. 576 (latin)
Alioquin tantus diligentia, ut [1]Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Junonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas, et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset; pictura redderet.
- [1] Agrigentinis]. Crotoniatis, Cicero lib. 2 de Invent. Idem [Dalec.]
Scheffer, Johannes, Graphice, id est, de arte pingendi liber singularis, cum indice necessario(publi: 1669), "Finis ejus est pictura, quam imaginem vocamus, rem artifici propositam, exacte referentem in plano" (numéro §4) , p. 17 (latin)
Jam quoniam pictura veritatem sequi debet, ideo pro ea Latini usurparunt imaginem, sicque apellarunt, quicquid a pictore pingeretur. Cicero de Invent. II Vt excellentem muliebris formæ pulchritudinem muta in sese imago contineret, Helenæ se pingere simulacrum velle dixit. Loquitur de Zeuxide, qui pinxit Helenam nunquam a se visam, nec ad exemplum unum, verum multiplex ex diversis puellis captum, qualis neque extitit, nec existere ulla unquam potuit, et tamen imaginem illius ait Tullius pinxisse.
Scheffer, Johannes, Graphice, id est, de arte pingendi liber singularis, cum indice necessario(publi: 1669), "Primum argumentum est, quod appello rem pingendam, ingenio judicioque pictoris decenter inventam aut dispositam" (numéro §28) , p. 102 (latin)
Quando seligenda optima convenientissimaque argumento cum cura, componenda cum judicio, immutanda quoque sæpius cum decoro. Ita Zeuxis Lucinæ Veneris apud Crotoniatas imaginem picturus, ex quinque pulcherrimis civitatis ejus puellis, optimas selegit perfectissimasque partes, ac in Veneris unius transtulit picturam. Sed in illo genere, cum iconicæ fieri picturæ debent, parum putet quispiam requiri. Scilicet res depingendæ sunt, ut natura sua sese habent. Canis hic, aut equus, aut homo suis exprimendus est coloribus, non ergo videor juvari quid ingenio meo posse. Verum est et hic nonnullus ipsi locus. Primum enim rerum omnium gratia non eadem, sive hoc, sive isto modo adspiciantur. Aliæ jucundiores in fronte, aliæ a tergo, aliæ a lateribus, aliæ si stent, aliæ si cubent, aliæ si in alto, aliæ si in depresso humilique collocentur. Ergo ista, sicut decet, seligere ac ordinare, res profecto est judicii non minimi. Sic picturus cubum, non a fronte ipsum, sed a latere adpiciendum collocabit. Illo enim modo nihil prope habet, quod repræsentet.
Huret, Grégoire, Optique de portraicture et peinture(publi: 1670), p. 106-107 (fran)
Car d’un costé il[Explication : Alberti.] pose son disciple capable de faire la teste et la figure d’une Helene, puis qu’il ne luy donne d’autre enseignement que de copier le naturel, sçavoir une ou plusieurs belles filles, ainsi qu’il raporte qu’a fait Zeuxis, et partant il pose qu’il sçait connoistre et copier le beau naturel ; donc il le pose estre sçavant, puis au contraire il le croit si ignorant, qu’il n’aura pas l’esprit d’achever de faire toute sa figure entiere d’après les mêmes belles filles, mais qu’il en achevera les mains après quelque vieille ou rustique villageoise, en faisant ainsi doubles frais en modelles pour tout gâter, c’est pourquoy il l’en avertit.
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), p. 478 (italien)
Come l’impossibilità è perfezzione della pittura e della poesia. Aristotele vuol mostrare coll’esempio di Zeusi che è lecito al poeta il dire cose impossibili pur che sieno megliori, com’è impossibile per natura che una donna abbia in sé tutte le bellezze raccolte, quali ebbe la figura di Elena, che era bellissima, e per conseguenza migliore del possibile.
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), p. 17-18 (italien)
Vantavasi però Guido dipingere la bellezza non quale gli si offeriva agli occhi, ma simile a quella che vedeva nell’idea, onde la sua bella Elena rapita al pari dell’antica di Zeusi fu celebrata. Ma non fu cosí bella costei qual da loro si finse, poiché si trovarono in essa difetti e riprensioni anzi si tiene ch’ella mai navigasse a Troia, ma che in suo luogo vi fosse portata la sua statua, per la cui bellezza si guerreggiò dieci anni. Stimasi però che Omero ne’ suoi poemi adorasse una donna che non era divina, per gratificare i Greci e per rendere più celebre il soggetto suo della guerra troiana; nel modo ch’egli inalzò Achille ed Ulisse nella fortezza e nel consiglio. Laonde Elena con la sua bellezza naturale non pareggiò le forme di Zeusi e d’Omero; né donna alcuna fu, che ritenesse tanta venustà quanta la Venere Cnidia, o la Minerva Ateniese chiamata la bella Forma, né uomo in fortezza oggi si trova che pareggi l’Ercole Farnesiano di Glicone, o donna che agguagli in venustà la Venere Medicea di Cleomene. Per questa cagione gli ottimi poeti ed oratori volendo celebrare qualche soprumana bellezza, ricorrono al paragone delle statue e delle pitture. Ovidio […] altamente di Venere cantò, che se Apelle non l’avesse dipinta, sinora sommersa rimarebbe nel mare ove nacque:
Si Venerem Cois nunquam pinxisset Apelles
Mersa sub aequoreis illa lateret aquis.
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), p. 15-18 (italien)
[Note contexte]. Ma Zeusi, che con la scelta di cinque vergini formò l’immagine di Elena tanto famosa da Cicerone posta in esempio all’oratore, insegna insieme al pittore ed allo scultore a contemplare l’idea delle migliori forme naturali, con farne scelta da vari corpi, eleggendo le più eleganti. Imperoché non pensò egli di poter trovare in un corpo solo tutte quelle perfezzioni che cercava per la venustà di Elena, mentre la natura non fa perfetta cosa alcuna particolare in tutte le parti: « Neque enim putavit omnia quae quaereret ad venustatem uno in corpore se reperire posse, ideo quod nihil simplici in genere omnibus ex partibus natura expolivit ». Vuole però Massimo Tirio che l’immagine de’ pittori così presa da corpi diversi partorisca una bellezza, quale non si trova in corpo naturale alcuno, che alle belle statue si avvicini. Lo stesso concedeva Parrasio a Socrate, che’l pittore propostosi in ciascuna forma la bellezza naturale, debba prendere da diversi corpi unitamente tuttociò che ciascuno a parte a parte ottiene di più perfetto, essendo malagevole il trovarsene un solo in perfezzione. Anzi la natura, per questa cagione, è tanto inferiore all’arte, che gli artefici similitudinarii e del tutto imitatori de’ corpi, senza elezzione e scelta dell’idea, ne furono ripresi [1]
- [1] voir aussi Polygnote et Pauson ; Pireicus
Lamy, Bernard, La Rhétorique ou l’art de parler(publi: 1675), « Règles pour le style sublime » (numéro IV, 9) , p. 350 (fran)
Il faut donc cacher les défauts, ou pour mieux parler, puisque la vérité doit toujours paraître, il faut s’attacher à tourner les choses dont on veut donner une grande idée, de manière qu’elles apparaissent par leur bel endroit. Zeuxis, pour représenter Hélène aussi belle que les poètes grecs la font dans leurs vers, étudia les traits naturels des plus belles personnes de la ville où il faisait cet ouvrage, et donna à son Hélène toutes les grâces que la nature avait partagées entre un grand nombre de femmes bien faites. Lorsqu’on est maître de son sujet, on peut ajouter ou retrancher.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de Schoonheyt, dat’er een Kunstgeregelde Schoonheyt is » (numéro VIII, 1) , p. 279-280 (n)
- [5] Jan de Bruyn, in zijn Wetsteen
- [6] 2. Boek, c. 6
- [1] Schoonheyt
- [2] Ofze is
- [3] Bacons tegenstelling
- [4] By een ander toegestemt
- [7] Dat een geoffent konstenaer van de schoonheyt recht kan oordeelen.
Maer eer ik voortgae met van de kuntschap der nae de kunst geregelde schoonheyt te spreeken, zoo valt my in, dat de zelve van sommige kunst onkundige zelfs ontkent is te zijn.
[1] Fransiskus Bacon, van de schoonheit spreekende, brengt de konst in verkleynin. Dat is het beste deel van schoonheyt, zegt hy, ’t welk geen [2] Schilder kan uitleggen; noch door geen eerste aenzien kan bemerkt worden. En daeren is geen zoo uitmuntende, die geen wanstal onderworpen [3] is. Men kan niet weten of Apelles, or Albert Durer, grooter gek was, van welke de eene, een beeld van Geometricale proportien wilde maken, en d' ander de beste deelen van verscheyde schoonheden nemende, eene daer uit bestont te formeeren. Maer zulk een afbeeldinge (dunkt hem) kon niemant behaegen, dan den Schilder zelfs. Niet te min (dunkt hem voorts) zoo zouw een Schilder wel een beeter beelt kunnen maken, dan ’er oit geweest is, maer dat zoude door geluk, of by geval, geschieden; gelijk’t gebeuren kan, dat een muzikant in zijn speelen een zoet geluit maekt, zonder eenigen regel. Maer hier op moet een konstenaer uitroepen, ô Bakon! Uw hooge wijsheyt doet u doolen, en dit is vermetelheyt buiten uw leest. Zeker’t geene G. Vossius zegt, dat hoe groot ook een schoonheyt is, zy wort van verscheide beelden overwonnen, geschiet niet by geval, schoon'er somtijts wel eenige toeval van Gratie de hulpende handt toe verleent heeft. Onzen grooten Verulamius wort van een ander schrijver nagevolgt, hy meent, zegt hy, de beste meesters hebben altijts de schoonheyt gestelt in de gelijkmaeticheyt van deelen, of anders in een alderbeste medemeetlijkheyt van’t geheel tot yder deel, en wederom van de deelen onderling [4] tegen elkander. Maer andere hebbenze in een zekere bevallijkheyt van gedaente en verwe begrepen, en om dat zy haer niet en kenden, zoo hebbenze haer als onkennelijk beschreven. En dus voortgaende meent hy al [5] verder, dat wanneer kunstige Schilders een groote schoonheit uitgebeelt hebben, het zelve geensins deur regels van de kunst, maer alleen door een slach van’t geluk, en by geval gebeurt is. Ja hy meent, dat Apelles Schilderyen, [6] die uit veelerley schoonheden getrokken waren, niemant anders, als hem zelf zouden behaegt hebben: noch hy wil ook niet gelooven, dat de meesters, daer Claudianus van gewaegt, zijn Exempel volgden. Maer hy meent, dat het al luk op raek was, gelijk het werpen van Protogenes spons, die het schuim, dat hy door zijn konst niet en had kunnen volmaken, uitgaf. Maer zulk slach van schrijvers spreeken als de blinde van de verwen, en voornamentlijk dezen; want schoon hy even te vooren een juffer, voor zoo veel zijn verstant hem toeliet, na de kunst geformeert heeft, als hy op’t papier wierp:
Lumina sunt Melitae Iunonia, dextra Minervae,
Mamillae Veneris, sura maris Dominae.
Godinne Thetyszette aen Melita de beenen,
Den boezem Venus; de besneede handen scheenen
Van Pallas, het gezicht van Jovis Gemalin.
Of als hy een andere toestelt, met een hooft van Praeg, de borsten uit Oostenrijk, den buik uit Vrankrijk, den rug uit Brabant, de handen uit Engeland, de voeten van den Rijnstroom, en de dgiejen uit Zwitserlant: en zegt, dat deze by een Schildery, die hy stelt gezien te hebben, niet haelen zouden; zoo breekt dit des Schilders Regel niet. En hy bekent stilzwijgens, dat dien konstenaer zijn werk nae een beter denkbeelt gemaekt [7] hadde. Alle menschen, zegt Plutarchus, zijn niet begaeft met de zelve oordeelens kracht, ’t eene gezicht is meer door de natuur of door de konst geholpen om het schoone te onderkennen. Hier uit ontstaet het, dat geoeffende Schilders vaerdichlijk van de gestaltens en gedaentens der dingen kunnen oordeelen. Zeker waenwijs Idioot riep volmondich uit, dat hy de Venus, die Zeuxis geschildert hadde, niet schoon en vond. Maer Nikomachus zeyde, Neemt mijne oogen, en zy zal u een Godinne schijnen te zijn. Het moeten konst verstandige oogen zijn, die van de schoonheyt recht zullen oordeelen: en de recht kunstkundige meesters hebben nimmermeer gemist een waere schoonheyt, volgens de regelen van de konst, voort te brengen, zoo dikwils zy’t zelve hebben voorgenomen: ’t welk hen lichtelijk gemist zou hebben, indien’er geen vaste en zeekere regels by hun bekent waren geweest, waer in dat de waere schoonheyt bestont.
Hier op zegt Alben Durer, Dat niemant uit zijn zin en gedachten een schoonheyt kan uitdrukken: maer dat het noodig zy, dat iemant, die een schoonheyt uit zijn gemoed wil voortbrengen, de zelve daer in te vooren opgegaert en bewaert heeft, door een vlytige naevolginge, en datmenze dan voor diens eygen niet houden moet, maer voor een meesterschap door arbeyt verkreegen, die deeze vruchten baert, door het geene te vooren in’t gemoed gezaeyt was: en die de van binnen ontfange gedaente als een verborgen schat uitbrengt. Dat derhalven geoeffende meesters de leevendige exempelen, om haere beelden nae uit te drukken, niet van nooden hebben, dewijl’er door een lange oeffening, in haer gemoed zoo veel is samengevloeit, datze, al wat hun belieft, daer uit scheppen kunnen. Vorder besluit hy, dat dit voortbrengen van schoonheden van den ongeleerden en onervaren niet te hoopen is.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « De la beauté, et qu’il y a une beauté réglée par l’art » (numéro VIII, 1) , p. 422-424 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Mais avant de poursuivre cette discussion sur l’artifice de la beauté réglée par l’art, il me revient à l’esprit que certains ignorants de l’art ont même nié qu’elle puisse exister. Parlant de la beauté, Francis Bacon a déprécié l’art. Aucun peintre ne peut dévoiler la meilleure partie de la beauté et celle qui ne peut être remarquée au premier regard, dit-il. Et il n’y a là rien qui soit assez excellent pour être exempt de quelque laideur. On ne peut savoir qui, d’Apelle ou d’Albrecht Dürer, fut le plus grand fou, l’un voulant faire une figure aux proportions géométriques et l’autre se mettant à en former une autre à partir des meilleures parties de beautés variées. Une telle représentation, pensait-il, ne pourrait plaire à personne d’autre qu’au peintre lui-même. Et il estimait également que s’il arrivait qu’un peintre pût représenter une figure de telle sorte qu’elle parût meilleure que tout ce qui a existé jusque là, cela adviendrait par chance ou par hasard, comme il peut arriver qu’un musicien parvienne à faire un doux son en jouant mais sans suivre quelque règle. A ce sujet, ô Bacon ! un artiste s’exclamera : votre haute sagesse vous fait divaguer, et votre témérité vous fait aller au-delà de vos chaussures ! Il est certain que ce n’est pas le hasard qui fait, comme le dit Gerardus Vossius, qu’une beauté, aussi grande qu’elle soit, est toujours surpassée par différentes figures – quoique l’on ait parfois la chance que les Grâces nous prêtent une main secourable. Notre grand Bacon est suivi par un autre auteur qui pense, dit-il, que les meilleurs maîtres ont toujours placé la beauté dans la régularité des parties ou dans la meilleure commensurabilité du tout et de chaque partie ainsi que des parties entre elles, mais que certains ont compris qu’il s’agissait d’une certaine grâce de forme et de couleur qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils ont ainsi décrite confusément. Cet auteur poursuit en disant qu’il pense encore que, lorsque des artistes peintres parviennent à représenter quelque chose qui possède une grande beauté, cela ne peut en aucun cas s’expliquer par les règles de l’art, mais seulement par un coup de chance ou par le hasard. Et il considère même que les peintures d’Apelle, qui avaient été tirées de toutes sortes de beautés, n’ont plu à personne d’autre qu’à lui-même, et ne veut pas non plus croire que les maîtres dont Claudien a fait mention imitèrent son exemple : il suppose que tout cela est arrivé tout bonnement par chance, comme lorsque Protogène jeta l’éponge qui fit l’écume qu’il n’avait pu achever par son art.
De tels auteurs, et plus particulièrement ceux que j’ai cités, parlent comme des aveugles devant les couleurs. Celui que je viens de mentionner a conçu en son entendement, en la formant avec art et de toutes ses forces, l’apparence d’une jeune fille qu’il jette ainsi sur son papier : Il a également inventé le corps d’une autre jeune femme, en lui donnant une tête venue de Prague, une poitrine provenant d’Autriche, un ventre issu de France, un dos originaire du Brabant, des mains d’Angleterre, des pieds venant du Rhin et des genoux de Suisse. Et cet auteur a pu déclarer que ces figures n’ont rien à envier à une certaine peinture qu’il affirme avoir vue et que, malgré tout, ces figures ne dérogent pas aux règles des peintres, avouant subrepticement que l’artiste dont il parle avait fait son œuvre d’après une meilleure idée. Tous les hommes, dit Plutarque, ne sont pas doués de cette même force de jugement capable de discerner la beauté.
Pour discerner la beauté, la vue des uns est plus aidée par la nature, et celle des autres par l’art. Ce qui en ressort, c’est que les peintres exercés peuvent juger promptement de l’aspect et des formes des choses. Un fou idiot s’écria, plein de franchise, qu’il ne trouvait pas que la Vénus que Zeuxis avait peinte était belle. Mais Nicomaque lui dit : prends mes yeux, et elle te semblera une déesse. Ceux qui doivent correctement juger la beauté doivent avoir des yeux qui comprennent l’art. Et les vrais maîtres et connaisseurs de l’art n’ont jamais manqué, en suivant les règles de l’art, de créer une beauté véritable ainsi qu’ils avaient l’intention de la faire. Cette beauté leur aurait aisément échappé s’ils n’avaient connu aucune des règles fermes et sûres en lesquelles consiste la vraie beauté. Albrecht Dürer dit à ce propos que personne ne peut exprimer la beauté en ne faisant usage que de ses seuls sens et de ses seules pensées ; mais qu’il est nécessaire, pour vouloir faire sortir la beauté de son âme, de l’y avoir auparavant gardée et conservée avec soi, grâce à une imitation zélée ; et qu’il ne faut pas la garder pour elle-même mais pour en tirer, par le travail, une maîtrise qui enfantera les fruits de ce qui avait été auparavant semé dans l’âme et qui exprimera les formes reçues de l’intérieur comme un trésor caché ; et, donc, que les maîtres expérimentés n’ont pas besoin d’exemples vivants pour représenter leurs figures puisque, par une longue pratique, ils peuvent rassembler tant de choses en leur âme qu’il est ensuite possible de concevoir tout ce qui nous plaît. Il conclut enfin que les ignorants et les inexpérimentés ne peuvent espérer produire de telles beautés.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Hoe de Schoonheyt by d’ouden is betracht » (numéro VIII, 3) , p. 286-289 (n)
- [1] De Schoonheyt is in des Konstenaers idea
- [2] Welk van veele gezocht
- [3] Zeuxis zoekt de schoonheyt in al de maegden van Agrigenten, Apelles in Campaspe
Maer mogelijk zal nu iemant voorslaen, waeromme men doch zoo veel werks maekt van dingen te verbeelden, die nergens volkomen in de Natuur en zijn? of immers zoo zelden gevonden worden? Ik antwoorde hier op, datze, hoe raerder hoe waerdiger, in de denkbeelden van een doorluchtich en geoeffent verstant gevormt of gevonden worden: en immers zoo schoon of schoonder, als’er oit beelt van een konstige hand gezien is. Apelles, willende zijn Venus op’t alderschoonst uitbeelden, heeft eerst zijne gedachten boven alle zichtbaere schoonheden, die hem oit voorquamen, verheven; hy heeft in zijn vernuft een beelt geschildert, [1] dat in alle volmaektheden uitstak, en in deze opgetogentheyt het pinseel voerende, heeft hy wel deeze onberispelijke Godinne, tot verwondering van al de werelt, op’t tafereel gebaert, maer noch geensins de volkomene gelijkenisse van zijn Godtlijk denkbeelt hervoor gebracht. Phidias heeft Jupiter niet gezien, zegt Seneka, nochtans heeft hy hem gemaekt als donderende. Minerva is hem noit verschenen, nochtans scheenze als van den Hemel gedaelt. Maer Phidias is eerst in zijn vernuft als in een Poëetschen Hemel opgeklommen; hy heeft eerst als in een verrukking de Majesteyt en heerlijkheyt dezer Hemellieden gezien, eer hy’t ont werp dezer heerlijke gedaentens by der hand nam. Zijn beelden kregen een wonderlijke majesteyt en schoonheyt, maer hoe veel heerlijker zijn noch de denkbeelden daer van in zijn konstkennende vernuft geweest ! […] Poogen ook de Poëten en Dichters haere vaerzen met keurlijke spreuken en braeve stoffen op te pronken, zoo past het den Schilders, die op rijklijker vracht vaeren, de alderschoonste dingen van natuur tot haer onderwerp te kiezen; en die majesteyt, die men niet dan met hulpe van Aglaje verkrijgen kan, op’t vlytichst nae te trachten. [2] Den Haerlemschen Kornelis, zegt Mander, was uitnemende vlytich in’t teykenen na’t leeven, daer toe uitzoekende van de beste en schoonste roerende en’t leevende antijke beelden, die wy hier genoeg binnen’s lands hebben, als de is. gewiste en alderbeste studie, die men vinden mach, als men een volkomen oordeel heeft van het schoonste uit het schoon t’onderscheyden. […] D’Antijke Grieken gebruikten veel schoone levende beelden, om aen een eenich beek een schoone en waerdige gedaente te geven; gelijk vertelt wort van Zeuxis, toen hy voor die van Agrigenten ken zoude de groote Juno, om in haeren Tempel, welke stont te Lacinium [3] in Calabrien, nu Capo di Colomni genoemt, te offeren: dat hy eerst al de dochteren der stadt naekt zach, verkiezende uit haer alleen vijf, de schoonste van stal, en uit deeze zocht hy wederom de schoonste deelen uit, tot volmaking van zijn werk. Dit wiert deze dochteren niet alleen tot geen schande gerekent: maer zy wierden daer over met lofdichten vereert. Of dat by ons goet gekeurt zou worden, laet ik daer.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Comment la beauté a été recherchée par les anciens » (numéro VIII, 1) , p. 430 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Mais peut-être que chacun demandera maintenant pourquoi l’on travaille tant à représenter des choses qui, nulle part dans la nature, n’existent parfaites ou, tout du moins, ne s’y trouvent que rarement. Je répondrais que ces choses sont d’autant plus estimables qu’elles sont rares, et qu’elles se forment ou se trouvent dans les idées d’un entendement illustre et exercé. Et je dirais aussi qu’elles y sont aussi belles ou plus belles que n’importe quelle figure que l’on pourrait voir peinte par une main habile. Voulant représenter sa Vénus de la plus belle façon possible, Apelle éleva d’abord ses pensées au-dessus de toutes les beautés visibles qui pouvaient lui apparaître. Il peignit en son génie une image qui excellait dans toutes ses perfections. Puis, tandis qu’il était ainsi en chanté, il prit son pinceau et enfanta dans son tableau une déesse irréprochable que le monde entier admira, sans pour autant parvenir de quelque façon à une parfaite ressemblance avec son idée divine. Sénèque dit que Phidias n’a pas vu Jupiter, mais qu’il l’a fait comme tonnant ; que Minerve ne lui est jamais apparue, et que, pourtant, celle qu’il avait sculptée semblait être tombée du ciel. C’est que, tout, d’abord, Phidias s’est comme élevé en son grand génie vers un ciel poétique, et qu’il y a vu, comme pris d’un ravissement, la majesté et la noblesse de ces personnages célestes, avant d’entreprendre de concevoir leurs nobles formes. Si ses sculptures ont reçu une majesté et une beauté admirables, que leurs idées étaient plus nobles encore dans le génie de ce grand connaisseur de l’art ! […] Si les poètes et les versificateurs cherchent à agrémenter leurs vers de proverbes choisis et de dignes matières, il convient également que les peintres, qui voyagent plus lourdement chargés, choisissent les plus belles choses de la nature comme leurs objets et recherchent avec le plus de zèle possible cette majesté que l’on ne peut trouver sans le secours d’Aglaé. Cornelis van Haarlem, dit Van Mander, dessinait sur le vif avec un zèle excellent. Il recherchait pour cela les meilleures et les plus belles figures antiques, animées et vivantes, que nous avons ici au pays en assez grand nombre, et qui sont l’étude la plus certaine et la meilleure que l’on puisse trouver lorsqu’on possède un jugement parfait afin de différencier ce qu’il y a de plus beau dans le beau. Mais cela demande beaucoup, et n’a parfaitement réussi ni à notre Haarlémois ni même au curieux Dürer. Et même Michel-Ange, lorsqu’il vit l’œuvre du grand Titien et en vanta le coloris, n’oublia pas d’ajouter qu’il était dommage que les peintres vénitiens n’apprissent pas assez à leurs débuts à dessiner. Si un maître tel que Titien, si doué dans l’imitation de la nature et sur le vif, avait en effet été bien aidé par l’art de dessin, et s’il avait soutenu son grand esprit et son vif tour de main par l’étude, il aurait surpassé tout le monde. […] Pour donner à quelque figure une belle et digne forme, les Grecs de l’Antiquité utilisaient de nombreuses figures belles et vivantes. C’est ce que l’on raconte de Zeuxis qui, lorsqu’il dut faire pour les habitants d’Agrigente la grande Junon pour un sacrifice en leur temple, situé à Lacinium, en Calabre (aujourd’hui appelé Capo di Colomni), vit tout d’abord toutes les filles de la ville nues, n’en choisit que cinq, les plus belles de port, et qu’il rechercha les plus belles parties de celles-ci afin de perfectionner son œuvre. Non seulement ces filles ne furent pas considérées honteusement pour cela, mais on leur offrit même des vers de louange. Je vous laisse le soin de savoir si cela serait souhaitable chez nous.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de Persooneele kennis; of d’eerste waerneming in de daedt van een geschiedenis » (numéro III, 7) , p. 101 (n)
Zeuxis schilderde Helena, als of hyze in Ilium zelfs gezien hadde.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Première observation concernant l’action de l’histoire : la connaissance des personnages » (numéro III, 7) , p. 204 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Zeuxis peignit Hélène comme s’il l’avait lui-même vue à Ilion.
Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, III, 7, « Première observation concernant l’action de l’histoire : la connaissance des personnages », p. 204
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de gebreeken en de leelijkheyt » (numéro II, 10) , p. 64-65 (n)
- [1] Geen vrouwbeelt daer niet op te zeggen valt
En zoo zalmen, in’t vermijden der gebreeken, de schoonheit vinden. De gebreeken zijn gemeen, maer de schoonheit is raer, en laet zich van niemant kennen, als van dieze navorscht. De Heer de la Serre, door H. Dullaert verduist, gevalt my wel, daer hy in zijn Onderhout der goede geesten aldus redevoert: Laet ons alleen van de wercken der natuer spreecken, zy heeft noyt maegt, [1] buiten de geene, die Godt als eerste wieg, waer in hy rusten wilde, begenadigde, voortgebracht, daer niets op te zeggen viel. Daer uyt sproot dit, dat die groote schilder, die van voornemen was om de schoone Heleene na zijn verbeelding uit te beelden, de schoonste dochteren uit de stad verkoor: op dat zijn penseel, uit zoo groot een getal van schoone aengezichten, van elks iet ontleenende, maer een eenige volmaektheyd zoude te samen brengen. Het welk ons d’onmacht van de natuer openbaert, in een schoonheyd zonder gebreck te vormen. Ik heb noch noit vrouwe zoo schoon gezien, datze aen al de werelt zouw behaegt hebben.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Des défauts et de la laideur » (numéro I, 10) , p. 152 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
C’est ainsi qu’il faut trouver la beauté : en évitant les défauts. Les défauts sont communs. Mais la beauté est rare et ne se fait connaître que de ceux qui la recherchent. Ce que dit Monsieur Puget de la Serre, traduit en néerlandais par Heijmen Dullaert, convient bien à mon propos. Voilà ce qu’il affirme dans son Entretien des bons esprits : parlons seulement des œuvres de la nature. Elle n’a jamais fait de jeune femme dont il n’y ait rien à redire, en-dehors de celle dont Dieu lui fit grâce comme dans le premier berceau où il voulut se reposer. D’où il s’ensuivit que le grand peintre qui eut l’intention de représenter la belle Hélène d’après son imagination choisit les plus belles filles de la cité afin qu’en empruntant quelque chose d’un si grand nombre de beaux visages, son pinceau en recueillît cependant quelque perfection. Ceci nous montre l’impuissance de la nature à former une beauté sans défaut. Jamais encore je n’ai vu femme si belle qu’elle plût au monde entier.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de dryderley graden der konst » (numéro III, 3) , p. 78 (n)
- [1] Zeuxis schilderde gaerne een vremde of kluchtige verziering
[1] Zeuxis Schilderde ongaren gemeene Historien, ’t zy van oorlogen, of de daden der helden of goden, maer zocht altijts eenige geestige verzieringe, ’t zy in’t Zeuxis uitbeelden van eenige driften en hartstochten, als in zijn Penelope de kuische eerbaerheit, in zijn Jupiter de Majesteit, in zijn worstelaers den yver tot winnen, in zijn Slangeworgenden Herkules den schrik van Alkmena en Amfitrion, in zijn Agrigentsche Juno, daer hy al de dochteren der Stadt om naekt zagh, de volkomenste schoonheit, in zijn Helene de Poëtische drift van Homerus, in zijn Centauren de wonderlijke vereenigingen van half mensch, half dier. En eyndelijk in zijn oude Bestemoer zijn wonderlijken aert, want hy lachte zich zelven te berste.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Des trois degrés de l’art » (numéro III, 3) , p. 176-177 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Mais Zeuxis n’aimait pas peindre des histoires ordinaires, même lorsqu’il s’agissait de guerres ou d’actions héroïques et divines. Il cherchait toujours à concevoir de spirituelles inventions et à exprimer des émotions ou des passions : l’honneur chaste dans sa Pénélope, la majesté dans son Jupiter, l’envie de vaincre dans ses Lutteurs, la peur d’Alcmène et d’Amphitryon dans son Hercule étranglant le serpent, la plus parfaite beauté dans sa Junon d’Agrigente, pour laquelle il vit nues toutes les filles de la cité, l’inspiration poétique d’Homère dans son Hélène, la merveilleuse réunion des moitiés humaine et animale dans ses Centaures, ou le merveilleux caractère de sa Vieille femme, dont il rit lui-même aux éclats.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 3(publi: 1679) (Cinquième Entretien), p. 3 (fran)
C’estoit sans doute, luy dis-je en soûriant, une beauté semblable à cette Inconnuë dont parle Lucien, qui seule possedoit non seulement tout ce qu’il y a de plus excellent dans les statuës et les peintures des Anciens, mais encore ce que les poëtes ont jamais attribué de plus charmant à leurs Divinitez.
Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 127 (fran)
On dit que son chef d’œuvre fut le portrait d’une Hélene, dont l’Orateur romain a pris plaisir de décrire l’excellence sous les plus riches termes de sa rhétorique dans le commencement de son second livre De inventione. On dit qu’il tira cette rare piece, qui fut estimée le miracle de la peinture, sur cinq des plus belles filles de la ville de Crotone, qu’il choisit sur un plus grand nombre que ces peuples lui avoient présentées à ce dessein, prenant de chacune ce qu’il y trouva de plus charmant pour le donner à son Hélene, qu’il trouva ensuite si belle et si accomplie, qu’il mit au-dessous de ce distique.
Haud turpe est Teucros, fulgentesque aere Pelasgos,
Conjuge pro tali diuturnos ferre labores.
Baldinucci, Filippo, Vita di Gian Lorenzo Bernini(publi: 1682), p. 69-70 (italien)
Voleva, che i suoi scolari s’innamorassero del più bello della Natura, consistendo, come’ei diceva, tutto il punto dell’arte in saperlo conoscere, e trovare ; onde non ammetteva il concetto di quei tali, che affermarono, che Michelagnolo e gli antichissimi maestri greci, e romani avessero, nell’opere loro, aggiunto una certa grazia, che nel naturale non si vede ; perché diceva egli, che la Natura sa dare a’ suoi parti tutto il bello, che loro abbisogna, ma che il fatto sta in saperlo conoscere all’occasione ; e in tal proposito era solito raccontare, che nello studiare la Venere de’ Medici, osservando il graziosissimo gesto, ch’ella fa, s’era una volta anch’egli lasciato portare da simil credenza : ma nel far poi grandissimi studi sopra il naturale, aveva tal grazia di gesto in varie occasioni molto chiaramente osservato. Teneva per favola ciò, che si racconta della Venere Crotoniate, cioè che Zeusi la ricavasse dal più bello di diverse fanciulle, togliendo da chi una parte e da chi un’altra ; perché diceva egli che un bell’occhio d’una femmina non istà bene sopra un bel viso d’un altra, così una bella bocca e vadasi discorrendo ; cosa che io direi esser verissima, perché le parti non son belle solamente per se stesse, ma anche in riguardo dell’altre parti ; in quella guisa, che un bel fusto d’una colonna si loda per la proporzione, ch’egli ha in se medesimo, ma se a questo si aggiungnerà una bella base, un bel capitello non soui, tutta la colonna insieme perderà sua bellezza.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685) (t. V), p. 200-201 (latin)
Alioqui tantus diligentia, [1]ut Agragantinis facturus tabulam, quam in templo Junonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset pictura redderet.
- [1] Vt Agragantinis. Qui tabulam faciendam locarant, quam in templo Junonis Laciniae, quod prope Crotonem in Italia fuit, ex voto facto dedicarent. Simile Zeuxidis factum refert et Cicero, lib. 2. de Invent. num. 1. cum vellent Crotoniatae templum illud ipsum Junonis egregiis picturis locupletare : atque ita ex selectis quinque virginibus Helenam finxisse tum dicitur. Quamnam Agrigentinis picturam expresserit, non constat. De Junonis Laciniae ara, lib. 2. sect. CXI. pag. 258.
Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685), p. 11-12 (anglais)
Though Nature be the rule, yet Art has the priviledge of perfecting it; for you must know that there are few objects made naturally so entirely beautiful as they might be, no one man or woman possesses all the advantages of feature, proportion and colour due to each sense. Therefore the antients, when they had any great work to do, upon which they would value themselves did use to take several of the beautifullest objects they designed to paint, and out of each of them, draw what was most perfect to make up one exquisite figure; thus Zeuxis being imployed by the inhabitants of Crotona, a city of Calabria, to make for their temple of Juno, a female figure, naked; he desired the liberty of seeing their handsomest virgins, out of whom he chose five, from whose several excellencies he fram’d a most perfect both in features, shape and colouring, calling it Helena. At last in the time of Alexander the great, all the artists, both painters and sculptors, met and considered how to give such infallible rules to their art, as no artist should be able to depart from them without erring; and to that end having examined all the beauties of nature, and how each part of a human body ought to be, to make one accomplished model for posterity to govern themselves by: a statue was made according to those rules by Polycletus, a famous sculptor of that age; and it proved so admirable in all its parts, that it was called, the Rule, and all those that wrought afterwards, imitated as near as they could the proportions of that figure and the graces of it, as believing it was impossible fort art to go beyond it.
[Callières, François de], Histoire poëtique de la guerre nouvellement déclarée entre les Anciens et les Modernes(publi: 1688) (livre onzième), p. 250 (fran)
Ce n’est pas sur un si petit essay, ajoûta Zeuxis, qu’on doit juger de nôtre merite, c’est sur mon Helene qui renfermoit en elle toutes les beautez de cinq des plus belles personnes de la Grece.
Junius, Franciscus, De pictura veterum, liber I(publi: 1694, trad: 1996) (I, 1, 3), p. 3-4 (latin)
Magnum quidem est animatarum inanimatarumque rerum vivas quasdam imagines animo capere, majus tamen, earundem imaginum indiscretam similitudinem exhibere, praesertim, si non satis habeat artifex inhaerere singularium naturae operum similitudini, sed potius ex diligenti speciosissimorum corporum inspexione perfectum aliquod exemplar animo inscribat, atque ad hoc, tanquam ad emendatissimum Polycleti canonem, conspicuae pulchritudinis imagines describat. [...] Sciebat Zeuxis nihil in simplici genere omni ex parte perfectum esse polivisse naturam : vide Tullium, in ipso statim lib. II de Inventione. Aliud enim alii commodi aliquo adjuncto incommodo muneratur, tanquam non sit habitura quod caeteris largiatur, si uni cuncta concesserit. Relicturus itaque Crotoniatis excellentem muliebris formae pulchritudinem, non putavit in uno corpore omnem luculentae venustatis gratiam quaerendam ; sed quinque virgines formosissimas delegit, ut mutum in simulachrum ex animali exemplo veritatem transferret : τὸν τῶν ἄλλων κρείττον ἀπανθίζων : optima quaeque ex aliis decerpens, ut loquitur Dionys. Halicarnass. ; καὶ ἐκεῖνο τὸ ἀκρότατον ζητῶν κάλλος, ὅπερ ἀνάγκη ἓν εἶναι atque excellentissimam illam pulchritudinem quaerens, quam necesse est unicam esse, ut loquar cum Luciano in Hermonimo. Liquet ergo verissimum esse illud Socratis ad Parrhasium : Ἐπειδὴ οὐ ῥᾴδιον ἑνὶ ἀνθρώπῳ περιτυχεῖν ἄμεμπτα πάντα ἔχοντι, ἐκ πολλῶν συναγόντες τὰ ἐξ ἑκάστου κάλλιστα, οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ ποιεῖτε φαίνεσθαι : Quando non facile est unum hominem nancisci, in quo reprehensionis omnia sint expertia, de multis colligentes ea quae in singulis pulcherrima sunt, ita scilicet tota corpora ut pulchra videantur efficitis, Xenoph. lib. III Apomnem.
Junius, Franciscus, De pictura veterum, liber I, (trad: 1996), p. 134-140 (trad: "La Peinture des Anciens, livre I" par Nativel, Colette en 1996)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
C’est une grande chose sans doute de saisir vivantes dans son esprit certaines images d’objets animés ou inanimés, mais c’en est une plus grande encore de produire une réplique indiscernable de ces mêmes images, surtout si l’artiste, non content de s’attacher à reproduire fidèlement des œuvres singulières de la nature, imprime plutôt dans son esprit, après avoir attentivement examiné les corps les plus beaux, un modèle parfait et, en s’y conformant comme au canon absolument sans défauts de Polyclète, trace des images d’une beauté sensible. [...] Zeuxis savait que la nature n’a rien façonné de parfait en tout point dans un seul genre : voyez Cicéron, dès le début du livre II de De l’invention. En effet, elle gratifie chacun d’un avantage différent, mais en y associant un inconvénient, comme si, en prodiguant tous ses présents à un seul, elle risquait de ne plus avoir de quoi faire largesse aux autres. C’est pourquoi, devant laisser aux Crotoniates la beauté accomplie de la forme féminine, il ne pensa pas qu’il lui fallait chercher dans un seul corps toute la grâce d’un charme brillant, mais il choisit les cinq jeunes filles les plus belles afin de faire passer dans une image muette la vérité prise à un modèle vivant, « cueillant ce que chacune avait d’excellent », comme dit Denys d’Halicarnasse, « et recherchant cette éminente beauté qui est nécessairement unique », pour reprendre les mots de Lucien dans Hermotime. Il apparaît donc que cette remarque de Socrate à Parrhasios est parfaitement juste : « Puisqu’il n’est pas aisé de trouver un seul homme dans lequel tout soit irréprochable, vous réunissez, en les prenant à plusieurs, les parties les plus belles en chacun et vous faites en sorte que les corps dans leur ensemble paraissent beaux. »
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (I, 5, 2)(latin)
- [1] plastae certe atque ii qui coloribus utuntur
[1] in singulis corporibus praestantissimas quasque verae pulchritudinis notas observant, easque in unum aliquod opus conferunt, ut non tam didicisse a natura, quam cum ea certasse, aut potius illi legem dedisse videantur.
Junius, Franciscus, De pictura veterum, liber I, (trad: 1996) (I, 5, 2)(trad: "La Peinture des Anciens, livre I" par Nativel, Colette en 1996)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Dans chaque corps, les sculpteurs et ceux qui utilisent la couleur observent les marques les plus éminentes de la vraie beauté et les réunissent dans une seule oeuvre, si bien qu’ils semblent moins avoir appris de la nature que rivaliser avec elle ou, plutôt, lui avoir donné une loi.
Commentaires : page?
Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique(publi: 1697), art. « Zeuxis », p. 1277-1278 (fran)
On ne sauroit dire si cette Hélène de Zeuxis [Explication : "la courtisane"] étoit la même qui étoit à Rome du temps de Pline, ou la même qu’il fit aux habitans de Crotone, pour être mise au Temple de Junon. Il ne sera pas hors de propos de dire ici ce que Zeuxis exigea de ceux de Crotone, par raport à ce portrait. Ils l’avoient fait venir à force d’argent, pour avoir un grand nombre de tableaux de sa façon, dont ils vouloient orner ce temple ; et lorsqu’il leur eut déclaré qu’il avait dessein de peindre Hélène (D), ils en furent fort contens, parce qu’ils savoient que son fort était de peindre des femmes. Ensuite il leur demanda quelles belles filles il y avoit dans leur ville, et ils le menerent au lieu où les jeunes garçons aprenoient leurs exercices. Il vit le plus commodément du monde s’ils étoient beaux, et bien faits partout ; car ils étoient nuds : et comme il en parut très content, on lui fit entendre qu’il pouvoit juger par là s’il y avait de belles filles dans la ville, puisqu’on avoit les sœurs des garçons qui lui paraissoient les plus admirables. Alors il demanda à voir les plus belles, et le Conseil de ville ayant ordonné que toutes les filles vinssent en un même lieu, afin que Zeuxis choisit celles qu’il voudroit : il en choisit cinq, et prenant de chacune ce qu’elle avoit de plus beau, il en forma le portrait d’Helene. Ces cinq filles furent fort loüées par les poëtes, de ce que leur beauté avoit obtenu le suffrage de l’homme du monde qui s’y devoit connoître le mieux (E), et leur nom ne manqua point d’être consacré à la posterité. Je pense pourtant qu’il n’en reste plus aucune trace. Ciceron qui nous aprend toutes ces choses, a laissé à deviner à son lecteur que le peintre voulut voir toutes nuës ces cinq jeunes beautez : mais Pline l’a dit expressément ; et même qu’avant que d’en choisir cinq, il les avait vuës toutes en cet état. Il est vrai qu’il veut que Zeuxis ait travaillé pour les Agrigentins, et non pas pour les Crotoniates, et qu’il ne dit point de qui étoit le portrait : à cela près on voit qu’il rapporte la même histoire que Ciceron.
(D) N’avoir dit autre chose sur le portrait d’Hélène, si ce n’est que Zeuxis le fit, est un peché d’omission inexcusable à Charles Etienne, et à Mrs Lloyd, Moreri, et Hofman, veu les singularitez de plusieurs sortes que les Anciens ont raportées touchant ce portrait. Charles Etienne n’a cité que Pline, qui n’en a parlé qu’en passant ; il faloit citer Ciceron et Élien, qui en ont touché les circonstances. Mrs Lloyd et Hofman ne citent à proprement parler que comme Charles Etienne : car encore qu’ils nous renvoyent à Ciceron, il est visible que c’est par raport à Zeuxis en general, et non par raport au portrait d’Helene ; cela, dis-je, est visible, puisqu’ils nous renvoyerent aussi à Plutarque dans la vie de Pericles, où il ne s’agit point du tout de ce portrait. Par la faute des imprimeurs on voit Ciceron cité dans le Dictionnaire de Mr. Lloyd, 2. De Juvent. Et dans celui de Mr. Hofman, libr. 2. de Juventut. au lieu de lib. 2 de Invent. ce qui est capable de faire acroire à plusieurs lecteurs que Ciceron a écrit de Juventute, non moins que de Senectute. Vossius[1] a relevé une faute de Boulenger, qui a dit dans son livre de la Peinture, que ce fut Venus et non Helene que Zeuxis peignit, sur les cinq originaux vivans qu’il avoit devant ses yeux : mais en relevant cette faute Vossius en a fait une autre, ayant assûré que Pline ne marque pas moins expressément que Ciceron, que Zeuxis peignit Helene. Il n’est pas vrai que Pline marque cela ; il parle en general d’un portrait. Notez que Celius Rhodiginus a fait un gros solécisme, en[2] parlant du tableau d’Helene la courtisane. Zeuxis, dit-il, pictura nobilem, inter caetera ejus artificii, haud parum multa qua circumferuntur, et hominum desideria vix explent, Helenam quandoque ab eo expictam ferunt, cui tantum sane attribuerit, ut non temere nec quemlibet, ac (ut Graeci dicunt), ὡς ἔτυχε, spectatum admitteret, ni ῥητὸν ἀργύριον, id est propositam pecunia quantitatem erogasset. Il est échapé de semblables fautes de langage aux meilleurs auteurs.
(E) On pourroit douter si les cinq filles que Zeuxis choisit, étoient chacune plus belle que celles qu’il ne choisit point. La raison de ce doute est qu’il ne voulut que rassembler en un corps les beautez qui se trouvoient separément dans ces cinq filles : pour cela il n’étoit pas besoin qu’elles fussent toutes fort belles : il suffisoit que les unes eussent les beautez qui manquoient aux autres. Or qui peut nier qu’il n’y ait des femmes d’une beauté fort mediocre, qui à ne comparer que quelque partie à quelque partie surpassent les grandes beautez. Ainsi on ne voit pas que Ciceron, ni les poëtes dont il parle, aient été nécessairement bien fondés, à preferer les cinq filles de Crotone choisies par le peintre d’Hélène, à celles qu’il renvoya. Peut-être en renvoya-t-il ausquelles il ne manquoit que peu de chose, pour être parfaitement belles ; mais qui ne servoient de rien à son but, parce que les mêmes beautez dont elles étoient pourvuës, se trouvoient en un degré plus exquis dans l’une des cinq ; après quoi il suffisoit qu’une autre des cinq, mediocrement jolie d’ailleurs, eût ce peu de chose qui manquoit à celles qu’il renvoya. La question, comme chacun voit, n’est pas importante, on peut la laisser là pour ce qu’elle vaut ; et si l’on veut mettre en fait que Zeuxis choisit les cinq plus belles, non pas à cause que cela étoit necessaire à son entreprise, mais afin de jouir d’un spectacle plus divertissant, je ne m’y opposerai pas. Un des principaux fondemens de l’historiette a été ce qu’on dit ordinairement, qu’il n’y a rien de parfait en ce monde. Cela est surtout veritable en matière de beauté : je m’en raporte à la critique que les belles femmes sont les unes des autres ; et si ne voyent-elles pas tout, comme Zeuxis voulut faire, resolu sans doute de ne suivre pas la méthode dont Horace parle, dans la I. Satire du 2.livre :
[3]Ne corporis optima lynceis
Contemplere oculis, Hypsea caecior, illa
Quae mala sunt spectes. O crus ! o bracchia ! verum
Depygis, nasuta, brevi latere ac pede longo est.
Au fond le peintre n’avoit besoin que de[4] son imagination pour faire le portrait d’une beauté achevée ; car il est certain que nos idées vont plus loin que la nature. Il ne seroit pas plus impossible de trouver des hommes aussi parfaits que les héros de roman, que de trouver des femmes aussi belles que les heroïnes du même pays. Cela est si vrai, que quand les auteurs veulent représenter en peu de mots une personne parfaitement belle, ils se contentent de dire qu’elle surpasse les idées des poëtes et celles des peintres.
(L). […] Je dirai seulement qu’elles[Explication : les remarques de Dati sur la vie de Zeuxis.] m’ont appris une chose que Vossius ne savait pas, c’est que Boulenger n’est pas le premier qui a dit que Zeuxis peignit Vénus, et non pas Helene, sur les originaux vivants qu’il avoit choisis parmi les plus belles filles de la ville. Volaterran et Jean de la Cassa avaient déjà pris en cela l’un pour l’autre : Lipse qui plus est a dit quelque part[5] que ce fut Junon que Zeuxis peignit, et non pas Helene. Je dirai en passant que Carlo Dati a fait un procès à Pline, qu’il n’a point soutenu de bonnes raisons. Il croit qu’à cause que le temple de Junon Lacinia étoit auprès de Crotone dans la Calabre, les Agrigentins n’ont point fait faire à Zeuxis un tableau qui dût être consacré dans ce temple. Mais le temple de Delphes, et celui de Jupiter Olympien, n’étoient-ils pas remplis des dons de toutes sortes de peuples ; comme aujourd’hui Nôtre-Dame de Lorette des ex voto des païs catholiques ? Quand je publiai ce qu’on vient de dire, je ne savois pas que le Tassoni est tombé dans la même faute que Juste Lipse. Questi fu colui, dit-il[6] en parlant de Zeuxis, che chiamato da gli Agrigentini, o come hanno altri voluto da i [7]Protoniati, a fare il ritratto di Giunone, il copiò dalle fattezze più belle di cinque vergine da loro elette fra un numero infinito, che ne vide d’ignude. La langue italienne n’est guere moins exposée aux équivoques que les langues mortes : si un Français donnoit à ses termes l’arrangement que l’on vient de voir dans ceux du Tassoni, on lui attribueroit avec raison d’avoir dit que Zeuxis vit nuës une infinité de filles, et que les Agrigentins en choisirent cinq sur ce grand nombre qui servirent de patron au peintre. Ce n’est point ainsi qu’il faut raporter les circonstances de ce tableau.
- [1] De graphice pag. 69 in libro de 4. artib. popular.
- [2] Celius Rhodiginus antiq. lect. lib. 19 cap. 27 pag. m. 1086.
- [3] Voici comment Robert et Antoine Le Chevalier d’Agneaux, nâtifs de vire en Normandie ont traduit ces vers. Rien de plus naïf.
Tout ainsi ce qu’en soi le corps a de plus beau,
D’yeux lyncéens ne voy Regarde plus qu’Hypsée aveugle les parties
Qui plus laides y sont. Ebahi tu t’écries
O la greve, ô les bras, mais long nez et courts flancs,
Et grêle cuisse elle a avecques les pieds grans.
- [4] Ego sic statuo nihil esse in ullo genere tam pulchrum quo non pulchrius id sit unde illud ut ex ore aliquo quasi imago exprimatur, quod neque oculis, neque auribus, neque ullo sensu percipi potest, cogitatione tantum et mente complectimur… Nec vero ille artifex (Phidias) cum faceret Iovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quaedam, quam intues, in eaque defixus, ad illius similitudinem artem et manum dirigebat (Cicéron, in Oratore, init.).
- [5] Monit. Polit. L. 1 c. 1.
- [6] Alessandro Tassoni, Pensieri diversi liv. 1. cap. 19. pag. 414.
- [7] C’est sans doute une faute d’impression pour Crotoniati.
Rosignoli, Carlo Gregorio, La Pittura in giudicio overo il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene(publi: 1697), « Le colpevoli discolpe de’ pittori immodesti », §2, « Altre scuse inescusabili de’ medesimi » (numéro cap. III) , p. 45-46 (italien)
Altri abbagliati dello splendor dell’oro, e pervertiti dal fascino dell’interesse, non giudicano biasimevole ciò che riesce loro di guadagno : [1]Nec quicquam videtur turpe ; quod est quæstuosum. Dicono che le pitture ignude e lusinghiere sono ricercate con maggior prezzo, e compre a peso d’oro. L’Elena di Zeusi essersi più volte venduta cento talenti. I due famosi quadri di Danae, e d’Adone essersi pagati migliaia di doppie.
- [1] Plin. in Præf.
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 112 (fran)
Les Agrigentins luy ayant demandé le tableau d’une Helene nuë pour mettre dans leur temple, ils lui envoyérent en même tems, ainsi qu’il l’avoit demandé, plusieurs des plus belles filles de leur païs. Il en retint cinq, et aprés les avoir considérées, il se fit une idée de leurs plus belles parties pour en composer le corps qu’il avoit à réprésenter. Il le peignit d’aprés elles ; et cette figure, qu’il acheva avec tant de soin, luy parût si parfaite, qu’il ne feignit point de dire des peintres qui venoient l’admirer, qu’ils pouvoient bien la louër, mais non pas l’imiter.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “En que se concluyen las partes integrales de la pintura”, §7 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 9) , vol. 1, p. 176-177 (espagnol)
Y así, aquellos diligentísimos griegos, no de una sola figura hacían estudio, para el desempeño del arte; eligiendo de muchas las mejores, y de las mejores formando una sola, que siendo semejante a todas, venía a ser a ninguna semejante. Tal fué aquella celebrada Juno del eminente Zeuxis, para los agrigentinos, en la cual, habiendo visto desnudas sus doncellas, y eligido cinco las más perfectas, tomando de cada una lo más acertado, formó aquella eminentísima tabla de la diosa, que se colocó en su templo de Juno Lacinia; siendo ejemplo tan repetido de los oradores, y decantado de los poetas; cuanto debe ser huído de los artífices católicos; pues menor inconveniente es declinar algo de la eminencia del arte, que peligrar en la corrupción del espíritu; que no es tan poderoso el embeleso de la pintura, que baste a defraudarle su ejecutoriado imperio a la Naturaleza. Para esto, a diligencia de nuestros mayores nos ha proveído de bellísimas estatuas, y modelos, donde se debe estudiar lo más perfecto, y elegante de la simetría de la mujer, sin buscarlo tan a costa de nuestra ruina: pero donde no interviniere este inconveniente, se debe seguir este ejemplo, procurando ver, y contemplar el natural, con la subordinación, y respeto a las elocuentes estatuas de los griegos, tan veneradas en Roma, y traducidas a nuestra Españapor el singular poder del señor Rey Felipe Cuarto, a diligencia de Don Diego Velázquez, su Pintor de cámara.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Propiedades accidentales de la pintura” (numéro Tomo I, Teórica della pintura, II, 8, §4) , vol. 1, p. 321 (espagnol)
Y aún lo acreditó más el gran Lisipo (como ya dijimos) que eligiendo siempre de ella lo mejor decía, que las estatuas de los otros, eran como eran los hombres; pero las suyas, como los hombres debían ser: porque la Naturaleza produce lo perfecto en toda la especie; pero no en todo individuo, por los varios accidentes, e influjos, que alteran la formación de la prole; y porque, parece, le faltarían perfecciones para otros, si todas las concediese a uno: y así, no es perfecta una mujer, en quien una, y otra parte se celebra; sino aquella, en quien ninguna carece de perfección; pero la discreción del artífice está, en saber conocerlas y discernirlas. Bien lo practicó así el eminente Zeuxis en la hermosa Juno (que otros quieren fuese Helena, otros Alcmena) que pintó para los agrigentinos; (como notamos, lib. I, cap. 9) pues habiendo elegido cinco doncellas, entre las más perfectas de Grecia, de todas cinco formó una sola, que siendo igual en perfección a todas, era superior a cada una; pues sólo tomaba lo que en cada una halló más peregrino. Y así, el mayor elogio de una hermosura, es decir, que es como una imagen; porque ninguna llega a tanta perfección, cuanta en la imagen se examina.
Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 53; 241-244 (fran)
- [1] D’autres disent que ce fut à Crotone, et rapportent cette histoire d’une maniere plus circonstanciée. Quoi qu’il en soit, en voilà l’essentiel : il croyoit qu’il faloit consulter la Nature, et aller la perfection par le choix des plus belles choses, qu’Elle nous présente
Quoique d’ailleurs il[Explication : Zeuxis.] fut si sévère sur les mesures et sur la beauté de chaque partie, qu’ayant à travailler à une Hélène, destinée au temple de Junon de Lacinie, par les Agragantins, il se fit amener l’élite de leurs jeunes filles, et après les avoir considerées à la manière de ce tems-là, il en choisit cinq des plus belles, pour copier ce qu’elles avoient d’éxcellent et en composer ensuite un original accompli. [1].
Note au texte latin, p. 241
(H). Ut Agragantis facturus tabulam, quam in templo Junonis Laciniae publice dicarent. Voici un éxemple du peu d’éxactitude des anciens auteurs. Denys d’Halicarnasse dit simplement, que le peintre Zeuxis travaillant à une Helene sans drapperie, ceux de Crotone, qui estimoient beaucoup son pinceau, lui envoyerent les plus belles filles qu’ils purent trouver chez eux, afin que les ayant bien considérées, il fit passer dans son tableau les traits qui l’auroient le plus frappé : et en effet, ayant rassemblé ce qu’il trouva en elles de plus avantageux, il en composa dans sa tête une beauté accomplie. Ciceron raconte la chose plus en détail : « Dans le tems que ceux de Crotone, dit-il, étoient dans l’opulence et qu’ils passoient pour le peuple de l’Italie le plus heûreux, ils formerent le dessein d’enrichir de belles peintures le temple de Junon Lacinienne, qui est au dessous de leur ville, et pour lequel ils ont toûjours eû beaucoup de dévotion. Ils firent donc venir à grands fraix le peintre Zeuxis, qui avoit alors la réputation de primer entre tous ceux de son art. C’est le même qui a fait plusieurs tableaux, qui ont été conservez dans ce temple jusqu’à présent, par le grand respect qu’on a gardé pour ce sainct lieu. Il leur dit donc, que pour leur laisser le modelle d’une beauté éxcellente à tous égards, il avoit dessein de faire pour eux une Helene. Ceux-ci, qui n’ignoroient pas qu’il triomphoit principalement sur les figures de femme, reçurent la proposition avec d’autant plus de joye, qu’ils se persuaderent que s’il vouloit bien s’appliquer de son mieux dans le genre où il étoit superieur à tous les autres, il ne manqueroit pas de leur donner un chef-d’œuvre, digne du temple à la gloire duquel ils s’intéressoient. Aussi ne furent-ils pas trompez. Zeuxis leur demanda où étoient leurs plus belles filles ? Venez, lui dirent-ils, et en même tems ils le menerent à l’Academie où la jeunesse de Crotone étoit occupée à apprendre ses éxercices ; composée d’un grand nombre de garçons, tous d’une proportion et d’une dignité singuliere. Car il faut savoir que les Crotoniates étoient célébres pour la taille et pour la vigueur, et que plusieurs d’entreux ont remporté de très-belles victoires dans ces sortes de jeux où il faut combattre tout nud. Comme le peintre admiroit à son aise la beauté et la prestance de ces corps, qu’il voyoit à découvert et qu’il ne se lassoit point d’en faire l’éloge ; Courage, Nous avons les sœurs de ces beaux garçons ; lui dirent-ils, et vous pouvez juger des unes par les autres. Hé bien ! dit le peintre, faites m’en voir quelques unes des plus belles, pour en composer cette Helene que je vous ai promise ; car il n’est pas possible d’inspirer quelque vie et quelque vérité à un tableau muet, qu’on ne le tire de la nature même. Aussitôt les Crotoniates s’assemblerent, et, par un decret public, ils firent venir en un même lieu toutes leurs filles, en accordant au peintre la liberté de choisir, pour son dessein, celles qu’il trouveroit à propos. Il en choisit cinq, dont les poëtes ont conservé le nom à la posterité, comme ayant été jugées les plus accomplies en beauté par l’homme du monde qui s’y connoissoit le mieux. C’est ainsi que ce grand homme ne crut pas pouvoir trouver, en un seul corps, tout ce qu’il cherchoit pour former une beauté parfaite ; parce que la Nature ordinairement ne finit point son ouvrage dans un individu, et que, de peur que donnant tout à l’un, elle n’eut rien à donner aux autres, elle aime mieux compenser en tous les imperfections, qu’elle leur laisse, par les bons endroits qu’elle leur accorde. » DE INVENT. Lib. 2 c. 1. Il reste à savoir si c’est là la même histoire, que celle de notre Pline. Le P. H. ne le croit pas, parce qu’il s’agit ici des Agragantins, peuple de Sicile, et que le nom du tableau n’est pas marqué. Cependant il y a apparence que c’est le même fait. I. Il s’agit du même peintre. 2. Du même temple. 3. De l’examen d’un grand nombre de vierges. 4. De cinq entr’autres qui furent choisies. 5. D’une beauté parfaite, telle qu’on suppose avoir été Helene. 6. Et enfin Ciceron et Denys d’Halicarnasse s’accordent pour l’essentiel, au sujet d’Helene et de Crotone. M. Félibien, qui n’est pas fort éxact dans ce qu’il rapporte de l’histoire ancienne, parle ainsi de cette Helene : Et cette admirable figure, dit-il, qu’il peignit pour ceux de Crotone, en laquelle il fit paroître ce qu’il y avoit de plus parfait dans les plus belles filles de la Grèce. Ne diroit-on pas, à l’entendre, qu’on fit venir en Italie toutes les plus belles filles du Péloponnèse et des îles adjaçantes, pour fournir au peintre de quoi choisir ? Si cela est, il faut avoûer qu’il eut bien à faire, et que jamais spectacle ne fut plus magnifique.
Notes au texte latin, p. 244 :
(U) Romae Helena est in Philippi porticibus. Dans la 9 région de Rome, il y avoit plusieurs portiques […] À l’égard de cette Helene de Zeuxis, consacrée dans ce portique, on ne sçait pas bien laquelle c’est : car l’histoire parle de plusieurs. 1. Il en fit une pour les Agragantins, ou du moins pour ceux de Crotone, destinée au temple de Junon de Laciniae. 2. Eustathe nous parle d’une autre qui étoit à Athène. Stobée nous raconte, apparemment de la même, qu’un ignorant ne l’ayant pas trouvée belle, le peintre Nicomaque le releva aussitôt en lui repliquant, prenez mes yeux et vous la trouverez déesse. Elien fait aussi mention de la même ; qui étant admirée par le peintre Nicostrate (lisez Nicomaque) et quelqu’un lui demandant d’où lui venoit ces éxtases ? Vous ne me feriez pas cette question, dit-il, si vous aviez mes yeux : tant il est vrai, que, comme pour juger d’un beau poëme, ou d’une belle harangue, il faut avoir l’oreille bonne ; de même pour se connoître aux ouvrages de l’art, il faut avoir de bons yeux. Enfin le même auteur nous parle aussi d’une Helene du même Zeuxis, qui ne lui fait pas beaucoup d’honneur. C’est qu’il ne la faisoit voir à personne que pour de l’argent, et encore faloit-il payer d’avance, comme lorsqu’on va voir une rareté. Les Grecs, qui étoient de grands railleurs, badinerent beaucoup là-dessus, et donnerent à ce tableau le nom d’Helene la courtisane, qui se faisoit payer tant par visite. Je ne doute pas qu’un habile peintre, qui auroit travaillé à un chef-d’œuvre pendant quelques années, n’en pût tirer beaucoup d’argent. Si le peintre de Hambourg, qui a fait voir ici une tête de femme, à quiconque a voulu, avoit mis une taxe à la curiosité publique, il eut pû amasser une somme considérable. Car une infinité de monde y a couru, et avec raison. Il auroit pû faire la même chose à Paris, à La Haye, à Amsterdam et par toute l’Europe et s’en retourner fort riche dns son païs. Il n’est donc pas étonnant que Zeuxis, dans un siécle où la peinture n’étoit pas encore un art libéral, ait pris de l’argent de toute la Grèce, pour montrer une Helène, qui étoit peut-être la copie de celle de Crotone.
Turnbull, George, A Treatise on Ancient Painting(publi: 1740), p. 32 (anglais)
We are told by the best philosophers what ought to be the scope and study of those who would arrive at perfection in the designing arts; and what really was the aim and pursuit of the Ancients whose works were so perfect. For thus Socrates accosts Parrhasius in the Conference between them recorded by Xenophon: When you painters would represent some perfect form, do you not collect from many objects those beauties, which, when skilfully combined together, make a most beautiful whole[1]? Maximus Tyrius speaking of the ancient sculptors and statuaries, says[2], “They chose with admirable discernement and taste, the most beautiful parts out of many bodies, and of these scattered excellencies made one perfect piece: but this mixture and combination is done with so much judgment and propriety, that they seem to have taken but one model of consummate beauty for their imitation. For Art ought thus to aim at somewhat more perfect than Nature, which yet shall appear natural; and therefore let us not imagine that we can ever find one natural beauty that can dispute with the statues of the great masters.” In fine, how the ancient painters attained to that exquisite Idea of Beauty, Simplicity and Greatness, in which the excellence of their works consisted, is finely represented to us by Cicero, in order to shew how a notion of perfect eloquence must be in like manner formed, by setting to view a Zeuxis chusing from many beautiful women, the several graces and charms, that being put together with judgment and taste, composed his famous Helen, that most compleat form and standard of female beauty. What Cicero makes this famous painter say is very remarkable: “Set before me some of your most beautiful virgins, whilst I paint the picture I have promised you, that truth may be transferred from the living original into my mute copy[3].”
The modern masters who brought painting to so great perfection, had the same notion of the art, and of the method of study that is requisite to produce works of good taste, and uncommon beauty. This evidently appears from the accounts that are given us of Raphael, Michael Angelo, Titian, Guido, Rubens, Poussin, and many others; and from the writings of Leonardo da Vinci, and other authors upon this art.
- [1] The passage has been often referred to, and is given at full length at the begining of the four chapter.
- [2] Maximus Tyrius, Dissert. 7. So Plato, pictorum facultas nullum in pingendo terminum habere videtur, sed semper inumbrando, et deumbrando, vel quomodocunque aliter a pictoribus id vocetur, nec cessat unquam ; non enim potest fieri ut ad pulchriora expressioraque incrementum non habeatur. Platon de Leg. lib. 6.
- [3] Cic. Rhet. lib. 2. ab initio. “Praebete igitur mihi, quaeso, ex istis virginibus formosissimis, dum pingo id, quod pollicitus sum vobis, ut mutum in simulacrum ex animali exemplo veritas transferatur.” He adds the reason why a painter ougt not to take his Idea of Beauty from one particular part, but from many objects of nature. “Ille autem quinque delegit; quarum nomina multi poetae memoriae tradiderunt, quod eius essent iudicio probatae, qui pulchritudinis habere verissimum iudicium debuisset. Neque enim putavit omnia, quae quaereret ad venustatem, uno se in corpore reperire posse, ideo quod nihil, simplici in genere, omni ex parte perfectum, natura expolivit. Itaque tamquam ceteris non sit habitura quod largiatur, si uni cuncta concesserit, aliud alii commodi aliquo adiuncto incommodo muneratur.” And then he goes on to shew that the same must be done in oratory: Quod quoniam nobis quoque voluntatis accidit ut artem dicendi perscriberemus, non unum aliquod proposuimus exemplum — ac si par in nobis hujus artis, atque in illo picturae, scientia fuisset, fortasse magis hoc suo in genere opus nostrum, qua mille in sua pictura nobilis eniteret, etc.
Batteux, Charles, Les Beaux-Arts réduits à un même principe(publi: 1746), p. 91-92 (fran)
Que fit Zeuxis quand il voulut peindre une beauté parfaite ? Fit-il le portrait de quelque beauté particulière, dont sa peinture fût l’histoire ? Il rassembla les traits séparés de plusieurs beautés existantes, il se forma dans l’esprit une idée factice qui résultât de tous ces traits réunis : cette idée fut le prototype, ou le modèle de son tableau, qui fut vraisemblable et poétique dans sa totalité et ne fut vrai et historique que dans ses parties prises séparément. Voilà l’exemple donné à tous les artistes, voilà la route qu’ils doivent suivre, et c’est la pratique de tous les grands maîtres sans exception. Quand Molière voulut peindre la Misanthropie, il ne chercha point dans Paris un original, dont sa pièce fût une copie exacte ; il n’eût fait qu’un portrait ; il n’eût instruit qu’à demi. Mais il recueillit tous les traits d’humeur noire qu’il pouvait avoir remarqués dans les hommes ; il y ajouta tout ce que l’effort de son génie put lui fournir dans le même genre ; et de tous ces traits rapprochés et assortis, il en figura un caractère unique, qui ne fut pas la représentation du vrai, mais celle du vraisemblable. Sa comédie ne fut point l’histoire d’Alceste, mais la peinture d’Alceste fut l’histoire de la Misanthropie prise en général.
Batteux, Charles, Les Beaux-Arts réduits à un même principe(publi: 1746), p. 96 (fran)
Voilà la source et le principe de l’enthousiasme. On sent déjà quels doivent en être les effets par rapport aux arts imitateurs de la belle nature. Rappelons-nous l’exemple de Zeuxis. La nature a dans ses trésors tous les traits dont les plus belles imitations peuvent être composées : ce sont comme des études dans les tablettes d’un peintre. L’artiste qui est essentiellement observateur, les reconnaît, les tire de la foule, les assemble. Il en compose dans son esprit un tout dont il conçoit une idée vive, qui le remplit. Bientôt son feu s’allume, à la vue de l’objet ; il s’oublie ; son âme passe dans les choses qu’il crée : il est tour à tour Cinna, Auguste, Phèdre, Hippolyte ; et si c’est un La Fontaine, il est le Loup et l’Agneau, le Chêne et le Roseau.
Massé, Jean-Baptiste, « Sur la nécessité de bien connaître l’antique et l’anatomie », Conférence prononcée à l’Académie royale de peinture et de sculpture le 8 novembre 1749(redac: 1749/11/08), p. 390 (fran)
Les marques honorables de distinction et les grandes récompenses accordées aux fameux artistes chez les Grecs ont sans doute infiniment contribué à la sublimité de leur savoir. Ces hommes chéris dans leur patrie étaient parvenus à un si haut point de perfection du temps d’Alexandre, que ce que les historiens disent de merveilleux de Zeuxis et d’Apelle nous paraîtrait incroyable, si le mérite de ces grands peintres n’était pas confirmé par celui des sculpteurs, leurs contemporains, dont les ouvrages ont passé jusqu’à nous.
Ils ne prenaient, dans les différents modèles qu’ils étudiaient, que les beautés qui pouvaient convenir le mieux au tout dont ils s’étaient fait la plus noble image. La persuasion où ils étaient de représenter la divinité même dans des statues qui, immédiatement au sortir de leurs mains, devenaient les objets du culte public, élevait encore leur génie. Enfin, par de savantes réflexions, tant sur le rapport que doivent avoir les parties entre elles que sur les grands caractères et la majesté des têtes, sur les grâces, le touchant, le simple, l’élégant et le vrai beau, ils fixèrent si bien les proportions de la belle nature suivant les sexes et les âges, que les chefs-d’œuvre de leurs mains qui nous sont demeurés ont servi jusqu’ici de règles invariables aux grands artistes qui leur ont succédé, et personne n’ignore que les plus distingués des peintres et des sculpteurs sont ceux qui en ont le plus approché.
Bellori, Giovanni Pietro, Descrizione delle Immagini dipinte da Rafaello d’Urbino nelle camere del Palazzo Vaticano, con alcuni ragionamenti in onore delle sue opere, e della pittura, e scultura(publi: 1751), « Dell’ingegno, eccellenza, e grazia di Raffaelle comparato ad Apelle », p. 237 (italien)
Onde se tanto si loda Zeusi di aver contemplato cinque vergini per ritrarne la similitudine più perfetta di un Elena, qual commendazione maggior a Raffaelle si conviene, che ad ogni tratto del suo pennello animò Elene, e Dee?
Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique(publi: 1752), article « Zeuxis », p. 704 (fran)
On a beaucoup vanté le tableau d’une Hélene que ce peintre fit pour les Agrigentins. Cette nation lui avoit envoyé les plus belles filles d’Agrigente. Zeuxis en retint cinq, et c’est en réunissant les graces et les charmes particuliers à chacun qu’il conçut l’idée de la plus belle personne du monde, que son pinceau rendit parfaitement.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « Réflexions sur quelques chapitres du XXXVe livre de Pline » (publi: 1759, redac: 1752:1753), Troisième partie, « Du caractère et de la manière des peintres grecs », p. 196 (fran)
Mais pour revenir à Zeuxis, j’avoue que j’ai peine à accorder tout ce que les récits de Pline me font penser du talent de ce grand homme, avec ce qu’il dit en finissant l’article qui le regarde : deprehenditur tamen Zeuxis grandior in capitibus articulisque. Si ce mot de deprehenditur n’indiquoit pas le reproche, et n’autorisoit pas la traduction de faire ses têtes et ses attachemens trop forts, j’aurois pris le mot de grandior comme un éloge, en disant qu’il faisoit ces parties d’un grand caractère, d’autant qu’il le loue de travailler avec soin et d’après la Nature, alioqui tantus diligentia ; car ce fut lui qui demanda aux Agrigentins les cinq filles, pour faire le tableau qu’ils vouloient placer dans le temple de Junon Lacinienne. Quoi qu’il en soit, un défaut aussi considérable que celui des proportions pourroit détruire toutes les belles qualités que Pline lui accorde ; mais on doit savoir gré à cet auteur de nous avoir donné la critique aussi bien que l’éloge.
Nos modernes n’ont jamais été assez heureux pour avoir de semblables modèles, ni en aussi grand nombre ; ce que j’en dis, n’est point du tout pour faire une plaisanterie ; mais la différence des mœurs et des usages nous met aujourd’hui dans une situation embarrassante pour les modèles des femmes, toûjours plus difficiles à trouver complets que ceux de l’autre sexe.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « De la peinture ancienne » (redac: 1753/11/10), p. 246 (fran)
Zeuxis peignit une Pénélope sur la figure de laquelle on reconnaissait les mœurs. Il n’est pas possible de donner une idée plus délicate de l’esprit et du pinceau de ce grand artiste. En effet, l’expression des mœurs me paraît une opération sublime. Je crois pouvoir dire, avant de comparer Zeuxis plus exactement encore, que, comme lui, Raphaël a peint les mœurs et a su les exprimer. Quels caractères ! Quelle réunion de grandeur, de simplicité, de noblesse, cet illustre moderne n’a-t-il pas mis dans toutes ses têtes et surtout dans celles des Vierges ! Malgré cette comparaison anticipée, je dois dire que ce serait Léonard de Vinci que je comparerais à Zeuxis, surtout à cause du terminé auquel il s’appliquait. Il est vrai que Pline reproche à Zeuxis, en finissant [l’article de] cet artiste, de faire ses têtes et ses attachements trop forts ; un défaut aussi considérable, et qu’on ne peut reprocher à Léonard, diminue beaucoup les autres belles parties que Zeuxis pouvait avoir. Il faut cependant convenir qu’il travaillait avec soin et d’après la nature, car ce fut lui qui demanda aux Agrigentins les cinq filles pour faire le tableau qu’ils voulaient placer dans le temple de Junon Lucinienne. Nos modernes n’ont jamais été assez heureux pour avoir de semblables modèles, ni en aussi grand nombre. Ce n’est point dans le dessein de faire une plaisanterie que j’appuie sur ce fait, mais pour gémir de voir la différence des mœurs et des usages nous mettre aujourd’hui dans une situation embarrassante pour les modèles de femmes, toujours plus difficiles à trouver complets que ceux de l’autre sexe.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « Sur l’Hermaphrodite », conférence lue le 2 décembre 1758 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1758/12/02), p. 548 (fran)
La difficulté de reporter le choix des différentes parties sur un tout est, en quelque façon, expliquée, quand on pense à l’opération de Zeuxis, quoique plus grossière et plus facile. Pline nous apprend que les Agrigentins donnèrent cinq filles à ce grand artiste, pour dessiner la Junon Lucinienne qu’ils voulaient faire peindre. Il faut convenir que Zeuxis trouva moins de difficulté dans le choix qu’il avait à faire ; les filles qu’il eut pour modèles étaient du même âge et lui présentaient la seule nature qu’il devait exprimer. Il est aisé de sentir que l’artiste qui a voulu représenter Salmacis a dû surmonter un plus grand nombre d’obstacles, et cet exemple prouve qu’il ne suffit pas, pour être un grand homme dans les arts, d’être le fidèle imitateur de la nature : il faut que le génie agisse, et que, pour ainsi dire, il soit créateur, mais avec sagesse et sans écart. Pour arriver à cette profondeur de l’art, il est nécessaire d’avoir vu la nature sans discontinuation. Elle doit être si familière, et l’étude de ses beautés si méditée, qu’il soit possible de n’en pas être ébloui. Ces préparations sont indispensables pour corriger la nature, mais toujours par elle-même, en se rappelant l’exemple d’une plus belle partie, pour la rejoindre à celle dont on a été satisfait. Ce n’est qu’en prenant un pareil essor qu’un artiste s’élève au-dessus du vulgaire.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting(publi: 1760), "Of Design" (numéro Dialogue IV) , p. 40-42 (anglais)
The artist, therefore, observing that nature was sparing of her perfections, and that her efforts were limited to parts, availed himself of her inequality[1], and drawing these scattered beauties into a more happy and complete union, rose from an imperfect imitative, to a perfect ideal beauty. We are informed, that the painters of Greece pressed in crowds to design the bosom and breasts of Thais; nor were the elegant proportions of Phryne less the object of their study. By this constant contemplation of the beautiful, they enriched their imagination and confirmed their taste; from this fund they drew their system of beauty; and though we should consider them but as imitators as to the parts, we must allow them to have been inventors in the compositions. And indeed, when we reflect on the taste and judgment requisite to form these various ideas into such a wonderful agreement, we cannot set too high a value on their productions. The poets and writers of Antiquity acknowledge this superiority of invented to real beauty.
- [1] Ὁνπερ τροπον, και τοις τα αγαλματα τουτοις διαπλατλουσιν, οἱ παν το παν ἑκαστε καλον συναγαγοντες· καὶ κατα την τεχνην εκ διαφορων σωματων αθροισαντες εις μιμησιν μιαν, καλλος ἑν ὑγιες και αρτιον και ἡρμοσμενον αυτο αυτῳ εξειργασαντο. Και ουκ αν εὑροις σωμα ακριβες κατα αληθειαν αγαλματι ὁμοιον· Ορεγονται γαρ αἱ τεχναι του καλλιστου.
Maxim. Tyr, Dissert. xxiii. ed. London.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting, "Du dessin" (numéro Dialogue IV) , p. 41-43 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ainsi les artistes observant que la nature étoit avare de ses perfections, que ses faveurs étaient partagées entre les différentes parties, profiterent de cette inégalité pour réunir en un tout plus parfait, les beautés que la nature avait dispersées ; et d’une imitation imparfaite[1], ils s’élevèrent jusqu’au beau idéal. La gorge de Thaïs, la taille de Phryné servoient de modéle aux peintres de la Gréce. Leur imagination s’enrichissoit, et leur goût s’épuroit par la contemplation constante de la beauté ; et quoiqu’ils ne fussent qu’imitateurs quant aux parties, ils étoient inventeurs dans l’ensemble. En effet, si nous considérons combien il falloit de goût e de discernement pour combiner ces différentes parties, de maniere à en former un tout vrai qui plût, on ne peut attacher trop de prix à leur travail. Les poëtes et les auteurs de l’Antiquité ont reconnu la supériorité de la beauté idéale sur la beauté naturelle.
- [1] Ὁνπερ τροπον, και τοις τα αγαλματα τουτοις διαπλατλουσιν, οἱ παν το παν ἑκαστε καλον συναγαγοντες· καὶ κατα την τεχνην εκ διαφορων σωματων αθροισαντες εις μιμησιν μιαν, καλλος ἑν ὑγιες και αρτιον και ἡρμοσμενον αυτο αυτῳ εξειργασαντο. Και ουκ αν εὑροις σωμα ακριβες κατα αληθειαν αγαλματι ὁμοιον· Ορεγονται γαρ αἱ τεχναι του καλλιστου.Maxim. Tyr, Dissert. xxiii.
Le Mierre, Antoine-Marin, La Peinture, poème(publi: 1761), « Chant premier [le dessein] », p. 13-15 (fran)
Mais malgré cet essor[Note contexte] la figure vulgaire,
Sans accord et sans grace, étoit sans caractère ;
Le beau, dans tout son jour, n’étoit point présenté ;
Il fallut ajouter à l’objet imité ;
On vit que le vrai beau disperse les parties,
Jamais sur un seul être à la fois réunies,
L’artiste jetta l’œil éclairé par le goût,
Sur ces traits divisés, pour en former un tout;
Et sa main dans ce choix heureusement guidée
Montra l’homme parfait qui n’étoit qu’en idée.
Spectacle ravissant dans la Grece étalé !
Sous ce vaste portique Apelle a rassemblé
Cet essaim de beautés, doux et brillans modeles ;
L’amour vole incertain où reposer ses ailes :
Mon œil croit voir en cercle, Helene, Flore, Hebé,
Thétis, Psyché, Diane et Vénus et Thisbé.
Déesses, pardonnés, je vous mêle aux mortelles,
C’est être égale à vous que d’être au rang des belles ;
Sur les divers appas de ces jeunes objets,
Le peintre laisse errer ses regards satisfaits ;
Il préfere ce bras, c’est ce pied qui l’attire,
Cet œil l’a séduit, il choisit ce sourire ;
De lis plus éclatans ce cou paroît semé,
Ce front est plus uni, ce buste est mieux formé ;
Plus beau dans ses contours, ce sein qu’il idolâtre,
S’éleve et se sépare en deux globes d’albâtre;
En rassemblant ces traits, Appelle transporté
N’a peint aucune belle, il a peint la beauté.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), “Die Antike und die Schöne Natur” (numéro I, 6) , p. 69-75 (allemand)
Polyklet nahm zu seiner Statue, die nachmals die Regel gennenet ward, die schönen Verhältnisse, nich von einem einzigen Körper, sondern er verband die an verschiedenen Gegenständen wahrgenommene Vollkommenheit der Theile. Dieses beweiset aber auch im gemessensten Verstande nur für die Vorzüglichzeit dieser Theile an einer im übrigen vieilleicht minder schönen Bildung. Vermuthlich finden Sie, werthester Freund, diesen Beispiel überzeugender, als wenn Zeuxis, von den höflichen Einwohnern von Croton, die ihm ihre schönste weibliche Jugend zum Auswählen schickten, fünf Schönheiten behielt, um bei dem dieser Stadt zum Denkmal bestimmten Bildnisse der Helena die richtigste Wahl zu treffen. Es konnte sich in diese Wahl etwas von der ersten Gesinnung der Aristippus[1] einmischen, dem Dionysius die Wahl von drei Schönen erlaubte: er behielt sie aber alle drei. Nachdem auch die fünfte, welche Zeuxis ausgesucht hatte, von dem Cicero für die schönsten von Croton erkläret worden, wird es von mir verwegen scheinen, daran zu zweifeln, oder die Absicht des Künstlers blosserdings auf die verschiedene eizelne Theile einzuschränken, die iegliche von den erfohrnen Schönen vor allen übrigen im höchsten Grade befaß. Aber Cicero konnte hier nichts mehr, als muthmassen, wie Bayle[2] nachher gethan: und, Muthmassung für Muthmassung, glaube ich, daß Bayle recht hat. Ist er geneigt, den zurückgeschickten Schönen das Wort zu redden: so bin ich fast überzeugt, daß sie, bis auf diejenige Ausnahme, welche die Wahl des Zeuxis vor andern, nur in Ansehung dieser Theile, bestimmt hatte, leicht mehr Vollkommenheiten vereinigen konnten.
Mehr, als jener schönen Theile, bedurften weder Zeuxis noch Polyklet zur Erfüllung ihrer Idee von der Schönheit im Ganzen. Beide Künstler gewähren mir Beispiele von dem ersten Falle, den ich oben angeführet habe.
Allein eben dergleichen in Gedanken schwebendes Bild der vollkommenen Schönheit konnte andern nicht minder grossen Künstlern die Hand leiten, so bald sie ihre Wahl auf ein einziges Urbild richteten, an welchem sich die Natur in den vorzüglichsten Theilen gütig und mild, und irgend in einer geringen Ausnahme sparsam erwiesen. Dieses ist der andere Fall, der vieilleicht selbst einer der zurückgeschickten Schönen von Croton, nach dem verschiedenen Augenmerk eines andern Künstlers, zu statten kommen können.
Welchem von beiden Wegen würden Sie, werthester Freund, den Vorzug geben ? Sehen wir auf die Schwierigkeit und Kunst der Verbindung: so scheint die Frage schon oben entschieden zu sein. Der Geschmack, der vornehmste Gesetzgeber in den Werken der Kunst, kann in beiden Fällen gleichen Antheil haben. Desto unschädlicher kann man hierinn der Willkühr des Künstlers trauen. Die Laune, die in dem gewählten Falle selbst den Geschmack des Künstlers zu schärfen pfleget, würde ihm in dem ihm auferlegten Falle den Einfluß versagen. Nennen Sie jenes eine Begeisterung, oder geben ihr, mit den Dichtern, einen noch höhern Namen. Sie ist in den Künsten etwas wirkliches; und sie ist schäßbar, so lange sie ihre Grenzen halt, und die Künstler dieselbe mit dem Pinsel, oder dem Meisel, wie die Helden der Schaubühne ihre Hoheit mit den Kleidern, ablegen.
Ich verlasse noch nicht den Zeuxis. Augustin Niphus, der Zeitgenoß Kaiser Karls des fünften, giebt mir hierzu Gelegenheit. Also darf ich Ihnen doch denjenigen anführen, der sich, wie man sagt, den Kaiser unter den Gelehrten nennte. Er machte uns von der schönen Fürstin Johanna von Arragonien, derren Leibarzt er war, eine solche Beschreibung, daß, seines Ermessens, Zeuxis, wofern er zur Vergleichung gelangen können, aller weitern Wahl ware überhoben gewesen[3]. Sorgfältiger hat uns Vitruv die schönen Verhältnisse des menschlichen Körpers nicht zuerst vorgerechnet, noch Anakreon seinen Freundinn beschrieben, als dieser Kenner des Schönen bemühet gewesen ist, uns einen Begriff der Schönheit durch das Bild seiner Fürstin zu geben. Doch werden Sie, wersthester Freund, die Angenbraunen daran vermissen, die Anakreon an der Abbildung seiner Geliebten nicht ganz zusammengewachsen, aber auch durch seinen merklichen Unterschied getheilt verlangte. In diesem Stücke wird es uns erlaubt sein, von dem Begriffe, den einige Alten[4] von der Regelmässigkeit der Gesichstbildung gehabt, etwas abzuweichen: so wie wir die weissen Augenbraunen der Diana, die zu Clazomene verehret wurde, einer Ausnahme, die vermuthlich in der hendnischen Götterlehre wichtige Entdeckungen verspricht, willig überlassen.
Allein, ich muß es Ihnen, geliebter Freund, gestehen: ich möchte nicht gerne von der Seltenheit, auf die gänzliche Sparsamkeit der Natur in Verschönerung einzelner Gegenstände schliessen. Die Wahl wird vorausgesetzt. Ich begehre auch das Exempel des Demetrius nicht anzuführen. Dessen erhabene Schönheit konnte, wie es bei dem Plutarch in dessen Leben heißt, weder von den Malhern, noch von den Bildhauern seiner Zeit erreichet werden, ungeachtet dazumal die größten Künstler lebten. Nebenumstände können sich hier eingemischet haben; und vieilleicht mochte von dem Bericht der Geschichtschreiber die Ueberzeugung der Künstler etwas abgehen, die gewohnt waren, die Gesetze der Aehnlichkeit, zu beobachten. Genug, Apelles fand zu seiner Venus, die aus dem Meere steiget, ein Muster in der Natur[5]. Vom Alcibiades ward Merkur genommen. Ist es auch, wie Herr Wilckelmann in ähnlichem Fall vom Praxiteles und andern sehr wahrscheinlich angiebt[6], geschehen, ohne von den allegemeinen grossen Gesetzen der Kunst abzuweichen: so half doch das wohlgewählte Urbild die idealische Schönheit sinnlich ausdrücken. Geschmack und Wahrheit verlangen nichts mehr.
Was das schöne Gechlecht im vollreichen Croton einzeln oder getheilt zeigte, konnte vieilleicht die bildende Natur gelüstet haben, an einem unbetrachtlichen Orte in einem Gegestande, der sich dem Künstler nicht zur Nachahmung dargeboten, zu vereinigen. Die schöne Natur hat, wie die Kunst, ihre Meisterstücke. Und sollte sie, in so fern sie sich diesen Künstlern hülfreich erzeigt hat, unter gleichen Gesetzen für uns entkräftet, für uns erschöpfet sein? Wäre dieses gegründet: so möchte ich den angenehmern Irrthum der traurigen Wahrheit vorziehen. Eine völlige Ueberzeugung dürfte manchen Künstler kaum versuchen lassen, was er nicht zu erreichen hoffet. Nein, wir wollen ihn viehlmehr glauben lassen, es sei das Urtheil zu scharf, so lange der schönere Theil uns seinen Auspruch vorenthält. Eine Sophonisbe Auguisciola oder eine Rosalba hätten, als Künstlerinnen, uns so viel schönes und zuverlässiges, als immermehr Augustin Niphus, davon sagen können.
- [1] S. dessen vom Diogenes beschriebenes Leben, das Dacier, nach der Ueberfeßung des Le Fevre, seinem Plutarch angehängt hat, t. viii. p. 442.
- [2] S. in dessen Wörterbuche den Artickel : Zeuxis, in der Anmerkung (E).
- [3] … forma, quae corporis pulchritudo est, tanta, ut nec Zeuxis, cum Helenae speciem effingere decrevisset, apud Crotoniates tot puellarum partes, ut unam Helenae effigiem describeret, perquisivisset, si sola hujusmodi inspecta illi ac pervestigata excellentia fuisset. Dieses ist, aus seinem Tractat. De pulchro der Anfang der Beschreibung, welche Herr von Crousaz seinem Traité du Beau t. I. ch. 4. ganz eingerücktet hat. Bayle giebt l.c. im Artikel : Ieanne d’Arragon, mehr Nachricht von dieser Fürstin. Die Stellen der Alten über die Schönheit der Theile des menschlichen Körpers giebt Franz Junius (Dujon) zur Erlaüterung einer Beschreibung die Sidonius Apollinaris von der Schönheit des ostgotischen Königs Theodorichs (Dieterichs) gemacht hat. Iunius de Pictura Veterum l. III. c. 9. Felibiens Beschreibungen sind bekannter.
- [4] So beschreibt auch der phrygische Dares, in dem unter seinem Namen bekannten Werke von der Zerstörung Troia, die Helena mit einem Zeichen zwischen beiden Augenbraunen, notam inter duo supercilia habentem.
- [5] Plinius muthmasset, es sei die Campaspe, die dem Apelles abgetretene Geliebte des Alexanders, gesehen. Athenaus sagt es ausdrüklich, daß Apelles sie nach der Phryne, als sie an dem Feste, das dem Neptun zu Ehren gehalten wurde, entkleidet ins Meer gestiegen, geschildert habe; und Arnobius versichert, daß man in ganz Griechenland die Bilder der Venus nach dieser berühmten Schönheit gemahlet habe.
- [6] Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke S. 11.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’antique et de la belle nature » (numéro I, 6) , p. 66-71 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Polyclete, pour faire sa fameuse statue, nommée la Règle, prit les belles proportions, non d’un seul corps, mais de plusieurs ; et il y réunit les perfections des parties qu’il avoit remarquées dans différentes figures. Dans le sens le plus restreint ce procédé de l’artiste ne prouve qu’en faveur de l’excellence de ces parties relativement à une figure moins belle dans tout le reste. Peut-être, mon ami, vous trouverez cet exemple plus convainquant que celui de Zeuxis, lorsque ce peintre fit son tableau d’une Helene, si vanté par les Anciens. Vous savez que les Crotoniates, d’autres disent les Agrigentins, dans l’intention de laisser un monument à leur ville, lui envoyerent les plus belles filles de leur pays pour le mettre à même de faire un beau choix ; que cet artiste en retint cinq, et que c’est en réunissant les charmes particuliers à chacune, qu’il conçut l’idée d’une beauté parfaite, qu’il rendit supérieurement dans la personne d’Helene. Dans ce choix il a pu se glisser quelque chose de la façon de penser d’Aristippe[1] à qui Denys le Tyran donna le choix de trois belles filles : le philosophe les prit toutes. Comme Ciceron nous assure que les cinq filles que Zeuxis s’étoit reservées pour lui servir de modeles, étoient les plus belles de Crotone, il paroîtra témeraire de ma part de douter du fait, ou de restreindre l’intention de l’artiste aux différentes parties, que chacune de ces beautés choisies possédoit au suprême dégré. Mais dans cette affaire Ciceron ne pouvoit que conjecturer, comme Bayle[2] a fait à son tour : et conjecture pour conjecture j’aime mieux croire que Bayle a raison. Notre philosophe moderne penche fortement pour la beauté des jeunes filles renvoyées. Pour moi je suis presque convaincu, qu’à l’exception des beaux détails qui ont fixé le choix de Zeuxis, celles qui ont été renvoyées ont eu en total plus de beauté en partage que celles qui sont restées.
Ces belles parties suffisoient donc à Zeuxis et à Polyclete pour remplir leur idée de la beauté d’un tout. Ces deux artistes me fournissent des exemples du premier cas dont j’ai parlé plus haut, de ces objets que la nature s’est plue à embellir. Cependant cette même image d’une beauté accomplie, présente à la pensée de l’homme habile, pouvoit guider la main d’un autre artiste non moins habile, dès qu’il fixoit son choix sur un seul original, pour lequel la nature s’étoit montrée libérale dans les parties les plus frappantes, et pour lequel elle n’a eu de réserve que dans les choses moins apparentes. Voilà un exemple du second cas en question. Tout dépendant de la maniere d’envisager les objets, il a fort bien pu arriver qu’une des beautés de Crotone, renvoyée par Zeuxis, ait servi ensuite de modele à un autre artiste, accoutumé à voir les choses sous un autre point de vue, et l’esprit assez second pour suppléer à ce qui manquoit à son original.
Ces deux cas différents conduisent à une même fin, qui est de réaliser la beauté idéale, en consultant la nature. Dans le premier, l’artiste combine les plus belles parties d’après l’idée qu’il s’est formée du tout ; dans le second, cette même idée vient à son secours et lui fait faire les exceptions convenables dans le tout presque parfait. Or ces deux cas s’accordent aussi en ceci, qu’il ne faut jamais négliger de consulter la nature.
Auquel de ces deux chemins, mon ami, donneriez-vous la préférence ? Si nous considérons la difficulté, et l’art qu’il faut pour lier les parties, il paroît que nous avons décidé la question par ce que nous avons dit plus haut. Le goût, cet arbitre dans les productions de l’art, peut avoir également part dans les deux cas en question. A cet egard on ne risque jamais rien de s’en rapporter au choix arbitraire de l’artiste. Le goût particulier de l’homme à talent, ce goût qui éleve son imagination, lorsqu’il choisit lui-même, lui refuseroit son influence, s’il étoit obligé de se plier aux idées d’autrui. Rien ne nous empêche de nommer la première manière un enthousiasme, ou de lui donner, à l’exemple des poëtes, un nom encore plus élevé. Dans les arts cet enthousiasme est quelque chose de réel, et il est estimable tant qu’il se tient renfermé dans de justes bornes, et que les artistes savent y renoncer en quittant le pinceau et le ciseau, comme les héros de théatre savent se dépouiller de leur grandeur en ôtant leurs habits.
Je reviens encore à Zeuxis. Augustin Niphus, contemporain de l’Empereur Charles-Quint, m’en fournit l’occasion. Vous me permettrez, mon ami, de vous citer celui qui, à ce qu’on prétend, se disoit l’Empereur des Savants. Il nous donne une description magnifique d’une des plus belles princesses de son temps, de Jeanne d’Aragon, dont il étoit le médecin ; il prétend que Zeuxis, s’il avoit été à portée d’en faire la comparaison, auroit trouvé en elle toutes les beautés réunies pour faire son Hélene[3]. Vitruve a été moins exact à nous calculer les belles proportions du corps humain, Anacréon a été moins soigneux à nous faire la peinture de sa maîtresse, que ne l’a été ce connoisseur du beau à nous donner une idée de la beauté de sa princesse. Cependant, mon cher ami, vous regretterez peut-être de ne pas trouver dans cette descriptions, les sourcils qu’Anacréon nous dépeint si bien en nous faisant le portrait de sa maîtresse : connoisseur en beauté, il ne vouloit pas qu’il se joignissent tout à fait, mais il ne vouloit pas non plus qu’ils fussent séparés par un intervalle trop sensible. A cet égard il nous sera permis de nous écarter un peu de l’idée qu’ont eue quelques Anciens[4] de la régularité des traits du visage et de la physionomie, et de regarder aussi comme une exception les sourcils blancs de Diane, révérée à Clazomene, exception qui promet sans doute des découvertes importantes dans la mythologie.
Il faut vous avouer, mon cher ami, de ce qu’il est rare de trouver des objets individuels parfaitement beaux, je n’en voudrois pas inférer que la nature en fût entierement avare. Je suppose toujours dans l’artiste la capacité d’en faire le choix. Je ne veux pas non plus citer l’exemple de Démétrius Poliorcetes. Plutarque rapporte dans la vie de ce prince que sa beauté étoit telle que ni les peintres ni les sculpteurs de son tems, ne purent venir à bout de la rendre parfaitement, quoiqu’on vit fleurir alors les plus grands artistes. Dans ce fait il peut y avoir eu du plus ou du moins; il se pouroit bien aussi que le récit des historiens ne s’accordât pas avec le sentiment des artistes accoutumés à observer les loix de l’harmonie, au dépens même d’un peu de ressemblance. Il suffit de remarquer qu’Apelle, pour faire sa Venus sortant de la mer, trouva un modele dans la nature[5]. La figure de Mercure fut faite d’après celle d’Alcibiade. Si Praxitele et d’autres, suivant les observations de M. Winckelmann[6], ont procédé de la même façon dans les cas semblables, sans s’écarter des loix universelles de l’art, il résulte que le modele d’un beau choix concouroit à rendre d’une maniere sensible la beauté idéale de l’artiste. Le goût et la vérité n’en demandent pas davantage.
Les beautés dont le sexe de l’opulente Crotone montroit des parties séparées, pouvoient bien avoir incité l’art imitatif, confiné en une ville moins opulente, de les combiner dans un objet qui ne s’étoit pas présenté à l’artiste pour être imité. La belle nature procéde comme l’art : elle a ses chefs-d’œuvres. Et cette belle nature, qui a si bien secondé les artistes de l’Antiquité et qui suit constamment les mêmes loix, seroit-elle sans force, sans énergie pour nous ? Si la chose étoit ainsi, je préférerois l’agréable erreur à la triste vérité. Une pleine conviction de cette assertion décourageroit l’artiste et l’empêcheroit d’entreprendre une chose dans laquelle il ne se flatteroit pas de réussir. Non, tâchons plutôt de le persuader que ce jugement est trop sévère, et trop peu flatteur pour le sexe, et que c’est à cette belle partie du genre humain a décider cette importante question. En effet, une Anguiscola, ou une Rosalba, en qualité d’artistes, auroient pu nous dire sur cet objet des choses aussi belles et aussi concluantes qu’un Augustin Niphus.
- [1] Voyez, la vie d’Aristippe par Diogene, traduite par le Fevre et inserée à la suite du Plutarque de Dacier.
- [2] Voyez dans son Dictionnaire, l’article Zeuxis, à la remarque E.
- [3] — forma, qua corporis pulchritudo est, tanta, ut nec Zeuxis, cum Helenae speciem effingere decrevisset, apud Crotoniates tot puellarum partes ut unam Helenae effigiem describeret, perquisivisset, si sola hujusmodi inspecta illi ac pervestigata excellentia fuisset. C’est ainsi que Niphus, dans son Traité De Pulchro, commence la description de la belle Jeanne, que Crousaz a inserée toute entiere dans son Traité du beau. Tom. I Chap. IV. Voyez aussi l’article de Jeanne d’Aragon du Dictionnaire de Bayle. François Junius, de Pictura Veterum, L. III c. IX. rapporte les passages des anciens sur la beauté des parties du corps humain, pour servir de commentaire à une description de la beauté de Theodoric Roi des Ostrogoths, faite par Sidonius Apollinaris.
- [4] Dans l’histoire de la guerre de Troye, attribuée faussement à Darès le Phrygien, on dépeint Helene avec un signe entre les deux sourcils, notam inter duo supercilia habentem.
- [5] Pline présume que c’étoit Campaspe maîtresse d’Alexandre qui la céda à Apelle. Cependant Athenée dit expressément qu’Apelle avoit fait sa Venus d’après Phryné, lorsque cette fameuse courtisane, à la fête de Neptune, se deshabilla devant le peuple et entra toute nue dans la mer. Arnobe l’Ancien nous assure que toutes les figures de Venus, connues dans la Grece, avoient été faite d’après cette illustre beauté.
- [6] Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke etc.
Mengs, Anton Raphaël, Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerei(publi: 1762), p. 18 (allemand)
- [1] In der Schönheit kann die Kunst die Natur übertreffen.
[1] Die Kunst der Malerei heisset zwar eine Nachahmung der Natur, und scheinet durch das Wort, nach, geringer an Volkommenheit zu sein als die Natur ; dieses ist aber nur mit Begingung wahr : es giebt Sachen in der Natur, so die Kunst unmöglich nachahmen kann, und wo sie sehr schwach gegen die Natur erscheint, nämlich in Licht und Finsterniß : hingegen hat sie einen Theil so sehr mächtig ist, einen Theil der die Natur weit übertrift – dieser ist die Schönheit. Die Natur ist in ihren Hervorbringungen sehr vielen Zufällen unterworfen ; die Kunst aber wirket frei weil sie lauter schwache Materien zum Werkzeuge hat, in welchen seine Widerstrebung ist. Die Kunst der Malerei kann aus dem ganzen Schauplazte der Natur das Schönste wählen, und die Materien von vielerlen Orten, und die Schönheit von vielerlen Menschen sammeln, da die Natur die materie eines Menschen nur aus der Mutter desselben nehmen, und sich mit allen Zufällen begnügen muß : also können die gemalten Menschen meicht schöner als die Wahraftigen sein.
Mengs, Anton Raphaël, Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerei, p. 43 (trad: " Pensées sur la beauté et sur le goût dans la peinture" par Modigliani,Denise)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
L’art de la peinture est appelé, il est vrai, une imitation (Nachahmung) de la nature, et semble, à cause du mot nach, être d’une perfection inférieure à celle de la nature ; mais ceci n’est vrai que sous réserve : il y a des choses dans la nature que l’art est incapable d’imiter, et où il paraît bien faible auprès d’elle, par exemple la lumière et l’obscurité. En revanche, il possède une partie très puissante, une partie qui dépasser largement la nature – celle-ci est la beauté. La nature, dans ses productions, est soumise à de très nombreux hasards ; tandis que l’art agit librement, parce qu’il n’a pour instrument que de faibles matières qui n’offrent pas de résistance. L’art de la peinture peut choisir dans tout le théâtre de la nature ce qui est le plus beau, et réunir les matières de plusieurs lieux et la beauté de plusieurs hommes, alors que la nature doit emprunter la manière d’un homme uniquement à sa mère et s’accommoder de tous les hasards : ainsi les hommes peints peuvent facilement être plus beaux que les hommes réels.
Algarotti, Francesco, Saggio sopra la pittura, saggio sopra l’Academia di Francia che è in Roma(publi: 1763), «Della simmetria», p.46-47 (italien)
La Natura, la quale nella formazione delle specie, ha toccato il segno ultimo della perfezione, non fa lo stesso nella formazione degl’individui. Dinanzi agli occhi di essa pare, che siano un niente quelle cose che hanno un principio ed un fine, che appena nate hanno da morire. Abbandona in certo modo gl’individui alle cause seconde: e se in essi traluce talvolta un qualche raggio primitivo di perfezione, troppo egli viene ad essere offuscato dall’ombra, che lo accompagna. L’arte risale agli archetipi della natura, coglie il fiore di ogni bello, che qua e là osservato le viene, sa riunirlo insieme in modelli perfetti, e proporlo agli uomini da imitare[1]. Così quel dipintore, ch’ebbe ignude dinanzi a se le fanciulle Calabresi, niuna altra cosa fece, siccome ingegnosamente dice il Casa[2], che riconoscere i membri ch’elle aveano quasi accattato, chi uno, e chi un altro da una sola; alla quale fatto restituire da ciascuna il suo, lei si pose a ritrarre, immaginando che tale e così unita dovesse essere la bellezza di Elena. Lo stesso adoperarono alcun tempo innanzi gli antichi scultori, quando essi ebbero a figurare in bronzo od in marmo le immagini dei loro Iddii, e de’ loro eroi.
- [1] And since a true knowledge of Nature gives us pleasure, a lively imitation of it, either in poetry or painting, must of necessity produce a much greater. Far both these arts, as I said before, are, not only true imitations of nature, but of the best Nature, of that which is wrought up to a nobler pitch. They present us with images more perfect than the life in any individual : and we have the pleasure to see all the scatter’d beauties of Nature united, by a happy chymistry, without its deformities or faults. C’est-à-dire puisque la véritable connoissance de la nature nous fait plaisir, sa vive image soit dans la poësie, soit dans la peinture, doit nécessairement nous en procurer de plus grands. Car ces deux arts ne sont pas seulement une imitation de la nature ; comme je l’ai dit ci-devant, mais une imitation de la belle nature et de ce qu’il y a de plus beau ; ils nous présentent des images plus parfaites que celles que la nature nous offre dans les individus : nous goûtons ainsi la satisfaction de voir toutes les beautés naturelles réunies par un heureux assemblage sans apercevoir aucun défaut, ni aucune imperfection.
- [2] Nel Galateo. Vedi Vita di Zeusi di Carlo Dati Postilla XI.
Algarotti, Francesco, Saggio sopra la pittura, saggio sopra l’Academia di Francia che è in Roma, « De la symétrie ou des proportions », p. 50-53 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
La nature, qui dans la création de l’espece est parvenue au plus haut degré de perfection n’a pas eu les mêmes succès dans chaque individu. Tout ce qui a un principe et une fin et qui périt presque au moment qu’il a pris naissance, n’est rien devant ses yeux. Elle abandonne pour ainsi dire les individus aux causes secondes. Si l’on voit parmi eux quelque lueur primitive de la perfection, elle est trop offusquée par l’ombre qui l’accompagne. L’Art remonte au modele de la nature ; il cueille les fleurs de toutes les beautés qu’il a observé, et sait ensuite les réunir dans des modeles parfaits qu’il propose aux hommes afin qu’il les imite[1]. C’est ainsi que fit ce peintre devant les yeux duquel toutes les filles de la Calabre passerent nues : il ne fit autre chose, comme le dit ingénieusement Monsieur de la Casa[2], que de reconnoître les membres qu’elles avoient pour ainsi dire emprunté de la beauté et obligea chacune de ses filles à les restituer. Pour cela, il copia donc ce qu’elles avoient de plus beau et en forma un ensemble, s’imaginant d’ailleurs que la beauté d’Helêne devoit être le résultat de cet assemblage. Les anciens sculpteurs avoient fait la même chose quelque tems auparavant, quand ils eurent à représenter en bronze la figure de leurs dieux ou de leurs héros.
- [1] And since a true knowledge of Nature gives us pleasure, a lively imitation of it, either in poetry or painting, must of necessity produce a much greater. Far both these arts, as I said before, are, not only true imitations of nature, but of the best Nature, of that which is wrought up to a nobler pitch. They present us with images more perfect than the life in any individual : and we have the pleasure to see all the scatter’d beauties of Nature united, by a happy chymistry, without its deformities or faults. C’est-à-dire puisque la véritable connoissance de la nature nous fait plaisir, sa vive image soit dans la poësie, soit ldans la peinture, doit nécessairement nous en procurer de plus grands. Car ces deux arts ne sont pas seulement une imitation de la nature ; comme je l’ai dit ci-devant, mais une imitation de la belle nature et de ce qu’il y a de plus beau ; ils nous présentent des images plus parfaites que celles que la nature nous offre dans les individus : nous goûtons ainsi la satisfaction de voir toutes les beautés naturelles réunies par un heureux assemblage sans apercevoir aucun défaut, ni aucune imperfection.
- [2] Dans la Galatée. Voyez la vie de Zeusis de Charles Dati. Article XI.
Commentaires : Trad. Pingeron, 1769, « De la symétrie ou des proportions », p. 50-53
Algarotti, Francesco, Saggio sopra la pittura, saggio sopra l’Academia di Francia che è in Roma(publi: 1763), p. 70-71 (italien)
Il naturalista, come lo Storico, rapppresenta le cose quali sono ; il pittore le rappresenta come il poete, quali esser dovrebbono. Tutto è natura, dice della poesia uno scrittore Inglese, e los tesso è da darsi della pittura, ma una natura ridotta a metodo[1]. Di modo che il Regolo di Policleto, l’Apollo di Belvedere, l’Elena di Zeusi, la S. Cecilia di Raffaello, il quadro in somma benché verisimile non si troverà mai in verità : siccome la collera di Achille è verisimile non vera ; tanto ella è cosa perfetta.
- [1] ’Tis nature all, but nature methodized.
Winckelmann, Johann Joachim, Geschichte der Kunst der Altertums(publi: 1764, trad: 1766), p. 155 (allemand)
Die Natur aber und das Gebäude der schönsten Körper ist selten ohne Mängel und hat Formen, oder Teile, die sich in andern Körpern vollkommener finden, oder denken lassen, und dieser Erfahrung gemäß verfuhren diese weisen Künstler wie ein geschickter Gärtner, welcher verschiedene Absenker von edlen Arten auf einen Stamm propfet ; und wie eine Biene aus vielen Blumen sammelt, so blieben die Begriffe der Schönheit nicht auf das individuelle einzelne Schöne eingeschränkt, wie es zuweilen die Begriffe der alten und neuern Dichter und der mehrsten heutigen Künstler sind, sondern sie suchten das Schöne aux vieilen schönen Körper zu vereinigen. Sie reinigten ihre Bilder von aller persönlichen Neigung, welche unsern Geist von dem wahren Schönen abzieht. So sind die Augenbrauen der Liebsten des Anakreons, welche unmerklich voneinander geteilt sein sollten, eine eingebildete Schönheit persönlicher Neigung, so wie diejenige, welche Daphnis beim Theocritus liebte, mit zusammenlaufenden Augenbrauen. Ein späterer grieschicher Dichter hat in dem Urteile des Paris diese Form der Augenbrauen, welche er der schönsten unter den drei Göttinnen gibt, vermutlich aus angeführten Stellen gezogen. Die Begriffe unserer Bildhauer, und zwar derjenigen, die das Alte nachzuahmen vorgeben, sind im Schönen einzeln und eigeschränkt, wenn sie zum Muster einer großen Schönheit den Kopf des Antinous wählen, welcher die Augenbrauen gesekt hat, die ihm etwas Herbes und Melancholisches geben.
Es fällte Bernini ein sehr ungegründetes Urteil, wenn er die Wahl der schönsten Teile, welche Zeuxis an fünf Schönheiten zu Kroton machte, da er eine Juno daselbst zu malen hatte, für ungereimt und für erdichtet ansah, weil er sich einbildete, ein bestimmtes Teil oder Glied reime sich zu keinem andern Körper, als dem es eigen ist. Andere haben keine als individuelle Schönheiten denken können, und ihr Lehrsatz ist : die alten Statuen sind schön, weil sie der schönen Natur ähnlich ist. Der vordere Satz ist wahr, aber nicht einzeln, sondern gesammelt (collective) ; der zweite Satz aber ist falsch : denn es ist schwer, ja fast unmöglich, ein Gewächs zu finden, wie der Vatikanische Apollo ist.
Winckelmann, Johann Joachim, Geschichte der Kunst der Altertums, (trad: 1766), « Histoire de l’art chez les Grecs », « Formation de la beauté idéale », vol. 1, p. 261-263 (trad: "Histoire de l'art chez les Anciens" par Sellius, Gottfried en 1766)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Les plus belles formes ne sont pas sans défauts ; et quelque beau que l’on suppose un corps, il a toujours quelques parties défectueuses, ou qui au moins ne sont pas si parfaites, que d’autres corps ne les montrent plus parfaites. Les sages artistes entoient pour ainsi dire les parties d’un individu sur celles d’un autre, comme le jardinier ente sur une tige les provins d’une espèce plus noble. L’abeille forme son miel du suc de plusieurs fleurs. De même l’idée de la beauté chez les Grecs n’étoit point bornée au seul beau individuel, comme elle l’est quelquefois chez les poëtes tant anciens que modernes, et chez la plupart des artistes de notre temps. Mais ils surent allier les beautés de plusieurs individus. Ils purifierent leurs figures de toute affection personnelle qui éloigne souvent notre esprit du vrai beau, pour enfanter des beautés de fantaisie. La maîtresse d’Anacréon devoit avoir des sourcils qui ne fussent qu’imperceptiblement séparés. Ainsi Daphnis, chez Théocrite[1], aime les sourcils joints[2]. Un poëte grec[3] d’un temps postérieur donne la même forme aux sourcils de la plus belle des trois déesses au jugement de Pâris, et il est probable qu’il avoit pris cette pensée des anciens poëtes cités. Les idées de nos sculpteurs, de ceux même qui prétendent imiter l’antique, se montrent trop resserrées, quand ils choisissent pour modele d’une grande Beauté la tête d’Antinoüs, dont les sourcils descendent visiblement trop bas, ce qui lui donne quelque chose de dur et de mélancolique.
Bernini[4] avoit tort de regarder comme fabuleux et ridicule ce qu’on rapporte de Zeuxis. On dit que ce peintre voulant faire une Junon choisit à Crotone cinq Beautés les plus parfaites qu’il put trouver, et qu’il prit les plus beaux traits des unes et des autres, ne jugeant pas qu’une partie déterminée, ou un membre parfait fût tel qu’il ne pût pas convenir à un corps autre qu’au sien. D’autres n’admettent que des beautés individuelles. Dans leur système, les statues antiques ne sont belles que parce qu’elles ressemblent à la belle Nature, et la Nature est belle quand elle ressemble à ces belles statues[5]. La premiere proposition est vraie, parce qu’il s’y agit non pas de la Nature individuelle telle qu’elle se montre dans les individus, mais de la belle Nature formée des beautés de plusieurs individus rassemblées en un seul tout. Quant à la seconde assertion elle est fausse : car il est difficile, et même impossible de trouver dans la Nature un corps aussi parfait que l’Apollon du Vatican, ce qui sert encore à prouver que la grande Beauté des statues antiques n’est point individuelle mais collective.
- [1] Idyl. VIII. vs. 72.
- [2] Les traducteurs rendent le mot σύνοφρυς par junctis superciliis, suivant sa composition. Mais on pourroit aussi le traduire par orgueil, selon l’explication d’Hesychius. On dit que les Arables trouvent très-beaux les sourcils qui se joignent. La Roque, Mœurs et coutumes des Arabes, p. 217.
- [3] Coluth.
- [4] Baldinuc. Vita di Bernin. P. 70.
- [5] De Piles. Remarq. Sur l’Art de peind. de Du Fresnoy. p. 107.
Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), p. 265 (fran)
Mais des tableaux beaucoup plus importans de Zeuxis étoient, par exemple, son Hélene, qu’on ne voyoit d’abord qu’avec de l’argent, d’où vint que les railleurs nommerent ce portrait Hélene la courtisanne. On ne sait point si cette Hélene de Zeuxis étoit la même qui étoit à Rome du tems de Pline, ou celle que les Crotoniates le chargerent de représenter, pour mettre dans le temple de Junon. Quoi qu’il en soit, il peignit son Hélene d’après nature sur les cinq plus belles filles de la ville, en réunissant les charmes et les graces particulieres à chacune, pour en former la plus belle personne du monde, que son pinceau rendit à ravir.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), t. I, p. 152; 274-284 (fran)
Au reste, il étoit si exact, que pour faire aux Agrigentins ce tableau qu’ils devoient consacrer dans le temple de Junon Lacinienne, il examina leurs filles nuës, et en choisit cinq, pour peindre d’après elles ce que chacune avait de plus beau (27).
Notes, t. I, p. 274-284 : (27) Quand on est un peu familier avec l’art, on ne donne pas pour une preuve singulière de l’exactitude d’un peintre, le choix qu’il fait de plusieurs modèles ; parce que les peintres et les sculpteurs en ont fait, en font, et en feront autant, pour produire un ouvrage vraiment étudié et de leur mieux possible. La nature n’est pas ordinairement parfaite dans un seul individu, comme Pline en convient, et comme nous le savons tous. Ce n’est pas que quelques artistes, incités tout autant par le goût de la débauche que par celui de l’étude, ne fassent quelquefois servir l’un de prétexte à l’autre ; mais nous ne les voyons ici que comme artistes ; et quant à Zeuxis, c’est assez que nous sachions qu’il étoit d’un faste, d’un orgueil et d’une vanité insuportables, sans vouloir encore chercher à deviner s’il aimoit plus que de raison les beaux modèles. N’affectons pas le rigorisme ; complimentons Zeuxis qui a goûté le plaisir de parcourir des yeux tant de vierges nues, virgines nudas. Tenons-nous en à dire qu’il n’y a rien là de si remarquable, et que si nos mœurs publiques ressembloient à celle des Agrigentins, nos artistes ne manqueroient pas de faire publiquement comme Zeuxis ce qu’ils font tous les jours en particulier, à la virginité près.
Cependant nous autres modernes, nous pourrions plus volontiers rassembler moins d’individus de la même espèce pour faire une seule et belle figure ; parce que pour certains sujets, nous trouvons dans les monumens de la sculpture antique, la règle du beau à laquelle nous devons raporter l’objet vivant qui nous sert de modèle. C’est ainsi que nous rectifions les défauts du naturel sur les principes de la belle sculpture grecque. Mais les Grecs, nos maîtres dans l’art de cette partie, étoient créateurs ; ils faisoient cette règle du beau que nous devons suivre à quantité d’égards. Il étoit donc nécessaire qu’ils travaillassent à établir et à fixer le beau de l’art, qui avant eux ne l’étoit pas encore. Cette dernière partie de l’observation n’est sans doute pas neuve, mais il seroit injuste de l’exiger de Pline. Je ne conseillerois pas pour cela aux peintres et aux sculpteurs de s’en tenir à un seul modèle : ce n’est qu’en comparant plusieurs à l’Antique, qu’ils s’assureront d’autant mieux du choix qu’ils doivent faire, et qu’ils connoîtront la supériorité des sculpteurs grecs.
Bacon dit quelque part[1], l’idée du peintre qui, pour réprésenter Vénus, déroba ses traits à plusieurs modèles, ne devoit faire qu’une beauté de fantaisie fort imparfaite, parce qu’elle n’imitoit pas le désordre gracieux et l’imperfection même de la nature. Bayle, article Zeuxis, dit, au fond il n’avoit besoin que de son imagination pour faire une beauté achevée ; car il est certain que nos idées vont plus loin que la Nature. Voilà comment un génie du premier ordre, et un littérateur de la plus vaste érudition et d’un esprit étonnant, raisonnent quand ils veulent parler de ce qu’ils ne connoissent pas : exemple qui devroit réfréner les décisions de tant de gens de mérite, qui parlent aussi mal de la peinture et de la sculpture avec infiniment moins d’esprit, de savoir et de génie, que ces deux grands hommes. Ce qui produit tant d’équivoques et de méprises dans nos jugemens, c’est que nous adaptons les objets à nos idées au lieu de former nos idées sur les objets mêmes. La première méthode est prompte et convient à notre impatience ; l’autre est lente et trop laborieuse pour notre paresse.
Comment Bayle ne s’est-il pas souvenu que l’imagination ne fait autre chose que modifier des idées et des formes sur le modèle de celles que nous avons reçues des objets ; que c’est ainsi que se produit le Beau idéal ou composé, dont les parties qui le constituent sont éparses entre les diférens objets de la Nature, et dont l’ensemble, que notre imagination en compose, n’est que l’assemblage et le résultat ? Ainsi le peintre et le sculpteur, quelque imagination qu’ils aient, ne peuvent qu’imiter la Nature. Il est donc certain que nos idées, produisissent-elles des monstres, ne vont pas plus loin que la Nature. Cette observation qui sert de réponse à Bayle, en sert aussi à l’idée fausse de Bacon. Sa méprise a peut-être séduit M. Burke, et peut avoir été la base de quelques endroits de ses Recherches philosophiques sur l’origine des idées que nous avons du Beau et du Sublime ; très bon ouvrage à plusieurs égards.
Ce n’est pas, comme l’observe M. Burke, dans les productions des arts seulement que nous devons chercher les règles et l’étendue de l’art ; c’est le nullam artem in se versari de Cicéron ; c’est ce Beau exquis dont Phidias avoit l’idée, et sur lequel il tenait les yeux attachés lorsqu’il faisoit son Jupiter et sa Minerve ; c’est la pensée de Platon quand il dit qu’un peintre qui voudroit représenter la beauté seulement d’après la plus belle femme qu’il connût, n’auroit produit cependant que la copie d’une image, d’une partie de la Beauté, et non pas une imitation de la vraie Beauté ; c’est la pensée d’Aristote quand il dit que les bons peintres en donnant aux objets leurs véritables formes, les font cependant plus beaux ; parce qu’ils forment plutôt leurs caractères d’après le Beau de la Nature universelle, que d’après un seul individu. Il est étonnant que Bacon, ce génie si singulier, n’ait rien perçu de tout cela ; il est plus étonnant encore qu’il ait eu une opinion contraire et aussi diamétralement oposée au but de l’art : il ne l’est pas autant qu’il ait trouvé des aprobateurs.
Mais prenons garde que voulant donner de l’extension à nos recherches, nous ne perdions de vuë le point où se trouvent rassemblés les principes du vrai Beau. Les monumens qui nous restent de la belle sculpture grecque, ayant été faits sans contredit d’après la plus belle espèce humaine, sont seuls capables de former ou de rectifier notre goût et de nous conduire sûrement au meilleur choix des objets naturels, comme je l’ai dit plus haut. Ces monuments précieux nous aprendront que le Beau individuel étant fort rare, surtout dans nos climats occidentaux, des hommes savans dans cette partie sont enfin parvenus sous le plus beau ciel, et par les combinaisons de plusieurs siècles, à fixer l’idée du Beau. Ajoutez à la nature du climat la forme du gouvernement, l’éducation et physique et morale ; tout aura concouru nécessairement à produire notre plus belle espèce. Que le Beau dont les statuaires grecs nous ont transmis le modèle, soit un Beau individuel ou un Beau collectif, il sera toujours pour ceux que de vaines recherches n’empêcheront pas de l’apercevoir et de le sentir, le Beau par excellence. Sur ce pied là, me dira-t-on, le Beau ne sera donc nulle part que dans la Grèce ? Pardonnez-moi ; mais partout ailleurs il est plus rare, et la force de l’habitude a tant de pouvoir sur nos organes, qu’elle les dispose à goûter et à imiter dificilement ce que nous voyons peu. Comme certains pays, quoique situés sous les mêmes parallèles, peuvent beaucoup varier entre eux, à cause de la température de l’air, ils peuvent aussi varier dans la beauté de leurs productions. C’est dans ce sens que la Grèce a produit la plus belle espèce humaine ; mais les ardeurs brûlantes de la zone torride, et les glaces du cercle polaire, ne produisent pas la beauté. Il y a dans la partie du Nord que j’habite actuellement des têtes qui auroient servi de modèle à Phidias pour celle de sa belle Minerve ; et le goût du statuaire, que des minois lubriques ou chiffonnées n’avoient pas dépravé, les lui auroit fait regarder comme il voyoit les têtes grecques.
Qu’il y ait des hommes dont les recherches ne s’étendent guères au-delà de ce qui les environne, tous les pays en produisent ; mais il y en a quelques-uns qui cherchent le beau, le bon et le vrai, ailleurs que dans leurs foyers. Ne disons donc pas comme M. le Comte Algarotti, surtout quand nous parlerons de la peinture et des peintres, Egli è una assai comune opinione tra i Francesi, che sotto il felice loro cielo sia nata, e cresciuta ogni cosa bella, e quasi che stimino perduto opere e vana il cercare più là (Saggio sopra l’Academia di Francia), parce que nous ferions gratuitement une imputation injuste aux artistes françois. Si M. Algarotti a voulu parler du peu de goût qu’il auroit pu suposer aux François en général pour les voyages, il devoit en chercher la cause ailleurs que dans l’opinion qu’il leur prête, d’imaginer que tout ce qu’il y a de beau, naît et croît sous leur ciel heureux. Combien de nations plus voyageuses que la françoise, et qui en cela ont bien raison, se croyent, chacune en son particulier, les premières nations du globe ! M. Algarotti devoit savoir que beaucoup de François voyagent avec fruit ; et surtout, il ne devoit pas placer son reproche dans un écrit où il traite des études que nos peintres et nos sculpteurs vont faire avec empressement en Italie. Revenons aux principes du beau dans la sculpture grecque.
Avec ces principes on est un peu scandalisé quand on lit dans l’ouvrage de M. Burke (section 4, 6 et 9 de la troisième partie), que la proportion, la convenance et la perfection, ne sont point la cause de la beauté dans l’espèce humaine. Comment un très habile homme et de beaucoup d’esprit, n’a-t-il pas aperçu que des raisons qu’il donne il ne résulte, tout au plus, que le joli, l’agréable ? C’est peut-être parce qu’il n’est ni peintre ni sculpteur. S’il eut fait des statues sur les principes du Beau qu’il veut établir, il eût bientôt senti, même avec moins d’esprit qu’il n’en a, que les grands artistes grecs ont pensé autant qu’il soit possible à ce qui constitue la beauté dans l’espèce humaine ; il eût cessé de les contredire, et les eût étudiés. Je n’en dirois pas autant d’un homme dont le goût ne seroit que national, ou qui l’auroit dépravé. Mais, sans pratiquer l’art, si M. Burke eût observé les belles statues grecques, s’il les eût examinées en connoisseur instruit, il auroit senti que le vrai Beau, le Beau absolu, consiste dans la proportion, la convenance, et la perfection. Au reste, en voulant définir le Beau, M. Burke a très bien dit ce que c’est que le joli, dont le Beau chimérique est tout voisin.
L’artiste qui passe sa vie à étudier tous les objets de son art, ne doit pas être surpris de trouver à chaque instant des hommes qui, occupés d’autres soins, n’entendent pas bien sa langue ; mais que ces mêmes hommes prétendent lui en enseigner le rudiment, c’est ce qu’il a quelque droit de ne pas écouter. Laissez à l’artiste la connoissance du Beau dans l’espèce humaine ; c’est particulièrement son affaire ; et si vous voulez l’aider dans ses ouvrages, aprenez comme lui à connoître ce Beau.
M. Burke a beaucoup parlé du Sublime. Je n’en dirai que deux mots, et sans examiner si la vuë d’un mur nud d’une grande hauteur et d’une longueur considérable, est sans doute sublime, ou si cette vuë porte l’ame à la stupidité, je remarquerai qu’un architecte habile et digne de beaucoup d’éloges, a copié cet endroit de l’ouvrage de M. Burke : qu’il y a cru, et qu’il a pensé en 1764 que chacun pourroit y croire. Le livre anglois a été traduit en françois en 1765 par M. l’Abbé D.F. c’est cette traduction que je lis, et où je trouve qu’il y a eu autre chose à copier que le Sublime d’un grand mur nud. Mais deux hommes de mérite peuvent se rencontrer dans un même sujet.
M. Burke définit le Sublime dans les objets matériels, tout ce qui imprime de la terreur. Ne resulteroit-il pas de cette définition trop vague, que le gibet, qu’un roué, seroient sublimes ? Que les phantômes, les aparitions quelconques, seroient sublimes ? Que le voleur qui présente au coin d’un bois le pistolet à la gorge du passant, seroit sublime ? Que les souris et les araignées seroient sublimes pour ceux à qui elles impriment de la terreur ? Cependant comme il y a des hommes qui sans être stupides, envisagent froidement les dangers : qu’il y en a qui n’ont peur ni des revenans, ni des souris, ni des araignées ; il en résulte que la définition n’est rien moins qu’éxacte. Le vrai sublime est essentiel ; il est réel, il est absolu, et n’est relatif que dans des cas très particuliers. L’océan est sublime ; l’habitude, la stupidité, la surdité, la cécité peuvent seules en diminuer ou en empêcher l’effet sur notre sensorium commune.
L’embaras où se trouvent et où laissent leurs lecteurs la plupart des auteurs qui ont écrit du Beau rélativement à l’art, peut venir de plusieurs causes : 1° de la rareté du vrai Beau : 2° de n’en avoir cherché l’exemplaire que dans les individus d’un climat : 3° de l’impossibilité où sont ordinairement les gens de lettres d’étudier la sculpture grecque et de la comparer avec le naturel qui peut y avoir des raports : 4° et conséquemment, de prendre le joli pour le Beau ; ce qui les conduit à croire que le Beau n’est que relatif ; parce que le joli, variant à l’infini, doit être perpétuellement relatif. Si, au lieu de chercher le Beau dans un traité sur le Beau, les écrivains consultoient les grands artistes quand il s’en trouve, ils s’égareroient moins en voulant les instruire. Le goût le moins dépravé par l’éducation, le préjugé, l’habitude, est le plus sûr. Nous faisons comme le cordonnier du tableau d’Apelles, et nous avons raison comme lui : mais si nous allions plus loin que le Beau dans l’espèce humaine et dans les objets matériels, nous pourrions aussi mériter la réprimande ne sutor ultra crepidam.
Je vois dans les prisonniers turcs et dans d’autres hommes venus de la Grèce, des preuves perpétuelles que l’Apollon et l’Hercule, par exemple, ne sont rien moins que des figures absolument idéales : à Paris je le croyois. Je sais aussi que dans la Crimée, Nord de la grande Grèce, on voit communément des femmes dont la tête est semblable à celle de la belle Niobé antique. Les naturels de ce pays, autrefois la Chersonèse Taurique, conservent encore les traits que nous admirons dans les belles statues grecques. Ils ne s’allient point avec les Turcs, les Tartares, ni avec d’autres nations qui leur soient étrangères. Le sang y est encore grec. Les écrivains spéculatifs qui font leurs observations à l’Opéra, dans nos cercles galans, et sur tous préaux où nos dames vont faire assaut de beauté, et qui ne voient que les hommes de nos villes, doivent nécessairement écrire sur le Beau comme ils en écrivent. Que ne peut-on dire sans offenser personne qu’un traité sur le Beau est presque toujours un cours de galimathias ! Platon tout grec et tout savant qu’il étoit, ne vous enseignera pas à le faire autrement, quoiqu’il ait peint, dit-on, dans sa jeunesse ; et je n’ai pas vu qu’il fut connoisseur dans le Beau relatif à l’art, si je puis en juger par ceux de ses ouvrages qui sont traduits.
Après avoir dit librement mon avis dans un autre écrit sur quelques erreurs de M. Winckelmann, je dois avec la même candeur convenir que je n’ai rien lu de mieux sur le Beau dans l’art que ce qu’il en a écrit : il étoit fondé sur l’unique base qui soit solide ; et soit qu’il doive cette vérité à ses conversations avec les artistes, soit qu’il la tienne de ses observations propres, il a touché le but. J’ai repris cet écrivain dans quelques endroits où je crois qu’il méritoit de l’être ; ce qui auroit pu s’étendre davantage : mais que sont les méprises d’un homme contre la raison qu’il peut avoir d’ailleurs ? Si l’envie me prenoit de rassembler ce qu’il y a de bon dans L’Histoire de l’art, je le ferois avec autant de franchise, et je pardonnerois à l’auteur d’avoir cru que la France n’a produit à peine que deux peintres de réputation. S’il a copié Vigneul Marville qui n’admet que le Poussin, le Sueur et à peine Le Brun, parce qu’il a fait plus d’ouvrages, c’est un homme qui s’acroche au premier mot qu’il trouve à sa bienséance, et qui s’en fait une autorité, quelque infirme qu’elle puisse être. Sa morgue et son mépris pour notre École lui ont fermé les yeux jusqu’à un excès souvent des plus ridicules. Trop de préjugés l’empêchoient d’apercevoir combien on peut compter d’artistes dans notre École qui malgré certaines préventions nationales, peuvent être mis au nombre des peintres de réputation. Mais un François qui ne reconnoîtroit pas la supériorité des grandes Écoles italiennes, et qui avec le courage (qui n’est pas toujours selon la science) et les connoissances légères de M. le Marquis d’Argens, s’efforceroit de nous grandir aux dépens de nos maîtres, auroit un droit à nos remercimens sans doute ; mais nous lui dirions : Prenez garde ; vous n’êtes pas armé à votre avantage, et vous ataquez des géants cuirassés de manière qu’ils sont invulnérables.
- [1] Voyez Analyse de la philosophie du chancelier Bacon, tome premier chap. 41.
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776), t. I, p. 189-190 (fran)
Les habitans de Crotone[1] formèrent le dessein d’enrichir de belles peintures un de leurs plus superbes temples. Pour cet effet, ils firent à grands frais venir dans leur ville le célèbre Zeuxis, qui avoit la réputation d’être le premier de son art. Zeuxis voulant mériter le choix qu’on avoit fait de lui, dit au peuple de Crotone : « Afin de vous laisser le modèle d’une beauté parfaite, je me propose de peindre pour vous une Hélène. » L’offre fut acceptée avec la plus grande joie, les Crotoniates ne pouvant ignorer que Zeuxis excelloit surtout à peindre des femmes. Leur espérance ne fut pas trompée. « Où sont vos plus belles jeunes filles ? » leur demanda-t-il. Alors les Crotoniates le menèrent à l’Académie, où les jeunes gens, tout nuds, étoient occupés à se former dans leurs exercices ; comme il considéroit attentivement les proportions et les corps de cette jeunesse robuste, et ne pouvoit se lasser d’en faire l’éloge : « Courage ! lui dirent-ils ; nous avons les sœurs de ces beaux garçons, et vous pouvez juger des unes par les autres. » « Eh bien, dit le peintre, faites m’en voir quelques-unes des plus belles, pour me donner l’idée de l’Hélène que je vous ai promise. » Aussitôt les Crotoniates s’assemblèrent ; et, par un décret public, ils firent venir en un même lieu toutes leurs filles, en accordant à Zeuxis la liberté de prendre celles qu’il trouveroit dignes de lui servir de modèles. Il en choisit cinq, qu’on doit regarder comme des beautés parfaites, puisqu’elles furent jugées telles, par l’homme qui avoit la plus grande idée des perfections de la nature ; mais il la surpassa, lorsqu’il réunit dans un tout idéal les charmes des cinq belles personnes qu’il eut longtemps sous les yeux[2].
Denys d’Halicarnasse dit simplement que, Zeuxis travaillant à une Hélène, qu’il peignoit sans draperies, les Crotoniates, qui estimoient beaucoup son pinceau, lui envoyèrent les plus belles filles qu’ils purent trouver dans la ville, afin qu’il fît passer dans son tableau les grâces qui l’auroient le plus frappé.
Quoi qu’il en soit, les Crotoniates, enchantés de la belle Hélène, que le pinceau de Zeuxis avoit fait naître parmi eux, ne la montrèrent d’abord que difficilement, et encore pour de l’argent ; ce qui donna lieu d’appeler cet excellent tableau, Hélène la courtisane[3].
Un de ces hommes froids, et incapables d’éprouver la moindre émotion à l’aspect du beau, remarquoit des défauts dans ce fameux ouvrage : que ne pouvez-vous le voir avec mes yeux ! s’écria le peintre Callimaque. Le même Callimaque ne pouvoit se lasser d’admirer ce chef-d’oeuvre, et passoit régulièrement une heure ou deux à le considérer.
- [1] Ancienne ville d’Italie, qui subsiste encore, dans le royaume de Naples.
- [2] Ce morceau est tiré de Cicéron, De invent. Lib. 2, cap. I. Plusieurs auteurs disent que ce furent des filles d’Agrigente qui servirent de modèles à Zeuxis.
- [3] Des auteurs prétendent que Zeuxis ne peignit point Hélène pour les habitants de Crotone, mais Vénus ; et Juste-Lipse soutient que ce fut Junon. Bayle, Carlo Dati, et la plupart des auteurs sont pour une Hélène.
Piron, Alexis, Œuvres complètes, t. VI(publi: 1778), A Madame la Comtesse de***, p. 120-121 (fran)
On sait qu'un statuaire grec,
Voulant en bronze, ou marbre, ou cire,
Représenter une Vénus,
A qui le plus subtil Argus,
Eût-il le savoir de Caylus,
En rien ne pût trouver à dire,
Rassembla dans son attelier
Tout ce qu'alors avoit la Grece
En belles de plus régulier,
Et puis choisit avec adresse
Ce que chacune avoit de mieux,
Pour en composer à son aise
Un tout qui fût délicieux;
Un tout digne d'orner les cieux,
Et de remplir de curieux
L'Attique et le Péloponnèse.
Saisi du trouppe précieux
De trente, une seule il en forge;
D'une brune prenant les yeux,
D'une blonde les bras, la gorge;
De l'une, le front radieux;
De l'autre, la taille céleste;
De celle-ci, l'air gracieux;
De celle-là, le maintien leste;
Là de l'élégant du joyeux,
Ici du noble et du modeste;
Sourcils, cheveux, ainsi du reste.
Monsieur le sculpteur, je vous vois.
Ah, vous vous délectez au choix!
Vraiment, je le crois bien! La peste!
Vous êtes plus heureux dix fois,
Que celui dont la main galante
Présenta la pomme brillante:
Le berger n'en jugea que trois,
Et vous en avez jugé trente.
Fréron, Élie, "Coup d'œil général sur les ouvrages de feu M. l'abbé le Batteux, de l'Académie Françoise, etc." (publi: 1780), p. 77-78 (fran)
Il[Explication : l’auteur, l’abbé Batteux.] a glissé rapidement sur la difficulté qui naît du principe ; sçavoir, ce que c’est que la belle nature. Il la définit ainsi : « ce n’est pas le vrai qui est, mais le vrai qui peut être, le beau vrai, qui est représenté comme s'il existoit réellement, et avec toutes les perfections qu’il peut recevoir ». Là-dessus, il rapporte l’exemple de Zeuxis, qui, voulant peindre une beauté parfaite, rassembla les traits séparés de plusieurs beautés existantes, et se forma dans l’esprit une idée factice qui résulta de tous ces traits réunis.
Cette définition et cet exemple sont fort justes pour ce qui regarde le beau physique, sur lequel on ne peut guère se tromper, puisque les yeux en sont les premiers juges ; et quoique chaque nation ait des idées un peu différentes sur la beauté ; quoiqu’une belle Chinoise ne fît pas grande sensation en Europe, et qu’une beauté moresque n’ait pas de grands charmes pour les yeux circassiens, il est pourtant vrai que le goût général se réunit pour ces modèles de beautés que les Grecs nous ont laissés. Mais quant au beau moral, il n’est pas si facile de fixer le point précis de sa perfection : or, vous sçavez que le beau physique domine beaucoup moins que le beau moral dans la poésie et dans l’éloquence. C’était sur ce point que l’abbé Le Batteux auroit dû étendre la première partie de son ouvrage, et tâcher de nous donner une idée précise de la belle nature, relativement aux mœurs.
Hayley, William, An Essay on Painting in two epistles to Mr. Romney(publi: 1781), p. 63 (anglais)
Note IX. Verse 210.
The gay, the warm, licentious Zeuxis drew. The Helen of Zeuxis is become almost proverbial: the story of the artist’s having executed the picture from an assemblage of the most beautiful females is mentioned (though with some variation as to the place) by authors of great credit, Pliny, Dionysius of Halicarnassus, and Cicero. The last gives a very long ad circumstantial account of it.
De Inventione, lib. 2.
If the story is true, it is perhaps one of the strongest examples we can find of that enthousiastick passion for the fine arts which animated the ancients. Notwithstanding her praeminence in beauty, it seems somewhat singular that the painter should have chosen such a character as Helen, as a proper decoration for the Temple of Juno. A most celebrated Spanish Poet, though not in other respects famous for his judgment, has, I think, not injudiciously metamorphosed this Helen of Zeuxis into Juno herself.
Zeusis, Pintor famoso, retratando
De Juno el rostro, las faciones bellas
De cinco perfettissimas donzellas
Estuvo attentamente contemplando.
Rimas de Lope de Vega. Lisboa, 1605, p. 51-52.
Junius supposes this picture to have been rated a little to high.
Barry, James, Lecture II, On Design(redac: 1784:1798), p. 96-97 (anglais)
There is a strange passage in one of Lord Bacon’s essays respecting this principle of selection from aggregate nature, which is very unworthy his fine and penetrating genius. The passage is as follows: In beauty, that of favor is more than that of color; and that of decent and gracious motion more than that of favor. That is the best part of beauty which a picture cannot express; no, nor the first sight of the life. There is no excellent beauty that hath not some strangeness in the proportion. A man cannot tell whether Apelles or Albert Durer were the more trifler; whereof the one would make a personage by geometrical proportions; the other, by taking the best parts out of divers faces, to make one excellent. Such personages, I think, would please nobody but the painter that made them. Not but I think a painter may make a better face than ever was, but he must do it by a kind of felicity, as a musician that maketh an excellent air in music, and not by rule. A man shall see faces, that if you examine them part by part, you shall find never a good; and yet altogether do well.
On this passage I shall just observe, that though it be true that this excellent beauty may (as he observes) have some strangeness in the proportion, yet it does not follow but that this disproportion or strangeness might be happily avoided by a judicious artist, whilst that which is beautiful was alone imitated. As to the faces good only in the whole result, and not in the parts, it is the proportionate arrangement only that pleases, and not the disagreeable particulars. Nature is here, as the Italians feelingly express it, but ben sbozzata, well sketched out : adequate finishing is wanting. The business of art is harmoniously to unite the beautiful parts of the former with this beautiful proportionate arrangement of the latter; and if Lord Bacon had understood the subject better, he would have found that it was by this conduct only (which he had unwarily condemned in Apelles) that any true beauty could be produced, which should be no less admirable in its several component parts than in the proportionate and harmonious arrangement of the whole together. As to the possibility of producing any excellence by those happy dashes which resemble the musical felicity, they may perhaps, according to the old story of the painted horse, be allowed to effect something in the imitation of froth and bubble, but that is all. However, the ignorance of our admirable Bacon in matters of this kind was very excusable at a time when, from the mistaken notions of religion, all elevated and artist-like exertions were proscribed in his country, where the wretched business of face-painting bounded the national prospect.
Junker, Carl Ludwig, Jupiter eine Antike, zugleich ein Muster, für die würdige sinnliche Darstellung des ewigen Vaters(publi: 1786), p. 37 (allemand)
Zur Göttin seiner Schönheit borgte der griechische Künstler einzelne Züge: das Ideal iener Schönheit bestand blos in glücklicher Verbindung einzelner Schönheiten zu einem Ganzen. Denn γραφικη ἐσιν εἰκασια των ὠρομενων. Socrates apud Xenoph.
Junker, Carl Ludwig, Jupiter eine Antike, zugleich ein Muster, für die würdige sinnliche Darstellung des ewigen Vaters, (trad: 1798), p. 329 (trad: "De la manière de représenter le Père éternel, d’après les idées des Grecs" par Jansen, Hendrick en 1798)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Pour représenter la déesse de la beauté, l’artiste grec emprunta des traits isolés ; et l’idéal que son génie créa ne consistait que dans l’heureuse réunion de beautés éparses.
Marmontel, Jean-François, Élémens de littérature(publi: 1787), art. « Comédie », t. II, p. 140 (fran)
La tragédie est un tableau d’histoire ; la comédie est un portrait : non le portrait d’un seul homme, comme la satire, mais d’une espèce d’hommes répandus dans la société, et dont les traits les plus marqués sont réunis dans une même figure.
Marmontel, Jean-François, Élémens de littérature(publi: 1787), article « Fiction », t. III, p. 425-429 (fran)
Fiction. Production des arts, qui n’a point de modèle complet dans la nature.
L'imagination compose et ne crée point: ses tableaux les plus originaux ne sont eux-mêmes que des copies en détail; et c'est le plus ou le moins d'analogie entre les differens traits qu'elle assemble, qui constitue les quatre genres de fiction que nous allons distinguer, savoir, le parfait, l'exagéré, le monstrueux, et le fantastique.
La fiction qui tend au parfait, ou la fiction en beau, est l’assemblage régulier des plus belles parties dont un composé naturel soit susceptible; et dans ce sens étendu, la fiction est essentielle à tous les arts d’imitation. En peinture, les Vierges de Raphaël et les Hercule du Guide n’ont point dans la nature de modèle individuel ; il en est de même, en poésie, des caractères d’Andromaque, de Didon, d’Orosmane, etc. Qu’ont fait les artistes ? Ils ont recueilli les beautés éparses des modèles existans, et en ont composé un tout plus ou moins parfait, suivant le choix plus ou moins heureux de ces beautés réunies. Voyez, dans l'article critique, la formation du modèle intellectuel, d'après lequel l'imitation doit corriger la nature. […]
La fiction doit être une peinture de la vérité, mais de la vérité embellie par le choix et par le mélange des couleurs et des traits qu’elle puise dans la nature. Il n’y a point de tableau si parfait dans la disposition naturelle des choses, auquel l’imagination n’ait pas encore à retoucher. La nature, dans ses opérations, ne pense à rien moins qu’à être pittoresque : ici, elle étend des plaines, où l’œil demande des collines; là, elle resserre l’horizon par des montagnes où l’œil aimeroit à s’égarer dans le lointain. Il en est du moral comme du physique; l’histoire a peu de sujets que la poésie ne soit obligée de corriger et d’embellir, pour les adapter à ses vues. C’est donc au peintre à composer des productions et des accidens de la nature un mélange plus vivant, plus varié, plus attachant que ses modèles. Et quel est le mérite de les copier servilement ? Combien ces copies sont froides et monotones, auprès des compositions hardies du génie en liberté ! Pour voir le monde tel qu’il est, nous n’avons qu’à le voir en lui-même ; c’est un monde nouveau qu’on demande aux arts, un monde tel qu’il devroit être, s’il n’étoit fait que pour nos plaisirs. C’est donc à l’artiste à se mettre à la place de la nature, et à disposer les choses suivant l’espèce d’émotion qu’il a dessein de nous causer, comme la nature les eût disposées elles-mêmes, si elle avoit eu pour premier objet de nous donner un spectacle riant, gracieux, ou touchant, ou terrible.
Commentaires :
Pauw, Cornélius de, Recherches philosophiques sur les Grecs(publi: 1788), « Considérations sur l’état des beaux-arts à Athènes », §1, « De la peinture, et de la Vénus et Cos et de Gnide » (numéro III, 7) , t. II, p. 71 (fran)
Cicéron assure que dans une ville telle que Crotone, où selon quelques historiens la population excédoit cent-mille habitans, Zeuxis ne put rencontrer un seul individu capable de servir de modèle à une figure d’Hélène qu’il vouloit représenter dans le temple de Junon sur le promontoire de Lacinium : il dut choisir jusqu’à cinq vierges Crotoniates, dont il copia les beautés individuelles, pour en former un ensemble idéal, qui ne répondit pas à beaucoup près dans l’exécution aux grandes espérances qu’on en avoit conçues dans la théorie ; car nous avons déjà eu l’occasion de prouver que cette Hélène de Zeuxis n’étoit point un tableau de la première force : il fixoit les regards de quelques artistes, mais n’attiroit pas la multitude comme la Cassandre de Polygnote, qui étoit encore fameuse au temps de Lucien.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), art. « Sculpture », « Sculpture chez les Grecs », p. 324 (fran)
La beauté ne se trouvant pas également parfaite dans toutes les parties d’un même individu, il faut la considérer comme un choix des plus belles parties prises dans différens modèles ; mais avec tant de soin et d’intelligence, que ces parties détachées de différens corps, ont entre elles cet accord parfait d’où résulte un beau tout.
Il paroît que les anciens se bornèrent quelquefois au beau individuel, même dans les siècles les plus florissans de l’art. Théodote, à qui Socrate fit une visite avec ses disciples, servoit de modèle aux artistes de son temps. Il est probable aussi que Phryné servit quelquefois seule de modèle à des peintres et à des sculpteurs. Mais Socrate, dans son entretien avec Parrhasius, nous apprend que, pour s’élever à une beauté plus parfaite, les artistes réunissoient dans une seule figure les beautés de plusieurs corps, et nous savons que Zeuxis, pour peindre son Hélène, choisit les différentes beautés des plus belles femmes de Crotone.
Barthélémy, Jean-Jacques, Le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire(publi: 1788), « Description d’Athènes » (numéro Seconde partie, Section troisième, Siècle de Périclès, chapitre XII) , vol. 1, p. 397 (fran)
Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long de la rue, et qu’on a singulièrement multipliés dans la ville. Les uns sont isolés ; d’autres, appliqués à des bâtiments auxquels ils servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent une partie de la journée. On voit dans presque tous, des peintures et des statues d’un travail excellent. Dans celui où l’on vend la farine[1], vous trouverez un tableau d’Hélène, peint par Zeuxis[2].
- [1] Hesych. In Αλφίτ. Aristoph. in eccles. v. 682.
- [2] Eustath. in iliad. Lib. 11, p. 868, lin. 37.
Barthélémy, Jean-Jacques, Le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire(publi: 1788), « Extrait d’un voyage sur les côtes de l’Asie, et dans quelques-unes des îles voisines » (numéro Seconde partie, Section troisième, Siècle de Périclès, ch. LXXII) , vol. 4, p. 107-108 (fran)
Combien fut plus estimable la candeur de cet Athénien qui se trouva par hasard au portique où l’on conserve la célèbre Hélène de Zeuxis ! Il la considéra pendant quelques instants ; et moins surpris de l’excellence du travail, que des transports d’un peintre placé à ses côtés, il lui dit : mais je ne trouve pas cette femme si belle. C’est que vous n’avez pas mes yeux, répondit l’artiste[1].
- [1] Plut. ap. Stob. serm. 61, p. 394. Ælian. var. hist. lib. 14, p. 47.
Füssli, Johann Heinrich, Lecture I. On Ancient Art(redac: 1801/03/16), p. 358-359 (anglais)
From the essential style of Polygnotus, and the specific discrimination of Apollodorus, Zeuxis, by comparison of what belonged to the genius and what to the class, framed at last that ideal form, which, in his opinion, constituted the supreme degree of human beauty, or, in other words, embodied possibility, by uniting the various but homogeneous powers scattered among many, in one object, to one end. Such a system, if it originated in genius, was the considerate result of a taste, refined by the unremitting perseverance with which he observed, consulted, compared, selected the congenial but scattered forms of nature. Our ideas are the offspring of our senses: we are not able to create the form of a being we have not seen, without retrospect to one we know, than we are able to create a new sense. He whose fancy has conceived an idea of the most beautiful form, must have composed it from actual existence, and he alone can comprehend what one degree of beauty wants to become equal to another, and at last superlative. He who thinks the pretty handsome, will think the handsome a beauty, and fancy he has met an ideal form in a merely handsome one; whilst he who has compared beauty with beauty, will at last improve form upon form to a perfect image: this was the method of Zeuxis, and this he learnt from Homer, whose model of ideal composition, according to Quintilian, he considered his model[1]. Each individual of Homer forms a class, expresses and is circumscribed by one quality of heroic power; Achilles alone unites their various but congenial energies. The grace of Nireus, the dignity of Agamemnon, the impetuosity of Hector, the magnitude, the steady prowess of the great, the velocity of the lesser Ajax, the perserverance of Ulysses, the intrepidity of Diomede, are emanations of energy that reunite in one splendid centre fixed in Achilles. This standard of the unison of homogeneous powers exhibited in successive action by the poet, the painter, invigorated, no doubt, by the contemplation of the works of Phidias, transferred to his own art, and substantiated by form, when he selected the congenial beauties of Croton to compose a perfect female[2].
- [1] Quintilian (Inst. Orator. XII. 10) says that Zeuxis followed Homer, and loved powerful forms even in women. W.
- [2] This was for a picture of Helen for the temple of Juno Lacinia at Croton, and which Zeuxis painted from five virgins of that place. Zeuxis exhibited this picture for a head-money, before it was placed in its destination, whence it acquired the nick-name of the Prostitute (Cicero, De Invent. II, 1 ; Aelian, Var. Hist. IV, 12). W.
Füssli, Johann Heinrich, Lectures on Painting, (trad: 1994), Première Conférence: de l'art antique, p. 19-20 (trad: "Conférences sur la peinture" par Chauvin, Serge en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
À partir du style de Polygnote, qui traitait des essences, et de la distinction par espèce d’Apollodore, Zeuxis, en comparant ce qui procédait du genre et ce qui relevait de la classe, cerna enfin cette forme idéale, qui dans son opinion constituait le degré suprême de beauté humaine, ou, en d’autres termes, en incarnait la possibliité, en unissant les forces diverses mais homogènes dispersées parmi tant d’objets en un seul, à une fin unique. Un tel système, s’il trouvait son origine dans le génie, était le résultat réfléchi d’un goût affiné par la persévérance sans faille avec laquelle il avait observé, consulté, comparé et sélectionné les formes, dispersées mais en affinité, de la nature. Nos idées sont le fruit de nos sens, nous ne sommes pas plus capables de créer la forme d’un être que nous n’avons pas vu sans nous référer à un autre que nous connaissons, que nous ne sommes à même de créer un nouveau sens. Celui dont l’imagination a conçu une idée de la forme la plus belle doit l’avoir composée à partir de la réalité existante, et lui seul peut saisir ce qui fait défaut à un degré de beauté pour devenir égal à un autre, et enfin superlatif. Celui qui trouve le joli élégant prendra l’élégance pour de la beauté, et s’imaginera avoir rencontré une forme idéale alors qu’elle n’est qu’élégante, tandis que celui qui a comparé la beauté à la beauté pourra progresser de forme en forme jusqu’à parvenir à une image parfaite ; telle était la méthode de Zeuxis, qu’il avait apprise chez Homère, dont selon Quintilien il prenait pour modèle le mode de composition idéal. Chaque individu homérique forme une classe, exprime, et est délimité par, une qualité unique de puissance héroïque ; seul Achille unit leurs énergies diverses quoiqu’en affinité. La grâce de Nirée, la dignité d’Agamemnon, l’impétuosité d’Hector, la grandeur et les prouesses constantes d’Ajax le Grand, la vélocité de l’autre Ajax, la persévérance d’Ulysse, l’intrépidité de Diomède, sont autant d’émanations d’énergie qui se rassemblent en un centre radieux fixé autour d’Achille. Ce modèle d’unisson de forces homogènes exposées en action successive par le poète, le peintre, stimulé sans aucun doute par la contemplation des oeuvres de Phidias, l’a greffé sur son art propre en lui conférant sa substance par la forme, lorsqu’il choisit les affinités des beautés de Crotone pour composer une forme féminine parfaite.