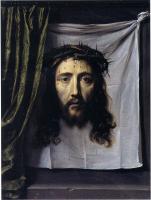Zeuxis et Parrhasios : les raisins et le rideau
Bibliographie
Images
Zeuxis peignant les raisins Le Maître De Pétrarque (WEIDITZ DER JÜNGERE Hans )
Medium : gravure sur bois
Pas de fichier image pour cette oeuvre
L’Enfant à la corbeille de fruits Le Caravage (MERISI DA CARAVAGGIO Michelangelo )
Medium : huile sur toile
La Sainte Famille avec un rideau Rembrandt (VAN RIJN Rembrandt Harmenszoon )
Medium : huile sur bois
Nature morte de fleurs avec un rideau VAN DER SPELT Adriaen VAN MIERIS Frans
Medium : huile sur bois
Commentaires : signé [Van der Spelt] et daté
Trompe-l’œil GYSBRECHTS Cornelis Norbertus
Medium : huile sur toile
Pas de fichier image pour cette oeuvre
L'Art de la peinture (L'Atelier, La Peinture, L'Allégorie de la Peinture) VERMEER Johannes
Medium : huile sur toile
Zeuxis peignant l’Enfant aux raisins (Pas d'information sur l'artiste)
Medium : peinture à l’encaustique ?
Tesauro, Emmanuele, Il cannocchiale aristotelico, o sia idea delle argutezze heroïche, vulgarmente chiamate imprese, e di tutta l’arte simbolica e lapidaria, esaminata in fonte co’ rettorici precetti del divino Aristotele, che comprendono tutta la Rettorica, e Poetica elocuzione(publi: 1654), "Idea delle Argutie Heroiche", p. 122 (italien)
Assai è con una metafora ingannare animali; più è l'ingannar' huomini. Nel più famoso duello de' penelli che mai vedesse la Grecia; vantando Zeusi di volere in concorrenza di Parrasio, esprimere una uva così naturale, che inviterebbe gli ucelli a darle di becco; sicome in fatti con ammiration de' giudici, si videro a quell'esca fallace correre i tordi; l’emulo produsse il suo quadro, il qual pareva havere un velo trasparente davanti all’uva ; cosi felicemente dipinto, che Zeusi, fatta la sua sperienza, quasi trionfando gridò : Hor togli tu del quadro cotesto velo. Furono grandi le risa, e gli applausi de’giudici ; vedendo che Zeusi (sic) haveva uccellato l’uccellatore. Et cosi, chi disperava di poter vincere con l’Arte, vinse col l’Ingegno.
Fénelon, François de Salignac de la Mothe, Dialogue des morts(publi: 1718, redac: 1692:1696), « Parrhasius et Poussin », vol. 2, p. 608 (fran)
PARRHASIUS
Je suis ravi de trouver un peintre moderne si équitable et si modeste. Vous comprenez bien que, quand Zeuxis fit des raisins qui trompaient les petits oiseaux, il fallait que la nature fût bien imitée pour tromper la nature même. Quand je fis ensuite un rideau qui trompa les yeux si habiles du grand Zeuxis, il se confessa vaincu. Voyez jusqu’où nous avions poussé cette belle erreur. Non, non, ce n’est pas pour rien que tous les siècles nous ont vantés.
Giarda, Cristoforo, Bibliothecae Alexandrinae Icones symbolicae P. D. Christofori Giardae cler. Reg. S. Pauli elogiis illustratae(publi: 1626), p. 95 (latin)
Est enim poesis, queadmodum pictura naturae studiosissima aemulatrix, usque adeo, ut qui harum peritissimi artium habentur, virtutem illarum, ac laudem in hac perfecta imitatione repositam arbitrentur. Certant itaque sorores ambae, atque hoc incensae studio in arenam quodammodo, ut olim Zeusis, et Parrhasius celeberrimi pictores fecisse memorantur, de imitationis palma sollicitae descendunt. Imitatur utraque naturam, et rerum, et artium communem parentem, coloribus pictura, sententiis ars poetica ; lineamentis illa, haec argumentis ; illa figuris, haec dicendi formis ; umbris illa, haec verbis ; illa vitricem se putat, quod oculis res subjiciat, ac eosdem saepius fallat, haec se se ostentat, quod animis res exprimat, ac illos in fraudem saepissime impellat. Pictura corporum effictrix tantum ; poesis non modo corporum, sed imitatrix etiam animorum, audax pictura ; audacior (p. 96) tamen poetica. Quoties illa quinam cervicem humano junxit capiti ? Quoties mulier ore pulcherrima. Ut in piscem utrpiter desineret, effecit ? Quoties aprum Mari, delphinum sylvis appinxit ? Quod enim vero portentum, quae chymera, quod monstrum est tam ex diversis, et inter se pugnantibus naturis, quod sua cogitatione libera poesis non conflarit, compactum in caetus hominum non invexerit, inlatum plausibile non reddiderit ? Sed meum non est litem hanc inter sorores componere. Illud quidem non abs re mea existimo, ab illa, quae ambas inter reperitur, similitudine probare poesim esse picturam loquentem, picturam vero tacitam poesim. Ut enim in pictura multa sunt quae si eminus contempleris, capiunt magis, et placent ; quaedam alia, si cominus, et longius ; ita procul dubio, plura sunt in poesi, quae condi volunt, alia, quae bono lumine constituta magis delectant.
Commentaires :
Thévet, André, Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecs, latins et paiens(publi: 1584), chapitre 92, « Eudes de Monstreul », fol. 503r-v (fran)
Je pouvoie icy employer, pour preuve de mon dire, l’estime qu’on a faict des peintures de Timarele (sic), Irene, Calypso, Aristarete et Lala Cyzena si je ne sembloye vouloir preferer les femmes à Zeuziz, Parrhase, Apelles, Aristides, Polygnote, Euphranor, et plusieurs autres excellens pourtrayeurs, aucuns desquels ont avec si grand heur rencontré, que nous lisons que les raisins pourtraicts par Zeuzis inviterent les oyseaux à les venir bequeter, et le cheval d’Apelles en platte peinture esmeut les naturels à hennir.[1]
- [1] voir aussi Femmes peintres, Apelle Cheval
Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiæ (redac: :(39), trad: 1932) (X, 27-28 (Reinach 237))(latin)
Traditur enim Zeuxin, ut puto, pinxisse puerum uuam tenentem, et, cum tanta esset similitudo uuae, ut etiam aues aduolare faceret operi, quemdam ex spectatoribus dixisse aues male existimare de tabula ; non fuisse enim aduolaturas, si puer similis esset. Zeuxin aiunt obleuisse uuam et seruasse id, quod melius erat in tabula, non quod similius.
Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiæ , (trad: 1932) (X, 5, 27)(trad: "Controverses " par Bornecque, Henri en 1932)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
On raconte que Zeuxis, je crois, peignit un enfant tenant une grappe de raisin et que, comme le raisin était d’une ressemblance si grande qu’il attirait les oiseaux, un spectateur déclara que les oiseaux faisaient la critique du tableau ; car ils n’auraient osé s’approcher si l’enfant eût été ressemblant. Zeuxis, dit-on, effaça le raisin et conserva la partie la meilleure, non la plus ressemblante du tableau.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (65-66)(latin)
Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur et, cum ille detulisset uuas pictas tanto successu, ut in scaenam aues aduolarent, ipse detulisse linteum pictum ita ueritate repraesentata, ut Zeuxis alitum iudicio tumens flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam atque intellecto errore concederet palmam ingenuo pudore, quoniam ipse uolucres fefellisset, Parrhasius autem se artificem. Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uuas ferentem, ad quas cum aduolassent aues, eadem ingenuitate processit iratus operi et dixit: « uuas melius pinxi quam puerum, nam si et hoc consummassem, aues timere debuerant. »
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Parrhasius entra en compétition avec Zeuxis : celui-ci avait présenté des raisins si heureusement reproduits que les oiseaux vinrent voleter auprès d’eux sur la scène ; mais l’autre présenta un rideau peint avec une telle perfection que Zeuxis, tout gonflé d’orgueil à cause du jugement des oiseaux, demanda qu’on se décidât à enlever le rideau pour montrer la peinture, puis, ayant compris son erreur, il céda la palme à son rival avec une modestie pleine de franchise, car, s’il avait personnellement, disait-il, trompé les oiseaux, Parrhasius l’avait trompé, lui, un artiste. On rapporte que Zeuxis peignit également, plus tard, un enfant portant des raisins : des oiseaux étant venus voleter auprès de ces derniers, en colère contre son œuvre, il s’avança et dit, avec la même franchise : « J’ai mieux peint les raisins que l’enfant, car, si je l’avais aussi parfaitement réussi, les oiseaux auraient dû avoir peur ».
Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Dicono che costui contese del dipignere con Zeusi et havendo Zeusi arrecato uve depincte tanto appuncto che gl’ulceri (sic) credendo che fussino vere uve vi volavano. Nella scena lui produxe un lenzuolo dipincto elquale pareva tanto vero che Zeusi lo stimolava che rimovessi la vela e mostrassi la pictura e conosciuto l’errore si chiamo vincto con ingenua vergogna perche lui havea ingannato gl’uccelli e Parrhasio havea ingannato lui elquale era artefice. Dicono che dipoi Zeusi dipinxe un fanciullo che portava uve allequali volando gl’uccelli. Con la medesima vergogna s’adirò con lopera sua dicendo Io dipinxi meglio l’uve che el fanciullo. Imperoche se io havessi dipicto a perfectione el fanciullo gl’uccelli l’harebbono temuto.
Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 987 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Dicesi, che costui contese nel dipignere con Zeusi, et havendo quello portate uve dipinte, tanto simili, che nelle scene gli uccegli vi volavono sopra. Et esso vi produsse un lenzuolo dipinto, che in modo rapresentava il proprie, che Zeusi gonfiato pel giudicio degli uccegli, finalemente domandasse, che levato il lenzuolo, mostrasse la pittura, e conosciuto l’errore, gli concede la palma, con ingenua vergogna, perché esso haveva ingannati gli uccegli, e Parrasio se artefice. Dicesi che dipoi Zeusi dipinse un fanciullo, che portava uve, sopra lequali volando uno uccello, con il medesimo sdegno si adirò con la opera sua, et disse. Io ho dipinto meglio le uve che il fanciullo, perche se anchora questo havessi recato à perfettione, gli uccegli l’harieno temuto.
Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1096 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Dicono che questo Parrasio dipinse a pruova con Zeusi; e havendo Zeusi arrecate uve dipinte tanto bene, che gli uccelli credendo che fossero uve vere, volarono a beccarle; egli mise fuori un lenzuolo dipinto ilquale pareva tanto vero, che Zeusi solecitava pure a dirgli, ch’e’ levasse la vela, e mostrasse la pittura; e conosciuto l’errore, si chiamò per vinto con nobil vergogna ; perche egli haveva ingannato gli uccegli, e Parasio haveva ingannato lui, ch’era artefice. Dicono, che Zeusi dipinse poi un fanciullo, che portava l’uve, allequali volando gli uccegli, con la medesima vergogna s’adirò contra l’opera, dicendo, io ho saputo dipignere meglio l’uve, che’l fanciullo. Percioche se io havessi ridotto bene a perfettione il fanciullo, gli uccegli ne havrebbono havuto paura.
Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 944 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
On dit que Parasius presenta le collet, en fait de peinture, à Zeuxis, auquel combat Zeuxis produit sur l’eschaffaut un tableau de raisins peints si au vif, que les oiseaux le venoyent becquer sur l’eschaffaut mesme. Au contraire Parasius apporta un linceul peint si au naturel, que Zeuxis se glorifiant des becquades que les oyseaux avoyent donnees à ses raisins, dit tout haut, comme par moquerie, qu’il estoit temps d’oster le linceul, pour voir quelle piece Parasius avoit apportee. Mais cognoissant par apres que ce n’estoit que peinture, et se trouvant confus, usa neantmoins d’une grande honnesteté à ceder le prix à Parasius : disant, qu’il avoit bien eu le moyen de tromper les oiseaux : mais que Parasius avoit fait d’avantage de l’avoir trompé luy-mesme, qui s’estimoit consommé en l’art de peinture. On dit aussi que Zeuxis fit depuys un garçon, portant une grappe de raisins : et voyant que les oiseaux y venoyent becquer cint contre son tableau bien fasché, blasmant son ouvrage mesme, d’une grande sincerité, confessant qu’il avoit mieux fait les raisins que le garçon : car si le garçon eust esté fait entierement selon le naturel, les oiseaux eussent craint de venir becquer les raisins.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 237 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
On raconte que Parrhasius entra en lutte avec Zeuxis ; que celui-ci exposa dans cette lutte un tableau représentant des grappes de raisin, peintes tellement au naturel, que les oiseaux venoient les becqueter sur l’échaffaud ; que de son côté Parrhasius produisit un tableau représentant une toile avec tant de vérité ; que Zeuxis, tout orgueilleux du succès de ses grappes, et du suffrage des oiseaux, demanda avec instance qu’on levât enfin cette toile pour voir ce qui étoit dessous ; et qu’ayant reconnu son erreur, il s’avoua ingénuement vaincu, d’autant qu’il n’avoit trompé que les oiseaux, et que Parrhasius avoit trompé un artiste tel que Zeuxis. On dit qu’ensuite[1] Zeuxis peignit un enfant portant des grappes de raisin, lesquelles un oiseau vint pour becqueter ; et qu’à cette vue il fit avec même ingénuité le procès à son ouvrage. J’ai mieux peint les grappes que l’enfant, s’écria-t-il ; car si j’eusse bien consommé celui-ci, l’oiseau auroit craint d’en approcher.
- [1] Voyez Séneque, in Controv. 34, liv. 5.
Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 69 (italien)
- [1] r
- [2] n
Questo Pa[1]as[s]o si pruovò con Zeusis, secondo che scrive Prinio, archo dipinto uno linteo, e Zeusis uno grappolo d’uve, fatto con tanta maravigla che, essendo scostati, gl’uccielli andavano per beccarlo; Zeusis, leva lo intellecto tuo e non rimane nulla della tua pictura, ma di me rimane ingannati gli uccegli. Co[2] questa vergogna li concedette la victoria. Poi si dice che Zeusis dipinse uno fanciullo portante uve, al quale quando gl’ uccelli venivano per becchare dell’uve, Zeusis, considerato che la perfectione era nell’uve e non nel fanciullo, imperò che se il fanciullo avesse avuto la perfetta pictura arebbono temuto el fanciullo, quasi adirato, cercò di racconciare la figura.
Ferabos, Giovanni Antonio, « Imago ejusdem principis a Pietro burgensi picta alloquitur ipsum principem » (Vat. Cod. Urb. Lat. 1193, fol. 114)(publi: 1466), n. 8 p. 319 (latin)
Qui capit aut falso palmite Zeuxis aves.
Ferabos, Giovanni Antonio, « Imago ejusdem principis a Pietro burgensi picta alloquitur ipsum principem » (Vat. Cod. Urb. Lat. 1193, fol. 114), p. 58 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Ce n’est pas non plus Zeuxis, qui a trompé les oiseaux avec ses fausses grappes de raisin.
Commentaires : Trad. É. Pommier, 1998, p. 58
Leonardo da Vinci, Libro di pittura(publi: 1651, redac: 1485:1519), “Del poeta e del pittore” (numéro I, 14) , t. I, p. 138-139 (italien)
Con questa[Explication : pittura.] si muove gli amanti inverso li simulacri della cosa amata a parlare con le imitate pitture; con questa si muove li popoli con infervorati voti a ricercare li simulacri degli idii; e non van vedere l’opere de’ poeti, che con parole figurino li medesimi idii. Con questa s’ingannano li animali: già vid’io una pittura che ingannava il cane mediante la similitudine del suo padrone, alla quale esso cane faceva grandissima festa; e similmente ho veduto i cani baiare, e voler mordere li cani dipinti; et una scimmia fare infinite pazzie contro ad una scimmia depinta. Ho veduto le rondine volare e posarsi sopra li ferri depinti che spuntano fuori delle finestre degli edifizi.
Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres(publi: 1583, redac: 1488), fol. 17r-v (latin)
Nec Zeuxis inferior pictura Sander habetur,
Ille licet volucres pictis deluserit uvis.
Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres, p. 196 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Sandro n’est pas tenu pour inférieur à Zeuxis, même si celui-ci a su tromper les oiseaux par ses raisins peints.
Schedel, Hartmann, Liber Chronicarum(publi: 1493), fol. LXXI (latin)
Zeuxis heracleotes maximus pictor et ipse aetate hac (ut Eusebius habet) inclitus fuit. Qui Plinio teste lib. 35 naturalis historie peniculum ad magnam gloriam perduxit. Opes tantas acquisivit ut institueret donare opera sua: eoque nullo precio satis digno permutari posse diceret. Pinxit autem ut idem Plinius ait puerum uvas ferentem ad quas aduolarent aues: processit iratus operi et dixit: uvas melius pinxi quam puerum tam et si hunc consumasses aues ipse timuissent. Idem etiam secundum Quintilianum umbrarum inuentor perhibetur. Parrasius quoque hac etate summus pictor cum predicto Zeuxide in certamen descendit. Et cum Zeuxis detulisset uvas tanto decore pictas ut aues aduolarent, ipse lintheum auibus pictum detulisse traditur. Ita veritatem representantis ut Zeuxis alitum iudicium afflagitaret. Sed tandem remoto lintheo et ostensa pictura atque errore intellecto palmam ingenuo pudore concesserit Parrasio: quoniam ipse aues fefellisset.
Patrizi, Francesco (da Siena), De institutione reipublicae libri IX, l. I, chap. 10, De pictura, sculptura, & caelatura, & de earum inuentoribus, &qui in illis profecerint(publi: 1494), fol. 86r-v (annotations) (fran)
Quant aux raisins peints voicy qu’en dit Pline livre 35, ch. 10. On dit que Parrhasius présenta le collet en fait de peinture à Zeuxis, auquel combat Zeuxis produisit sur l’eschaufaut un tableau de raisins peints si au vif, que les oiseaux les venoient becqueter sur l’eschaufaut mesme. Au contraire Parrhasius apporta un linceul peint si au naturel, que Zeuxis se glorifiant des becquades, que les oiseaux avaient donnez à ses raisins, dit tout hault, comme par mocquerie, qu’il estoit temps d’oster le linceul, pour veoir quelle piece Parrhasius avait apportée. Mais cognoissant par après, que ce n’estoit que peinture, et se trouvant confus, usa néantmoins d’une grande honnesteté à céder le prix à Parrhasius, disant, qu’il avait bien eu le moyen de tromper les oiseaux, mais que Parrhasius avoit fait d’avantage, de l’avoir trompé luy-mesme, qui s’estimoit consommé en l’art de peinture. Autant en dit Clément Alexandrin en son exhortation aux Gentils.
Pacioli, Luca, De divina proportione(publi: 1509, redac: 1496:1498), « Quello che significa e importi questo nome mathematico e discipline mathematici » (numéro cap. III) , p. 17 (italien)
Commo de Xeuso anco se leggi in Plinio « De picturis », che siando a contrasto del medesmo exercitio con Parrasio, sfidandose de pennello quello feci una cesta d’uva con suo’ pampane inserta, e posta in publico gli ucelli vinse commo a vera, a se gettarse. E l’altro feci un velo. Alhora Xeuso disse a Parrasio, havendolo ancor lui posto in publico e credendo fosse velo che coprisse l’opera sua facta a contrasto : « Leva via el velo e lassa vedere la tua a ogni uno commo fo la mia ». E così rimase vincto perché se lui li uccelli animali irrationali, e quello uno rationale e maestro ingannò. Se forse el gran dilecto el summo amore a quella – ben che di lei ignaro – non m’inganna, e universalmente non è gentile spirito a chi la pictura non dilecta, quando ancor l’uno e l’altro animale rationale et irrationale, a sè alice.
Savonarole, Prediche sopra Amos e Zaccaria(publi: 1496), vol. II, p. 274-276 (italien)
Per accidens, e questo è quando col senso esteriore vedi una cosa, e la fantasia te n’appresenta un’altra: verbigrazia, io vi vedo qua tutti con l’occhio, e alla fantasia s’apresenta e a l’intelletto che voi siate vivi, non già che l’occhio possa vedere la vita, ma perché l’occhio vede la figura e il colore e li movimenti e rappresentali a l’intelletto; l’intelletto poi giudica la vita, e benché la vita non si vegga, tamen e’ si dice: – Io veggo che tu se’ vivo –, ma questo vedere si domanda per accidens. E questo è quello dove io ti voglio. Dice santo Augustino che l’occhio nostro in Paradiso vedrà la maestà di Dio, non che l’occhio la vegga per obietto proprio, ma vedendo la luce che nelli corpi resplenderà, iudicherà l’intelletto e conoscerà che quivi è presente la maestà di Dio: Ille est qui habitat lucem inaccessibilem quam nemo vidit umquam; sicché questo vedere del beato sarà per accidens. Praeterea la pecorella immediate che la vede el lupo, fa concetto che sia suo nimico, se ben lei non l’avessi mai visto prima; non che l’occhio della pecora vegga la nimicizia, ma questo vedere si chiama per accidens per la estimativa che così gli giudica. A volere adunque far buon giudizio, bisogna avere buon occhio, buona estimativa e buona fantasia, altrimenti non si potrebbe ben iudicare. Verbigrazia, e’ son certi dipintori che fanno figure che paion vive, ma chi ha buon occhio e buona fantasia, subito che vede quella figura, iudica che la è morta e non è viva; ma chi avessi cattivo occhio saria qualche volta ingannato e giudicheria, vedendo là una figura d’un uomo un poco discosto, che’l fussi un uomo vivo. Vedi che l’uccellino che non ha buon occhio e vede là nel campo un uomo di stracci coll’arco, il quale mettono questi contadini ne’ campi, e credi che sia un uomo vivo e fugge perché non ha buon occhio. Ma perché nessuna cosa non può operare sopra la sua virtù, però dove non è buon occhio l’intelletto non opera sopra quello che gli mostra l’occhio. Intellectus enim dicitur intus legens, perché legge dentro quello che piglia da’ sensi esteriori, onde si soleva dire anticamente intellegere quasi intus legere. Lo intelletto in puris naturalibus non va più là che si sia quella sustanzia delle cose naturali che l’occhio li appresenta. A volere adunque iudicare le cose di Dio, bisogna l’occhio spirituale, e chi non l’ha non può veder bene se costui va in verità o no e se le cose sua son da Dio o no; ma chi ha l’occhio spirituale ha un vedere penetrativo che passa drento insino alle medulle, e conosce se costui va in verità o no, e giudica con l’intelletto penetrativo pieno di lume spirituale se gli è buono, come che fa colui che ha buon occhio naturale e vede qua l’uva naturale e la dipinta e conosce subito quale è la vera e qual no. Ma l’uccellino che non ha buon occhio, qualche volta resta ingannato e crede che quella uva dipinta sia naturale.
Pacioli, Luca, De divina proportione(publi: 1509, redac: 1496:1498), p. XIV (italien)
Commendatione de la Prospectiva. Xeuso e Parrasio pictori dignissimi. Commo la pictura inganna l’uno e l’altro animale, cioè rationale e irrationale.
Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XX), fol. CCXIIII (latin)
Fert et pinxisse puerum vuas ferentem, ad quas cum aduolarent aues, iratus operi dixit. Vuas melius pinxi quam puerum. Nam si hoc consummassem aues timere debuerant.
Lancilotti, Francesco, Tractato di pittura(publi: 1509), t. I, p. 744 (italien)
Parrasio Zeusi a pingier vinse:
l’un gli uccelli ingannò, l’altro el factore
d’una tovaglia, sì ben la distinse.
Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), « Pictores diversi » , p. 354 (latin)
Et quum Zeusis detulisset vuas adeo ingeniose pictas, vt ad eas aues devolarent, Parrhasius lintheum attulit, veritate adeo repræsentata, vt Zeusis alitum iudicio tumens flagitaret, remoto lintheo ostendi sibi picturam, et intellecto errore, palmam concederet : quoniam ipse aues fefellisset, Parrhasius vero se artificem. Idem Zeusis postea pinxit puerum vuas ferentem, ad quas quum devolassent aues, iratus est operi suo, quod vuas pinxisset melius, quam puerum, nam si puerum consummasset, aues rimere debuerant.
Agrippa, Henri Corneille, De incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva(publi: 1537), « De pictura » (numéro XXIV) (latin)
Pictura autem ars monstruosa, sed imitationem rerum naturalium accurratissima, linea mentorum deceptione et colorum debita appositione constans […]. Dicitur enim pictura non aliud quam poesis tacens : poesis vero pictura loquens, tam sunt sibi invicem affines. Nam sicut pœtæ, sic pictores historias et fabulas fingunt, omniumque rerum imagines, lumen, splendorem, umbras, eminentias, depressiones, exprimunt. Illud præterea ex ipsa optica habes pictura, ut vitium decipiat, ac in una imagine variato situ, plures species intuentium oculis obfundat ; et quo statuaria pertingere non potest, ipsa pervenit pingit ignem, radios, lumen, tonitrua, fulmina, fulgura, occasum, auroram, crepusculem, nebulas, hominisque affectus, sensus animi, ac pene vocem ipsam exprimit ; et mentitis dimensionibus, commensurationibus, quæ non sunt, tanquam ea quæ sunt, aut quæ non sunt ita tamen videri facit. Quemadmodum de Zeusi et Parrasio pictoribus narrant historici : qui cum de artis prerogativa venissent in certamen et prior detulisset uvas pictas tanta similitudine, ut aves avolarent ; alter detulit pictum velum sic veritatem mentiens, ut ille avium iudicio tumens postularet, deductio velo ostendit picturam ; tandem agnito errore, coactus est illi palmam deferre, cum ipse aves fefelisset, Parrhasius vero artificem.
Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 13 (italien)
Dipinse un fanciullo, ch’haueua uue in mano, allequalj gl’uccellj credendo fussino non dipinte, ma vere, ui volauan per beccharle. Onde esso dicio grandemente sdegnato, disse hauere dipinto piu naturale l’uue che il fanciullo, imperoche non ui farebbono volatj gl’uccellj, s’hauessino il fanciullo conosciuto, che di quello paura hauto harebbono.
Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 14 (italien)
Dipinsono a gara egli et Zeusj, onde che Zeusj dipinse nella scena uue tanto pronte, che quelle vere credendo li uccellj per beccarne vi uolorno. Et Parrasio pur nella scena dipinse un lenzuolo tesouj, che tanto propio pareua, che a quello riuoltosi Zeusj (tanto nell’arte nominato ne passatj et presentj seculj) disse, che se uoleua che vedessj quello che dipinto hauessj, che leuassi la uela, et conoscendo djpoi l’errore suo, si chiamo da Parrasio superato.
Ricci, Bartolomeo, De imitatione. Liber I(publi: 1541), t. I, p. 425 (latin)
Ac iam illum quoque, quem imitemur, et facile aequari, et superari etiam posse interdum, comprobemus. Certe, ut isti dicunt, in naturae rebus effingendis tardissima est hominum ars, atque ingenium minime impigrum. Sane tamen horum utrunque usque eo vires suas intendit ut cum naturae opere horum opus interdum recte conferri possit. Siquidem memoriae proditum esse a doctissimis viris legimus saepius, Zeusim eracleotem, pictorem eius aetatis excellentissimum, uvae racemum ita suo artificio ad naturam expressisse ut ad eum aves, tanquam ad verum, cupide advolitarent ac rostro etiam saepius appeterent.
Speroni degli Alvarotti, Sperone, Discorso in lode della pittura(redac: 1542), p. 1000 (italien)
Ma torniamo un’altra volta alla scoltura. Di questa giudicano due sensi, il tatto e il viso ; ma il tatto per la materia e la forma, il viso per la forma sola, ché, essendo il tatto sentimento del duro e molle, grave e leggiero, aspro e lene, ed esendo tutte tai qualità nella imagine scolpita, che al tatto, giudice di tai qualità corporali e di essa quantità, non possa bella parere ; al quale anche, la notte, parve bella la Citaccia, che era sì brutta alla vista. Dunque è la statua tanto più rozza della pittura, quanto può esser giudicata da un rozzissimo senso quale è il tatto. Ma nella pittura è solo vero giudice il viso. Il tatto ben credere esser giudice, come nell’uve di Zeusi ; ma in fatto se inganna, perché da tanto non è. Dunque anche in ciò la pittura è più nobile della scoltura, perché il suo giudice è più nobile.
Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga(redac: 1548) (Quarto Dialogo), p. 334-335 (portugais)
Este foi o que pintou um minino memorado, que levava um cesto d’uvas na cabeça, tão naturales, que as aves desciam a ellas ; mas elle desdenhoso o sofria mal, dizendo que se o minimo fora melhor pintado que as uvas, que os passaros houveram medo de lhe não picar nas uvas.
Hollanda, Francisco de, Da pintura antiga et Diálogos de Roma (2e partie), (trad: 1911), p. 178 (trad: "Quatre dialogues sur la peinture" par Rouanet, Léo en 1911)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
C’est de lui[Explication : Zeuxis.] qu’était cette fameuse peinture d’un enfant portant sur sa tête une corbeille de raisins, si bien imités au naturel que les oiseaux descendaient vers eux. Mais il s’en plaignait, prétendant avec dédain que, si l’enfant eût été mieux peint que les raisins, les oiseaux, ayant peur de lui, se seraient gardés de becqueter les grappes.
Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 112 (italien)
La — Non so dove a’ tempi nostri si trovasse un pittore che con una pittura accendesse il cuor de un uomo di libidine, come Ponzio, legato de Caio imperatore (per quanto dice Plinio), ch’infiammatosi d’una Elena dipinta, tentò più meggi per portarsela seco, ma, essendo la pittura in muro, ciascuna invenzione fu debole; e Zeusi, che dipinse l’uve tanto simili alle proprie, che gli augelli volavano a quelle credendo mangiarsele.
Fa — Degno de più onorato preggio fu Parasio, che dipinse un panno bianco in un quadro, sotto il qual accennò esservi certe figure, e Zeusi, suo concorrente, scintillando ancor nella gloria acquistata per l’uve, stimolava Parasio che facesse scoprire il quadro; al che rispose Parasio: “Scoprilo da te stesso”. Zeusi, cupido di vedere l’opra che parea e non era, accostatosi alla tavola, diede di mano nel velo dipinto, ond’egli confessò esser vinto dall’ingeniosità del rivale.
La — Maggior difficultà è ingannare un maestro nella medesima arte, con la qual egli si vince, ch’ingannar gli augelli, liquali conoscono le cose per le forme senza altra distinzione, e che così dipinta, dipinsi poco tempo è in una loggia un gallo Indiano, imitandone un vivo, il qual vivo veduto il dipinto, cominciò alterarsi di tanto sdegno, che gridando, con l’ali, e ungnie difformò tutta la pittura, e per lungo spazio li tennero un certo riparo. Il medesimo m’è occorso in alcuni cavalli, sì come avvenne a quel d’Apelle, e a un ratto dipinto da un moi amico, al qual s’aventò un gatto credendolo vivo.
FA — De ciò vi presto indubitata fede. Et è chiaro che fu senza comparazione maggior l’intelligenzia di Parasio, perch’ancora egli fece nella insula di Rodi una pernice sopra una colonna, alla qual volavano le vere cotornici, et anco m’aita a crederlo ch’el ditto Zeusi fece un fanciullo che teneva pur uve in un piatto, alle quali, come le prime, venivano gli augelli, non spavendosi per lo fanciullo. Dil che Zeusi si sdegnò con sé stesso, dicendo: «S’il fanciullo avesse del vivo, come l’uve hanno del vero, gli augelli lo temerebbo no».
Varchi, Benedetto, Lezzione. Nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, fatta da lui publicamente sulla Accademia Fiorentina la terza domenica di Quaresima, l’anno 1546. In Due lezzioni, di M. Benedetto Varchi, sulla prima delle quali si dichiara un sonetto di M. Michelangelo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura o la pittura, con una lettera d’esso Michelagnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori sopra la questione sopradetta(publi: 1549), p. 38 (italien)
Ma che ci devemo maravigliare degli animali bruti, se gli uomini medesimi, anzi i medesimi pittori eccellentissimi, rimangono ingannati dalla pittura? Come avvenne quando, contendendo Zeusi con Parasio, non conobbe un telo dipinto, giudicandolo vero e comandando che si levasse, per poter vedere la figura che egli credeva che vi fusse sotto. E di simili essempi hanno avuti pure assai i tempi nostri, come ultimamente nel ritratto di mano di M. Tiziano di papa Pagolo terzo.
Varchi, Benedetto, Lezzione. Nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, fatta da lui publicamente sulla Accademia Fiorentina la terza domenica di Quaresima, l’anno 1546. In Due lezzioni, di M. Benedetto Varchi, sulla prima delle quali si dichiara un sonetto di M. Michelangelo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura o la pittura, con una lettera d’esso Michelagnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori sopra la questione sopradetta(publi: 1549), p. 46 (italien)
E concederebbero che imitano bene più, cioè in più cose, la natura, ma non già meglio, cioè più perfettamente, come si disse di sopra. Et all’uve d’Apelle et ai cani che abbaiarono a’ cani dipinti, et a tutti gli altri essempi antichi e moderni risponderebbero prima il medesimo, il che è maggior cosa, essere avvenuto alle sculture, onde il medesimo Plinio, che raconta degli uccelli e de’ cani, racconta ancora nel medesimo luogo de’ cavalli che anitrirono a’ cavalli di marmo e di bronzo. Ma che più ? Non dice egli che gli uomini medesimi si sono innamorati delle statue di marmo, come avvenne alla Venere di Prassitele ? Benché questo stesso avviene ancora oggi tutto il giorno nella Venere che disegnò Michelagnolo a M. Bartolomeo Berrini, colorita di mano di M. Iacopo Puntormo.
Doni, Vincenzo, Disegno(publi: 1549), p. 37r (italien)
Et quell’altra gara che nacque tra Zeusi e Parrasio di quella pittura, la qual cosa è tanto trita e divolgata che io mi vergogno a dirla che uno ingannasse gl’uccelli, e l’altro il pittore.
Biondo, Michelangelo, Della nobilissima pittura, et della sua arte, del modo, & della dottrina, di conseguirla, agevolmente et presto, opera di Michel Angelo Biondo(publi: 1549), « Della forma della pittura che apparve in visione a l’autore » (numéro cap. IV) (italien)
Parausi ingannò gli uccelli con uva pinta ; ma Zeusi deluse l’istesso artefice con un mantile pinto ; cotesto ancora gli è stato di gloria e di grande onore al buon pittore, quando Agrippa volse comprare le dua figure pinte dal pittore per tredici milla libre di peso d’oro.
Vasari, Giorgio, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri(publi: 1550), "Vita di Paolo Uccello", t. IV, p. 217, note 2 (italien)
Nella morte di costui furono fatti molti epigrammi e latini e volgari, de’ quali mi basta porre solamente questo :
Zeusi et Parrasio ceda et Polignoto
Ch’io fei l’arte una tacita natura :
Diei affetto et forza ad ogni mia figura
Volo agli uccelli, a’ pesci il corso e’l noto.
Vasari, Giorgio, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri(publi: 1550), “Vita di Dosso e Battista ferraresi”, t. V, p. 101 (italien)
Dicesi che Bernazzano fece in un cortile a fresco certi paesi molto belli, e tanto bene imitati, che essendovi dipinto un fragoletto pieno di fragole mature, acerbe e fiorite, alcuni pavoni ingannati della falsa apparenza di quelle, tanto spesso tornarono a beccarle, che bucarono la calcina dell’intonaco.
Dolce, Lodovico, Dialogo di pittura intitolato l’Aretino, nel quale si raggiona della dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie che a perfetto pittore si acconvengono(publi: 1557), p. 182-183 (italien)
È noto insino a’ fanciulli che Zeusi dipinse alcune uve tanto simili al vero, che gli uccelli a quelle volavano, credendole vere uve. […] Potete ancora aver letto che Parrasio, contendendo con Zeusi, mise in publico una tavola, nella quale altro non era dipinto fuor che un panno di lino, che pareva che occultasse alcuna pittura, si fattamente simile al naturale, che Zeusi più volte ebbe a dire che lo levasse e lasciasse vedere la sua pittura, credendolo vero. Ma nel fine, conosciuto il suo errore, si chiamò da lui vinto, essendo che esso aveva ingannato gli uccelli, e Parrasio lui, che ne era stato il maestro, che gli aveva dipinti.
Boaistuau, Pierre, Le Théâtre du monde, où il est faict un ample discours des miseres humaines(publi: 1558), p. 209 (fran)
- [1] Excellence de l’homme en la peinture
Laissons les armes, et descendons aux arts, qui semblent un peu plus vils et abjects, comme peincture, architecture, statuaire, et pourtraicture. [1] Quelle divinité en Zeuxis peintre excellent ? lequel contrefit par son art une vigne pleine de raisins, tant subtilement elabouree, que les oiseaux qui voloyent par l’air, se ruoyent dessus esperans y prendre pasture.
Lomazzo, Gian Paolo, Il Libro dei Sogni(redac: (1563)), Leonardo Vinci e Fidia, entrambi pittori e scultori (numéro Ragionamento quinto) , p. 93 (italien)
FIDIA — Gran maraviglia fu quella, veramente, de quando si vide, ne’ giuochi di Claudio Ulcro gli corvi ingannati dalla immagine volassero alla similitudine de tegoli e che Zeusi facesse le uve dipinte, tanto simil al vero, che a quelle ne volassero gli uccelli ; che gli uccelli rimanessero di cantare per l’apparenza d’un serpente, dipinto nel triunvirato famoso. Et oltre de questi, molti altri che li puoi sapere, senza che io te li narri.
LEONARDO — Li so ; ma ancora de moderni de simili e de più miracoli ne sono per diverse pitture de grandi valentuomini acaduti.
FIDIA — Sí ?
LEONARDO — Sí.
FIDIA — Narrameli un poco.
LEONARDO — Volentieri.
FIDIA — Via.
LEONARDO — Bramantino, creato di Bramante, suscitatore della buona architettura, fece una fabrica in pittura, tanto simile al vero, con diverse erbe e fiori, che fuori delle fisure de arhitravi e capitelli nascevano, che a quelli per beccare e doppoi riposarsi, si videro volar alcuni uccelli, che grande admirazione diedero della pittura ai riguardanti. Et è noto che Andrea Mantegna, essendo in la città di Mantova accanto a un santo Girolamo, mentre a mangiare andava, una mosca, tanto simile al vero, che esso maestro, essendo venuto, cominciò col fazzoletto a volerla levar via, imbratando d’intorno di quella, che a oglio fatta era ; onde acorgendosi quella esser dipinta, er invidia, scacciò via esso Andrea Mantegna ; il quale andò poi a Venezia, ove fece, col mezzo delle sue opere, stupire grandemente Giovan Bellino pittore.
Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 137 (italien)
Parrasio combatte con Zeusi che aveva dipinto l’uve et lui dipinse il velo. Dipinse Zeusi un putto carico d’uve, alle quali volando certi uccelli, confessò d’aver fatto bene l’uve, ma il putto male, perché se’l putto fusse stato bene, gl’uccelli avrebbero avuto paura allo acostarsi.
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), t. I, p. 187 (italien)
Alla medesima età et a lui nell’arte concorrenti furono Timante, Androcide, Eupompo e Parrasio, con cui (Parrasio dico) si dice Zeusi avere combattuto nell’arte in questo modo, che, mettendo fuori Zeusi uve dipinte con si bell’arte che gli uccegli a quelle volavano, Parrasio messe innanzi un velo sì sottilmente in una tavola dipinto come se egli ne coprisse una dipintura, che credendolo Zeusi vero, non senza qualche tema d’esser vinto chiese che, levato quel velo, una volta si scoprisse la figura; et accorgendosi dello inganno, non senza riso dello avversario, si rese per vinto confessando di buona coscienza la perdita sua, conciosiaché egli avesse ingannato gli uccelli e Parrasio sé, così buon maestro. Dicesi il medesimo Zeusi aver dipinto un fanciullo, il quale portava uve, alle quali volando gli augelli seco stesso s’adirava, parendogli non aver dato a cotale figura intera perfezzione, dicendo: “Se il fanciullo così bene fusse ritratto come l’uve sono, gli augelli dovrebbono pur temerne”.
Van Haecht, Laurens, Mikrokosmos Parvus mundus(publi: 1579), "Homines atque volucri picturis decipiuntur", fol. 75r (latin)
Tam pulchre iuuenem Zeuxis depinxerat vuas
Gestantem manibus cupidis, vt morsibus illas
Carpere tentarent volucres persaepe rapaces.
Parrasiusque suas minui cum cerneret artes :
Si pueri species ad viuum picta fuisset,
Non certe auderent aliquos decerpere fructus ;
Sed trepidas adeo volucres inuaderet horror,
Vt fugerent hominum potius commercia, dixit
Atque domi in muro cortinam pinxerat, arte
Egregia, Zeuxis quam dum remouere putaret,
Deceptus, muro dextram offendebat in ipso.
Doctus erat coruos Zeuxis timidasque columbas
Ludere, Pharrhasius (sic) pictorem fallere clarum.
Commentaires : Lettre de la gravure: In manu artificum opera laudabuntur. Ecclesiast. 9. d. correction orthographique, ok
2 sous-textesVan Haecht, Laurens, Mikrokosmos Parvus mundus, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Zeuxis avait peint d’une façon si belle un enfant tenant des raisins
Dans ses mains avides, que les oiseaux voleurs
Essayaient très souvent de s’en emparer en les picorant.
Et Parrhasius, alors qu’il voyait ses talents être diminués, dit :
Si l’image de l’enfant se trouvait peinte d’après la réalité,
Les oiseaux effrayés n’oseraient assurément pas picorer quelques fruits ;
Mais la peur les envahirait à tel point
Qu’ils fuiraient plutôt tout contact avec les hommes.
Et, sur un mur de la maison, Parrhasius avait peint avec un remarquable talent
Un rideau ; pensant l’ouvrir, Zeuxis fut trompé
Et heurta sa main contre le mur-même.
Zeuxis avait été instruit dans l’art de duper les corbeaux et les craintives colombes,
Parrhasius dans celui de rendre illustre sa peinture.
Homines atque volucres picturis decipiuntur (1579) gravure
De Zeuxis et de Parrhasios (1630) gravure
Commentaires :
Van Haecht, Laurens, Mikrokosmos, (trad: 1630), "De Zeuxis et de Parrhasius" (numéro LXXIV) , fol. 75r (trad: "Le Microcosme contenant divers tableaus de la vie humaine representez en figures avec une brieve exposition en vers francois" en 1630)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Zeuxis peintre fameux en son art tres adextre
Fit iadis un pourtrait si naif et si beau
D'un enfant qui tenoit des raisins en sa dextre,
Qu'ils furent par abus becquetez d'un oiseau.
Un autre neantmoins y trouva a reprendre,
Disant que si l'enfant eust esté bien depeint
L'oiseau ne fut venu si pres de luy se rendre,
Craignant d'estre surpris ou chassé ou atteint.
Ce fut Parrhasius qui fit ceste censure,
Qui d'abondant peignit un rideau si bien fait
Que Zeuxis demanda qu'on en fit ouverture,
Ne cuidant que ce fust d'un rideau le pourtrait.
Nul maistre ne sauroit son ouvrage parfaire
Si bien au gré de tous et si exactement,
Que quelque autre il n'y ait qui puisse encor mieux faire.
Dieu seul est un ouvrier sage parfaitement.
Homines atque volucres picturis decipiuntur (1579) gravure
De Zeuxis et de Parrhasios (1630) gravure
Commentaires : Lettre de l'image: Hebr. 6. Tendons à la perfection.
Paleotti, Gabriele, Discorso intorno alle immagini sacre e profane(publi: 1582), « Della dilettazione che apportano le immagini cristiane » (numéro I, 22) , p. 220 (italien)
Onde quelle pitture che più imitano il vivo e vero, per modo che ingannano gli animali e tal volta gli uomini, come racconta Plinio di Zeusi e di Parasio, tanto più sempre sono state degne di commendazione e maggiormente hanno dilettato i riguardanti.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 270 (italien)
Dipinse ancora di bianco solamente altre figure molto lodate e un fanciullo, che portava dell’uve, alle quali essendeo volati gli uccelli, Zeusi seco stesso si adirava, dicendo, s’io havessi ben dipinto il fanciullo, gli uccelli di lui temendo, non volerebbono all’uve. [...] Nel medesimo tempo, e suo concorrente fu Parrasio d’Efeso città d’Asia, il quale, secondo che si dice, fece à dipignere à concorrenza con Zeusi, et il vinse. Percioche havendo Zeusi, dipinto uve tanto naturali che gli uccelli vi volavano, egli[Explication : Parrasio.] addusse un lenzuolo dipinto in una tavola, come se fosse stato una tela, che coprisse la pittura, et era fatto con tant’arte, che Zeusi credendolo vero, disse che si togliesse via il lenzuolo, acciò si potesse vedere la pittura, ma accortosi dell’inganno, tinto di nobil vergogna, si chiamò perdente.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 37 (italien)
Et i corbi ne’ giuochi di Claudio Pulcro non andarono à posarsi su’ tegoli dipinti nella scena pensandosi esser veri ? Gli uccelli non si calarono per beccare l’uva di Zeusi ? E le cavalle non anitrirono al cavallo dipinto da Apelle ? Che diranno gli scultori che Plinio, che scrive queste cose, dice ancora che ad alcuni cavalli di marmo e di bronzo i vivi anitrirono, esempio solo in tutte l’opere loro ; ma che risponderanno quando si mostrerà che la pittura non solo ha ingannati gli occhi degli animali, ma degli huomini ancora, et huomini nell’arte eccellentissimi ? Come quando Zeusi famoso pittore ingannato dai colori, e dall’ombre, comandò che si levasse via il telo dipinto da Parrasio, per vedere la pittura, che sotto quello nasconder si pensava.
Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della virtù del colorire » (numéro Libro terzo, cap. I) , p. 164-165 (italien)
Non è dubbio, che tutte le cose ben formate, e condotte per disegno e doppoi colorite secondo l’ordine loro non rendano il medesimo aspetto che rende la natura istessa in quel moto, o gesto, peroché sino a gli cani vedendo altri cani dipinti dietro gl’abbaiano, quasi chiamandogli, e sfidandogli, credendo che siano vivi per la sola apparenza, non altrimenti che facciano vedendo se stessi in uno specchio; come si narra aver fatto un cane che ne guastò uno ch’aveva dipinto Gaudenzio sopra una tavola di un Christo che portava la Croce, a Canobio. E si legge gli ucelli esser volati ad altri uccelli perfettamente rappresentati, come fecero quelle pernici, che volarono alla pernice dipinta da Parrasio sopra una colonna nell’isola di Rodi. Racontano gl’istorici, che fu già dipinto un drago in Roma, così naturale, nel triumvirato, che fece cessar gl’uccelli dal canto. E fu cosa più maravigliosa quella pittura nel teatro di Claudio il bello; ove si dice che gli volarono negl’occhi i corvi ingannati dall’apparenza delle tegole finte, e volsero uscire per quelle finestre finte, con grandissima maraviglia e riso dei riguardanti. È istoria nota a ciascuno di Zeusi che dipinse certi grappi d’uva tanto naturali, che nella piazza del teatro vi volarono gli uccelli per beccargli, e ch’egli medesimo restò poi ingannato del velo, che contra que’ grappi d’uva avea dipinto Parrasio. Mi sovviene ancora di quella grandissima maraviglia del cavallo dipinto per mano d’Apelle a confusione d’alcuni pittori che lo gareggiavano, il quale tantosto che i cavalli vivi ebbero visto, cominciarono a nitrire, sbuffare e calpestrar co’ piedi in atto d’invitarlo a combattere. L’istesso Apelle dipinse quel mirabile Alessandro col folgore in mano, il qual mostrava tanto rilievo. In Roma a giorni nostri in Transtevero si vedono dipinti da Baltasar da Siena certi fanciuletti che paiono di stucco, talché hanno gabbato talvolta l’istessi pittori; i quali essempi, con tutti gl’altri che si leggono della virtù del colorire, facilmente si possono ammetter per veri, poiché anco a i tempi moderni Andrea Mantegna ingannò il suo maestro con una mosca dipinta sopra al ciglio d’un leone; et un certo altro pittore dipinse un papagallo così naturale, che levò il canto a un papagallo vero. E sanno molti che Bramantino espresse in certo loco di Milano, nella Porta Vercelliana un famiglio così naturale, che i cavalli non cessarono mai di lanciargli calzi, sinché non gli rimase più forma d’uomo. E’l Barnazano, eccellente in far paesi, rappresentò certi fragoli in un paese, sopra il muro, così naturali, che gli pavoni gli beccarono, credendoli naturali e veri; et il medesimo in una tavola dipinta da Cesare da Sesto, del battesimo di Cristo, nella quale fece i paesi, dipinse sopra le erbe alcuni ucelli tanto naturali, che essendo posta quella tavola fuori al sole, alcuni ucelli gli volarono intorno credendogli vivi e veri; la quale si truova ora appresso il Sig. Prospero Visconte, cavalier milanese ornato di belle lettere.
Commentaires : éd. 1584, p. 187 TROUVER IMAGE DE PERUZZI putti? Farnesina?
Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « Della proporzione del corpo virile di otto teste » (numéro Libro primo, cap. X) , p. 52-53 (italien)
Zeusi anch’egli si tenne vergognato per la naturalezza, a dir così, dell’uva e per il mancamento nel fanciullo.
Bocchi, Francesco, Eccellenza del San Giorgio di Donatello(publi: 1584), p. 163-164 (italien)
Perloché dipinse Zeusi alcuni grappoli di uve con tanta somiglianza de’naturali, che gli uccelli dell’aria, ingannati dalla bella vista, si calarono per beccargli. Ma Parrasio all’incontro dipinse un lenzuolo con rilievo si grande, che il suo avversario, comecché molto fosse intendente, dal grande artifizio restò nondimeno ingannato; e poco appresso, avendo con quei grappoli insiememente dipinto un fanciullino, né cessando gli uccelli per ciò parimente di volarvi, conoscendo di essere a Parrasio inferiore, ogni lode di tale arte gli concedette. Onde egli si vede di quanta perfezzione quelle opere siano spogliate, dalle quali la vivacità, come era in questo fanciullino, è separata. Perroché, se egli fosse stato dipinto dimostrantesi in guisa che volesse adoperare, arebbe altresi agli uccelli recato spavento, e molto meno l’appetito dell’uve che il timore di quello gli arebe commossi. Ma la vivacità e la forza mirabile che si vede nel San Giorgio, tuttoché quella che è propria della favella gli sia negata, troppo più nobilmente adopera che la pittura di Zeusi non poté adoperare: perché le vive membra nel morto marmo, dall’artifizio del chiaro artefice sostentate, piene di vigore e di vivacità e di valore altresi, spirano si gran forza, si gran virtù e si vera magnanimità, che di agguagliarle con parole non credo io che si potesse giammai.
Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), « Commentarius de pictura » (numéro IV) , p. 17 (latin)
Maxime tamen nobilitatus fuit [Explication : Parrasius.] certamine illo, quo Zeuxidem superauit, ingenua ipsius Zeuxidis confessione, quod is vuis pictis aues tantum fefellisset, sed Parrasius artificem ipsum flagitantem remoto linteo ostendi picturam ; cum tamen in ea tabula nihil praeter linteum pictum esset. Ea tunc penicilli laus fuit, rerum species accurate pingere.
Garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo(publi: 1585), « De’ pittori, e miniatori, et lavoratori di mosaico » (numéro Discorso XCI) , p. 290 (italien)
Quindi nota Plinio nel 35. lib. Al c. 10 che nella contentione tra Zeusi et Parrhasio celeberrimi pittori, Zeusi ingannò gli uccelli con l’uve dipinte in mostra portate, e Parrhasio il pittore istesso con un velo sopra una figura tanto artificiosamente dipinto, che pareva cosa reale, e non finta, e l’istessa al c. 4 disse, che la scena de giuochi di Claudio Pulchro hebbe alcune regole dipinte si raramente, ch’ei corvi vi si fermarono sopra ingannati della pittura. Alla qual cosa aggiungo per maggior confirmatione che l’eccellente pittore de’ nostri tempi M. Lodovico Pozzo ha raccontato a me in Trevigi, che in una città della Fiandra da lui nominata, in un cortile d’un palazzo vi è dipinto una cavalla, che pose in tanta furia un dì un cavallo, che a tutte foggie volea accostarsele, e fiutata che l’hebbe, le tirò una copia di calzi con un’ empito maraviglioso, conoscendo per naturale istinto d’esser si gabbato nella pittura di quella.
Alberti, Romano, Trattato della nobiltà della pittura(publi: 1585), p. 215 (italien)
Di dove inferiamo che, non essendo altro la pittura se non imitazione di quelle cose che si possono vedere, si come è stato detto da Socrate, Platone, Filostrato et altri, senza dubbio alcuno arrecherà gran piacere, tanto più non essendo arte che più di questa imiti la natura: imperocché leggiamo che li cavalli veri hanno annitrito alli dipinti, e che li uccelli son volati alle uve et alli tetti dipinti, e di più, molte volte si son gabbati gli uomini istessi, anzi gl’istessi artefici, come Zeusi, che si pensò che un lenzuolo dipinto fusse vero. Di dove nasce che quasi ciascuno si trova, il quale non desideri di far gran profitto in questa arte, sì ancor per la maraviglia che lei a ciascheduno apporta, come per la celerità e brevità di tempo [...] nella quale produce, a simiglianza dell’onnipotente Dio e della Natura sua ministra, animali, uomini, piante, fiumi, città, castelli, fonti, palazzi [...].
Garzoni, Tommaso, La piazza universale di tutte le professioni del mondo(publi: 1585), p. 290 (italien)
Parrhasio, che fece il velo memoriale.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Daléchamps, Jacques, C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXXVII(publi: 1587), p.740 (latin)
Seneca Controv. 5. liv. 10 narrat vuas deletas a Zeuxide, seruatumque puerum vt meliorem, quamuis non ita similem.
Comanini, Gregorio, Il Figino(publi: 1591), p. 260 (italien)
Or tu che pensi ch’abbia
L’ingegnoso Arcimboldo
Nel qui ritrarmi fatto
Col suo pennel, ch’avanza
Pur quel di Zeusi, o quello
Di chi fe’ l’inganno
Del sottil vel dipinto
Nel certame di gloria ?
Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1597), p. 803 (fran)
Il peignit aussi Marsyas lié à un arbre. Plus un tableau de raisins avec un garçon qui les portoit, si bien tirez que les oiseaux descendoient pour les becquer : ce qu’aiant apperceu il se mit avec pareille naifveté en colere contre son ouvrage, disant, I’ay mieux peint les raisins que le garçon : car si i’eusse donné à cettui-ci toutes ses perfections, les oiseaux en eussent eu peur.
Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1597), p. 795 (fran)
Puis il contendit avec Zeuxis à qui emporteroit l’honneur des deux en leur art. Zeuxis apporta un tableau de raisins ni naifvement contrefais que les oiseaux en furent trompez descendans pour les becquer : et Parrhase en presenta un autre auquel il avoit un rideau peint de tel artifice que Zeuxis tout glorieux d’avoir trompé les oiseaux, aprés avoir longtemps contemplé cette peinture, se tournant vers Parrhase lui dit qu’il tirast ce rideau s’il vouloit qu’on vist sa besogne. Si lui quitta Zeuxis la victoire, confessant qu’il avoit bien deceu les oiseaux ; mais que lui mesme avoir esté surprins par Parrhase.
Meres, Francis, Palladis Tamia : Wits Treasury, Being the second part of wits Commonwealth(publi: 1598), "Painters", p. 287 (anglais)
Hee painted grapes so livelie, that birdes did flie to eate them. Parrhasius painted a sheete so artificiallie, that Zeuxis tooke it for a sheete in deede, and commaunded it to bee taken away to see the picture, that hee thought it had vayled; as learned and skilfull Greece had these excellently renowned fort their limning:so England hath these: Hiliard, Isaas Oliver, and John de Creetes, very famous for their painting.
Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III, « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro cap. III) , p. 120-121 (espagnol)
[1] Con desseo de ganar fama y no dineros, se corregia Zeusis, quando pinto el niño que llevava las uvas en la mano, porque llegandose a ellas las aves, dezia que no estava bien pintado el niño, porque si lo estuviera como las uvas, con temor del niño no llegaran a ellas las aves. Del desseo de ganar fama procedieron las contiendas entre Parrasio y Timantes en la pintura del Ayaz. Del desseo de ganar fama, procedieron las que huvo entre los insignes escultores Agoracrito y Alcamenes. Del desseo de ganar fama el uno mas que el otro procedieron las grandes contiendas entre Protogenes y Apeles. Con desseo de ganar fama las ha avido tambien grandes entre los pintores y escultores de cien años de esta parte.
- [1] voir aussi Apelle et Protogène
Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Van Zeuxis van Heraclea, Schilder », fol. 67v (n)
- [1] Zeuxis bedrieght voghelen, en Parasius bedrieght hem.
Men seght, seyt Plinius, dat Parasius teghen Zeuxis den hals bandt ophingh, en weddede om best te schilderen. Zeuxis beroepen [1] zijnde, bracht te voorschijn op’t Tooneel een Tafereel, daer soo natuerlijcke druyven in waren gheschildert, datter self op’t Tooneel de Voghelen in quamen picken. Daer tegen bracht Parasius op zijn Tafel eenen doeck, soo natuerlijck ghedaen, dat Zeuxis, die op t’picken der Vogelen aen zijn druyven soo heel moedigh was, seyde overluydt, als uyt spot, dat het haest tijdt was dat slaeplaken af te nemen, op datmen mocht sien, wat Parasius voor schilderije hadde ghebracht: maer doe hy daer nae bevondt, dat het eenen doeck was alsoo gheschildert, ghelijck ofter de Schilderije mede was bedeckt gheweest, hem vindende beschaemt, ghebruyckte nochtans groote beleeftheyt, ghevende Parasio den Prijs, en seyde: Hy hadde wel met zijn Const de Vogelen bedrogen, maer Parasius hadde meer gedaen, bedrogen hebbende hem, die in de Schilder-const ervaren was. Men seght dat Zeuxis hier naer maeckte een jongh knechtken, draghende in een schotel oft korfken een deel druyven, en siende dat de Vogels weder quamen picken, was op zijn Tafereel verstoort, lasterende zijn eyghen werck, met een groote eenvuldicheyt belijdende, dat hy de druyven beter hadde ghemaeckt als den knecht: want hadde den Knecht geheel ghemaeckt gheweest nae ghelijckenis van het leven, de Voghels en hadden de druyven niet hebben durven picken.
Agucchi, Giovanni Battista, Trattato della pittura(publi: 1947, redac: 1603:1610), p. 267-268 (italien)
Mentre dipigneva nella propria casa una tavola per un Signor grande, questi, quando l’opera fù a buon termine vi andava spesso a vederla. Ma ad Annibale pareva, che quel Signore non si mettesse a guardare, et attentamente considerare la pittura della tavola, come la qualità dell’opera meritava ; e che con maggiore applicazione si fermasse a consigliarsi con uno specchio, che da una parte della stanza era al muro attaccato. Onde pensò Annibale di vendicarsene : e quando un’altro giorno giudicò, che quegli potesse a lui tornare, levò quello specchio, e nell’istesso luogo ne dipinse uno su’l muro a quello somigliante, ma vi finse sopra una coperta, la quale, lasciando solamente vedere una picciol parte del cristallo, impediva lo specchiarsi, e’l vedersi tutto il volto intero. Essendo poi di nuovo tornato il personnaggio alla casa dei Carracci, fermatosi non molto con gli occhi volti alla pittura, che per lui si dipigneva, verso lo specchio secondo il suo solito, prestamente se n’andò : e veggendo l’impedimento di quella coperta, che non finta, ma vera, era dall’occhio giudicata, vi pose incontinente la mano sopra, per tirarla da parte, e discuoprire tutto ’l cristallo : ma sentendo di toccar la piana superficie del muro, e ben presto accorgendosi dell’inganno, ritirò la mano a se con quella prestezza, e celerità, che si suol fare quando avviene di toccar una cosa, che non si crede essere calda, e poi si sente esser cocente. E nel medesimo tempo più nascosamente, che egli potè, voltò gli occhi verso Annibale, et alcun’ altro, che ivi era, per vedere, se, di quel che a lui era successo, si fossero avveduti : poiché gli corse subito all’animo di celarlo, se poteva, per ischivare la vergogna, che lo stimolò il quel punto pensando alle risa altrui, che potean farsi di quell’inganno. Ma Annibale, che attentissimamente l’osservò, del tutto ben si accorse, et altrettanto seppe far finta di non esserne avveduto, per osservar prima ciò che ne seguiva. Ma un’altro di coloro, che ivi si trovò, e lo vide, e che non era informato di quell’inganno da Annibale a bello studio premeditato, fermò lo sguardo verso quel Signore, e con curiosità ancora se gli accostò, per intendere quale cose gli avesse cagionato quel subitaneo ritiramento di mano, dubitando forse non l’avere morsicato o punto uno scorpione, o altro animaletto velenose. Onde poiché il personnaggio fù certo, che il fatto non si potea celare, deposta la vergogna, riputò subito se stsso anzi di lode meritevolissimo, se, confessando lietamente l’inganno, in che egli era incorso, ne commendasse molto, come fece, l’ingegno dell’inventore : e così parimente tutti gli altri, che vi furono presenti, se ne presero piacer grande, e discorsero eruditamente di simili casi celebrati dagli scrittori in lode de’ pittori antichi più famosi.
Céspedes, Pablo de, Discurso de la comparacion de la antigua y moderna pintura y escultura, donde se trata de la excelencia de las obras de los antiguos, y si se aventajaba á la de los modernos, dirigido a Pedro de Valencia y escrito á instancias suyas año de 1604 (redac: 1604), p. 281-283 (espagnol)
Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur ... fefelisset. Paréceme conseja. El engañó las aves y engañáronle á él con la tohalla pintada. Haberse engañado las aves en la capilla del papa en algunos asientos y cornisas hechos por Micael Ángel es cosa cierta: no por eso se hace gran caso. Ticiano restrató al duque de Ferrara, y puso el duque su retrato en una ventana, y él se puso a otra para gustar el engaño, y quantos pasaban, pensando que era el duque, lo reverenciaban con la gorra en la mano. Y el mismo Ticiano, que es mas, estando en Roma fué á ver las pinturas que hizo Rafael en el jardin de Agustin Guigi, que ahora es del cardenal Farnesio, y en una lonja que sale á la puerta hay unos niños pintados de blanco y negro, y algunas cornisas fingidas de estuque, y no quiso creer que los niños fuesen de pintura, hasta tanto que truxo una caña y los tentó para ver si eran de bulto: tanto duró en él el engaño, que aunque otros se lo decian, no lo creía. Hízolos Baltasar Peruci de Siena.
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), « Het leven van Frans Floris, uytnemende Schilder van Antwerpen », fol. 243r 10-12 (n)
Herman van der Mast, gheboren van den Briel, noch woonachtigh te Delft: desen, nae de doot van Floris, trock woonen by Frans Francken, daer hy copieerde eenen Cruys-drager van Floris, die een handt hiel op een witachtigh Cruys: en alsoo op dit principael Cruys een beest oft coppe met langhe beenen quam sitten, conterfeytte hy dat op t’zijn, de schaduwen en alles wel volgende. Den Meester boven comende, seyde: Ick sie wel dat ghy niet al te neerstich geschildert hebt, want de Spinnen u werck beschijten, en wildet met zijnen hoet wegh jaghen: en alsoo’t niet wegh gingh, en siende dat gheschildert was, werdt beschaemt, en seyde, dat hy’t niet soude uyt doen, maer alsoo laten staen. S’anderdaeghs dit hebbende laten sien zijn medeghesel Gheldorp, en vertelt de geschiednis van den Meester, roemende uyt boerdt, dat Zeuxis den Voghelen, maer dat hy zijn eyghen Meester had bedroghen, met dit beestgen te schilderen: dan desen wildet oock niet gelooven, tot dat hy ondancks van hem daer by getrocken werdt.
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck, (t. I), p. 349-351 (trad: "The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604). Preceded by The lineage, Circumstances and Place of Birth, Life and Works of Karel van Mander, Painter and Poet and likewise his Death and Burial, from the second edition of the Schilder-boeck (1616-1618), Doornspijck, Davaco, 6 volumes, 1994-1999Le Livre des peintres, Paris, les Belles Lettres, 2001-2002 (traduction partielle)" par Miedema, Hessel; Gérard-Powell, Véronique )(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Après la mort de Floris, il alla habiter chez François Francken et fit, d’après Floris, la copie d’un Christ portant sa croix, lequel Christ posait sa main sur une croix blanchâtre ; et comme sur cette croix était venu se poser un insecte, – une araignée à longues pattes, – il l’imita dans sa peinture, avec les ombres et jusqu’au moindre détail. Le maître, montant à l’atelier, dit à l’élève : « Je vois que tu n’as pas travaillé fort assidûment puisque les araignées viennent salir ta peinture », et il prit son chapeau pour chasser l’insecte, comme celui-ci ne s’en allait pas, il s’aperçut qu’il était peint et, tout confus, recommanda de le laisser. Le lendemain van der Mast montra la chose à son condisciple Geldorp et raconta la méprise du maître, rappelant, par manière de plaisanterie, que Zeuxis avait trompé les oiseaux, tandis que lui avait trompé son propre maître, mais Geldorp n’en voulut rien croire jusqu’à ce qu’il eût lui-même constaté la chose.
Commentaires : Traduction Hymans, 1884-1885, t. I, p. 349-351
Zuccaro, Federico, L’Idea de’ pittori, scultori ed architetti(publi: 1607) (II, 6), p. 27-28 (italien)
Così l’arte della pittura non è che sia cielo, o elementi, o cosa elementare, pietre, minere, o animali, o uomini, ma che imiti tutte queste cose all’esterno. Il che ella fa talora con tanta diligenza et arte, che restano ingannati gl’occhi non pure degli animali, ma gl’uomini stessi, anzi gli istessi professori, come occorse nello sfido che fu tra Zeusi e Parrasio, fra gli antichi pittori tanto eccellenti e così famosi, stimati quasi dèi : uno de’ quali dipinse l’uva sì al naturale, che gli uccelli, ingannati dall’apparenza di quella, volavano per beccarla. L’altro così maravigliosamente dipinse un velo che mostrava coprire un quadro dipinto, che Zeusi stesso, tanto eccellente artefice, ne restò ingannato dall’accortezza dell’arte di Parrasio. Non meno ancora a’ tempi nostri sono stati sì eccellenti imitatori del vero di alcune cose, che hanno all’improvviso ingannato molti, come fra gli altri un ritratto di Carlo V di man di Tiziano, sì famoso pittore, e un altro di Leon X di man di Raffael d’Urbino, fra gli eccellenti eccellente ; i quali non solo ingannarono più volte principi, e signori, ma il primo l’istesso figlio di Carlo V, il gran Filippo, che fu poi il monarca dei re, e dell’uno, e l’altro emisfero ; il qual ritratto essendo messo davanti a un tavolino, ingannato dall’artificio dei colori, cominciò a trattar seco negozi. Non meno attonito, e maraviglioso restò il cardinal Pesia Datario di Leone, che presentò bolle, e calamaio, e penna a far la segnatura inginocchiato al ritratto del Papa Leone. Ma che più diremo del bellissimo partimento di stucco finto, e alcuni puttini finti di stucco di mano di Baldassar Peruzzi da Siena, in una loggia nel palazzo di Agostino Ghisi in Roma, che non è alcuno, che lo mira, che non creda, che sia di rilievo ? Eppure è opera di pennello di semplice chiaro, e oscuro, con tal artifizio, e con tal’arte fatto, avendo in quello lo studioso pittore finto la polvere, che si suole comporre nella superficie del rilievo, e preso il lume di sotto con tant’arte, che inganna chiunque lo mira. Tiziano istesso sì gran pittore, che ingannò altri, non poteva credere, che l’opera fosse altra che di rilievo; e vi bisognò la scala, e il tatto della propria mano per isgannarsi.
Commentaires : lier: Titien, Raphael, Peruzzi
Scribani, Charles (Carolus Scribanius), Antverpia(publi: 1610), « Ars pictoria », p. 32 (latin)
Sed neque priscos in his desiderabis artifices ; non Atheniensem Apollodorum, Parrhasium Ephesium, aut Xeuxen illius linteo deceptum, cui etiam palmam concessit ingenuo pudore, non Eupompum, Pamphilum, Demophilum, Melanthium, Echionem, Euphranorem, Cydiam, Pausiam.
Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte seconda » (numéro Diceria I) , fol. 59v-60v (italien)
- [1] Isai. 46
- [2] Ose. 9
Ma meglio, e forse più vivamente porremo questo singolar certame raffigurare nel certame di Parrasio, e di Zeusi. L’uno appella l’altro a dipignere, la pugna è dubbiosa, il premio proposto è la gloria. Viensi al paragone, comparono in duello, scendono nello steccato; la lizza è l’officina, la scherma lo studio; i pennelli son l’armi, i colori gli assalti, i trati le ferite. Et havendo l’uno in un canestro d’uve dipinte rappresentata in guisa la verità, che delusi à beccarle vi volarono gli uccelletti, uscì della mano dell’altro, quasi colpo di gran maestro, un velo così ben fatto, che Zeusi già gonfio del giudicio degli uccelli, per veder qual pittura sotto il velo di Parrasio si nascondesse, volse levarlo, et inteso l’errore cedete arrossito la palma. Vincesi (gli disse) percioche io hò gli uccellini ingannati, ma tu l’artefice istesso. Prende somigliantemente à cozzare Satanasso con Christo, osa d’entrar seco in agone, presume di concorrere, e di dipingere a gara. Il meglio però ch’e’ sappia fare si è il dipingere delle frutta per adescar gli uccelletti. [1] Vocans ab Oriente avem. Et s’egli non rappresenta l’uva, rappresenta almeno un pomo con la cui vana bellezza tira all’inganno la semplicità de’ nostri primi padri. [2] Quasi uvas in deserto inveni Israel, quasi prima poma ficulneæ. Ephraim quasi avis avolavit. Ma ceda al nostro divino Pittore, il quale hà un velo formato di tanta maraviglia (ecco la Sindone) e gli hà dato co’ suoi stupendi colori tanto di forma, che il pregio della disfida guadagna, e nè ottiene gloriosamente la vittoria. E tanto basti quanto alla vivacità della naturalezza.
Nunes (das Chagas), Filipe, Arte da pintura, symmetria e perspectiva(publi: 1615), p. 1-2 (portugais)
He a pintura huma arte tão rara, e tem tanto que entender, e mostra tanta crudição, que deixo de lhe chamar rara, por lhe chamar quasi divina, e não digo muito ; pois he tão rara, e excellente, que toca quasi a conhecimento divino, ter na mente tão vivas as especies das cousas, que assim se possão pôr em prática, e pintura, que parece que lhe não falta mais que o espirito. Testimunho desta verdade he aquella historia celebrada da contenda de Zeuxis, Heracleotes com Parrhasio, como conta Plinio lib. 35 cap. 10. que pintou com tanta propriedade hum cesto de uvas, que as aves do ceo se vinhão a ellas cuidando que erão verdadeiras ; e a toalha, que Parrhasio pintou, tanto ao natural, que enganou com ella o mesmo Zeuxis.
Servin, Loys, Actions notables et plaidoyez de Messire Loys Servin conseiller du Roy en son conseil d’Estat, et son advocat general en sa Cour de Parlement(publi: 1619), "Cause de la Royne Marguerite pour les Comtes de Clairmont et d'Auvergne", du lundi XXXIX de May 1606, p. 127 (fran)
- [1] Plinius historie naturalis libro 35. capite 10. de Zeuxidis et Parrhasii pictorum contentione.
Si comme [1] on dit que Zeuxis excellent peintre, avoit peint des grappes de raisin en un tableau, avec tant de naïfveté que les oyseaux y avoloient. Mais Parrhasius, autre grand peintre, représenta au mesme theatre un linge qu’il avoit imité si delicatement, que Zeuxis pensant que ce fust un vray linge, lui dit qu’il le levast s’il vouloit que l’on vist les figures qui estoient dessous. La response fut que Zeuxis avoit trompé les oyseaux par le iugement desquels il estoit enflé: mais Parrhasius avoit trompé un grand ouvrier entre les peintres. Ici les clairvoyans n'ont point apperceu que sous le voile des raisons et des textes alleguez pour les deffendeurs, il y ait rien de caché qui puisse faire doute à ceux qui se cognoissent en arguments: ains la verité a esté si forte, que l'advocat des deffendeurs a esté contrainct de la confesser.
Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), p. 388 (italien)
[1] Che Zeusi rappresentasse uva matura naturalissima, anche i nostri moderni il sanno fare, e in tutte le sorti di frutti; ma he volassero uccelli a beccarla nel teatro pieno di gente, o che Parrasio suo emulo dipignesse così al vivo una pernice, che le pernici vere in mirarla cantassero, sono greche romanzerie, perché gli uccelli non volano ne anco a beccar l’uva vera quando veggono gente, e le pernici non cantano ne anco a veder le vere, se non vanno in amore.
- [1] voir aussi fortune de Pline
Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), « Statue, e pitture antiche e moderni » (numéro libro X, cap. XIX) , p. 386 (italien)
Di Zeusi fu concorrente Parrasio, e in un desfida, che fecero, dicono gli scrittori, che Zeusi dipinse certi grapoli d’uva così naturalmente, che alcuni uccelli volarono nel teatro a beccarli, dove era concorso il popolo. Ma Parrasio dipinse un lenzuolo bianco, che copriva un quadro, con tanta industria, che’l medesimo Zeusi ingannato disse, che si levasse, e si scoprisse la pittura ; indi accortosi dell’errore, restò di vergogna confuso, e si chiamò vinto.
Binet, Étienne, Essay des merveilles de nature(publi: 1621), « Platte peinture », « Préface au lecteur de la peinture » (numéro ch. X) , p. 190-191 (fran)
Le plus grand trompeur du monde c’est le meilleur Peintre de l’Univers, et le plus excellent ouvrier ; car à vray dire l’eminence de ce mestier ne consiste qu’en une tromperie innocente, et toute pleine d’enthousiasme et de divin esprit. Les Poëtes ont leurs inspirations dans la tête où est la verve poëtique, et les peintres au fin bout des doigts, et à la pointe sçavante du pinceau. Mais il faut tromper l’œil ou tout cela n’y vaut rien ; il faut qu’on croye que cela est creux et enfoncé, cela enflé et boursoufflé, cecy hors d’œuvre, et qui se iette entierement hors du tableau, cecy esloigné d’une bonne lieue, cela d’une hautesse extrême, cela percé à jour, cecy tout vif et plein de mouvement, que ce cheval court et escume à force de souffler, que ce chien iappe voirement, que ce sang coule de la playe, que les nuées tonnent en effet, et que les nuages sont tous descousus à force d’esclairs qu’on void sortir coup sur coup, que cet homme rend l’esprit et qu’on void l’ame sur ses lévres, que les oiseaux bequettent ces raisins et se cassent le bec, qu’on crie haut qu’il faut oster le rideau afin de voir ce qui est caché, cependant il n’y a rien de tout cela, car tout cela est plat, pres, bas, mort et contrefait si artistement qu’il semble que la nature se soit couchée là dessus pour aider le peintre à nous tromper finement, et se moquer de notre bestise.
Lancelloti, Secondo, L’Hoggidi(publi: 1623), "Che per conto dell’architettura, pittura, e scoltura agl’ingegni Hoggidi non deve darsi taccia di maggiore imperfezione" (numéro Disinganno 15) , t. II, p. 301-302 (italien)
Stiamo a vedere (cosi parmi di sentire, c’ho buone orecchie, gli hoggidiani quasi in un’assemblea fra di loro) che costrui vorracci far travedere, c’hoggidi si trovi pittore, il quale o come Zeusi con l’uve faccia volare a quelle gli uccelli, o come Parrasio inganni Zeusi con un velo quasi fosse vero, o come un’Apelle muova le cavalle ad annitrire ad un cavallo, o come un’altro con un’imagine di Dragone spaventare gli uccelli, o come Protogene muovere verso le sue pernici i maschi a libidine, altri un cane verso una cana, altri un bue verso una giovenca ; stiamo a vedere. Stiamo a vedere, che saremo da costui affascinati a credere c’hoggidi comprassi una pittura, come quella d’Aristide Tebano dal Re Attalo 100 talenti, che al conto di Brodeo fanno 6000 ducati, o come quella di Timomaco comprata da Cesare dittatore 80 talenti staremo a vedere. Buone parole signori hoggidiani. Si come io non nego, che tutte dette cose non sieno state si ritte, che l’ho lette più volte, cosi voi per grazia vostra non mi negate il vero, che non da altri che da Plinio Farfalloniero per la vita, e che voi ne altri con minimo vestigio d’esse pitture mi poteste provare tanta eccellenza loro, di maniera che bisogna starsene a Plinio. Se noi affermaremo, ch’i pittori (da 300 in 400 anni al più, perché non meno di 1000 anni credesi che sia stata morta e sepolta la pittura, se non hoggidi) sono stati si come di numero moltissimi, cosi d’arte perfettissimi tutti che non habbiano commossi gli uccelli, i cani, e i cavalli, hanno inserito stupore ne gli uomini, e non parliamo in aria, ma mostriamo l’opere loro.
Lancelloti, Secondo, L’Hoggidi(publi: 1623), p. 308-309 (italien)
- [1] Jacob Vuympf c. 68
Oh, Zeusi con l’uva dipinta, dite voi [1], trasse gli uccelli a beccarla, il che non habbiamo d’alcuno de’nostri mentovati di sopra. Già io ho dato dentro con un libro di farfalloni contra gli antichi historici, et hocci rotto, come suol dire il volto, un paio di scarpe, intendinla come voliono i presenti o posteri bell’ingegni, e però non temo, che son omillanterie delle Grecia, e Farfalloni di Plinio, e quello dell’uva, e quelli de gli animali, che dessero segno di riconoscere altri della loro specie fatti di colore per naturali. Erano, scrive Plinio, dipinte in una scena quell’uve. Hora quardisi s’ha del verisimile, che gli uccelli in una sala (ma era per avventura all’aria aperta) o dove si è tanto popolo (ma dovete succedere forse prima, o dopo la comedia, tuttavia chi gli vide ?) avvertino alcuni grappi d’uva, e volino per mangiarla. Che sorte d’uccelli furono quelli, passeri, rondini, tordi, merli ? dovevano pure dircelo. Manco probabile assai è di quell’altre, ch’un fanciullo haveva in mano. Supposto in cuor del verno, e che la terra tutta sia coperta di neve affatto, e gli uccellini tutti morti di fame, e mettasi un putto in mezzo ad un campo con un grappo d’uva grande poco meno che quello che fù portato da due uomini sopra una stanga dalla Palestina a gli Ebrei, io scommetterei un regno, se l’avessi, che non accosteravvisi mai uccello alcuno, ancorché ad effetto vero e non finto. De gli animali porto l’istessa opinione, perché questi non si risentono al coito solamente per la vista, ma per lo moto, per l’odore, e per la voce, niuna delle quali tre cose ha la pittura, farfalloneggi quanto vuole Plinio, Valerio, e chi chi sia. Appresso di me pare di minor maraviglia senza comparazione che Zeusi fosse ingannato dal velo di Parrasio, così ch’un’uomo che per una bella immagine o statua sia provocato a libidine, e v’avesse chi commettesse disonesta con essa, de che pare che si strabilii Valerio, e qualche altro di lui, quasi che forse non sia mostruosità maggiore l’usare con donne morte, come scrivono che succedesse già a Fabriano nell’uccisione de’Chiavelli Tiranni, e a Milano 60 anni sono quando quivi era la peste. Ma Plinio e Valerio sopra tutti hanno infilzato sù ogni cosa, pure che potesse riempire le carte, sufferire motivo di conceteggiare, hoggidianare, e partorire stupore ne’leggitori. I nostri pittori ed historici non attesero a tante avvertenze e baie che se ci avessero applicato l’animo, averebbono gli uni veduto e gli altri notato casi, ed esperienze più maravigliose delle sudette. Non più di grazia.
Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 116v (espagnol)
Pintò a Marsias atado, y unas uvas que en un cestillo tenia un niño : cuyos granos llegaron a picar los paxaros.
Boulenger, Julius Cæsar, De pictura, plastice, statuaria, libri duo(publi: 1627), « De picturis nativis et veluti vivis » (numéro I, 11) , p. 44 (latin)
Habuit scena ludis Claudii Pulchri, magnam admirationem picturae, cum ad tegularum similitudinem corui decepti imagine aduolarent. Cum Zeuxis detulisset vuas pictas tanto successu, vt in scenam aues aduolarent, Parrhasius detulit linteum pictum tam subtili opere, vt Zeuxis alitum indicio tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostenderet picturam, atque intellecto errore concederet palmam ; quoniam ipse aues fefellisset, Parrhasius se artificem. Fertur et postea Zeuxis puerum vuas ferentem pinxisse, ad quas cum aduolassent aues, iratus operi, dixit : Vuas bene pinxi, puerum male, quem aues timere debuerant. Apelles imagines adeo similitudinis indiscretae pinxit, vt quidam ex facie hominum addiuinans, quos metoscopos vocant, ex iis dixerit aut futurae mortis annos, aut praeteritae vitae.
Puget de la Serre, L’Entretien des bons esprits sur les vanitez du monde(publi: 1630), « De la vanité de la Renommée » (numéro ch. VII) , p. 207-208 (fran)
En toutes les Sciences, en tous les Arts, et en toutes les actions publiques, les hommes se sont tousiours peinez d’en acquerir la perfection, l’un à l’envy de l’autre. Aristote en sa profession, a disputé la pomme avec tous ses compagnons, et pas un ne l’a emportee, parce qu’elle sert de prix à une gloire qui ne se peut iamais acquerir. Apelles a paru en lice aussi bien que Zeusis pour la peinture, et tous deux veritablement ont fait des merveilles à representer leurs defauts ; Iugez de quelle nature peut estre leur renommee. Lisipe et Phidias ont relevé aussi en bosse leurs imperfections, et en ont laissé le relief, afin que la memoire endure tousiours. Ce n’est pas que leurs ouvrages ne soient admirables : mais non pas iusques au point de meriter la gloire de cette renommee qu’ils cherchoient. Ie n’aurois iamais fait, si ie voulois mettre en avant le nom de tous ceux qui les premiers ont animé les inventions que nous avons de toute sorte d’arts. Mais quoy que leurs apprentifs mettent tous les iours en œuvre, la renommee de ces grands maistres, c’est tousiours un feu estaint, dont les cendres seulement demeurent, ne pouvant prendre une forme plus vile, et plus abiecte.
Espinosa y Malo, Felix de Lucio, El pincel, cuyas glorias descrivia Don Felix de Lucio Espinosa y Malo(publi: 1681), p. 11 (espagnol)
[1] : Tanto se equivoca con la naturaleza, que para creer verdaderos sus objetos, ponen poca dificultad los ojos; y persuadidos de la apariencia, ilustran el primor con el engaño, y engrandecen el arte con la credulidad. Bolaron las perdizes à la perdiz que pintò Protogenes en Rodas. Un pintado dragon en el Triumvirato hizo enmudecer la confusa armonía de los paxaros, que quitava el sueño à Lepido. Llegaron à los ojos de Claudio en su mismo teatro los cuervos, engañados de las pintadas rejas, queriendo salir de las fingidas ventanas: las ubas de Zeuxis, y la toalla de Parrasio son exemplares notorios, que comprueban el intento; y mas de todos, los puntuales, y parecidos retratos que formava Apeles, por cuyos semblantes pronosticaban muchos judiciarios con acierto la vida, y sucesos de los hombres: esto no es ir tan apadrinada el arte de la naturaleza, que pueda hazer sus vezes en la casualidad? Esto no es buscar la naturaleza con cuidado al arte, por no quererla tener por enemiga? Pues què mayor blason de la pintura, que gozar el triunfo de los ojos, y aprisionar la atención de los afectos?
- [1] voir aussi Oiseaux Claudius Pulcher, Protogène Satyre
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo quarto de la pintura teorica, de la practica, y simple imitacion de lo natural, y de la simpatia que tiene con la poesia”, fol. 55v-56r (espagnol)
- [1] Contienda de Zeusis y Parrasio.
- [2] Plinio. Los mas dificultoso y estimable en la pintura son los perfiles y dintornos.
- [3] Puerta fingida en la Encarnacion
Maes. [1] Que si fué tan celebrada la batalla del vencedor Parrasio con el vencido Zeusis, engañandose el uno al otro, con imitar el natural, avemos de entender seria concurriendo la parte docta y cientifica, y que seria con docta pintura, y no acaso : desto no dudo : que no se havia de hazer tanta ponderacion de aver imitado un racimo de uvas, y una cortina, ò velo, ni habrian adquirido tanto nombre y fama en la antiguedad, sin mas arte, ni ciencia que una diligente y cuidadosa imitacion : y de la misma historia entendemos ser esto assi, porque aviendo despues Zeusis pintado un niño con las ubas, advierte la historia, que baxaron los pajaros a picar dellas, sin recato, ni temor del que las llevaba ; de donde él mismo se acusò de impróvido y de imperfecto artífice : [2] y à Parrasio dieron el lauro de señalarse en las mas perfecta parte de las que tiene el arte, que son los buenos perfiles, que es lo mismo que saber el buen dibujo docta y cientificamente; porque en los cuerpos, particularmente en los humanos, es la mas importante y delicada, y de mayor estimacion: no digo que hazer los medios, y lo de adentro dellos no sera de gran dificultad y excelencia, mas muchos lo han conseguido, ò suplido con un buen amassimento de colores, con gallardia y facilidad; pero circunscribir, ò delinearle de tal suerte, que lo encierre y junte todo, con tal providencia y arte, que no solo nos enseñe lo que circunscribio, mas nos prometa y signifique lo que està escondido, y vemos contiguo a lo que nos muestra formado, esto lo han alcançado mui pocos.
Dicip. Assi lo confiesso, que lo contrario seria demasiada terquedad; si bien no del todo desengañado de la opinion en que estaba. Y aplaudiendo semejantes modos de imitaciones, alabo las que son proprias, y entre la cortina y racimos de Zeuxis, puedan tener lugar algunas cosas hechas en nuestros tiempos, como lo merece una puerta fingida que estaba en la Encarnacion [3], que un Capellan de aquella Real casa me certificò, que pensando era natural, y que estaba entreabierta, como lo significaba, se fue a entrar por ella, y a costa de una cabeçada echò de ver la verdad: y no menos aora se hizieran de ordinario los mismos engaños de aquella puerta, a no averla quitado, rompiendo pared para el servicio de la Iglesia, y su mayor comodidad.
Lebrun, Pierre, Recueil des essaies des merveilles de la peinture(publi: 1849, redac: 1635), p. 767-768 (fran)
Le plus grand trompeur du monde c’est le meilleur peintre de l’univers et le plus excellent ouvrier, car à vray dire l’eminence de ce mestier ne consiste qu’en une tromperie innocente, et toute pleine d’entousiasme et de divin esprit, les poetes ont leurs inspirations dans la teste où est la verve poëtique, et les peintres au fin bout des doigts et à la pointe sçavante du pinceau. Mais il faut tromper l’œil ou tout n’y vaut rien : il faut qu’on croie que celà est creux et enfoncé, celà enflé, et boursoufflé, cecy hors d’œuvres et qui se jette entierement hors du tableau, cecy esloigné d’une bonne lieue, cela d’une hautesse extrême, cela percé à jour, cecy tout vif et plein de mouvement, que ce cheval court et escume à force de souffler, que ce chien jappe voirement, que ce sang coule de la playe, que les nuées tonnent en effet, et que les nuages sont tous descousus à force d’esclaires qu’on voie sortir coup sur coup, que cet homme rende l’esprit, et qu’on voie l’ame sur ses levres, que les oiseaux bequettent ces raisins et se cassent le becque, qu’on crie haut qu’il faut oster le rideau afin de voir ce qui est caché, cependant il n’y a rien de tout celà, car tout celà est plat, pres, bas, mort et contrefait si artistement qu’il semble que la nature se soit couchée la-dessus pour aider le peintre à nous tromper finement et se moquer de notre bestise.
Lancelloti, Secondo, Farfalloni degli antichi historici(publi: 1636), "Che due valentissimi dipintori, mancando loro non so come di far bene la spuma nella bocca d’un cane, e d’un cavallo, gittando irati una spugna nella tavola, la facessero ; e che ad un sonatore di citara, rompendosi una corda, una cicala volandovi supplisse al mancamento" (numéro Farfallone XCIX) , p. 494-495 (italien)
- [1] Plin. L. 35 cap. 10 Dipinture antiche al vivo. Val. M. li. 8 cap. 1
- [2] Ael. li. 10. v. h. c. 10
[1] Di molte rare dipinture abbiamo da Plinio in particolare gran memorie, come dell’uve di Zeusi, alle quali per beccarle volarono gli uccelli, del velo di Parrasio, che’ngannò l’istesso Zeusi ; d’una cavalla, che mosse un cavallo ad annitrire ; d’un cane alla cui vista abbaiarono i cani ; e d’un toro, che vedendo una vacca di bronzo si mostrò incitato alla libidine appresso Valerio Massimo, che fà le meraviglie al solito, e stima che fosse maggior cosa in ogni modo, ch’un giovane sentisse titillazione all’aspetto d’una statua di marmo rappresentante una bella donna, che detti animali si commovessero a dipinture tali, io giudico il contrario, se fossero state vere ; come nell’hoggidi de gl’ingegni nel Disinganno dela Pittura discorrerò, piacendo al Cielo, più a lungo. Non asserisco, che quei racconti delle dipinture accennate sieno FARFALLONI apertamente, ma così fra’ denti. Ben vero è che parmi, che mentre gli scrittori vogliono amassar sù, ed empire le carte di quanto Dio sa come, e donde intesero si contradicano, o deroghino all’eccellenza di quelli ch’innalzavano fino alle stelle. Non parlo di quello, che riferisce Eliano [2], cioè che’n quel principio, che cominciossi a dipongere i dipintori scrivevano sotto alle loro opere, questo è un bue, questo è un cavallo, od altro che fosse, accioché si discernesse. Cum ars pingendi iam ortum duceret, et quodammodo in lacte fasciisque versaretur, adeo rudi, et impolito stylo depinxerunt animantia, ut ad scribere ad ea pictores necesse esset, Hoc est bos, illus equus, hoc arbor ; che appresso di me d’essere riputato uno de solenni FARFALLONI, ch’io habbia quì registrato, ne voglio badare più a trattenermici, tanto è vergognoso.
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1637) (III, 2, 8), p. 165 (latin)
- [1] Symmetria tamen, vel cum similitudinis jactura, insistendum putabant
[1] Quemadmodum igitur ex jam dictis constare potest, antiquos artifices non levem verae similitudinis rationem habuisse : ita iidem impensiore cura, praeter nudam similitudinem, exprimere studebant praecipuam illam virtutem, quae ex observatione symmetriae promanat; quemadmodum haec duo eleganter distinxit Maximus Tyrius Dissert. XVI : Ἡ Ὁμήρου ποίησις τοιάδε τὶς ἐστὶν, ὅιον εἰ καὶ ζωγράφον έννοήσας φιλόσοφον Πολύγνωτον, ἢ Ζεῦξιν, μὴ γράφοντα εἰκῆ· καὶ γὰρ τούτων ἔσται τὸ χρῆμα διπλοῦν· τὸ μὲν ἐκ τῆς τέχνης, τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς· κατὰ μὲν τῆν τέχνην, τὰ σχήματα καὶ τὰ σώματα εἰς ὁμοιότητα τοῦς ἀληθοῦς διασώζοντα· κατὰ δὲ τῆν ἀρετῆν, εἰς μίμησιν τοῦς κάλλους τὴν εὐσχημωσύνην τῶν γράμμων διατιθέντι : Talis est Homeri poesis, qualis pictura Polygnoti futura erit aut Zeuxidis, si simul pictores illi fiant philosophi. Duplicem enim sibi scopum proponent: quorum alter artem, alter virtutem spectabit. Quod ad artem, ut figurae ac corpora veritatem referant: quod ad virtutem, ut congrui linearum ductus, ipsam pulchritudinem diligenter exprimant. Haec Tyrius. Traditur etiam Zeuxin pinxisse puerum uvam tenentem; et cum tanta esset similitudo uvae ut etiam aves advolantes operi, quendam ex praesentibus dixisse, aves male existimare de tabula : non fuisse enim advolaturas, si puer similis esset. Zeuxin aiunt oblevisse uvam et servasse illud, quod melius erat in tabula, non quod similius. Seneca Controv. 5 libri decimi. Ad veritatem Lysippum et Praxitelem accessisse optime affirmant: nam Demetrius tanquam nimius in ea reprehenditur, et fuit similitudinis quam pulchritudinis amantior, Quintilianus XII, 10.
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (III, 8), t. II, p. 238 (espagnol)
No lo sucedió así a Zeuxis cuando pintó el muchacho que llevaba unas uvas sobre la cabeza, a las cuales volaban a picar los páraxos, por donde, airado contra su obra, dixo: “Mejor he pintado las uvas que el muchacho, porque, si estuviera perfeto, las aves tuvieran miedo de llegar a éllas”. Bien se vee por este hecho cuán impacientemente llevan los grandes pintores que los que miran sus cuadros reparen y celebren las cosas menos importantes y se olviden, por las niñeras, de lo principal. Cuenta Pedro Mexia, que refiere Estrabón en el libro catorceno, que Parrasio pintó en la isla de Rodas un Sátiro junto a una coluna y encima della una perdiz, la cual hacía tanta ventaja a todo lo demás que todo el pueblo dexaba de mirarlo por alabar la perdiz y, trayendo otras vivas, reclamaban y cantaban a la pintada; lo cual no pudiendo sufrir el artífice, pidió licencia para raerla, porque deshacía la otra pintura, con ser tan excelente. Y porque non falte exemplo moderno, el Racionero Pablo de Céspedes pintó un famoso cuadro de la Cena de Cristo Nuestro Señor que yo he visto en la Iglesia mayor de Cordoba y, teniendola en su casa, los que la venían a ver celebran mucho un vaso que estaba pintado en ella, sin atender a la valentía de lo demás y, viendo que se les iban los ojos a todos a aquel juguete, enfurecido, daba voces a su criado: “Andrés, bórrame luego este jarro e quítamelo de aquí”. ¿ Es posible que no se repare en tantas cabezas y manos en que he puesto todo mi estudio y cuidado y se vayan todos a esta impertinencia?”
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (III, 2, 8), p. 265 (anglais)
- [1] lib. XII, cap. 10
The ancient therefore as they did not neglect similitude, so did they for all that make more work of symetrie: esteeming similitude to be the work of art, whereas symetrie proceeded out of some perfection in the artificer surpassing art: see Maximus Tyrius Dissert. XVI, where he does most accurately distinguish these two things. It is reported also that Zeuxis painted a boy holding a cluter of grapes; and when the grapes were so like that the birds came flying to them, it happened that one of them who were present said that the birds did not think well of the picture; for that they never would have ventured to come so near, if the boy had been like: yet do they say that Zeuxis did put out the grapes, keeping what was better in the picture, and not what was more like: see Seneca the Rhetorician lib. X, Controv. 5. Lysippus and Praxiteles are esteemed to come nearest unto truth; says Quintilian [1], for Demetrius is blamed as being too curious to this point, and loved similitude more than pulchritude.
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (I, 4), t. I, p. 72 (espagnol)
Resta ahora ver cómo la pintura es aparente y engaña; y lo que halla el tacto en la escultura, y cómo pertenece al rilievo la vo y las demás acciones. No puede la escultura a solas, sin la vida de la pintura, engañar (porque se ve la matería de que es formada) ni aun a los animales; y pienso que si alguna vez lo ha hecho ha sido estando ayudada del pintor con el color natural de las cosas. La pintura a solas sí puede hacer estos engaños a la vista, que es admirable excelencia, como hizo Zeusis engañando las aves con las uvas, y Apeles con el caballo, y Parrasio con el lienzo, y otros munchos modernos, obligando a los animales y a los hombres y a los grandes artífices a hacer sentimiento a su modo.
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (II, 9), t. I, p. 471 (espagnol)
Y comenzando por los primeros y más antiguos, colígese con evidencia de los casos raros, sucedidos a estos artifices, que refiere Plinio y otros autores, que el modo de pintar de Apeles, Protógenes, Parrasio, Zeuxis y los demás era acabado como lo es el natural, pues los engaños que de la vista de sus obras sucedieron fueron de cerca y no de lejos; y que no eran sus pinturas a borrones ni confusas; porque claro es que para engañar los páraxos y obligarles a picar las uvas, si de muy cerca no lo parecieran, fuera disparate hacernos creer cosas semejantes; y que Zeuxis dixo a su competidor Parrasio levantase el lienzo, o él lo fuese a levantar, teniendo el pintado por natural, pareciéndole que debaxo de aquel velo estaba la pintura, lo cual era imposible si no estuviera muy determinado y dulcemente colorido; contienda que, a mi ver, escribió gallardamente el doctor Enrique Vaca de Alfaro (cuya temprana muerte nos privó de mayores cosas) en éste:
Prudo el pintor de Eraclia, en ingenioso
certámen, ablatir al fiel modelo
de las ópimas uvas, en su vuelo
escuadrón de avecillas numeroso;
Mas a idea tan diestra, a tan glorioso
pincel burló, engaño, mentido velo,
que seca tabla, no estrellado cielo
ni bosque de Diana cela umbroso.
La vitoria se arroga dignamente
el efesio pintor, ni se la niega
el culto Zeuxis, de su patria gloria;
Pues vencer al artifice prudente,
más que de torpes aves copia ciega,
digno es de fama, digno es de memoria.
Rampalle, Daniel de, L’Erreur combatuë. Discours académique où il est curieusement prouvé, que le monde ne va point de mal en pis(publi: 1641), p. 139 (fran)
Les raisins, et les fruits de la main du Gobe, ou de la Moilon, tromperoient aussi bien les oyseaux, que celuy de Zeuxis, si ce qu’on en dit ne tenoit de la fable grecque : de mesme que le conte de la perdrix de Parrhasius qu’il peignit sur une colonne ; ie ne sçay si ce fut avec tant de succez : mais pour le moins c’estoit avec bien peu de iugement, de la percher en un lieu, où les naturelles ne se posent iamais ; i’aimerois aussitost peindre une cane sur un arbre, ou une poule dans la mer. Et iamais le Bassan qui estoit incomparable en la peinture des animaux, n’eût commis des fautes de cette nature.
Angel, Philips, Lof der Schilderkonst(publi: 1642, redac: 1641), p. 12-13 (n)
Korts naer desen geestighe Apollodorus, is die uytmuntende Zeuxus ten voorschijn ghekomen, die onse Konst een grooten luyster heeft weten te geven, soo dat hy de Vogelen door sijn geschildert fruyt heeft weten uyt de lucht te lockē, en door sijn natuerelijck nabootsen in de selve een begeerte verwect om te prouven, en daer toe vliegende sijnse bedrogen gheweest, maer Parasius die hem soo ver overtrefte, als de Son de Maen in glans en klaerheyt te boven gaet, heeft hem bedroghen door een gheschildert Slaep-laken, dat hy van de Schildery wilde af-nemen, om Parasius Kunst te sien, dewelcke-hy, nochtans een Schilder sijnde, niet en wist dat hyse sach. Dus is onse Konst van trap tot trap op gheklommen, en by veele Groote en Wijse van de Werelt geacht gheweest boven andere Konsten.
Bisagno, Francesco, Trattato della pittura(publi: 1642), “Di alcuni essempi avvenuti d’essersi ingannati, pittori istessi, huomini, e animali per la virtù, e forza del colorito” (numéro cap. XXXVI) , p. 223-229 (italien)
A maggior gloria, e lode di questa nobilissima virtù della pittura, e divina scienza del colorire, narrarò alcuni casi avvenuti, medianti li quali, si potrà con raggione concludere quanto questa scienza, fra tutte l’altre del mondo sia di maggior grado, e dignità, e si rassomigli alla divina, poiche non solamente gli animali irrationali, ma gli huomini stessi, e i professori medesimi sono rimasti più volte delusi; cosa che non ha potuto operare già mai la scoltura.
E historia già nota a ciascuno di Zeusi, che dipinse certi graspi d’uva tanto naturali, che nella piazza del teatro, vi volarono gli uccelli per beccargli ; e che egli medesimo restà poi ingannato del velo, che sopra quei grappi d’uva haveva dipinto Parrasio.
Si legge anco gli uccelli, esser volati ad altri uccelli perfettamente rappresentati; come fecero quelle perini, che volarono alla pernice dipinta da Parrasio sopra una colonna nell’isola di Rodi.
Raccontano gl’historici, che fù già dipinto un drago in Roma così naturale nel Triumvirato, che fece cessar gli uccelli dal canto.
Fù cosa più maravigliosa quella pittura nel Teatro di Claudio il bello; ove si dice, che gli volarono negli occhi i corvi ingannati dall’apparenza delle tegole finte, e volsero uscire per quelle finestre finte, con grandissima maraviglia, e riso de’riguardanti.
Mi sovviene ancora di quella grandissima maraviglia del cavallo dipinto per mano di Apelle, a confusione di alcuni pittori, che lo gareggiavano: il quale tantosto che i cavalli vivi hebbero visto, cominciarono a nitrire, sbuffare, e calpestar coi piedi in atto d’invitarlo a combattere.
L’istesso Apelle dipinse quel mirabile Alessandro co’l folgore in mano; il qual mostrava tanto rilievo.
In Roma ai giorni nostri in Tanstevero si vedono dipinti da Baldassar da Siena certi fanciulletti, che paiono di stucco, talche hanno ingannato tal volta gl’istessi pittori; i quali essempi con tutti gli altri, che si leggono della virtù del colorire, facilmente si possono ammettere per veri, poiche più modernamente Andrea Mantegna ingannò il suo maestro, con una mosca dipinta sopra il ciglio d’un leone.
E un certo pittore dipinse un papagallo, così naturale, che fce ammutire ad un pappagallo vero.
E noto a molti, che Bramantino espresse in certo loco di Milano, nella porta Verellina, un famiglio così naturale, che i cavalli non cessarono mai di lanciarli calci, finche non gli rimase più forma d’huomo.
Il Barnazano eccellente in far paesi rappresentò certe fragole in un paese sopra il muro, così naturali, che gli pavoni le beccarono, credendole naturali, e vere.
Il medesimo accadde in una tavola dipinta da Cesare, da Sesto, del Battesimo di Christo, nella quale fece i paesi: dipinse sopra l’herbe alcuni uccelli tanto naturali, che essendo posta quella tavola fuori al sole, alcuni uccelli vi volarono intorno, credendogli vivi, e veri.
Commentaires : lier images modernes?
Affictiones(redac: 1643), fol. 22v-23r (latin)
TITULUS : VERITAS POETICA PICTURA
EPIGRAPHE : Placet quia proxima uero
CARMEN :
Zeuxis artificem manum
Carpat Androcydes licet,
Timanthesque male inuidus
Secum Parrhasium trahat
Deceptae uolucres satis.
Vuae sat celebrem canent.
Quin iam tempora pampino
Et dignas hederis comas,
Autumnus quoque iudicet,
Gaudet quippe coloribus
Naturae quoties ualet
Ars ueris dare proxima.
Coi cur tabulas Venus ?
Affictiones, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
TITRE : La vérité poétique
ÉPIGRAPHE : Elle plaît parce qu’elle est proche de la vérité
POÈME : Bien qu’Androcyde critique la main habile de Zeuxis et que Timanthes, fortement envieux, entraîne avec lui Parrhasius, les oiseaux ont été suffisamment trompés. Les raisins chanteront abondamment la gloire [de Zeuxis]. Bien plus, l’automne aussi peut juger ses tempes dignes du pampre et ses cheveux dignes du lierre, car il se réjouit chaque fois que l’art, avec les couleurs de la nature, parvient à créer des œuvres très proches de la vérité. Pourquoi un tel apprécie-t-il tes tableaux, Vénus de Cos ?
Oiseaux picorant les raisins de Zeuxis, \"Placet quia proxima uero\" (1643) peinture sur vélin?
Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 6 (italien)
- [1] Parrasio
[1] Parrasio d’Effeso quello fù, che deluse Zeusi col finto velo, che arrecò gratia à sembianti, andamenti gentili a capelli, e le dovute proportioni alle membra.
Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 5 (italien)
- [1] Zeusi
[1] Acquistò poscia fama di valoroso Zeusi di Eraclea nell’Olimpiade novantesima quinta per la naturale espressione dell’uve, alle quali volarono ingannati gli uccelli, e per le opere a chiaro oscuro.
Lomazzo, Giovanni Paulo; Pader, Hilaire, Traicte de la proportion naturelle et artificielle des choses de Ian Pol Lomazzo, peintre milanois(publi: 1649), « De la proportion du Corps Viril de 8. Testes » (numéro chapitre X) , p. 29 (fran)
Quoy que le principal de chaque ouvrage soit tout le corps d’un Tableau et toute l’histoire ensemble, comme estant le tout auquel les raisons des parties se doivent rapporter ; le Peintre pourtant ne doit pas se persuader que pour bien qu’il fasse une seule chose dans un ouvrage, elle luy reüssisse, si la perfection qu’il luy donne va au delà de la raison, qui regarde le tout. Au contraire qu’il s’asseure de n’en avoir que desplaisir et confusion, parce que faisant dominer une figure sur une autre, celle icy en reste offensée, et la plus excellente mesme en est affoiblie en quelque façon, n’ayant point le rapport convenable qu’elle devroit avoir avec les autres parties selon la vraye maniere. Et c’est la raison pour laquelle plusieurs Peintres tant anciens que modernes et des plus signalés, s’estans advisés qu’ils estoient transportés d’un trop violent desir de bien faire, ont laissé leurs Tableaux imparfaits, ne pouvant amender ou corriger cette faute achevée que par la destruction de leur ouvrage, comme l’antique et fameux Eufranore en fait foy, lequel peignant dans Athenes les 12 Dieux, fit Neptune avec tant de merveilleuses parties, tant pour la proportion, le Colorit, et le reste, que voulant peindre celle de Jupiter et plus majestueuse, et d’un plus bel aspect, il luy fut impossible, auant debuté toute la fougue de ses plus belles pensées à la premiere figure. Zeuxis rougit voyant que l’enfant n’approche pas la naïfveté naturelle du raisin. Leonard d’Avince parmy les modernes Peintre tres-excellent, peignant une Cene au Refectoir de Saincte Marie des Graces à Milan, et ayant peint les Apostres, fit Saint Jacques le Majeur et le Mineur avec tant de beauté et majesté, que voulant faire le Christ, il ne peut achever cette Divine face, quoy qu’il fust singulier.
Commentaires : LIER Cène Léonard
Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), "De Graphice", §38 (numéro cap. V) , p. 79 (latin)
- [1] lib. 10 controvers. 5
- [2] lib. 35. cap. 10
Notum etiam ex Seneca [1], et Plinio [2], de uvis ab eo pictis, ad quas advolarent aves ; et quam aegra hoc tulerit, quod non melius pinxisset puerum, quem alioqui aves metuissent.
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « Della forza, che ha la pittura nel rappresentare » (numéro I, 6) , p. 22-23 (italien)
Pictores, avverte S. Crisostomo, imitantur arte naturam, et colores coloribus permiscentes, visibiles corporum depingunt imagines, et faciunt homines, et animalia, et arbores, et campos variis floribus adornatos, et omnia quae videntur, per artem imitantes mirabilem historiam videntibus praestant. Pare, che voglia dire il Santo : l’occhio è testimonio all’intelletto, che l’arte del dipingere a tanto forza nel rappresentare, che può nomarsi emulatrice della natura. Et invero una cosa ben formata con disegno, e ben colorita condecoro dall’arte, rende quasi il medesimo aspetto, che rende la stessa cosa dalla natura prodotta, e perfezionata nell’essere naturale: e però sono seguiti, e seguono alle volte inganni graziosi. I cavali vivi abbaiarono già a’ dipinti cani ; al cavallo figurato da Apelle nitrirono i veri cavalli ; le vive pernici volarono alla pernice dipinta da Parrasio sopra la colonna di Rodi ; i corvi con riso da’ riguardanti presero il volo alla finte finestre, e tegole del teatro di Claudio ; e le fragole effigiate dal Barnazzano tirarono a se i pavoni, che le stimarono naturali. Taccio molti altri inganni seguiti negli animali, e negli uccelli ; e ne ricordo alcuni successi negli uomini. Parrasio disegnò si bene il suo velo, che vero da Zeusi fu stimato. Baldasar da Siena dipinse nella città di Roma alcune cornici tanto bene, e con gl’intagli, e lavori tanto aggiustati, che gli stessi pittori alle volte l’hanno stimate di stucco, rimanendo graziosamente ingannati: tanto può l’arte esercitata col talento di un valente professore. E maestro di tal’eccellenza fù Giotto, benché per altro tanto umile, che sempre rifiutò d’esser chiamato Maestro. Egli ebbe un’ingegno cosi eccellente, che, come scrive un’ antico autore (Boccac. giorn. 6 n. 5) niuna cosa dalla natura è fatta, che egli con lo stile, e con la penna, o col pennello non dipingesse simile a quella, che non simile, anzi più tosto dessa paresse: intanto che molte volte nelle cose da lui fatte si trova, che il visivo senso degli uomini vi prese errore, quello credendo esser vero, che era dipinto. Inferiore a questo grande artefice io non stimo il famoso Coreggio, uomo d’impareggiabile valore nel dipingere. Da lui fu fatta quella maraviglia, che è principalissima tra tutte le maraviglie di oggidi ; e si vede nella Cupola della Catedrale della città di Parma : ove egli figurò una cornice intorno con tale, e tanto squisito artificio, che chi, da basso alzando gli occhi, la rimira, non può credere, che sia cosa dipinta ; tutto che, esser tale, detto gli venga, e confermato da molti : e quindi segue, che essendo veramente pittura, porge ad ognuno occasione di volersene chiarire presenzialmente con la solita esperienza di toccarla con un’asta, per vedere evidentemente, e provare se sia lavoro di rilievo, e di stucco, o pure d’opera dipinta. Cosi nell’altrui inganno trionfa la forza dell’artificiosa rappresentazione. Ma non passiamo con silenzio la gloria di Tiziano. Scrive di lui il Vasari , che fece un’ immagine di Papa Paolo 3 e che avendola posta sopra un terrazzo al sole per vernicarsi, cagionò, che fù da molti, mentre passavano, veduta, e stimata essere il vero, e vivo Papa ; che però facendoli umilissimamente di berretta, lo riverivano. Ed invero da niuno mai meglio fù quel gran pontefice espresso, che da Tiziano ; il quale parimente fece la di lui figura, che ora si vede nel Palazzo Farnesiano di Roma, e sta in attitudine di parlare a Pier Luigi ; e sembra piuttosto vivo, e spirante, che dipinto, e rappresentato.
Da gli addotti casi, e da altri, che addur potrei, voglio inferire, che la pittura ha gran forza nel rappresentare. Questa forza considerò Francesco Patrizio ne’ danari fatti da Policleto, mentre scrisse, che non mancava loro altro, che la gravezza ed il suono. E quell’altro la riconobbe ne’ pesci scolpiti da Fidia, quando avviso :
Pisces aspicis, adde aquam, natabunt.
E nella cagnuola dipinta, e paragonata ad una viva, quando disse :
Ipsam denique pone cum catella,
Aut viramque pitabis esse veram,
Aut utramque pitabis esse pictam.
Perché erassi ben formata al naturale, che niente le mancava se non lo spirito ed il moto. La pittura ha gran forza nel rappresentare ; e ciò le conviene per due ragioni : ho detto della prima, perché ella è emulatrice della natura ; dirò brevemente della seconda.
Affictiones (redac: 1652), fol. 20r, 1652 (latin)
TITULUS : Poemata proxime ad naturas rerum accedentia optima.
EPIGRAPHE : Proxima veris.
Commentaires :
1 sous-texteAffictiones, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
TITRE : Les meilleurs poèmes sont ceux qui se rapprochent le plus de la nature.
ÉPIGRAPHE : Les choses proches de la vérité.
Zeuxis peignant les raisins et le rideau, \" Poemata proxime ad naturas rerum accedentia optima\" (1652) peinture sur vélin?
Sales, François de, Traité de l’amour de Dieu(publi: 1654), t. V, p. 243 (fran)
Or je veux maintenant dire ainsi : quand le saint amour de charité rencontre une âme maniable et qu’il fait quelque long séjour en icelle, il y produit un second amour, qui n’est pas un amour de charité quoiqu’il provienne de la charité, ains c’est un amour humain, lequel néanmoins ressemble tellement la charité, qu’encore que par apres elle périsse en l’âme, il est avis qu’elle y soit toujours, d’autant qu’elle y a laissé après soi cette sienne image et ressemblance qui la represente ; en sorte qu’un ignorant s’y tromperait, ainsy que les oiseaux firent en la peinture des raisins de Zeuxis, qu’ils crurent être des vrais raisins, tant l’art avoit proprement imité la nature. Et néanmoins, il y a bien de la différence entre la charité et l’amour humain qu’elle produit en nous : car la voix de la charité prononce, intime et opère tous les commandements de Dieu dedans nos cœurs ; l’amour humain qui reste après elle, les dit voirement et intime quelquefois tous, mais il ne les opère jamais tous, ains quelques-uns seulement.
[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 27-29 (fran)
Il eut neantmoins pour concurrent Parrhasius qui le vainquit dans une gageure qu’ils avoient faite à qui representeroit le mieux la verité de quelque chose ; et cette histoire est si celebre que chacun sçait que Zeuxis ayant exposé en public un tableau, où il avoit si bien peint des raisins que les oiseaux venoient pour les bequeter, Parrhasius en fit apporter un autre où estoit un rideau si bien fait, que Zeuxis y fut trompé le premier : car le voulant tirer pour voir l’ouvrage qu’il croyoit être caché au dessous, il receut la honte de s’estre mépris, et avoüa que Parrhasius l’avoit vaincu.
Je pense, dit alors Pymandre, que ces messieurs les historiens nous en font accroire ; car ou les oiseaux de ce temps-là avoient les sens beaucoup moins subtils que ceux d’apresent, ou bien ceux d’aujourd’huy ont bien plus de jugement pour ne se méprendre pas, puisque nous ne voyons point qu’il y en ait qui s’arrétent non seulement à des fruits peints sur une toille, mais mesme à ceux qui sont de relief, et qui ont la forme et la couleur des fruits naturels.
Si vous croyez, repartis-je, en riant, que les oiseaux d’à cette heure aient plus de discernement que ceux du temps dont je parle ; il faut donc croire aussi que les hommes d’alors avoient la veuë moins délicate que ceux d’apresent, puisque Zeuxis lui-même tout habille qu’il estoit se trompa au tableau de Parrhasius ; mais estant difficille de donner son jugement sur les ouvrages de ces Anciens Peintres, puis qu’il ne nous en reste rien que nous puissions confronter avec les Modernes, je pense qu’il nous est libre d’en avoir telle opinion que bon nous semble. Neanmoins comme l’on voit encore aujourd’huy certaines peintures qui trompent les yeux des hommes et le sentiment des bêtes, je ne croy pas que l’on doive douter que celles des Anciens ne fissent un semblable effet, puisque mesme il y a des tableaux fort mediocres en bonté, qui se trouvent propres à tromper la veuë de ceux qui les voyent, plûtost que ne feroient d’autres ouvrages plus excellens.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Premier Entretien), p. 67-68 (fran)
Il eut neanmoins pour concurrent Parrhasius qui le vainquit dans une gageure qu’ils avoient faite à qui representeroit le mieux la verité de quelque chose ; et cette histoire est si celebre que chacun sçait que Zeuxis ayant exposé en public un tableau, où il avoit si bien peint des raisins que les oiseaux venoient pour les bequeter, Parrhasius en fit apporter un autre où estoit un rideau si artistement fait, que Zeuxis y fut trompé le premier car le voulant tirer pour voir l’ouvrage qu’il croyoit être caché au dessous, il receut la honte de s’estre mépris, et avoüa que Parrhasius l’avoit vaincu.
Je pense, dit alors Pymandre, que ces messieurs les historiens nous en font accroire ; car ou les oiseaux de ce temps-là avoient les sens beaucoup moins subtils que ceux d’apresent, ou bien ceux d’aujourd’huy ont bien plus de jugement pour ne se méprendre pas, puisque nous ne voyons point qu’il y en ait qui s’arrêtent non seulement à des fruits peints sur une toile, mais mesme à ceux qui sont de relief, et qui ont la forme et la couleur des fruits naturels.
Si vous croyez, repartis-je, en riant, que les oiseaux d’à cette heure aient plus de discernement que ceux du temps dont je parle ; il faut donc croire aussi que les hommes d’alors avoient la veuë moins délicate que ceux d’apresent, puisque Zeuxis lui-même tout habile qu’il estoit se trompa au tableau de Parrhasius ; mais estant difficile de donner son jugement sur les ouvrages de ces anciens peintres, puis qu’il ne nous en reste rien que nous puissions confronter avec les modernes, je pense qu’il nous est libre d’en avoir telle opinion que bon nous semble. Neanmoins comme l’on voit encore aujourd’huy certaines peintures qui trompent les yeux des hommes et le sentiment des bestes, je ne croy pas que l’on doivent douter que celles des Anciens ne fissent un semblable effet, puisque mesme il y a des tableaux fort mediocres en bonté, dont le sujet se trouve propre à tromper la veuë de ceux qui les voyent, plustost que ne feroient d’autres ouvrages plus excellens.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), p. 4-5 (italien)
- [1] Plin. 35. 10
- [2] Antol. L. 4. c. 4. ep. 23.
- [3] Plin. 35. 10
- [4] Sen. Contr. l. 5. 5.
Ma frà quest’ultimo[Explication : Parrasio.] e lui in particolare fu tanta emulazione, che si venne al cimento. [1] Dipinse Zeusi così felicemente alcuni grappoli d’uva che gli uccelli ad essi volarono per mangiarne. A quest’uva dipinta pare che alludesse quel greco poeta in quei versi, « da’ colori ingannato/ Quasi la mano a prender l’uva io stesi » [2] [3] Portò all’incontro Parrasio una tavola sopra cui era dipinta una tela così al vivo, che gonfiandosi Zeusi per lo giudicio degli uccelli, fece instanza a Parrasio, che rimossa la tela mostrasse la sua pittura. Avvedutosi dell’errore, e vergognatosi cedè liberamente la palma, perchè se egli aveva ingannato gli uvvelli, Parrasio aveva ingannato l’artefice. Dicesi in oltre ch’egli dipinse un fanciullo, il quale avena in mano dell’uva, e che ad essa pure volando gli uccelli, con la medesima ingenuità s’adirò con l’opera, e disse. Io ho fatto meglio l’uva, che il fanciullo, perchè se io l’avessi ridotto a perfezione gli uccelli ne dovevano aver paura. Altri scrivono [4], che non egli, ma uno degli spettatori, disse: che gli uccelli stimavan poco buona la tavola, perchè non vi si sarebbero gettati, se il fanciullo fosse stato simile al vero; e che Zeusi cancellò l’uva serbando quel ch’era meglio nel quadro, non quel ch’era più simigliante. Io per me inclino più volontieri al secondo racconto, essendo certo che Zeusi era anzi ambizioso, ed altiero, che modesto ed umile; come l’averebbe dimostrato la sua schietta confessione.
Perrault, Charles, La Peinture, poëme(publi: 1668), p. 224 (fran)
Votre art en même temps, pour comble de sa gloire,
Fera mille tableaux, d’éternelle mémoire ;
Avec un soin égal, les fruits représentés
Par les oiseaux déçus se verront becquetés
Et là, d’un voile peint avec un art extrême
L’image trompera les yeux du trompeur même.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669), vol. 3, p. 577 (latin)
Descendisse hic in certamen cum [1]Zeuxide traditur. Et cum ille detulisset uvas pictas tanto successu, ut in scaenam aves advolarent, ipse detulisse linteum pictum ita veritate repraesentata, ut Zeuxis, alitum judicio tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam, atque intellecto errore concederet palmam ingenuo pudore, quoniam ipse volucres fefellisset, Parasius autem se artificem. Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uvas ferentem, ad quas cum advolassent aves, eadem ingenuitate processit [2]iratus operi et dixit: uvas melius pinxi quam puerum : nam si et hoc consummassem, aves timere debuerant.
- [1] Zeuxide traditur.] Ridentem obiisse Zeuxidem cum vetulam a se pictam aspiceret, tradunt. Apud Festum hi versus extant citati ex vetere quodam poëta :
Nam quid modi facturus risu denique ?
Nisi pictor fieri vult qui risu mortuus est.
Idem.
- [2] Iratus operi.] Seneca Controv. 5 lib. 10 narrat uvas deletas a Zeuxide, servatumque puerum ut meliorem, quamvis non ita similem. Dal.
Scheffer, Johannes, Graphice, id est, de arte pingendi liber singularis, cum indice necessario(publi: 1669), "Non nimium sibi ipsi fidere vel placere, sed examinare cuncta sine studio vel ira" (numéro §83) , p. 222 (latin)
Quæ fuit Zeuxidi ingenuitas, de quo Plin. certamen ejus cum Parrhasio describens, qui linteum pinxerat ; quod Zeuxes ipse putabat esse verum : intellecto errore concessit palmam ingenuo pudore. Et mox de eodem judicium ferente de pictura propria : Fertur et postea pinxisse puerum uvas ferentem, ad quas cum advolassent aves, eadem ingenuitate processit iratus operi, et dixit : uvas melius pinxi quam puerum : nam si et hoc consummassem, aves timere debuerant. Similis fuit ingenuitas Apellis, eodem auctore : Fuit, ait, non minoris simplicitatis, quam artis. Non cedebat Amphioni de dispositione, Asclepiodoro de mensuris.
Browne, Alexander, Ars pictoria(publi: 1669), « Of proportion. The proportion of a man of eight heads », p. 18 (anglais)
A most pregnant example whereof we have in that antient painter Euphranor ; who being to draw the Twelve Gods in Athens, he began whith the picture of Neptune, which he wrought so exquisitely both for proportion, colour, and all other points ; that purposing afterwards to make Jupiter ; the like disgrace happened to Zeuxes by the naturaleness of his grapes, and the imperfection of the boy, not unlike unto which was that of Leon Vincent of late dayes, who being to paing Christ at his last supper in the middst of his disciples in the refectory of St. Maria de Gratia in Milane, and having finished all the other apostles, he represented the two James’s with such perfection, of grace and majesty, that endeavouring afterwards to express Christ, he was not able to perfect and accomplish that sacred countenance, notwithstanding his incomparable skill in the art.
Anguier, Michel, "L’union de l’Art et de la nature", conférence lue à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 4 juillet et le 1er août 1671(redac: 1671/07/04; 1671/08/01), p. 416 (fran)
Il est certain que les plus excellents sculpteurs du monde n’ont jamais prétendu qu’une figure d’homme, de pierre, marbre ou or, fut un homme en sa nature, si ce n’est le peuple grossier et ignorant qui adorait les images des faux dieux de Jupiter, Mars, Mercure et autres comme si ces simulacres eussent été véritablement des dieux. Mais on peut dire que Dieu ayant fait l’homme à son image et ressemblance de sa nature, il lui a donné une intelligence capable d’imiter tous les ouvrages de la nature par la sculpture et la peinture, et d’une manière si excellente qu’en voyant les images il semble qu’on voie la nature des choses mêmes. De là vient que ce fameux peintre Zeuxis trompait les oiseaux qui venaient becqueter les fruits qu’il avait peints, et que Parrhasius avait peint un rideau si naturel que Zeuxis voulait le tirer pour voir ce qui était caché et peint dessous. Mais ce qui est de plus surprenant est que cet admirable sculpteur Pygmalion devint lui-même amoureux de son ouvrage comme si c’eût été une personne vivante et naturelle, tant cet art était venu chez les Anciens au dernier point de sa perfection qu’ils représentaient les choses comme vivantes, ainsi que les auteurs rapportent des statues de Dédale qui semblaient parler, voir et marcher tant elles avaient de ressemblance au naturel. C’est à quoi doivent principalement travailler les sculpteurs et les peintres, à rechercher très soigneusement dans leurs ouvrages la nature même.
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), “Vita di Annibale Carracci”, p. 35 (italien)
Quivi[Explication : a Parma.] egli conobbe Paolo Veronese ancor vivo, Tintoretto e ’l Bassano, in casa del quale egli restò ingannato piacevolmente, distendendo la mano per pigliare un libro, che era dipinto.
Silos, Juan Michael, Pinacotheca sive romana pictura et sculptura, libri duo, in quibus excellentes quædam, qua profanæ, qua sacræ, quæ Romæ extant, epigrammatis exornantur(publi: 1673), « Picturæ proloquium », p. 3 (latin)
Capta racemifero calatho sat nota volucris :
Sat notus ficto capus velamine Zeuxis.
Pulchra meæ monumenta artis, geminumque tropheum
Candida sunt vela hæc, uvæ flaventis et aurum.
Affictiones(redac: 1673), fol. 53v-54r (latin)
TITULUS : Prosperitas Mundi animum non satiat
EPIGRAPHE : Decipimur specie. Hor(atius) in art(e) poe(tica)
CARMEN :
Quo uolitatis aues ? ad pictas Xeuxidis uuas ?
Sistite, nil stomachus quo satietur habent.
Cur sectaris opes, cur Mundi Prospera?
Mundi Prospera nil animus quo saturetur habent.
NOMEN : Jacobus Acosta Bruxel(lensis) Poet(a) in Gym(nasio) Soc(ietatis) Jesu. Bruxell(is) 1673.
Affictiones, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
TITRE : La prospérité du monde ne rassasie pas l’âme
ÉPIGRAPHE : Nous sommes trompés par l’apparence
POÈME : Où volez-vous oiseaux ? Vers les raisins peints de Zeuxis ?
Cessez ! Elles n’ont rien qui puisse rassasier l’estomac.
Pourquoi cherches-tu les richesses, pourquoi la prospérité du monde ?
La prospérité du monde n’a rien qui puisse repaître âme.
NOM : Jacques Acosta, poète bruxellois au Collège de la Compagnie de Jésus de Bruxelles. 1673.
Oiseaux picorant les raisins de Zeuxis, \"Prosperitas Mundi animum non satia\" (1673) peinture sur vélin?
Cossart, Gabriel, Orationes et carmina(publi: 1675), p. 238-239 (latin)
Uvæ Zeuxidis, eodem stilo[Explication : ovidiano.]
Ingens artis opus, nullique imitabile dextræ
Pictor adumbrabat Zeuxis, lætusque videndum
Præbuerat populo. Media stat paupere cultu
Agrestis puer in tabula, cui sordida circum
Uvis autumnus madefacerat ora subactis :
Mille patens plagis petasus sordentia velat
Tempora, trita fluunt laceratis tegmina pannis :
Falcula de zona pendet : quin ligneus olli
Calceus, et viles abscundunt crura cothurni :
Dextra gerit calathum, quem frondibus umbra coronat
Pampineis, uvæque replent de vite recentes.
Et dubites, verasne autumnus miserit uvas,
Zeuxis an autumni fructus æquavit arte :
Nedum oculi, solus ponit discrimina tactus.
Talia dum magno vulgus miracula plausu
Suspicit ; ecce tibi pennis delusa volucrum
Turba supervolitat, vitæque cupidine prædæ
In tabulam mora nulla ruit : vacuoque dolosas
Aggreditur rostro, tunditque, et verberat uvas.
At punctu delusa cohors procul impete magno
Avolat, et magno redit impete ; captaque rursus
Uvarum aspectu vanos sorbere colores
Accelerat, telamque premit : dum territa vulgi
Murmure, veloci liquidum secat æthera penna
Stridens, et solidas alio sibi queritat escas.
Exoritur populi clamor sequiturque fugaces.
Interea fremitu Caveæ, plausuque secundo
Elatus Zeuxis cunctos putat ire minores,
Atque suum miratur opus ; mirabilis ipse,
Ni foret imperfectus honos. Non integra, Zeuxi
Gloria, crede, tua est : pars optima rapta triumphi.
Namque suo si tela foret perfecta colore ;
Num trepidas ipso juvenis terrere volantes
Debuit aspectu, et turbam prohibere voracem ?
Cossart, Gabriel, Orationes et carmina, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
C’est une œuvre immense, inimitable, que traçait le peintre Zeuxis, et qu’il offrait tout heureux à la vue de la foule. Au milieu du tableau se tient un jeune paysan dont l’automne a barbouillé le visage crasseux de raisins écrasés : un large chapeau, béant de mille plaies, couvre ses tempes salies ; ses vêtements usés, en haillons déchirés, le quittent ; une faucille pend à sa ceinture ; bien plus, il a des semelles de bois, et de méchants cothurnes lui cachent les jambes ; sa main tient une corbeille, que l’ombre couronne de feuilles de pampre, et que remplissent les raisins à peine cueillis. Et on pourrait se demander si l’automne a produit de véritables raisins ou si Zeuxis a par son art égalé les fruits de l’automne : les yeux mêmes sont incapables de faire la différence, seul le toucher le peut. Pendant que la foule admire un si grand miracle en applaudissant, voici qu’une troupe d’oiseaux prise par l’illusion se met à voleter au-dessus ; et, désireuse de s’emparer de cette proie pour s’en nourrir, se jette sans délai sur le tableau : elle attaque les raisins feints de son bec vide, les frappe, et revient à la charge. Mais trompée dans sa prise, la troupe s’envole au loin dans un grand mouvement, et dans un grand mouvement, revient ; à nouveau trompée par l’aspect des raisins, elle picore en hâte les couleurs trompeuses et harcèle la toile ; jusqu’à ce que, terrifiée par les murmures de la foule, elle fende l’air limpide d’une plume rapide, avec un bruit strident, et aille chercher ailleurs des nourritures solides. Un cri s’élève de la foule et poursuit les fuyards. Entretemps, rempli d’orgueil par la clameur des spectateurs et leurs applaudissements favorables, Zeuxis pense que tous les autres lui sont inférieurs et admire son propre ouvrage. Lui-même serait admirable, si son honneur n’était imparfait. Ta gloire, Zeuxis, n’est pas entière, crois-moi : la meilleure part du triomphe t’a été enlevée. Car si ta toile était parfaite par son coloris, le jeune homme n’eût-il point dû terrifier par son seul aspect les volatiles tremblants, et éloigner leur troupe vorace ?
Commentaires : Trad. E. Hénin
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Vervolg van de dryderley graden der konst » (numéro III, 3) , p. 87 (n)
Echter staet dit vast, dat hoe overaerdig eenige bloemen, vruchten, of andere stillevens, gelijk wy’t noemen, geschildert zijn, deeze Schilderyen evenwel niet hooger, als in den eersten graed der konstwerken moogen gestelt worden; al waerenze zelfs van de Heem, pater Zegers, jae Zeuxis en Parrasius, tot bedriegens toe uitgevoert.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Suite des trois degrés dans l’art de peinture » (numéro III, 4) , p. 18 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Soyez toutefois certain qu’aussi agréablement que soient peintes quelques fleurs, fruits ou autres natures mortes (comme nous les appelons), ces peintures ne pourraient cependant être placées plus haut que le premier degré des œuvres d’art, seraient-elles même faites par De Heem, le Père Seghers, et même Zeuxis ou Parrhasius, en guise de tromperies.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678) (I, 4), p. 24-25 (n)
- [1] De Schilder konst is de Natuur te verbeelden
- [2] Een spiegel der natuer
De Schilderkonst is een wetenschap, om alle ideen, ofte denkbeelden, die de gansche zichtbaere natuer kan geven, te verbeelden: en met omtrek en verwe [1] het oog te bedriegen. Zy is volmaekt, wanneerze het eynde, daer Parrasius van roemde, bereikt, die aldus opgaf:
Nu, zeg ik, is het eynd van onze konst gevonden,
Maer’t onverwinlijk eynd my houd als vast gebonden,
Dat ik niet verder mach; dus heeft een yder mensch
’t Geen by te klagen heeft, of’t geen niet gaet na wensch.
[2] Maer dit eind heeft hy hem gewis ingebeelt gevonden te hebben, toen hy den moedigen Zeuxis bedroog. Want een volmaekte Schildery is als een spiegel van de Natuer, die de dingen, die niet en zijn, doet schijnen te zijn, en op een geoorlofde vermakelijke en prijslijke wijze bedriegt. Den Konst versmader Agrippa bekent, dat de Schilder konst een zeer zuivere navolgster der natuerlijke dingen is, die eertijts d’eerste plaets der vrye konsten in hadde. En zeker zy was outstijts, en is noch de bloeme van alle Konsten.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « De la fin de l’art de peinture » (numéro livre I, ch. 4) , p. 104 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
L’art de peinture est une connaissance qui doit permettre de représenter toutes les idées ou tous les concepts que l’ensemble du monde visible peut nous donner, et tromper l’œil par les contours et les couleurs. Cet art est parfait quand il atteint l’objectif que Parrhasios se glorifiait d’avoir atteint. Il s’en est même vanté ainsi :
Maintenant, je le dis, j’ai atteint la fin de notre art.
Mais cette invincible fin semble me tenir si fermement captif
Que je ne puis aller plus loin. Chaque homme
A ainsi de quoi se plaindre s’il ne peut faire selon ses vœux.
Et il a certainement imaginé avoir atteint cette fin en trompant le courageux Zeuxis. Une peinture parfaite, en effet, est comme un miroir de la nature. Elle fait que des choses qui n’existent pas paraissent exister, et trompe d’une façon permise, amusante et louable. Agrippa, pour lequel l’art de peinture est fort méprisable, reconnaît toutefois qu’il constitue une très pure imitation des choses naturelles et qu’il a occupé naguère la première place des arts libéraux.
Malvasia, Giulio Cesare, Felsina pittrice(publi: 1678), t. II, p. 405 (italien)
Dirò, che questa sottilissima olanda (sic), che veste la nudità della tavola, e che è così vera, che Zeusi, scordatosi le risa dell’emulo Parrasio, diria si levasse, e così nobilmente ordita dal disegno e tessuta dal colorito, che solo potria servir di tele al mostruoso ingegno per nuovi lavori, o più tosto di superbissima corina per degno riguardo de’già fatti.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van’t Hair en Kleedy » (numéro VI, 7) , p. 229 (n)
- [1] Behangsels en Tapyten
[1] Gy kunt ook in behangsels en Tapijten eer behaelen, gelijk gezegt word van Parrasius, die zijn tegenstrever Zeuxis alleen met een gordijn voor zijn stuk te schilderé (als genoeg bekent is) bedroog en overwon. Johan da Udine schilderde t'einden een galery van’t Vatikaen, een tapytsery of behangel, en als den Paus daer langs de schilderyen quam zien, zoo liep een staffier voor uit, om, gelijk zy gewoon zijn, ’t zelve op te lichten, maer vond zich bedroogen. In deeze dingen heeft het wel koloreeren voornamentlijk heerschappy, en een volkomen vermogen, zoo lang als het geene wy navolgen binnen onze verwen bepaelt is. Gelijk wy daer proeven genoeg van zouden kunnen aenwijzen.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Des cheveux et des vêtements » (numéro VI, 7) , p. 364 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Vous serez également très honoré si vous représentez des tapisseries et des tapis, comme cela a été dit de Parrhasius, qui a trompé et surpassé son adversaire Zeuxis en ne peignant qu’un rideau devant son œuvre, comme cela est assez connu. A l’extrémité d’une galerie du Vatican, Giovanni da Udine peignit une tapisserie ou une tenture. Et lorsque le pape vint y voir les peintures, un estaffier le devança afin de la soulever, comme c’est la coutume : il fut ainsi trompé. C’est surtout le bon coloris qui donne ici de la force et rend parfaitement possible ces choses, pour autant que ce que nous imitons soit déterminé par nos couleurs, comme nous pourrions bien le prouver.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van’t koloreeren. En eerst van iets vlax » (numéro VI, 2) , p. 218 (n)
Nochtans is hier ook eer meede ingeleit, wanneer vorsten en vorstinnen bedroogen wierden. Parrasius lywaet, of voorhang, behield hem de zeege tegens den moedigen Zeuxis: en den Malthezer verkrijgt noch daeglijx grooten roem, in zijn geschilderde tapijten.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Du coloris – et d’abord du coloris des objets plats » (numéro VI, 2) , p. 350 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Toutefois, on y gagne aussi des honneurs à tromper souverains et souveraines. Le lin ou la tenture de Parrhasius lui donna la victoire contre le courageux Zeuxis. Et Francesco Fieravino reste aujourd’hui encore très célèbre pour ses tapis peints.
Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 127-128 (fran)
Ce peintre eut la gloire de surmonter par l’industrie de son art le fameux Parrhasius, qu’il sçut adroitement tromper[1], tout habile maître qu’il étoit, par la représentation d’un rideau, lorsque celui-ci ne sçut tromper que des oiseaux par la peinture de ses raisins. Tout le monde en sçait l’histoire.
- [1] On répete partout ce trait historique comme une merveille : cependant il est maintenant connu de tout le monde combien il est facile de faire illusion dans de pareilles bagatelles.
Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685) (Dialogue I), p. 17-18 (anglais)
Zeuxis painted grapes, so that the birds flew at them to eat them. Apelles drew horses so such a likeness, that upon setting them before live horses, the live ones neighed, and began to kick at them, as being of their own kind. And amonsgt the modern painters, Hannibal Carache, relates of himself, that going to see Bassano at Venice, he went to take a book off a shelf, and found it to be the picture of one, so lively done, that he who was a great painter, was deceived by it. The flesh of Raphael’s picture is so natural, that it seems to be alive. And so do Titians pictures, who was the greatest master for colouring that ever was, having attained to imitate humane bodies in all the softness of flesh, and beauty of complexion.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685), t. V, p. 201 (latin)
Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur. Et cum ille detulisset uvas pictas tanto successu, ut in scenam aves advolarent, ipse detulisse linteum pictum, ita veritate repraesentata, ut Zeuxis, alitum judicio tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam, atque intellecto errore concederet palmam ingenuo pudore, quoniam ipse volucres fefellisset, Parrhasius autem se artificem. [1]Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uvas ferentem, ad quas cum advolassent aves, eadem ingenuitate processit iratus operi et dixit: Vvas melius pinxi quam puerum: nam si et hoc consummassem, aves timere debuerant.
- [1] Fertur et postea. Confer ista cum iis quae Seneca pater de hac ipsa re affert, in Controv. 34. lib. 5.
Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685) (Dialogue II), p. 40 (anglais)
His concurrents in the art were nevertheless great masters; amongst them were Timantes and Parrhasius; and with this last Zeuxis had many contests, in one of which he owned himself overdone; for having agreed each of them to draw something for mastery, Zeuxis drew grapes so rarely done, that the birds flew and peck’d at them; and thereupon he bidding Parrhasius show his piece, was by him presented with a picture, with a curtain before it; which Zeuxis going hastily to draw, found that it was nothing but a painted one, so well done, that it had deceiv’d him.
Catherinot, Nicolas, Traité de la peinture(publi: 1687), p. 21 (fran)
[1] Fables des peintres, comme celle de Zeuxis et de Parrhase, celle d’Apelle et de Protogene. Mais enfin elles sont bien insensées. Quant à la derniere c’est une verité, si on veut en croire Pline. On peut encore adjoûter l’ecume du chien que Protogène ne pouvoit peindre, et celle du cheval que Néalcès ne pouvoit peindre pareillement. Et il ne se faut point étonner de ceci, car toutes les histoires anciennes regorgent de fables, et pour les depister il ne faut que supprimer ce qui est de surprenant.
- [1] voir aussi Fortune de Pline, Apelle et Protogène, Protogène Ialysos
Baldinucci, Filippo, Lettera al marchese Vincenzio Capponi(publi: 1687), p. 9 (italien)
Anno elleno forse le mani, i pennelli, i colori, le tele de’ maestri rinomati, una tal virù, che basti a far miracoli, onde null’altro abbisogni a chi l’ha, per poter dire di possedere un tesoro, che il sapere, ch’elle uscirono dalle lor mani ? no per certo, onde bisogna pure in fine, o vogliamo, o no tornare ad un principio, che tanto è precioza una pittura, quanto ell’è bella, e ridotta in ogni sua parte a quell’eccellenza, alla quale a per fine di portarla l’ottimo artista colla mano, che obbedisce all’intelletto. I grappoli dell’uva di Zeusi non ingaronno gli uccelli sino al segno di fargli calare a cibarsene, perchè furon parto della mano di Zeusi, ma perché s’assomigliavano al vero ; ne la tanto rinomata tela di Parrasio ingannò lo stesso Zeusi, perché di mano di Parrasio, ma perché ne punto, ne poco si distingueva sell’era vera o finta. Ma che è più (se fu vero quanto lasciarono scritto antichi autori) lo stesso Zeusi avendo dipinto in mano ad un fanciullo altri grappoli, a’ quali pure volarono gli uccelli, forte si aditò con se stesso, e diede, come noi diremmo oggi, di mestica al quadro, perchè (dissegli) s’io avessi dipinto bene il fanciullo, siccome l’uva, gli uccelli ne averebbono avuto paura, e non sarebbero corsi a’ grappoli. L’uva, e’l fanciullo eran di mano di Zeusi, e nondimeno l’uva potè ingannare, e non il fanciullo ; ora o fosse questa verità, o favola, non è vero, che un gran maestro sia in ogni sua opera sempre simile a se stesso, e per conseguenza è cosa vana il confondersi tanto nel ricercare del nome del pittore, più che della perfezione della pittura.
Perrault, Charles, Le Siècle de Louis le Grand(publi: 1687), p. 12 (fran)
Ces peintres si fameux des siecles plus âgez,
De talens inoüis furent-ils partagez,
Et le doit-on juger par les rares merveilles,
Dont leurs admirateurs remplissent nos oreilles :
Faut-il un si grand art pour tromper un oiseau,
Un peintre est-il parfait pour bien peindre un rideau ?
Et fut-ce un coup de l’art si digne qu’on l’honore,
De fendre un mince trait, d’un trait plus mince encore ?
A peine maintenant ces exploits singuliers
Seroient le coup d’essai des moindres écholiers.
Ces peintres commençans dans le peu qu’ils apprirent,
N’en sçurent gueres plus que ceux qui les admirent.
Perrault, Charles, Parallèle des anciens et des modernes(publi: 1688:1696), t. I, p. 200-201 (fran)
L’ABBÉ — On dit que Zeuxis representa si naïvement des raisins que des oiseaux les vinrent becqueter : quelle grande merveille y a-t-il à celà ? Une infinité d’oiseaux se sont tuez contre le Ciel de la perspective de Rüel, en voulant passer outre sans qu’on en ait esté surpris, et cela mesme n’est pas beaucoup entré dans la loüange de cette perspective.
LE CHEVALIER — Il y a quelques temps que passant sur le Fossé des Religieuses Angloises, je vis une chose aussi honorable à la peinture que l’histoire des raisins de Zeuxis, et beaucoup plus divertissante. On avoit mis secher dans la cour de Mr. le Brun, dont la porte estoit ouverte, un tableau nouvellement peint, où il y avoit sur le devant un grand chardon parfaitement bien representé. Une bonne femme vint à passer avec son asne, qui ayant vû le chardon entre brusquement dans la cour, renverse la femme qui taschoit de le retenir par son licou, et sans deux forts garçons qui luy donnerent chacun quinze ou vint coups de bâton pour le faire retirer, il auroit mangé le chardon, je dis mangé, parce qu’étant nouvellement fait, il auroit emporté toute la peinture avec sa langue.
L’ABBÉ — Ce chardon vaut bien les raisins de Zeuxis dont Pline fait tant de cas. Le mesme Pline raconte encore que Parrhasios avoit contrefait si naïvement un rideau, que Zeuxis mesme y fut trompé. De semblables tromperies se font tous les jours par des ouvrages dont on ne fait aucune estime. Cent fois des cuisiniers ont mis la main sur des perdrix et sur des chappons naïvement representez pour les mettre à la broche ; qu’en est-il arrivé ? On en a ri, et le tableau est demeuré à la cuisine.
[Callières, François de], Histoire poëtique de la guerre nouvellement déclarée entre les Anciens et les Modernes(publi: 1688) (livre onzième), p. 248-250 (fran)
Zeuxis et Parrasius apprirent avec beaucoup d’indignation que ce Poëte moderne[Explication : Perrault.] vouloit profiter de leur ancien different pour diminuer la reputation de leurs ouvrages, lorsqu’il dit,
Ces peintres si fameux des siecles plus agez,
De talens innoüis furent-ils partagez,
Et le doit-on juger par les rares merveilles,
Dont leurs admirateurs remplissent nos oreilles,
Faut-il un si grand art pour tromper un oiseau,
Un peintre est-il parfait pour bien peindre un rideau.
Je crois, dit Zeuxis, que les peintres modernes que ce Poëte pretend mettre au dessus de nous n’ont point encore fait aux oyseaux de pareilles tromperies, et je croy ajoûta Parrasius qu’aucun Peintre d’entr’eux ne s’est encore trouvé exposé à vouloir tirer un rideau peint par un autre Peintre son concurrent, ainsi bien loin que nôtre dispute diminuë du prix de nos ouvrages, elle sert à leur faire connoître combien nous sommes au dessus d’eux par les choses mêmes qu’ils témoignent mépriser.
Rosignoli, Carlo Gregorio, La Pittura in giudicio overo il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene(publi: 1697), « Le colpevoli discolpe de’ pittori immodesti » (numéro cap. III, §1) , p. 40 (italien)
Forse che Zeusi non si rendè più celebre con colorire i grappoli d’uva pendenti da’ pampani, così rilevati e rugiadosi, che la Natura a farli veri, non li sa far più veri ? Onde gli uccelli ingannati volarono a beccarli ; sin che venuti famelici, ne partirono digiuni. Anzi egli stesso hebbe a confessare, ch’era riuscito meglio in dipignere le uve, che il giuvannetto presso d’esse. Peroche gli augelli andarono a bezzicare le uve, credendole vere, e non temettero il fanciullo, perche lo ravvisarono dipinto.
Rosignoli, Carlo Gregorio, La Pittura in giudicio overo il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene(publi: 1697), « Saggia ammenda delle figure ignude col vestirle » (numéro cap. X, §2 ) , p. 186-187 (italien)
Benche molti intendenti delle pitture pregino sopra ogni altr’ornamento i corpi ignudi, come se in formarli si ricerchi maggior maestria : contuttociò a giudicio d’altri maestri dell’arte non si richiede minor peritia e industria per colorire un bel panneggiamento con pieghe ben disposte, e rilievi ben ordinati : per increpare le falde degli abiti, spiegarne gli suolazzi, e rifiorirne i fredi. Che lodi non acquistò Parrasio per quel celebre velo, con cui gabbò e vinse Zeusi, che si gloriava d’havere ingannati gli uccelli, tirandogli a beccare le uve dipinte ? Ma poi fu egli deluso, quando corse a rimuover colla mano la tenda colorita dall’emolo, per iscoprir la pittura, che in fatti non v’era, ma solo il velo dipinto, ingannator degli occhi con le bugie del pennello. Ond’hebbe a confessare : [1]Vicisti me, Parrasi. Ego enim illusi avibus : tu vero decepisti Zeusim. Direte forse, che in quel velo non tanto fu lodata la leggiadria dell’opera, quanto l’invention dell’ingegno. Sia così : e così facciasi.
- [1] Plin. l. 35.
Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique(publi: 1697), art. « Zeuxis », p. 1279-1280 (fran)
Il ne faut pas oublier que Zeuxis ayant disputé le prix de la peinture avec Parrhasius, le perdit (F) ; voici comment. Zeuxis avait si bien peint des raisins, que les oiseaux fondoient dessus pour les bequeter. Parrhasius peignit un rideau si artistement, que Zeuxis le prit pour un vrai rideau qui cachoit l’ouvrage de son antagoniste, et tout plein de confiance il demanda que l’on tirât vite ce rideau, afin de montrer ce que Parrhasius avoit fait. Ayant connu sa méprise il se confessa vaincu, puisqu’il n’avoit trompé que les oiseaux, et que Parrhasius avoit trompé les maîtres mêmes de l’art. Une autre fois il peignit un garçon chargé de raisins : les oiseaux volerent encore sur ce tableau ; il s’en dépita, et reconnut ingénûment que son ouvrage n’étoit pas assez fini, puisque s’il eût aussi heureusement representé le garçon que les raisins, les oiseaux auroient eu peur du garçon. On dit qu’il effaça les raisins, et qu’il ne garda que la figure où il avoit le moins réussi.
(F) Ordinairement on raporte avec peu de netteté le fait qui concerne les oiseaux, que Zeuxis trompa par des raisins en peinture. Si l’on consultoit bien Pline on ne tomberoit pas dans la confusion ; car on verroit que Zeuxis fit deux differents tableaux qui se rapportent à ce fait, et qui eurent chacun leur avanture particuliere. Je ne remarque point que beaucoup d’auteurs racontent, que Zeuxis voulut tirer lui-même le rideau de Parrhasius : ce n’est pas ainsi que Pline raporte la chose ; mais c’est une alteration des circonstances trop petite pour en parler. On a beaucoup plus de raison de trouver étrange, que le Dictionnaire de Moreri ne dise rien du defi, ou de la gageure, de ces deux peintres, et que Mrs. Lloyd et Hofman n’en disent qu’un petit mot. Pour ce qui regarde l’autre tableau où un garçon portoit des raisins, M. Moreri en a parlé d’une manière qui ne lui sauroit faire d’honneur : puisqu’il en a retranché les principales circonstances, n’ayant rien dit du jugement que Zeuxis porta lui-même de ce tableau. Mr. Hofman n’a pas oublié cela, mais il s’est servi d’une phrase qu’il devoit entierement suprimer ; eadem ingenuitate, dit-il, processit (Zeuxis) iratus operi ac dixit. Ces paroles sont de Pline, et font un très-bel effet dans l’original, où elles ont relation à l’histoire de la gageure, c’est-à-dire au narré de Pline, touchant l’ingenuité avec laquelle Zeuxis avoüa qu’il étoit vaincu. Mais lorsque dans un article où il n’y a rien de cette ingenuité, on nous vient apprendre que Zeuxis reconut avec la même ingenuité, etc., on nous jette dans des tenebres impenetrables, où nous pouvons seulement conjecturer que l’on nous donne une piece toute tronquée. Presque tous les abbreviateurs sont sujets à ce defaut.[1] Mr. Hofman est ici beaucoup plus excusable que Mr. Lloyd, car quand ce dernier a gardé la phrase, eadem ingenuitate processit, qu’il trouvoit dans Charles Etienne, il lui étoit aisé de sentir qu’on la raportoit à une chose à quoi le lecteur de Charles Etienne étoit renvoyé. Mr. Lloyd a suprimé ce renvoi, et par ce moyen il a mis plus de tenebres dans son article. Ce n’est pas que je pretende excuser entierement Charles Etienne, car son ut in Parrhasio supra vidimus, ne lui pouvoit pas donner droit de se servir de ces termes eadem ingenuitate processit, puisqu’il ne venoit pas de parler du succès de la gageure. L’article de Zeuxis est beaucoup meilleur dans[2] Calepin, que dans tous les dictionnaires dont je viens de parler. Mais je n’ai point vu d’auteur qui ait plus mal recité la dispute des deux peintres, que celui[3] qui fait le plus de figure dans le Commentaire Variorum sur Valere Maxime. Il assûre que Parrhasius peignit des oiseaux sur une toile, si semblables à la verité, que Zeuxis craignant le jugement des oiseaux, lui donna cause gagnée par une pudeur ingenuë. Je suis fort trompé si la phrase qu’il employe, Zeuxis alitum judicium timens, n’est une corruption de celle de Pline, Zeuxis alitum judicio tumens ; et si cela est, quel exemple n’avons-nous point ici des metamorphoses qui arrivent aux pensées ?
Souvenons-nous que Don Lancelot de Pérouse traite de fable tout ce qu’on a dit de l’effet de ces deux peintures. Il ne croit point que les oiseaux bequetassent la vigne de Zeuxis, ni que Zeuxis ait pris pour un vrai rideau celui de Parrhasius. Voilà comment il se tire de l’objection que cela fournit à ceux qui meprisent l’habileté des Modernes : il nie le fait ; cette methode de résoudre les difficultés est bien commode.[4] Oh, Zeusi con l’uva dipinta, dite voi, trasse gli uccelli a beccarla, il che non habbiamo d’alcuno de’ nostri mentovati[5] di sopra. Già io non ho dato dentro con un libro di Farfalloni contra gli antichi historici, e hocci rotto, come suol dire il volgo, un paio di scarpe, intendinla come vogliono i presenti o posteri bell’ingegni, e però non temo, che sono millanterie della Grecia, e Farfalloni di Plinio, e quello dell’uva, e quelli de gli animali, che dessero segno di riconoscere altri della loro specie fatti di colore per naturali. M. Perrault aussi zêlé pour les modernes que Don Lancelot, a trouvé une reponse bien plus solide ; car il allegue des faits semblables et de fraîche date, et qui prouvent que ce n’est pas en cela que consiste la delicatesse de la peinture. Voici ses paroles : On[6] dit que Zeuxis representa si naïvement des raisins que des oiseaux les vinrent becqueter : quelle grande merveille y a-t-il à cela ? Une infinité d’oiseaux se sont tuez contre le Ciel de la perspective de Ruël, en voulant passer outre sans qu’on en ait esté surpris, et cela même n’est pas beaucoup entré dans la louange de cette perspective.... Il[7] y a quelques temps que passant sur le Fossé des Religieuses Anglaises, je vis une chose aussi honorable à la peinture que l’histoire des raisins de Zeuxis, et beaucoup plus divertissante. On avoit mis sécher dans la cour de M. le Brun, dont la porte étoit ouverte, un tableau nouvellement peint, où il y avoit sur le devant un grand chardon parfaitement bien representé. Une bonne femme vint à passer avec son asne, qui ayant vu le chardon entre brusquement dans la cour, renverse la femme qui tâchoit de le retenir par son licou, et sans deux forts garçons qui luy donnerent chacun quinze ou vingts coups de bâton pour le faire retirer, il auroit mangé le chardon, je dis mangé, parce qu’estant nouvellement fait, il auroit emporté toute la peinture avec sa langue... Pline raconte encore que Parrhasios avait contrefait si naïvement un rideau, que Zeuxis mesme y fut trompé. De semblables tromperies se font tous les jours par des ouvrages dont on ne fait aucune estime. Cent fois des cuisiniers ont mis la main sur des perdrix et sur des chapons naïvement representez pour les mettre à la broche ; qu’en est-il arrivé ? On en a ri, et le tableau est demeuré à la cuisine.
- [1] On en peut voir des exemples dans le livre de Mr. Gronovius de pernice Judae. Voyez Nouvell. de la Republ. des Lettres 1684. mois de Mai, art. 6.
- [2] Il y faut corriger la citation de Pline au livre 53. pour 35. Charles Etienne et le P. Cantel dans son Val. Max. in usum Delph. citent le 55.
- [3] Il s’apelle Oliverius. Voyez le Val. Maxime Variorum de Leyde 1655. pag. 314.
- [4] Secondo Lancelloti da Perugia Abbate Olivetano, l’Hoggidi parte 2. Disinganno 15. p. 308.
- [5] Jacob. Vuympf. ca. 68.
- [6] Perrault. Parallele des anciens et des modernes to. 1 p. 136. édit. de Holl.
- [7] Id. in pag. 137.
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 110 (fran)
[1] Nous avons à la vérité quelques morceaux de peinture antique, mais ni les tems, ni les auteurs n’en sont point connus : le plus considérable est à Rome dans la Vigne Aldobrandine, et représente un mariage. Cet ouvrage est d’un grand goût de dessein, et tient beaucoup de la sculpture et des bas-reliefs grecs. Il est sec et sans intelligence des groupes, ni du clair-obscur : mais il est à croire que tous les ouvrages de peinture qui se faisoient en Gréce dans ces tems-là, n’étoient pas de la même sorte ; puisque ce que nous lisons de Zeuxis et de Parrhasius, qui ont trompé par leur pinceau, non seulement les animaux, mais les peintres mêmes, doit nous persuader qu’ils avoient pénétré dans les principes de la peinture plus avant que l’auteur de cet ouvrage. Il est vray qu’ils n’avoient pas l’usage de l’huile, laquelle donne tant de force aux couleurs ; mais ils pouvoient avoir des sécrets que nous ignorons, et Pline nous dit qu’Apelle se servoit d’un vernis qui donnoit de la vigueur à ses couleurs, et qui les conservoit. Quoy qu’il en soit, on ne peut pas aller contre le témoignage universel des anciens auteurs qui ont parlé des peintres de ces tems-là, et des écrits desquels on doit inférer que la peinture y étoit dans un haut degré de perfection, et que le nombre des habiles peintres y étoit fort grand.
- [1] Voir aussi Fortune de Pline, Apelle atramentum
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 113 (fran)
Parrasius néanmoins luy disputoit le premier rang, et ils convinrent de faire chacun un tableau en concurrence. Zeuxis peignit des raisins, et Parrasius un rideau. L’ouvrage du prémier étant éxposé, attira des oyseaux qui vinrent béqueter les raisins qu’il avoit peints, et qu’ils crûrent être véritables. Zeuxis tout glorieux du suffrage de ces animaux, dit à Parrasius qu’il fit donc voir son tableau, et qu’on tirât ce rideau qui le couvroit : mais se trouvant surpris par ce même rideau, qui étoit le tableau de Parrasius, il confessa ingénuëment qu’il étoit vaincu, et que n’ayant trompé que les oyseaux, Parrhasius l’avoit trompé luy-même, tout peintre qu’il étoit.
Zeuxis peignit quelque tems aprés un garçon qui portoit une corbeille de raisins, et voyant que les oyseaux les venoient aussi béqueter, il avoüa avec la même franchise que si les raisins étoient bien peints, il falloit que la figure le fut bien mal ; puisque les oyseaux n’en avoient aucune peur.
Piles, Roger de, "Si la poésie est préférable à la peinture", conférence prononcée à l'Académie royale de peinture et de sculpture le 7 mai 1701(redac: 1701/05/07), p. 68 (fran)
La fin de la peinture, comme de la poésie, est de surprendre de telle sorte que leurs imitations paraissent des vérités. Le tableau de Zeuxis où il avait peint un garçon qui portait des raisins, et qui ne fit point de peur aux oiseaux, puisqu’ils vinrent becqueter ces fruits, est une marque que la peinture de ces temps-là avait accoutumé de tromper les yeux en tous les objets qu’elle représentait. Cette figure ne fut en effet censurée par Zeuxis même que parce qu’elle n’avait pas trompé.
Guérin, Nicolas, "Description de l’Académie royale de peinture et de sculpture", lue le 25 novembre 1713 à l'Académie royale de peinture et de sculpture(publi: 1713/11/25), p. 97 (fran)
Qu’auraient servi aux Zeuxis, aux Parrhasius, aux Apelle, les pompeux éloges qui leur sont donnés dans l’histoire, si le marbre n’avait fait passer jusqu’à nous quelques morceaux de sculpture du même temps, pour nous faire juger que le grand goût et la correction du dessein qui s’y trouve, était très apparemment commun aux peintres comme aux sculpteurs ? Sans cela, rien ne nous obligerait de regarder la peinture et la sculpture de ces temps éloignés que comme n’étant alors que dans leur enfance, et les louanges qui sont données à ces premiers maîtres que comme un transport officieux de gens qui n’auraient encore rien vu de plus beau.
Les preuves que Pline nous veut donner de leur habileté, dans le récit qu’il fait de la dispute des deux premiers de ces peintres, Zeuxis et Parrhasius, de même que de celle d’Apelle et de Protogène, ne seraient en effet guère capables de nous en faire naître une plus noble idée. Des raisins, un rideau, quelques lignes tracées sur une toile qui, selon ce qu’il en dit, marqueraient plutôt une subtilité de main qu’une production du génie, sont de trop petits objets pour nous faire valoir le mérite de ces grands hommes.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Estimación de la pintura y sus profesores, en los siglos pasados”, §1 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, II, 9) , vol. 1, p. 332 (espagnol)
Volaron también las aves a las pintadas uvas de Zeuxis; y éste se engaño del velo pintado de Parrasio. Las perdices volaron a la que pintó Protógenes en la isla de Rodas. El terror del dragón, pintado en el Triunvirato hizo callar las aves, que interrumpían el sueño a Lepido. Volaron los cuervos a sentarse sobre la tejas pintadas en el teatro de Claudio Emperador. A el pintado caballo de Apeles, relinchaban las yeguas: y el cade su dueño. Y siendo, como es, la Pintura imitación del natural, no puede negarse, llegaría a lo sumo de su perfección; pues pudo lograr lo fingido créditos de verdadero.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Propiedades accidentales de la pintura”, §4 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 8 ) , vol. 1, p. 322 (espagnol)
Siendo esto así, no será mucho, que tengan los ojos más abiertos los pintores para juzgar las obras de su arte, que aquellos, que no lo profesan; pues éstos sólo disfrutan el deleite, pero aquéllos la inteligencia. Por eso Nicomaco le respondió a cierto imperito en el arte (que dijo: no le parecía hermosa la Helena que pintó Zeuxis:) toma mis ojos, y te parecerá una deidad. Mas lo que es digno de reparo, es, que tengan también esta perpicacia para juzgar sus propias obras. Bien sabida es la célebre competencia de las líneas de Apeles, y Protógenes, cuya ingenuidad cedió a la sutileza de la última línea de Apeles. Y no menos la competencia de los dos eminentes Zeuxis, y Parrasio; pues habiendo aquél pintado, con tan extremada propiedad, unas uvas, que los pájaros volaban a picarlas; hinchado con la gloria de este suceso, instaba, que descrubriesen un velo, que había pintado Parrasio, para ver lo que debajo de él se ocultaba. Y habiendo reconocido su engaño, con ingenuo pudor le cedió a Parrasio la palma, diciendo; que él había engañado a las aves; pero Parrasio a él, siendo artífice.
No fue menos su ingenuidad, cuando habiendo pintado un chicuelo, que tenía las uvas, y volando a ellas las aves, exclamó airado contra su obra, diciendo: Mehor pinté las uvas, que el chicuelo; pues si estuviese éste bien pintado, no bajarían las aves a picarlas.
Patrizi, Francesco (da Siena), Lecture d’un chapitre à la louange de la peinture de L’institution de la République de Patrizi, le 3 septembre 1718 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1718/09/03), p. 164 (fran)
Quant aux raisins peints, voici ce qu’en dit Pline, livre 35, ch. 10 : « On dit que Parrhasius présenta le collet en fait de peinture à Zeuxis ; auquel combat Zeuxis produisit sur l’échafaud un tableau de raisins peints si au vif, que les oiseaux les venaient béqueter sur l’échafaud même. Au contraire Parrhasius apporta un linceul peint si au naturel que Zeuxis se glorifiant des becquades que les oiseaux avaient données à ses raisins, dit tout haut, comme par moquerie, qu’il était temps d’ôter le linceul pour voir quelle pièce Parrhasius avait apportée. Mais connaissant par après que ce n’était que peinture, et se trouvant confus, usa néanmoins d’une grande honnêteté à céder le prix à Parrhasius, disant qu’il avait bien eu le moyen de tromper les oiseaux, mais que Parrhasius avait fait davantage de l’avoir trompé lui-même qui s’estimait consommé en l’art de peinture
Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 53; 242 (fran)
- [2] Son ingenuité à l’égard de ses propres ouvrages
Zeuxis avait fait une piéce, où il avoit si bien peint des raisins, que, dès qu’elle fut éxposée, les oiseaux s’en approcherent pour en becqueter le fruit. Sur quoi, transporté de joye et tout fier du suffrage de ces petits juges, il demanda à Parrhase, qu’il fit paroître incessamment ce qu’il avoit à leur opposer. Parrhase obéït, et produisit sa pièce, couverte, comme il sembloit, d’une étoffe délicate, en maniere de rideau. Tirez ce rideau, ajouta Zeuxis, que nous voyions ce beau chef-d’œuvre. À cette parole Parrhase se mit à rire, et fit toucher au doigt aux spectateurs et à Zeuxis lui-même, que le rideau qu’ils voyoient n’avait rien de réel que l’apparence. Je suis vaincu[1], dit aussitôt ce dernier, en reconnaissant son erreur avec cette ingenuité, qui lui était naturelle, et qui est indispensable en pareil cas, je suis vaincu, et je confesse ingénument que Parrhase est plus habile que moi : car je n’ai trompé que des oiseaux ; au lieu que pour lui, il m’a trompé moi-même, qui suis peintre !
[2] On voit par là que Zeuxis étoit de bonne foi, dans ces sortes de combats ; mais c’est ce qui parut encore dans la suite, lorsqu’ayant peint un Jeune Garçon, qui portoit sous le bras un panier de raisins ; car apparemment il triomphoit sur ce fruit ; et s’appercevant une seconde fois que des oiseaux s’approchoient pour en goûter, loin de se réjouïr d’un incident, qui auroit fiat éxtasier un peintre médiocre, il se dépita encore contre son ouvrage ; et, avec la même ingenuité qu’auparavant, voici comme il en raisonna devant tout le monde : Si les raisins ne sont pas mal, puisque des oiseaux y ont été trompez, il faut convenir que le jeune homme, qui les porte, n’est gueres bien, puisqu’ils n’en ont point été effrayez ! Si j’avois fini la figure aussi bien que j’ai fini le panier, ces petits animaux n’auroient jamais été si hardis.
Note au texte latin, p. 242 :
(L) Descendisse hic in certamen cum Zeuxide traditur. Ce certamen est encore une gageûre dans Félibien, mais non pas dans Adriani ; con cui (Parrasio dico) si dice Zeusi havere combattuto nel arte. On peut se battre pour la gloire, à coups de pinceaux, sans faire de gageure. Du reste, rien de plus utile que l’émulation, pour faire des progrès dans quel art et dans quelle science que ce soit. C’est la raison de Quintilien en faveur des écoles publiques ; surtout lorsqu’elles sont bien instituées. Écoutons-le sur ce sujet : « Il est certain qu’un enfant ne peut apprendre chez lui, que ce qu’on lui enseigne, et qu’aux écoles il apprend encore ce qu’on enseigne aux autres. Il verra tous les jours son maître approuver une chose, corriger l’ature, blasmer la paresse de celui-ci, louer la diligence de celui-là. Tout lui servira, l’amour de la gloire lui donnera de l’émulation, il aura honte de le céder à ses égaux, il voudra même surpasser les plus avancez. Voilà ce qui donne de l’ardeur à de jeunes esprits, et quoique l’ambition soit un vice, bien souvent pourtant elle produit la vertu. Je me souviens d’une coutume que mes maîtres observoient dans mon enfance avec succès. Ils nous partageoient en différentes classes, qu’ils régloient eux-mêmes selon nos forces : ainsi chacun disputoit dans sa place, qui étoit plus élevée, à mesure qu’il surpassoit les autres et qu’il avoit fait plus de progrès. Cela s’éxaminoit fort sérieusement, et c’étoit à qui emporteroit l’avantage. Mais d’être le premier de la classe et à la tête des autres, c’étoit, sur tout, ce qui faisoit l’object de notre ambition. Au reste, ce n’étoit point une affaire décidée sans retour : à la fin du mois, celui qui avoit été vaincu, pouvoit prendre sa revanche et renouveller la dispute, qui n’en devenoit que plus échauffée ; car l’un, dans l’attente d’un nouveau combat, n’oublioit rien pour conserver son avantage ; et l’autre trouvoit, dans sa honte et dans sa douleur, des forces pour se relever avec éclat. Je sçai bien que cela nous donnoit plus de courage et d’envie d’apprendre, que tout ce qu’auroient pû faire et nos maîtres et nos précepteurs et tous nos parens ensemble. » De l’instit. De l’Orat. Liv. I. ch. 3.
(M) Uvas pictas tanto successu, ut in scaenam aves devolarent. C’est la leçon de la I. Venitienne. La leçon commune porte, advolarent. Je suis pour la précédente, parce que devolare exprime mieux l’action des oiseaux, qui venoient fondre sur la scene de haut en bas, in scaenam. À l’égard de la chose même, voyez ce qu’on a dit ci-dessus, p. 177 rem. Y. Il semble que les oiseaux de Zeuxis ont donné lieu à cette épigramme de l’Anthologie, que Grotius a traduit de cette maniere :
Vix est ab uvis ut abstineam manum,
Ita me colorum forma deceptum trahit.
Quoi qu’il en soit, nos modernes se sont partagez sur ces sortes d’histoires. M. Félibien fait dire à son Pymandre, qu’apparemment les oiseaux de ce tems-là avaient les sens beaucoup moins subtils que ceux d’à présent, ou bien ceux d’aujourd’hui ont plus de discernement que ceux d’autrefois, puisque nous ne voyons pas qu’ils s’arrêtent non seulement à des fruits peints sur une toile, ni même à ceux qui sont de relief, et qui ont la forme et la couleur des fruits naturels. Cependant il ajoute ce correctif ; qu’il n’est gueres possible de donner son jugement sur des ouvrages que nous n’avons plus. M. Perrault va plus loin ; il prétend conclurre de là que les Anciens ne savoient pas peindre. « Pour vous convaincre, dit son Abbé, du peu de beauté des peintures antiques, et de combien elles doivent être mises au dessous de celles de Raphaël, du Titien et de Paul Veronese et de celles qui se font aujourd’hui, je ne veux me servir que des louanges mêmes qu’on leur a données. On dit que Zeuxis représenta si naïvement des raisins que des oiseaux les vinrent becqueter : quelle grande merveille y a-t-il à cela ? Une infinité d’oiseaux se sont tuez contre le Ciel de la perspective de Ruël, en voulant passer outre sans qu’on en ait été surpris, et cela même n’est pas beaucoup entré dans la louange de cette perspective. » J’avouë que je ne sens pas la force de ce raisonnement. Zeuxis a si bien peint des raisins, que des oiseaux y ont été trompez : donc sa peinture était médiocre ; Ruël a fait une perspective, où une infinité d’oiseaux se sont tuez par erreur ; donc cette perspective n’est pas éxcellente. Si notre Pline avait rapporté l’aventure des oiseaux, comme la preuve du vrai sublime dans la peinture, il y auroit quelque chose à dire : mais il se contente de narrer le fait sans aucune reflexion, et il fera voir dans la suite en quoi consiste la dignité de l’art. M. Perrault continuë son raisonnement par un fait qui renverse sa remarque : « On avoit mis secher dans la cour de M. le Brun, dont la porte était ouverte, un tableau nouvellement peint, où il y avoit sur le devant un grand chardon parfaitement bien représenté. Une bonne femme vint à passer avec son asne, lequel ayant vu le chardon, entre brusquement dans la cour, renverse la femme qui tachoit de le retenir par son licou, et sans deux forts garçons qui lui donnerent chacun quinze ou vingt coups de bâton pour le faire retirer, il auroit mangé le chardon, je dis mangé, parce qu’étant nouvellement fait, il auroit emporté toute la peinture avec sa langue. » Voilà un échantillon de cette belle logique de M. Perrault contre le mérite des Anciens. M. Le Brun, selon lui, étoit le plus grand peintre qui ait jamais été, et la Famille d’Alexandre est le chef-d’oeuvre de la peinture: cependant il a fait un chardon qui a trompé un asne ; s’ensuit-il qu’il ait été un peintre médiocre ? Point du tout : donc les raisins de Zeuxis, qui ont trompé des oiseaux, et non pas des asnes, ne prouvent point que Zeuxis ait été un peintre subalterne. Il faloit juger de Zeuxis par ce qui précède, par sa Pénélope, où il avait si bien représenté les mœurs, par son Jupiter qui était magnifique, et par son Hercule, où les éxpressions étoient si hûreuses et si vives. Enfin il ajoute que de semblables tromperies se font tous les jours par des ouvrages dont on ne fait aucune estime : que cent fois des cuisiniers ont mis la main sur des perdrix et sur des chappons naïvement représentez pour les mettre à la broche ; qu’on s’est contenté d’en rire ; mais que le tableau est demeuré à la cuisine. Je le veux, parce que la scene étoit à la cuisine, lieu obscur ; mais à l’égard de Zeuxis, ce fut tout autre chose. Il étoit question d’exprimer le beau fruit, et de le produire sur la scène, dans un combat de génie et de pinceau, en présence des experts.
(O) Quoniam ipse avec fefellisset, Parrhasius autem se artificem. C’est la leçon de l’éd. de Venise, de celle de Rome et d’un MS. de Dalecamp. La leçon commune porte volucres. Je n’en tire d’autre conséquence, sinon que les copistes se sont donné souvent de telles libertez. À l’égard de la chose même, on doit faire quelque attention à ce petit mot, Parrhasius autem se artificem. S’il y a quelque mérite dans la peinture, à tromper un asne, des oiseaux, des enfants, il y a bien plus de mérite à tromper les maîtres et les connoisseurs : il est vrai que ces sortes d’illusions tombent presque toûjours sur de petits sujets, des raisins qui sont becquetez ; un rideau que l’on suppose couvrir la peinture ; un chardon un peu éloigné, une servante, comme celle de Rembrandt au 1. ou au 2. étage ; des perdrix, ou des chappons dans une cuisine, des bas-reliefs sur un mur, qui attraperent plus d’une fois Carlo Dati, et choses semblables. D’oû vient que l’illusion ne tombe pas sur de grands sujets ? C’est qu’il y a très peu de peintres qui colorient bien ; c’est que les tableaux sont bordez de cadres, qui découvrent l’art, et ne se présentent pas toujours dans le point qu’il faut. Il y a ici un Allemand, qui ne fait que des portraits, mais qui à force de tems et de travail, donne la vérité même : il a fait le portrait de sa mere d’une manière si achevée, qu’il n’y a point d’œil au monde qui n’y fut trompé, s’il étoit sur une planche rognée. On a beau le regarder de prés, c’est toûjours la même chose ; c’est de la chair, ce sont des cheveux blancs, on les compte à l’infini, ce sont des yeux réels ; il faut toucher tout, pour se détromper ; on y voit le poil folet dans toute sa finesse et dans toutes les diverses teintes du visage, avec la dégradation des lumieres la plus insensible qui se puisse imaginer ; je crois que c’est l’ouvrage de plus d’une année. J’ai vû peindre cet homme pendant 3 heures de suïte, il travaille fort lentement, regarde ses gens de fort près et les fait asseoir jusqu’à 50 fois davantage, selon le prix qu’on y veut mettre. Mais aussi, il faut avouër que la ressemblance est entiere. Il a eû d’une seule maison jusqu’à 700 guinées, pour 5 ou 6 portraits ; Si Zeuxis colorioit comme cet homme-là, il avoit un talent rare.
(P) Ad quas cum advolarent aves. C’est la leçon de la I. Ven. et de la I. Romaine. Ici je laisse advolarent, à cause du ad quas. Mais je crois que plus haut il faut devolarent à cause d’in scenam.
(Q) Eadem ingenuitate processit iratus operi et dixit. C’est la leçon de tous les MSS. Et de toutes les edd. Pintianus voudroit qu’on supprimât processit et la conj. et, et qu’on lût ainsi : eadem ingenuitate iratus operi dixit : mais cela n’est pas nécessaire. Pline veut dire, qu’il fit paroître la même sincérité devant tout le monde, et qu’il procéda contre son propre tableau avec franchise.
(R) Nam si et hunc consummassem. C’est la leçon d’un MS. de Dalecamp. Les autres portent, nam si et hoc consummassem, ce qui me paroît rude à une oreille latine : uvas melius pinxi quam puerum, nam si et hoc, etc. Je doute fort que Pline ait parlé ainsi.
- [1] Candeur rare parmi les hommes du plus grand mérite. Il y en a qui donneroient plustôt leur argent, que de le ceder aux autres en habileté.
Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro ch. 5) , p. 154-155 (fran)
Zeuxis avoit plusieurs rivaux, dont les plus illustres étaient Timanthe et Parrhasius. Ce dernier entra en concurrence avec lui dans une dispute publique, où l’on disputoit les prix de peinture. Zeuxis avoit fait une piéce, où il avoit si bien peint des raisins, que, dès qu’elle fut exposée, les oiseaux s’en approchérent pour en becqueter le fruit. Sur quoi, transporté de joie et tout fier du suffrage de ces juges non suspects et non récusables, il demanda à Parrhasius qu’il fît donc paroistre incessamment ce qu’il avoit à leur opposer. Parrhasius obéit, et produisit sa piéce, couverte, comme il sembloit, d’une étoffe délicate en maniére de rideau. Tirez ce rideau, ajouta Zeuxis, et que nous voyions ce beau chef-d’oeuvre. Ce rideau étoit le tableau même. Zeuxis avoua qu’il étoit vaincu. Car, dit-il, je n’ai trompé que des oiseaux, et Parrhasius m’a trompé moi-même qui suis peintre.
Le même Zeuxis, quelque tems après, peignit un jeune homme, qui portoit une corbeille de raisins : et voyant que les oiseaux les venoient aussi becqueter, il avoua, avec la même franchise, que si les raisins étoient bien peints, il faloit que la figure le fût bien mal, puisque les oiseaux n’en avoient aucune peur.
Pascoli, Lione, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni(publi: 1730), t. I, p. 77-79 (italien)
[1] Emmi anche noto il fatto dell’uva dipinta da Zeusi, e del velo dipinto da Parrasio ; e fin dal primo momento, che mi giunse a notizia, lo conobbi per falso, e me ne risi. Nè mi dolse, che tali favolette fossero inventate da’ Greci ; perchè come essi furono maestri sublimi in ogni facoltà, vollero eziandio essere eccellenti autori di saporite, e d’ingegnose menzogne in ogni occasione. Dolsemi bensì, e ancor mi duole, che da voi, e da varii scrittori italiani, e latini sieno state credute ; e mi maraviglio, che diciate di non aver letti tai prodigi negli scrittori moderni, quando modernatmente non è mancato, chi ne sia andato di simiglianti inventando ; e mi maraviglio ancora, che non sappiate, che i volatili, come tutti quasi gli altri animali tratti sono per l’avidità del cibo, e degli altri appetiti dall’odorato, e non dalla vista. Gira la passera d’intorno al granajo ; e non vede il grano, che sta serrato. Cerca la colomba ne’ seminati, e non vede la veccia, che ricoperta fù dal bifolco. Razzola il pollo a lato al pagliaio, e non vede la pula che vi sta dentro. Gettasi ne’ querceti il germano, e non vede la ghianda, che v’è caduta ; perchè vi si getta ordinatamente di notte. Ma quando anche tirati fossero dalla vista, e non dall’odorato, dovuto avrebbero veder prima il putto maggiore dell’uva, e di quello aver paura, e non appressarvisi. E se me si dirà, che il putto dipinto non era con quella perfezione, con che dipinta era l’uva ; e non aver perciò potuto farlo comparire sì naturale, e sì vivo, che gl’ingannasse, che fu, come ho letto il dispiacere di Zeusi, risponderò subito, che avrebbero in simil caso dovuto aver timore della pittura, e del quadro ; perchè temono di qualunque cosa, che veggiono insolita. Non s’accosta il calderino al canapeto, ove dall’ortolano fu messa alcuna parruccaccia. Fugge il rigogolo dal fico, cui appeso fu dal vignajuolo un qualche straccio. Resta preservato il ciliegio da’ furti del merlo uscito dal nido, per riportare a’ figli l’imbeccata, se vi vede i rami neri, od in altro modo coloriti. Ora se non poterono gli uccelli privi dell’essenziale delle potenze per distinguere, e ben conoscere essere all’uva ingannati, molto meno ingannar si potè Zeusi ottimo conoscitore al velo, tanto maggiormente, che l’inganno seguir dovea non da lontano, ma di vicino sopra la stessa tavola, che si fingeva coperta dal velo. Oltre di che è anche naturale in casi tali d’andare per la curiosità prima di parlare al tatto, che fa tosto conoscere quella verità, che può occultare la vista. Son pittore ancor io, e sono il Rosa, e non ignoro ciocchè far si può col pennello ! Ma quando anche veri fossero i menzionati inganni, non mi pare, che recar possano a’ detti professori troppo gran loda ; dacchè questa deve nascere dalla perfetta imitazione delle cose animate d’anima ragionevole, e non delle materiali, e sensitive, per la differenza, che v’è tra un eccellente pittore di fiori, di frutti, e d’animali, da altro eccellente d’immagini umane, che merita tanto maggiore stima, quanto è più stimato del corpo lo spirito. Per altro so ancor io signor Abati, che tra le glorie del fortunato secolo dell’invitto domatore dell’oriente fa numero molto grande quella d’esservi abbondantemente fiorite le belle arti. Ma so ancora quanto a’ fatti veri di quel secolo abbiano gl’incredibili, e falsi pregiudicato. Tantocchè, se io non vedessi cogli occhi miei le loro statue, niente crederei delle pitture. E’ egli forse credibile, che dipigner si possano e’ tuoni, come è stato scritto, che si dipignevan da Apelle ? Che possa rappresentarsi un oggetto fiero, e pietoso, allegro, e mesto, altiero, ed umile in un medesimo tempo, come è stato scritto, che dipignesse il genio degli Ateniesi Parrasio ? Queste son cose signor Abati impossibili ! E se voi tralasciato avete di rammentarle, o perchè io non v’ho dato tempo, o perchè a voi non son note, ho voluto in ogni modo suggerirvele ; acciò possiate unirle all’altre, che testè rammentaste, per indurre in miglior occasione gli ascoltanti a uniformarsi al vostro giudizio ; giacchè, nè io, nè alcuno di questi insigni letterati che l’an sentite, vi concorrono, anzi lo disapprovano, e lo mettono in un con me, come ben vedete, in ridicolo.
Signor Abati mio non parlo in gioco,
Questo che dato avete è un gran giudizio,
Ma del giudizio voi n’avete poco.
- [1] voir aussi fortune de Pline
Pascoli, Lione, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni(publi: 1730), “Vita di Salvator Rosa”, t. I, p. 73-74 (italien)
E mentrecchè era un giorno in casa sua tutta la brigata, che secon anche pranzato aveva, prese esarruto l’Abati ad amplificare le maraviglie de’ pittori greci, e disse, che certe, che egli ne leggeva essere state fatte da que’ gran professori, che fiorirono nel fortunato secolo del grande Alessandro, non l’aveva mai ne lette, ne per tradizione sentite, che si facessero negli altri secoli, e che perciò li giudicava superiori a’ moderni, e riscaldato nel dire così si disse, che dicesse : “Devevi senza dubbio signor Salvadore esser noto, perché pienamente ne favellan l’istorie, che Zeusi dipinse tanto naturale, e vera l’uva con un putto in un quadro, che tentaron d’ingozzarla gli augelli ; e che Parrasio dipinse così esatamente un velo in una tavola, che Zeusi in vedendolo dovè dire, che lo scoprisse. Dovreste saper parimente, che Apelle coloriva così maestrevolmente, e con tanta naturalezza gli animali, e particolarmente i cavalli, che esposti alla pubblica vista, gli altri cavalli in passando nel vederli anitrivano. E questo seguì in Efeso, quando dipinse l’immagine equestre del mentovato Alessandro. Ed altrove adivenne, quando a concorrenza d’altri pittori ne dipinse un altro, e perché accorto s’era, che gli emuli avevano il favore de’giudici, s’appellò dal giudizio degli uomini a quello de’ brutti. Avrete letto, che Protogene era così esperto nel ritrarre dal naturale i volatili, che in essi infondendo quasi l’anima, giravan loro i vivi cantando d’intorno. E ciò fu veduto in Rodi nella pittura d’una pernice, in tempo, che alcune portatevi a posta di vicino la videro. Che diremo delle celebrate sottilissime loro linee ?”
Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique(publi: 1752), article « Zeuxis », p. 704 (fran)
Ce peintre saisissoit la nature dans toute sa vérité ; il avoit représenté des raisins dans une corbeille, mais avec un tel art que les oiseaux séduits venoient pour becqueter les grappes peintes. Une autre fois il fit un tableau où un jeune garçon portoit un panier aussi rempli de raisins, les oiseaux vinrent encore pour manger ce fruit. Zeuxis en fut mécontent, et ne put s’empêcher d’avouer qu’il falloit que le porteur fût mal représenté, puisqu’il n’écartoit point les oiseaux. Zeuxis avoit des talents supérieurs, mais il n’étoit point sans compétiteurs ; Parrhasius en fut un dangereux pour lui. Il appela un jour ce peintre en défi. Zeuxis produisit son tableau aux raisins qui tromperent les oiseaux mêmes ; quelle preuve plus forte de l’excellence de sa peinture ! Mais Parrhasius ayant montré son ouvrage, Zeuxis impatient s’écria, Tirez donc ce rideau, et c’étoit ce rideau même qui faisait le sujet de son tableau. Zeuxis s’avoua vaincu, puisqu’il n’avoit trompé que des oiseaux, et que Parrhasius l’avoit séduit lui-même.
La Nauze, abbé de, Mémoire sur la manière dont Pline a parlé de la peinture(publi: 1759, redac: 1753/03/20), p. 231-232 (fran)
- [1] Parallèle, t. I p. 200
- [2] Abrégé de la vie des peintr. Vie de Protog.
- [3] Vie de Zeuxis
- [4] Cours de peint. p. 443
Les couleurs ne sont pas le seul point où Pline se soit peint comme physicien, dans son histoire de la peinture ; il sème encore, çà et là, plusieurs traits relatifs à l’histoire naturelle des animaux, en racontant comment ils avoient été trompés à la vue de certains tableaux. L’objet ne paroît pas d’abord mériter l’attention des lecteurs, dont les uns traiteront ces faits de pure fable, et les autres de pure bagatelle ; cependant comme il n’y a rien de plus nuisible à la littérature que le mépris de ce que les anciens ont écrit, et rien de plus préjudiciable à l’histoire, que de vouloir juger de l’ancien temps par le nôtre, ces importantes considérations, et la nécessité de justifier la physique de Pline, demandent une réflexion sur la question présente. Sans la délicatesse de notre siècle, qui ne souffriroit jamais qu’on cherchât à faire illusion à des animaux, pour mettre un ouvrage de peinture à l’épreuve, peut-être que la tentative réussirait aujourd’hui comme autrefois ; et si l’on en veut croire M. Perrault [1], les peintres modernes ne le cèdent point aux anciens dans ce genre de succès. Il en rapporte plusieurs exemples du dernier siècle ; mais comme il n’en parle, ce semble, que pour pouvoir dire qu’un chardon de Le Brun, qui trompa un âne, valoit bien les raisins de Zeuxis, qui trompoient les oiseaux, il nous permettra de ne pas plus compter sur ses expériences que sur sa logique, et de nous en tenir au témoignage même de nos peintres modernes, qui ne veulent ici ni parallèle, ni conformité avec les anciens. Peut-être donc que la peinture en détrempe des anciens, moins luisante que la peinture à l’huile d’aujourd’hui, présentoit les objets d’une manière plus naturelle et plus séduisante. « Les anciens, dit M de Piles [2], avoient des vernis qui donnoient de la force à leurs couleurs brunes, et leur blanc était plus blanc que le nôtre, de sorte qu’ayant par ce moyen plus d’étendue de degrés de clair-obscur, ils pouvoient imiter certains objets avec plus de force et de vérité qu’on ne fait par le moyen de l’huile. » Aussi le même auteur a-t-il adopté sans difficulté, dans son abrégé de la vie des peintres [3], et dans le parallèle qu’il a fait de la peinture et de la poësie [4], le récit de Pline sur les animaux trompés par des peintres. Et comment nier ces sortes de faits, quand des écrivains les attestent positivement, que les exemples en sont variés et répétés, car Pline ne les rapporte pas tous, qu’ils ne renferment rien d’impossible, et que ces effets de l’ancienne peinture sont même beaucoup moins surprenans que ceux de l’ancienne musique ou de l’ancienne méchanique, dont il ne nous est pourtant pas permis de douter ? Des présomptions vagues contre l’Antiquité ne seront point admises, dans un siècle sur-tout équitable et éclairé, où d’anciennes découvertes, qu’on regardoit comme chimériques, se renouvellent chaque jour ; et si les savans modernes, à qui nous en sommes redevables, avoient écouté je ne sais quels préjugés préférablement à l’autorité de l’histoire, ils auroient acquis moins de gloire, et moins contribué à celle des arts. Ces réflexions sur les égards dûs au témoignage des anciens historiens sont de la dernière importance en tout genre de littérature, quoique l’occasion qui les fait naître puisse paroître mince et frivole.
Galloche, Louis, Traité de peinture, lu le 7 avril 1753 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1753/04/07), 88-89 (fran)
J’apprends du même auteur [Pline] que Zeuxis avait trompé deux fois différentes les oiseaux qui venaient becqueter les raisins qu’il avait peints, et fut trompé lui-même par le vrai d’un rideau que Parrhasios, son émule, avait feint, comme n’étant mis que pour couvrir son tableau
Diderot, Denis, Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763(redac: 1759:1763), Salon de 1763, p. 220-221 (fran)
Ah, mon ami, crachez sur le rideau d’Apelle et sur les raisins de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient, et les animaux sont mauvais juges en peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du Roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives ? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera, quand il voudra.
Le Mierre, Antoine-Marin, La Peinture, poème(publi: 1761), « Chant troisième [l’invention] », p. 68 (fran)
O puissance de l'Art! véritables prodiges!
O le plus séduisant, le plus doux des prestiges!
Plus on a su cacher les secrets du pinceau,
Plus il produit l’erreur, plus son triomphe est beau.
Trompé par les raisins l’oiseau vole au treillage,
L’animal belliqueux hennit à son image ;
Et l’œil du connoisseur et l’œil du villageois,
La science et l’instinct sont séduits à la fois.
Créateur des objets dont il est le copiste
L’art a trompé la brute, il va tromper l’artiste :
Zeuxis, tu cours lever ce magique rideau,
Il ne cache que l’art, ce voile est le tableau.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), t. II, „Von dem Ausdrucke überhaupt und der Ausführung insbesondere” (numéro IV, 2, 53) , p. 756 (allemand)
Die Mahlerey ist überhaupt ein Ausdruck, welcher der Seele einen Körper giebt, und leblosen Gegenständen das Täuschende (illusion). Hier ergreift Zeuxis den gemahlten Vorhang des Parrhasius, dort glaubt man die Dido von Lieb und Undank sprechen zu hören, und möchte mit dem Canitz[1] ihren Hohn an den Trojanern rächen.
- [1] Gedicht von der Poesie.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’expression en général et de l’exécution en particulier » (numéro IV, 2, 53) , t. II, p. 246 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
La peinture est en général une expression qui revêt l’ame d’un corps, et qui prête l’illusion aux objets inanimés. Ici Zeuxis porte la main sur le rideau peint par Parrhasius, là on croit entendre la sensible Didon s’exhaler en plaintes contre l’ingratitude d’Enée : on est tenté, comme dit Canitz, de vanger son injure sur les Troyens. C’est là l’expression des passions.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), „Von dem Ausdrucke überhaupt und der Ausführung insbesondere” (numéro IV, 2, 53) , t. II, p. 760-761 (allemand)
Dieser Charakter lieget demnach in der Wahrheit der Umrisse und in der Wahrheit der Tinten: nur vereinigt überreden beyde. Niemand hätte an dem Gemählde des Parrhasius, das den Vorhang vorstellte, der Ausdruck der Natur des Stoffes an demselben allein den Zeuxis betrügen können, wenn die Ordnung der Falten unnatürlich gewesen wäre. Eben so wenig würde der richtigste Wurf der Falten das Auge haben überreden können, wenn ihnen die ausgedrückte Wahrheit des Stoffes gemangelt hätte. Die Züge, denen die Ueberlieferung jener überredenden Tinten anvertrauet worden, sollen mit der Rauhigkeit[1] oder der Glätte, der Weichlichkeit oder der Härte, der Zärte oder der Durchsichtigkeit[2] der Körper, wie mit ihren Formen überein treffen. Das heißt : Zeichnung, Farbe und Behandlung sind einstimmig. Das Urtheil des Auges entscheidet was der leichten und festen Hand zur Ausführung überlassen wird.
- [1] Carl Ruthard, ein berühmter Jagdmahler, pflegte zuweilen bey der fleissigen Manier, die er einmal angenommen hatte, z. B. einige Borsten des Ebers mit dem Pinselstiel nachzuahmen. Die einstimmige Behandlung dieser Art möchte wohl den fleissigen Zügen des jüngern Weenix und der freyen Hand des Franz Snyders den Vorzug schwerlich streitig machen. Jenes Hülfsmittel ist in blossen Nebendingen, z. B. Spitzen durchzubrechen, damit der Grund durchspiele, einem Pieter Quast und Brekelekamp endlich nicht zu misgönnen ; ihre Manier ist auch darnach.
- [2] Ein anders ist es, in diesen und andern Fällen beym Glasiren, den Grund durchspielen zu lassen, wie Giusmann in gewissen Vorgründen, oder auch wohl Art van der Neer in seinen Landschaften den Mondschein. Die Klarheit an den vom Monde beschienenen Gebäuden hat er in einem Gemählde, durch den durchspielenden Grund des Brettes, unter einer leichten Glasirung, heraus zu bringen gesucht. In allen diesen Fällen ist die Erreichung der natur die Hauptabsicht. Den flüchtigen Kriegsmahlereyen haben diese Vortheile nichts ausserordentliches.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’expression en général et de l’exécution en particulier » (numéro IV, 2, 53) , t. II, p. 250 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ce caractère est par conséquent renfermé dans la vérité des contours et dans la vérité des teintes : l’union de ces deux vérités opere le prestige. Dans le tableau de Parrhasius qui représentoit un rideau, l’expression de la nature de l’étoffe toute seule n’auroit jamais pu tromper Zeuxis, si l’ordre des plis n’avoit pas été naturel. De même le jet le plus exact n’auroit jamais pu persuader l’œil, si ces plis n’avoient pas porté le vrai caractere de l’étoffe. Il faut que les traits, destinés à nous offrir cette illusion des teintes, s’accordent avec le rude et le poli[1], avec la molesse et la dureté, le tendre et le transparent des corps, ainsi qu’avec leurs formes. C’est à dire, il faut que le dessin, le coloris et la manœuvre soient dans un bel accord. Le jugement de l’œil décide, quelles parties on doit abandonner à la facilité de la main dans l’exécution.
- [1] [1] Dans le stratagême des glacis, les peintres font quelquefois paroître les fonds derriere les objets, comme a fait Huysman dans ses premiers plans, ou Art van der Neer dans ses clairs de lune. Celui-ci dans un de ses paysages a tâché de produire ce ton lumineux des demeures rustiques éclairées par la lune, au moyen du fond vague des planches sous un glacis léger. Rendre la nature doit être toujours l’objet principal.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), „Von den Mittelfarben überhaupt“ (numéro IV, 1, 48) , t. II , p. 694 (allemand)
Auf die angezeigte Masse haben die Trauben des Zeuxis, leicht Haltung, Rundung und Klarheit gewinnen können: und noch jetzt erhält der forschende und geübte Niederländer durch den Saft dauerhafter Farben, und die Vortheile des Glasirens und gemässigter Wiederscheine für seine Gemählde, die ihm und allen Mahlern empfohlne Durchsichtigkeit.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, t. II, « Des demi-teintes en général » (numéro IV, 1, 48) , p. 182 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
C’est ainsi que Zeuxis a pu donner à ses raisins le ton de la dégradation, la rondeur et la clarté : c’est ainsi que le Flamand laborieux et exercé releve ses tableaux par la suavité de ses couleurs, par les avantages de ses glacis et de ses reflets, et qu’il y introduit ces tons transparents qu’on ne sauroit trop recommander à tous les peintres.
Algarotti, Francesco, Saggio sopra la pittura, saggio sopra l’Academia di Francia che è in Roma(publi: 1763), “La bilancia pittorica”, p. 140 (italien)
Il quel medesimo tempo tanto alla pittura propizio si distinse Jacopo Bassano per la forza del tingere. Pochissimi seppero al pari di lui fare quelle giusta dispensazione di lumi dall’una all’altra cosa, e quelle felici contrapposizioni, per cui gli oggetti dipinti vengono a realmente rilucere. Egli si potè far vanto di avere ingannato un Annibale Caracci, come già Parrasio ingannò Zeusi[1].
- [1] Vedi lo stesso [Bellori] nella vita di Annibale Caracci.
Algarotti, Francesco, Saggio sopra la pittura, saggio sopra l’Academia di Francia che è in Roma, « La balance des peintres », p. 216 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Le Bassan se distingua à peu-près dans le même tems[Explication : que Titien.] par la force de sa couleur. Peu de peintres sçurent mieux que lui, faire une juste distribution des lumieres et connoître ces heureuses oppositions qui font ressortir les objets. peut se vanter d’avoir trompé Annibal Carrache comme Parrhasius trompa Xeusis (sic)[1].
- [1] Bellori.
Galloche, Louis; Cochin, Charles-Nicolas, "Nouvelle version du Traité de peinture de Louis Galloche", lue le 3 décembre 1763 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1763/12/03), p. 810-811 (fran)
Il [Pline] nous apprend que Zeuxis avait trompé deux fois différentes les oiseaux qui venaient becqueter les raisins qu’il avait peints, et qu’il fut trompé lui-même par la vérité d’un rideau que Parrhasios, son émule, avait feint comme n’étant mis que pour couvrir son tableau.
Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), p. 265 (fran)
Dans le nombre de ses productions pittoresques, tous les auteurs s’étendent principalement sur celle de les raisins, et du rideau de Parrhasius. Ce n’est point cependant dans ces sortes de choses que consiste le sublime et la perfection de l’art ; de semblables tromperies arrivent tous les jours dans nos peintures modernes, qu’on ne vante pas davantage par cette seule raison. Des oiseaux se sont tués contre le ciel de la perspective de Ruel en voulant passer outre, sans que cela soit beaucoup entré dans la louange de cette perspective. Un tableau de M. le Brun, sur le devant duquel étoit un grand chardon bien représenté, trompa un âne qui passoit, et qui, si on ne l’eût empêché, auroit mangé le chardon ; je dis avec M. Perrault mangé, parce que le chardon étant nouvellement fait, l’âne auroit infailliblement léché toute la peinture avec sa langue. Quelquefois nos cuisiniers ont porté la main sur des perdrix et sur des chapons naïvement représentés pour les mettre à la broche ; on en a ri, et le tableau est demeuré à la cuisine.
Diderot, Denis ; Falconet, Étienne, Le Pour et le contre. Pline et les anciens auteurs qui ont parlé de peinture et de sculpture(publi: 1958, redac: 1766-1773), Lettre de Falconet à Diderot, 25 mai 1766, p. 186 (fran)
Encore un post-scriptum et je finis, il s’agit d’un ancien dont je vous ai dit un mot ailleurs. Je ne l’ai pas encore lu ; mais en le parcourant, je viens de trouver que le fameux satyre de Protogène était appuyé contre une colonne sur laquelle était peinte une perdrix si ressemblante qu’on laissait le satyre, quoique parfait, pour n’admirer que l’oiseau. Les perdrix mêmes venaient voltiger autour, en la saluant de leur ramage. (Strab., L. XIV p. 632). Mon ami, une belle preuve que la peinture était alors au berceau et qu’on y était fort peu accoutumé, c’est l’admiration si fréquente des gens et des bêtes. Montrez aujourd’hui une chienne ou une perdrix de Desportes, d’Oudry, de Chardin, de Bachelier ou des autres peintres dont nous admirons les ouvrages en ce genre, vous verrez ce qu’en dira le chien de chasse : et pourtant croyez sans peine que nos peintres modernes ont représenté une chienne ou une perdrix aussi bien que le peintre grec. Strabon a presque bien observé le Jupiter de Phidias, et le voilà qui donne du nez dans la perdrix de Protogène, j’en suis vraiment fâché.
Dictionnaire d’anecdotes, de traits singuliers et caractéristiques, historiettes, bons mots, naïvetés, saillies, reparties ingénieuses, etc. etc.(publi: 1766), art. « Peintres », vol. 2, p. 536 (fran)
Un peintre avoit représenté un enfant tenant une corbeille de fruits. Quelqu’un, pour vanter le tableau, disoit que ces fruits paroissoient si naturels, que les oiseaux venoient les becqueter. Un paysan de bon sens, qui écoutoit ces louanges, répondit : Assurément si les fruits sont si bien représentés, l’enfant ne l’est guères. En effet, il falloit supposer que la figure fût bien mal peinte, puisque les oiseaux n’en avoient point peur.
Diderot, Denis ; Falconet, Étienne, Le Pour et le contre. Pline et les anciens auteurs qui ont parlé de peinture et de sculpture(publi: 1958, redac: 1766-1773), Lettre de Falconet à Diderot, 6 mars 1766, p. 117 (fran)
Le même Apelle peignit un cheval si bien que les chevaux qu’il avait pris pour juges, hennissaient devant son tableau et ne regardaient seulement pas ceux de ses concurrents. Depuis ce temps-là on a toujours fait la même expérience. Idque postea semper illius experimentum artis ostentatur. […]
Diderot, Denis ; Falconet, Étienne, Le Pour et le contre. Pline et les anciens auteurs qui ont parlé de peinture et de sculpture(publi: 1958, redac: 1766-1773), Lettre de Falconet à Diderot, 6 mars 1766, p. 123 (fran)
Quoi ! Pline s’amuse à faire bien au long le petit conte des raisins et du rideau, de Zeuxis et de Parrhasius, il a la même complaisance pour les deux lignes tirées sur une table d’attente par Apelle à Protogène, sans pourtant nous apprendre si ces lignes représentaient ou non quelques objets de la nature. Il croit en bonne et franche nourrice, que des chevaux jugeaient bien un concours de peinture, et le grand homme qui se complaît à ces niaiseries nous dit en courant que le Laocoon et préférable aux autres ouvrages. […] Oui, sans doute Pline a loué quelquefois platement des ouvrages, peut-être sublimes, comme vous l’avouez ironiquement et comme je le crois fort sérieusement. Il a loué aussi, comme je voudrais mériter de l’être, de prétendues beautés que nous laissons aux Boulevards et au pont Notre-Dame.
Diderot, Denis ; Falconet, Étienne, Le Pour et le contre. Pline et les anciens auteurs qui ont parlé de peinture et de sculpture(publi: 1958, redac: 1766-1773), Lettre de Diderot à Falconet, 5 août 1766, p. 218 (fran)
Lorsque vous reprochez à Pline l’écume du chien de Ialyse, les raisins de Zeuxis, la ligne de Protogène, le rideau d’un autre, vous oubliez le titre de son ouvrage, Pline vous crie, je ne suis pas peintre, je suis historien. Ce n’est pas des beaux-arts seulement, c’est de l’histoire naturelle que j’écris.
Dictionnaire portatif des faits et dits mémorables de l’histoire ancienne et moderne, tome 2(publi: 1768), art. « Zeuxis », p. 721 (fran)
Zeuxis et Parrhasius entrerent un jour en lice et se disputerent le prix. Zeuxis parut le premier avec son tableau, où il avoit peint des raisins. Les oiseaux y furent trompés, et s’approcherent pour les becqueter. Parrhasius vint ensuite ; il avoit peint sur son tableau un rideau. Zeuxis, fier du suffrage des oiseaux, lui dit : « Tirez votre rideau et voyons votre ouvrage » ; mais il fut bien surpris lorsqu’il s’apperçut que ce rideau étoit peint : il s’avoua vaincu, et trouva moins difficile de tromper des oiseaux que les yeux d’un peintre.
Ce fameux tableau des raisins trouva des critiques ; ces raisins étoient portés par un petit paysan : quelqu’un s’avisa de dire que si les raisins étoient bien peints, le petit paysan l’étoit fort mal, puisque les oiseaux n’en avoient point de peur.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), t. I, p. 153 (fran)
On dit que celui-ci présenta le défi à Zeuxis, qui ayant aporté des raisins peints avec tant de vérité que des oiseaux vinrent pour les béqueter, l’autre aporta un rideau si naturellement réprésenté, que Zeuxis, fier du sufrage des oiseaux, demanda que le rideau fût tiré pour qu’on vît le tableau; qu’alors Zeuxis ayant reconnu son erreur, acorda avec une franchise modeste le prix à son rival, parce que lui n’avoit trompé que des oiseaux, et Parrhasius un artiste (29). On dit qu’ayant peint ensuite un Enfant qui portoit des raisins qu’un oiseau était venu pour béqueter, il se fâcha avec la même franchise contre son tableau, et dit : « J’ai mieux peint les raisins que l’Enfant ; car si celui-ci eut été aussi bien fait, l’oiseau auroit dû avoir peur » (30).
Notes, t. I, p. 287-288 : (29) Ce conte est répeté partout comme une merveille. Cependant chacun sait aujourd’hui, ou doit savoir, combien il est facile de faire illusion dans ce genre de peinture. Quand on raporte de ces historietes, et qu’on les met sur le compte de quelques grands artistes, il faut les qualifier de ce qu’elles sont et ne les donner que pour ce qu’elles valent. Il n’y auroit pas de reproche particulier à faire à Pline, si, comme tant d’autres écrivains, il eut raporté ce trait pour l’ajuster dans un discours qui au fond lui seroit étranger. Mais il semble que si un philosophe historien s’est engagé à traiter un sujet ex professo, quelque soit son siècle, il doit donner les choses pour ce qu’elles valent ; et si son siècle n’est pas apréciateur, c’est un philosophe qui écrit comme son siècle pense, auquel cas il n’y a pas de mal de rectifier lui et son siècle.
(30) C’est encore un bon petit conte à ces deux égards. Tous les jours des oiseaux aprochent, sans en avoir peur, du plus beau tableau et de la plus belle statue ; ils s’y reposent même. Lorsqu’un âne voulut, dit-on, manger un beau chardon peint dans une des batailles d’Aléxandre Le Brun, pourquoi n’avoit-il pas peur de ce cheval blanc qui galope tout auprès, de cette foule de cavaliers et de soldats qui sont en mouvement dans ce tableau ? Ce n’étoit pas que les hommes et les chevaux fussent plus mal réprésentés que le chardon ; c’est que l’instinct des bêtes les conduit à l’aparence de ce qui leur est propre, et qu’au-delà un âne est un mauvais connoisseur en peinture. Les objets variés et groupés, les lumières et les ombres diversement projettées, sont autant de causes qui empêchent les animaux de rien distinguer dans un tableau ; si l’enfant eût porté le même raisin à sa bouche, l’oiseau ne seroit pas venu pour le béqueter ; si le chardon n’eût pas été tout seul dans un coin du tableau de Le Brun, ou qu’il eût été bien groupé avec d’autres objets, l’âne ne l’eût pas aperçu. Et puis tout cela est-il bien vrai ? En le suposant, des raisins pouvoient donc jusqu’à un point décevoir les oiseaux, sans que l’enfant fut plus mal peint que les raisins ; et pour que Parrhasius eut dit ce qu’on lui fait dire ici, il auroit fallu qu’il eût peu de talent, peu de jugement et peu de connoissance de son art. C’est ce que Pline eut observé, si lui-même eut connu l’art. Voyez les notes 58 et 64 .
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776), t. II, p. 150-151 (fran)
Le Brun ayant achevé un tableau sur le devant duquel il avoit peint un grand chardon, représenté d’après nature, on mit ce tableau dans la cour de la maison où demeuroit Le Brun, afin de le faire sécher. Une bonne femme et son âne passèrent dans la rue ; l’âne n’eut pas plutôt apperçu le chardon du tableau, qu’il entre brusquement dans la cour, renverse la femme qui tâchoit de le retenir par son licou, et, sans deux garçons vigoureux qui, à force de coups de bâton, l’obligèrent à se retirer, il auroit mangé le chardon ; on peut dire qu’il l’auroit mangé, parce que le tableau étant nouvellement fait, il en auroit emporté toute la peinture avec sa langue[1].
- [1] Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes.
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776), t. I, p. 188 (fran)
Zeuxis rendit si parfaitement la nature, que les oiseaux vinrent plusieurs fois becqueter des raisins qu’il avoit peints dans une corbeille.
Parrhasius ôsa seul défier cet artiste, aussi habile qu’orgueilleux. Zeuxis produisit la représentation des raisins qui avoit trompé les oiseaux. Parrhasius ayant montré son ouvrage, Zeuxis impatient s’écria : tirez donc ce rideau ! C’était ce rideau même qui faisoit le sujet du tableau. Zeuxis alors s’avoua vaincu, puisqu’il n’avoit trompé que des oiseaux, au lieu que Parrhasius l’avoit séduit lui-même.
Quelque temps après, Zeuxis peignit un jeune garçon, qui portoit sur la tête un panier rempli de raisins. Il s’aperçut encore que les oiseaux, attirés par la ressemblance du fruit, s’approchoient pour le becqueter ; mais loin de s’en applaudir, il en conclut que son ouvrage avoit des défauts. Voici comment il raisonna : « Si les raisins ne sont pas mal, puisque les oiseaux y ont été trompés, il faut convenir que le jeune homme qui les porte, n’est guère bien, puisqu’ils n’en sont point effrayés ».
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, article « Peinture chez les Grecs », Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), p. 643 (fran)
Zeuxis, défié par Parrhasius, apporta des raisins peints que des oiseaux vinrent becqueter : Parrhasius apporta de son côté un rideau peint, que son rival le pria de tirer, afin qu’on pût juger de son ouvrage. Zeuxis se déclara vaincu, parce que lui-même n’avoit trompé que des animaux, et que Parrhasius avoit trompé un peintre. Ce n’est pas sur ces petites illusions d’un moment que l’on juge des ouvrages de l’art. Ce n’est pas sur la représentation d’une grappe de raisin et d’un rideau, que les plus grands peintres d’un siècle florissant par les arts, se dispurent le prix. Voyez l’article ILLUSION. Mais si l’on suppose que ce récit avoit quelque fondement, il peut nous faire apprécier les progrès que l’art avoit faits dans les parties nécessaires à des illusions semblables.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), art. « Illusion », vol. 1 , p. 438 (fran)
Le but des arts qu’on appelle arts d’imitation, est fixé par cette dénomination même. Ils doivent imiter la vérité, mais ces imitations ne doivent pas être prises pour la vérité même. Si elles ressembloient parfaitement à la nature, si elles pouvoient être prises pour elle, elles n’exciteroient plus aucun sentiment d’admiration ni de plaisir. […] Cependant les personnes qui ne connoissent point l’art, placent dans l’illusion la perfection de la peinture. Cette erreur n’est pas nouvelle. Les anciens ont célébré les raisins de Zeuxis que des oiseaux vinrent becqueter, et le rideau de Parrhasius qui trompa Zeuxis lui-même. Il est vrai que l’artiste, en prenant les précautions nécessaires pour la manière dont il expose ses ouvrages, peut opérer une illusion complette par des peintures de fruits, de rideaux, de bas-reliefs, d’ornemens d’architecture, et d’autres objets semblables ; mais il ne fera jamais prendre pour la vérité même un tableau qui supposera des plans variés et un certain enfoncement. Si donc l’illusion étoit la première partie de la peinture, la plus grande gloire, dans ce genre, seroit réservée aux peintres qui ne traitent que les plus petits détails de la nature, et le dernier de tous les genres seroit celui de l’histoire, parce qu’il se refuse plus que les autres à la parfaite illusion.
« On voit, dit Félibien, de certaines remarques qu’Annibal Carrache a faites sur les vies des peintres de Vasari, et à l’endroit où il est parlé de Jacques Bassan, il dit : Jacques Bassan a été un peintre excellent et digne de plus grandes louanges que celles que Vasari lui donne, parce qu’outre les beaux tableaux qu’on voit de lui, il a fait encore de ces miracles qu’on rapporte des anciens Grecs, trompant par son art, non seulement les bêtes, mais les hommes : ce que je puis témoigner, puisqu’étant un jour dans sa chambre, je fus trompé moi-même, avançant la main pour prendre un livre que je croyois un vrai livre, et qui ne l’étoit qu’en peinture. »
Est-il bien vrai qu’Annibal ait fait cette note ? Mais s’il l’a faite, il ne faut pas se laisser séduire par quelques mots peu réfléchis, échappés à ce grand artiste. Surpris d’avoir été trompé lui-même par un ouvrage de l’art, il a mis, sans y bien songer, trop d’importance à cette petite aventure : mais on peut être bien sûr qu’il auroit pas donné l’un de ses moindres tableaux d’histoire pour le livre peint et découpé du Bassan.
Gazette française. Papier-nouvelles de tous les jours et de tous les pays(publi: 1792:1797), "L’Andromède représentée par la Troupe royale au Petit-Bourbon, avec l'explication de ses machines", p. 281 (fran)
Vous ne trouverez pas ici même artifice que Parrhaze employa dans son rideau pour tromper son compétiteur dans la peinture ; car celui qui se présente le premier aux yeux des spectateurs ne doit pas borner la vue. C’est pourquoi il se lève pour faire l’ouverture du théâtre, mais avec une telle vitesse que l’œil le plus subtil, quelque attachement qu’il y apporte, ne peut suivre la promptitude avec laquelle il disparoît, tant les contrepoids qui l’élèvent sont industrieusement proportionnés à sa grande étendue.
Goethe, Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke(publi: 1798, trad: 1996) (vol. 38), p. 151-152 (allemand)
ZUSCHAUER — Nur dem Ungebildeten, sagen Sie, könne ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen.
ANWALD — Gewiß, erinnern Sie sich der Vögel, die nach des großen Meisters Kirschen flogen.
ZUSCHAUER — Nun beweis’t das nicht, daß diese Früchte vortrefflich gemalt waren ?
ANWALD — Keineswegs, vielmehr beweis’t mir, daß diese Liebhaber echte Sperlinge waren.
ZUSCHAUER — Ich kann mich noch deswegen nicht erwehren, ein solches Gemälde für vortrefflich zu halten.
ANWALD — Soll ich Ihnen eine neuere Geschichte erzählen ?
ZUSCHAUER — Ich höre Geschichte meistens lieber als Raisonnement.
ANWALD — Ein großer Naturforscher befaß, unter seinem Haustieren, einen Assen, den er einst vermißte, und nach langem Suchen in der Bibliotek fand. Dort saß das Tier an der Erde, und hatte die Kupfer eines ungebundnen, naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifriges Studium des Hausfreundes, nahte sich der Herr, und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Asse die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildert gefunden, herausgespeis’t habe.
ZUSCHAUER — Die Geschichte ist lustig genug.
ANWALD — Und passend hoffe Ich.
Goethe, Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke, (trad: 1996), p. 184-185 (trad: "« Du vrai et du vraisemblable dans les œuvres d’art »" par Schaeffer, Jean-Marie en 1996)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
LE SPECTATEUR — Ce n’est qu’à un homme non cultivé, dites-vous, qu’une œuvre d’art peut apparaître comme une œuvre de la nature.
LE DÉFENSEUR — Certainement ; rappelez-vous les oiseaux qui se précipitaient sur les cerises du grand maître.
LE SPECTATEUR — Eh bien, cela ne prouve-t-il pas que ces fruits étaient peints à la perfection ?
LE DÉFENSEUR — Nullement, pour moi cela prouve au contraire que ces amateurs étaient de véritables moineaux.
LE SPECTATEUR — Cela ne saurait m’empêcher pourtant de trouver parfaite une telle toile.
LE DÉFENSEUR — Voulez-vous que je vous raconte une histoire plus récente ?
LE SPECTATEUR — En général je préfère les histoires aux raisonnements.
LE DÉFENSEUR — Un grand naturaliste possédait, parmi d’autres animaux domestiques, un signe, qu’un jour il perdit et retrouva, après de longues recherches, dans sa bibliothèque. L’animal y était assis à même le sol, les gravures d’une œuvre d’histoire naturelle non encore reliée éparpillées à l’entour. Le maître, étonné par cette application studieuse dont avait fait preuve son animal domestique, s’approcha : interloqué et contrarié, il put constater que le singe gourmand avait mangé tous les scarabées qu’il avait trouvé dépeints ici et là.
LE SPECTATEUR — L’histoire est assez plaisante.
LE DÉFENSEUR — Et pertinente, j’espère.
Commentaires :
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Aesthetik(publi: 1835:1838, redac: 1818:1829), Einleitung, III. "Begriff des Kunstschönen, Gewöhnliche Vorstellungen von der Kunst", 3. "Zweck der Kunst"(fran)
Zwar gibt es ebenso Beispiele vollendet täuschender Nachbildung. Die gemalten Weintrauben des Zeuxis sind von alters her für den Triumph der Kunst und zugleich für den Triumph des Prinzips von der Nachahmung der Natur ausgegeben worden, weil lebende Tauben dieselben sollen angepickt haben. Zu diesem alten Beispiele könnte man das neuere von Büttners Affen hinzufügen, der einen gemalten Maikäfer aus Rösels Insektenbelustigungen [1] zernagte und von seinem Herrn, dem er doch auf diese Weise das schönste Exemplar des kostbaren Werkes verdarb, zugleich um dieses Beweises von der Trefflichkeit der Abbildungen willen Verzeihung erhielt. Aber bei solchen und anderen Beispielen muß uns wenigstens sogleich beifallen, daß, statt Kunstwerke zu loben, weil sie sogar Tauben und Affen getäuscht, gerade nur die zu tadeln sind, welche das Kunstwerk zu erheben gedenken, wenn sie nur eine so niedrige Wirkung von demselben als das Letzte und Höchste zu prädizieren wissen. Im ganzen ist aber überhaupt zu sagen, daß bei bloßer Nachahmung die Kunst im Wettstreit mit der Natur nicht wird bestehen können und das Ansehen eines Wurms erhält, der es unternimmt, einem Elefanten nachzukriechen.
- [1] 1741 ff.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Aesthetik, Introduction, "Représentations communes", t. I, p. 98-99 (trad: "Esthétique" par Bénard, Charles; Timmermans, Benoît; Zaccaria, Paolo)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Il est vrai qu’on trouve des exemples d’imitations qui procurent une illusion parfaite. Les grappes de raisin peintes par Zeuxis sont citées depuis l’Antiquité comme le triomphe de l’art, et en même temps comme le triomphe du principe de l’imitation de la nature, car des colombes vivantes seraient allées les becqueter. Nous pouvons ajouter à cet exemple antique l’exemple moderne du singe de Büttner, qui rongeait un hanneton dessiné dans l’ouvrage de Rösel, Plaisantes curiosités du monde des insectes, mais obtint tout de même le pardon de son maître, dont il avait pourtant abîmé le bel exemplaire de la précieuse œuvre, car il avait ainsi montré l’excellence de la reproduction. Mais avec ces exemples, et d’autres du même genre, nous devrions au moins nous rappeler que, au lieu de louer des œuvres d’art en raison du fait qu’elles ont trompé même des colombes ou des singes, on ne devrait que blâmer ceux qui pensent exalter l’œuvre d’art quand ils présentent un effet si vulgaire comme sa fin ultime et suprême. Nous devons surtout dire que l’art ne pourra jamais, en se bornant à imiter la nature, entrer en compétition avec elle, et qu’en essayant de le faire, il ressemble à un ver qui rampe derrière un éléphant.
Füssli, Johann Heinrich, Lecture IV, "Colour. Fresco Painting", p. 507 (anglais)
Deception follows glare; attemps to substitute, by form or colour, the image for the thing, always marks the puerility of taste, though sometimes its decrepitude. The microscropic precision of Denner, and even the fastidious, though broader detail of Gerard Dow, were symptoms of its dotage. The contest of Zeuxis and Parrhasius, if not a frolic, was an effort of puerile dexterity. But deception, though as its ultimate pitch never more than the successful mimicry of absent objects, and for itself below the aim of art, is the mother of imitation. We must penetrate the substances of things, acquaint ourselves with their peculiar hue and texture, and colour them in detail, before we can hope to seize their principle and give their general air.
Füssli, Johann Heinrich, Lectures on Painting, (trad: 1994), « De la couleur : la fresque » (numéro VIIIe Conférence) , p. 177 (trad: "Conférences sur la peinture" par Chauvin, Serge en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
À cet éblouissement succède l’illusion du trompe-l’œil ; les tentatives de substituer l’image à la chose, par la forme ou la couleur, sont toujours le signe d’un goût puéril, parfois même dégénéré. La précision microscopique de Denner, voire la minutie de détail de Gherard Douw – certes plus ample – étaient des symptômes de radotage. Le concours entre Zeuxis et Parrhasios fut, sinon un divertissement, du moins une rivalité d’adresse puérile. Mais la peinture de trompe-l’œil, quoique à son paroxysme elle n’excède jamais la simulation réussie d’objets absents, et reste elle-même en-deçà du but véritable de l’art, est la mère de l’imitation. Il nous faut pénétrer la substance des choses, nous familiariser avec leurs tons et leur texture respectifs, et les colorer en détail, avant de prétendre en saisir le principe et en restituer l’allure générale.
Bonnefoy, Yves, La Vie errante(publi: 1993), « Les raisins de Zeuxis », 57 (fran)
Un sac de toile mouillée dans le caniveau, c’est le tableau de Zeuxis, les raisins, que les oiseaux furieux ont tellement désiré, ont si violemment percé de leurs becs rapaces, que les grappes ont disparu, puis la couleur, puis toute trace d’image en cette heure du crépuscule du monde où ils l’ont traîné sur les dalles.
Bonnefoy, Yves, La Vie errante(publi: 1993), « Encore les raisins de Zeuxis », 76-77 (fran)
Zeuxis peignait en se protégeant du bras gauche contre les oiseaux affamés. Mais ils venaient jusque sous son pinceau bousculé arracher des lambeaux de toile.
Il inventa de tenir, dans sa main gauche toujours, une torche qui crachait une fumée noire, des plus épaisses. Et ses yeux se brouillaient, il ne voyait plus, il aurait dû peindre mal, ses raisins auraient dû ne plus évoquer quoi que ce soit de terrestre, – pourquoi donc les oiseaux se pressaient-ils plus voraces que jamais, plus furieux, contre ses mains, sur l’image, allant jusqu’à lui mordre les doigts, qui saignaient sur le bleu, le vert ambré, l’ocre rouge ?
Il inventa de peindre dans le noir. Il se demandait à quoi pouvait bien ressembler ces formes qu’il laissait se heurter, se mêler, se perdre, dans le cercle mal refermé de la corbeille. Mais les oiseaux le savaient, qui se perchaient sur ses doigts, qui faisaient de leur bec dans le tableau inconnu le trou qu’allait rencontrer son pinceau en son avancée moins rapide.
Il inventa de ne plus peindre, de simplement regarder, à deux pas devant lui, l’absence des quelques fruits qu’il avait voulu ajouter au monde. Des oiseaux tournaient à distance, d’autres s’étaient posés sur des branches, à sa fenêtre, d’autres sur des pots de couleur.
Bonnefoy, Yves, La Vie errante(publi: 1993), « Encore les raisins de Zeuxis", 81-89 (fran)
I. Zeuxis, malgré les oiseaux, ne parvenait pas à se déprendre de son désir, certainement légitime : peindre, en paix, quelques grappes de raisin bleu dans une corbeille.
Ensanglanté par les becs éternellement voraces, ses toiles déchiquetées par leur terrible impatience, ses yeux brûlés par les fumées qu’il leur opposait en vain, il n’en continuait pas moins son travail, c’était à croire qu’il percevait dans les vapeurs toujours plus épaisses, où s’effaçait la couleur, où se disloquait la forme, quelque chose de plus que la couleur ou la forme.
II. Il reprenait souffle, parfois. Assis à quelques pas de son chevalet parmi les grives et les aigles et tous ces autres rapaces qui s’apaisaient aussitôt qu’il cessait de peindre et semblaient même presque dormir, appesantis dans leurs plumes, pépiant parfois vaguement dans l’odeur de fiente.
Réfléchissant comment se lever en silence et approcher de la toile sans que l’espace à nouveau bascule, d’un coup, dans les battements d’ailes et les innombrables cris rauques ?
III. Et quelle surprise aussi bien cette fin d’après-midi où, s’étant mis debout d’un bond, ayant saisi un pinceau, l’ayant trempé dans du rouge – déjà quelles bousculades, d’ordinaire, quels cris de rage ! –, il dut constater, sa main en tremblait, que les oiseaux ne lui prêtaient aucune attention, cette fois.
C’était bien des raisins pourtant, ce qu’il commençait à peindre. Deux grappes, presque deux pleines grappes là où hier encore les becs infaillibles eussent déjà arraché jusqu’à la dernière des fibres où se fût pris un peu de couleur.
IV. Et pas même, pourtant, ces grappes lourdes, un de ces déguisements par lesquels il avait essayé, parfois, de donner le change à la faim du monde. Ainsi avait-il ébauché, ah certes naïvement ! des raisins rayés de bleu et de rose, d’autres cubiques, d’autres en forme de dieu terme noyé dans sa grande barbe. En vain, en vain ! Son projet n’avait pas même le temps de prendre forme. On dévorait l’idée à même l’esprit, on l’arrachait à sa main tentant d’aller à la toile. Comme s’il y avait dans l’inépuisable nature des raisins striés, des grains durs à six faces qu’on jetterait sur la table, pour un défi au hasard, des grappes comme des statues de marbre pour la délectation des oiseaux.
V. Il peint en paix, maintenant. Il peut faire ses grappes de plus en plus ressemblantes, appétissantes, il peut les couvrir de cette tendre buée qui fait si agréablement valoir contre la paille de la corbeille leur or irisé de gris et de bleu.
Il en vient même, enhardi, à poser à nouveau de vrais raisins près de lui, comme autrefois. Et un moineau, une grive – est-ce donc cela, une grive ? – viennent bien, à des moments, se percher au rebord de la corbeille réelle, mais il les chasse d’un geste, et ceux-là ne reviennent plus.
VI. Longues, longues heures sans rien que le travail en silence. Les oiseaux ont repris devant la maison leurs grands tournoiements du haut du ciel, et quand ils passent près de Zeuxis, qui vient peindre sur la terrasse, c’est avec la même indifférence que s’ils frôlaient un buisson de thym, une pierre.
Il y eut bien, une fois, cette troupe étincelante de perroquets et de huppes qui s’assembla sur les terrasses proches, et cria haut et fort ce qu’il crut être de la colère, mais l’heure d’après, sur quelque décision, perroquets et huppes et grives étaient partis.
VII. Ah, que s’est-il passé, se demande-t-il ? A-t-il perdu le sens de ce que c’est que l’aspect d’un fruit, ou ne sait-il plus désirer, ou vivre ? C’est peu probable. Des visiteurs viennent, regardent. « Quels beaux raisins ! », disent-ils. Et même : « Vous n’en avez jamais peint d’aussi beaux, d’aussi ressemblants. »
Ou bien, se dit-il encore, a-t-il dormi ? Et rêvé ? Au moment même où les oiseaux déchiraient ses doigts, mangeaient sa couleur, il aurait été assis, dodelinant du chef, dans un coin de l’atelier sombre.
Mais pourquoi maintenant ne dort-il plus ? En quel monde se serait-il réveillé ? Pourquoi regretterait-il, comme il sent bien qu’il le fait, ses jours de lutte et d’angoisse ? Pourquoi en vient-il à désirer de cesser de peindre ? Et même, qu’il n’y ait plus de peinture ?
VIII. Zeuxis erre par les champs, il ramasse des pierres, les rejette, il revient à son atelier, prend ses pinceaux, il tremble de tout son corps quand un oiseau, rapide comme une flèche, vient prendre un des grains dans la corbeille. Il attend alors, va à la fenêtre, il regarde les grands vols migrateurs élire un toit, loin là-bas dans la lumière du soir, réduisant à poussière bleue la grappe du soleil qui décline.
Étrange, cet oiseau qui était venu se poser hier, au rebord de cette même fenêtre. Il était multicolore, il était gris. Il avait ces yeux de rapace, mais pour tête une eau calme où se reflétaient les nuées. Apportait-il un message ? Ou le rien du monde n’est-il que cette boule de plumes qui se hérissent, quand le bec y cherche une puce ?
IX C’est quelque chose comme une flaque, le dernier tableau que Zeuxis peignit, après longue réflexion, quand déjà il inclinait vers la mort. Une flaque, une brève pensée d’eau brillante, calme, et si l’on s’y penchait on apercevrait des ombres de grains, avec à leur bord vaguement doré la fantastique découpe qui ourle aux yeux des enfants la grappe parmi les pampres, sur le ciel lumineux encore du crépuscule.
Devant ces ombres claires d’autres ombres, celles-ci noires. Mais que l’on plonge la main dans le miroir, que l’on remue cette eau, et l’ombre des oiseaux et celle des fruits se mêlent.