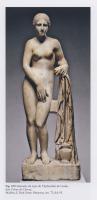Praxitèle, Vénus de Cnide
Bibliographie
Images
Statue d’Aphrodite dite Vénus d’Arles, Paris, Musée du Louvre, n° Ma 429. (Pas d'information sur l'artiste)
Aphrodite de Cnide, reconstitution en plâtre formée de l’association de la Tête Kaufmann sur le torse de la Vénus Colonna (Pas d'information sur l'artiste)
Tzétzès, Ἱστοριαι (Chiliades) (redac: :(1180)), « Sur Praxitèle » (numéro VIII, 195) , p. 314 (grecque)
ρϟε’ ΠΕΡΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
Ὁ Πραξιτέλης λιθουργῶν ὑπῆρχεν ἀνδριάντας,
οὗπερ πολλὰ μέν ἕτερα, ἓν δὲ τῶν δινωνύμων,
τὸ ἐν τῇ Κνίδῳ ἄγαλμα, γυμνὴ ἡ Ἀφροδίτη
λίθῳ λευκῷ βασιλικῷ τῷ καὶ Πεντελησίῳ,
ἧσπερ πολλοὶ καὶ ἐμμανῶς ἠράσθησαν ἀνθρώπων,
καὶ Μακαρεὺς Περίνθιος, ὃς ἐμμανεῖ τῷ πόθῳ,
πιμπρᾶν ἐθέλων τὸν ναὸν τῷ μὴ τοῦ πάθους λήγειν,
καθ’ ὕπνους ἤκουσεν αὐτῆς λεγούσης τὰ Ὁμήρου·
“οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ εὐκνήμιδας Ἀχαιοὺς
τοιῇδ’ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν”.
Ἰσχάδα τὴν Κνιδίαν δὲ πόρνην ἐκ ταύτην ἔσχε.
Τοῦτο δὲ πρὸς τὴν Τέρτυλλαν ὁ Πτολεμαῖος γράφει,
εἴ που τὸν Ἡφαιστίωνα γινώσκεις Πτολεμαῖον.
------(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Praxitèle était un tailleur de statues de pierre,
duquel naquirent bien des oeuvres variées, mais une unique méritent d'être parmi les renommées :
L’effigie de Cnide, l’Aphrodite nue,
En pierre blanche et royale du Pentélique,
qui précisément fut aimée d’amour fou par bien des hommes,
dont Macareus de Périnthe qui, devenu fou de désir,
Voulait incendier son temple parce que sa passion ne connaissait pas de fin ;
il l'entendit dans son sommeil lui dire ces vers d’Homère :
« Pas de blâme aux Troyens et aux Achéens aux bonnes jambières
si pour une telle femme ils souffrent si longtemps de si longs maux ».
C'est qu'à cause d'elle, elles avaient la figue sèche, les putains de Cnide !
C'est ce que, contre Tertylla, écrit Ptolémée
--- Si d’aventure tu connais Héphestion Ptolémée.
Varchi, Benedetto, Lezioni quattro sopra alcune quistioni d’amore(redac: :1565), « Quistione sesta, Se alcuno può innamorarsi, o amare senza speranza » (numéro vol. 2) , p. 547 (italien)
E ben sappiamo di Pigmalione, e quello che ad alcune statue di marmo avvenisse ; ma cotali si chiamano furori e non amori. E chi dubitando dicesse, nelle pitture e sculture essere i colori e perciò le loro bellezze potere trapassare per gli occhi al cuore, risponderemo che nell’amore del quale si favella, s’ama non solo l’anima, ma prima e più l’anima che il corpo, dove nelle sculture e pitture sono i corpi soli, in quel modo che vi sono ; onde in tutti gli amori, se non forse nel ferino, avverrebbe il medesimo. E a chi replicasse che altri non s’innamora nè delle pitture nè delle statue che rappresentano e mancano di vita, e per conseguente di anima, ma delle donne rappresentate da quelle, le quali vivono e conseguentemente hanno anima ; si risponderebbe che le statue, oltra che non rappresentano l’anime più che tanto, mancano di movimento ; e per conseguenza chi le mira, nolle mira in guisa che le luci si riscontrino ; e quando bene si riscontrassero, non si mostrerebbono benigne e cortesi ; e quando cortesi e benigne si dimostrassero, non può credere colui, se è di sano intelletto, che si dimostrino a lui ; e se dalla benignità del volto e guardatura degli occhi, prendesse speranza che anco a lui dolci ed amorevoli mostrare si dovessero, in cotal caso genererebbe in sè un certo principio e quasi origine d’amore. E se pure alcuno si trovasse tanto ostinato che volesse credere a ogni modo, o sè medesimo o altri, essersi al grido innamorati, sappia ciò essere stato non cosa ordinaria nè naturale, ma mostro e capriccio, o vero ghiribizzo suo ; e i filosofi debbono di quelle cose trattare, le quali, non di rado o non mai, ma il più delle volte avvengono.
Valère Maxime (Valerius Maximus), Factorum dictorumque memorabilium libri IX (redac: 1:50, trad: 1935), « Quam magni effectus artium sint », « De effectibus artium raris apud externos » (numéro VIII, 11, ext. 4 (Oberbeck 1228+)) , t. II, p. 242 (latin)
Cuius coniugem Praxiteles in marmore quasi spirantem in templo Cnidiorum collocauit, propter pulchritudinem operis a libidinoso cuiusdam conplexu parum tutam. Quo excusabilior est error equi, qui uisa pictura equae hinnitum edere coactus est ; et canum latratus aspectu picti canis incitatus taurusque ad amorem et concubitum aeneae uaccae Syracusis nimiae similitudinis irritamento compulsus. Quid enim uacua rationis animalia arte decepta miremur, cum hominis sacrilegam cupiditatem muti lapidis liniamentis excitatam uideamus ?
Valère Maxime (Valerius Maximus), Factorum dictorumque memorabilium libri IX , (trad: 1935) (VIII, 11, ext. 4), p. 243 (trad: "Faits et dits mémorables " par Constant, Pierre en 1935)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
4. L’épouse de ce dieu, œuvre en marbre de Praxitèle, qui se trouve dans le temple de Cnide, semble vivre et respirer. Telle en est la beauté que son caractère divin ne put la protéger contre les embrassements passionnés d’un impudique. Ce trait rend plus excusable l’erreur du cheval à qui la vue d’une cavale en peinture arracha un hennissement, celle des chiens qui se mirent à aboyer en voyant un chien représenté dans un tableau, ou celle du taureau qu’on vit à Syracuse s’enflammer de désir pour une génisse d’airain sous l’impression produite par une parfaite ressemblance. Pourquoi s’étonner que l’art trompe ainsi des êtres privés de raison, quand nous voyons les formes d’une statue de pierre insensible exciter dans un homme une passion sacrilège ?
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia(redac: 77, trad: 1950:1998) (XXXVI, 20-21 (Overbeck 1227)), p. 55 (latin)
20. Praxitelis aetatem inter statuarios diximus, qui marmoria gloria superauit etiam semet. Opera eius sunt Athenis in Ceramico, sed ante omnia est non solum Praxitelis, uerum in toto orbe terrarum Venus, quam ut uiderent, multi nauigauerunt Cnidum. Duas fecerat simulque uendebat, alteram uelata specie, quam ob id praetulerunt quorum condicio erat, Coi, cum eodem pretio detulisset, seuerum id ac pudicum arbitrantes. Reiectam Cnidii emerunt, inmensa differentia famae. 21. Voluit eam a Cnidiis postea mercari rex Nicomedes, totum aes alienum, quod erat ingens, ciuitatis dissoluturum se promittens. omnia perpeti maluere, nec inmerito. Illo enim signo Praxiteles nobilitauit Cnidum. Aedicula eius tota aperitur, ut conspici possit undique effigies deae, fauente ipsa, ut creditur, facta. Nec minor ex quacumque parte admiratio est. Ferunt amore captum quendam, cum delituisset noctu, simulacro cohaesisse eiusque cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Cnido et alia signa marmorea inlustrium artificum, Liber pater Bryaxidis et alter Scopae et Minerua, nec maius aliud Veneris Praxiteliae specimen quam quod inter haec sola memoratur.
Overbeck, Johannes, Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, (trad: 2002)(trad: " La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques" par Muller-Dufeu, Marion en 2002)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Nous avons cité parmi les statuaires l’âge de Praxitèle qui se surpassa lui-même dans la gloire du marbre. Ses œuvres se trouvent à Athènes au Céramique, mais au-dessus de toutes les œuvres, non seulement de Praxitèle, mais de toute la terre, il y a la Vénus : beaucoup ont fait le voyage à Cnide pour la voir. Il en avait fait deux et les vendait ensemble, l’une avec un voile, que préférèrent pour cette raison ceux qui étaient originaires de Cos, la trouvant pudique et sévère, lorsqu’il la leur proposa au même prix ; les Cnidiens achetèrent celle qu’ils avaient rejetée et qui devint bien plus célèbre. Plus tard le roi Nicomède voulant l’acquérir auprès des Cnidiens, promit de rembourser toutes les dettes de la cité, qui étaient immenses : ils préférèrent les supporter entièrement, et à raison ; car par cette statue, Praxitèle rendit Cnide célèbre. Son abri est entièrement ouvert, afin qu’on puisse voir l’effigie de toutes parts, ce qui fut fait, croit-on, avec l’aide de la déesse. L’admiration est la même de tous les côtés. On raconte qu’un homme, épris d’amour pour elle, se cacha pendant la nuit, s’unit à la statue et laissa une tache comme trace de son désir. Il y a aussi à Cnide d’autres statues de marbre d’artistes célèbres : un Liber Pater de Bryaxis, un de Scopas, ainsi qu’une Minerve, et un autre exemplaire de la Vénus de Praxitèle, trop grand pour être mentionnée parmi ces seules œuvres.
Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 245v-246r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
L’eta di Praxitele dicemmo tra gli statuari : elquale ne la gloria del marmo vinse se medesimo : l’opere sue sono in Atene in Ceramico. Ma inanci a tutte non solamente quelle di Praxitelle : ma etiamdi quelle di tuto el mondo e Venere laquale acioche potessino vedere molti sono navicati in Gnido. Lui n’havea facte due una coperta di vestimento laquale elesonno gl’homini di Coo aquali erono state date le prese stimando essere cosa severa e pudica : quegli di Gnido comperorono l’altra con gran differentia di fama. Dipoi Nicomede re la volse comperar da loro tuta quella pecunia laquale loro haveono debito che era grande e permetteva di pagarla. Ma loro volsono piu tosto sopportare ogni cosa e meritamente perche con quella statua. Praxitelle havea nobilitato Gnido loro patria. El tempociuolo dove e questa statua si puo aprire tutto accioche si possa vedere da ogni parte la statua a che lei come credono presta favore. Ne minore l’admiratione da qualunche parte. Dicono che uno s’inamoro di questa statua e che vi rimase nascosto una nocte e che l’habraccio. Il che dimostra la macchia rimasavi. Sono in Gnido altre statue di marmo d’artifici excellenti. Prima uno Baccho di Praxitele et un altro di Scopa et una Minerva. Ne si puo dimostrare magior segno dela bellezza di Venere de Praxitele se non che tra tutte quante statue sola questa e nominata.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, (vol. 11), p. 383 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Nous avons parlé de Praxitele[1] en traitant des statuaires en airain : or cet artiste étoit de plus sculpteur en marbre ; et dans ses ouvrages en ce genre il ne s’est pas contenté de surpasser ses rivaux, il s’est surpassé lui-même. Les simulacres de sa façon se voient à Athenes dans le Céramique ; mais, avant tout, la Vénus[2], dirons-nous de Praxitele, ou plutôt la Vénus du monde entier ; car est-il pays au monde d’où on ne soit parti à la voile pour venir à Cnide admirer cette Vénus ? Il en avoit sculpté deux, et les mettoit en vente l’une avec l’autre ; mais il avoit voilé l’une, et ce fut celle que choisirent ceux de Cos, quoiqu’ils pussent avoir l’autre au même prix : mais peu connoisseurs en cet art, ils se figurerent que celle qu’ils voyoient étoit sévere et pudique autprès de l’autre qu’ils ne voyoient pas. La Vénus négligée par ceux de Cos ne le fut pas par ceux de Cnide, qui l’acheterent. Cette Vénus cnidienne est d’un prix infiniment supérieur à l’autre. C’est ce que comprit le roi Nicomede[3], qui depuis voulut acheter des Cnidiens ce chef-d’œuvre, à condition de payer toute leur dette nationale, qui étoit immense. Les Cnidiens aimerent mieux endurer les dernieres extrémités, que d’en passer par ce traité : et ce ne fut pas sans raison ; car toute la célébrité de leur ville est uniquement due à cet ouvrage de Praxitele. Ce temple est une simple colonnade circulaire, sans murailles, ouvert de toutes parts, il laisse voir l’effigie de la Déesse, de quelque côté qu’on la regarde : et cette magie de l’art passe pour un prodige surnaturel, comme si Vénus elle même se prêtoit à réaliser cette illusion. Mais où est le vrai prodige, c’est que de quelque côté, et sous quelque biais qu’on la contemple, cette statue est réellement un chef-d’œuvre admirable en tous sens. On raconte que quelqu’un en devint amoureux[4], se cacha dans le temple à la faveur de la nuit, et vint à bout de remplir son désir. Une tache qui se voit à la statue, est regardée comme un indice du fait. Cnide possede d’autres statues de marbre de la main d’artistes illustres ; témoin le Bacchus de Bryaxis[5] ; un autre Bacchus et une Minerve de Scopas[6]. Aussi ce qui est propre à nous faire apprécier au juste le mérite de la Vénus de Cnide, c’est cette considération, qu’au milieu de plusieurs chefs-d’œuvre, on ne parle uniquement que d’elle.
- [1] Au liv. 34.
- [2] Voyez, sur ce mémorable chef-d’œuvre, l’Anthologie, liv. 4, chapitre 12.
- [3] Roi de Bithinie, contemporain de Mithridate.
- [4] Voyez Valere Maxime, l. 8, chap. 11 ; Posidippe l’historien, chez Clément d’Alexandrie, Protrept. page 38.
- [5] Statuaire dont fait mention Pausanias, in Attic. p. 73 et ailleurs.
- [6] Statuaire dont fait mention Pausanias, ibid.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, (trad: 1950:1998) (XXXVI, 20-21), p. 55 (trad: "Histoire naturelle " par André, Jacques; Beaujeu, Jean; Desanges; Jehan; Ernout, Alfred en 1950:1998)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
A propos des artistes du bronze nous avons dit l’époque à laquelle vécut Praxitèle qui se surpassa lui-même par la gloire qu’il acquit en travaillant le marbre. Il y a de ses œuvres à Athènes, au Céramique, mais sa Vénus est à la tête, je ne dis pas seulement de toute sa production, mais de celle de tous les artistes du monde, et bien des gens ont fait la traversée de Cnide pour aller la voir. Il avait fait et il mit en vente en même temps deux Vénus, dont l’une était voilée. Les gens de Cos qui avaient fait la commande préférèrent cette dernière ; des deux, Praxitèle avait demandé le même prix, mais ils jugeaient austère et chaste l’attitude de la seconde. Les Cnidiens achetèrent celle qu’ils n’avaient pas voulue et dont la renommée l’emporte infiniment.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia(redac: 77, trad: 1950:1998) (VII, 127 (Oberbeck 1228)), p. 85 (latin)
Praxiteles marmore nobilitatus est Gnidiaque Venere praecipue uesano amore cuiusdam iuuenis insigni et Nicomedis aestimatione regis grandi Gnidiorum aere alieno permutare eam conati. Phidiae Iuppiter Olympius cotidie testimonium perhibet, Mentori Capitolinus et Diana Ephesia, quibus fuere consecrata artis eius uasa.
Overbeck, Johannes, Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, (trad: 2002)(trad: " La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques" par Muller-Dufeu, Marion en 2002)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Praxitèle doit sa renommée à ses marbres, surtout à la Vénus de Cnide, qui est célèbre par l’amour insensé qu’elle inspira à un jeune homme et par le prix dont l’estima le roi Nicomède, qui essaya de l’échanger contre paiement de la lourde dette des Cnidiens.
Lucien de Samosate, Ζευς ὁ τραγοιδος(redac: 150:175) (10)(grecque)
Ἀφροδίτη
οὐκοῦν, ὦ Ἑρμῆ, κἀμὲ λαβὼν ἐν τοῖς προέδροις που κάθιζε: χρυσῆ γάρ εἰμι.
Ἑρμῆς
οὐχ ὅσα γε, ὦ Ἀφροδίτη, κἀμὲ ὁρᾶν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ πάνυ λημῶ, λίθου τοῦ λευκοῦ, Πεντέληθεν, οἶμαι, λιθοτομηθεῖσα, εἶτα δόξαν οὕτω Πραξιτέλει Ἀφροδίτη γενομένη Κνιδίοις παρεδόθης.
Lucien de Samosate, Ζευς ὁ τραγοιδος, p. 94 (trad: "Jupiter tragique" par Talbot, Eugène)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Vénus — Alors, place-moi donc aussi sur les premiers bancs, car je suis d’or.
Mercure — Non pas, Vénus, autant du moins que je puis voir. Si je ne suis pas tout à fait myope, tu es taillée, je crois, dans un bloc de marbre blanc du Pentélique, dont il a plu à Praxitèle de faire Vénus, et tu as été livrée comme telle aux Cnidiens.
Lucien de Samosate, Περὶ τῶν εἰκονῶν (redac: 150:175, trad: 1913:1967) (4-6)(grecque)
ΛΥΚΙΝΟΣ.
Ἐπεδήμησάς ποτε, ὦ Πολύστρατε, τῇ Κνιδίων;
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
Καὶ μάλα.
ΛΥΚΙΝΟΣ.
Οὐκοῦν καὶ τὴν Ἀφροδίτην εἶδες πάντως αὐτῶν;
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
Νὴ Δία, τῶν Πραξιτέλους ποιημάτων τὸ κάλλιστον.
ΛΥΚΙΝΟΣ.
Ἀλλὰ καὶ τὸν μῦθον ἤκουσας, ὃν λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι περὶ αὐτῆς, ὡς ἐρασθείη τις τοῦ ἀγάλματος καὶ λαθὼν ὑπολειφθεὶς ἐν ἱερῷ συγγένοιτο, ὡς δυνατὸν ἀγάλματι. τοῦτο μέντοι: ἄλλως ἱστορείσθω. σὺ δὲ — ταύτην γάρ, ὡς φής, εἶδες — ἴθι μοὶ καὶ τόδε ἀπόκριναι, εἰ καὶ τὴν ἐν κήποις Ἀθὴνησι τὴν Ἀλκαμένους ἑώρακας.
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
ἦ πάντων γ᾽ ἄν, ὦ Λυκῖνε, ὁ ῥᾳθυμότατος ἦν, εἰ τὸ κάλλιστον τῶν Ἀλκαμένους πλασμάτων παρεῖδον.
ΛΥΚΙΝΟΣ.
ἐκεῖνο μέν γε, ὦ Πολύστρατε, οὐκ ἐξερήσομαί σε, εἰ πολλάκις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνελθὼν καὶ τὴν Καλάμιδος Σωσάνδραν τεθέασαι.
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
εἶδον κἀκείνην πολλάκις.
ΛΥΚΙΝΟΣ.
ἀλλὰ καὶ ταῦτα μὲν ἱκανῶς. τῶν δὲ Φειδίου ἔργων τί μάλιστα ἐπῄνεσας ;
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
τί δ᾽ ἄλλο ἢ τὴν Λημνίαν, ᾗ καὶ ἐπιγράψαι τοὔνομα ὁ Φειδίας ἠξίωσε; καὶ νὴ Δία τὴν Ἀμαζόνα τὴν ἐπερειδομένην τῷ δορατίῳ.
Λυκῖνοςτὰ κάλλιστα, ὦ ἑταῖρε, ὥστ᾽ οὐκέτ᾽ ἄλλων τεχνιτῶν δεήσει. φέρε δή, ἐξ ἁπασῶν ἤδη τούτων ὡς οἷόν τε συναρμόσας μίαν σοι εἰκόνα ἐπιδείξω, τὸ ἐξαίρετον παρ᾽ ἑκάστης ἔχουσαν.
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
καὶ τίνα ἂν τρόπον τουτὶ γένοιτο ;
ΛΥΚΙΝΟΣ.
οὐ χαλεπόν, ὦ Πολύστρατε, εἰ τὸ ἀπὸ τοῦδε παραδόντες τὰς εἰκόνας τῷ λόγῳ, ἐπιτρέψαιμεν αὐτῷ μετακοσμεῖν καὶ συντιθέναι καὶ ἁρμόζειν ὡς ἂν εὐρυθμότατα δύναιτο, φυλάττων ἅμα τὸ συμμιγὲς ἐκεῖνο καὶ ποικίλον.
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
εὖλέγεις: καὶδὴπαραλαβὼνδεικνύτω: ἐθέλωγὰρεἰδέναιὅτικαὶχρήσεταιαὐταῖς, ἢὅπωςἐκτοσούτωνμίαντινὰσυνθεὶςοὐκ 'ἀπᾴδουσανἀπεργάσεται
Λυκῖνος καὶ μὴν ἤδη σοι ὁρᾶν παρέχει γιγνομένην τὴν εἰκόνα, ὧδε συναρμόζων, τῆς ἐκ Κνίδου ἡκούσης μόνον τὴν κεφαλὴν λαβών· οὐδὲν γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος γυμνοῦ ὄντος δεήσεται· τὰ μὲν ἀμφὶ τὴν κόμην καὶ μέτωπον ὀφρύων τε τὸ εὔγραμμον ἐάσει ἔχειν ὥσπερ ὁ Πραξιτέλης ἐποίησεν, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν δὲ τὸ ὑγρὸν ἅμα τῷ φαιδρῷ καὶ κεχαρισμένῳ, καὶ τοῦτο διαφυλάξει κατὰ τὸ Πραξιτέλει δοκοῦν·τὰ μῆλα δὲ καὶ ὅσα τῆς ὄψεως ἀντωπὰ παρ᾽ Ἀλκαμένους καὶ τῆς ἐν κήποις λήψεται, καὶ προσέτι χειρῶν ἄκρα καὶ καρπῶν τὸ εὔρυθμον καὶ δακτύλων τὸ εὐάγωγον εἰς λεπτὸν ἀπολῆγον παρὰ τῆς ἐν κήποις καὶ ταῦτα. τὴν δὲ τοῦ παντὸς προσώπου περιγραφὴν καὶ παρειῶν τὸ ἁπαλὸν καὶ ῥῖνα σύμμετρον ἡ Λημνία παρέξει καὶ Φειδίας: ἔτι καὶ στόματος ἁρμογὴν αὐτὸς καὶ τὸν αὐχένα, παρὰ τῆς Ἀμαζόνος λαβών ἡ Σωσάνδρα δὲ καὶ Κάλαμις αἰδοῖ κοσμήσουσιν αὐτήν, καὶ τὸ μειδίαμα σεμνὸν καὶ λεληθὸς ὥσπερ τὸ ἐκείνης ἔσται: καὶ τὸ εὐσταλὲς δὲ καὶ κόσμιον τῆς ἀναβολῆς παρὰ τῆς Σωσάνδρας, πλὴν ὅτι ἀκατακάλυπτος αὕτη ἔσται τὴν κεφαλήν. τῆς ἡλικίας δὲ τὸ μέτρον ἡλίκον ἂν γένοιτο, κατὰ τὴν ἐν, Κνίδῳ ἐκείνην μάλιστα. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο κατὰ τὸν Πραξιτέλη μεμετρήσθω. τί σοι, ὦ Πολύστρατε, δοκεῖ ; καλὴ γενήσεσθαι ἡ εἰκών ;
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
καὶ μάλιστα, ἐπειδὰν εἰς τὸ ἀκριβέστατον
Lucien de Samosate (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), Περὶ τῶν εἰκονῶν , (trad: 1934)(trad: "Les Portraits " par Chambry, Emile en 1934)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Lycinus — As-tu jamais été à Cnide, Polystrate ?
Polystrate — Sans doute.
Lycinus — Et tu as bien examiné la Vénus de ce pays ?
Polystrate — Oui, par Jupiter ! C’est le chef-d’œuvre de Praxitèle.
Lycinus — Tu sais aussi l’histoire qu’on y raconte au sujet de cette statue, qu’un jeune homme en devint amoureux, se cacha dans le temple et satisfit, comme il put, sa passion ? Mais nous te parlerons de cela une autre fois. Puisque tu as vu, dis-tu, cette Vénus, réponds-moi maintenant si tu as aussi vu celle d’Alcamène, qui est à Athènes, dans les jardins.
Polystrate — Ah ! Lycinus, j’aurais été le plus insensible des hommes, si je n’avais été admirer un des plus beaux ouvrages de ce sculpteur.
Lycinus — Je ne te demanderai pas, Polystrate, si tu es monté souvent à l’Acropole pour voir la Sosandra de Calamis.
Polystrate — Oui, je l’ai souvent considérée.
Lycinus — Cela me suffit. Quel est celui des ouvrages de Phidias que tu estimes le plus ?
Polystrate — Quel autre, sinon sa Lemnienne, sur laquelle Phidias n’a pas dédaigné de graver son nom, et, par Jupiter, son Amazone, qui s’appuie sur une lance.
Lycinus — Toutes ces statues, mon ami, sont des chefs-d’œuvre, et nous n’avons plus besoin d’autres artistes. A présent, de toutes ces statues nous allons essayer de composer une seule image, en prenant à chacune d’elles ce qu’elle a de plus parfait.
Polystrate — Comment faire ?
Lycinus — Ce n’est pas difficile, Polystrate. Confions ces statues à l’éloquence : chargeons-les de transporter ces beautés, de les disposer, de les fondre dans les proportions les plus exactes, en observant à la fois et l’ensemble et la variété.
Polystrate — Tu as raison. A l’éloquence de mettre la main à l’œuvre et de montrer son talent. Je suis curieux de savoir l’emploi qu’elle fera de toutes ces perfections, et comment d’une foule de beautés elle en composera une seule dont toutes les parties seront d’accord.
Lycinus — Eh bien, voici comment nous allons te faire voir cette image façonnée par nos mains. De la Vénus arrivée à Cnide, elle ne prend que la tête : nous n’avons pas besoin du reste du corps, puisqu’il est nu. Quant aux cheveux, au front et aux sourcils, qui semblent dessinés au pinceau, nous les garderons tels que Praxitèle les a faits. Nous conserverons aussi la grâce humide de ces yeux brillants, sans rien changer à l’idée de Praxitèle. Les joues et les saillies du visage, nous les emprunterons à Alcamène et à la Vénus des Jardins, qui nous donne, en outre, l’extrémité des mains, l’heureuse proportion du corps, les doigts ronds et effilés. Voilà ce que nous prenons à la Vénus des Jardins. Le contour entier du visage, la délicatesse des joues, le beau dessin du nez, nous seront fournis par la Lemnienne de Phidias, dont l’Amazone nous offre l’ouverture gracieuse de la bouche et la rondeur du cou. Calamis embellira notre statue de la pudeur ravissante, du sourire fin de sa Sosandra ; elle en aura le vêtement noble et décent, sauf la tête qui demeurera découverte. Pour la taille, nous la mesurerons sur celle de la Vénus de Cnide, et Praxitèle nous en fournira les proportions. Que te semble de notre statue, Polystrate ?
Polystrate — Elle sera fort belle, surtout quand elle sera complètement achevée.
Commentaires : trad Talbot, pas chambry!
Lucien de Samosate (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), ῾Υπὲρ τῶν εἰκονῶν (redac: 150:175) (18-23)(grecque)
ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ.
ἐδόκει τε ἀσέβημα ἑαυτῆς καὶ πλημμέλημα τοῦτο δόξειν, εἰ ὑπομένοι τῇ ἐν Κνίδῳ καὶ τῇ ἐν κήποις ὁμοία λέγεσθαι: καί σε ὑπεμίμνησκε τῶν τελευταίων ἐν τῷ βιβλίῳ περὶ αὐτῆς εἰρημένων, ὅτι μετρίαν καὶ ἄτυφον ἔφης αὐτὴν οὐκ ἀνατεινομένην ὑπὲρ τὸ ἀνθρώπινον μέτρον, ἀλλὰ πρόσγειον τὴν πτῆσιν ποιουμένην, ὁ δὲ ταῦτα εἰπὼν ὑπὲρ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν ἀναβιβάζεις τὴν γυναῖκα, ὡς καὶ θεαῖς ἀπεικάζειν. […]
ΛΥΚΙΝΟΣ.
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἐξαγώνια καὶ πόρρω τοῦ πράγματος. ὑπὲρ δὲ οὗ χρὴ ἀπολογήσασθαι, τοῦτό ἐστιν, ὅτι τῇ ἐν Κνίδῳ καὶ τῇ ἐν κήποις καὶ Ἥρᾳ καὶ Ἀθηνᾷ τὴν μορφὴν ἀναπλάττων εἴκασα. ταῦτά σοι ἔκμετρα ἔδοξεν καὶ ὑπὲρ τὸν πόδα. […] φέρ᾽ οὖν, εἰ δοκεῖ, πρόσαγε τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰρημένοις τοὺς κανόνας ἀμφοτέρους, ὡς μάθῃς εἴτε τούτῳ εἴτ᾽ ἐκείνῳ ἐοίκασιν. ἐγὼ γὰρ εἰ μέν τινα ἄμορφον οὖσαν ἔφην τῷ ἐν Κνίδῳ ἀγάλματι ὁμοίαν, γόης ἂν καὶ τοῦ Κυναίθου κολακικώτερος ὄντως νομιζοίμην εἰ δὲ τοιαύτην ὑπάρχουσαν οἵαν πάντες ἴσασιν, οὐ πάνυ ἐκ πολλοῦ διαστήματος ἦν τὸ τόλμημα. τάχ᾽ ἂν οὖν:'- φαίης, μᾶλλον δὲ ἤδη εἴρηκας, ‘ ἐπαινεῖν μέν σοι εἰς τὸ κάλλος ἐφείσθω: ἀνεπίφθονον μέντοι ποιήσασθαι τὸν ἔπαινον ἐχρῆν, ἀλλὰ μὴ θεαῖς ἀπεικάζειν ἄνθρωπον οὖσαν.’ ἐγὼ δὲ — ἤδη γάρ με προάξεται τἀληθὲς εἰπεῖν — οὐ θεαῖς σε, ὦ βελτίστη, εἴκασα, τεχνιτῶν δὲ ἀγαθῶν δημιουργήμασιν λίθου καὶ χαλκοῦ ἢ ἐλέφαντος πεποιημένοις: τὰ δὲ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γεγενημένα οὐκ ἀσεβές, οἶμαι, ἀνθρώποις εἰκάζειν. ἐκτὸς εἰ μὴ σὺ τοῦτο εἶναι τὴν Ἀθηνᾶν ὑπείληφας τὸ ὑπὸ Φειδίου πεπλασμένον ἢ τοῦτο τὴν οὐρανίαν Ἀφροδίτην ὃ ἐποίησεν Πραξιτέλης ἐν Κνίδῳ οὐ πάνυ πολλῶν ἐτῶν. ἀλλ᾽ ὅρα μὴ ἄσεμνον ᾖ τὰ τοιαῦτα περὶ τῶν θεῶν δοξάζειν, ὧν τάς γε ἀληθεῖς εἰκόνας ἀνεφίκτους εἶναι ἀνθρωπίνῃ μιμήσει ἔγωγε ὑπολαμβάνω.
Lucien de Samosate (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), ῾Υπὲρ τῶν εἰκονῶν , p. 3-4 (trad: "Pour les portraits ")(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
18. Lycinus — Le point sur lequel je dois me justifier, est d’avoir comparé votre beauté à celle de la Vénus de Cnide et de la Vénus des jardins, à celle de Junon et de Minerve. Cet éloge vous semble excessif ; c’est une chaussure trop grande pour le pied. […] 22. Maintenant, rapprochez, si vous le voulez bien mon ouvrage de chacune de ces deux règles [[5 : la flatterie ou l’éloge sincère]], et vous verrez s’il s’applique à celle-ci ou à celle-là. Si j’avais comparé une femme laide à la Vénus de Cnide, je passerais à bon droit pour un flagorneur plus impudent que Cynéthus ; mais lorsque c’est une femme comme vous, et que tout le monde connaît, la distance n’est pas assez grande pour qu’on blâme ma témérité. 23. Peut-être me direz-vous, ou plutôt vous me l’avez déjà dit : « Je vous permets de louer ma beauté ; mais il fallait faire un éloge à l’abri de tout reproche, et non pas assimiler une mortelle à des déesses. » Je réponds à cela, puisque la vérité m’y force, que je ne vous ai point comparée à des déesses, ô femme accomplie, mais à des chefs-d’œuvre de nos meilleurs artistes, à des ouvrages de pierre, d’airain ou d’ivoire. Il n’y a pas d’impiété, je pense, à comparer l’homme aux œuvres sorties de sa main ; à moins que vous ne confondiez Minerve avec la statue faite par Phidias, et la Vénus Uranie avec le marbre que Praxitèle a sculpté quelques années après. Prenez garde qu’une telle opinion ne blesse les dieux, dont il me semble que la véritable image ne saurait être représentée par la main des mortels.
Lucien de Samosate (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), Ἒρωτες (redac: (150):(175), trad: 1912)(grecque)
11 καὶ δόξαν ἡμῖν Κνίδῳ προσορμῆσαι κατὰ θέαν καὶ τοῦ Ἀφροδίτης ἱεροῦ—ὑμνεῖται δὲ τούτου τὸ τῆς Πραξιτέλους εὐχερείας ὄντως ἐπαφρόδιτον—ἠρέμα τῇ γῇ προσηνέχθημεν αὐτῆς οἶμαι τῆς θεοῦ λιπαρᾷ γαλήνῃ πομποστολούσης τὸ σκάφος. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἔμελον αἱ συνήθεις παρασκευαί, ἐγὼ δὲ τὸ ἐρωτικὸν ζεῦγος ἑκατέρωθεν ἐξαψάμενος κύκλῳ περιῄειν τὴν Κνίδον οὐκ ἀγελαστὶ τῆς κεραμευτικῆς ἀκολασίας μετέχων ὡς ἐν Ἀφροδίτης πόλει. στοὰς δὲ Σωστράτου καὶ τἆλλα ὅσα τέρπειν ἡμᾶς ἐδύνατο, πρῶτον ἐκπεριελθόντες ἐπὶ τὸν νεὼν τῆς Ἀφροδίτης βαδίζομεν, νὼ μέν, ἐγώ τε καὶ Χαρικλῆς, πάνυ προθύμως, Καλλικρατίδας δ’ ὡς ἐπὶ θέαν θήλειαν ἄκων, ἥδιον ἂν οἶμαι τῆς Ἀφροδίτης Κνιδίας τὸν ἐν Θεσπιαῖς ἀντικαταλλαξάμενος Ἔρωτα. 12 καί πως εὐθὺς ἡμῖν ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ τεμένους Ἀφροδίσιοι προσέπνευσαν αὖραι· τὸ γὰρ αἴθριον οὐκ εἰς ἔδαφος ἄγονον μάλιστα λίθων πλαξὶ λείαις ἐστρωμένον, ἀλλ’ ὡς ἐν Ἀφροδίτης ἅπαν ἦν γόνιμον ἡμέρων καρπῶν, ἃ ταῖς κόμαις εὐθαλέσιν ἄχρι πόρρω βρύοντα τὸν πέριξ ἀέρα συνωρόφουν. περιττόν γε μὴν ἡ πυκνόκαρπος ἐτεθήλει μυρρίνη παρὰ τὴν δέσποιναν αὐτῆς δαψιλὴς πεφυκυῖα τῶν τε λοιπῶν δένδρων ἕκαστον, ὅσα κάλλους μετείληχεν· οὐδ’ αὐτὰ γέροντος ἤδη χρόνου πολιὰ καθαύαινεν, ἀλλ’ ὑπ’ ἀκμῆς σφριγῶντα νέοις κλωσὶν ἦν ὥρια. τούτοις δ’ἀνεμέμικτο καὶ τὰ καρπῶν μὲν ἄλλως ἄγονα, τὴν δ’εὐμορφίαν ἔχοντα καρπόν, κυπαρίττων γε καὶ πλατανίστων αἰθέρια μήκη καὶ σὺν αὐταῖς αὐτόμολος Ἀφροδίτης ἡ τῆς θεοῦ πάλαι φυγὰς Δάφνη. Παντί γε μὴν δένδρῳ περιπλέγδην ὁ φίλερως προσείρπυζε κιττός. ἀμφιλαφεῖς ἄμπελοι πυκνοῖς κατήρτηντο βότρυσιν· τερπνοτέρα γὰρ Ἀφροδίτη μετὰ Διονύσου καὶ τὸ παρ’ ἀμφοῖν ἡδὺ σύγκρατον, εἰ δ’ ἀποζευχθεῖεν ἀλλήλων, ἧττον εὐφραίνουσιν. ἦν δ’ ὑπὸ ταῖς ἄγαν παλινσκίοις ὕλαις ἱλαραὶ κλισίαι τοῖς ἐνεστιᾶσθαι θέλουσιν, εἰς ἃ τῶν μὲν ἀστικῶν σπανίως ἐπεφοίτων τινές, ἀθρόος δ’ ὁ πολιτικὸς ὄχλος ἐπανηγύριζεν ὄντως ἀφροδισιάζοντες. 13 ἐπεὶ δ’ἱκανῶς τοῖς φυτοῖς ἐτέρφθημεν, εἴσω τοῦ νεὼ παρῄειμεν. ἡ μὲν οὖν θεὸς ἐν μέσῳ καθίδρυται — Παρίας δὲ λίθου δαίδαλμα κάλλιστον— ὑπερήφανον καὶ σεσηρότι γέλωτι μικρὸν ὑπομειδιῶσα. πᾶν δὲ τὸ κάλλος αὐτῆς ἀκάλυπτον οὐδεμιᾶς ἐσθῆτος ὁ κάλλος αὐτῆς ἀκάλυπτον οὐδεμιᾶς ἐσθῆτος ἀμπεχούσης γεγύμνωται, πλὴν ὅσα τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ τὴν αἰδῶ λεληθότως ἐπικρύπτειν. τοσοῦτόν γε μὴν ἡ δημιουργὸς ἴσχυσε τέχνη, ὥστε τὴν ἀντίτυπον οὕτω καὶ καρτερὰν τοῦ λίθου φύσιν ἑκάστοις μέλεσιν ἐπιπρέπειν. ὁ γοῦν Χαρικλῆς ἐμμανές τι καὶ παράφορον ἀναβοήσας, Εὐτυχέστατος, εἶπεν, θεῶν ὁ διὰ ταύτην δεθεὶς Ἄρης, καὶ ἅμα προσδραμὼν λιπαρέσι τοῖς χείλεσιν ἐφ’ ὅσον ἦν δυνατὸν ἐκτείνων τὸν αὐχένα κατεφίλει· σιγῇ δ’ ἐφεστὼς ὁ Καλλικρατίδας κατὰ νοῦν ἀπεθαύμαζεν. ἔστι δ’ἀμφίθυρος ὁ νεὼς καὶ τοῖς θέλουσι κατὰ νώτου τὴν θεὸν ἰδεῖν ἀκριβῶς, ἵνα μηδὲν αὐτῆς ἀθαύμαστον ᾖ. δι’ εὐμαρείας οὖν ἐστι τῇ ἑτέρᾳ πύλῃ παρελθοῦσιν τὴν ὄπισθεν εὐμορφίαν διαθρῆσαι. 14 δόξαν οὖν ὅλην τὴν θεὸν ἰδεῖν, εἰς τὸ κατόπιν τοῦ σηκοῦ περιήλθομεν. εἶτ’ ἀνοιγείσης τῆς θύρας ὑπὸ τοῦ κλειδοφύλακος ἐμπεπιστευμένου γυναίου θάμβος αἰφνίδιον ἡμᾶς εἶχεν τοῦ κάλλους. ὁ γοῦν Ἀθηναῖος ἡσυχῇ πρὸ μικροῦ βλέπων ἐπεὶ τὰ παιδικὰ μέρη τῆς θεοῦ κατώπτευσεν, ἀθρόως πολὺ τοῦ Χαρικλέους ἐμμανέστερον ἀνεβόησεν, Ἡράκλεις, ὅση μὲν τῶν μεταφρένων εὐρυθμία, πῶς δ’ ἀμφιλαφεῖς αἱ λαγόνες, ἀγκάλισμα χειροπληθές· ὡς δ’εὐπερίγραφοι τῶν γλουτῶν αἱ σάρκες ἐπικυρτοῦνται μήτ’ ἄγαν ἐλλιπεῖς αὐτοῖς ὀστέοις προσεσταλμέναι μήτε εἰς ὑπέρογκον ἐκκεχυμέναι πιότητα. τῶν δὲ τοῖς ἰσχίοις ἐνεσφραγισμένων ἐξ ἑκατέρων τύπων οὐκ ἂν εἴποι τις ὡς ἡδὺς ὁ γέλως· μηροῦ τε καὶ κνήμης ἐπ’ εὐθὺ τεταμένης ἄχρι ποδὸς ἠκριβωμένοι ῥυθμοί. τοιοῦτος ἄρα Γανυμήδης ἐν οὐρανῷ Διὶ τὸ νέκταρ ἥδιον ἐγχεῖ· παρὰ μὲν γὰρ Ἥβης οὐκ ἂν ἐγὼ διακονουμένης ποτὸν ἐδεξάμην. ἐνθεαστικῶς ταῦτα τοῦ Καλλικρατίδου βοῶντος ὁ Χαρικλῆς ὑπὸ τοῦ σφόδρα θάμβους ὀλίγου δεῖν ἐπεπήγει τακερόν τι καὶ ῥέον ἐν τοῖς ὄμμασι πάθος ἀνυγραίνων. 15 ἐπεὶ δὲ τοῦ θαυμάζειν ὁ κόρος ἡμᾶς ἀπήλλαξεν, ἐπὶ θατέρου μηροῦ σπίλον εἴδομεν ὥσπερ ἐν ἐσθῆτι κηλῖδα· ἤλεγχε δ’ αὐτοῦ τὴν ἀμορφίαν ἡ περὶ τἆλλα τῆς λίθου λαμπρότης. ἐγὼ μὲν οὖν πιθανῇ τἀληθὲς εἰκασίᾳ τοπάζων φύσιν ᾤμην τοῦ λίθου τὸ βλεπόμενον εἶναι· πάθος γὰρ οὐδὲ τούτων ἔστιν ἔξω, πολλὰ δὲ τοῖς κατ’ ἄκρον εἶναι δυναμένοις καλοῖς ἡ τύχη παρεμποδίζει. μέλαιναν οὖν ἐσπιλῶσθαι φυσικήν τινα κηλῖδα νομίζων καὶ κατὰ τοῦτο τοῦ Πραξιτέλους ἐθαύμαζον, ὅτι τοῦ λίθου τὸ δύσμορφον ἐν τοῖς ἧττον ἐλέγχεσθαι δυναμένοις μέρεσιν ἀπέκρυψεν. ἡ δὲ παρεστῶσα πλησίον ἡμῶν ζάκορος ἀπίστου λόγου καινὴν παρέδωκεν ἱστορίαν· ἔφη γὰρ οὐκ ἀσήμου γένους νεανίαν—ἡ δὲ πρᾶξις ἀνώνυμον αὐτὸν ἐσίγησεν—πολλάκις ἐπιφοιτῶντα τῷ τεμένει σὺν δειλαίῳ δαίμονι ἐρασθῆναι τῆς θεοῦ καὶ πανήμερον ἐν τῷ ναῷ διατρίβοντα κατ’ ἀρχὰς ἔχειν δεισιδαίμονος ἁγιστείας δόκησιν· ἔκ τε γὰρ τῆς ἑωθινῆς κοίτης πολὺ προλαμβάνων τὸν ὄρθρον ἐπεφοίτα καὶ μετὰ δύσιν ἄκων ἐβάδιζεν οἴκαδε τήν θ’ ὅλην ἡμέραν ἀπαντικρὺ τῆς θεοῦ καθεζόμενος ὀρθὰς ἐπ’ αὐτὴν διηνεκῶς τὰς τῶν ὀμμάτων βολὰς ἀπήρειδεν. ἄσημοι δ’ αὐτῷ ψιθυρισμοὶ καὶ κλεπτομένης λαλιᾶς ἐρωτικαὶ διεπεραίνοντο μέμψεις. 16 ἐπειδὰν δὲ καὶ μικρὰ τοῦ πάθους ἑαυτὸν ἀποβουκολῆσαι θελήσειεν, προσειπὼν τῇ δὲ τραπέζῃ τέτταρας ἀστραγάλους Λιβυκῆς δορκὸς ἀπαριθμήσας διεπέττευε τὴν ἐλπίδα, καὶ βαλὼν μὲν ἐπίσκοπα, μάλιστα δ’ εἴ ποτε τὴν θεὸν αὐτὴν εὐβολήσειε, μηδενὸς ἀστραγάλου πεσόντος ἴσῳ σχήματι, προσεκύνει τῆς ἐπιθυμίας τεύξεσθαι νομίζων· εἰ δ’, ὁποῖα φιλεῖ, φαύλως κατὰ τῆς τραπέζης ῥίψειεν, οἱ δ’ ἐπὶ τὸ δυσφημότερον ἀνασταῖεν, ὅλῃ Κνίδῳ καταρώμενος ὡς ἐπ’ ἀνηκέστῳ συμφορᾷ καὶ κατήφει καὶ δι’ ὀλίγου συναρπάσας ἑτέρῳ βόλῳ τὴν πρὶν ἀστοχίαν ἐθεράπευεν. ἤδη δὲ πλέον αὐτῷ τοῦ πάθους ἐρεθιζομένου τοῖχος ἅπας ἐχαράσσετο καὶ πᾶς μαλακοῦ δένδρου φλοιὸς Ἀφροδίτην καλὴν ἐκήρυσσεν· ἐτιμᾶτο δ’ ἐξ ἴσου Διὶ Πραξιτέλης καὶ πᾶν ὅ τι κειμήλιον εὐπρεπὲς οἴκοι φυλάττοιτο, τοῦτ’ ἦν ἀνάθημα τῆς θεοῦ. πέρας αἱ σφοδραὶ τῶν ἐν αὐτῷ πόθων ἐπιτάσεις ἀπενοήθησαν, εὑρέθη δὲ τόλμα τῆς ἐπιθυμίας μαστροπός· ἤδη γὰρ ἐπὶ δύσιν ἡλίου κλίνοντος ἠρέμα λαθὼν τοὺς παρόντας ὄπισθε τῆς θύρας παρεισερρύη καὶ στὰς ἀφανὴς ἐνδοτάτω σχεδὸν οὐδ’ ἀναπνέων ἠτρέμει, συνήθως δὲ τῶν ζακόρων ἔξωθεν τὴν θύραν ἐφελκυσαμένων ἔνδον ὁ καινὸς Ἀγχίσης καθεῖρκτο. καὶ τί γὰρ ἀρρήτου νυκτὸς ἐγὼ τόλμαν ἡ λάλος ἐπ’ ἀκριβὲς ὑμῖν διηγοῦμαι; τῶν ἐρωτικῶν περιπλοκῶν ἴχνη ταῦτα μεθ’ ἡμέραν ὤφθη καὶ τὸν σπίλον εἶχεν ἡ θεὸς ὧν ἔπαθεν ἔλεγχον. αὐτόν γε μὴν τὸν νεανίαν, ὡς ὁ δημώδης ἱστορεῖ λόγος, ἢ κατὰ πετρῶν φασιν ἢ κατὰ πελαγίου κύματος ἐνεχθέντα παντελῶς ἀφανῆ γενέσθαι.
Commentaires :
1 sous-texteLucien de Samosate (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς), Ἒρωτες , (trad: 2003), p. 22-28 (trad: "Les Amours " par Maréchaux, Pierre en 2003)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
11. Comme nous résolûmes de faire escale à Cnide, pour y voir notamment le temple d’Aphrodite, vanté à cause de l’ouvrage vraiment le plus aphrodisiaque que l’on doive au ciselage habile de Praxitèle, nous fûmes doucement poussés vers la terre par un calme délicieux que fit naître, je crois, la déesse qui escortait notre navire. Je laissai à mes autres compagnons le soin des préparatifs ordinaires et, prenant de chaque main notre couple amoureux, je fis le tour de Cnide, en riant de tout mon cœur des figures lascives de terre cuite qu’on y rencontre, ce qui n’est pas étonnant dans une ville consacrée à Aphrodite. D’abord, nous visitâmes le portique de Sostrate et tous les endroits qui pouvaient nous procurer quelque agrément ; nous marchâmes ensuite jusqu’au temple d’Aphrodite, Chariclès et moi, avec la satisfaction la plus marquée tandis que Callicratidas répugnait à la pensée que le spectacle sentirait la femme ! Il aurait, je crois, échangé très volontiers l’Aphrodite de Cnide contre l’Éros de Thespies !
12. A peine étions-nous dans la première enceinte, que nous sentîmes la douce haleine des zéphyrs amoureux. En effet la cour était loin d’être revêtue de dalles en pierres polies, ce qui l’eût vouée à l’infécondité, mais comme il est naturel dans un temple d’Aphrodite, tout n’était que riches cultures fruitières. Les arbres au dense feuillage s’élevaient déjà fort haut et enfermaient sous un berceau de verdure l’espace alentour. Surpassant les autres essences, dans une débauche de baies, croissait, près de sa reine, le myrte luxuriant, et avec lui chaque espace d’arbres qui avaient reçu le don de la beauté. En dépit de leur âge avancé, ces derniers n’étaient pas flétris ou desséchés, mais toujours dans la fleur de la jeunesse, ils arboraient des rameaux encore verts et tout gonflés de sève. Quelques arbres qui ne portaient que leur beauté en guise de fruit se mêlaient à cet ensemble : cyprès et platanes se dressaient au plus haut des airs et, parmi eux, Daphné, la fugitive contemptrice d’Aphrodite, qui échappa jadis à la déesse. Autour de chaque tronc qu’il tenait enlacé serpentait le lierre, cet ami de l’amour. Des vignes pleines d’entrelacs étaient chargées de lourdes grappes. Aphrodite, en effet, a plus de volupté lorsque Dionysos l’accompagne et nous devons conjuguer les plaisirs que l’un et l’autre nous procurent : séparés, ils flattent moins nos sens. Dans les endroits où l’ombre était plus épaisse, des couches plaisantes s’offraient à ceux qui désiraient y festoyer. Les honnêtes gens de la cité venaient rarement ici, tandis que le peuple de la ville s’y portait en foule les jours de fête, sans doute pour y rendre d’intimes hommages à Aphrodite !
13. Lorsque nous eûmes suffisamment goûté la douceur de cet ombrage, nous entrâmes dans le temple. La déesse en occupe le milieu ; c’est une statue en marbre de Paros, de la plus parfaite beauté. Elle sourit doucement, un peu aguicheuse, et ses lèvres s’entrouvrent avec grâce. Toute sa beauté, qu’aucun voile ne dérobe, est nue et offerte, sauf que l’une de ses mains cache furtivement sa pudeur. Si absolu était le talent de l’artiste que le marbre naturellement dur et roide rendait justice à chaque partie de son corps. A cette vue, Chariclès, transporté d’une espèce de délire, ne put s’empêcher de s’écrier :
— A coup sûr, le plus heureux des dieux, c’est Arès, qui fut enchaîné à cause d’elle !
Disant cela, il courut jusqu’à elle, puis serrant les lèvres et allongeant le cou du mieux qu’il pouvait, il la baisa tendrement. Callicratès gardait le silence et concentrait son admiration. Le temple possède une porte de chaque côté pour ceux qui veulent voir attentivement la déesse de dos, à dessein de ne passer sur aucun de ses charmes sans l’admirer. On peut donc aisément contempler sa beauté postérieure, en entrant par cette autre porte.
14. De fait, comme nous avions décidé de voir la déesse en son entier, nous fîmes le tour de l’enceinte. Une femme à qui la garde des clés est dévolue, nous eut à peine ouvert la porte, qu’un étonnement subit s’empara de nous à la vue de tant de beauté. L’Athénien, qui jusque-là avait regardé avec indifférence, considérant ces parties de la déesse, qui lui rappelaient les garçons, s’écria avec un enthousiasme encore plus véhément que celui de Chariclès :
— Héraklès ! Que ce dos est bien proportionné ! Comme ces hanches sont charnues, et quelle prise douillette elles offrent ! Et comme les chairs de ces fesses sont joliment arrondies ! Elles ne sont ni trop maigres ni sèchement étendues sur les os, elles ne se répandent pas non plus en un excès d’enbonpoint. Et ces deux petits plis creusés sur chacun des reins, qui pourrait en dire la suavité ? Quelle pureté de ligne dans cette cuisse et dans cette jambe qui s’effile jusqu’au talon ! Tel est Ganymède dans les cieux lorsqu’il verse à Zeus un nectar qui n’en est que plus doux ; et quant à moi, Hébé dût-elle me servir, je n’accepterais pas ce breuvage de sa main.
A cette exclamation délirante de Callicratidas, peu s’en fallut que Chariclès, en proie à une admiration quasi excessive, ne demeurât pétrifié. Ses yeux, flottant dans une langueur humide, laissaient échapper quelques larmes.
15. Quand notre admiration satisfaite se fut un peu refroidie, nous aperçûmes sur l’une des cuisses de la statue une petite tache qui paraissait comme une souillure au milieu d’un vêtement. La blancheur éclatante du marbre accusait encore plus ce défaut ; hasardant d’abord une conjecture plausible sur la vérité de ce détail, j’imaginai que ce que nous voyions était naturel à la pierre. En effet, certaines pierres ne sont pas absolument exemptes de défauts et souvent un tel accident vient nuire à la beauté d’ouvrages qui sans cela seraient incomparables. Croyant donc que cette tache noire était une imperfection naturelle, j’admirais en cela même l’art de Praxitèle, qui avait su masquer cette difformité du marbre à l’endroit où on pouvait le moins l’apercevoir. Mais la sacristine qui nous accompagnait raconta à ce sujet une histoire à peine croyable. Un jeune homme d’une famille distinguée (mais dont l’acte a fait taire le nom) venait fréquemment dans ce temple ; possédé par un mauvais génie, il devint éperdument amoureux de la déesse et, comme il passait là des journées entières, on attribua d’abord sa conduite à une vénération superstitieuse. En effet, au matin, il quittait son lit bien avant l’apparition de l’aurore et accourait en ce lieu, ne rentrant chez lui qu’à regret après le coucher du soleil. Durant tout le jour, il se tenait devant la déesse, ses regards étaient continuellement fixés sur elle ; ce n’était que murmures indistincts et plaintes amoureuses formant un monologue secret.
16. Mais, quand il voulait donner le change à sa passion, il faisait une invocation puis il comptait un par un quatre osselets de gazelle libyenne et jouait aux dés ses espérances. S’il réalisait un heureux coup et notamment s’il amenait le coup de la déesse (aucun dé ne tombant du même côté), alors il se prosternait devant elle et se flattait de jouir incessamment de l’objet de sa passion. Si au contraire, ce qui n’arrivait que trop souvent, sa planchette était le théâtre d’un coup malchanceux et si par conséquent les osselets trahissaient une position défavorable, il s’emportait en imprécations contre Cnide toute entière et faisait montre d’un découragement catégorique, s’imaginant avoir essuyé un irréparable désastre. Mais bientôt il reprenait les dés et cherchait par un nouveau coup à corriger sa dernière infortune. Comme le feu de son amour était sans cesse attisé avec plus de violence, notre homme en avait gravé les témoignages sur tous les murs. L’écorce délicate de chaque arbre était ainsi devenue comme un héraut proclamant la beauté d’Aphrodite. D’ailleurs, il honorait Praxitèle à l’égal de Zeus et tout ce que sa demeure renfermait de précieux, il le donnait en offrande à la déesse. Enfin, l’ardente exacerbation de ses désirs dégénéra en frénésie et son audace lui procura un moyen de satisfaire sa concupiscence. Un jour en effet, alors qu’à son coucher le soleil déclinait, à pas de loup et à l’insu des assistants, il se glissa derrière la porte et, se dissimulant dans l’endroit le plus enfoncé, il y resta sans faire le moindre bruit, en retenant son souffle. Les sacristines, suivant l’usage, tirèrent du dehors la porte sur elles et voilà notre nouvel Anchise enfermé dans le temple ! Mais est-il besoin de caqueter et de vous conter par le menu l’audacieux attentat de cette nuit scélérate ? On découvrit au jour les traces de ses embrassements amoureux et la déesse portait cette tache en témoignage de l’outrage qu’elle avait subi. Quant au jeune homme, comme le rapporte la rumeur publique, il se précipita, dit-on, soit sur des rochers, soit dans les vagues de la mer : le fait est qu’il disparut à jamais.
17. La sacristine parlait encore lorsque Chariclès l’interrompit en s’écriant :
- Ainsi, une femme se fait aimer même lorsqu’elle est de pierre ! Que serait-ce si l’on contemplait vivante une beauté si accomplie ? Une seule de ses nuits ne vaudrait-elle pas le sceptre de Zeus ?
Mais Callicratidas lui répondit en souriant :
- Nous ne savons pas encore, Chariclès, si en arrivant à Thespies nous n’apprendrons pas une foule d’histoires semblables. En attendant, celle-ci comporte un témoignage irrécusable de cette Aphrodite qui t’est si chère.
- Comment donc ? repartit Chariclès.
Alors Callicratidas lui répondit, à mon avis, avec beaucoup de pertinence :
- Bien que ce jeune épris eût le loisir de passer une nuit entière et en complète liberté pour satisfaire sa passion, il dit l’amour à la statue comme à un garçon, parce qu’il eût désiré obscurément, selon moi, que même chez la femme, le sexe ne fût point par devant !
Athénée de Naucratis (Αθηναίος Ναυκρατικος), Δειπνοσοφισται (redac: (166):(233), trad: 2006:2012) (XIII, p. 590f (Overbeck 1241)), t. VI, p. 412 (grecque)
[1] τῇ δὲ τῶν Ἐλευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ τῶν Ποσειδωνίων ἐν ὄψει τῶν Πανελλήνων πάντων ἀποθεμένη θοἰμάτιον καὶ λύσασα τὰς κόμας ἐνέβαινε τῇ θαλάττῃ· καὶ ἀπ’ αὐτῆς Ἀπελλῆς τὴν Ἀναδυομένην Ἀφροδίτην ἀπεγράψατο. καὶ Πραξιτέλης δὲ ὁ ἀγαλματοποιὸς ἐρῶν αὐτῆς τὴν Κνιδίαν Ἀφροδίτης.
- [1] voir aussi Apelle Praxitèle et Phryné
Commentaires :
1 sous-texteOverbeck, Johannes, Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, (trad: 2002)(trad: " La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques" par Muller-Dufeu, Marion en 2002)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Phryné, au milieu de la fête des Éleusinies et de celle des Poseidonies, sous les yeux de tous les Grecs réunis, défit son manteau, délia sa chevelure, et entra dans les flots : ce fut là pour Apelle le modèle de l’Aphrodite Anadyomène ; et le sculpteur Praxitèle, son amant, sculpta sur son modèle l’Aphrodite de Cnide.
Athénagoras d’Athènes, Πρεσβεια περι Χριστιανων (redac: (176):(177), trad: 1992), [Les dieux des cités ne sont que des créatures matérielles récentes; invention du nom des dieux; bref historique du développement des arts plastiques] (numéro XVII, 14 (Overbeck 1243)) , p. 126 (grecque)
ἠ Ἀφροδίτη ἐν Κνίδῳ ἑταίρα Πραξιτέλους τέχνη.
Athénagoras d’Athènes, Πρεσβεια περι Χριστιανων , (trad: 1992) (XVII, 4), p. 127 (trad: "Supplique au sujet des chrétiens " par Pouderon, Bernard en 1992)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
L’Aphrodite de Cnide est une autre production de Praxitèle.
Élien (Κλαύδιος Αἰλιανός), Ποικίλη ἱστορία(redac: (201):(235)) (IX, 39)(grecque)
Πῶς δὲ οὐκ ἂν φαίη τις γελοίους ἅμα καὶ παραδόξους τούσδε τοὺς ἔρωτας; τὸν μὲν Ξέρξου, ὅτι πλατάνου ἠράσθη. νεανίσκος δὲ Ἀθήνησι τῶν εὖ γεγονότων πρὸς τῷ πρυτανείῳ ἀνδριάντος ἑστῶτος τῆς Ἀγαθῆς Τύχης θερμότατα ἠράσθη. κατεφίλει γοῦν τὸν ἀνδριάντα περιβάλλων, εἶτα ἐκμανεὶς καὶ οἰστρηθεὶς ὑπὸ τοῦ πόθου, παρελθὼν ἐς τὴν βουλὴν καὶ λιτανεύσας ἕτοιμος ἦν πλείστων χρημάτων τὸ ἄγαλμα πρίασθαι. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειθεν, ἀναδήσας πολλαῖς ταινίαις καὶ στεφανώσας τὸ ἄγαλμα καὶ θύσας καὶ κόσμον αὐτῷ περιβαλὼν πολυτελῆ εἶτα ἑαυτὸν ἀπέκτεινε, μυρία προκλαύσας. Γλαύκης δὲ τῆς κιθαρῳδοῦ οἳ μέν φασιν ἐρασθῆναι κύνα, οἳ δὲ κριόν, οἳ δὲ χῆνα. καὶ ἐν Σόλοις δὲ τῆς Κιλικίας παιδὸς Ξενοφῶντος ἠράσθη κύων, ἄλλου δὲ ὡραίου μειρακίου ἐν Σπάρτῃ κολοιός.
Élien (Κλαύδιος Αἰλιανός), Ποικίλη ἱστορία, (trad: "Historias curiosas" par Cortés Copete, Juan Manuel)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Est-il quelqu’un qui puisse ne pas convenir que les amours dont je vais parler étaient aussi ridicules qu’incroyables ? Xerxès aimait follement un platane. Un jeune Athénien, d’une des familles les plus distinguées de la ville, devint passionnément amoureux d'une statue de la Bonne Fortune qui était dans le prytanée : après l’avoir caressée et serrée dans ses bras, furieux, éperdu, il alla trouver les prytanes, et les conjura de lui vendre la statue, pour laquelle il était prêt à donner une somme considérable. N’ayant pu l’obtenir, il la ceignit de bandelettes, lui mit une couronne sur la tête, la revêtit d'ornements précieux, offrit des sacrifices, puis se donna la mort, en versant un torrent de larmes. La joueuse de lyre Glanée fut aimée, suivant les uns, par un chien ; suivant d'autres, par un bélier, ou par une oie. Un chien se passionna pour un enfant nommé Xénophon, de Soles, ville de Cilicie. On parle d’un geai qui devint amoureux d’un enfant de Sparte parfaitement beau.
Commentaires : Trad. Bon-Joseph Dacier, 1827
Philostrate d’Athènes (Φιλόστρατος), Τὰ ἐς τὸν Τυάνεα ᾽Απολλώνιον (redac: (217):(245), trad: 2006) (VI, 40), vol. II, p. 202-204 (grecque)
Κἀκεῖνα ἀξιομνημόνευτα εὗρον τοῦ ἀνδρὸς. ἐρᾶν τις ἐδόκει τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἕδους, ὃ ἐν Κνίδῳ γυμνὸν ἵδρυται, καὶ τὰ μὲν ἀνετίθει, τὰ δ´ ἀναθήσειν ἔφασκεν ὑπὲρ τοῦ γάμου, Ἀπολλωνίῳ δὲ καὶ ἄλλως μὲν ἄτοπα ἐδόκει ταῦτα, ἐπεὶ δὲ μὴ παρῃτεῖτο ἡ Κνίδος, ἀλλ´ ἐναργεστέραν ἔφασαν τὴν θεὸν δόξειν, εἰ ἐρῷτο, ἔδοξε τῷ ἀνδρὶ καθῆραι τὸ ἱερὸν τῆς ἀνοίας ταύτης, καὶ ἐρομένων τῶν Κνιδίων αὐτόν, εἴ τι βούλοιτο τῶν θυτικῶν ἢ εὐκτικῶν διορθοῦσθαι "ὀφθαλμοὺς" ἔφη "διορθώσομαι, τὰ δὲ τοῦ ἱεροῦ πάτρια ἐχέτω, ὡς ἔχει."
Καλέσας οὖν τὸν θρυπτόμενον ἤρετο αὐτόν, εἰ θεοὺς νενόμικε, τοῦ δ´ οὕτω νομίζειν θεοὺς φήσαντος, ὡς καὶ ἐρᾶν αὐτῶν, καὶ τῶν γάμων μνημονεύσαντος, οὓς θύσειν ἡγεῖτο, "σὲ μὲν ποιηταὶ" ἔφη "ἐπαίρουσι τοὺς Ἀγχίσας τε καὶ τοὺς Πηλέας θεαῖς ξυζυγῆναι εἰπόντες, ἐγὼ δὲ περὶ τοῦ ἐρᾶν καὶ ἐρᾶσθαι τόδε γιγνώσκω· θεοὶ θεῶν, ἄνθρωποι ἀνθρώπων, θηρία θηρίων, καὶ καθάπαξ ὅμοια ὁμοίων ἐρᾷ, ἐπὶ τῷ ἔτυμα καὶ ξυγγενῆ τίκτειν, τὸ δὲ ἑτερογενὲς τῷ μὴ ὁμοίῳ ξυνελθὸν οὔτε ζυγὸς οὔτε ἔρως. εἰ δὲ ἐνεθυμοῦ τὰ Ἰξίονος, οὐδ´ ἂν ἐς ἔννοιαν καθίστασο τοῦ μὴ ὁμοίων ἐρᾶν. ἀλλ´ ἐκεῖνος μὲν τροχῷ εἰκασμένος δι´ οὐρανοῦ κνάμπτεται, σὺ δ´, εἰ μὴ ἄπει τοῦ ἱεροῦ, ἀπολεῖ ἐν ἁπάσῃ τῇ γῇ οὐδ´ ἀντειπεῖν ἔχων τὸ μὴ οὐ δίκαια τοὺς θεοὺς ἐπὶ σοὶ γνῶναι." ὧδε ἡ παροινία ἐσβέσθη καὶ ἀπῆλθεν ὁ φάσκων ἐρᾶν ὑπὲρ ξυγγνώμης θύσας.
Philostrate d’Athènes (Φιλόστρατος), Τὰ ἐς τὸν Τυάνεα ᾽Απολλώνιον , (trad: 1862)(trad: "Apollonius de Tyane: sa vie, ses voyages, ses prodiges " par Chassang, Alexis en 1862)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Encore quelques actes d'Apollonius, dont le souvenir mérite d'être conservé. Un homme était amoureux de la statue de la Vénus de Cnide, qui est représentée nue. Il lui faisait de riches dons, et promettait de lui en faire de plus riches encore afin qu'elle l'acceptât pour époux. Apollonius trouvait absurde une telle conduite. Mais les habitants de Cnide n'y voyaient rien de mal : ils disaient même que le pouvoir de la déesse n'en était que plus manifeste, puisqu'elle trouvait un amant. Apollonius n'en voulut pas moins purifier le temple de cette folie ; les Cnidiens lui demandèrent s'il se proposait d'amender quelque chose aux sacrifices et aux prières : « Je veux répondit-il, amender les yeux, mais vos rites nationaux resteront tels qu'ils sont. » Il fit venir l'amoureux transi, et lui demanda s'il croyait aux Dieux. « J'y crois si bien, répondit l'insensé, que je suis épris d'une déesse, que je veux l'épouser, et que je célèbre les sacrifices de l'hymen. - Mon ami, lui dit Apollonius, votre présomption vous vient des poètes qui chantent l'hymen des Anchise et des Pélée avec des déesses, mais croyez à ce que je vais vous dire de l'amour entre les différents êtres. Les Dieux aiment des déesses; les hommes, des femmes; les animaux, des femelles de leur espèce; chaque être aime son semblable, pour en fauter des êtres semblables à lui. Quand il y a union entre deux êtres d'espèces différentes, c'est une monstruosité, ce n'est pas un hymen. Si vous aviez songé â l'histoire d'Ixion, jamais il ne vous serait venu à l'esprit de vous éprendre pour un être d'une nature différente de la vôtre. Ixion tourne comme une roue dans le ciel; quant à vous, si vous ne renoncez à entrer dans ce temple, vous serez poursuivi par le malheur sur toute la terre, et vous ne pourrez dire que les Dieux ne sont pas justes envers vous. » Ainsi s'éteignit cette ivresse, et l'amoureux s'en alla, après avoir offert à Vénus un sacrifice pour implorer son pardon.
Arnobe (Arnobius), Adversus nationes (redac: (297):(304), trad: 2010) (VI, 13, 1-3 (Overbeck 1242)), t. VI, p. 11 (latin)
1. Sed quid ego dis datas falces et fuscinas rideo, quid cornua, malleos et galeros, cum simulacra quædam sciam certorum ferre hominum formas et infamium liniamenta meretricum ? 2. Quis est qui ignoret Athenienses illos Hermas Alcibiadi ad corporis similitudinem fabricatos ? Quis Praxitelen nescit, Posidippi si relegat, ad formam Cratinæ meretricis, quam infelix perdite diligebat, os Veneris Cnidiae sollertiarum cœgisse certamine ? 3. Sed sola est hæc Venus cui de scorti uultu translaticium decus auctum est ? Phryna illa Thespiaca, sicut illi referunt qui negotia Thespiaca scriptitarunt, cum in acumine ipso esset pulchritudinis, uenustatis et floris, exemplarium fuisse perhibetur cunctarum quæ in opinione sunt Venerum siue per urbes Graias siue iste quo fluxit amor talium cupiditasque signorum.
Overbeck, Johannes, Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Qui ignore, pour peu qu’il relise les œuvres de Posidippus, que Praxitèle donna à la Vénus de Cnide le visage de sa maîtresse Cratinè, que le malheureux aimait à la folie, dans al rivalité des habiles ? La célèbre Phryné de Thespies, à ce que racontent ceux qui ont écrit l’histoire de Thespies, était juste au sommet de sa beauté, de sa grâce et de sa fleur : on la présente comme le modèle de toutes les Vénus que l’on tient en estime soit dans les villes de Grèce, soit là où coule cet amour et ce désir de ce genre de statues…
Arnobe (Arnobius), Adversus nationes , (trad: 2010) (VI, 13, 1-3), t. VI, p. 11 (trad: "Contre les gentils, livre VI " par Fragu, Bernard en 2010)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
1. Mais qu’ai-je à rire en vous voyant donner aux dieux des faux et des tridents, des cornes, des marteaux et des chapeaux, quand je sais que certaines de ces statues reproduisent la forme de personnages précis et les traits de prostituées ? 2. Quelqu’un ignore-t-il que ces Hermès d’Athènes ont été façonnés pour ressembler à Alcibiade ? Qui ne sait, s’il relit Posidippe, que Praxitèle, mobilisant tout son savoir-faire, contraignit le visage de la Vénus de Cnide à ressembler à celui de Cratine, une prostituée dont le malheureux était éperdument épris ? 3. Mais cette Vénus est-elle la seule à qui la tradition prête une beauté accrue par le visage d’une traînée ? Cette Phryné de Thespies, comme le rapportent ceux qui écrivirent sur les affaires de Thespies, au sommet de sa beauté, de sa grâce et de son épanouissement, fut, dit-on, le modèle de toutes les Vénus qui ont quelque réputation, que ce soit parmi les cités grecques ou partout où se répandit l’amour et le désir de telles statues.
Patrizi, Francesco (da Siena), De institutione reipublicae libri IX, l. I, chap. 10, De pictura, sculptura, & caelatura, & de earum inuentoribus, &qui in illis profecerint(publi: 1494) ( l. I, chap. 10), p. 39r (latin)
Lysippus tamen et Praxiteles eius artis artifices peregregii propius ad veritatem accesserunt, quod praecipuè ostendit Praxiteles in Caeo Veneris imagine, cuius pulchritudinem nullus artifex imitari unquam potuit.
Patrizi, Francesco (da Siena), De institutione reipublicae libri IX, l. I, chap. 10, De pictura, sculptura, & caelatura, & de earum inuentoribus, &qui in illis profecerint, fol. 82r (trad: "De l’Institution de la république, augmentée de moytié d’annotations tirées de tous les autheurs qui en ont traicté, où se peut apprendre à bien régir le royaume et gouverner un royaume" par Tigeou, Jaques)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
- [2] Gnydus
- [3] Valère le Grand liv. 8, c. 11, Pline li. 7, ch. 38.
[1] Toutesfois Lysippus et Praxiteles furent souverains ouvriers en cet art et approchèrent plus près de la vérité, [2] comme le monstre Praxiteles principalement par la statue de Vénus, qu’il fit pour ceux du Cap de Scio, et ny eut onques ouvrier, qui peust imiter sa beauté. [3]
- [1] voir Phidias, Zeus et Athéna
Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XVIII), fol. CXCIIv (latin)
- [1] Praxiteles
[1] Praxiteles marmore nobilitatus, duplici Venere, Gnidia et Coa, set Gnidia vesano amore iuuenis insignis, qui noctu delituit in templo simulacroque cohaesit. Tum Nicomedis aestimatione regis, grandi Gnidiorum aere alieno permutare eam conantis. Natus est in Græcia Italiæ ora, ciuitate Romana donatus. Scripsit teste Varrone, quinque volumina nobiliorum operum in toto orbe.
Textor, Joannes Ravisius (Jean Tixier de Ravisy, dit), Officina(publi: 1520), « Sculptores, cælatores », p. 356 (latin)
Praxiteles marmore nobilitatus est, duplicique Venere, Coa et Gnydia, sed Gnydia præcipue, cui ob elegantem formam noctu congressus est puer, relictis maculis tantæ libidinis indicibus. Quintilianus : Cedat Praxiteles, cuius muliebris imago procacem impulit ad coitum iuuenem. Sunt tamen qui hoc dicant de alio simulachro.
Equicola, Mario, Libro di natura d’amore(publi: 1525, trad: 1584) (lib. II), fol. 87v (italien)
Si dipinge queta Dea nuda, perche l’effetto della libidine non è mail celato. Apelle la dipinse come usciva del mare. Prasitele due ne sculpì una nuda, e una velata : la nuda fu in grandissima stima, appresso quelli di Gnido.
Equicola, Mario, Libro di natura d’amore, (trad: 1584), fol. 108rv (trad: "Les six livres de Mario Equicola d’Alveto autheur celebre, De la nature d’Amour, tant humain que divin, et de toutes les differences d’iceluy" par Chappuys, Gabriel en 1584)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Ceste Deesse se depainct nue, pource que l’effect de la luxure n’est jamais celé. Appelles là depaincte ainsi qu’elle est sortie de la mer. Praxitele en fit deux, une nue, et une autre couverte : ceux là de Gnide eurent en grande estime la nue.
Equicola, Mario, Libro di natura d’amore(publi: 1525, trad: 1584), « Forza et potentia d’Amore » (numéro libro IV) , fol. 195v-196r (italien)
- [1] Statue amate da huomini
Questo[Explication : Amore.] constrigne gli huomini quasi a pazzia muta la natura de’ constantissimi ; fa divenir pazzi coloro, che son tenuti savi solo per ottenere un nostro desiderio, o per timore che l’acquistato non perdiamo. Di ferro contra i parenti ne arma, contra i carissimi a veleni ci sospinge e non solamente all’amor de’fanciulli ci trabocca et a corrompere quella tenera e fresca età, quando è su’l fiore e nella piu bella primavera, ma alle marmoree statue l’humana libidine fa trascendere, [1] come leggiamo della Venere Gnidia opera di Prasitele : della quale uno si innamorò et occultatosi nel tempio, in quel modo che gli fu concesso la notte con la statua si abbracciò : e cosi satiò quel suo irregolato, e dishonesto appetito : mi arrossisco a pensarlo non che ridirlo. Restò al marmo il segno di quella impetuosa incontinentia. Alchida giovane Rhodiano di Cupido, opera del medesmo scultore, s’infiammò, e similmente vi lasciò segno d’amore. Eliano riferisce in Athene haver un giovane amata la statua della fortuna, et essendogli vietato e negato di comprarla, la notte vicino a lei fu trovato morto : e come il medesmo auttore scrive, Cratis Pastore amò una capra. O inestimabile possanza, o forza de gli animi nostri signora e domina, o amor che ogni cosa vinci.
Equicola, Mario, Libro di natura d’amore, (trad: 1584) (livre IV), f. 217v-218 r (trad: "Les six livres de Mario Equicola d’Alveto autheur celebre, De la nature d’Amour, tant humain que divin, et de toutes les differences d’iceluy" par Chappuys, Gabriel en 1584)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
- [1] Statues aymes par les hommes
Il[Explication : l’amour.] nous induit et pousse aux poisons contre les amis et non seulement nous fait tresbucher en l’amour des enfans, et nous incite à corrompre cete tendre et fresche jeunesse, quand elle est en sa fleur, et en son beau printemps, mais aussi fait monter la luxure humaine, [1] jusques aux statues de marbre, comme nous lisons, de Venus Gnidienne de la main et œuvre de Praxitele de laquelle un s’enamoura, et s’estant caché au temple il embrassa la nuit la statue, en la maniere qu’il peut, et ainsi il assouvit son deshonneste et regulier apetit : mais j’ay honte de le penser, et non seulement de le redire et reciter : le signe ou marque de cete impétueuse et furieuse incontinence demoura au marbre. Alchidas jeune Rhodian s’enflamma de Cupidon, œuvre du mesme sculpteur, et ouvrier, et y laissa par semblable, le signe d’amour. Elian récite, qu’un jeune homme ayma à Athènes, la statue de fortune, et comme on luy eust refusée, et defendu l’acheter, on le trouva la nuict, mort pres d’elle : et comme le mesme autheur escrit, le pasteur Cratis ayma une chièvre. O inestimable puissance ! ô grande force, dame et maistresse de noz cœurs, ô amour qui vaincs et surmontes toute chose.
Érasme (Desiderius Erasmus), Christiani matrimonii institutio(redac: 1526) (V, col. 696 E-F)(latin)
Loquax enim res est tacita pictura, et sensim irrepit in animos hominum. Quid autem turpitudinis est, quod hodie non repraesentent pictores et statuarii ? Et his delitiis quidam ornant sua conclauia, quasi iuuentuti desint irritamenta nequitiae. Membraque uerecundiae gratia celas ne uideantur, cur in tabula nudas ? Et quae non iudicares tutum ad tuendam filiarum filiorumue pudicitiam intueri, si fierent, cur ea numquam pateris abesse a conspectu liberorum ? Nota est fabula de iuuene, qui in statua Veneris suae intemperentiae notas reliquit. Addunt artifices quidam etiam uerecundis argumentis de quo nequitiam.
Everaerts, Jan (dit Johannes Secundus ou Jean Second), Epigrammatum liber unus(redac: 1528:1536, trad: 2007), (latin)
In Venerem Cnidiam
Cernere cum cuperet propriam Cytheræa figuram,
Venit in undosam per mare uecta Cnydum
Utque oculis totam lustraverat undique formam,
Dixit, Praxiteli visa ubi nuda fui ?
Non te Praxiteles vidit Dea magna, nec fas
Cernere conspicuas, et sine ueste Deas.
Qualem Mars voluit, talem fixere Dionem
Ferrea belligero subdita cæla Deo.
Commentaires : ED 2007?
Everaerts, Jan (dit Johannes Secundus ou Jean Second), Epigrammatum liber unus(redac: 1528:1536, trad: 2007) (n°85)(latin)
In Veneris statuam
Nuda Venus nulli uisa est, si uisa sed ulli est,
Hic vidit, nudam qui statuit Venerem.
Commentaires : Jean Second, Epigrammatum liber unus, 85 ED 2007?
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 346 (latin)
Ipse Paris, nudam Anchises, et uidit Adonis,
Tres solum noui, Praxiteles sed ubi ?
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 346 (latin)
Ipse Decus formæ posui tibi pulchra Dione,
Hac quum nil sola gratius ipse habeam.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 347 (latin)
Diuinam effigiem Veneris si uideris ipse,
Laudabis Phrygium quam cito iudicium.
Visa tibi at fuerit rursus ueneranda Minerua,
Clamabis, pastor præterit hanc ne Paris ?
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 348 (latin)
Quum Cnidiam cernis Venerem, num protinus inquis.
Mortales cunctos hæc regit atque deos ?
Innixam cernens hasta sed Pallada Athenis
Quam uere dices, o Pari pastor eras.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 346 (latin)
Hanc Cytherea tibi statuam pulcherrima pono,
Nihil mage quod mirer quam tua forma mihi est.
Commentaires :
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 355 (latin)
Antea in Idæis conspexit montibus illam
Pastor, qui formæ prætulit ipse decus.
Rursus Praxiteles Cnidiis putatur
Hanc firmam testem iudicii Paridis.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 346 (grecque)
Τοῦ αὐτοῦ. Εἰς τὸ αὐτό.
Σοὶ μορφῆς ἀνέθηκατε ῆς περικαλλὲς ἄγαλμα
Κύπρι, τεῆς μορφῆς φέρετρου οὐδὲν ἔχων.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 345 (latin)
Nemo unquam Venerem uidit, si quis tamen unquam
Vidit, erit nudam hic qui Venerem statuit.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 345 (latin)
Non te Praxiteles, nec ferri uis ea finxit,
Sic steteras quondam iudice sub Paride.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 345 (latin)
Ipsa Venus Cnidios nebula consepta pererrat,
Quæ suo concupiens cernere imago foret.
Quumque loco claro circunspexisset, Vbi, inquit,
Me potuit nudam cernere Praxiteles?
Non uidit, neque enim fas, extat uis ea ferri,
Expolit qualem Mars Venerem cupiit.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 346 (latin)
Me Paris, Anchisesque, et nudam uidit Adonis,
Hos scio tres tantum, Praxiteles sed ubi ?
Commentaires :
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529) (liber IV), p. 347 (latin)
Spumigenæ Veneris diuinos aspice uultus,
Et Paris, hic dices, arbiter æquus erat.
Ac rursum dices, ubi uisa sit Attica Pallas,
Spreuit ut hanc pastor præteriitque Paris.
Cornarius, Janus (Johannes Hainpol, dit), Selecta epigrammata græca latine versa, ex septem epigrammatum græcorum libris(publi: 1529)(latin)
Platonis, In statuam Veneris, quae apud Cnidum erat.
Ad Cnidiam uenit uolitans in fluctibus urbem,
Visura effigiem pulchra Erycina suam ;
Atque loco in celebri quum sese cerneret, inquit,
Nudum ubi me potuit cernere Praxiteles ?
At non Praxiteles, quæ non fas cernere, uidit :
Sed facit ars qualem Mars cupiat Venerem.
Commentaires : COMPLETER PAGINATION Correction orthographique ok
Mexía, Pero, Silva de varia lección(publi: 1540) (troisième partie, XIII), p. 511-512 (fran)
Les Historiographes escrivent pour chose vraye qu’en la ville d’Athenes il y avoit un jeune home yssu de honneste maison, riche competemment & qui estoit fort cogenu, lequel ayant curieusement regardé une statuë de marbre, fort excellement eslaborée, qui estoit en un lieu public d’Athenes, il s’énamoura tellement, qu’il ne pouvoit s’esloigner du lieu où elle estoit assise, ains l’embrassoit moult doucement, & tout le temps qu’il n’estoit aupres d’elle, il se trouvoit mal content, & déploré. Si vint ceste passion à telle extrémité quil recourut au Senat d’Athenes, où faisant offre de grands deniers, il supplia qu’on luy fist grace de la pouvoir emporter chez lui : il ne sembla point au Senat, que de son authorité il peust permettre cela, ny vendre une statuë publique : tellement que celle requeste luy fust refusée : dont il receut en son cœur une merveilleuse tristesse, & s’en alla vers la statuë, qil enrichit d’une couronne d’or, luy donnant vestements, & joyaux de grandes richesse, puis l’adoroit, & contemploit, & avec ceste folie persevera par plusieur jours, jusques à ce que luy estant telles choses deffenduës par le Senat, il se tua soy mesme de courroux.
Doni, Vincenzo, Disegno(publi: 1549), « Parte quinta », fol. 36r (italien)
Fu gia fatta una Venere tanto eccellente e lasciva, che fu necessario tenervi le guardie continue, tanto commoveva gl’huomini. Un’altra Venere fu pure da un maestro greco fatta tanto risplendente e di lucida candidezza, che faceva perdere la luce a gl’huomini ; in modo che furono sforzati a stipendiare una guardia alla porta, che avertiva a chi v’entrava ; che’l marmo pario greco è d’infinita più bianchezza e durezza, che viene a pigliare grandissimo lustro ; ne ci si vede alcuna macchia, come ne’ nostri da Carrara.
Dolce, Ludovico, Lettere di diversi eccellentissimi huomini, raccolte da diversi libri(publi: 1559), Lettre de Ludovico Dolce à Alessandro Contarini sur la Vénus et adonis du Titien, 1554:1555, p. 481-485 (italien)
Vi giuro, signor mio, che non si truova uomo tanto acuto di vista e di giudicio, che veggendola non la creda viva ; niuno così raffreddato dagli anni, o si duro di complessione, che non si senta riscaldare, intenerire, e commoversi nelle vene tutto il sangue. Nè è meraviglia che se una statua di marmo potè in modo, con gli stimoli della sua bellezza, penetrare nelle midolle d’un giovane, ch’egli vi lasciò la macchia, or, che dee far questa, ch’è di carne, ch’è la beltà stessa, che par che spiri ?
Commentaires : VERIFIER PAGINATION
Gilio, Giovanni Andrea, Degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie(publi: 1564), p. 107 (italien)
Ottaviano Augusto dedicò al tempio di Cesare suo padre la famosa Venere che usciva del mare, opera d’Apelle; la quale, come vol Plinio, non trovò mai pare.
Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 170 (italien)
Praxitele fece dua Venere, una vestita et l’altra ignuda, la quale comperorno gli Gnidii, più bella senza comparatione de l’altra vestita che comperarono i Coii a chi stette la electione, a’ quali, come molti oggi, parve quella vestità più onesta. A questa ignuda intervenne quella novella etc. ; volsela comperar il re Nicomede, pagando tutto il debito della città quod erat ingens.
Gilio, Giovanni Andrea, Degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie(publi: 1564), p. 78-79 (italien)
Gli antichi non avevano la religione pura, casta e santa come noi. E che vero sia, considerate che la religione di Giove era fondata ne’stupri, negli adulterii, negli incesti ; quella di Priapo ne l’orribilità del membro ; quella di Venere ne la carnale lascivia ; quella di Cibele ne lo strappare de le membra virili de’suoi Coribanti. E tal diro anco degli altri iddii. I Romani (come scrive Plinio) tolsero a’Greci l’uso di fare le statue e le pitture nude ; come si legge d’Apelle, che fece quella bella figura di Venere nuda che usciva del mare, che con tanta cura fu gran tempo conservata nel palazzo di Agusto. Fidia[Note contexte] anch’esso fece quella bella statua di Venere, la quale non fu sicura da certi lussuriosissimi giovini, de la cui lidibine resto macchiata. I pittori che furono avanti Michelagnolo non fecero mai la figura de la gloriosa Vergine nuda, né quella di alcun santo, ecceto ne’martirii, et allora gli velavano le parti vergognose. Quella del Signor nostro, da la fanciullezza, dal battesimo, da la flagellazione e crucifissione e resurrezzione in poi, non mai. E questo per onestà, la quale deve tenere il primo luogo ne le figure sacre.
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), p. 211 (italien)
Vidonsi di lui parimente due bellissime figure, l’una rassembrante una onesta mogliera che piangeva, e l’altra una femmina di mondo che rideva (e’ si crede che questa fusse quella Frine famosissima meretrice), e nel volto di quella onesta donna pareva l’amore che ella portava al marito et in quello della disonesta femmina l’ingordo prezzo che ella chiedeva agli amanti.
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567), p. 219 (italien)
Ma fra le molte eccellenti, e non solo di Prassitele ma di qualunche altro maestro singolare in tutto il mondo, è più chiara e più famosa quella Venere la qual sol per vedere e non per altra cagione alcuna molti di lontano paese navigavano in Gnido. Fece questo artefice due figure di Venere, l’una ignuda e l’altra vestita, e le vendè un medesimo pregio ; la ignuda comperarono quei di Gnido, la quale fu tenuta di gran lunga migliore e la quale Nicomede re volle da loro comperare offerendo di pagare tutto il debito che aveva il lor comune, che era grandissimo ; i quali elessero innanzi di privarsi d’ogni altra sustanza e rimaner mendichi che di spogliarsi di così bello ornamento : e fecero saviamente, perciò che quanto aveva di buono quel luogo, che per altro non era in pregio, lo aveva da questa bella statua. La cappelletta dove ella si teneva chiusa si apriva d’ogn’intorno, talmente che la bellezza della dea, la quale non aveva parte alcuna che non movesse a maraviglia, si poteva per tutto vedere. Dicesi che fu chi, innamorandosene, si nascose nel tempio e che l’abbracciò, e che del fatto ne rimase la macchia la quale poi lungo spazio si parve.
Montaigne, Michel de, Essais(publi: 1580:1588), « Sur des vers de Virgile » (numéro III, 5) (fran)
Elles ne vendent que le corps : La volonté ne peut estre mise en vente, elle est trop libre et trop sienne : Ainsi ceux cy disent, que c’est la volonté qu’ils entreprennent, et ont raison. C’est la volonté qu’il faut servir et practiquer. J’ay horreur d’imaginer mien, un corps privé d’affection. Et me semble, que cette forcenerie est voisine à celle de ce garçon, qui alla saillir par amour, la belle image de Venus que Praxiteles avoit faicte : Ou de ce furieux Ægyptien, eschauffé apres la charongne d’une morte qu’il embaumoit et ensueroit : Lequel donna occasion à la loy, qui fut faicte depuis en Ægypte, que les corps des belles et jeunes femmes, et de celles de bonne maison, seroient gardez trois jours, avant qu’on les mist entre les mains de ceux qui avoient charge de prouvoir à leur enterrement. Periander fit plus merveilleusement : qui estendit l’affection conjugale (plus reiglee et legitime) à la jouyssance de Melissa sa femme trespassee. Ne semble ce pas estre une humeur lunatique de la Lune, ne pouvant autrement jouyr d’Endymion son mignon, l’aller endormir pour plusieurs mois : et se paistre de la jouyssance d’un garçon, qui ne se remuoit qu’en songe ? Je dis pareillement, qu’on ayme un corps sans ame, quand on ayme un corps sans son consentement, et sans son desir.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 36 (italien)
La decima et ultima ragione che le statue muovano più gli affetti umani che le pitture, non consentono in alcun modo e dicono in ciò poco valere l’esempio della figura di Pimmalione e della Venere di Prasitele; percioché da cose tanto stemperate e dishoneste non si può far derivare nobiltà, né perfettione; e che quando ciò vaglia, che le pitture molto più muovono gli affetti delle sculture e che ad essi ancora non mancano gli esempi da recare in campo delle pitture, che a disconvenevoli atti amorosi hanno incitati gli huomini, sicome l’Atalanta, e la Elena dipinte ignude in Lavinio, che mossero a lascivo amore Pontio legato di Gaio imperadore, il quale ogni sforzo fece per portarnele seco.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 263 (italien)
Di marmo scolpì due Venere, una vestita e una ignuda e le mise ad un medesimo prezzo; laonde quei di Coo à cui toccava à pigliare elessero quella vestita per esser più honesta e l’altra nuda per li medesimi denari; ma per differente gloria di fama, comperarono quei di Gnido, la quale il re Nicomede tentò di comperare, offerendo di pagar tutti i debiti della città, che erano grossa somma; ma gli huomini soffersero prima di patire ogni disagio, che privarsi di così bella figura, la quale veramente nobilitò Gnido; percioche da varie parti del mondo vi concorrevono le genti, tratti dalla fama della bellezza di questa Venere, la quale era accomodata in un picciol tempio, che da tutte le bande si apriva talmente che la Dea intorno, intorno rimirar si potea e non havea parte, che a rimirarla non empiesse altrui di maraviglia: e dicono essere stata cotale la sua bellezza che un giovane essendone caldamente innamorato, nascososi una notte nel tempio, abbracciandola sfogò il suo amoroso disiderio e della sua dolcezza ne mostrò il marmo poi lungo tempo il segno.
Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), "Della forma di Venere" (numéro Libro settimo, cap. X) , p. 494 (italien)
Ma oltre diverse altre forme e figure di questa dea, che secondo diversi nomi gli furono attribuite, o secondo alcuno suo effetto, le quali lungo sarebbe a ricordare ad una ad una, ve ne sono alcune ch’in verun modo non debbono essere tralasciate. Fra le quali fu quella dipinta da Nicearco fra le Grazie e gl’Amori et un’altra di mano di Nealce; ma la più bella che fra gl’antichi si trovasse, fin a quel tempo, fu quella che scolpì in marmo Fidia, la quale già si trovò nell’opere di Ottavia in Roma. Quelli di Coo n’ebbero una di mano di Prassitele, vestita, la quale tennero più bella di quella della quale erano possessori che poi fu portata in Gnido di mano del medesimo maestro.
Commentaires : ed 1584, p. 569
Lomazzo, Gian Paolo, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura(publi: 1584), « De la forma di Venere » (numéro Libro settimo, cap. X) , p. 490 (italien)
Perché Afrodite la chiamano i Greci dalla spiuma. Virgilio, parimenti, fa che Nettuno così risponde a lei quando ella lo prega a volere ormai acquetare la tempesta del mare ch’avea assalito il suo figliuolo Enea:
Giusto è che ne’ miei regni tu ti fidi,
Perché tu già di questi nata sei.
Il che volendo mostrare gl’antichi, la dipingevano ch’ella quindi usciva fuori, stando in una gran conca marina, giovane e bella quanto era possibile, e tutta ignuda. E le diedero la conca marina, perché, come dice Giuba, nel congiungersi col maschio tutta si apre e si mostra, per alludere a quello che si fa ne’ piaceri amorosi. Fu fatta tutta ignuda perché rende ignudi coloro che la imitano e per mostrare quello a ch’ella è sempre apparecchiata, et ancora per dar a divedere che chi va dietro a lascivi piaceri rimane spesso spogliato e privo d’ogni bene, avendo perso le ricchezze, il corpo indebolito e l’animo macchiato, sì che nulla ha più di bello; et oltre di ciò per farci conoscere che i furti amorosi non possono stare occulti sempre; laonde, o per questa o per qual altra cagion si fosse, Prassitele fece a Gnidij quella sua tanto celebrata Venere nuda di marmo bianchissimo; tanto bella, che molti vi navigavano per vederla; di cui come scrivono Luciano e Plinio, se ne innamorò uno si fattamente, che gli lasciò in un fianco la macchia del desiderio suo. E di questo parere vogliono molti che sia la statua per la maravigliosa bellezza che si ritrova in lei la quale è ora in Roma, ch’anch’io ho veduta.
Commentaires : ed 1584, p. 564-565
Baudelot de Dairval, Antoine, De l’utilité des voyages, et de l’avantage que la recherche des antiquitez procure aux sçavans(publi: 1586), « Les statues » (numéro vol. 1) , p. 89-91 (fran)
- [1] Vie d’Apoll.
- [2] Propter quod unum visuntur Thespiæ
- [3] Par Veneri Gnidiæ noilitate et injuria
Ces statuës Monsieur ne se sont-elles pas fait le plus souvent des amans, des sujets, ou des adorateurs. Ephese et Argos sans parler de tant d’autres villes, n’ont eu pendant long-temps d’autres souverains sans doute que leurs Deesses, et leurs Temples : et que la derniere même ne distinguoit ses années que par le nom des prêtres de sa Junon. L’amour de ce jeune Perinthien pour la Venus de Gnide est si celebre qu’il n’est pas besoin d’en raporter les circonstances. Il y en eut encore un autre du tems de Domitien, comme on le voit dans Philostrate [1]qui fit des presens de la plus grande partie de son bien au Temple, dans l’esperance qu’il avoit d’en épouser la Deesse. Les magistrats même et les habitans de Gnide souffroient cette prodigieuse manie, pour rendre leur ville et leur Deité plus fameuses, ou pour quelque autre raison qui n’est pas venuë jusques à nous. Cette admirable statuë neanmoins n’étoit pas la seulle qui excitoit de ces desirs extraordinaires. Celle de la bonne fortune qui étoit à Athene dans le Prytanée, eut un amant d’une des meilleures familles de cette ville. Le jeune Athenien qui en étoit éperdu, ne pouvant obtenir des magistrats qu’il l’achetât au rapport d’Elian il se donna la mort aprés avoir fait des sacrifices et des offrandes magnifiques à cette maîtresse inaccessible et inalienable. Enfin outre une infinité d’autres ce Cupidon de Thespies qu’on alloit voir de tous côtez et pourquoy l’on alloit seulement à Thespies dit Ciceron [2], et celuy de la ville de Pare qu’Alchidas Rhodien rendit celebre par sa fureur ; aussi selon Pline ne cedoit-il pas à la Deesse de Gnide ny en beauté ny en avantures [3].
Lomazzo, Gian Paolo, Idea del tempio della pittura(publi: 1590), "Della nobiltà della pittura" (numéro cap. VI) , p. 268 (italien)
- [1] Figura d'un giovane dipinto amata da una donna.
- [2] Alchidia Rodio amò la statua di Venere Gnidia
- [3] Pigmalione si accese della statua da lui scolpita
- [4] Eccellenza di pittori talvolta degna più tosto di biasimo che di laude
A quali basterà che io avertisca che si guardino di non metter studio in rappresentar le figure loro in atti molli e lascivi. Percioché non solamente con tal vista si vengono a corrompere gl’animi et ad accendersi a far quello che in figura vedono, ma spesse volte s’inducono ad amar ferventemente, come si legge di [1] colei che s’innamorò d’un giovane dipinto sotto il portico d’Atene, di [2] Alchidia Rodio che in Gnido amò l’opera di Prassitele, e di [3] Pigmalione che, amando la sua figura d’avorio, ottenne con prieghi che li fosse dato spirito e vita per poterla godere, come si favoleggia.[4] Onde di cotali pitture e scolture, quantunque per altro fossero eccellentissime, in vece di lode ne segue agli artefici scorno e vituperio, oltre l’offesa che si fa a Dio; dove per lo contrario, servendosene a buono uso e massima ad onorar Dio et incitar gli altri a riverirlo et adorarlo, se ne riporta insieme gloria e riputazione.
Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III, « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro cap. III) , p. 122-123 (espagnol)
No se vee claramente que la fama de las obras y professores destas artes es celebrada como cosa milagrosa, casi por todos los poetas en sus versos ? […]
Ausonio
Vera Venus fictam cum vidit Cypria dixit,
Vidisti nudam me puto Praxiteles ?
Non vidi nec fas, sed ferro opus omne polimus :
Ferrum Gradivi Martis in arbitrio.
Qualem igitur Domino scierant placuisse Cytheren,
Talem fecerunt ferrea cœla Deam.
Es a saber.
La verdadera Venus de Cypro, viendo su retrato esculpido dixo, Pienso que me has visto desnuda Praxiteles ?
No vi, ni era justo, pero qualquiera obra que hazemos es con yerro, y el yerro esta debaxo del arbitrio del apressurado Marte.
Por manera que la misma suerte que supieron los buriles que se contento el señor Marte de Venus, dessa misma la hizieron.
Ferrand, Jacques, Traité de l’essence et guérison de l’Amour ou mélancolie érotique(publi: 1610) (ch. XI), p. 239-240 (fran)
Autres qui appliqueront leurs amours aux choses inanimées et insensibles, comme ceux qu’Ælian et Philostrate en la Vie d’Apollonius recitent s’estre amourachez d’une statuë de marbre si esperduëment qu’ils se tuerent du regret qu’ils receurent de ce que le senat d’Athenes leur defendoit d’acheter ces belles idoles de leur ame. Xercés s’enamoura d’un arbre, Alkidias Rhodien d’une statuë de Cupidon de l’ouvrage de Praxiteles, Charicles d’une statuë de Venus Cnidienne, Narcisse et Eutelidas de leurs ombres. Quoy que le Prince des Peripatheticiens en ses Morales nous enseigne que l’affection qu’on porte aux choses inanimées n’est pas vray amour, pour autant qu’on ne peut pas estre d’elles reciproquement aimé, et par ce qu’on ne leur peut desirer du bien, en quoy consiste la nature de l’amour.
Marius, Hadrianus (Adriaan Nicolai, dit), Poemata et effigies trium fratrum belgarum(publi: 1612)(latin)
In Venerem Cnidiam e Graeco
Nuda Venus nulli uisa, aut si uisa cuiquam est,
Huic uisa est, nudam tam bene qui statuit.
Dinet, Pierre, Cinq livres des hiéroglyphiques, où sont contenus les plus rares secrets de la nature, et proprietez de toutes chsoes. Avec plusieurs admirables considerations, et belles devises sur chacune d'icelles(publi: 1614) (livre V), p. 600-603 (fran)
- [1] Statuë de Venus faicte par Appelles
- [2] Venus faicte par Praxiteles est encore à Rome
- [3] François premier restaurateur des bonnes lettres
- [4] Description plaisante de la Venus adoree en Gnidos.
- [5] Myrthe dedié à Venus.
- [6] Description d'une beauté au portraict de Venus.
Deux chefs-d'œuvres touchant ce subiect se racontent: tres memorables sur tous ceux qui onques furent. L'un de platte peincture, l'autre de plein relief: à sçavoir la tant[1] renommee Venus d'Apelles, sortant de la mer: Et la statuë de la mesme Deesse, faicte de marbre parien, par le tres-excellent sculpteur Praxiteles. Laquelle encores pour le iourd'huy, au moins selon le bruict commun, se void toute-entiere à[2] Rome, dans le iardin de Belveder, et de bronze, en ceux de Fontaine-bleau faicte ietter sur l'antique en moule par le grand Roy François[3] de ce nom, pere et restaurateur de ces bonnes lettres, qui de present par la guerres civiles, et par le malheur du temps petit à petit s'esvanoüissent. C'est celle-cy, que Lucian descrit avec toutes ses appartenances et dependances, lors qu'elle estoit en sa plus grand'vogue et credit en la cité de Gnidos: où si grand nombre de peuple est autresfois abordé de tous les endroicts de la terre, expressément pour la voir, plustost que par devotion. Car quelle devotion croyoit on pouvoir estre, en une chose si mondaine et lascive? Lucian donques la descrit ainsi au Dialogue des amours.
[4] Dés la premiere entree du boscage, soudain nous nous sentismes ie ne sçay comment haleinés, d'un doux et soüef vent venerien: car ceste serenité et lumiere celeste, ne se venoit pas accueillir en un terroir du tout sterile et pierreux: ainsi estoit (comme pour un si sainct heureux lieu que le temple de la Deesse d'amour) tres-fertilement recestu de beaux arbres fruictiers, qui de leurs verdoyans et feuillus rameaux espanchez çà et là au loing lambrissoient presque l'air de costé et d'autres: et le[5] myrthe toufu provenant à souhait chez sa dame et maistresse, avoit desployé et bouté hors ces fleurs odorantes. [...] Apres donc que nous fusmes suffisamment rassassiés de ces verdures, où la Deesse d'un marbre parien estoit plante tout au beau milieu (ouvrage certes par trop beau et exquis) sousriant de ie je sçay quel ris feintif et mignard. Au reste sa beauté toute entiere est à l'abandon, en une claire et evidente veuë: car elle est descouverte totalement et sans vesture quelconque qui puisse rien voiler de sa personne, horsmis que l'une des mains, comme ne pensant point à soy, elle couvre ses secrettes parties, assez nonchalamment toutesfois: en quoy l'artificielle subtilité de[6] l'ouvrier a tant eu de force, que mesme la nature du marbre, ainsi dur et solide de soy, condescend neantmoins et obeyt à representer proprement chaque membre, en sa deuë et requise naïfveté: comme les belles et charnuës espaules: le flanc relevé, les fesses gentiment arrondies et troussees, la greve droict allongee d'un tres-bien compassé profil iusques à la cheville du pied. Bref tout le demeurant du corps tellement elabouré qu'il n'y restoit rien que la seule parole. Voila quelque partie de ce qu'en dit Lucian, couvrant le surplus de silence qui pourroit estre desagreable aux oreilles chastes et pudiques.
Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte terza » (numéro Diceria I) , fol. 74v-75r (italien)
Sò che Alchida Rhodico s’innamorò libidinosamente della statua di Venere, opera di Prassitele. Hò letto, che Pigmalione della sua s’invaghì sì follemente, che con esso lei ragionava, l’abbracciava, e con affettuosi gemiti sospirava. Sovviemmi, che Giunio havendo veduto un simulacro delle Muse ignude, si accese per esso di strano ardore. Mi ricordo, che Pontio si compiacque in guisa d’Atalanta, e d’Helena fatte già per mano di Cleofanto, che sene struggeva di disiderio. Trovo scritto finalmente amante esserci ritrovato tanto focoso, che morì baciando della sua cara amata il ritratto. Ma perche quell’affetto, e quell’amore, che vanamente altri spese in imagini morte et insensate, non impieghiamo noi un questa imagine viva e vitale, di essa santamente innamorandoci, stringendola con le braccia del cuore, riscaldandola co’baci dell’anima, e lavandola col bagno delle lagrime nostre ?
Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte prima » (numéro Diceria I) , fol. 4r (italien)
Et che che se le mancano i lumi, e l’ombre che può dar l’Artefice, ella hà nondimeno quelli, e quelle che fà la Natura istessa, e che si vanno naturalmente variando; et che se dal canto di lei s’adducono l’uve di Zeusi, il cavallo d’Apelle, e i cani di Nicia, dove corsero gli animali; per sé non mancano la giumenta di Mirone, la Verene di Prassitele, e quella di Pigmalione, di cui s’innamorarono gli huomini.
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo octavo, delo practico del Arte, con sus materiales vozes, y terminos, principios de Fisionomia, y Simetria, y la estimacion, y estado que oi tiene en la Corte de España”, fol. 156r (espagnol)
- [1] Tarc. lib. 15. par. I
No sé si real çarà mas la generosidad del dar, que la possession y aprecio de una cosa peregrina; que tal vez semejantes cosas han dado renombre, y estimacion à tota una provincia. [1] Tal fue la Venus que hizo Praxiteles para la ciudad de Guido, que diximos. Llevòse una imagen en lamina de una tercia, de mano del Corezo, que la truxo Pompeo Leoni de Italia, y despues de Galès dio dos mil escudos por ella, y no se la quiso dar: mas al fin despues la huvo por otra mano, y por otro precio.
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (II, 9, 3), p. 183 (anglais)
Nicomedes the king would have bought Praxiteles his Venus of the Gnidians, offering for it to pay all their debts, which did amount to a great summe of money ; but they chose rather to endure any extremitie, than to part with such a rare piece of worke: neither was it without cause that the Gnidians did shew themselves so resolute, seeing Praxiteles made Gnidus renowned by this piece of worke.
Rampalle, Daniel de, L’Erreur combatuë. Discours académique où il est curieusement prouvé, que le monde ne va point de mal en pis(publi: 1641), p. 144-145 (fran)
- [1] La Porte Milanois
I’ay parlé en dernier lieu de ce Prince des Peintres, pource qu’il est encore célèbre en la Sculpture, et que les Statuës de sa façon, ou du Bandinelli, du Pilon, et du Cavalier Bernin, pourroient bien estre comparées à celles de Phidias, de Polyclète, de Myron, et de Léocarès. Il est vray que cet Art n’est pas du tout en si haute estime qu’il estoit iadis chez les Romains, dont la passion avoit rempli la Ville d’un si grand nombre de Statues, qu’au rapport de Cassiodore, il n’estoit guère moindre que celuy de ses habitans. Mais pour vous faire voir en un mot que les modernes en ont attaint la perfection, comme les Anciens, si la Iunon de Ctésiclès rendit iadis Clisophon éprits de son amour ; si l’on vid dans Cypre un ieune homme idolâtre de la Vénus de Praxitélès, et si dans Athènes un austre estourdy se tua de pure passion devant une statue de la bonne Fortune. De nostre temps on a esté contraint à Rome de couvrir d’une chemise de bronze une statue de la main d’un moderne, [1] pour la garantir de l’aveugle sensualité d’un Espagnol.
La Mothe le Vayer, François de, Petits traitez en forme de lettres escrites à diverses personnes, Lettre IX, « Sur la peinture »(publi: 1662, redac: 1649:1662), t. II, p. 443 (fran)
J’aime mieux que le paganisme nous fournisse des exemples de cette nature, que la vraie religion, où il ne se trouve que trop de telles impietez. En combien d’églises voions-nous l’effronterie d’un Praxitele, qui donnoit à Venus le visage d’une Cratine qu’il aimoit, de mesme que d’autres lui attribuoient celuy de la courtisane Phryné, et à Mercure celuy d’Alcibiade, selon que Clement Alexandrin l’a remarqué ? Il ne faut que lire, pour nous en faire honte, l’invective de Pline contre un Arelius, qui pratiquoit à Rome la mesme chose un peu devant le temps de l’Empereur Auguste. Fuit et Arelius Romae celeber paulo ante Divum Augustum, nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper alicujus feminae amore flagrans, et ob id Deas pingens, sed dilectarum imagine.
Conférences de l’Académie royale de peinture et de scupture(publi: 2006:2015, redac: 1667:1789), Guillet de Saint-Georges, Harangue prononcée le 17 décembre 1683 à l’Académie royale de peinture et de sculpture (numéro t. II, vol. 1) , 93 (fran)
Tout le monde sait que le Roi Nicomède voulut affranchir les Gnidiens de tous les tributs qui leur avaient été imposés, pourvu qu’ils lui donnassent la Vénus de Praxitèle, qu’ils possédaient et qui attirait tous les ans dans leur ville un nombre infini de Curieux. Ce peuple le refusa, et préféra cette célèbre statue au soulagement que ce prince lui offrait.
Lamoignon de Basville, Nicolas de, "Plaidoyer pour le sieur Gérard Van Opstal", lu le 4 février 1668 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1668/02/04), 217-218 (fran)
Aussi ne peut-on voir sans étonnement dans l’histoire qu’une statue de la main d’Aristide fut vendue trois cent septante-cinq talents et une autre de Polyclète six-vingts mille sesterces, et que le roi de Nicomédie voulant affranchir la ville de Gnide de plusieurs tributs, pourvu qu’elle lui donnât cette Vénus de la main de Praxitèle qui attirait tous les ans un concours infini de curieux, les Gnidiens aimèrent mieux demeurer toujours tributaires que de lui donner cette statue.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669), vol. 3, p. 632-633 (latin)
Praxitelis ætatem inter statuarios diximus, qui marmoria gloria superavit etiam semet. Opera ejus sunt Athenis [1]in Ceramico, sed ante omnia, et non solum Praxitelis, verum et in toto orbe terrarum Venus, quam ut viderent multi, navigaverunt Gnidum. Duas fecerat, simulque vendebat, alteram velata specie, quam ob id [2]prætulerunt optione, quorum conditio erat, Coi, cum eodem pretio detulisset, severum id ac pudicum arbitrantes : rejectam Gnidii emerunt, inmensa differentia famæ. Voluit eam postea a Gnidiis mercari rex Nicomedes, totum æs civitatis alienum, quod erat ingens, dissoluturum se promittens. Omnia perpeti maluere, nec immerito : illo enim signo Praxiteles nobilitavit Gnidum. Ædicula ejus tot aperitur, ut conspici possit undique effigies Deæ, favente ipsa, ut creditur facto. Nec minor ex quacunque parte admiratio est. Ferunt amore captum quendam, cum delituisset noctu, simulacro cohæsisse, ejusque cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Gnido et alia signa marmorea inlustrium artificum, Liber pater Bryaxidis et alter Scopæ, et Minerva : nec majus aliud Veneris Praxitelicæ specimen, quam quod inter hæc sola memoratur.
- [1] In Ceramico.] Prope Ceramicum vicum, et in ipsius aditu. Pausanias l. I Praxitelis opera duo fuisse tradit, alterum statuam equestrem, alterum Neptunum, qui in equo sedens Polyboten gigantem hasta petit. Vide quod adnotatum est c. 12. lib. 35. Dalec.
- [2] Prætulerunt optione, quorum conditio erat, Coi.] Deme verbum optione, ex vetere exemplari. Alioqui legendum videretur, optio quorum conditione erat. Pint.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « De tweede vrucht der konst. Winst en Rijkdom » (numéro IX, 5) , p. 352 (n)
Men zegt dat die van Koos hondert talenten voor de Venus Anadiomene genoten, die zy van de schattinge afkortten.
Koning Nicomedes wil de die van Gnidus van alle haere schulden ontlasten, die ongelooflijk groot waren, voorde Venus en Praxiteles, maer zy weygerden’t; doch dit was geen Schildery, maer een statue.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Le deuxième fruit de l’art. Gain et richesse » (numéro IX, 5) , p. 508 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
On dit que les habitants de Cos reçurent cent talents pour la Vénus Anadyomène qu’ils prirent de leur trésor. Le roi Nicomède voulut décharger les habitants de Cnide de toutes leurs dettes, incroyablement élevées, en échange de la Vénus de Praxitèle, mais ils le refusèrent. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une peinture mais d’une statue.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685), t. V, p. 274-275 (latin)
[1]Praxitelis aetatem inter statuarios diximus, qui marmoris gloria superavit etiam semet. Opera ejus sunt Athenis in Ceramico: sed ante omnia, et non solum Praxitelis, verum et in toto orbe terrarum, [2]Venus, quam ut viderent multi, navigaverunt Gnidum, duas fecerat, simulque vendebat, alteram velata specie, quam ob id quidem praetulerunt, [3]quorum condicio erat, Coï, cum alteram etiam eodem pretio detulisset, severum id ac pudicum arbitrantes: rejectam Gnidii emerunt, immensa differentia famae. Voluit etiam postea a Gnidiis mercari rex [4]Nicomedes, totum aes civitatis alienum, quod erat ingens, dissoluturum se promittens. Omnia perpeti maluere, nec immerito: illo enim signo Praxiteles nobilitavit Gnidum. Aedicula ejus tota aperitur, ut conspici possit undique effigies deae, favente ipsa, ut creditur, facto. Nec minor ex quacumque parte admiratio est. [5]Ferunt amore captum quendam, cum delituisset noctu, simulacro cohaesisse, ejusque cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Gnido et alia signa marmorea illustrium artificum, Liber pater [6]Bryaxidis: et alter Scopae, et Minerva: nec majus aliud Veneris Praxiteliae specimen quam quod inter haec sola memoratur.
- [1] Praxitelis aetatem… diximus. Libro 34. sect. 19.
- [2] Venus. In illud simulacrum extant epigrammata perelegantia in Anthol. lib. 4. cap. 12. quorum illud primum Antipatri :
Τίς λίθον ἐψύχωσε; τίς ἐν χθονὶ Κύπριν ἐσεῖδεν;
Ἵμερον ἐν πέτρῃ τίς τόσον εἰργάσατο;
Πραξιτέλους χειρῶν ὅδε που πόνος, ἢ τάχ’Ὄλυμπος
Xηρεύει Παφίης ἐς Κνίδον ἐρχομένης.
Quis lapidis spirare dedit ? quis Cyprida vidit ?
In terris quantum marmor amoris habet ?
Praxitelis manus : Venere, ut puto, vegia cali
Jam caret : ad Cnidios venit ut ipsa Venus.Et sextum ab ipso, Eveni :
Παλλὰς καὶ Κρονίδαο συνευνέτις εἶπον, ἰδοῦσαι
τὴν Κνιδίην· « Ἀδίκως τὸν Φρύγα μεμφόμεθα ».
Vt Cnidiam videre Jovis soror atque Minerva.
Disserunt : querimur non bene de Paride. - [3] Quorum condicio. Hoc est, optio. Cicero, pro Cluent. num. 14. Sed cum esset ac illi proposita conditio, ut aut juste pieque accusaret, aut acerbe indigneque moreretur, etc.
- [4] Nicomedes. Bithyniae rex, Mitridaticis temporibus.
- [5] Ferunt amore. Vide Valerium Max. lib. 8. cap. II, pag. 400. Ex Posidippo historico refert hoc ipsum Clemens Alex. in Protrept. pag. 38. Ἀφροδίτη καὶ ἄλλη ἐν Κνίδῳ λίθος ἦν, καῖ καλὴ ἦν· ἔτερος ἠράσθη ταύτης καὶ μίγνυται τῇ λίθῳ· Ποσίδιππος ἱστορῶ ἐν τῷ περὶ Κνίδου.
- [6] Bryaxidis. Βρύαξις statuarius a Pausania laudatur, lib. I. Attic. pag. 73. et alibi passim. Σκώπας ab eodem in Atticis, etc.
[Lemée, François], Traité des statuës(publi: 1688), « De quelques effets surprenants des statuës » (numéro chapitre XIV) , p. 378 (fran)
- [1] Cujus aspectus insensato dat concupiscentiam et diligit mortuæ imaginis effigiem sine anima. Sap. 25. v. 5
- [2] Metamorphos. lib. 10
- [3] Natal. Comes l. 7 c. 16. Mythol.
Si cette statuë avoit ainsi retenu les innocentes marques de la foiblesse du sexe qu’elle representoit, combien d’autres en ont-elles conservé les criminels attraits. [1] Il y en a qui par des charmes aussi surprenants que pernicieux, ont donné de l’amour aux insensez qui les ont regardées, et leur ont fait cherir l’image d’une personne qui n’étoit plus.
Ovide est admirable sur l’aventure de Pigmalion [2], qui n’avoit jamais pu aimer de femme, que celle qu’il se fit luy-même avec de l’yvoire. La Venus de Gnide, la Bonne Fortune d’Athennes, le Cupidon de Tespir, et celui de Pare, ont eu des amans, et l’on ne sçauroit parler qu’avec horreur de la folie ou plûtôt de la rage de Clisophus le Selymbrien [3].
[Callières, François de], Histoire poëtique de la guerre nouvellement déclarée entre les Anciens et les Modernes(publi: 1688) (livre onzième), p. 257-258 (fran)
Ce n’est plus entre nous, dit Praxitelles en s’adressant à Phidias, que roule la dispute de la préference, sur la perfection de nôtre art, c’est le fameux Girardon, ce sont les deux freres Gaspards et le gracieux Baptiste qui nous ont enlevé cette gloire, leurs ouvrages sont au dessus des nôtres et ils seront immortels comme eux.
Lorsqu’il leur manquera quelque bras quelque nez.
Ma Venus de Gnide, qu’on alloit voir de si loin ny tous mes autres ouvrages ne sont pas dignes d’estre comparez à l’excellence des leurs, j’ay beaucoup d’impatience, ajoûta-il de voir ces nouveaux Heros de nôtre art, afin d’apprendre d’eux ce que nous avons ignoré.
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (III, 2, 9), p. 165-166 (latin)
- [1] Nihil igitur mirum antiquos Artifices, Græcos præsertim, e nudis fere imaginibus præcipuam exactæ artis captasse famam.
[1] Quoniam autem nuda corpora, Vitia, si qua sunt, non celant, nec laudes parum ostentant, ut loquitur Plin. Junior lib. III, epist. 6; in iis potissimum elaborandis antiquiores desudarunt. Ipsa nuditas hominis mire ad pulchritudinem facit, Lactant. de Opificio Dei, cap. 7. Aristænetus lib. I, epist. I: Ἐνδεδυμένη μὲν εὐπροσωποτάτη· ἐκδότα δὲ, ὅλη πρόσωπον φαίνεται : Vestem induitur, formosa exuitur, tota forma est. Gestiebant itaque simplicissimum nudæ proportionis ornatum, sine ullo vestium tegmine oculis omnium exponere. Quamvis aliam quoque rationem afferat Alexander Aphrodis. propter quam veteres artifices deorum ac regum statuas plerumque nudas finxerint : Οἰ ἀνδριαντοποιοὶ πρὸς τιμὴν ἐνίοτε γυμνοὺς πλάττουσι θεοῖς τε καὶ βασιλεῖς, inquit Aphrodis. lib. I, problem. 87, δεῖξαι βουλόμενοι τούτων τὸ φανερὸν τῆς δυνάμεως καὶ γνώμης ἐκτὸς ὂν πάσης κακίας κεκρυμμένης : Statuari sæpenumero honoris ergo nudos fingunt deos ac reges, ut indicent manifestam eorum vim, apertumque animum ab omni occulta malitia quam longissime remotum esse. Quanta vero cum ratione statuarum suarum plerasque nudas factitaverint, vel uno Praxitelis exemplo satis ostenditur.
Monier, Pierre, Histoire des arts qui ont rapport au dessein(publi: 1698), p. 41 (fran)
Praxiteles étoit l’un des plus habiles, et des plus renommez sculteurs de son tems ; et les deux Venus qu’il fit pour les viles de Gnide, et de Coos[1], sont autant d’illustres preuves de sa capacité, que de sa gloire.
- [1] Pausanias en ses Attiques, a décrit plusieurs pieces de ce sculteur.
Coypel, Antoine, "Commentaire de l’Épître à son fils (les anciens et les modernes)", lu le 1er septembre 1714 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1714/09/01), 122 (fran)
L’estime que l’on faisait de ces rares ouvrages vint à un si haut point, qu’une statue de la main d’Aristide fut vendue trois cent soixante et quinze talents ; et une autre de Polyclète six vingt mille sesterces ; et que le roi de Nicomédie, voulant affranchir la ville de Gnide de plusieurs tributs, pourvu qu’elle lui donnât cette Vénus de la main de Praxitèle qui attirait tous les ans un concours infini de curieux, les Gnidiens aimèrent mieux rester toujours tributaires que de lui donner leur statue.
Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la sculpture » (numéro livre XXIII, ch. 4) , p. 106-107 (fran)
Les habitants de l’île de Cos avoient demandé une statue de Vénus à Praxitèle. Il en fit deux, dont il leur donna le choix pour le même prix. L’une étoit nue, l’autre voilée ; mais la première l’emportoit infiniment pour la beauté : immensa differentia famæ[Note contexte]. Ceux de Cos eurent la sagesse de donner la préférence à la derniére, persuadés que la bienséance, l’honnêteté et la pudeur ne leur permettoient pas d’introduire dans leur ville une telle image, capable d’y faire un ravage infini pour les mœurs : severum id ac pudicum arbitrantes. Cette retenue des payens, à combien de chrétiens fera-t-elle honte ? Les Cnidiens furent moins attentifs aux bonnes mœurs. Ils achetérent avec joie la Vénus rebutée, qui fit depuis la gloire de leur ville, où l’on alloit exprès de fort loin pour voir cette statue, qui passoit pour l’ouvrage le plus achevé de Praxitèle. Nicoméde, roi de Bithynie, en faisoit un tel cas, qu’il offrit aux habitants de Cnide d’acquitter toutes leurs dettes, qui étoient fort grandes, s’ils vouloient la lui céder. Ils crurent que ce seroit se déshonorer, et même s’appauvrir, que de vendre, pour quelque prix que ce fût, une statue qu’ils regardoient comme leur gloire et leur trésor.
Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro ch. 5) , p. 204-205 (fran)
Nous avons vû une ville, qui avoit le choix de deux statues de Vénus, toutes deux de la main de Praxitéle, c’est tout dire, l’une voilée et l’autre nue, référer la premiére quoique beaucoup moins estimée, parce qu’elle étoit plus conforme à la modestie et à la pudeur. Que pourrois-je ajouter à un tel exemple ? Quelle condamnation pour nous, si nous rougissons de le suivre !
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « De la sculpture et des sculpteurs anciens, selon Pline » (publi: 1759, redac: 1753/06/01) (t. XXV), p. 319-320 (fran)
« J’ai parlé du temps auquel vivoit Praxitèle, qui s’est surpassé lui-même pour la gloire du marbre. Presque tous les ouvrages de ce grand artiste sont à Athènes dans le Céramique. Mais celui qui surpasse ceux qui peuvent être dans tout le monde, et ceux de Praxitèle lui-même, c’est une Vénus qui a engagé plusieurs personnes à passer la mer pour aller la voir à Gnide. Praxitèle en avoit fait une autre, et il les mit en vente en même temps, et donna le choix pour le même prix, quoique l’une des deux fût drapée. Les habitans de Cos choisirent cette dernière, la croyant plus décente et plus honnête ; cependant celle qu’ils dédaignèrent eut une réputation bien supérieure, et les habitans de Gnide l’achetèrent. Le roi Nicomède voulut par la suite en donner une somme considérable, il consentoit à payer toutes leurs dettes ; mais ils firent bien de refuser ses propositions, car leur ville a été illustrée par cette statue. Elle est placée dans un petit bâtiment qui reçoit le jour de tous les côtés, et qui permet de l’admirer sans obstacles et de toutes les faces ; elle semble même accueillir ceux qui la vont visiter : favente ipsa, ut creditur, facto. »
Je ne dis rien de ce dernier trait, c’est un des payemens que Pline se donnoit pour les peines que lui coûtoient ses recherches. Il continue et dit : « on assure qu’un homme en devint amoureux, et trouva moyen de passer la nuit avec elle[1]. »
Les récits de cette nature se trouvent également rapportés dans l’histoire de nos artistes modernes. Ne dit-on pas qu’un espagnol s’est laissé enfermer la nuit dans l’église St. Pierre de Rome, pour jouir d’une figure qui est au tombeau du pape Paul III ? elle est de la main de Guillaume della Porta, élève de Michel-Ange, et sculpteur un peu sec. Depuis ce temps, soit que l’aventure ait eu quelque fondement, ou plustôt parce que cette figure étoit trop nue, on l’a couverte d’une draperie de bronze ; mais dans la vérité, quoique l’on ne doive pas disputer des goûts, je connois vingt statues plus capables d’inspirer une pareille fureur.
- [1] Lucien rapporte le même fait, et dit qu’il l’avoit appris du garde du temple de Gnide.
Commentaires : attacher photo de statue Della Porta
Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières, comte de, « De la sculpture selon Pline », discours lu le 1er juin 1754 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1754/06/01), 347-348 (fran)
J’ai parlé du temps auquel vivait Praxitèle, qui s’est surpassé lui-même pour la gloire du marbre. Presque tous les ouvrages de ce grand artiste sont à Athènes dans le Céramique. Mais celui qui surpasse ceux qui peuvent être dans tout le monde et ceux de Praxitèle lui-même, c’est une Vénus qui a engagé plusieurs personnes à passer la mer pour aller la voir à Gnide. Praxitèle en avait fait une autre ; il les mit en vente en même temps et donna le choix pour le même prix, quoique l’une des deux fût drapée. Les habitants de Cos choisirent cette dernière, la croyant plus décente et plus honnête ; cependant celle qu’ils dédaignèrent eut une réputation bien supérieure et les habitants de Gnide l’achetèrent. Le roi Nicomède voulut par la suite en donner une somme considérable, il consentait à payer toutes leurs dettes ; mais ils firent bien de refuser ses propositions car leur ville a été illustrée par cette statue. Elle est placée dans un petit bâtiment qui reçoit le jour de tous les côtés et qui permet de l’admirer sans obstacles et de toutes les faces ; elle semble même favoriser ceux qui la vont visiter. Il continue et dit : on assure qu’un homme en devint amoureux et trouva moyen de passer la nuit avec elle. Les récits de cette nature se trouvent également dans l’histoire de nos artistes modernes. Ne dit-on pas qu’un Espagnol s’est laissé enfermer la nuit dans l’église de Saint-Pierre de Rome pour jouir d’une figure placée sur le tombeau du pape Paul III ? Elle est de la main de Guillaume della Porta, élève de Michel-Ange et sculpteur un peu sec. Depuis ce temps, soit que l’aventure ait eu quelque fondement, ou plutôt parce que cette figure était en effet trop nue pour la place qu’elle occupait, on l’a couverte d’une draperie de bronze ; mais dans la vérité, quoique l’on ne doive jamais disputer des goûts, je connais vingt statues plus capables d’inspirer une pareille fureur.
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung(publi: 1755, trad: 1991), p. 10 (allemand)
Das Gesetz aber „die Personen ähnlich und zu gleicher Zeit schöner zu machen“, war allezeit das höchste Gesetz, welches die griechischen Künstler über sich erkannten, und setzet notwendig eine Absicht des Meisters auf eine schönere und vollkommenere Natur voraus. Polygnotos hat dasselbe beständig beobachtet.
Wenn also von einigen Künstlern berichtet wird, daß sie wie Praxiteles verfahren, welcher seine Knidische Venus nach seiner Beischläferin Kratina gebildet, oder wie andere Maler, welche die Lais zum Model der Grazien genommen, so glaube ich, sei es geschehen, ohne Abweichung von gemeldeten allgemeinen großen Gesetzen der Kunst. Die sinnliche Schönheit gab dem Künstler die schöne Natur; die Idealische Schönheit die erhabenen Züge: von jener nahm er das Menschliche, von dieser das Göttliche.
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung, (trad: 1991), p. 23-24 (trad: "Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture" par Charrière, Marianne en 1991)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Cette loi prescrivant de « représenter les personnes ressemblantes tout en les embellissant » fut de tout temps la loi suprême à laquelle se plièrent les artistes grecs. Elle suppose nécessairement l’intention de représenter une nature plus belle et plus parfaite. Polygnote a constamment observé cette loi. Si l’on raconte donc de quelques artistes qu’ils ont procédé comme Praxitèle qui représenta la Vénus de Gnide d’après sa concubine Cratina, ou comme d’autres peintres qui prirent Laïs comme modèle pour les Grâces, je crois qu’ils le firent sans s’écarter des lois générales de l’art que je viens d’indiquer. La beauté sensible apporta à l’artiste la belle nature ; la beauté idéale lui apporta les traits sublimes : à l’une il emprunta l’humain, à l’autre le divin.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting(publi: 1760), “Of Design” (numéro Dialogue IV) , p. 48-50 (anglais)
Seneca[1] observes, that « Naked bodies, as they betray their imperfection, sot they give a full exhibition of their beauties. » Each of these effects tends to the improvement of design. Clothing on the contrary, disguises beauty, and gives a protection to faults. The Greeks[2], it is known, almost ever represented their figures naked. But the Romans, whose character was military, dressed theirs in armour. That art which challenges criticism, must always be superior to that which shuns it. We are told by Pliny[3], “That Praxiteles had made two statues of Venus, which he sold at the same time; the one clothed; which for that reason, was preferred by the people of Cos: those of Gnidus purchased that which was rejected. The reputation of these statues was widely different; for by this last Praxiteles ennobled Gnidus”. We may conceive then, that the Greeks had the same advantage over the Romans, that the naked Venus had over the clothed: this advantage holds still more strongly against the moderns; who, borrowing their characters and subjects from a chaste religion, are not only forced in decency to cloth their figures; but often, by propriety, to make that clothing of the coarsest materials. Hence it is, that we often see a saint bending under a load of drapery, and the elegant form of a nun overwhelmed in the blanketing of her order. If paint sometimes represents to us the naked body of a Christ, it is either stretched on a cross, or disfigured by sufferings; whilst the virgin-mother is hooded to the eyes, and the beauties of the Magdalen are absorbed in velvet. The result of this habit is evident, when our first artists come to design the nude; a comparison of Raphael’s figures, in the Incendio di Borgo, with the Laocoon or Gladiator, would have much the same effect, as that of a Flemish coach-horse with an Arabian courser.
- [1] Nuda corpora, vitia si qua sint, non celant, nec laudes parum ostentant. Lib. Iii. Ep. 6.
- [2] Graeca res est nihil velare ; at contra, Romana ac militaris, thoracas addere. Plin. lib. xxxiv. c. 5.
- [3] Duas fecerat Veneres Praxiteles, simulque vendebat ; alteram velata specie, quam ob id quidem praetulerunt Coi ; rejectam Gnidii emerunt : immensa differentia famae ; illo enim signo Praxiteles nobilitavit Gnidum. Lib. xxxiv. c. 5.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting, « Du dessin » (numéro Dialogue IV) , p. 50-51 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Praxitele, au rapport de Pline, « avoit fait deux statues de Venus, qu’il mit en vente dans le même tems ; l’une étoit habillée, et pour cette raison, fut préférée par les habitans de Cos, ceux de Gnide prirent l’autre. Ces deux statues firent une fortune bien différente, la dernière rendit célébre la Ville de Gnide ». Il y a lieu de croire que les Grecs ont eu sur les Romains, le même avantage que la Venus de Gnide avait sur celle de Cos ; cet avantage est bien plus grand encore par rapport aux modernes, qui, empruntant la plûpart de leurs caracteres et de leurs sujets d’une religion qui prescrit la chasteté, sont forcés non-seulement par la décence à vêtir leurs figures, mais encore par la convenance à les vêtir souvent des étoffes les plus grossieres.
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « Des progrès et des avantages réciproques de la sculpture et de l’idolâtrie, produits par l’altération et l’abandon des maximes précédentes » (numéro Première partie, chapitre septième) , p. 78 (fran)
La perfection d’une nouvelle statue favorisoit d’autant plus les progrés de l’idolâtrie, que sa célébrité devenoit quelquefois la source de nouvelles populations et de nouvelles villes, par le concours des étrangers qu’elle attiroit. C’est à son Cupidon de marbre, dit Ciceron[1], que la ville de Thespie devoit son être, témoignage que Pline cite en parlant du concours que la Vénus de Praxitelle attiroit à Gnide. La beauté de la statue, et la majesté du temple devinrent aussi la principale source de l’accroissement de la ville d’Éphese, et les sacrificateurs se trouvoient fort bien de l’erreur générale des Grecs tant ignorants que savants, qui y concouroient.
- [1] Propter eum Thespiæ visuntur, nam alia visendi causa nulla est. Verr. IV.
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « Des sculpteurs de l’Antiquité » (numéro Troisième partie, chapitre premier) , p. 407-408 (fran)
Mais parmi tous les ouvrages que nous ne faisons qu’indiquer, la Vénus Gnidienne mérite quelque détail à part. Les grâces, les proportions, l’énergie et le charme de celle de Médicis, sa conformité parfaite, en un mot, à la description que Lucien nous fait de celle de Gnide, nous mettroit à portée d’admirer encore ce prodige de la sculpture, si l’inscription[1] grecque qui accompagne celle que nous possedons ne l’attribuoit à Cléomene fils d’Apollodore d’Athènes, inscription cependant qui est regardée comme apochryphe.
Quoiqu’il en soit, la célébrité de ce chef-d’œuvre de Praxitelle étoit si grande que plusieurs entreprenoient le voyage de cette isle uniquement pour la voir. On rapporte à ce sujet une anecdote : c’est qu’ayant fait deux statues de cette Déesse, l’une voilée, l’autre nue et regardée comme impudique, les Cnidiens peu scrupuleux achetèrent la dernière comme surpassant l’autre en perfection, et ils la placèrent dans une chapelle ouverte dans toutes ses faces afin qu’on pût la voir sans empêchement de tous côtés. La nature étoit si parlante dans cette figure qu’on prétendoit qu’elle excita la passion d’un libertin, qui caché de nuit dans la chapelle y laissa des marques de sa lubricité. Pline[2] dit qu’un Cupidon du même artiste qui étoit dans la Propontide, partagea la même gloire et la même honte ; contes peut-être qui ont donné lieu à celui qu’on fait à Rome dans le même goût touchant une statue plus respectable. Ce qu’il y a de sur c’est que le Roi Nicomede offrit en vain aux Gnidiens un prix immense pour leur Vénus, car la regardant comme un monument qui faisoit la plus grande illustration de leur ville, ils auroient plutôt tout sacrifié que de la perdre.
- [1] On dispute sur le mérite de cette inscription, les uns la disant antique, les autres prétendant qu’elle est l’ouvrage d’un moderne, faite dans le temps que cette belle statue fut trouvée à Tivoli.
- [2] Par Veneri Gnidiæ in nobilitate et injuria adamavit enim eo Alchidas Rhodius atque in eo quoque simile amoris vestigium reliquit. Plin. lib. XXXVI. 5.
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « Du costume » (numéro Troisième partie, chapitre troisième) , p. 457 (fran)
- [1] Plin. lib. XXXVI
- [2] Arthemid. cap. XL. 11
II y eut cependant des Grecs qui se piquèrent de l’ancienne sévérité, surtout à l’égard des statues de femmes. Les habitants de Coos ne voulurent point acheter une statue de Vénus quoiqu’excellemment travaillée, parce qu’elle étoit nue et préférèrent celle qui étoit voilée [1]. Les Oneyrocrites disoient qu’une Vénus toute nue n’étoit bonne que pour les femmes de mauvaise vie qui demandent le prix de la beauté [2]. Toutefois le goût de la nudité des figures prévalut chez les Grecs, et presque toutes leurs Vénus qu’on voit dans les différents cabinets d’antiquités, sont sans voile ainsi que l’Hercule Farnese, l’Antinoüs, l’Hermaphrodite, et tant d’autres statues grecques. Parmi celles dans ce goût qu’on voit à Portici, il y en a une d’un jeune homme d’onze à douze ans qui doit être un portrait ; il est aussi parfait que l’Antinoüs qui est à Rome.
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « Des collections d’antiquités et des tatues faites par amour de l’étude » (numéro Deuxième partie, chapitre vingtième) , p. 381 (fran)
- [1] Cic. Verr. IV
Cicéron parle du prix immense que l’on donnoit pour certaines pieces [1]. Nicomede voulut acheter des Gnidiens la Vénus de Praxitelle pour une somme prodigieuse.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), t. II, p. 12 (fran)
Mais la première des statues non seulement de Praxitèles, mais de toute la terre, c’est sa Vénus, qui a engagé bien des gens à faire le voyage de Gnide pour la voir. Cet artiste avoit fait deux Vénus qu’il vendoit ensemble ; l’une étoit nuë, l’autre habillée. Les habitans de Cos, qui avoient le choix, préférèrent celle-ci, quoiqu’ils pussent avoir l’autre au même prix, parce qu’elle leur sembla plus chaste et plus honnête. Les Gnidiens achetèrent l’autre. La différence de leur réputation est extrême. Le roi Nicomèdes voulut acheter celle des Gnidiens, sous la promesse de payer les dettes de la ville qui étoient immenses ; mais ses habitans aimèrent mieux s’exposer à tout que de s’en défaire ; et ils eurent raison, car par cette figure Praxitèle illustra la ville de Gnide. Le petit temple où elle est placée, est ouvert de toute part, afin que la figure puisse être vuë de tous côtés : ce qui ne déplait pas, à ce qu’on croit, à la déesse ; de quelque côté qu’on la voye, on l’admire également. On dit qu’un homme épris d’amour pour cette figure, s’étant caché, en jouït pendant la nuit, et qu’une tache qui y resta, fut la marque de sa passion.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), art. « Sculpture », « Histoire de la sculpture, Seconde partie », PRAXITELE (numéro §60) , p. 357-358 (fran)
Tous les ouvrages que Pline vient de rapporter sont de bronze : il parle ailleurs de ceux de marbre. « En parlant des statuaires, dit-il, nous avons fait mention de Praxitèles qui s’est surpassé lui-même dans le marbre. Mais la première des statues, non-seulement de Praxitèles, mais de toute la terre, c’est sa Vénus qui a engagé bien des gens à entreprendre la navigation de Gnide pour la voir. Cet artiste avoit fait deux Vénus qu’il mit en vente en même temps : l’une étoit couverte d’une espèce de voile, et par cette raison, ceux de Cos, qui avoient le choix, la préférèrent, quoiqu’ils pussent avoir l’autre au même prix, croyant montrer en cela de la pudeur et des mœurs sévères : les Gnidiens achetèrent l’autre. La différence de leur réputation est extrême. Le roi Nicomède voulut dans la suite acheter celle des Gnidiens, sous la promesse de payer les dettes de la ville, qui étoient immenses ; mais les habitans aimèrent mieux s’exposer à tout que de s’en défaire, et ils eurent raison ; car, par cette figure, Praxitèle illustra la ville de Gnide. Le petit temple où elle est placée est ouvert de toutes parts, afin que la figure puisse être vue de tous côtés, ce qu’on croit ne pas déplaire à la déesse ; et, de quelque côté qu’on la voie, elle excite une égale admiration. On dit qu’un homme épris d’amour pour cette figure, s’étant caché, en jouit pendant la nuit, et qu’une tache qui y resta fut la marque de sa passion. » […]
Le même auteur fait voyager le jeune Anacharsis à Gnide : « Bientôt, lui fait-il dire, nous nous trouvames en présence de la célèbre Vénus de Praxitele. On venoit de la placer au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux portes opposées, afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts. Comment peindre la surprise du premier coup-d’œil, et les illusions qui la suivirent bientôt ? Nous prêtions nos sentimens au marbre, nous l’entendions soupirer. Deux élèves de Praxitele, venus récemment d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre, nous faisoient entrevoir des beautés dont nous ressentions les effets, sans en pénétrer la cause. Parmi les assistans, l’un disoit : Vénus a quitté l’Olympe, elle habite parmi nous. Un autre : si Junon et Minerve la voyoient maintenant, elles ne se plaindroient plus du jugement de Pâris. Un troisième : la Déesse daigna autrefois se montrer sans voile aux yeux de Pâris, d’Anchise, et d’Adonis : a-t-elle apparu de même à Praxitele ?... Oui, répondit un élève, et sous la figure de Phryné. En effet, au premier aspect, nous avions reconnu cette fameuse courtisane. Ce sont de part et d’autre les même traits, le même regard. Nos jeunes artistes y découvroient en même temps le souris enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitele, nommée Cratine. »
« C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs, prenant leurs maîtresses pour modèles, les ont exposées à la vénération publique sous les noms de différentes divinités. C’est ainsi qu’ils ont représenté la tête de Mercure d'après celle d’Alcibiade. » « Les Gnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise à la fois les intérêts de leur commerce et ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la superstition, passionnés pour les arts, il suffit d’un oracle ou d’un monument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit très-souvent qui passent les mers et viennent à Gnide contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitele. » Nous avons dit à l’article MYTHOLOGIE, en parlant de Vénus, que celle qui porte le nom de Médicis, nous offre probablement, sinon une copie, du moins une imitation de la Vénus de Gnide. On voyoit encore celle-ci à Constantinople du temps de Théodose.
Grotius, Hugo; Saumaise, Claude, Anthologia graeca cum versione latina Hugonis Grotii (XI, 2)(latin)
De effigie Veneris in Cnido
Nulli nuda Venus uisa est, puto : si tamen ulli,
Visa viro, nudam qui dedit hanc Venerem.
Commentaires : TRAD Grotius, quoi??
Grotius, Hugo; Saumaise, Claude, Anthologia graeca cum versione latina Hugonis Grotii (VII, 2)(latin)
Platonis, De effigie Veneris in Cnido
Diva Paphi Cnidiam trans æquora uenit ad urbem,
Effigiem cupiens pulchra uidere suam.
Venit ut in templum lustravitque omnia, quando est
Praxiteles nudam me speculatus? ait.
Non uidit, Venus, ille nefas quæ cernere. Sed Mars
Ferreus expressit qualem ipse Deam.
Commentaires : CHECK REFERENCE; trad. Grotius d'une épigr Platon??
Anthologie grecque, Première partie, Anthologie palatine (publi: 1928:2011) (n°164)(grecque)
[Note contexte]
Εἰς ἄγαλμα Ἀφροδίτης τῆς ἐν Κνίδῳ. Τοῦ αὐτοῦ.
Σοὶ μορφῆς ἀνέθηκα τεῆς περικαλλὲς ἄγαλμα,
Κῦπρι, τεῆς μορφῆς φέρτερον οὐδὲν ἔχων.
Commentaires : Lucien, v. 120-180
1 sous-texteAnthologie grecque, Première partie, Anthologie palatine, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Du même. A toi j’ai consacré cette image splendide de ta beauté, Cypris ; hors ta beauté je n’ai rien de plus précieux !
Commentaires : Lucien, v. 120-180, ibid., n°164
Alciphron (Αλκιφρονος), Επιστολαι εταιρκαι(trad: 1949), Φρύνη Πραχιτέλει (numéro Lettre 1, frag. 3 (Overbeck 1251)) , p. 250-252 (grecque)
... μὴδείσῃς·ἐξείργασαιγὰρπάγκαλόντιχρῆμα, οἷονἤδητίοὐδεὶς ειδεπώποτεπαντῶντῶν διὰ χειρῶνπονηθέντων,τὴνσεαυτοῦἑταίρανἱδρύσας ἐντεμένει.μέσηγὰρἕστηκαἐπὶ τῆς ἈφροδίτηςκαὶτοῦἜρωτοςἄματοῦσοῦ.μὴφθονήσῃςδέμοιτῆςτιμῆς·οἱγὰρἡμᾶςθεασάμενοιἐπαινοῦσιΠραξιτἐλη,καὶὅτιτῆςσῆςτέχνηςγέγοναοὐκἀδοξοῦσιμεΘεσπιεῖςμέσηνκεῖσθαιθεῶν.
ἒνέτιτῇδωρειᾷλείπει, ἐλθεῖνσεπρὸςἡμᾶς,ἱναἐντέτεμένειμετ'ἀλλήλων κατακλινῶμεν.οὐμιανοῦμενγὰρτοὺςθεοὺςοὓςαὐτοὶπεποιήκαμεν.ἔρρωσο.
Overbeck, Johannes, Die Antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
[Note contexte]Ne crains pas ; car tu as accompli une bien belle chose, telle qu’aucun de ceux qui travaillent de leurs mains, en installant ta maîtresse dans un sanctuaire : car je me suis tenue près d’Aphrodite avec ton Éros. Ne me refuse pas cet honneur : ceux qui nous ont regardés louent Praxitèle et puisque je suis ton œuvre, les Thespiens ne me jugeront pas indignes d’être placée au milieu des dieux.
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°161), p. 142 (grecque)
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Οὔτε σε Πραξιτέλης τεχνάσατο οὔθ’ ὁ σίδαρος·
ἀλλ’ οὕτως ἔστης ὥς ποτε κρινομένη.
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°161), p. 141 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Non, tu n’es pas une création de Praxitèle, ni de son ciseau ; mais c’est bien la pose que tu pris jadis au jour du concours[Explication : le concours de beauté jugé par Pâris.] !
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°160), p. 141 (grecque)
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Ἡ Παφίη Κυθέρεια δι’ οἴδματος ἐς Κνίδον ἦλθε,
βουλομένη κατιδεῖν εἰκόνα τὴν ἰδίην·
πάντη δ’ ἀθρησασα περισκέπτω ἐνὶ χώρῳ,
φθέγξατο· « Ποῦ γυμνὴν εἶδε με Πραξιτἐλης; »
Commentaires : av. 348 av. JC
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°160), p. 141 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Cythérée la Paphienne était venue par la mer à Cnide, désireuse de voir sa propre statue. Elle l’examina sous tous ses aspects, la place étant bien dégagée, et s’écria : « Mais où donc a-t-il pu me voir nue, Praxitèle ? »
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°159), p. 141 (grecque)
Τίς λίθον ἐψύχωσε; τίς ἐν χθονὶ Κύπριν ἐσεῖδεν;
Ἵμερον ἐν πέτρῃ τίς τόσον εἰργάσατο;
Πραξιτέλους χειρῶν ὅδε που πόνος, ἢ τάχ’Ὄλυμπος
χηρεύει Παφίης ἐς Κνίδον ἐρχομένης.
Commentaires : avant 348 av. J.-C.
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°159), p. 141 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Qui a donné une âme à la pierre ? Et qui a vu Cypris ici-bas ? Tant d’attraits dans le marbre qui les a taillés ? De la main de Praxitèle c’est là le travail…, à moins que, désertant l’Olympe, la Paphienne à Cnide soit venue !
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°162), p. 142 (grecque)
Ἁ Κύπρις τὰν Κύπριν ἐνὶ Κνίδῳ εἶπεν ἰδοῦσα·
« Φεῦ, φεῦ· ποῦ γυμνὴν εἶδέ με Πραξιτέλης; »
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°162), p. 142 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Cypris, à Cnide, vit Cypris et dit : « Oh, ciel, où m’a-t-il vue nue, Praxitèle ? »
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°166), p. 143 (grecque)
Τοῦ αὐτοῦ.
Πρόσθε μὲν Ἰδαίοισιν ἐν οὔρεσιν αὐτὸς ὁ βούτας
δέρξατο τὰν κάλλευς πρῶτ’ ἀπενεγκαμέναν·
Πραξιτέλης Κνιδίοις δὲ πανωπήεσσαν ἔθηκεν,
μάρτυρα τῆς τέχνης ψῆφον ἔχων Πάριδος.
Commentaires : vers 40 av. J.-C.-20 ap. J.-C
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°165), p. 143 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Du même. Sur les monts de l’Ida jadis, le bouvier, de ses yeux, vit celle qui gagna le prix de la beauté. Et Praxitèle à tous les Cnidiens l’a fait voir, ayant pour garant de son art le vote de Pâris.
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°165), p. 143 (grecque)
ΕΥΗΝΟΥ
Παλλὰς καὶ Κρονίδαο συνευνέτις εἶπον, ἰδοῦσαι
τὴν Κνιδίην· « Ἀδίκως τὸν Φρύγα μεμφόμεθα ».
Commentaires : vers 40 av. J.-C.-20 ap. J.-C.
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°165), p. 143 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Pallas et l’épouse de Zeus ont dit, en voyant la Cnidienne : « Nous avons tort de blâmer le Phrygien[Explication : Pâris.] ».
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°168), p. 144 (grecque)
Γυμνὴν εἶδε Πάρις με, καὶ Ἀγχίσης, καὶ Ἄδωνις·
τοὺς τρεῖς οἶδα μόνους. Πραξιτέλης δὲ πόθεν;
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°168), p. 144 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Dans ma nudité Pâris m’a vue, et Anchise et Adonis encore. Je ne sais que ces trois-là ! Mais Praxitèle, alors, où donc ?
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°163), p. 142 (grecque)
ΛΟΥΚΙΝΑΝΟΥ
Εἰς ἄγαλμα Ἀφροδίτης τῆς ἐν Κνίδῳ
Τὴν Παφίην γυμνὴν οὑδεὶς ἴδεν· εἰ δὲ τις εἶδεν,
οὖτος ὁ τὴν γυμνὴν στησάμενος Παφίην.
Commentaires : v. 120-180
1 sous-texteAnthologie grecque, Première partie, Anthologie palatine , (n°163)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
De Lucien. La Paphienne nue, personne ne l’a vue ! Mais si quelqu’un l’a jamais vue, c’est bien celui-là qui a dressé dans sa nudité la Paphienne.
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°160b), p. 141 (grecque)
Πραξιτέλης οὐκ εἶδεν ἃ μὴ θέμις· ἀλλ’ ὁ σίδηρος
ἔξεσεν οἵαν Ἄρης ἤθελε τὴν Παφίην.
Anthologie grecque, Première partie, Anthologie palatine, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Praxitèle n’a pas vu ce qu’il n’est pas permis de voir. Mais les formes que son ciseau a données à la Paphienne, Arès les eût aimées.
Commentaires : Platon (attr.), avant 348 av. J.-C., Anthologie de Planude, éd. 1980 , n°160b
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°167), p. 143-144 (grecque)
ΑΝΤΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ
Φάσεις τὰν μὲν Κύπριν ἀνὰ κραναὰν Κνίδον ἀθρῶν·
« Ἅδε που ὡς φλέξει καὶ λίθος εὖσα λίθον· »
τὸν δ’ ἐνὶ Θεσπιάδαις γλυκὺν Ἵμερον οὐχ ὅτι πέτρον
ἀλλ’ ὅτι κἠν ψυχρῷ πῦρ ἀδάμαντι βαλεῖ.
Τοίους Πραξιτέλης κάμε δαίμονας, ἄλλον ἐπ’ ἄλλας
γᾶς, ἵνα μὴ δισσῷ πάντα θέροιτο πυρί.
Commentaires : IIe siècle av. J.-C.
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°167), p. 143-144 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Tu diras en regardant la Cypris de Cnide la rocheuse : « Celle-ci, tout marbre qu’elle soit, un jour enflammera le marbre », et du tendre Amour de Thespies « il fera flamber plus que la pierre et portera le feu au cœur de l’acier froid ». Tels sont les dieux que fit Praxitèle, un là-bas, l’autre ici : deux foyers ensemble auraient tout embrasé !
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980), n°170 (grecque)
ΕΡΜΟΔΩΡΟΥ
Τὰν Κνιδίαν Κυθέρειαν ἰδών, ξένε, τοῦτό κεν εἴποις·
« Αὐτὰ καὶ θνατῶν ἄρχε καὶ ἀθανάτων. »
Τὰν δ’ἐνὶ Κερκοπίδαις δορυθαρσέα Παλλάδα λεύσσων,
αὐδάσεις· « Ὄντως βουκόλος ἦν ὁ Πάρις. »
Commentaires : v. 150 av. J.-C.
1 sous-texteAnthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°170), p. 144 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
En voyant la Cythérée de Cnide, étranger, tu pourrais dire : « Sois donc la reine et des dieux et des hommes ! » Mais en regardant chez les fils de Cécrops Pallas à la lance sans peur, tu t’écrieras : « un vrai bouvier, ce Pâris ! »
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII(trad: 1980) (n°169), p. 144 (grecque)
Ἀφρογενοῦς Παφίης ζάθεον περιδέρκεο κάλλος
καὶ λέξεις· « Αἰνῶ τὸν Φρύγα τῆς κρίσεως. »
Ἀτθίδα δερκόμενος πάλι Παλλάδα, τοῦτο βοήσεις·
« Ὡς βούτης ὁ Πάρις τήνδε παρετρόχασεν. »
Anthologie grecque. Deuxième partie. Anthologie de Planude, t. XIII, (trad: 1980) (n°169), p. 144 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
De la Paphienne née de l’écume contemple la beauté divine ! Tu diras alors : « Bravo ! Phrygien, tu fus bon juge ! » Porte maintenant tes regards sur la Pallas d’Athènes et tu t’écrieras : « Quel bouvier ce Pâris ! Il passa près d’elle sans la voir ! »