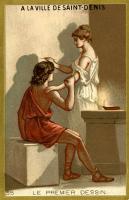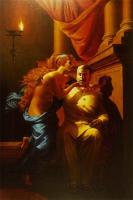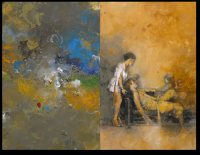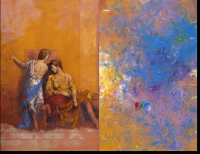Dibutade et la jeune fille de Corinthe
Bibliographie
Images
Dibutade dessinant à la lueur d’une lampe le portrait de son amant, ou l’Invention du dessin LEVRAC-TOURNIÈRES Robert
Medium : huile sur bois
Commentaires : morceau de réception à l’Académie en 1716
L'invention de la peinture, d’après Charles Le Brun LE BRUN Charles CHAUVEAU François
Medium : gravure
Dibutade faisant le portrait de son amant ou L’invention de la peinture RAOUX Jean
Medium : huile sur toile
L’ Origine de la Peinture RUNCIMAN Alexander
Medium : dessin
Pas de fichier image pour cette oeuvre
L’Origine de la Peinture : une famille dessinant des ombres chinoises Schenau Ou Schönau ( ZEISSIG Johann Eleazar)
Medium : huile sur toile
Commentaires : signé et daté « Schenau.pinxit.ug. 17.3 »
L’Origine de la peinture ou les portraits à la mode, d’après Schenau OUVRIER Jean Schenau Ou Schönau ( ZEISSIG Johann Eleazar)
Medium : gravure
La fille de Dibutades dessinant le profil de son amant CACAULT Pierre René
Medium : plume et lavis sur papier
Commentaires : signé au verso
La Fille de Butades de Sicyone dessinant le profil de son amant Marià Fortuny (FORTUNY I MARSAL Marià Josep Bernat )
Medium : dessin au lavis
Restout, Jacques, La Réforme de la peinture(publi: 1681), p. 106-107 (fran)
Il me dit donc, qu’au premier âge du monde elle avoir déjà eu quelques commencemens, aussi bien que la sculpture dans la famille de Lamech ; mais que son progrez fut interrompu par le Deluge, dans lequel les arts que les hommes avoient commencé d’exercer, furent presque tout à fait perdus avec leurs auteurs. Toutesfois la memoire sen estant conservée dans la famille de Noë, ses descendans recommencerent à les chercher, et les trouverent peu à peu par leur travail et la subtilité de leur esprit.
Entre les autres, l’invention de la peinture fut telle : un jeune homme des descendans de Sem voyant une jeune fille qu’il aimoit uniquement, fut sur le point de faire un voyage de quelques mois, après mille témoignages d’une affection tres-tendre, et mille protestations d’une constance inébranlable de part et d’autre, prevoyant bien l’ennui que lui devoit causer l’absence d’une personne si chere, s’avisa d’une chose que son amour lui inspira sur le champ, pour leur mutuelle consolation : car remarquant que le soleil qui se levoit alors, frapoit directement un mur proche lequel ils estoient, et qu’ainsi l’ombre des corps marquant justement leurs contours, en representoit la figure, il fist approcher son amante, et la faisant tourner de profil au soleil, traça sur le mur d’un crayon tel que l’occasion lui pût fournir, le contour de ce visage qu’il avoit tant de peine à perre de vûë ; puisqu’il faut, dit-il, que je sois privé quelque temps de votre presence, j’auray au moins ce crayon devant les yeux, pour adoucir la peine d’une absence qui ne me peut estre que tres-fâcheuse. Après l’amante en fist autant sur un voile qu’elle emporta, et ainsi commença le dessein ; ce qui donna occasion à d’autres de représenter d’autres corps dont ils faisoient seulement les contours. Peu à peu quelques-uns voulurent adjoûter, et remplirent les contours d’une seule couleur, ensuite on disingua les couleurs selon la nature des choses que l’on representoit, après on forma les dedans ; enfin, la peinture vint peu à peu au gré, où vous sçavez que les anciens peintres l’éleverent.
Ainsi de la sculpture, car quelques-uns se mîrent à faire de cire et de terre ce que les autres faisoient avec leurs lignes ; peu après ils taillerent la pierre, les marbres, et fondirent les metaux pour en faire des statuës, et tout ce que la peinture faisoit avec ses couleurs.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (151)(fran)
Fingere ex argilla similitudines Butades Sicyonius figulus primus inuenit Corinthi filiae opera, quae capta amore iuuenis, abeunte illo peregre, umbram ex facie eius ad lucernam in pariete lineis circumscripsit, quibus pater eius inpressa argilla typum fecit et cum ceteris fictilibus induratum igni proposuit, eumque seruatum in Nymphaeo, donec Mummius Corinthum euerterit, tradunt.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (151)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l’art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile sur l’esquisse, en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher.
Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 243r (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Questa arte trovo in Corintho Dibutade Sycionio maxime per opera della figluola laquale presa dall’amore d’uno giovane volendo lui ire in altri paesi con la lucerna fece l’ombra dela sua persona apparire nel muro e poi con linee la termino nellequali ponendo el padre suo la terra ne fece una forma e dipoi secca la messe a chuocere coglaltri vasi e questa dicono che fu conservata in Nympheo insino che Corintho fu disfacta da Mumio.
Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 1000 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Dibutade Sicyonio vasellaio, fu il primo che trovò tale arte in Corintho per le opere della figliuola, laquale presa dallo amore di uno giovane, ilquale dovendo andare in pellegrinaggio, circunscrisse l’ombra della faccia sua alla lucerna nel muro con le linee, per lequali il padre suo, imprimendovi la terra fece la forma. Et dipoi seccata con gli altri vasi la messe à cuocere al fuoco. Et questa dicano, che fu conservata in Nympheo, infino a che Mummio rovino Corintho.
Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1111 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Dibutade Sicionio stovigliano fu il primo che trovò questa arte in Corintho, et massimamente per opera della sua figliuola, laquale essendo innamorata d’un giovane, et volendo egli ire in lontan paese, con la lucerna disegnò l’ombra della sua persona sul muro, et poi con linee la terminò, nellequali linee mettendo il padre suo la terra, ne fece una forma, et poiche l’hebbe secca, la mise a cuocere con gli altri vasi, et questa dicono, che fu conservata in Ninfeo, finche Mummio disfece Corintho.
Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 967-968 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Apres avoir monstré l’estat de l’art de peinture, sera bon de mettre l’art de potterie apres. Et pour venir à son origine, on dit que Debutades, pottier de terre de Sycion, fut le premier qui se mit à former image, de la terre mesme dont il faisoit ses pots, et ce par le moyen d’une fille qu’il avoit : laquelle estant amoureuse d’un jeune homme, charbonna à l’ombre de la chandelle, contre la muraille, le pourfil du visage de son amoureux, pour le contempler tousjours en son absence. Quoy voyant son pere, suyvit les dits traits, emplastrant d’argile la muraille, selon le pourfil des traits que dessus : et voyant qu’il y avoit quelque forme en sa besongne, il la mit cuire avec la fournee des pots. Et dit-on, qu’il mit ceste teste es estuves de Corinthe, où elle demeura jusques à ce que Mummius rasa la dite ville.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, (vol. 11), p. 297-305 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Cet art doit sa premiere invention à Dibutade, potier de terre sicyonien établi à Corinthe ; graces toutefois à sa fille[1] : car celle-ci, étant amoureuse d’un jeune homme qui partoit pour un long voyage, traça le pourtour de l’ombre profil de son amant sur la muraille, à la lueur d’une lampe. Son pere, sur ce même dessein, plaqua de l’argile, exécutant cette image en relief, sur le dessein tracé ; puis mettant ensuite cette argille à durcir au four avec ses autres poteries, il eut ainsi le premier type en terre cuite. On veut que ce premier type ait été gardé à Corinthe dans le temple des Nymphes, jusqu’au tems où Mummius prit et démolit cette ville.
- [1] [1] Je trouve quatre vers mis au bas d’un portrait gravé, lesquels prouvent que leur auteur, homme ou femme, a pris le nom propre Dibutade pour la fille de l’artiste de ce nom. Ces vers sont d’ailleurs assez bien tournés, et dictés par le sentiment. Les voici :
Dibutade peignit ; son maître fut l’Amour,
Et son amant fut son modele :
L’amitié triomphe à son tour ;
Elle a fait ce portrait fidele.
Athénagoras d’Athènes, Πρεσβεια περι Χριστιανων (redac: (176):(177), trad: 1992), [Les dieux des cités ne sont que des créatures matérielles récentes; invention du nom des dieux; bref historique du développement des arts plastiques] (numéro XVII, 3) , p. 124 (grecque)
Αἱ δ’εἰκόνες μέχρι μήπω πλαστικὴ καὶ γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιητικὴ ἦσαν, οὐδὲ ἐνομίζοντο· Σαυρίου δὲ τοῦ Σαμίου καὶ Κράτωνος τοῦ Σικυωνίου καὶ Κλεάνθους τοῦ Κορινθίου καὶ κόρης Κορινθίας ἐπιγενομένων καὶ σκιαγραφίας μὲν εὑρεθείσης ὑπὸ Σαυρίου ἵππον ἐν ἡλίῳ περιγράψαντος, γραφικῆς δὲ ὑπὸ Κράτωνος ἐν πίνακι λελευκωμένῳ σκιὰς ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἐναλείψαντος, — ἀπὸ δὲ τῆς κόρης ἡ κοροπλαθικὴ εὑρέθη (ἐρωτικῶς γάρ τινος ἔχουσα περιέγραψεν αὐτοῦ κοιμωμένου ἐν τοίχῳ τὴν σκιάν, εἶθ´ ὁ πατὴρ ἡσθεὶς ἀπαραλλάκτῳ οὔσῃ τῇ ὁμοιότητι— κέραμον δὲ εἰργάζετο — ἀναγλύψας τὴν περιγραφὴν πηλῷ προσανεπλήρωσεν· ὁ τύπος ἔτι καὶ νῦν ἐν Κορίνθῳ σῴζεται).
Athénagoras d’Athènes, Πρεσβεια περι Χριστιανων , (trad: 1992) (XVII, 3)(trad: "Supplique au sujet des chrétiens " par Pouderon, Bernard en 1992)(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Quant aux images des dieux, aussi longtemps que n'existèrent ni la plastique, ni la peinture, ni la sculpture, elles n'étaient même pas en usage; puis vient le temps de Saurias de Samos, de Craton de Sicyone, de Cléanthe de Corinthe et de la jeune Corinthienne; la reproduction par ombre portée fut découverte par Saurias, tandis qu'il dessinait un cheval au soleil; la peinture, par Craton qui colora les silhouettes d'un homme et d'une femme sur une planche préalablement blanchie; quant au modelage de figurines, il fut découvert grâce à la jeune Corinthienne: en effet, tombée amoureuse d'un jeune homme, elle avait reproduit son ombre sur un mur tandis qu'il dormait; alors son père, émerveillé par la ressemblance, qui était parfaite — il était potier —, modela en relief la silhouette en en comblant les contours avec de l'argile; la figure est conservée encore à ce jour à Corinthe.
Commentaires :
Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 53-54 (italien)
Il primo fu Buzaide Sicino di Corintio, secondo Prinio, il quale Buzaide trovò la figluola inamorata d’uno giovane il quale partendosi da essa, esso andante di fuori, ella all’ombra della lucerna lineò nel muro la faccia sua tanto perfectamente che ·lla effigie d’esso giovane era maravigliosa. Veggendo lo’ ngegno delle linee circundate, el padre tolse creta e fecie la faccia del giovane in modo tale che parea essa testa la sua propria; la quale testa stette nel Ninfeo di Corinto infino a tanto che Llumio disfece Corintio; in quello tempo non si usava l’arte statuaria se non di creta e gesso.
Gaurico, Pomponio, De sculptura(publi: 1504), « De claris sculptoribus » (numéro ch. VIII) , p. 249 (latin)
Harum autem originem sane quondam olim de Aegyptio Sacerdote Solon acceperit, nobis quidem semper puellulis non licet. Plasticen tamen ipsam Chaldaeus Moses antiquissimam est testatus, haud equidem inepte, cuius author deus ipse primus extiterit, neque uero aliter uideri debet, quam optimum eum fuisse Plastam, qui hos tam admirabiliter mundos ita formauit. Tanta uero plastices huius authoritas, ut eam nonnulli Sculpturae matrem appellarint. Fertur et a Dibutade Sicyonio Corynthi adinuenta, deamantis filiolae beneficio.
Gaurico, Pomponio, De sculptura, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
L’origine de ces genres, Solon l’a sans doute apprise jadis d’un prête égyptien ; pour nous, qui sommes toujours de petits enfants, ce savoir est interdit. Cependant, Moïse le Chaldéen a affirmé que le modelage était le genre le plus ancien ; et non sans raison, car Dieu lui-même fut son premier inventeur. On ne peut qu’en effet reconnaître qu’il a dû être le meilleur modeleur, lui qui a si admirablement formé ces mondes. L’importance de cette discipline est telle, que certains l’ont appelée mère de la sculpture. On dit aussi qu’elle a été inventée à Corinthe par Butade de Sicyone, pour sa fille amoureuse.
Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 4 (italien)
Il fare di terra fiure, dallj antichj chiamato plastice, ne fu il primo inventore Dibutade Sicionio (Butades), che lauoraua vasj di terra et altre cose in Corintho, per cagione della figluola, laquale era d’une giouane innamorata; et hauendo esso a partirsj per altrj paesi, ella auantj che si partissi, fece con la lucerna apparire nel muro l’ombra della persona sua et dipoi l’ando con linee circuendo et terminando, nelle qualj dipoi il padre Dibutade pose la terra et ne fece una forma, et dipoi seccha, con altrjvasj di terra la messe a quocere; et fu conseruata tal forma, sino che Corintho fu disfatta.
Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 149 (italien)
Dicono il primo inventore[Explication : della plastice.] essere stato Dibutade sicionio che, avendo la figliuola contornato un giovane nel muro a l’ombra, lui la fece di terra argilla et cottola la messe guora con l’altre stoviglie, et che per questo la fu serbata nel ninfeo fino a quel tempo che Mummio spianò Corinto.
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567) (t. I), p. 204-205 (italien)
Il primo che si dice aver ritratto di terra fu Dibutade Sicionio, che faceva le pentole in Corinto, e ciò per opera d’una sua figliuola, la quale, essendo innamorata d’un giovane che da lei si doveva partire, si dice che a lume di lucerna con alcune linee aveva dipinta l’ombra della faccia di colui cui ella amava, dentro alla quale poi il padre, essendoli piaciuto il fatto et il disegno della figliuola, di terra ne ritrasse l’imagine, rilevandola alquanto dal muro ; e questa figura poi asciutta, con altri suoi lavori, mise nella fornace. E dicono che la fu consecrata al tempio delle Ninfe, e che ella durò poi insino al tempo che Mummio consolo romano disfece Corinto.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 254-255 (italien)
- [1] Il far di terra quando fu trovato.
[1] Ma lasciando da parte quello che per la lunghezza del tempo non si può ritrovare; dico, che l’arte del far di terra, tenuta da molti la madre della scultura, fu secondo alcuni primieramente ritrovata in Corinto da Dibutade Sicionio facitor di vasi, consciosia che, essendo una sua figliuola innamorata d’un giovane, il quale dovea per suoi affari allontanarsi da lei, ella al lume della lucerna dintornando con linee l’ombra del suo viso, facesse di quello nel muro apparire il disegno, la qual opera il padre di lei considerando e piacendole molto, vi mise dentro della terra e ne formò una testa, e poi che fu secca la mise à cuocere nella fornace con gli altri suoi vasi e questa, si dice, che poi fu consacrata nel tempio delle Ninfe, dove si vide appesa fin che Mummio consolo Romano disfece Corinto.
Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « Voor-reden, op het Leven der oude Antijcke Doorluchtighe Schilders, soo wel Griecken als Romeynen », fol. 61v (n)
Plinius ooc in zijn gemelde 35e. Boeck, Cap. 12. verhaelt van de dochter van een Potbacker, Deburates, welcke verlieft op eenen Iongeling, trock metter kole den pourfijl van zijn tronie, die van t’keerslicht schadude op eenen muer, om hem altijts voor oogen en in haer gedacht te hebben, waer op den Vader de eerste tronie soude van aerde verheven gemaect en gebacken hebben: waerom de Teycken-const de voor-geboorte tegen t’Beelt-snijden haer te roemen soude hebben.
Felici, Ettore, Tractatus desideratissimus de communione seu societate, deque lucro item ac quaestu, damno itidem ac expensis, primum in Germania ab Angelo Felicio factus: omnibus tum in scholis tum in foro versantibus utilis ac necessarius : Accessit demum index rerum, verborum ac materiarum locuplentissimus(publi: 1606) (caput VII, "De his, qui contrahere prohibentur ex defectu naturalis sanitatis", §13-14)(latin)
Et ex amore, quo ducimur ad vitam activam, consistente in videndis atque conversandi oblectatione, prædicta etiam de amore voluptuoso dici non possunt. Quinimo affirmandum est, amorem istum inter homines amicitias indissolubiles, societatesque frequentes parere, hominibus omnibusque viventibus pacem et cubile securum elargiri. Dicitur bonorum studiosus, malorum spretor, in labore, in timore, in desiderio, in sermone gubernator, perfectus adiutor, servatorque præcipuus. Cum primum amor iste afflaverit ruditas ab hominibus removetur, et isto amore duce virtutes omnes cognitæ, et artes liberales inventæ fuerunt, et exercentur, Platon in convi. in 2. orat.
Et me legisse recordor, picturam et sculpturam a muliere quadam virum suum amante inventas fuisse. Etenim mulier quædam in civitate Corinthi, quæ amati viri ad bellum proficiscentis imaginem in sui absentia semper præ oculis retinere cupiebat, quemadmodum in corde indelebiliter sculptam conservabat, dum viri facies apposita ad lucernæ lumen umbram in muro reddebat, accepto carbone leviter, quasi tenui designatæ partes, et si chari et amati viri imaginem designavit et pinxit, qua visa, eius pater, qui figulus erat, accepto luto, levi manu ad imaginis similitudinem statuam fecit, et eam coxit in fornaci cum suis vasibus, et ita cæteri postea ex imagine illa pingere,et ex illa statua fingere didicerunt.
Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte prima » (numéro Diceria I) , fol. 5v (italien)
- [1] Hect. Falic. trac. I. de societ.
Bella certo (se [1] debbo credere a chi ne scrive) fù la prima origine della Pittura, di cui sovviemmi haver letto, che l’inventore fù Amore; percioche licentiandosi dalla sua donna un’amante nell’ultima notte de’suoi trastulli per andar lontano, e volendo di sé lasciarle qualche ricordo, disegnò la sua effigie rozamente nel muro, contornata su l’ombra del proprio corpo al reflesso della candela. Et così fece il nostro celeste Vago, che in quell’estremo, e doloroso commiato non volse da noi allontanarsi senza lasciare in pittura alla nostra memoria una dolce rimembranza da se stesso. Pittura non rozza, ma perfetta; fatta all’ombra notturna d’una morte horribile, e tenebrosa, ma formata al lume ardente della sua infinita sapienza, e della sua sviscerata carità, là dove gli strali d’Amore fecero ufficio di pennelli, poich’altro ch’amorose saette non furono già que’ santissimi chiodi, che lo trafissero in croce.
Boulenger, Julius Cæsar, De pictura, plastice, statuaria, libri duo(publi: 1627) (I, 19), p. 69-70 (latin)
Plasticen Dibutades Sicyonius figulus primus inuenit, Corinthi filiae opera, quae capta amore iuuenis, illo abeunte peregre vmbram ex facie eius ad lucernam lineis circumscripsit, quibus pater eius impressa argilla typum fecit, et cum caeteris fictilibus induratum igni proposuit. Sunt qui in Samo primos omnium plasticen inuenisse Rhoecum, et Theodorum tradant, multo ante Battiadas Corintho pulsos. Dibutadis inuentum est rubricam addere, aut ex rubrica cretam fingere, primusque personas tegularum extremis imbricibus imposuit, quae inter initia prototypa vocauit, postea idem ectypa fecit. Aelianus, lib. 14 cap. 37.
Renaudot, Théophraste, Cinquante-huitiesme Conference du mercredy 27. Dec. 1634, dans Seconde Centurie des Questions traitées ez Conferences du Bureau, depuis le 3 novembre 1634. Jusques à l'11 fevrier 1636(publi: 1636), p. 146 (fran)
Et comme si le desir de se representer estoit naturel à toutes choses, il n’y a point de corps qui ne produise incessamment son image : laquelle voltige et flotte dans l’air, tant qu’elle ait rencontré quelque corps solide et poli pour former son tableau, tel qu’est celui qui se void dans les miroirs et dans l’eau claire, beaucoup plus parfait que ceux que l’art forme avec le pinceau : voire mesme que leurs originaux, de la matiere corporelle desquels ils sont entierement dépoüillez. Et comme les commencemens de tous les arts sont grossiers, celui de la peinture s’attribuë à la fille de Belus, qui voyant l’ombre de son pere contre une muraille la contretira d’un charbon. Car la pourtraiture inventée par Philocles Egyptien, a precedé la peinture, inventée par Gyges Lydien en Egypte, selon Pline : ou par Pyrrhus cousin de Dedale, selon Aristote.
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (I, 2), t. I, p. 31 (espagnol)
Pero todos concuerdan (dice Plinio) en que fué primeramente imitada de la sombra del hombre. Y es conforme a la opinión de Atenágoras, aunque difiere en los inventores. La adumbración, dice, inventó Surias, sámio, cubriendo o manchando la sombra de un caballo, mirado a la luz del sol. La pintura (esto es los perfiles) inventó Craton, lineando en una blanca tabla la sombra de un hombre y de una mujer, con diferencia y distinción. Y la coroplástica (que est l’arte del vaciar) inventó Cora y su padre Dibutades, sicyonio. Esta, amando un mancebo y habiéndose de partir, la noche antes dibuxó la sombra que causaba dél la luz del candil en la pared, y su padre labrando en fondo dentro de aquellas lineas, hinchó el espacio de barro, y salió una figura que despues coció.
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (II, 8, 6), p. 140 (anglais)
Yea, the first beginning of these arts seem to have proceeded out of a desire of prolonging the memory of the deceased, or else of them whose absence would be most grievous unto us without such a remembrance. See what Fulgentius reporteth of the Ægyptian Syrophanes. A Corinthian maid also, taught by Love, ventured to put her unskilfull hand to the first beginnings of art, drawing lines about the shadow of her lover that was to go a great journey. Whereupon (as it is the custome of men to prosecute small beginnings with a stedfast study) her father Dibutades, a potter by his trade, cut out the space comprised within the lines, and filling it with clay, he made a pattern and hardened it in the fire, profering to Greece the first rudiments of picture and statuary.
Ridolfi, Carlo, Le meraviglie dell’arte, overo le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato(publi: 1648), p. 4 (italien)
- [1] Leon Battista Alberti lib. I della Pittura. Celio Rodigino, et altri
- [2] Questa fù figliuola di Dibutade Stovigliaio facitor de’ vasi di Creta.
Ma discoriamo del modo dell’inventione. Alcuni dissero [1], che si apparasse il disegno da alcune imperfette figure, che si veggono tal’hora ne’ marmi dalla natura impresse, altri dalle nubi, e fù chi scrisse, che fosse originato per virtù d’Amore, che somministrasse nella mente d’una fanciulla [2] tale sottigliezza di formar con linee il volto dell’amante, che da lei allontanar dovevasi, dall’ombra, che vide di quello impressa nel muro mediante il lume della lucerna, conservando in quella guisa la di lui memoria.
Saint-Jean, Léon de, Le Portrait de la sagesse universelle, avec l’idée générale des sciances (sic) ; et leur plan representé en Cent Tables, chapitre LIII, « La peinture »(publi: 1655), « La peinture » (numéro chapitre LIII) , p. 331 (fran)
D’où il s’ensuît par une riche observation, que le dessein est sans doute la première peinture ; attribuée à la fille de Belus, qui voyant l’ombre de son pere contre une muraille, la porfila et contretira avec un charbon. Son example a donné occasion d’imiter la Nature, premierement avec le simple trait. Puis l’on y a ajoûté le blanc, et le noir. Ensuite l’on s’est étudié à placer les lumieres, qui ont formé le relief. Enfin l’experiance, l’étude et l’imitation ont ajoûté les autres couleurs et embellisemans.
[Félibien, André], De l’origine de la peinture et des plus excellens peintres de l’Antiquité(publi: 1660), p. 19 (fran)
Mais comme la Peinture est asseurément fort ancienne, il est difficile de bien connoistre son origine. Pour moy je ne doute pas qu’elle ne soit née avec la Sculpture, et que le mesme esprit qui enseigna aux hommes à former des images de terre ou de bois, ne leur apprist aussi en mesme temps à tracer des figures sur la terre ou contre les murailles.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Ier Entretien), p. 60-61 (fran)
Et c’est par là, ce me semble, qu’on peut juger que l’invention de la peinture est tres-ancienne ; mais je ne vous puis pas dire qui en a esté l’auteur. Ie croy mesme qu’il seroit assez inutile d’en vouloir faire la recherche, puisque nous voyons que tous les Anciens qui en ont écrit sont de differente opinion. Neanmoins, repartit Pymandre, les Egyptiens qui ont des premiers possedé les arts et les sciences, disent que la peinture estoit chez eux plusieurs siecles avant qu’elle fust connuë des Grecs. Oüy, luy repliquai-je, mais les Grecs qui n’ont jamais manqué de s’attribuer autant qu’ils ont pû la gloire des sciences et des arts, écrivent aussi que ce fut à Sicyone ou à Corinthe, que la peinture commença de paroistre. Mais à vous dire vray, les uns et les autres s’accordent si peu touchant celuy qui en fut l’inventeur, que l’on ne sçauroit qu’en croire : ils conviennent tous seulement que le premier qui s’avisa de desseigner, fit son coup d’essay contre une muraille en traçant l’ombre d’un homme que la lumiere faisoit paroistre. Et pour donner plus de beauté à cette histoire, il y en a qui ont écrit que l’Amour qui en effet est le grand maistre des inventions, fut celuy qui trouva celle-cy, et qui apprit à une jeune fille le secret de desseigner en luy faisant marquer l’ombre du visage de son amant, afin d’avoir une copie des traits de la personne qu’elle cherissoit. Cependant nous ignorons le nom de celuy qui reduisit cette invention en pratique, et en fit un art qui est depuis devenu si noble et si excellent. Les uns veulent que ç’ait esté un Philocles d’Egypte ; les autres un certain Cleante de Corinthe ; et d’autres qu’Ardice Corinthien et Telephanes de Chiarenia au Péloponnèse, ayent commencé à desseigner sans couleurs et avec du charbon seulement ; et que le premier qui se servit d’une couleur pour peindre, ait esté un Cléophante de Corinthe, qui pour cela fut surnommé MONOCROMATOS.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666) (Ier Entretien), p. 57-58 (fran)
Comme tous les arts ont esté fort grossiers et fort rudes dans leur naissance, et ne se sont perfectionnez que peu à peu, et par une grande application ; il ne faut pas douter que celuy de la peinture aussi bien que tous les autres n’ait eu un commencement tres-foible, et ne se soit augmenté que dans la suite des temps. Mais comme la peinture est assurément fort ancienne, il est difficile de bien connoistre son origine. Pour moy je ne doute pas qu’elle ne soit née avec la sculpture, et que le mesme esprit qui enseigna aux hommes à former des images de terre ou de bois, ne leur apprit aussi en mesme-temps à tracer des figures sur la terre ou contre les murailles.
Bosse, Abraham, Lettres écrites au Sr Bosse, graveur, avec ses reponses sur quelques nouveaux traittez concernant la perspective et la peinture(publi: 1668), « Réponse du sieur Bosse à la lettre de Monsieur du Boccage », p. 8 (fran)
Pour l’estampe de la bergere qui trace le profil du visage de son amant contre un mur, ce que vous en avez dit dans vostre lettre est tres-vray, et mesme j’ay eu la curiosité d’en faire un dessein tel qu’il faudroit qu’il fust, car le bras de cette bergere, doit avoir plus de cinq à six pieds de long pour atteindre à ce mur suivant la situation d’icelle, et outre que l’ombrage que fait la table sur le plancher est du double plus petit qu’il ne faut, elle n’en fait point contre ce mur, bien qu’elle y touche, ny la lampe aussi, et toutefois il doit y en avoir une tres-grande. Le profil du berger contre l’autre mur opposé est faux, puisqu’il n’est plus grand que celuy du naturel, ce qui seroit bon à une clarté du soleil, mais à celuy d’une lampe il doit estre extraordinairement plus grand sans comparaison. Il y a encore d’autres fautes que je ne vous dis point, jugeant que vous avez pû les remarquer.
Bosse, Abraham, Lettres écrites au Sr Bosse, graveur, avec ses reponses sur quelques nouveaux traittez concernant la perspective et la peinture(publi: 1668), « Copie de la lettre dudit du Boccage, envoyée à Messieurs les peintres et sculpteurs de l’Académie », p. 5 (fran)
J’ay veu aussi dans l’une des estampes d’un de ces livres[Explication : le frontispice de Le Brun et Chauveau pour La Peinture de Perrault.], qu’une bergere y a tracé à faux contre un mur à la lumiere d’une lampe, le portrait de son amant ; et que l’on y a ce me semble negligé les veritables regles, tant à la situation de ses objets qu’à leur proportion ; de plus, que les places de leurs jours, ombres et ombrages, y sont tellement mises à faux, qu’en des endroits l’erreur s’y voit de plus de trois pieds ; et mesme sur de ces objets, il y a du jour où il faut de l’ombre, et en d’autres de l’ombre où il faut du jour.
Perrault, Charles, La Peinture, poëme(publi: 1668), p. 236-238 (fran)
Quelques profanes voix ont dit que le hasard
Aux premiers des mortels enseigna ce bel art,
Et que quelques couleurs, bizarrement placées,
Leur en ont inspiré les premières pensées ;
Mais qu’ils sachent qu’Amour, le plus puissant des dieux,
Le premier aux humains fit ce don précieux ;
Qu’à sa main libérale en appartient la gloire,
Et pour n’en plus douter, qu’ils en sachent l’histoire.
Dans l’île de Paphos fut un jeune étranger,
Qui vivait inconnu, sous l’habit d’un berger ;
La nature avec joie, et d’un soin favorable,
Amassant en lui seul tout ce qui rend aimable,
Avec tant d’agrément avait su le former,
Que ce fut même chose et le voir et l’aimer.
Des eaux et des forêts les nymphes les plus fières,
Sans attendre ses vœux, parlèrent les premières ;
Mais son cœur, insensible à leurs tendres désirs,
Loin de les écouter, méprisa leurs soupirs.
Entre mille beautés, qui rendirent les armes,
Une jeune bergère eut pour lui mille charmes,
Et de ses doux appas lui captivant le cœur,
Eut l’extrême plaisir de plaire à son vainqueur ;
L’aise qu’elle sentit d’aimer et d’être aimée,
Accrut encor l’ardeur de son âme enflammée.
Soit que l’astre des cieux vienne allumer le jour,
Soit que, dans l’Océan, il finisse son tour,
Il la voit, de l’esprit et des yeux attachée
Sur le charmant objet dont son âme est touchée ;
Et la nuit, quand des cieux elle vient s’emparer,
Sans un mortel effort ne l’en peut séparer.
Pour la seconde fois, la frileuse hirondelle
Annonçait le retour de la saison nouvelle,
Lorsque, de son bonheur le destin envieux
Voulut que son berger s’éloignât de ces lieux.
La nuit qui précéda cette absence cruelle,
Il veut voir sa bergère, et prendre congé d’elle,
Se plaindre des rigueurs de son malheureux sort,
Et de ce dur départ, plus cruel que la mort.
Elle, pâle, abattue, et de larmes baignée,
Déplore en soupirant sa triste destinée ;
Et, songeant au plaisir qu’elle goûte à le voir,
Ne voit, dans l’avenir, qu’horreur et désespoir.
Amour, qui sais ma flamme et les maux que j’endure,
N’auras-tu point pitié de ma triste aventure ?
Je ne demande pas la fin de mon tourment ;
Mais, hélas ! donne-moi quelque soulagement.
Sur l’aile des soupirs sa prière portée,
Du tout-puissant amour ne fut point rejetée.
Sur le mur opposé, la lampe, en ce moment,
Marquait du beau garçon le visage charmant ;
L’éblouissant rayon de sa vive lumière,
Serrant de toutes parts l’ombre épaisse et grossière
Dans le juste contour d’un trait clair et subtil,
En avait nettement dessiné le profil.
Surprise, elle aperçoit l’image figurée,
Et, se sentant alors par l’amour inspirée,
D’un pinceau, par hasard, sous ses doigts rencontré,
Sa main, qui suit le trait par la lampe montré,
Arrête sur le mur, promptement et sans peine,
Du visage chéri la figure incertaine ;
L’Amour ingénieux, qui forma ce dessein,
Fut vu, dans ce moment, lui conduisant la main.
Sur la face du mur marqué de cette trace,
Chacun du beau berger connut l’air et la grâce,
Et l’effet merveilleux de cet événement
Fut d’un art si divin l’heureux commencement.
Par la nymphe aux cent voix la charmante Peinture,
Instruite du succès d’une telle aventure,
Vint apprendre aux mortels mille secrets nouveaux,
Et leur montra si bien comment, dans les tableaux,
Les diverses couleurs doivent être arrangées,
Ensuite, au gré du jour, plus ou moins ombragées ;
Comment il faut toucher les contours et le trait,
Et tout ce qui peut rendre un ouvrage parfait ;
Qu’enfin l’art est monté, par l’étude et l’exemple,
À ce degré suprême où notre œil le contemple,
Digne de la grandeur du roi que nous servons,
Digne de la splendeur du siècle où nous vivons.
Lamoignon de Basville, Nicolas de, "Plaidoyer pour le sieur Gérard Van Opstal", lu le 4 février 1668 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1668/02/04) (I, 1), p. 213 (fran)
Ainsi, Messieurs, en défendant la cause de ma partie, je ne ferai point de différence entre le nom de sculpteur et celui de peintre, puisque pour être parfait dans l’une de ces professions, il faut les entendre toutes les deux. Pline, qui en a curieusement recherché toutes les particularités, écrit que les fables en ont donné la gloire à Prométhée et qu’elle fit partie de ce larcin qu’il commit dans le ciel, mais que l’histoire en attribue l’invention à la plus ingénieuse des passions. Cet auteur dit qu’une jeune femme de Corinthe, étant sur le point de voir s’éloigner son mari, s’avisa de tracer le profil de son visage sur celui de son ombre afin de conserver quelque image de ses traits qui la pût consoler dans l’ennui de son absence ; que le père de cette jeune femme, pour contribuer à la consolation de sa fille par un moyen si innocent, remplit ces traits avec de l’argile et s’efforça d’imiter la rondeur du naturel ; qu’ainsi la peinture et la sculpture furent inventées en même temps. […] Néanmoins, la vanité des Grecs, qui se flatte d’ordinaire de l’invention des plus belles choses, a tort de s’attribuer celle-ci. Elle tire sa source de plus haut, et nous sommes obligés de croire que Dieu fut le premier statuaire du monde lorsqu’ayant créé tous les êtres, il forma dans la figure de l’homme le portrait de la Divinité.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669) (vol. 3), p. 606 (latin)
Ejusdem operæ terræ fingere ex argilla similitudines, Dibutades Sicyonius figulus primus invenit Corinthi filiæ opera : quæ capta amore juvenis, illo abeunte peregre, umbram ex facie ejus ad lucernam in pariete lineis circumscripsit : quibus pater ejus impressa argilla typum fecit, et cum ceteris fictilibus induratum igni proposuit.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van het oogmerk der Schilderkonst; watze is, en te weeg brengt » (numéro I, 4) , p. 25 (n)
- [1] Bloem der konsten
- [2] Dochter der schaduwe
En zeker zy was outstijts, en is noch de bloeme van alle Konsten [1] : Hierom rekenen onze Poëten haer af komstich van Narcissus, die in een bloem verandert wiert. Want wat mach beter rijmen op der konsten, de schoone gestaltenis dezes jongelings, zich in de kristallijnklare fonteine spiegelende, dan een konstich en wel geschildert beelt de natuer gelijkvormich.
Hierom [2] noemen andere haer ook de schoone dochter van de schaduwe. Want gelijk de schaduwe den uitwendigen omtrek der dingen onfeylbaer afpaelt, waer uit gezeyt wort, dat de Teykenkonst haer eerste begin nam, zoo beelt de Schilderkonst de geheele natuer na.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « De la fin de l’art de peinture » (numéro ch. 4) , p. 104 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Et il est certain qu’il[1] a été autrefois, et qu’il est encore, la fleur de tous les arts. Pour cette raison, nos poètes le pensent issu de Narcisse, qui fut changé en fleur. En effet, y a-t-il chose pouvant mieux aller avec la belle apparence de ce jeune homme qui se miroite à la surface d’une fontaine claire comme le cristal d’une figure habilement et correctement peinte, et de façon conforme à la nature ? C’est ainsi que d’autres disent aussi que l’art de peinture est comme la belle fille de l’ombre, car comme l’ombre détermine infailliblement le contour extérieur des choses dont, disait-on, l’art de dessin avait tiré ses origines, l’art de peinture imite aussi la nature dans son ensemble.
- [1] L’art de peinture.
Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, livre I, ch. 4, « De la fin de l’art de peinture », p. 104
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van’t begin, opgang, en ondergang der Schilderkonst » (numéro VII, 1) , p. 245 (n)
- [1] Was eerst zeer slecht
Hier op verteltmen, dat zeeker Harder de schaduwen zijner schaepen allereerst met zijn staf in het zand teykende; en dat hy, alsze weg liepen, met vermaek haere beeltenissen op den grond zag, en daer door lust kreeg om deeze kunstgreep verder te vervolgen. En wijders: Dat de dochter van Deburatus, potbakker van Sycionien, de schaduwe van haer minnaers tronie van ter [1] zyden met een houtskoole op de muer trok, om zijn gedaente, terwijl hy in den krijg was, gestadich voor haere oogen te behouden: dat de Vader dit beginsel opmaekte; en dat hier uyt de eerste schilderye wiert.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Du début, de l’essor et du déclin de l’art de peinture » (numéro VII, 1) , p. 382 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
On raconte à ce propos qu’un berger a été le tout premier à dessiner les ombres de ses moutons sur le sable, avec son bâton, et que, quand ces moutons allaient paître plus loin, il regardait avec plaisir leurs images sur le sol, grâce à quoi qu’il a eu envie de perpétuer cet artifice. Et l’on dit aussi que la fille de Dibutadès, un potier de Sicyone, traça sur un mur, à l’aide d’un fusain, l’ombre du visage de son amant, vue de côté, afin de conserver continuellement son aspect devant ses yeux alors qu’il était à la guerre, que le père améliora ces débuts, et que ce fut l’origine de la première peinture.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685) (t. V), p. 240 (latin)
Ejusdem opere terrae fingere ex argilla similitudines, [1]Dibutades Sicyonius figulus primus invenit Corinthi, filiae opera : quae capta amore juvenis, illo abeunte peregre, umbram ex facie ejus ad lucernam in pariete lineis circumscripsit : quibus pater ejus impressa argilla typum fecit, et cum ceteris fictilibus induratum igni proposuit.
- [1] Dibutades. Is ex argilla fingebat simulacra eximia, quae propter artificis ingenium, artisque solertiam, aliis etiam ex auro conflatis anteponebantur. Citat hujus rei auctorem Aristotelem, lib. 1. de part. anim. cap. 5. Riolanus, lib. 1. Anthrop. pag. 3. sed falso : nam de Dibutade apud philosophum, si bene memini, nec vola, ut aïunt, nec vestigium est.
[Lemée, François], Traité des statuës(publi: 1688), « De la matiére des statuës » (numéro chapitre III) , p. 37 (fran)
J’ay remarqué cy-dessus que Dibutades passe selon quelques-uns pour avoir donné lieu aux images de terre. Il y en a encore qui donnent cet honneur à Rhoecus et à Theodore de l’Isle de Samos.
[Lemée, François], Traité des statuës(publi: 1688), « Des origine, noms, définition, et division des statuës » (numéro chapitre premier) , p. 1-2 (fran)
- [1] Plin. lib. 35. c. 12
Il n’y a rien de plus incertain que l’origine des statuës ; ceux qui en ont parle [1] disent qu’un potier commença la premiere en couvrant d’argile certains lineamens que sa fille s’avisa de tracer sur l’ombre de son amant, qu’une muraille luy rendoit à la lueur de la chandelle : mais quoy qu’il soit assez vray-semblable qu’une telle circonstance ait donné lieu à la peinture et à la statuaire, il faut pourtant demeurer d’accord que leur découverte est plus ancienne que cette jeune amante, qu’on dit être la fille de Dibutades.
Perrault, Charles, Le Cabinet des beaux arts, ou Recueil d’estampes gravées d’après les tableaux d’un plafond où les beaux arts sont représentés. Avec l’explication de ces mêmes tableaux(publi: 1690), p. 41-42 (fran)
Quelques personnes ont pris plaisir a dire que l’amour en[1] etoit l’inventeur et qu’il en avoit fourni l’idée a l’amant d’une jeune fille qui tricotoit afin qu’elle fit plus promptement et avec moins de peine par le moyen de cette machine la tâche qui lui etoit ordonnée, fable a peu pres semblable a celle de l’invention de la peinture qu’on attribue aussi a l’Amour. Car on conte qu’une jeune bergère voyant l’ombre du visage de son berger que la lampe marquoit sur le mur, fut inspirée par l’amour d’en tracer le profil, et qu’on vid même ce petit Dieu qui conduisoit la main de cette ingénieuse amante.
- [1] la machine a faire des bas de soie.
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (II, 8, 6), p. 72-73 (latin)
- [2] Pag. 45, D. edit. Regiæ.
- [3] Lib. I Mytholog. 6 unde Idolum dicatur.
- [1] Artes imitandi plurimum inter alia commendat, quod earum beneficio non modo desiderium absentium extenuamus, et memoriam defunctorum extendimus, verum etiam quod minacis picturae terrore quandoque incommoda quaedam superamus, quodque picturarum statuarumque opera legationes frequenter obimus.
[1] […] Expressit hoc ipsum Plinius Junior, lib. 11, epist. 7 : Amavi consummatissimum juvenem, inquit, tam ardenter, quam nunc impatienter requiro. Erit ergo pergratum mihi effigiem ejus subinde intueri, subinde respicere, sub hac consistere, præter hanc commeare. Etenim si defunctorum imagines domi positæ dolorem nostrum levant, quanto magis eæ, quibus in celeberrimo loco non modo species et vultus illorum, sed honor etiam et gloria refertur ? Quin etiam videntur prima harum artium initia ex hoc animi humani motu provenisse. Lactantius, de Orig. erroris, cap. 2 : Omnium fingendarum similitudinum ratio idcirco ab hominibus inventa est, ut posset eorum memoria retineri, qui vel morte subtracti, vel absentia fuerant separati. Mycerinus rex Ægypti justitia et religione præter cæteros venerandus, unicam filiam morte amissam graviter lugens, cadaver defunctæ in qualecunque ægri animi solatium ligneæ et multo auro obductæ bovi inclusit ; ipsam deinde bovem de medio non removit, sed in splendisissimo regiæ suo conclavi oculis omnium exposuit, ubi ei quotidie varii odores adolebantur, et singulis noctibus lucerna pernox accendebatur : Herodotus, lib. II, cap. 129, 130. Vide Etymologicum in Ἐπώνυμοι ; vide quoque Cedrenum, ubi de Serucho agit [2] ; lege denique quæ super hac re de Syrophane Ægyptio referuntur a Fulgentio [3] Virgo certe Corinthia, amore suadente, rudem dexteram tantarum artium primordiis ausa est applicare, umbramque amantis peregre profecturi ad lucernam lineis designare ; mox, ut est mos hominum parvula initia pertinaci studio persequendi, pater virginis Dibutades figulus spatium lineis comprehensum exsculpens atque argilla complens, typum fecit, eumque induravit igne, ex tam tenuibus initiis prima picturae et plastices rudimenta exhibiturus : unde apparuit verissimum esse illud Cassiodori Variar. I, 12 ; Mos est hominibus occasiones repentinas ad artes ducere.
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 107-108 (fran)
[Note contexte] De l’origine de la peinture. Quoyque les auteurs qui ont dit quelque chose de l’origine de la peinture, en ayent parlé diversement, tous conviennent néanmoins, que l’ombre a donné occasion à la naissance de cet art. Pline rapporte sur ce sujet l’histoire d’une fille de Sicyone, appellée Corinthia, et il dit qu’un jeune homme qu’elle aimoit, s’étant endormi à la lumiére d’une lampe, l’ombre de son visage qui donnoit sur une muraille luy paroissoit si ressemblante, qu’elle en voulut tracer les éxtrémitez, et faire ainsi le portrait de son amant. S’il est vray, comme il y a bien de l’apparence, que l’ombre a suscité l’inventeur de la peinture, l’imitation est si naturelle à l’homme, qu’il n’aura pas attendu jusqu’au tems de Corinthia à tracer les figures sur son ombre, qui est aussi ancienne que luy-même.
Mais sans s’étendre sur cette pensée, et sans chercher une source aussi incertaine qu’est celle de la peinture, on peut dire avec beaucoup de fondement que cet art a pris naissance en même tems que la sculpture, l’une et l’autre ayant le dessein pour principe, et que dès les tems d’Abraham, où la sculpture étoit en usage, la peinture par conséquent y étoit de la même sorte, et en pareil dégré.
Fraguier, Claude-François, De l’ancienneté de la peinture, dissertation lue à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1709 (publi: 1717, redac: 1709), p. 78-79 (fran)
En cet estat, l’homme qui est né imitateur, et dans qui l’inclination à imiter n’est peut-estre pas une vertu, se porta naturellement à l’imitation. Tout aidoit en luy ce penchant. L’ignorance le fortifioit, comme elle le fortifie encore aujourd’huy dans les enfants et dans les personnes en qui les lumières de l’esprit ni le discernement n’ont qu’une force médiocre. Les objets qu’il avoit sous les yeux sembloient l’inviter au plaisir de l’imitation, et la nature elle-mesme, qui par le moyen des jours et des ombres, peint toutes choses, ou dans les eaux, ou sur les corps dont la surface est polie, luy apprenoit à satisfaire son goust pour l’imitation. Il le satisfaisoit doublement tout à la fois, puisqu’en imitant les corps et les retraçant, il imitoit aussi la nature, qui les retrace et les imite en tant de façons différentes. Ainsi le soleil, que Platon nomme ingénieusement le plus habile de tous les peintres, apprit aux hommes les commencements de la peinture.
Telle fut vraysemblablement la première ébauche de cet art. Car il ne faut pas s’arrester à certains faits que l’on raconte ordinairement, quand on parle de l’origine de la peinture. On dit, par exemple, qu’une bergere, pour conserver le portrait de son amant, conduisoit avec sa houlette une ligne sur l’ombre que le visage du jeune homme faisait sur le sable. Il y a mille petits contes semblables, qui, vrais ou faux, ne servent qu’à confirmer ce qu’on vient de dire, et ne sont que des applications particulières d’un principe général, et comme des apologues inventez pour l’explication d’une vérité.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Composición física de la pintura”, §9 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 4) , vol. 1, p. 122 (espagnol)
Y hace al caso, según el mismo autor, el haber sido inventora del dibujo en Corinto la hija de Dibutades Alfaharero ; la cual prendada del amor de un mancebo, que estaba para ausentarse, delineó con un carbón la sombra de su rostro, causada de la luz en la pared : conque en sólo Dibutades hallamos gran fundamento para la deducción de la voz castellana dibujo, con antiguo, y bien ejecutoriado origen ; y no menos in buxo, por ser la materia en que se ejercitaba.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Composición física de la pintura”, §10 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 4) (espagnol)
De este caso de la hija de Dibutades, se infiere con evidencia, haber sido el inventor del dibujo el amor ; pues fué el estímulo de aquella primera delineación : y no se debe extrañar ; porque aunque el dibujo es hijo del entendimiento, éste no se actúa sin el imperio de la voluntad, a cuya potencia pertenece la ejecución, y sin la cual no llegará al perfecto, y último complemento de su sert. Y notése, que no digo fué el amor causa efectiva del dibujo, sino inventiva ; porque inventar, es hallar ; y el hallar, supone ya constituído, lo que se busca aunque es estas operaciones intelectivas sea en cierto modo de potencialidad respectiva a la operación externa ; pero aunque así sea, se supone constituído in actu primo, en cuanto en aquella esfera tiene toda la perfección, que puede tener ; bien, que en el acto segundo, aquella diligencia, y solicitud de actuar, se le deba a la voluntad, aunque (como potencia ciega) guiada del entendimiento.
Por esto debe ser práctica tan observada de los amantes el cominicarse los retratos, para remedio de la ausencia, como ejecutoriado estilo desde la primera aurora del dibujo : no apruebo lo injusto, que no hay cosa, por buena, o por indiferente, que no esté sujeta a las siniestras jurisdicciones del abuso ; y en esta materia hay algunos, no sólo indecentes, sino sacrílegos ; pero en lo decente, es acreditado estilo del divino Amor, cuando dice a su Esposa en los Cantares : Ponme como dibujo, o sello sobre tu corazón ; dejando, como amante fino, en prendas de su ausencia su corazón, en semejanza de pintura ; no sólo en el inefable cándido velo de la Eucaristía, sino en el sagrado dichoso lienzo de los santos sudarios, y pintura de su sacratísimo Cuerpo, u en otras divinas imágenes de su Humanidad sacrosanta ; todas ardentísimas demostraciones de su inefable amor, como se verá adelante.
Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 127 (fran)
DIBUTADE de Sicyone, simple potier de terre, est le premier qui se soit avisé d’éxprimer la figure humaine avec de l’argile. On dit que la chose se passa à Corinthe, et que sa fille lui en fit naître l’invention. C’est qu’étant amoureuse d’un jeune homme, qui l’aimoit, et qui devait la quitter pour un long voyage, elle se mit dans l’esprit d’en conserver les linéamens éxtérieurs, qu’elle traça fidellement contre la muraille, avec du charbon, à l’aide d’une lampe, qui les marquoit devant ses yeux. Et voilà l’origine de ce Contour célèbre, qui a longtemps été regardé comme le père de la plastique, de la peinture, de la sculpture, et généralement de tous les arts qui dépendent du trait. Dibutade, de retour chez lui, trouva ce crayon si singulier et si nouveau, qu’il résolut d’en faire quelque chose. Pour cet effet, il y appliqua de l’argile, l’étendit éxactement jusqu’à la circonscription de l’objet, et en fit ainsi une espèce de modèle, qu’il fit durcir au feu avec le reste de ses ouvrages.
Notes au texte latin, p. 303 :
(K) Ejusdem opere terrae fingere ex argilla. C’est la leçon de Venise, qu’il ne faut pas changer, quoi qu’il y ait des MSS. qui lisent autrement : il veut dire que si la terre nous fournit les couleurs, et nous procure les matériaux de la peinture, elle nous fournit aussi de quoi modeller, et donne lieu à la plastique et à la sculpture. Notre auteur ne laisse jamais passer l’occasion de faire l’éloge de cette commune Mere des Vivans, et on en verra dans la suite un éxemple notable : inenarrabili terrae benignitate, etc.
(L) Filiae opera. Voyez dans les Poësies de M. de Fontenelle, une Epître de Dibutadis à Polémon, où cette histoire n’est pas bien rapportée. Le plus sûr est de recourir aux sources.
Turnbull, George, A Treatise on Ancient Painting(publi: 1740), p. 1 (anglais)
Plato and other authors tell us, it was the Sun, the first and ablest of painters, that taught men to design and paint. And what else can these writers mean; what else can that known story of a shepherdess circumscribing her lovers shadow in order to preserve his image, and other such like fables concerning its origin, signify; but that this imitative art, which is equally useful and pleasant, and to which Nature points and invites us so strongly, by retracing or copying her own works in various manners, must have been very early attempted.
Fontenelle, Bernard le Bouyer de, Lettres à l’imitation des héroïdes d’Ovide(publi: 1752) (t. IV), p. 333-336 (fran)
(On dit que Dibutade de Sicione inventa la sculpture. Un soir sa fille traça sur une muraille les extrémitez de l’ombre de son amant, qui se formoit à la lumiére d’une lampe, et cela donna à Dibutade la premiére idée de tailler une pierre en homme. Je supose que cette fille ayant vû une belle statuë de la façon de son père, écrit à son amant. Les noms de Dibutadis et de Polemon sont feints).
Une nouvelle joïe, et que je veux t’écrire,
Tient mon esprit tout occupé.
Mon pere m’a fait voir un marbre qui respire,
Du moins si l’œil n’est pas trompé.
Qui ne s’étonneroit que la pierre ait su prendre
La mollesse même des chairs,
Et ce ne je sais quoi de vivant et de tendre
Qui forme les traits et les airs ?
Tu sais quelles raisons me font aimer la vue
D’un marbre si bien travaillé.
D’une si douce joie on n’a point l’ame émue,
Sans que l’amour y soit mêlé.
Par ce divin chef-d’œuvre est à mes yeux offerte
L’image de cet heureux soir,
Qui répara si bien une légère perte
Que tu crus alors recevoir.
Tu venais me parler, j’étais avec mon père ;
Il sait, il approuve nos feux :
Mais un pere est toujours un témoin trop sévere
Pour les amours et pour les jeux.
Quelques mots au hasard jetés par complaisance
Composoient tout notre entretien ;
Et nous interrompions notre triste silence,
Sans toutefois nous dire rien.
Une lampe pretoit une lumiere sombre
Qui m’aidoit encore à rêver.
Je voyois sur un mur se depeindre ton ombre ;
Et m’appliquois à l’observer.
Car tout plait, Polémon, pourvu qu’il represente
L’objet de notre attachement.
C’est assez pour flatter les langueurs d’une amante
Que l’ombre seule d’un amant.
Mais je poussai plus loin cette douce chimere ;
Je voulus fixer en ces lieux,
Attacher à un mur une ombre passagere,
Pour la conserver à mes yeux.
Alors en la suivant du bout d’une baguette,
Je trace une image de toi ;
Une image, il est vrai, peu distincte, imparfaite ;
Mais enfin charmante pour moi.
Dibutade, attentif à ce qu’Amour invente,
Conçoit aussitôt le dessein
De tailler cette pierre en figure vivante,
Selon l’ébauche de ma main.
Ainsi, cher Polemon, commence la sculpture ;
Graces à ces heureux hasards.
L’Amour qui sut jadis débrouiller la nature,
Aujourd’hui fait naître les arts.
Je sens un doux espoir à qui mon cœur se livre ;
Tout l’avenir s’offre à mes vœux.
Puisqu’on peut vivre en marbre, on y voudra revivre,
Pour se montrer à nos neveux.
Les héros par cet art étendront leur mémoire
Bien loin au-delà de leurs jours ;
Et le soin qu’ils auront d’éterniser leur gloire,
Eternisera nos amours.
Combien de demi-dieux, dont les hommes peut-être,
Eussent oublié jusqu’au nom !
Que d’exemples puissans que l’on n’eût pu connoître,
Si je n’eusse aimé Polemon !
Mais si tu ressemblois à tant d’amans volages,
Si tu changeois à mon égard,
Oserois-tu jeter les yeux sur les ouvrages
Que va produire un si bel art ?
Ta noire trahison auroit toujours contre elle
La voix de ces témoins muets,
Qui te reprocheroient cet amour si fidèle
Dont ils sont tous autant d’effets.
Je t’offense, et je sais qu’il s’eleve en ton âme
Un vif, mais doux ressentiment.
Viens, je réparerai ces soupçons de ma flamme,
Que je condamne en les formant.
Quoi ! de tels changemens seroient-ils donc possibles ?
Quoi ! cet amour toujours vainqueur
Animeroit par moi des marbres insensibles,
Et n’animeroit plus ton cœur ?
La Nauze, abbé de, Mémoire sur la manière dont Pline a parlé de la peinture(publi: 1759, redac: 1753/03/20), p. 265 (fran)
Il est inutile d’avertir que ces découvertes[Explication : de Cimon.], déjà connues pour la pluspart dans le dessein, dans la sculpture ou dans la plastique, regardent ici la peinture : le profil, par exemple, pouvoit fort bien avoir eu lieu plus anciennement, dans la figure que fit de son amant la fille de Dibutadès, en traçant sur le mur l’ombre du visage à la lueur d’une lampe ; ce qui fit naître à son père, ouvrier en poterie à Corinthe, l’idée du premier ouvrage de plastique connu dans la Grèce. Mais encore un coup Pline, à l’article de Cimon, parle de découvertes dans la peinture proprement dite, c’est ce qu’on ne doit jamais perdre de vûe.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « De la sculpture et des sculpteurs anciens, selon Pline » (publi: 1759, redac: 1753/06/01), p. 304-305 (fran)
Il dit que Dibutade, potier de terre à Corinthe, fut le premier qui inventa la plastique. Tout le monde sait que sa fille, éprise pour un jeune homme qui partoit pour un voyage, traça sur le mur l’ombre que son visage formoit par l’opposition d’une lampe. Le père, frappé de ce dessein, suivit les contours, et remplit avec de la terre les intervalles qu’ils occupoient ; ensuite il porta ce prétendu bas-relief dans son four avec ses autres ouvrages ; « on conserva même ce premier modèle jusqu’à la prise de Corinthe, que Mummius brûla et renversa. » Cette idée est mêlée de vraisemblance dans le détail, et d’agrément dans l’invention : mais quand on voudroit douter de ces prétendus faits, il est encore plus commode de les adopter ; on ne pourroit mettre à la place que d’autres suppositions.
Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières, comte de, « De la sculpture selon Pline », discours lu le 1er juin 1754 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1754/06/01), 340 (fran)
Il [Pline] dit donc que Dibutadès, potier de terre à Corinthe, fut le premier qui inventa la plastique. Tout le monde sait que sa fille, éprise pour un jeune homme qu’un voyage allait éloigner d’elle, traça sur le mur l’ombre que son visage formait par l’opposition d’une lampe. Le père, frappé de ce dessein, suivit les contours et remplit avec de la terre les intervalles qu’ils occupaient ; ensuite il porta ce prétendu bas-relief dans son four avec ses autres ouvrages. On conserva même ce premier modèle jusqu’à la prise de Corinthe, que Mummius brûla et renversa. Cette idée est mêlée de vraisemblance dans le détail et d’agrément pour l’invention ; mais quand on voudrait douter de ces prétendus faits, on ne pourrait mettre à la place que d’autres suppositions.
Rousseau, Jean-Jacques, Essai sur l’origine des langues(publi: 1781, redac: (1755)), « Des divers moyens de communiquer ses pensées » (numéro ch. I) , p. 60 (fran)
Quoique la langue du geste et celle de la voix soient également naturelles, toutefois la prémiére est plus facile et dépend moins des conventions : car plus d’objets frapent nos yeux que nos oreilles et les figures ont plus de varité que les sons ; elles sont aussi plus expressives et disent plus en moins de tems. L’amour, dit-on, fut l’inventeur du dessein. Il put inventer aussi la parole, mais moins heureusement. Peu content d’elle il la dédaigne : il a des maniéres plus vives de s’exprimer. Que celle qui traçoit avec tant de plaisir l’ombre de son amant lui disoit de choses ! Quels sons eût-elle employés pour rendre ce mouvement de baguéte ?
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung(publi: 1755, trad: 1991), p. 28 (allemand)
Man will unterdessen nicht behaupten, daß die Art in nassen Ton zu bilden den Griechen unbekannt, oder nicht üblich bei ihnen gewesen. Man weiß sogar den Namen desjenigen, welcher den ersten Versuch hierin gemacht hat. Dibutades von Sikyon ist der erste Meister einer Figur in Ton.
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung, (trad: 1991), p. 41 (trad: "Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture" par Charrière, Marianne en 1991)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Ce qui ne signifie pas que l’on prétende que le modelage en argile humide était inconnu des Grecs ou n’était pas habituel chez eux. On connaît même le nom de celui qui le premier en fit l’essai. Dibutadès de Sicyone est le premier à avoir exécuté une figure en argile.
Pernety, Antoine-Joseph, Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure avec un traité pratique des différentes manières de peindre dont la théorie est développée dans les articles qui en sont susceptibles. Ouvrage utile aux artistes, aux élèves et aux amateurs par Dom Antoine-Joseph Pernety(publi: 1756), « Traité pratique des différentes manières de peindre », p. viii (fran)
Ce seroit faire peu d’honneur à cet art admirable, que d’attribuer sa découverte à un pur effet du hazard, comme l’ont avancé quelques anciens auteurs. Quelques bergers, dit-on, traçant avec leurs houlettes des traits sur la terre, un d’eux s’avisa de suivre en traçant les extrêmités de l’ombre que ses moutons y formoient. Pline dit, qu’une jeune fille traça sur le mur l’ombre de son amant, pour en conserver en quelque maniere la présence ; et Philostrate, dans la vie d’Apollonius, ajoute à ce sujet, que les premiers peintres travaillant à remplir ce vuide par des traits, apprirent peu à peu à y ménager les jours et les ombres avec une seule couleur, et celle du fond. Quoi qu’il en soit, il est à croire que la Nature ayant fait les premiers portraits, elle fit aussi les premiers peintres. Elle inspira aux hommes le dessein de l’imiter, et peut-être que quelques circonstances singulieres ont contribué à faire réussir leurs recherches. C’est tout ce qu’on peut accorder au hazard dans l’honneur de cette invention.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting(publi: 1760), “Of the antiquity and usefulness of painting” (numéro Dialogue III) , p. 25-26 (anglais)
A — As it is evident that paint bears the immediate stamp, and very image of our conceptions[1], so it was natural, that men should sooner hit on this method of representing their thoughts, than by letters, which have no connection with, or resemblance to the ideas they stand for: from whence, no less than from the authority of history, it has been justly concluded, that writing is of a much later invention than painting. But that which brought the antiquity of the latter so much into doubt, was the vanity of the Greeks. Piquet that any other nation should have the honour of its invention, they dated its origin from its first appearance among themselves; they tell us of a certain maid, who to have some present image of her lover, who was about to leave her[2], drew the outlines of his shadow on a wall.
B — It was prettily imagined however, to make the most amiable of all our passions give birth to the most pleasing of all arts.
A — Pliny mentions this, objects to the Greeks their inconsistency, and want of accuracy.
- [1] It is to be observed, that, in the Greek tongue, the same word (γραφεῖν) signifies to paint, or to write ; which is easily accounted for, if we suppose that, like the Egyptians, they first explained their thoughts by paint : so that, afterwards, when letters were discovered, though they changed the manner, they continued the term.
- [2] Hence the art itself was by the Greeks termed σκιαγράφια and in the Latin, adumbrare and pingere are synonymous.
Webb, Daniel, An Inquiry into the Beauties of Painting, (trad: 1765), p. 26-27 (trad: "Recherche sur les beautés de la peinture" par Bergier, Daniel Claude François en 1765)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
A — La peinture portant l’emprunte immédiate et l’image de nos conceptions[1], il est naturel que les hommes l’aient employée avant les lettres, qui n’ont aucune connexion, ni aucune ressemblance avec elles ; d’où je conclus, fondé sur l’autorité de l’histoire, que l’Ecriture est beaucoup moins ancienne que la Peinture. Ce qui a fait douter de l’ancienneté de celle-ci, c’est la vanité des Grecs, qui, pour enlever aux autres nations l’honneur de cette découverte, ne daterent son origine que du moment qu’ils avaient commencé à la cultiver. Ils parlent de je ne sais quelle fille, qui, pour conserver le portrait de son amant, s’avisa de crayonner à la lueur d’une lampe l’ombre que son visage faisoit sur la muraille[2].
B — Rien n’est plus ingenieux que d’attribuer l’origine du plus agréable de tous les Arts, à la plus aimable de toutes les passions.
A — Pline, dont nous tenons cette histoire, accuse les Grecs d’inconséquence et d’inexactitude.
- [1] Il est bon d’observer que, dans la langue grecque, le même mot (γραφειν) signifie également peindre et écrire ; il est aisé de rendre raison de cette double signification, en supposant que les Grecs, de même que les Egyptiens, exprimèrent d’abord leurs pensées par le moyen de la peinture ; et qu’ayant dans la suite découvert les lettres, ils changerent de manière, et conserverent le terme dont ils s’étoient d’abord servi.
- [2] De là vient que les Grecs appelle cet art Σκιαγραφια, et que chez les Latins les mots adumbrare et pingere sont synonymes.
Commentaires :
Le Mierre, Antoine-Marin, La Peinture, poème(publi: 1761), « Chant premier [le dessein] », p. 1-2 (fran)
Je chante l’Art heureux dont le puissant génie
Redonne à l’univers une nouvelle vie,
Qui, par l’accord savant des couleurs et des traits,
Imite et fait saillir les formes des objets,
Et prêtant à l’image une vive imposture,
Laisse hésiter nos yeux entre elle et la nature.
Toi qui près d’une lampe et dans un jour obscur,
Vis les traits d’un amant vaciller sur le mur,
Palpitas et courus à cette image sombre,
Et de tes doigts légers traçant les bords de l’ombre,
Fixas avec transports sous ton œil captivé
L’objet que dans ton cœur l’Amour avoit gravé,
C’est toi dont l’inventive et fidelle tendresse
Fit éclore autrefois le Dessin dans la Grece.
Du sein de ces déserts, lieux jadis renommés,
Où parmi les débris des palais consumés,
Sur les tronçons épars des colonnes rompues,
Les traces de ton nom sont encore apperçues,
Leve-toi, Dibutade, anime mes accens,
Embellis les leçons éparses dans mes chants,
Mets dans mes vers ce feu qui, sous ta main divine,
Fut d’un art enchanteur la premiere origine.
Heureux pere ! Tu vis ce prodige nouveau,
Le crayon de ta fille alors fut un flambeau ;
Artiste en un moment, à sa clarté propice,
Tu découpes la pierre autour de cette esquisse,
Et déjà du ciseau l’industrieux secours
Donne un corps à l’image en bombant les contours.
D’abord à la Peinture on ne pouvoit atteindre,
Tout parut plus facile à modeler qu’à peindre ;
On arrondit la pierre, on façonna le bois,
Pour figurer un corps, d’un autre l’on fit choix.
Eh ! Regardez l’enfant, voyez comme il imite ;
Rarement à tracer la nature l’invite ;
Connut-il le crayon, ses effets sont trop lents,
Trop de fois il rompra sous ses doigts pétulans.
Mais il taille le liege, il sait pétrir la cire,
Il découpe le bois, il forme, il veut construire ;
Ainsi par le ciseau l’artiste commença,
Un art guida vers l’autre et bientôt l’on traça :
La Peinture naquit.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), „Nöthige Verbindung des Geschmacks und der Regeln“ (numéro I, 4) , p. 44-45 (allemand)
Die Geschichte der Griechen, die sich auch jener Ehre angemasset, und die idealische Schönheit zuerst in die bildenden Künste gebracht haben; diese Geschichte hat uns nicht gemeldet, ob das artige Mägdchen in Corinth ihren Liebsten aus der schönen Natur gewählet gehabt, bevor sie dessen Bild zuerst nach dem Schatten, den sie an der Wand wahrnahm, abgerissen. Sie erweckte den Witz ihres Vaters des Dibutades, eines Töpfers aus Sicyon, der von diesem Umrisse zur Bildneren Anlaß nahm, wie die Tochter die erste Anleitung zur Malherey gegeben hatte. Beide nehmen also diejenige natur, die sie vor sich hatten. Bei der Tochter hatte die Liebe für sie und für die Kunst gewählet, und wir wollen hoffen, daß die Neigung, mit dem gesunden Witze verbunden, nicht ganz ohne Geschmack gewesen sei.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’union nécessaire du goût et des règles » (numéro I, 2) , p. 41-42 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
L’histoire de la Grece qui s’arroge aussi l’honneur de cette invention, et qui se vante à plus juste titre d’avoir introduit la beauté idéale dans les arts imitatifs, ne nous dit pas si l’aimable Corinthia, jeune fille de Sicyone a choisi son amant dans la belle nature avant de tracer sa figure d’après l’ombre qu’elle apperçut sur une muraille. Par cet essai elle réveilla l’industrie de Dibutade son pere, potier de la même ville, à qui ce contour fournit l’idée de modeler des figures ; ainsi la fille donna les éléments de la peinture, comme le pere donna ceux de la sculpture. Ces premiers inventeurs choisirent donc la nature qu’ils avoient devant les yeux. Chez la fille l’amour s’étoit chargé de choisir pour elle et pour l’art ; et j’aime à croire que le penchant de son cœur, joint au discernement de son esprit n’a pas été entierement dénué de goût.
Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peinture », tome XII(publi: 1765), p. 267 (fran)
L’imagination s’est bien exercée pour trouver l’origine de la peinture ; c’est là-dessus que les poëtes nous ont fait les contes les plus agréables. Si vous les en croyez, ce fut une bergere qui la premiere, pour conserver le portrait de son amant, conduisit avec sa houlette une ligne sur l’ombre que le visage du jeune homme faisoit sur le mur. La Peinture, disent-ils, La brillante Peinture est fille de l’Amour. C’est lui le premier inspirant une amante, Aux rayons de Phébus guidant sa main tremblante, Crayonna sur un mur l’ombre de son amant. Des diverses couleurs le riche assortiment, L’art d’animer la toile et de tromper l’absence, Ainsi qu’à d’autres arts lui doivent la naissance. Ce sont là des apologues inventés pour l’explication de cette vérité, que les objets, mis sous les yeux de l’homme, semblent l’inviter à l’imitation ; et la nature elle-même, qui, par le moyen des jours et des ombres, peint toutes choses soit dans les eaux, soit sur les corps ont la surface est polie, apprit aux hommes à satisfaire leurs goûts par imitation.
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « De l’origine des statues » (numéro Première partie, chapitre premier) , p. 3-4 (fran)
- [1] Plin. liv. XXXV. 12. Athenag. In legat. pro Christian. et vid. Junium de pict. vet. in catalog. pag. 56
Quelques anciens ont donné à la sculpture une naissance commune avec la peinture [1]. Des profils de l’ombre d’un homme ou d’une brebis tracés sur un mur ou sur le sol, en firent naître également la premiere idée ; l’amour selon d’autres fut le premier artiste. Une jeune Grecque occupée de son amant qui se séparoit d’elle, pour en conserver la mémoire, essaie d’en dessiner l’image à la faveur d’une lampe, et fait ensuite la copie de cette ombre dessinée, avec de l’argille pris dans l’attelier de son pere Dibutades, potier de profession.
Quoi qu’il en soit de cette galante découverte, ainsi que de celles qu’on n’attribue qu’au hazard ; nous chercherons moins ici l’origine physique, que l’origine morale des statues, ou pour mieux dire, nous considérerons leur origine et leur progrès physiques, dans les causes morales qui les ont fait imaginer.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes(publi: 1771:1782) (XI), p. 299, note 1 (fran)
Dibutade peignit ; son maître fut l’Amour,
Et son amant fut son modèle ;
L’amitié triomphe à son tour ;
Elle a fait ce portrait fidèle.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772) (t. I), p. 189-190 (fran)
Dibutade de Sicyone, potier de terre, a le premier inventé l’art de faire, à Corinthe, des portraits en argile par le secours de sa fille. Amoureuse d’un jeune homme qui partoit pour un voyage, elle renferma dans des lignes l’ombre de son visage marquée sur une muraille à la lumière d’une lampe. Son père apliqua dessus de l’argile et en fit un modèle qu’il fit cuire avec ses autres copies.
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776) (t. I), p. 4-7 (fran)
§I. Ancienneté de la peinture : L’ombre des corps, produite par le soleil, a dû frapper les premiers hommes ; ainsi, le soleil peut être regardé comme l’origine de la peinture. Platon l’appelle ingénieusement le plus habile de tous les peintres.
§II. Origine de la peinture. Dans cette première supposition, qui n’est point dénuée de vraisemblance, quelques auteurs ont écrit qu’une bergere, pour conserver le portrait de son amant, traçoit avec sa houlette une ligne sur l’ombre que le visage du jeune homme faisoit sur le sable. D’autres attribuent tout simplement l’origine de la peinture à des bergers qui imprimèrent avec leur houlette des traits sur la terre ; l’un d’eux suivit les extrémités de l’ombre que ses moutons y formoient.
La belle Dibutade, fille d’un potier de Sicyone, passe généralement pour la créatrice des arts. Son amant alloit s’éloigner d’elle, et vint lui faire ses adieux. Les larmes et les plaisirs partagèrent des momens qu’ils croyoient ne devoir jamais renaître. Enfin, le jeune homme, accablé de la douleur d’une séparation prochaine, et plongé dans l’ivresse de son amour, s’endormit auprès de celle qu’il adoroit. La simple lueur d’une lampe éclairoit ces deux amants, et renvoyoit l’ombre du visage du jeune homme sur la muraille prochaine. Dibutade s’aperçoit pour la première fois de cet effet naturel ; inspirée par l’amour, elle veut conserver au moins les traits de celui qui va la quitter ; elle prend un charbon, et d’une main conduite par le plaisir, elle trace le portrait de l’objet de sa tendresse, en suivant les extrémités de l’ombre qui l’a frappée, et qu’elle voit se fixer avec étonnement. Voilà, dit-on, ce qui donna la première idée de la peinture, et ce qui fit naître ensuite la sculpture, et généralement tous les arts qui dépendent du trait.
Le père de Dibutade trouva l’invention de sa fille tout à fait singulière, et résolut d’en tirer parti. Pour cet effet, il appliqua de l’argile, l’étendit exactement jusqu’à la circonscription de l’objet ; il en fit ainsi une espèce de modèle, qu’il durcit au feu avec les ouvrages auxquels il travailloit ordinairement. Pline assûre[1] que ce premier essai de plastique fut conservé à Corinthe jusqu’à l’an 608 de Rome.
Pour revenir à la peinture, on lui donne encore une autre origine. Selon d’anciens auteurs, ce fut un jeune homme à qui l’amour inspira la première idée du dessein. Son amante alloit se séparer de lui ; lorsque, remarquant l’ombre que le soleil levant renvoyait sur un mur, il la fit approcher de cette muraille, et traça avec un charbon le profil du visage de celle qu’il idolâtroit. « Puisqu’il faut (lui dit-il) que je sois privé pendant quelque temps du plaisir de te voir, j’aurai du moins la douceur de contempler cette foible image, qui calmera une partie des peines que va me faire éprouver ton absence. » Les mêmes historiens ajoûtent, que la jeune personne, aussi tendre, aussi sensible, profita de l’heureux stratagème de son amant dont elle emporta les traits sur un voile qu’elle sut garder avec le plus grand soin.
C’est à la fille de Bélus[2] que nous devons le dessein, s’il en faut croire d’autres historiens. Cette princesse (disent-ils) voyant l’ombre de son père contre une muraille, en suivit les contours à l’aide d’un charbon. Si cette histoire étoit vraie, elle prouveroit que l’amour filial a fait naître la peinture.
§III. Ce que fut la peinture en Grèce, aux premiers siècles de son origine. Tout le travail des premiers artistes consistoit à suivre les traits de l’ombre que les corps forment, quand ils sont exposés au soleil, ou bien lorsqu’ils se trouvent entre une lumière quelconque, selon l’exemple qu’en avoit donné la tendre Dibutade.
- [1] Lib. 35.
- [2] L’un des premiers rois d’Assyrie, connu aussi sous le nom de Baal, ou Bel.
Hayley, William, An Essay on Painting in two epistles to Mr. Romney(publi: 1781), p. 9 (anglais)
Oh! Love, it was thy glory to impart
Its infant being to this magic art!
Inspir’d by thee, the soft Corinthian maid*
Her graceful lover’s sleeping form portray’d:
Her boding heart his near departure knew,
Yet long’d to keep his image in her view:
Pleas’d she beheld the steady shadow fall,
By the clear lamp upon the even wall:
The line she trac’d with fond precision true,
And, drawing, doated on the form she drew:
Nor, as the glow’d with no forbidden fire,
Conceal’d the simple picture from her fire,
His kindred fancy, still to nature just,
Copied her line, and form’d the mimic bust.
Thus from thy power, inspiring Love, we trace
The modell’d image, and the pencil’d face!
Notes, p. 59-60 :
* Note IV. Verse 126.
Inspir’d by thee, the soft Corinthian Maid. Pliny has transmitted to us the history of the Maid of Corinth and her father. “Dibutades, a potter of Sicyon, first formed likeness in clay at Corinth, but was indebted to his daughter for the invention; the girl being in love with a young man who was soon going from her into some remote country, traced out the lines of his face from his shadow upon the wall by candle-light. Her father, filling up the lines with clay, formed a bust, and hardened it in the fire with the rest of his earthen ware.” Plin. Lib. 35.
Athenagoras, the Athenian philosopher, gives a similar account of this curious and entertaining anecdote, adding the circumstance that the youth was sleeping when the likeness was taken from his shadow.
Περιεγραψεν αὐτε κοιμωμενε εν τοιχῳ την σκiαν.
The same writer, who lived in the second century of the Christian aera, informs us that this monument of ancient was extant at Corinth in his time, though Pliny seems to intimate that it did not survive the taking of that city by Mummius.
In the Poesies of Fontenelle there is an epistle from the Maid of Corinth, whom the author walls Dibutadis, to her imaginary lover Polemon. She describes her own work in the following stanzas:
Une lampe pretoit une lumiere sombre
Qui m’aidoit encore à rever.
Je voyois sur un mur se depeindre ton ombre ;
Et m’appliquois à l’observer ;
Car tout plait, Polémon, pourvu qu’il represente
L’objet de notre attachement :
C’est assez pour flatter les langueurs d’une amante
Que l’ombre seule d’un amant.
Mais je poussai plus loin cette douce chimere ;
Je voulus fixer en ces lieux,
Attacher à un mur une ombre passagere,
Pour la conserver à mes yeux.
Alors en la suivant du bout d’une baguette,
Je trace une image de toi ;
Une image, il est vrai, peu distincte, imparfaite ;
Mais enfin charmante pour moi.
Schiller, Friedrich von, Die Künstler(publi: 1789), p. 2-5 (allemand)
4. Was erst, nachdem Jahrtausende verflossen
Die alternde Vernunft erfand,
Lag im Symbol des Schönen und des Großen,
Voraus geoffenbart dem kindlichen Verstand.
Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieben,
Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt,
Eh’ noch ein Solon das Gesetz geschrieben,
Das matte Blüten langsam treibt.
Eh vor des Denkers Geist der kühne
Begriff des ew’gen Raumes stand,
Wer sah hinauf zur Sternenbühne,
Der ihn nicht ahnend schon empfand?
5. Die, eine Glorie von Orionen
Um’s Angesicht, in hehrer Majestät,
Nur angeschaut von reineren Dämonen,
Verzehrend über Sternen geht,
Gefloh’n auf ihrem Sonnenthrone,
Die furchtbar herrliche Urania,
Mit abgelegter Feuerkrone
Steht sie – als Schönheit vor uns da.
Der Anmuth Gürtel umgewunden,
Wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn,
Was wir als Schönheit hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.
6. Als der Erschaffende von seinem Angesichte
Den Menschen in die Sterblichkeit verwies
Und eine späte Wiederkehr zum Lichte
Auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieß,
Als alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten,
Schloß sie, die Menschliche, allein
Mit dem verlassenen Verbannten
Großmütig in die Sterblichkeit sich ein.
Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge,
Um ihren Liebling, nah am Sinnenland,
Und malt mit lieblichem Betruge
Elysium auf seine Kerkerwand.
7. Als in den weichen Armen dieser Amme
Die zarte Menschheit noch geruht,
Da schürte heil’ge Mordsucht keine Flamme,
Da rauchte kein unschuldig Blut.
Das Herz, das sie an sanften Banden lenket,
Verschmäht der Pflichten knechtisches Geleit;
Ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, senket
Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit.
Die ihrem keuschen Dienste leben,
Versucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick;
Wie unter heilige Gewalt gegeben,
Empfangen sie das reine Geisterleben,
Der Freiheit süßes Recht, zurück.
8. Glückselige, die sie – aus Millionen
Die Reinsten – ihrem Dienst geweiht,
In deren Brust sie würdigte zu thronen,
Durch deren Mund die Mächtige gebeut,
Die sie auf ewig flammenden Altären.
Erkor das heil’ge Feuer ihr zu nähren,
Vor deren Aug’ allein sie hüllenlos erscheint,
Die sie in sanftem Bund um sich vereint!
Freut euch der ehrenvollen Stufe,
Worauf die hohe Ordnung euch gestellt !
In die erhabne Geisterwelt
War’t ihr der Menschheit erste Stufe!
9. Eh ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht,
Dem alle Wesen freudig dienen –
Ein unermeßner Bau, im schwarzen Flor der Nacht,
Nächst um ihn her mit mattem Strahl beschienen,
Ein streitendes Gestaltenheer,
Die seinen Sinn in Sklavenbanden hielten
Und, ungesellig, rauh wie er,
Mit tausend Kräften auf ihn zielten,
– So stand die Schöpfung vor dem Wilden.
Durch der Begierde blinde Fessel nur
An die Erscheinungen gebunden,
Entfloh ihm, ungenossen, unempfunden,
Die schöne Seele der Natur.
10. Und wie sie fliehend jetzt vorüber fuhr,
Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten
Mir zartem Sinn, mit stiller Hand,
Und lerntet in harmon’schem Band
Gesellig sie zusammen gatten.
Leichtschwebend fühlte sich der Blick
Vom schlanken Wuchs der Ceder aufgezogen,
Gefällig strahlte der Krystall der Wogen
Die hüpfende Gestalt zurück.
Wie konntet ihr des schönen Winks verfehlen,
Womit euch die Natur hilfreich entgegen kam?
Die Kunst, den Schatten ihr nachahmend abzustehlen,
Wies euch das Bild, das auf der Woge schwamm;
Von ihrem Wesen abgeschieden,
Ihr eignes liebliches Phantom,
Warf sie sich in den Silberstrom,
Sich ihrem Räuber anzubieten.
Die schöne Bildkraft ward in eurem Busen wach.
Zu edel schon, nicht müßig zu empfangen,
Schuft ihr im Sand – im Thon den holden Schatten nach,
Im Umriß ward sein Dasein aufgefangen.
Lebendig regte sich des Wirkens süße Lust –
Die erste Schöpfung trat aus eurer Brust.
11. Von der Betrachtung angehalten,
Von eurem Späheraug’ umstrickt,
Verriethen die vertraulichen Gestalten
Den Talisman, wodurch sie euch entzückt.
Die wunderwirkenden Gesetze,
Des Reizes ausgeforschte Schätze
Verknüpfte der erfindende Verstand
In leichtem Bund in Werken eurer Hand.
Der Obeliske stieg, die Pyramide,
Die Herme stand, die Säule sprang empor,
Des Waldes Melodie floß aus dem Haberrohr,
Und Siegesthaten lebten in dem Liede.
Füssli, Johann Heinrich, Lecture I. On Ancient Art(redac: 1801/03/16), p. 349 (anglais)
Great as these advantages were, it is not to be supposed that nature deviated from her gradual process in the development of human faculties, in favour of the Greeks. Greek Art had her infancy, but the Graces rocked the cradle, and Love taught her to speak. If ever legend deserved our belief, the amorous tale of the Corinthian maid, who traced the shade of her departing lover by the secret lamp, appeals to our sympathy to grant it, and leads us, at the same time, to some observations on the first mechanical essays of painting, and that linear method which, though passed nearly unnoticed by Winkelmann, seems to have continued as the basis of execution, even when the instrument for which it was chiefly adapted had long been laid aside. […] The first essays of the art were skiagrams, simple outlines of a shade, similar to those which have been introduced to vulgar use by the students and parasites of physiognomony, under the name of silhouettes, without any other addition of character or feature but what the profile of the object thus delineated could afford.
Delpech, François-Séraphin, Examen raisonné des ouvrages de peinture, sculpture et gravure, exposés au Salon du Louvre en 1814(publi: 1814), p. 129 (fran)
N°208. DIBUTADE
Ceux qui connaissent le genre de talent de Madame Chaudet n'ont pas besoin de voir son tableau de Dibutade, pour le juger. Ils doivent sentir que ce sujet ne pouvait convenir qu'à un peintre d'histoire, et qu'il exigeait une certaine élévation de style, dont elle n'a pas fait preuve dans ses précédents ouvrages. Si je le cite, c'est pour avoir occasion de rappeler que l'origine de la peinture est due à une femme, et que le premier usage qu'on en a fait a été de retracer les traits de l'objet aimé. Elle est donc destinée, comme on voit par cette allégorie, à nous offrir des images agréables; plaire est le principal but qu'elle doit se proposer.
Labouïsse-Rochefort, Jean-Pierre-Jacques-Auguste de, Souvenirs et mélanges littéraires, politiques, et biographiques(publi: 1826) (t. II), p. 208 (fran)
Le célèbre Falconet ayant été peint par une femme, on fit ce quatrain :
Dibutade peignit ; son maître fut l’Amour,
Et son amant fut son modèle ;
L’amitié triomphe à son tour ;
Elle a fait ce portrait fidèle.
Un savant contesta dans le temps le nom de Dibutade : c’était celui du père ; celui de la fille n’est pas connu ; elle n’a été désignée anciennement que par Corinthia virgo ; c’est ainsi qu’en parle François Junius dans son traité de Pictura veterum. Mais puisque Pline ne nous a pas fait connaître le nom particulier de la fille, a-t-on eu beaucoup de tort de lui donner celui de son père ? et Fontenelle n’aurait-il pas eu raison de faire parler Dibutadis dans l’une de ses Héroïdes, si ses vers surtout avaient été mieux faits ? Quant au rédacteur de l’ouvrage intitulé Anecdotes des beaux-arts, je lui pardonne d’avoir dit : « La belle Dibutade, fille d’un potier de Sicyone, passe pour la créatrice de cet art. » Dibutade aima et créa ; l’auteur a eu raison d’en conclure qu’elle était belle.
Girodet-Trioson, Anne-Louis, Œuvres posthumes(publi: 1829) (t. I), p. 48 (fran)
Oui, c’est lui[Explication : Cupidon.] qui, jadis, dans l’antique Argolide,
D’une jeune beauté guida la main timide,
Lorsque, d’un tendre amant, son doigt sûr et léger,
Arrêta sur le mur le profil passager
Qu’y dessinait sans art une ombre vacillante.
Oh ! douce et chaste erreur d’une pieuse amante !
Séparée à regret de l’objet de ses feux,
À cette esquisse encore elle portait ses vœux
L’adorait en silence, et l’image fidèle
Recevait les serments adressés au modèle !
O Dibutade ! non, ce ne fut pas en vain
Que l’amour t’embrasa de son transport divin :
Lui-même, il aiguisa cette flèche acérée,
Qui servit de crayon à ta main rassurée :
Son flambeau fut ta lampe, et Minerve, en ce jour,
Applaudit d’un sourire aux leçons de l’Amour.
Töpffer, Rodolphe, Réflexions et menus propos d’un peintre génevois ou Essai sur le beau dans les arts(publi: 1848) (t. II, ch. 20), p. 105 (fran)
L’art est-il né, comme le dit une assez niaise tradition, de l’idée qu’eut un amant de crayonner sur la muraille le contour de l’ombre qu’y projetait le profil de sa maîtresse, ou bien l’art est-il né, au contraire, du premier essai que fit un homme, amant ou non, pour réaliser, au moyen de l’imitation, quelque conception du beau, fruste encore, élémentaire, grossière, mais enfin issue de sa pensée et qui la charmait ?
Bonnefoy, Yves, La Vie errante(publi: 1993), « Celle qui inventa la peinture », 77 (fran)
Quant à la fille du potier de Corinthe, elle a depuis longtemps abandonné le projet d’achever de tracer du doigt sur le mur le contour de l’ombre de son amant. Retombée sur sa couche, dont la bougie projette sur le plâtre la crête fantastique des plis des draps, elle se retourne, les yeux comblés, vers la forme qu’elle a brisée de son étreinte. « Non, je ne te préférerai pas l’image, dit-elle. Je ne te livrerai pas en image aux remous de fumée qui s’accumulent autour de nous. Tu ne seras pas la grappe de fruits que vainement se disputent les oiseaux qu’on nomme l’oubli. »