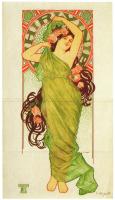Apelle, Praxitèle et Phryné
Bibliographie
Images
Athénée de Naucratis (Αθηναίος Ναυκρατικος), Δειπνοσοφισται (redac: (166):(233), trad: 2006:2012) (XIII, 590f), t. VI, p. 412 (grecque)
Ἦν δὲ ὄντως μᾶλλον ἡ Φρύνη καλὴ ἐν τοῖς μὴ βλεπομένοις. Διόπερ οὐδὲ ῥᾳδίως ἦν αὐτὴν ἰδεῖν γυμνήν · ἐχέσαρκον γὰρ χιτώνιον ἠμπείχετο καὶ τοῖς δημοσίοις οὐκ ἐχρῆτο βαλανείοις. Τῇ δὲ τῶν Ἐλευσινίων πανηγύρει καὶ τῇ τῶν Ποσειδωνίων ἐν ὄψει τῶν Πανελλήνων πάντων ἀποθεμένη θοἰμάτιον καὶ λύσασα τὰς κόμας ἐνέβαινε τῇ θαλάττῃ· καὶ ἀπ’ αὐτῆς Ἀπελλῆς τὴν Ἀναδυομένην Ἀφροδίτην ἀπεγράψατο.
Reinach, Adolph (éd.), Textes grecs et latins sur la peinture ancienne. Recueil Milliet, (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Phryné, au milieu de la fête des Éleusinies et de celle des Poseidonies, sous les yeux de tous les Grecs réunis, défit son manteau, délia sa chevelure, et entra dans les flots : ce fut là pour Apelle le modèle de l’Aphrodite Anadyomène
Athénée de Naucratis (Αθηναίος Ναυκρατικος), Δειπνοσοφισται , (trad: 2006:2012) (XIII, 590f), t. VI, p. 413 (trad: "The Learned Banqueters " par Olson, S. Douglas en 2006:2012)(anglais)(traduction récente d'un autre auteur)
The parts of Phyne's body that were not seen were actually the most beautiful. As a consequence, it was not easy to get a glimpse of her naked, because she used to wear a tunic that clung to her body, and avoided the public bath. But at the Eleusinia and the Posidonia festivals, with all the Greeks watching, she took off her robe, let down her hair, and entered the sea; Apelles drew the inspiration for his "Aphrodite Rising from the Sea" from her.
Clément d’Alexandrie, Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας (redac: (175):(200), trad: 1941) (IV, 53, 5-6 (cf Overbeck 1242)), p. 115 (grecque)
5 Πραξιτέλης δέ, ὡς, Ποσείδιππος ἐν τῷ περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ τῆς Ἀφροδίτης ἄγαλμα τῆς Κνιδίας κατασκευάζων, τῷ Κρατίνης τῆς ἐρωμένης εἴδει παραπλήσιον πεποίηκεν αὐτὴν, ἵν' ἔχοιεν οἱ δείλαιοι τὴν Πραξιτέλους ἐρωμένην προσκυνεῖν. 6 Φρύνη δὲ ὁπηνίκα ἤνθει ἡ ἑταίρα ἡ Θεσπιακή, οἱ ζωγράφοι πάντες τῆς Ἀφροδίτης εἰκόνας πρὸς τὸ κάλλος ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ αὖ καὶ οἱ λιθοξόοι τοὺς Ἑρμᾶς Ἀθήνησι πρὸς Ἀλκιβιάδην ἀπείκαζον.Ὑπλείπεται τῆς σῆς κρίσεως τὸ ἔργον ἐπάξαι, εἰ βούλει καὶ τὰς ἑταίρας προσκυνεῖν.
Clément d’Alexandrie, Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας , (trad: 1941) (IV, 53, 5-6), p. 116 (trad: "Le Protreptique " par Montdésert, Claude en 1941)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Praxitèle, comme le montre clairement Posidippe dans son livre sur Cnide, faisant la statue d'Aphrodite Cnidienne, lui donna la ressemblance de Cratinè son amie, afin que les malheureux habitants eussent à adorer la maîtresse de Praxitèle. 6. Lorsque Phryné, courtisane de Thespies, était dans la fleur de sa beauté, tous les peintres représentaient Aphrodite en lui prêtant ses traits, de même que les sculpteurs, à Athènes, donnaient à leur Hermès la ressemblance d’Alcibiade. A vous de mettre en œuvre votre jugement, pour voir si vous voulez adorer aussi les courtisanes !
Arnobe (Arnobius), Adversus nationes (redac: (297):(304), trad: 2010) (VI, 13), Overbeck 1242 (latin)
Quis Praxitelem nescit, Posidippi si relegat, ad formam Cratinae meretricis, quam infelix perdite diligebat, os Veneris Cnidiae sollertiarum collegisse certamine ? Phryna illa Thespiaca, sicut illi referunt qui negotia Thespiaca scriptirarunt, cum in acumine ipso esset pulchritudinis uenustatis et floris, exemplarium fuisse perhibetur cunctarum quae in opinione sunt Venerum siue per urbes Graias, siue iste quo fluxit amor talium cupiditasque signorum
Arnobe (Arnobius), Adversus nationes , (trad: 2010)(trad: "Contre les gentils, livre VI " par Fragu, Bernard en 2010)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Qui ignore, pour peu qu’il relise les œuvres de Posidippus, que Praxitèle donna à la Vénus de Cnide le visage de sa maîtresse Cratinè, que le malheureux aimait à la folie, dans al rivalité des habiles ? La célèbre Phryné de Thespies, à ce que racontent ceux qui ont écrit l’histoire de Thespies, était juste au sommet de sa beauté, de sa grâce et de sa fleur : on la présente comme le modèle de toutes les Vénus que l’on tient en estime soit dans les villes de Grèce, soit là où coule cet amour et ce désir de ce genre de statues.
Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551) (liber VII, cap. XVI), p. 410 (latin)
Apelles quoque patria Cous, peritia et gloria artis pingendi nemine inferior, pinxit celeberrimam Venerem emergentem, cuius vultum tantum ac pectos expressit e Phrynes formosissimæ amicæ aspectu, quod ea talis videretur Neptunaliorum Cerealiorumque tempore in omnium Græcorum conspectu ad mare vestibus et comis solutis.
Conti, Natale (dit Noël le Conte); Montlyard, Jean de (pseudonyme de Jean de Dralymont), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem, p. 782 (trad: "Mythologie, c’est à dire Explication des fables, contenant les généalogies des dieux, les cérémonies de leurs sacrifices, leurs gestes, adventures, amours et presque tous les préceptes de la philosophie naturelle et moralle. Extraite du latin de Noël Le Comte... par I. D. M.")(fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Apellés de Co ne cedant à personne en habileté et excellence de peinture, peignit une tres-belle Venus sortant des vagues de la mer : le visage et la poitrine de laquelle il tira sur celui d’une sienne amie, Phryne, femme belle en toute perfection, si que durant les festes de Neptune et de Cerés on l’avoit prise pour Venus. Elle prenoit ses cheveux à deux mains, et les espuroit sur le bord de la mer, avec tel artifice que c’estoit chose merveilleusement belle à voir.
Dolce, Lodovico, Dialogo di pittura intitolato l’Aretino, nel quale si raggiona della dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie che a perfetto pittore si acconvengono(publi: 1557), p. 176 (italien)
Devesi adunque elegger la forma più perfetta, imitando parte la natura. Il che faceva Apelle, il quale ritrasse la sua tanto celebrata Venere che usciva dal mare (di cui disse Ovidio che, se Apelle non l’avesse dipinta, ella sarebbe sempre stata sommersa fra le onde) da Frine, famosissima cortigiana della sua età ; et ancora Prasitele cavò la statua della sua Venere Gnidia dalla medesima giovane. E parte si debbono imitar le belle figure di marmo e di bronzo dei maestri antichi; la mirabile perfezzion delle quali chi gusterà e possederà a pieno, potrà sicuramente corregger molti difetti di essa natura e far le sue pitture riguardevoli e grate a ciascuno, percioché le cose antiche contengono tutta la perfezion dell’arte e possono essere esemplari di tutto il bello.
Molanus, Johannes, De picturis et imaginibus sacris(publi: 1570, trad: 1996) (II, 37), p. 128 (latin)
- [1] Orat. ad Gentes
Lasciuiam omnem vitandam esse in sacris imaginibus. [...] Visae quandoque sunt in locis vbi non decuit diuorum imagines, viuentium adhuc hominum ora vultusque referre, vt hoc vmbraico velamento illorum quos amabant effigie pascerent oculos. Hic fucus eliminari prohiberique debet, velut pestiferum illecebrosae cogitationis irritamentum. Nam adhunc modum imaginibus abuti nefarium est.
[1] Hac sane de causa etiam gentes irrisit Clemens Alexandrinus. Praxiteles, inquit, vt declarat Posidippus in libro de Cnidio, Veneris Cnidiae construens imaginem, fecit eam formam similem Cratinae quam amabat, vt adoratent miseri amicam Praxitelis. Cum floreret autem Phryne meretrix Thespiace, pictores omnes imitabantur Veneris imaginem ad Phrynes pulchritudinem. Sicut rursus lapicidae quoque Mercurius effingebant Athenis ad Alcibiadem. Restat nunc tuum adhiberi iudicium, si velis etiam adorare meretrices ?
Molanus, Johannes, De picturis et imaginibus sacris, (trad: 1996)(trad: " Traité des saintes images" par Christin, Olivier; Tassel, Benoît en 1996)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
- [1] Le Protreptique, l. VI
On voit parfois, en certains lieux où l’on n’aurait pas dû les accepter, des images de saints portant le visage et les traits d’hommes encore vivants ; et sous le couvert de ce subterfuge, les yeux se repaissent du portrait de ceux que l’on aime. Cette supercherie doit être éliminée et interdite car c’est une peste qui provoque la pensée à s’exciter. De fait, abuser des images dans cette perspective est funeste. C’est pour ce motif assurément que Clément d’Alexandrie se moqua des nations païennes : Praxitèle, dit-il, comme le montre clairement Posidippe dans son livre sur Cnide, faisant la statue d’Aphrodite Cnidienne, lui donna la ressemblance de Cratinè, qu’il aimait, afin que les malheureux habitants eussent à adorer la maîtresse de Praxitèle. Lorsque Phryné, courtisane de Thespies, était dans la fleur de sa beauté, tous les peintres représentaient Aphrodite en lui prêtant ses traits, de même que les sculpteurs d’Athènes donnaient à leur Hermès la ressemblance d’Alcibiade. À vous de mettre en œuvre votre jugement, pour voir si vous voulez adorer ainsi les courtisanes. [1]
Commentaires : Trad. F. Boespflug
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1637) (III, 2, 5 ), p. 262 (anglais)
- [1] Lib. XXXV, cap. 10.
- [2] Lib. VI. adversus gentes.
Many noble and renowned painters did in great troups resort to Lais, drawing for strife the brests and paps of her most beautifull body: yea Apelles made for this very reason wonderfull much of her, when she was not yet growne to her full age. The same Apelles made also that same famous picture called Venus Anadyomene, after the example of Phryne, as shee, to celebrate Neptunus feast, went starke naked into the sea, with her haire hanging loose down. See Athenaus lib. XIII, Deipnosoph. Although Pliny affirmeth, that the said Venus was made after Campaspe, a concubine of Alexander the Great. [1] Clemens Alexandrinus doth likewise relate, that the ancient painters ordinarily drew Venus in the likeness of Phryne: and that the ancient carvers also made the images of Mercury after the similitude of the goodly and handsome shape of Alcibiades. Arnobius teacheth us, that Praxiteles his Cnydian Venus was made after Cratina the whore. [2]
Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), De Graphice (numéro cap. V) , §49, p. 84 (latin)
- [2] p. 591 ed. Commel.
[1]
Multum gloriam meruit pingendo Venerem ἀναδυομένη sive e mari emergentem. Quam fecit ad exemplum Campaspes, pellicis Alexandri : ut est apud Plinium lib. XXXV cap. X. Vel, ut Athenaeus lib. XIII [2] narrat, exemplo Phrynes, conventibus Eleusiniis, aut Neptuni feriis, nudae, ac capillo passo, mare ingredientis. De hac ita Ovidius lib. IV de Ponto eleg. I :
Vt Venus artificis labor est, et gloria Coi,
Aequoreo madidas quae premit imbre comas.
Ac Propertius lib. III eleg VIII :
In Veneris tabula summam sibi ponit Apelles.
- [1] voir aussi Apelle Vénus anadyomène.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Vita d’Apelle » , p. 97 (italien)
: Alcuni asseriscono che il naturale di questa dea fosse cavato da Campaspe ; altri da Frine famosissima meretrice , la quale per ordinario non mai lasciandosi vedere ignuda, nel gran concorso, che si faceva presso ad Eleusi per le feste di Nettuno, deposte le vestimenta, e sparsi i capelli a vista di tutti sen’ entrava nel mare.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669), note (numéro vol. 3) , p. 583-584 (latin)
[1]
Venerem ἀναδυομενην Apellis pictam, Venerem Cnidiam Praxitelis sculptam fuisse ad exemplar Phrynes κλαυσιγέλωτος, sive σηστου, cum in Eleusiniorum panagyri spectante universa Græcia nudasset corpus, et in mare solute coma descendisset, scribit Athenæus pag. 292. vers. 29. Verba Rhodig. c. 15 l. 14 sunt hæc: Postea Phrynen miramur, non Hyperidis actione, quanquam admirabili, sed conspectus corporis, quod illa speciossimum alioqui, deducta nudaverat tunica, periculo liberatam: interposito mox decreto, ne quis misericordiæ captandæ gratia epiloguis uteretur. Hæc vero est, de qua Propertius ita canit :
Nec quam deletas potuit componere Thebas
Phryne, tam multis facta beata viris.
Ejus statuam fuisse apud Delphos auream scribit Libanius. Commeminit in præceptis sanitatis etiam Plutarchus, eam dicere solitam prodens, ubi jam consensuisset, ac flacida toto foret corpore, τὴν τρύγα πλείωνος πωλεῖν δια τὴν δόξαν, id est, pluris fecem vendere ex opinione, quam de ipsa concepissent homines. Hanc denique dixere Græci lecythum habere in malis : quod exponens Suidas, velut in sinu plane servans Græcorum omnia, ad faciei retulit tumorem : credo, quia sit lecythus protuberans vas : etiamsi de corporis habitu, hoc est a parvitate, Olpem piscatorem nuncupatum, conjectant Græcorum nonnulli ; quoniam Olpe lecythum indicet. Ego ad formæ elegantiam referendum contenderim. Ut illam intelligamus naturali specie præsignem, accersitam commendationem, et peregrinas haud magnopere nugas conquisivisse : quando lecythum Plinii testimonio, et Marci Tullii in epistolis ad Atticum, pro orationis etiam splendore, ac excussa in scribendo cura novimus accipi. Erat enim oleo dicatum vas lecythus, sed et unguentis quoque, unde et Lecythophorus puer Polluci. Verum et Trochaicum dimentrum catalecticum, quod Euripidion dicunt, etiam Lecythium vocatur, vel ex Aristophanis scommate, vel trochaici bombi ratione : quem exhibet lecythium quoque. Hactenus Rhodiginus, qui loco citato paulo post, Scribit (inquit) Apollodorus Phrynes fuisse duas ; alteram quarum Clausigelota cognominarit ; alteram vero Sarpedion. Clausigelos verbum apud Xenophontem est libro rerum Græcarum septimo, πάντας δὲ τοὺς παρόντας τότε γε τῳδ’ὄντι κλαυσιγελως ἶχεν, id est, præsentes autem universos tunc sane sonantior habebat risus. Herodicus celebratam Rhetoribus Phrynen σηστὸν, id est, Sestum vocitatam, tradit, quod attaminaret despoliaretque adeuntes, σηστὸν attaminare est. Quam avarior quispiam subblandiens diceret, Aphrodisium Praxitelis es ; at tu, inquit Phryne, amor Phidiæ. Demum libet lucubrationi huic, quam videmur, ducente stilo, in fœminas declamasse, quas tamen alibi summis celebrare laudibus, non expavimus, insererebreve quiddam ex Græcorum sanctuariis, non bonas lacerando, sed a malo malas deterrendo ;
Θησαθρὀς ἐστι τῶν κακῶν κακὴ γυνή.
Θηρῶν ἀπάντων ἀγριωτέρα κακὴ γθνή.
Θάλασσα, ἢ πῦρ ἢ γυνὴ κακὰ τρία.
Hactenus Rhodiginus. Anadyomenes meminit Pausanias in Corinthiacis. Idem.
- [1] voir aussi Apelle et Campaspe
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Hoe de Schoonheyt by d’ouden is betracht » (numéro VIII, 3) , p. 289 (n)
[1] Apelles bracht de vermaerde Lais, eer zy noch volwassen was, dikwils te pas. Van gelijken Phryne en Campaspe, op de welke hy zoo ge weldich, om haer uitnemende schoonheit, verliefde, dat Alexander, dieze ook beminde, uit edelmoedigheit, haer aen hem overliet; op dat hy met ruste, de uit der Zee opklimmende Venus, by de Grieken Anadyomene genoemt, na haer mocht voltrekken. welk stuk hy ook zoodanich uitvoerde, dat, toen her lang daer na, onder aen een weinich verdorven was, geen Schilder zoo stout te vinden was, die het dorst ondernemen te verhelpen. Andere Schilders hebben de schoone Gratina, Theodota, en meer andere vermaert gemaekt. Zy onderscheyden ook den landaert, want zy vonden meer schoonheit in d'Abderitaenen, als in andere, dies zy die meest in haere werken gebruikten. Want men vint volken en gestachten, die andere in schoonheyt overtreffen.
- [1] voir aussi Apelle et Campaspe
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Comment la beauté a été recherchée par les anciens » (numéro VIII, 3) , p. 433 (trad: "Introduction à la haute école de l’art de peinture" par Blanc, Jan)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Apelle s’est souvent servi de la fameuse Laïs, avant qu’elle n’atteigne l’âge adulte, tout comme de Phryné et de Campaspé, dont il tomba si vivement amoureux de l’excellente beauté qu’Alexandre, qui l’aimait également, la lui céda, par magnanimité, afin qu’il pût en toute tranquillité peindre d’après ses traits la Vénus sortant de la mer, appelée par les Grecs Anadyomène. D’autres peintres ont rendu célèbres les belles Cratina, Théodoté, et beaucoup d’autres. Ils différenciaient également les nationalités, trouvant plus de beauté chez les Abdéritaines que chez les autres et en en faisant la plu- part du temps usage dans leurs œuvres. On trouve en effet des peuples et des races qui surpassent les autres en beauté.
Commentaires : Trad. Jan Blanc, VIII, 3, « Comment la beauté a été recherchée par les anciens », p. 433
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (III, 2, 5), p. 163 (latin)
Pictores olim ad Laïdem consertim cursitare solebant, pectus atque ubera bellissimi corporis delineaturi; eamque ob id ipsum, vix dum adultam, magno in pretio habuit Apelles ; qui etiam nobilem illam Venerem anadyomenen pinxit ad exemplum Phrynes apud Eleusinem Neptuni feriis mare ingressae, capillo passo, depositis vestibus: Athenaeus libro XIII. Quamquam Plin. libro XXXV, cap. 10, ad exemplum Campaspes pellicis Alexandri magni pictam tradat Venerem illam e mari emergentem. Testatur etiam Clemens Alexandrinus in Protreptico, imagines Veneris a pictoribus Phrynes formam, quamdiu ea accuratissimam Alcibiadis formam effictos.
Dupuy du Grez, Bernard, Traité sur la peinture(publi: 1699), p. 55 (fran)
Apelle au reste surpassa tous les peintres de son temps, et tous ceux qui l’avoient precedé : on parle sur toutes choses de son tableau de la déesse Vénus : il l’avait representée sortant de la mer, et il avait pris pour modèle une des maîtresses d’Alexandre, qui s’appelait Campaspe, comme l’a écrit Pline : d’autres ont dit que cette déesse ressembloit à Phriné que ce peintre avait veu toute nuë, aux assemblées d’Éleusis ou à la Féte de Neptune.
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung(publi: 1755, trad: 1991), p. 8 (allemand)
Die schönsten jungen Leute tanzten unbekleidet auf dem Theater, und Sophocles, der große Sophocles, war der erste, der in seiner Jugend dieses Schauspiel seine Bürgern machte. Phryne badete sich in den Eleusinischen Spielen vor den Augen aller Griechen, und wurde beim herausteigen aus dem Wasser den Künstlern das Urbild einer Venus Anadyomene; und man weiß, daß die jungen Mädchen in Sparta an einem gewissen Feste ganz nackend vor den Augen der jungen Leute tanzten. Was hier fremde scheinen könnte, wird erträglicher werden, wenn man bedenket, daß auch die Christen der ersten Kirche ohne die geringste Verhüllung, so wohl Männer als Weiber, zu gleicher Zeit und in einem und eben demselben Taufstein getauft, oder untergetaucht worden sind. Also war auch ein jedes Fest den Griechen eine Gelegenheit für Künstler, sich mit der schönen Natur aufs genaueste bekannt zu werden.
Winckelmann, Johann Joachim, Gedanken über die Nachahmung der grieschichen Werke in der Melerei und Bildhauerkunst, Sendschreiben und Erlauterung, (trad: 1991), p. 21-22 (trad: "Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture" par Charrière, Marianne en 1991)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Les plus beaux adolescents dansaient nus au théâtre et dans sa jeunesse, Sophocle, le grand Sophocle, fut le premier à donner ce spectacle à ses concitoyens. Aux jeux d’Éleusis, Phryné se baigna sous les yeux de tous les Grecs et, au sortir de l’eau, elle fournit aux artistes l’archétype d’une Vénus anadyomène. On sait aussi qu’à Sparte, les jeunes filles dansaient entièrement nues devant les jeunes gens, lors de certaines fêtes. Ce qui pourrait ici nous dépayser ou nous choquer, on l’admettra plus facilement si l’on songe que les premiers chrétiens, hommes et femmes, étaient plongés ensemble dans les mêmes fonds baptismaux. Ainsi, chaque fête en Grèce était pour les artistes l’occasion de connaître avec la plus grande exactitude la belle nature.
Commentaires : Trad. Réflexions sur l’imitation, 1991, p. 21-22
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), Von dem Ausdruck der Leidenschaften“ (numéro III, 43, t. II) , p. 613 (allemand)
Es ist genug, wenn der Geschmack unserer Kunstrichter sich verfeinert, und was ihn beleidiget, oder ihm gefällt, nur mit durchgängiger Gerechtigkeit anzeiget. Wäre uns solches Gemählde unter Alterthümern aufbehalten worden: so würden andere vielleicht eben so bereit seyn, den Geschmack des Künstlers zu bewundern, der uns die Venus unter der bekannten Stellung, in welcher vielleicht Apelles die ins Wasser gestiegene Phryne verewiget hat, kenntlicher gebildet. Gravelle oder Ogle würden vielleicht den Beweis erleichtern müssen.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’expression des passions » (numéro III, 43, t. II) , p. 112 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Il suffit que le goût de nos critiques, à mesure qu’il s’épure, nous indique de bonne foi ce qui le choque et ce qui lui plaît. Si parmi les antiques nous trouvions un tableau qui représentât Vénus s’arrachant les cheveux, il se trouveroit sans doute des écrivains tout aussi disposés à admirer le goût de l’artiste qu’ils le sont à nous vanter l’attitude de cette déesse, dans laquelle Apelle immortalisa la belle Phryné qui, s’étant dépouillée de ses vêtements, entra nue dans la mer et servit de modele au peintre. Les collections des pierres gravées d’un Gravelle ou d’un Ogle pouroient peut-être prouver ce que j’avance.
Commentaires : Trad. Huber, 1775, III, 43, « De l’expression des passions », t. II, p. 112
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei(publi: 1762), “Die Antike und die Schöne Natur” (numéro I, 6) , p. 74 (allemand)
Allein, ich muß es Ihnen, geliebter Freund, gestehen: ich möchte nicht gerne von der Seltenheit, auf die gänzliche Sparsamkeit der Natur in Verschönerung einzelner Gegenstände schliessen. Die Wahl wird vorausgesetzt. Ich begehre auch das Exempel des Demetrius nicht anzuführen. Dessen erhabene Schönheit konnte, wie es bei dem Plutarch in dessen Leben heißt, weder von den Mahlern, noch von den Bildhauern seiner Zeit erreichet werden, ungeachtet dazumal die größten Künstler lebten. Nebenumstände können sich hier eingemischet haben; und vieilleicht mochte von dem Bericht der Geschichtschreiber die Ueberzeugung der Künstler etwas abgehen, die gewohnt waren, die Gesetze der Aehlichkeit, zu beobachten. Genug, Apelles fand zu seiner Venus, die aus dem Meere steiget, ein Muster in der Natur[1]. Vom Alcibiades ward Merkur genommen. Ist es auch, wie Herr Winckelmann in ähnlichem Fall vom Praxiteles und andern sehr wahrscheinlich angiebt[2], geschehen, ohne von den allegemeinen grossen Gesetzen der Kunst abzuweichen: so half doch das wohlgewählte Urbild die idealische Schönheit sinnlich ausdrücken. Geschmack und Wahrheit verlangen nichts mehr.
- [1] Plinius muthmasset, es sei die Campaspe, die dem Apelles abgetretene Geliebte des Alexanders, gesehen. Athenaus sagt es ausdrüklich, daß Apelles sie nach der Phryne, als sie an dem Feste, das dem Neptun zu Ehren gehalten wurde, entkleidet ins Meer gestiegen, geschildert habe; und Arnobius versichert, daß man in ganz Griechenland die Bilder der Venus nach dieser berühmten Schönheit gemahlet habe.
- [2] Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke S. 11.
Hagedorn, Christian Ludwig von, Betrachtungen über die Malerei, « De l’antique et de la belle nature » (numéro I, 6) , p. 70 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Il faut vous avouer, mon cher ami, de ce qu’il est rare de trouver des objets individuels parfaitement beaux, je n’en voudrois pas inférer que la nature en fût entierement avare. Je suppose toujours dans l’artiste la capacité d’en faire le choix. Je ne veux pas non plus citer l’exemple de Démétrius Poliorcetes. Plutarque rapporte dans la vie de ce prince que sa beauté étoit telle que ni les peintres ni les sculpteurs de son tems, ne purent venir à bout de la rendre parfaitement, quoiqu’on vit fleurir alors les plus grands artistes. Dans ce fait il peut y avoir eu du plus ou du moins; il se pouroit bien aussi que le récit des historiens ne s’accordât pas avec le sentiment des artistes accoutumés à observer les loix de l’harmonie, au dépens même d’un peu de ressemblance. Il suffit de remarquer qu’Apelle, pour faire sa Venus sortant de la mer, trouva un modele dans la nature[1]. La figure de Mercure fut faite d’après celle d’Alcibiade. Si Praxitele et d’autres, suivant les observations de M. Winckelmann[2], ont procédé de la même façon dans les cas semblables, sans s’écarter des loix universelles de l’art, il résulte que le modele d’un beau choix concouroit à rendre d’une maniere sensible la beauté idéale de l’artiste. Le goût et la vérité n’en demandent pas davantage.
- [1] Pline présume que c’étoit Campaspe maîtresse d’Alexandre qui la céda à Apelle. Cependant Athenée dit expressément qu’Apelle avoit fait sa Venus d’après Phryné, lorsque cette fameuse courtisane, à la fête de Neptune, se deshabilla devant le peuple et entra toute nue dans la mer. Arnobe l’Ancien nous assure que toutes les figures de Venus, connues dans la Grece, avoient été faite d’après cette illustre beauté.
- [2] Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke etc.
Commentaires : Trad. Huber, Réflexions sur la peinture, 1775, I, 6, « De l’antique et de la belle nature », p. 70
De l’usage des statues chez les Anciens. Essai historique(publi: 1768), « Des statues en l’honneur des femmes » (numéro Deuxième partie, chapitre sixième) , p. 271-272 (fran)
- [1] Pausan. Corinth. lib. II
- [3] Elian. Variat. Hist. lib. IX. 32
Si toutes les courtisannes auxquelles les Grecs dresserent des statues, eussent eu autant de titres séduisants qu’en eut Aspasie, une telle pratique mériteroit peut-être quelque indulgence ; mais ces monuments scandaleux de la lubricité des Grecs, devinrent trop communs pour ne pas surpasser, et la fidélité de l’histoire exige que nous en parlions.
On crut devoir consacrer aux siecles futurs la beauté surprenante de la courtisanne Laïs par une statue dans le temple de Vénus auprès de Corinthe [1], statue à laquelle les femmes qui se vouoient au ministere des plaisirs d’autrui, rendoient des honneurs. La fameuse Phryné eut deux statues faites de la main de Praxitelle un de ses amants : l’une étoit sous la figure d’une matronne larmoyante, l’autre sous celle d’une courtisanne qui se réjouit, sur le visage de laquelle, dit Pline[2] on voyoit et la passion de l’artiste, et le salaire qu’elle lui en avoit accordé ; on poussa l’impudence jusqu’à placer un pareil monument de libertinage sur une colonne dans le temple de Delphes, et c’est à la vue de cette image scandaleuse [3], que Crater le Cynique dit que l’on voyoit dans le temple une offrande de l’intempérance des Grecs.
- [2] Deprebenduntque in ea amorem artificis et mercedem in vultu meretricis. Pl. l. XXXIV. 8.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772), Notes (numéro t. I) , p. 368-369 (fran)
[1] (54) Bayle a fort bien montré que Pline manque ici d’exactitude, et qu’il multiplie les êtres sans nécessité, en faisant d’un seul morceau deux tableaux de Vénus qu’Apelles laissa imparfaits. (Voyez son article Apelles rem (I)). Quoiqu’il en soit de ce tableau ou de ces tableaux, Pline avoit oui dire que Campaspe servit de modèle pour la Vénus Anadyomène ; Athénée avoit aussi oui dire que c’étoit Phryné : d’où il résulte que la plupart de ces historiettes reçues de main en main, sont ou fausses ou incertaines ; ce qui n’empêche pas quelques écrivains d’assurer chacun de leur côté, que la chose s’est passée comme ils vous le disent. Campaspe et Phryné étant contemporaines, aurait pu toutes deux servir de modèle pour un même tableau ; et du reste il est fort indifférent que ce soit l’une ou l’autre. Ce n’est pas cependant que le sujet ne soit digne du savantissime Docteur Chrysostome Matanasius.
- [1] voir aussi Apelle Vénus anadyomène
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776) (t. I), p. 203-204 (fran)
Apelle rencontra un jour la courtisane Phryné, encore toute jeune, qui, portant une cruche d’eau, revenoit du Pirée[1] ; il fut tellement épris de sa beauté naissante, qu’il l’amena souper avec lui, et avec plusieurs de ses amis. Comme on le plaisantoit sur l’extrême jeunesse de Phryné : « Je vous prédis, leur dit-il, qu’elle effacera toutes les beautés d’Athènes, et je vous promets que cet enfant verra quelque jour à ses pieds des vieillards et des sages ».
Apelle surprit un jour cette Phryné, qui, venant de se baigner, n’étoit seulement couverte que de ses cheveux, dont l’ébène éclatant relevoit la blancheur d’une peau admirable. Apelle, rentré chez lui, l’ame remplie de ce charmant spectacle, et vivement amoureux de Phryné, conçut l’idée de peindre sa fameuse Vénus, sortant des eaux. Le prodigieux succès de ce tableau dut enorgueillir la belle Phryné, puisque Vénus n’étoit que son image, et qu’elle servoit ordinairement de modèle lorsqu’on vouloit représenter la mère de l’amour[2]
- [1] Le port d’Athènes.
- [2] Nous verrons aussi le sculpteur Praxitèle prendre pour modèle cette courtisane si fameuse. Pline dit que la Vénus sortant des eaux était le portrait de Campaspe. Nous avons cru devoir suivre le récit d’Athénée, liv. 13.
Arnaud, François, Mémoire sur la vie et les ouvrages d’Apelle(redac: 1783/06/02) (t. III), p. 183 (fran)
Quelques auteurs prétendent que ce fut d’après la belle Campasque qu’Apelle peignit cette déesse ; et d’autres, d’après Phryné, célèbre courtisane qui ne se montrait nue que dans les jours de fête consacrés à Neptune, où se transportant sur le bord de la mer, elle quittait tous ses vêtements, et entrait dans l’eau abandonnant sa chevelure au gré des vents, et ses charmes les plus secrets aux regards de la multitude.
Pauw, Cornélius de, Recherches philosophiques sur les Grecs(publi: 1788), « Considérations sur l’état des beaux-arts à Athènes », §1, « De la peinture, et de la Vénus et Cos et de Gnide », t. II (numéro III, 7) , p. 72-73 (fran)
Ce qui démontre combien il étoit difficile de trouver parmi les femmes Grecques des personnes réellement accomplies, c’est que Praxitèle et Apelle durent se servir du même modèle pour exécuter la Vénus de Cos en couleurs : Athénée, infiniment mieux instruit à cet égard que Pline le Naturaliste, assure que cette fameuse statue et ce fameux tableau étoient deux copies différentes de la courtisane Phryné, née à Thespies en Béotie, mais qui vint depuis exercer son empire à Athènes même[1]. Après avoir étudié plusieurs attitudes, elle crut en avoir découvert une qui lui paroissoit très-favorable pour faire briller tous les charmes de sa taille, et toutes les perfections de sa figure : c’est ainsi qu’elle voulut être peinte, et c’est encore ainsi qu’elle voulut être sculptée. Les artistes durent malgré eux se soumettre aux caprices de cette femme, qui tyrannisoit les yeux de l’un, et l’ame de l’autre.
De là il résulta que la Vénus de Gnide et la Vénus de Cos se ressembloient tellement, qu’il n’étoit pas possible d’y observer la moindre différence, ni dans les traits, ni dans le contour, ni surtout dans l’attitude : on y voyoit deux fois Phryné sortant des eaux du golfe Saronique, où elle se baignoit souvent entre Athènes et Éleusis sur la plage de Sciron. Mais il s’en faut de beaucoup que la figure peinte par Apelle ait jamais suscité autant d’enthousiasme dans l’esprit des Grecs, que la figure sculptée par Praxitèle : là ils croyoient l’entendre parler, et leur illusion étoit telle, dit Lucien, qu’ils finissoient par appliquer leurs lèvres sur celles de la Déesse. Aussi trouve-t-on dans l’Anthologie beaucoup plus de vers faits en l’honneur de la Vénus de Gnide, qu’en l’honneur de celle de Cos[2].
- [1] Dipnosoph. Lib. XIII. C. 2.
- [2] Lucien, dans les ἘΡΩΤΕΣ ou les Amours, et l’Anthologie, à l’article des Statues.
Barthélémy, Jean-Jacques, Le Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire(publi: 1788), « Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées à Anacharsis et à Philotas, pendant leur voyage en Égypte et en Perse » (numéro Seconde partie, Section troisième, ch. LXI, vol. 3) , p. 337-339 (fran)
Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est éclairé, cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes que dans d’autres ; et que dans les premières, la principale classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, je n’en excepte pas celle d’Athènes, tient d’autant plus à ses superstitions, qu’on fait plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les dernières fêtes d’Éleusis, la jeune et charmante Phryné, s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tomber ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la mer, et se joua long-temps au milieu des flots. Un nombre infini de spectateurs couvroit le rivage ; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : c’est Vénus qui sort des eaux. Le peuple l’auroit prise pour la déesse, si elle n’étoit pas si connue, et peut-être même, si les gens éclairés avoient voulu favoriser une pareille illusion.
N’en doutez pas, les hommes ont deux passions favorites, que la philosophie ne détruira jamais ; celle de l’erreur, et celle de l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et revenons à Phryné. La scène qu’elle nous donna et qui fut trop applaudie pour ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage des arts. Le peintre Apelle, et le sculpteur Praxitèle étoient sur le rivage. L’un et l’autre ont résolu de représenter la naissance de Vénus, d’après le modèle qu’ils avoient sous les yeux[1].
Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, et vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux tant de grâces à-la-fois. Praxitèle en est éperdument amoureux. Il se connoît en beauté ; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si parfait. Elle vouloit avoir le plus bel ouvrage de cet artiste. Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il, à condition que vous le choisirez vous-même. Mais comment se déterminer au milieu de tant de chefs-d’œuvre ? Pendant qu’elle hésitoit, un esclave secrètement gagné, vint en courant annoncer à son maître, que le feu avait pris à l’atelier, que la plupart des statues étaient détruites, que les autres étoient sur le point de l’être. Ah ! C’en est fait de moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour et le Satyre ! Rassurez-vous, lui dit Phryné en riant ; j’ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous forcer à m’éclairer sur mon choix. Elle prit la figure de l’amour, et son projet est d’en enrichir la ville de Thespies, lieu de sa naissance[2]. On dit aussi que cette ville veut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple de Delphes, et la placer à côté de celle de Philippe[3]. Il convient en effet qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant.
- [1] Athen. lib. 12, p. 590.
- [2] Pausan. lib. I, cap. 20, p. 46.
- [3] Athen. lib. 12, p. 590.