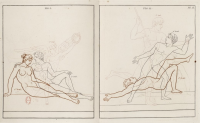Apelle et Protogène : le concours de la ligne
Bibliographie
Images
Le concours de la ligne entre Apelle et Protogène, reconstitutionQUATREMÈRE DE QUINCY Antoine Chrysostome
Medium : gravure
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV(redac: 77, trad: 1985) (81-83)(latin)
Scitum inter Protogenen et eum quod accidit. Ille Rhodi uiuebat, quo cum Apelles adnauigasset, auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam una custodiebat anus. Haec foris esse Protogenen respondit interrogauitque, a quo quaesitum diceret. “Ab hoc,” inquit Apelles adreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Et reuerso Protogeni quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellen uenisse, non cadere in alium tam absolutum opus; ipsumque alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse abeuntemque praecepisse, si redisset ille, ostenderet adiceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertit enim Apelles et uinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes uictum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens, placuitque sic eam tabulam posteris tradi omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam priore incendio Caesaris domus in Palatio audio, spectatam Rhodi ante, spatiose nihil aliud continentem quam lineas uisum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem.
Pline l'Ancien (Gaius Plinius Secundus), Naturalis Historia, liber XXXV, (trad: 1985) (81-83)(trad: "Histoire naturelle. Livre XXXV. La Peinture" par Croisille, Jean-Michel en 1985)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Ce qui se passa entre Protogène et lui ne manque pas de sel. Le premier vivait à Rhodes, Apelle y débarqua, brûlant de prendre connaissance de son œuvre, dont seule lui était parvenue la renommée, et il gagna incontinent son atelier. Le maître était absent, mais un tableau de notables proportions placé sur un chevalet était surveillé par une vieille femme toute seule. À sa question, elle répondit que Protogène était sorti et demanda qui elle devrait lui annoncer comme visiteur. « Voici », dit Apelle, et, s’emparant d’un pinceau, il traça au travers du tableau une ligne de couleur d’un délié extrême. Au retour de Protogène la vieille lui révéla ce qui s’était passé. On rapporte qu’alors l’artiste, dès qu’il eut contemplé cette finesse, dit que le visiteur était Apelle et que personne d’autre n’était capable de rien faire d’aussi achevé ; puis il traça lui-même, avec une autre couleur, une ligne encore plus fine sur la première et repartit en prescrivant, au cas où l’autre reviendrait, de la lui montrer et d’ajouter que c’était là l’homme qu’il cherchait. C’est ce qui se produisit, car Apelle revint et, rougissant de se voir surpassé, il refendit les lignes avec une troisième couleur, ne laissant nulle place pour un trait plus fin. Protogène alors, reconnaissant sa défaite, descendit en hâte au port à la recherche de son hôte et il fut décidé de garder ce tableau pour la postérité comme un objet d’admiration, universel certes, mais tout particulièrement pour les artistes. J’apprends qu’il a brûlé lors du premier incendie du palais de César sur le Palatin ; nous avions pu le contempler auparavant : sur une grande surface il ne contenait que des lignes qui échappant presque et, semblant vide au milieu des chefs-d’œuvre de nombreux artistes, il attirait l’attention par là-même et était plus renommé que tous les autres ouvrages.
Pline l’Ancien; Landino, Cristoforo, Historia naturale di C. Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro Landino fiorentino, fol. 240v (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
E da notare quello che intervenne tra lui e Protogene. Navigo in Rhodi Appelle cupido di vedere l’opere di Protogene elquale conosceva solamente per fama. Arrivo adunque alla sua officina ne velo trovo: ma vide una tavola grande laquale havea acconcia per dipingervi et una vecchia che la guardava et domandandolo la vechia chi esso fussi elquale adomandassi Protogene: rispose Apelles e prese el penello e meno una linea per quella tavola di somma tenuita: Torno Protogene et inteso dalla vecchia tutto il facto e riguardando tanto sottile linea disse chostui e Apelle perche altri non harebe facta si perfecta opera e dipoi fece una altra linea d’uno altro colore appresso a quella e più sottile di quella e partendosi dixe ala vechia che se Abpelle (sic) ritornassi gli mostrassi la linea e dicessi questo e quello che tu cerchi. Torno Apelles e vergognandosi essere stato vincto fece una terza linea a traverso di quelle d’uno altro colore tanto sottile che non lascio logho da poterla fare piu sottile. Protogene confessò se essere vincto e di subito ando al porto e condusse Appelle a casa sua e la tavola rimase dipoi in quella forma con admiratione di ciaschuno ma piu de gli artefici che nelle sequente eta furono. Questa arse nel primo incendio dela casa di Cesare in palatio, ma io l’havevo veduta innanzi non senza stupore: nellaquale niente altro era dipincto che quelle linee, lequali fugivano la vista, e così vota era più nobile che alcuna altra opera.
Pline l’Ancien; Brucioli, Antonio, Historia naturale di C. Plinio Secondo nuovamente tradotta di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli, p. 989-990 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
E da notare che cosa accade fra Protogene, e lui. Quello viveva a Rhodi, dove navico Apelle avido di conoscere le opere sue, essendogli cognito solamente per fama, e subito ne ando alla sua stanza. Et esso non vi era, ma una tavola di gran grandezza in quel luogo adattata alla pittura, et una vecchia che la guardava. Et questa disse che Protogene era fuore, e domando chi fusse che lo domandasse. Questo (disse Apelle) e preso uno pennello fece una linea per quella tavola di estrema suttilita. Ritornato Protogene, la vecchia gli disse quelle cose che erano accadute. Dicano che subito l’artefice disse, havendo contemplata la sottilita, esservi venuto Apelle, perche non poteva cadere in altro tanto assoluta opera. Et esso allhora di uno altro colore tiro in essa linea un’ altra piu sottile, e partendosi, comandò alla vecchia, che se quel tale ritornava, gli dimostrasse, e dicesse questo essere quello che cercava. Et cosi avvenne, perche ritornò Apelle, e vergognandosi di essere vinto, con uno terzo colore, seco pel mezo le linee, non lasciando piu luogo alla sottilita. Et Protogene confessandosi di essere vinto, ne ando al porto, cercando questo hospite. Et piacquegli di dare quella tavola cosi à posteri, con ammiratione di tutti, e massimamente di simili artefici. Et questa arse nel primo incendio della casa di Cesare nel palattio, havendola noi avanti avidamente veduta, di grande spacio, e niente altro conteneva, che linee, lequali apena si potieno discernere, fra le egregie opere di molti simile al vano, e per questo stesso allettante, e più nobile di ogni opera.
Pline l’Ancien; Domenichi, Lodovico, Historia naturale di G. Plinio Secondo tradotta per Lodovico Domenichi, con le postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati alteri auttori… et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene…, p. 1098-1099 (italien)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Notabil cosa è quella, che passò fra Protogene e lui. Stava Protogene a Rhodi; dove essendoito Apelle, desideroso molto di conoscere di vista lui, ilquale egli conosceva solamente per fama, subito andò a trovarlo a bottega. Era allhora Protogene fuor di casa, e non c’era altri che una vecchia, laquale era lasciata guardia d’una gran pittura, ch’egli tuttavia dipigneva. Questa vecchia rispose, che Protogene era fuor di casa, e domandogli chi era, che lo voleva; disse Apelle, direte el padron vostro; ch’io lo voleva io; e dato di mano a un pennello, tirò una linea sottilissima di colore per la tavola. Tornato che fu Protogene a casa, la vecchia gli disse quel ch’era passato. Dicono, che l’artefice subito havendo considerato bene la sottigliezza di quella linea, disse, che colui ch’era venuto quivi, era Apelle; percioche altri che egli non havrebbe potuto fare cosa tanto perfetta. Allhora Protogene tirò una linea piu sottile d’un altro colore in quella medesima, e uscendo di casa, ordino alla vecchia, che se colui tornava, gliela mostrasse, e dicessegli, come colui ch’egli cercava, l’haveva fatta, e cosi avenne. Percioche essendo tornato Apelle, ma vergognandosi d’esser vinto, tagliò quelle due linee con un terzo colore, non vi lasciando piu luogo da farvene alcuna altra piu sottili. Perche Protogene confessandossi d’esser vinto, corse al porto, cercando di quel forestiere. Et contentossi che quella tavola rimanesse con quelle linee, con maraviglia d’ogniuno, ma sopra tutto de gli huomini dell’arte. Truovasi, che questa tavola andò a male, quando la prima volta arse la casa di Cesare in palazzo, desiderosamente prima veduto da ogniuno; laquale come che fosse molto grande, altro non conteneva in se fuor che linee, lequali fuggivano la vista, e fra le opere illustri di molti parea quasi vana; e perciò allettava gli occhi delle persone, ed era molto più nobile d’ogni altra figura.
Pline l’Ancien; Du Pinet, Antoine, L’histoire du monde de C. Pline second… mis en françois par Antoine du Pinet, p. 948-949 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
- [1] l’eschaffaut
Sur quoy me souvient d’un acte fort gentil, dont il usa a l’endroit de Protogenes. Car ayant fantasie de cognoistre plus familierement Protogenes et de voir de sa besongne, pour ce qu’il en avoit tant ouy parler, il alla expres à Rhodes, où estant, s’achemina droit a sa boutique qu’une vieille gardoit, car de fortune Protogenes n’y estoit pas. Et comme il s’en vouloit aller, n’ayant trouvé celui qu’il cerchoit, la vieille luy demanda son nom pour savoir dire à Protogenes qui l’auroit demandé à son retour. Alors Apelles print un pinceau, et voyant sur l’estandy [1] de la boutique une toile tendue en un chassy, preste à peindre, y fit avec le pinceau un trait fort subtil, disant à la vieille, Vous direz à votre maistre, que celuy qui a fait ce trait l’a demandé. Protogenes donc estant de retour, et s’estant enquis de ceux qui l’avoyent demandé, la vieille luy compta tout ce qui estoit passé entre elle et Apelles. Ce qu’oyant Protogène, cognut au seul trait qu’Apelles avoit fait, qu’il estoit arrivé à Rhodes : car à son dire, il n’estoit possible qu’un autre qu’Apelles eust sceu faire un trait de couleur si subtil que cestuy-là. Et neantmoins ayant trempé un pinceau d’une autre couleur, il fit un autre trait au mesme tableau encore plus subtil que celuy d’Apelle : commandant à sa vieille au sortir de la maison, que si Apelles retournoit une autre fois le demander, qu’elle lui monstrast le traict qu’il avoit fait, luy declarant que celuy qu’il cerchoit l’avoit fait. Ce qu’advint : car Apelles estant retourné à la boutique de Protogenes pour le trouver, et se sentant aucunement confus d’avoir esté vaincu, print un autre pinceau d’une tierce couleur : duquel il coupa si subtilement les deux traits precedens, qu’il n’estoit possible d’en faire de plus subtils. Quoi voyant Protogenes, se confessant vaincu, courut au havre pour y chercher Apelle pour le recevoir hospitalement, et faire alliance d’hospitalité avec luy. En memoire de quoy, et l’un et l’autre laisserent ce tableau avec ses trois traits seulement, au grand estonnement de tous ceux qui les voyent encores, et plus encores de ceux qui s’entendoyent en cest art : car ce tableau fut seulement bruslé au premier feu qui se mit au palais de Caesar. Et de fait, j’ay prins autresfois grand plaisir à les contempler : car il estoit de grand volume, et neantmoins ne contenoit autre chose que ces trois traits, qui encore estoyent si menus, qu’à peine les pouvoit-on voir, de sorte qu’il sembloit que ce fust toile simple qu’on eust là mis parmi les autres riches tableaux qui estayent, et toutesfois ce tableau vide estoit plus considéré et estimé plus riche que tous les autres.
Pline l’Ancien; Poinsinet de Sivry, Louis, Histoire naturelle de Pline, traduite en françois [par Poinsinet de Sivry], avec le texte latin… accompagnée de notes… et d’observations sur les connoissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes, vol. 11, p. 247-249 (fran)(traduction ancienne d'un autre auteur)
Tout le monde a entendu parler de ce qui se passa entre Apelle et Protogene. Celui-ci demeuroit à Rhode. Apelle aborde dans cette isle, curieux de connoître ses ouvrages, dont il avoit entendu faire de grands récits. Il va droit à l’attelier. Protogene étoit absent ; une seule vieille étoit là, laissée à la garde d’une tableau immense dressé sur le chevalet, et sur lequel il n’y avoit encore rien de peint. Cette vieille dit à Apelle que Protogene étoit sorti. Qui lui dirai-je (ajouta-t-elle) avoir demandé à lui parler ? Celui-ci répondit, Apelle ; et en même tems saisissant un pinceau imbu de couleur, il conduisit sur le vaste champ de la toile un trait d’une étonnante ténuité. La vieille apprend à Protogene, de retour, ce qui s’étoit passé. On dit que cet artiste n’eut pas plutôt jetté les yeux sur ce linéament si subtil[1], qu’il s’écria qu’Apelle étoit venu, nul autre que lui n’étant capable de rien faire de si parfait. Prenant toutefois lui-même le pinceau, il conduisit sur ce linéament un trait d’une autre couleur, et si subtil, que la couleur de dessous le débordoit de part et d’autre. Ce qui étant fait, il sortit, commandant à la vieille, si l’étranger revenoit demander Protogene, de lui répondre, en lui montrant ce second trait : Voilà celui que vous cherchez. En effet, ce qu’il avoit prévu arriva. Apelle se présente une seconde fois ; il voit, non sans honte, qu’il a été suprassé : il reprend donc le pinceau, et dans l’interligne tracée par Protogene, il trace un troisième trait, qui tranche par le milieu les deux autres couleurs, ne laissant plus d’espace intermédiaire où tracer un quatrième linéament, si subtil qu’on le supposât. Cette fois-ci Protogene s’avoua vaincu, et sans autre délai, courut chercher son hôte au port. Ils convinrent de transmettre le tableau en cet état à la postérité ; monument d’admiration, non seulement pour le commun des hommes, mais même pour les artistes. J’ai oui dire que ce tableau avait été consumé dans le premier incendie[2] de la maison Césarienne au Palatium. C’étoit un spectacle vraiment singulier que ce vaste tableau, semblable à un grand vuide, au milieu de tant de chefs-d’œuvre, et qui, par cette raison, piquoit davantage la curiosité, et éclipsoit les ouvrages les plus accomplis, encore qu’il ne présentât que de simples linéaments si déliés, que la vue avoit peine à les saisir.
- [1] Ce qui fait dire à Stace, in Herc. Vind.
Linea quae veterem longè fateatur Apellem.
- [2] Sous Auguste. Voyez Suétone, chap. 57.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini, 208
Notice: Undefined offset: 999 in /var/www/html/pictor-in-fabula/WP/wp-content/themes/twentythirteen-child/template-anecdotes.php on line 576
()
Scitum est inter Protogenem et eum quod accidit. Ille Rhodi vivebat : quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus, fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis [1]in machina aptatam picturae, anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque, a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles : arreptoque penicillo [2]lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quae gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adjiceretque hunc esse quem quaereret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, sed vinci erubescens tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam [3]priore incendio domus Caesaris in Palatio audio : spectatam olim tanto spatio nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera [4]inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem.
[1] In machina. Le chevalet.
[2] Lineam ex colore. Lineam cave credas in pictura idem atque in geometrice esse, longitudinem sine latitudine. Est penicilli ductus, quem Graeci γραμμήν vocant, ut γραφεῖς pictores, opusque γράμμα. Nos tractum penicilli vocamus : hinc omnibus lineis absolutum opus, de consummato diximus, quod est ex pictura desumptum, καὶ μεταφοράν. Linearum porro tenuitate opus est, in multis lineamentis effingendis, in capillamento, exempli gratia, in venis, similibusque exacte formandis : hic enim non pressiore nisu, sed delicata as suspensa manu geri rem oportet. Statius, in Hercule Vind. Linea quae veterem longe fateatur Apellem.
[3] Priore incendio. Meminit Tranquillus in Octavio, cap. 57. In restitutionem Palatinae domus incendio absumptae etc. Vide notas et emend. num. XI.
[4] Inani similem. Ab omni pictura nudam : cum lineas modo tenues, nullam effigiem contineret.
Alberti, Leon Battista, De pictura(publi: 1540, redac: 1435, trad: 2004) (II, 31), p. 116 (latin)
Circumscriptio quidem ea est quae lineis ambitum fimbriarum in pictura conscribit. In hac Parrhasium pictorem eum, cum quo est apud Xenophontem Socratis sermo, pulchre peritum fuisse tradunt, illum enim lineas subtilissime examinasse aiunt. In hac vero circumscriptione illud praecipue servandum censeo, ut ea fiat lineis quam tenuissimis atque admodum visum fugientibus; cuiusmodi Apellem pictorem exerceri solitum ac cum Protogene certasse referunt. Nam est circumscriptio aliud nihil quam fimbriarum notatio, quae quidem si valde apparenti linea fiat, non margines superficierum in pictura sed rimulae aliquae apparebunt.
Alberti, Leon Battista, De pictura, (trad: 2004) (II, 31), p. 117 (trad: " La Peinture" par Golsenne, Thomas; Prévost, Bertrand en 2004)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
La circonscription consiste à inscrire par des lignes, dans la peinture, le tour des contours. On rapporte que le peintre Parrhasios, qui d’après Xénophon dialogua avec Socrate, était à cet égard merveilleusement habile : on prétend en effet qu’il s’était appliqué au tracé des lignes les plus fines. De fait, à mon avis, il faut veiller tout spécialement à ce que cette circonscription soit faite de lignes les plus ténues possible et qui échappent totalement à la vue ; comme celles que le peintre Apelle avaient coutume de s’exercer à tracer et qui l’ont conduit à rivaliser avec Protogène. La circonscription n’est en effet – dit-on – rien d’autre que le marquage des contours qui, s’il était effectué au moyen d’une ligne très visible, ne montrerait pas dans la peinture les bordures des surfaces mais des sortes de fissures.
Alberti, Leon Battista, De pictura , (trad: 1536) (II, 31), p. 237-238 (trad: "[Della pittura]" en 1536)(italien)(traduction ancienne de l'auteur)
Sarà circunscrizione quella che descriva l’attorniare dell’orlo nella pittura. In questa dicono Parrasio, quel pittore el quale appresso Senofonte favella con Socrate, essere stato molto perito e molto avere queste linee essaminate. Io così dico in questa circonscrizione molto doversi osservare ch’ella sia fatta di linee sottilissime fatta, quasi tali che fuggano essere vedute, in quali solea sé Appelles pittore essercitare e contendere con Protogene ; però che la circonscrizione è non altro che disegnamento dell’orlo, quale ove sia fatto con linea troppo apparente, non dimostrerà ivi essere margine di superficie ma fessura.
Ghiberti, Lorenzo, I commentarii(redac: (1450)), p. 73-74 (italien)
Questo intra Apelle e Protogine intervenne. A Rodi habitava Protogine, dove andò Appelle desideroso di conoscere l’opere di colui, le quali avea conosciute per fama. Giunto in Rodi, inmantanente andò alla casa di Protogine, quando esso Protogine non v’era, ma una vecchia guardante il luogo ove Protogine lavorava. Era in detto luogo una grande tavola, la quale era ingessata per disegnarla. Rispuose, la donna anticha, Protogine non esser in casa. L’anticha donna domandò Appelle chi egli era che •llo dimandava: sanza altro dire tolse uno pennello di quel luogo e fece uno tratto sottilissimo nella tavola. Tornato Protogine, dalla donna fu riferito ciò che aveva fatto. “Questo ha fatto Appelle.” Tolto Protogine il medesimo colore, et allato a quella lineta ne fè un’altra, molto più mirabile che quella d’Appelle. Allora Protogine disse alla donna: “Quando esso ritorna, digli ch’io el cercava.” E di poi, Appelle tornando, vedendo la linea di mano di Protogine essere molto più sottile che la sua, si vergognò esser vinto. Appelles rifece una altra linea, tanto sottile che essa non potea essere più. Protogine, veduta la linea fatta per le mani d’Appelle tanto mirabilmente, si confessò esser vinto.
Tengo che questo che Prinio scrive veramente può esser vero, ma molto mi maraviglio, sendo in costoro tanta profondità d’arte, e con tutte le parti del pittore e di geometria e dello scultore, mi pare certamente una debile dimostratione, e •ssì fatto autore questo recita la pruova di costoro, parlo come scultore e certo credo dovere esser così. Ma pure io parlerò, con riverentia di ciascuno lettore, io narrerò il creder mio, conciò sia cosa che Appelle compuose e publicò libri continenti dell’arte della pictura. Essendo ito a Rodi, a casa Protogine, trovando la tavola apparecchiata e volendo mostrare Appelle la nobiltà dell’arte della pictura, e quanto egli era egregio in essa, tolse il pennello e compuose una conclusione in prospettiva appartenente all’arte della pictura. Tornando Protogine, subito conobbe quella essere cosa d’Appelle et egli, come docto, Protogine ne fece un’altra conclusione, rispondente a quella. Tornando Appelle alla casa di lui, esso Protogine si nascose. Vide Appelle rifare un’altra conclusione di tanta perfectione e di tanta maraviglia nell’arte, non era possibile a Protogine agiugnere a essa, e vergognossi d’esser vinto. Nondimeno, andando ritrovò Appelle. […] Piacque a Protogine quella tavola, dove erano fatte le linie di mano d’Appelle, fosse veduta da tutto el popolo, overo conclusioni appartenenti alla pictura, e spetialmente da’ pictori e dagli statuarii, e da quelli erano periti. Ciascuno si lodava maraviglosamente. Consumossi detta tavola nelli incendii della casa di Cesare.
Filarete, Antonio di Pietro Averlino, dit, Trattato di architettura(redac: (1465)) (l. XXI ), p. 642-543 (italien)
Ma per volere queste cose fare in disegno senza altre misure di sesto, o di quadra, che benché così di punto non si possa come co’detti strumenti fare; se già non facessi come dice fu Apelle, e anche Zeusis[Note contexte], el quale dice che tirava le sue linee diritte col pennello, come fatto avesse proprio con la riga e più : che in su una sua sottilissima linea che lui aveva fatta el sopradetto ne tirò un’altra. O vero, come che dice quegli ancora, l’uno girò uno tondo perfetto senza sesto, e l’altro al primo posto punto nel mezzo misse, el sesto l’avesse proprio fatto. Se così fu, grazie date dalla natura, e non per pratica, anzi per accidente fare si potrebbe, se già a ventura o caso non venisse fatto.
Filarete, Antonio di Pietro Averlino, dit, Trattato di architettura(redac: (1465)) (l. XIX), vol. 2, p. 584 (italien)
Eragli ancora quello pittore dipinto, cioè Parrisio, il quale dice Zenofonte a Socrate costui essere stato molto perito in linie; pareva ci fusse ancora quello che sentendo la gran fama d’Apelle andò alla sua terra per conoscerlo, e non trovandolo in casa, solo una tavola vidde da lui cominciata e giù per una linea sottilissima da lui fatta, in quella medesima d’un altro colore ne fe’ con uno pennello un’altra.
Verino, Ugolino, De illustratione urbis Florentiae libri tres(publi: 1583, redac: 1488), folio 17r-v. (latin)
Et forsan superat Leonardus Vincius omnes ;
Tollere de tabula dextram sed nexcit, et instar
Protogenis multis vix unam perfecti annis.
Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum(publi: 1500, trad: 2011), « Nullam hodie lineam duxi » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (latin)
Τἠμερον οὐδεμἰαν γραμμὴν ἤγαγον, id est Hodie nullam lineam duxi. Ab Apelle pictore natum adagium in eos quadrat, quibus cessatum ab exercitio studii artisque suae. Id refertur a Plinio libro trigesimoquinto, capite decimo, cuius uerba non grauabor in hoc commentarium transcribere. Scitum est, inquit, inter Protogenen et eum quod accidit. Ille Rhodi uiuebat, quo cum Apelles adnauigasset auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit interrogauitque a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles adreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reuerso Protogene quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse, Apellem uenisse. Non enim cadere in alium tam absolutum opus, ipsum tunc alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse praecepisse abeuntem, si redisset ille, ostenderet adiceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles, sed uinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes uictum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens. Placuit sic eam tabulam posteris tradi omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam constat priore incendio Caesaris domus in Palatio auide ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem quam lineas uisum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem. Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in prouerbium uenit. Hactenus Plinius. Ceterum ad hanc lineam, qua protinus agnitus est a Protogene, respexit Statius in Hercule Vindice Epitrapezio, cum ait:
Linea quae ueterem longe fateatur Apellem.
Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum, (trad: 2011), « Aujourd’hui je n’ai pas tracé une ligne » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (trad: "Les Adages" par Saladin, Jean-Christophe en 2011)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Cet adage, qui tire son origine du peintre Apelle, concerne ceux qui ont marqué une pause dans la pratique de leur étude et de leur art. C’est rapporté au livre 35 de Pline, chapitre 10 et ce sera un plaisir pour moi de transcrire ses propos dans mon recueil. […] Suffit pour Pline. Par ailleurs c’est à cette ligne, grâce à laquelle sur-le-champ Apelle avait été reconnu par Protogène, qu’a songé Stace dans l’hercule sur la table de Vindex quand il dit :
La ligne de très loin révèle son pinceau,
Celui du vieil Apelle.
Érasme (Desiderius Erasmus), Collecteana Adagiorum, (trad: 2011), « Aujourd’hui je n’ai pas tracé une ligne » (numéro 312) , vol. 1, p. 286-287 (trad: "Les Adages" par Saladin, Jean-Christophe en 2011)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Cet adage, qui tire son origine du peintre Apelle, concerne ceux qui ont marqué une pause dans la pratique de leur étude et de leur art. C’est rapporté au livre 35 de Pline, chapitre 10 et ce sera un plaisir pour moi de transcrire ses propos dans mon recueil. […] Suffit pour Pline. Par ailleurs c’est à cette ligne, grâce à laquelle sur-le-champ Apelle avait été reconnu par Protogène, qu’a songé Stace dans l’hercule sur la table de Vindex quand il dit :
La ligne de très loin révèle son pinceau,
Celui du vieil Apelle.
Maffei, Raffaele (Il Volterrano), Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo et triginta libri cum duplici eorundem indice secundum tomos collecto(publi: 1506) (liber XIII), fol. CXXXVI (latin)
Notum et cum Protogene qui Rhodi viuebat illa linearum contentio, quam tabulam plures se vidisse restantur.
Il codice Magliabechiano cl. XVII. 17 contenente notizie sopra l’arte degli antichi e quella de’ fiorentini da Cimabue a Michelangelo Buonarroti, scritte da anonimo fiorentino(redac: (1540:1550)), p. 23-24 (italien)
Et hauendo esso Apelle gran disiderio di uedere l’opere di Prothogene, ilquale per fama solo conosceua, nauico in Rodj. L’arriuando alla bottegha di quello, vi vidde una gran tauola, che esso quiui aconcia haueua per dipignerla, et una sola vecchia, che a guardia della bottegha staua, allaquale esso di Prothogene domando ; e ella gli rispose, non v’essere, et chi egli era che Prothogene adomandassj. Allaquale non rispose Apelle, ma preso il pennello, fece una sottilissima linea in su quella tauola et partissi. Torno dipoi Prothogene et intese in tutto dalla uecchia et vidde la tanto sottil linea et giudichò, ch’Apelle stato fussj, perche altrj che quello non harebbe tale opera fatto. Prese il pennello et fece acanto a quella linea un altra piu sottile d’uno altro colore et partissi di bottega, hauendo inposto alla uecchia, che se quello che v’era stato tornassi, li mostrassj la linea, che fatto haueua, et dicessjli : questo è quello che tu cerchj. Torno Apelle et vidde et vergognosi assaj d’essere stato vinto et prese il pennello et fece un altra linea d’uno altro colore a trauerso di quelle due, tanto sottile, che piu sottile fare non si poteua, et partissi. Torno dipoj Protogene et vidde la linea atrauersata et confessò essere stato vinto et ando al porto et Apelle con seco condusse. Rimase la tauola in quel modo con marauiglia grandissima di ciascheduno intendente dell’arte, ne altro v’era dipinto che quelle linee ; et tanto strette e sottilj erano, ch’apena si schorgeuano. Questa tauola in Roma in casa Cesare in Palatio nel primo incendio arse.
Pino, Paolo, Dialogo di pittura(publi: 1548), p. 117 (italien)
La prontezza e sicurtà di mano è grazia concessa dalla natura, in ciò fu perfetto Apelle, e si legge a questo proposito ch’eccitato Apelle dalla fama di Protogene, pittore celeberrimo, andò a Rodi per visitarlo, desideroso di sapere se la lui gloria fusse equale all’opere, et entrato in casa sua, dimandò di Protogene a una certa vecchia, dalla qual li fu risposto che non v’era; et Apelle, preso un pennello, distinse una linea giustissima, dicendo a colei: « Dirai a Protogene: “quello che fece tal segno ti ricerca” ». Tornato Protogene, veduta la linea e inteso il tutto, con un altro colore formò un’altra linea per lo meggio di quella fatta da Apelle, e partìsi, ordinando alla vecchia che dicesse ad Apelle : « Colui che fece quest’altro segno è quello che tu ricerchi ». Ritornato Apelle e veduta la linea, con intrepida mano, raccolto il pennello, formò la terza linea nel corpo di quella fatta da Protogene, e fu di tal sottilità ch’era quasi invisibile. Tornando al ragionamento dico che la prontezza di mano è cosa de grande importanza nelle figure, e mal può oprare un pittore senza una sicura, e stabil mano, e quello assicurarsi sopra la bacchetta non fu mai usato da gli antichi, anzi è cosa vituperosa, dica chi vuole.
Doni, Vincenzo, Disegno(publi: 1549), p. 37 (italien)
Quell’altro essempio tra Apelle e Protogene pittor rodiano dell’haver tirato quelle linee si diritte e sottili.
Conti, Natale (dit Natalis Comes ou Noël le Conte), Mythologiae, sive explicationis fabularum libri decem(publi: 1551) (liber VII, cap. XVI), p. 410 (latin)
Edidit volumina doctrinam picturæ continentia, qui cognitus fuit Protogeni vel e tenuitate lineæ in tabula.
Borghini, Vincenzio, Selva di notizie(redac: 1564), p. 140 (italien)
Recita di quella linea fatta in su la tavola di Protogene etc.
Commentaires :
Adriani, Giovanni Battista, Lettera a m. Giorgio Vasari, nella quale si racconta i nomi, e l’opere de’più eccellenti artefici antichi in Pittura, in bronzo, et in marmo(publi: 1568, redac: 1567) (t. I), p. 190-191 (italien)
Fu costui[Explication : Apelle.] non solamente nell’arte sua eccellentissimo maestro, ma d’animo ancora semplicissimo e molto sincero, come ne fa fede quello che di lui e di Protogene dicono essere avvenuto. Dimorava Protogene nell’isola di Rodi sua patria, dove alcuna volta venendo Apelle con desiderio grande di vedere l’opere di lui, che le udiva molto lodare et egli solamente per fama lo conosceva, dirittamente si fece menare alla bottega dove ei lavorava, e giunsevi appunto in tempo che egli era ito altrove; dove, entrando Apelle, vide che egli aveva messo su una gran tavola per dipignerla, et insieme una vecchia sola a guardia della bottega, la quale, domandandola Apelle del maestro, rispose lui essere ito fuore. Domandò ella lui chi fusse quegli che ne domandava. “Questi”, rispose tostamente Apelle, e preso un pennello tirò una linea di colore, sopra quella tavola, di maravigliosa sottigliezza, et andò via. Torna Protogene, la vecchia gli conta il fatto, guarda egli, e considerata la sottigliezza di quella linea, s’avisò troppo bene ciò non essere opera d’altri che di Apelle, ché in altri non caderebbe opera tanto perfetta ; e preso il pennello, sopra quella istessa d’Apelle, d’altro colore ne tirò un’altra più sottile, e disse alla vecchia : “Dirai a quel buono uomo, se ci torna, mostrandoli questa, che questi è quegli che ei va cercando”. E così non molto poi, avvenne che tornato Apelle et udito dalla vecchia il fatto, vergognando d’esser vinto, con un terzo colore partì quelle linee stesse per lungo il mezzo, non lasciando più luogo veruno ad alcuna sottigliezza; onde tornando Protogene e considerato la cosa e confessando d’esser vinto, corse al porto cercando d’Apelle e seco nel menò a casa. Questa tavola, senza altra dipintura vedervisi entro, fu tenuta degna per questo fatto solo d’esser lungo tempo mantenuta viva, e fu poi come cosa nobile, portata a Roma e nel palazzo degli Imperadori veduta volentieri da ciascuno e sommamente ammirata, e più da coloro che ne potevano giudicare, tuttoché non vi si vedesse altro che queste linee tanto sottili, che poi appena si potevano scorgere ; e fra le altre opere nobilissime fu tenuta cara, e per quello istesso che entro altro non vi si vedeva, allettava gli occhi de’ riguardanti.
Vasari, Giorgio, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti(publi: 1568) (t. I), p. 383 (italien)
[Note contexte] Giotto, che cortesissimo era, squadrato il cortigiano prese un foglio di carta et in quello, co un pennello che egli aveva in mano tinto di rosso, fermato il braccio al fianco per farne compasso e girato la mano, fece un tondo si pari di sesto e di profilo, he fu a : vederlo una maraviglia grandissima. E poi, ghignando, volto al cortigiano gli disse : “Eccovi il disegno”. Tennesi beffato il mandato del papa, dicendo : “Ho io a avere altro disegno di questo?” Rispose Giotto: “Assai e pur troppo è quell che io ho fatto: mandatelo a Roma insieme con gli altri e vedrete se sarà conosciuto”. [...] fu conosciuto dal papa e da molti cortigniani intendenti quanto egli avanzasse di eccellenia tutti gli altri artefici de’suoi tempi. E percio, divulgatasi questa cosa, ne nacque quel proverbio famigliare e molto ancora ne’notri tempi usato : « Tu sei più tondo che l’O di Giotto ». Il quale proverbio non solo per il caso dondo nacque si puo dir bello, ma molto più per il suo significato, che consiste nella ambiguità del tondo, che oltra a la figura circulare perfetta significa ancora tardità e grossezza d’ingegno.
Borghini, Rafaello, Il riposo di Raffaello Borghini : in cui della pittura, e della scultura si fauella, de’piu illustri pittori, e scultori, et delle piu famose opere loro si fa mentione ; e le cose principali appartenenti à dette arti s’insegnano(publi: 1584), p. 273-274 (italien)
Fu di vero cosa notabile quella, che passò fra questi due famosi pittori; percioche essendo andato Apelle a Rodi per conoscere Protogene mosso dalla sua fama, e non havendolo trovato in casa, fu domandato da una vecchia chi egli fosse, acciò potesse dirlo al padrone, alla quale egli (preso un pennello e fatto sopra una tavola che era quivi per dipignersi una linea sottilissima) rispose diragli che colui, che ha fatto questa linea il domanda, e partissi. Ritornato Protogene à casa et inteso il seguito dalla vecchia, e veduta la linea, s’imaginò non l’haver potuta far altri che Apelle, et intinto un pennello in un altro colore, sopra la linea fatta ne tirò un’ altra più sottile, e disse alla vecchia mostrandogliele. Se quel buon huomo ci ritorna diragli che colui, che egli va cercando ha fatto questa e sene andò fuore. Poco dopo ritornato Apelle, e veduta la seconda linea, arrossato d’honorata vergogna, preso il pennello con un terzo colore partì quelle linee per lo mezzo d’una linea tanto sottile che non lasciò punto di luogo ad alcun’ altra sottigliezza. Laonde Protogene al suo ritorno, considerata la cosa e chiamandosi vinto, corse tosto al porto, e ritrovato Apelle, il menò à casa honorandolo molto. Fù poi questa tavola senza altra dipintura, come cosa nobile, portata a Roma e posta nel Palagio degli Imperadori, come un miracolo dell’arte; percioche quelle linee erano così sottili, che à gran pena discernere si poteano.
Lamo, Alessandro, Discorso intorno alla scoltura, et pittura(publi: 1584), p. 17 (italien)
E non solamente furono le buone pitture, o scolture appresso de gli antichi in grandissimo prezzo, e veneratione, ma le grosse bozzature, e le semplice linee ancora, il che chiaramente si manifesta vero dalla stima, che si faceva di quella tavola, dove solamente una linea di Prothogene, e due d’Apelle cosi sottili si scorgevano, ch’ella era ammirata da ciascuno, e da ogni grande huomo desiderata, e carissima sopra ogni altra sua cara cosa tenuta da Cesare, nel primo incendio del cui Palazzo ella poi si rissolse in cenere.
Montjosieu, Louis de, Gallus Romae hospes. Ubi multa antiquorum monimenta explicantur, pars pristinae formae restituuntur. Opus in quinque partes tributum(publi: 1585), « Commentarius de pictura » (numéro IV) , p. 6-9 (latin)
Tricolorem hic picturam ostendit. Est enim hic color extensus in tabula instar subiecti, medius inter vmbram & lumen, sensim ad vtrumque porrectus. Haec tria corpus plenum, & solidum faciunt. Sed in sociandis coloribus adhibenda est cura circa transitus colorum, vt molliter coeant indiscretis commissuris. Huc pertinet illud nobile certamen inter Apellem, & Protogenem valde celebratum. Tametsi pauci admodum intelligant de quo inter nobiles illos artifices certatum fuerit. Quod certamen sic ad Plinio describitur, vtillis temporibus vulgatissimum. Scitum est inquit, inter Protogenem, & eum (de Apelle loquitur) quid accidit. Ille Rhodi viuebat. Quo cum Apelles adnauigasset auidus cognoscendi opera eius fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petijt. Aberat ipse sed tabulam magnae amplitudinis in machina aptatam picturae anus vna custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogauitque ad quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles, abreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reuerso Protogeni quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse. Non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsum tunc alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redijsset ille, ostenderet, adijceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles, sed vinci erubescens tertio colore lineas secuit nullum relinquens subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem ; sed artificum praecipuo miraculo. Addit Plin. Consumptam eam constat priore incendio domus Caesaris, in palatio auide ante ad nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem, quàm lineas visum efugientes, inter egregia multorum opera inani similem, & eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem. Recte Plinius si audita tantum retulisset. Sed cum addat, antequam incendio consumpta esset tabula, eam se auide contemplasse, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem quam lineas visum effugientes, pace tanti viri dixerim, si totus Argus fuisset, si totus Lynceus, lineas videre non potuisset quae nusquam erant. Vir in caeteris diligentissimus hallucinatus est vulgi praeiudicio. Cum enim fama esset de lineis institutam disputationem inter nobiles illos artifices, & opus adhuc extare in ea tabula eas videre visus est : alioqui se parum perspicacem crediturus. Sed qui de lineis initum fuisse certamen ad claris illis artificibus dixerant, id aliorsum intelligebant, atque isti acceperint. Certum est enim in pictura colorata nullum esse prorsus linearum vsum. Imo vitio dari si lineae appareant. Extremae enim lineae, qua parte vmbra desinit ei prorsus adherent, & cum ea confunduntur. Quae verò intus sparguntur, ne ipsae quidem ab vmbra separantur. Sed nec qua lumen pictura recipit lineas vllas cernere est. Quod si ad graphicem spectemus, ne hic quidem video cur haec subtilitas linearum tantopere commendetur in pictore : cum artificum iudicio pictura linearis eo nomine nunquam laudetur ; sed id tantum spectetur, an graphice rerum effigies sint adumbrate. Nec inter est tenuioribus lineis an crassioribus. Imo de industria lineamenta crassioribus primum lineis adumbrantur. Vidi enim multa autographa peritissimorum artificum, qui hoc foelicissimo saeculo floruerunt. Michaelis angeli Bonaroti, Raphaelis urbinatis, Saluiati, Polidori, Parmensis, Titiani, aliorumque nobilium artificum, sed neminem animaduerti affectasse vnquam subtilitatem illam linearum. Itaque videndum est quod huius celebris certaminis subiectum fuerit, & quod tantum artis specimen, vt eo viso manus fama tantum cognitae subito dignoscerentur. Sed lectorem picturae quadantenus peritum opto, aut qui saltem doceri velit. Huic ego rem vt est paucis exponam. Primum nosse opere praetium est in pictura absoluta colores singulos tribus differentiis tanquam gradibus distingui. Luce, umbra, & splendore. Sine luce nihil omnino cerni potest. Haec quaquauersus corpus solidum opacum feriat, vmbram in parte opposita circumscribit. Inter lucem & umbram splendor spectatur. In lumine color dilutus est, in uvbra saturatus. In splendore coloris species cernitur ; in maiori luce non discernitur, nec item in vmbra intensa, sed opus est lumine moderato. In luce enim intentissima color omnis candidus apparet. Quocirca in transfiguratione Christi omnia apparebant spectantibus Apostolis candida, propter lucis intentionem. Contra si lux remissior sit, ne tunc quidem discernitur colos. Quo fit vt ad ignis, aut lunae splendorem rubeus color fuluus videatur, viridis ceruleus. Si vero vmbra in tensior sit, omnia nigra videbuntur : adeò nisi moderato lumine species discerni nequit. Haec Plinius optime exposuit in illo cap. v. lib. xxxv. Tandem inquit se ars ipsa distinxit, & inuenit lumen atque vmbras, differentia colorum alterna vice sese excitante. Deinde adiectus est splendor. Alius hic quam lumen, quem quia inter hoc, & vmbram esset, appellauerunt tonum. Commissuras vero colorum & transitus, armogen. Haec Plinius. Cleonides autor est tonum quatuor significare. Phtongum, interuallum, locum vocis, & eiusdem tenorem. Et hodie etiam musici indiferenter pro his quatuor vsurpant. Quoquomodo accipiamus recte veteres splendorem appellauerunt tonum. Est enim splendor in pictura idem quod phtongus in musica. & quemadmodum in musica proxima vocum solida interualla per tonos progrediuntur, sic per hos etiam tonos colorum species. Praeterea vt in musica locus vocis dicitur tonus, sic in pictura vbi coloris species refulget tonum dicemus. Denique etiam tenorem vtrobique recte appellabimus vbi vox interacutum, & graue sustinetur. & vbi color pariter inter lucem & vmbram substitet. Caeterum in musica tonus ad tono semitonio distinguitur. In pictura color ad colore armoge. Semitonium est transitus, & tanquam commissura vocum. & item armoge transitus & commissura colorum ; Armoge igitur in pictura instar semitonij est. Adde, quemadmodum tonus in musica in aequales partes diuidi non potest, sic nec coloris splendorem ab extremis aequali interstitio distare ; sed vmbram aliquanto latius excurrere instar semitonij maioris : vt in corpore spherico optica ratione demonstrari solet. Haec cum Plinius optime nouisset, miror eum non intellexisse qua de re institutum fuisset certamen inter nobiles illos artifices, tametsi tabulam vidisset. Nam in lineis exprimendis certasse falsum ostendimus. Cum & Plinius dicat penicilli opus fuisse. Atqui penicilli vsus nullus est in graphice. De sectione igitur lineae contenderunt. Hoc est de scissura & transitu colorum : de commissura illa quam Plinius Harmogen appellat. Enimuero digna res est in qua pictor excellere studeat, ne Apelles quidem ipse semel diuidere possit. In armoge verò, vt colorum, sic artis & artificis splendor elucet. Vt enim musicum eum laudabimus, qui recte modulabitur distinctis interuallis, sic pictor, qui colorum gradus pulchre distinxerit, & transitus eorum notauerit, ille quod summum est in arte assequutus erit. Cum igitur Apelles abrepto penicillo ex artis sui specimine ad Protogene agnosci vellet, non figuram expressit ; sed armogen in colore notauit. Protogenes artem agnouit ; sed artificis negligentiam notauit alio subinde colore interiecto transitum, qui duriusculus erat molliens. Aemulatio arti laenocinata est. Erubescens enim Apelles vinci, commissuram ipsam secuit alio interiecto colore, adeo tenui, vt nihil supra. Ita de systemate picturae diuidendo certarunt summi artifices. Digna certe cura in quam toto pectore incumberent. Plinius igitur in his parum exercitatus, cum tabulam auide contemplaretur, videre visus est lineas, tametsi visum effugientes fateatur, quia scilicet, nullae prorsus erant.
Armenini, Giovanni Battista, De’ veri precetti della pittura(publi: 1587), « Che l’invenzioni non si debbono cominciare a caso, ma con maturo discorso […] Dell’utile che n’apporta il dissegnare assai a questa parte […] » (numéro I, 9) , p. 90-91 (italien)
Ma d’intorno a questa parte io vi avertisco bene che abbiate per costume infallibile di far ogni giorno qualche dissegno, acciò che con più facilità poi si esprimano le cose, che tuttavia si sono da voi imaginate e che così ancora si adempia quel detto di Apelle che « dies non transeat sine linea », il qual detto non s’intende di fare un segno solo, nel modo che molti schiocchi si credono, ma si comprende esser d’una figura overo di una bozza o schizzo di qualche istorie, perché chi non sa che colui il quale dissegna in un’ora non faccia un numero infinito di linee e molti di figure ancora ? E non perciò si terria che costui vi attenda molto.
Junius, Hadrianus, Batavia(publi: 1588), p. 239 (latin)
Hos aetate superior paulo praecessit Ioannes Mostardus Harlemo oriundus, qui circa minuta potius, vt illi colossicotera, trivisse ingenium videtur, manupretio in venustate ac decore oris, comptu corporum, argutia vultus, capillitii elegantia, lineamentorum tenuitate, Protogenica ferme; viroris inimitabili apparatu, alio circa lucos, arbores, muscosos fontes, alio in vestitu, caeterisque rebus.
Lipse, Juste, Epistolarum centuriae duae. Quarum prior innovata, altera nova(publi: 1590)(latin)
- [1] δαΐφρονα ποικιλομήτην entem varia mente praeditum
Theodoro Bernardi S[alutem] D[icit].
Bene habet, mi Theodore, de amico illo nostro: extra metum sumus, imo extra suspicionem. Ille viuit (ex litteris eius mihi constat) et viuet, vt spero, in multos annos. Heu dolorem meum, si aliter! Variis virtutibus amorem nostrum meretur et certe amore. Quod quaeris a me de Apellaeis illis lineis, verasne eas censeam et quales, ad prius respondeo veras. Nec fas ambigere nisi si fidem spernimus historiae omnis priscae. Ad alterum nunc sileo et censeo vt prius ab amico illo nostro quaeras, cuius ingenium grande et capax, diffusum per has quoque artes. Mirificus ille vir est et quem Homeri verbis iure appelles δαΐφρονα ποικιλομήτην [1]. Ego coram aliquid tecum, quem decretum mihi visere ineunte hoc vere atque vna cum Henrico Spiegelio meo amplecti. Amo vtrumque; vterque me amate. Lugduni Bat[avorum], Prid[ie] Kalend[as] Mart[ias].
Guttierez de los Rios, Gaspar, Noticia general para la estimacion de las artes, y de la manera a en que se conocen las liberales de las que son mecanicas y serviles(publi: 1600), « Libro tercero en que se defiende que las artes del dibuxo son liberales, y no mecanicas », cap. III, « Pruevase que estas artes son liberales, conforme a la verdad, porque trabajando en ellas el entendimiento mas que el cuerpo, son tambien dignas de gloria y fama » (numéro cap. III) , p. 120-121 (espagnol)
[1] Con desseo de ganar fama y no dineros, se corregia Zeusis, quando pinto el niño que llevava las uvas en la mano, porque llegandose a ellas las aves, dezia que no estava bien pintado el niño, porque si lo estuviera como las uvas, con temor del niño no llegaran a ellas las aves. Del desseo de ganar fama procedieron las contiendas entre Parrasio y Timantes en la pintura del Ayaz. Del desseo de ganar fama, procedieron las que huvo entre los insignes escultores Agoracrito y Alcamenes. Del desseo de ganar fama el uno mas que el otro procedieron las grandes contiendas entre Protogenes y Apeles. Con desseo de ganar fama las ha avido tambien grandes entre los pintores y escultores de cien años de esta parte.
- [1] voir aussi Zeuxis et Parrhasios
Van Mander, Karel, Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders(publi: 1603:1604 ), « T’leven van Aertgen van Leyden, Schilder », fol. 237r (n)
T’welck Frans Floris van Antwerpen lockte te comen tot Leyden, alsoo hy te Delft was ontboden, om in de Kerck in de Cruys-Capelle te maken een Crucifix, en de plaetse quam besichtighen. Tot Leyden gecomen Aertgen te besoecken, en na zijn woonplaets vernemende, bevont hem te woonen in een arm slecht vervallen huysken, staende seer nae des Stadts Vesten aen de sijd-graft: binnen tredende, was Aertgen uytghegaen, versocht op zijn Camer te mogen comen, om van zijn werck te sien, midts hy om sulcx en hem te besoecken van verre alleenlijck was comen ghereyst, t’welck hem geern toeghelaten wiert: dus comende boven op een solderken onder het dack, nam een cooltgen van den Discipulen, die daer saten en conterfeytten, en maeckte onder dack op den witten muyr, die laegh en smal was, een Ossen hooft, met S. Lucas tronie, en t’Schilders wapen, soo verre den muyr dat mocht bestrecken, welcke dingen noch langhen tijdt die plaetse behielden, tot dat het van t’selfs door oudtheyt is vergaen. Frans dit gedaen hebbende, keerde weder tot zijn Herbergh. Aertgen t’huys ghecomen wiert gebootschapt, dat een vremdt van buyten daer was gheweest hem te spreken, en met verlof op zijn Camer was ghecomen, en hadder ghemaeckt in zijn afwesen in teghenwoordicheyt van zijn knechten met der Cool alsulcke dingen: maer wie hy was gheweest, wistmen hem niet te seggen. Aertgen boven comende, en siende, seyde stracx: dit is Frans Floris gheweest: des werdt hy beschaemt, niet wetende wat dencken, dat alsulcken Meester hem quam besoecken: dorft oock daer nae, van Frans in de Herberghe ontboden wesende, hem niet comen vinden, uyt oorsaeck, hem docht niet weerdt te wesen sulcken Meesters gheselschap.
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck, (t. I), p. 322, 324 (trad: "The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604). Preceded by The lineage, Circumstances and Place of Birth, Life and Works of Karel van Mander, Painter and Poet and likewise his Death and Burial, from the second edition of the Schilder-boeck (1616-1618), Doornspijck, Davaco, 6 volumes, 1994-1999Le Livre des peintres, Paris, les Belles Lettres, 2001-2002 (traduction partielle)" par Miedema, Hessel; Gérard-Powell, Véronique )(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Frans Floris d’Anvers vint à Leyde, attiré par la réputation du peintre[Explication : Aertgen van Leyden (ou Aert(gen) Claesz.).], au temps où la commande d’un Crucifiement pour l’église de Delft l’amena dans cette ville, pour l’emplacement que l’on destinait à son tableau. Le premier soin de Floris fut de s’informer de la demeure de son confrère ; ayant appris qu’il habitait non loin des remparts une petite maison délabrée, il s’y rendit aussitôt. Aertgen était sorti, mais Floris ayant fait connaître qu’il venait de loin expressément pour le voir, obtint la faveur de pénétrer dans l’atelier et de jeter un coup d’œil sur les œuvres qui y étaient. Il monta donc au grenier, – car c’était là que travaillait le peintre, – et, prenant le fusain d’un des élèves qu’il trouva en train de dessiner, il traça sur le mur bas et étroit, blanchi à la chaux, une tête de bœuf avec la face de saint Luc et l’armoirie des peintres, le tout aussi grand que le permettait l’étroit espace. Ce dessin subsista fort longtemps et ne s’effaça qu’à la longue. Ayant ainsi marqué son passage, Floris reprit le chemin de son auberge. Aertgen, lorsqu’il rentra, apprit qu’un étranger, venu pour le voir, avait été admis à visiter l’atelier et qu’après avoir tracé au fusain diverses choses, il était parti sans dire son nom. Au premier coup d’œil, Aertgen s’écria : « C’était Floris ! » et il se sentit tout confus de ce qu’un tel maître eût daigné lui rendre visite.
Commentaires : Traduction Hymans, 1884-185, t. I p. 322, 324
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), préface , p. 4r (n)
maer dat noch te verwonderen is, siet, eenen rouwen doeck, van Apelles en Protogenes slechs een weynigh betrocken, wort meer geacht, als al de costlijcke stucken in’t Paleys van Caesar.
Van Mander, Karel, Den grondt der edel vry schilder-const, (trad: 2009), p. 2 (trad: "Principe et fondement de l’art noble de la peinture" par Noldus, Jan Willem en 2009)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Mais voilà : il y a aussi[Explication : parmi les « trophées » de la peinture.] le fait surprenant qu’une toile presque vierge sur laquelle un Apelle ou un Protogène ont juste tiré quelques lignes est plus appréciée que toutes les pièces somptueuses du Palais de César.
Van Mander, Karel, Het Shilder-boeck(publi: 1604), Het leven der oude antijcke doorluchtighe schilders, « Van Appelles, Prince der Schilders », fol. 77v-78v (n)
Een seer edel daedt, tot een waerteecken van de beleeftheyt en goetaerdicheyt van Appelles, leestmen dat hy ghedaen heeft aen Protogenem, den welcken hy groote begeerte hadde met vriendelijcke gemeensaemheyt te kennen, en zijn wercken, daer hy soo veel gherucht van hoorde, te sien, soo dat hy door desen lust ghedreven hem ter Zee begaf, en seylde nae de Stadt Rhodes, alwaer gehavent wesende, is eenstreecks ghecomen nae zijnen Winckel, met sulcken voornemen, hem niet ten eersten te kennen te gheven, maer hem te ghelaten daer by gheval te zijn ghecomen. Doe hy ten huyse van Protogenes ghecomen was, en was (ghelijck oft soo wesen wilde) den Meester niet in huys: maer een oude Vrouwe, die t’huys waernam, liet hem op den Winckel. En also hy nae den Meester gevraeght hadde, en dat hy weder wech wilde, nadien hy den Meester niet ghevonden hadde, als wesende een vreemt Man, vraegde t’Wijf nae zijnen naem, op datse Protogeni als hy t’huys quam mocht seggen, wie nae hem gevraeght hadde. Appelles siende op den Esel staen eenen doeck op eenen raem gespannen, al bereyt om op te wercken, nam eenen pinceel, en trock daer mede eenen behendigen dunnen treck, seggende tot d’oude Vrouwe: Ghy sult u Meester seggen, dat den genen die desen treck ghemaeckt heeft, nae hem is comen vraghen. Doe hy nu wech ghegaen, en Protogenes t’huys ghecomen was, vragende ofter niemant gheweest en hadde, vertelde de Vrouwe watter gheschiet was van een vreemt Man. Protogenes dit hoorende, en siende, bekende stracx dat het Appelles hadde ghedaen, en dat hy te Rhodes most ghecomen wesen: want t’was (seyde hy) onmoghelijck, dat yemandt anders als Appelles soude connen maken met verwe en pinceel soo aerdighen dunnen treck als desen was: Doch Protogenes, hebbende eenen pinceel nat gemaeckt met een ander gedaente van verwe, maeckte noch eenen anderen treck op den selven doeck, die noch dunner was als dien van Appelles: en uytgaende seyde tot het oude Wijf, indien Appelles noch aen quaem, en nae hem vragen, datse hem toonen soude den treck dien hy ghemaeckt hadde, hem seggende, dit heeft ghedaen den ghenen, dien ghy soeckt. Het welck soo gheschiedde. Want Appelles weder ghekeert tot den Winckel van Protogenes, om hem te vinden, wert ten deele beschaemt, siende den treck, en hem overwonnen, nam hy eenen anderen pinceel met een derde ghedaente van verwe, waer mede hy de voorgaende twee trecken doorcloof soo behendich, dat het niet moghelijck en was netter noch aerdiger te doen, en trock weder henen. Protogenes t’huys comende, hem verwonnen kennende, liep stracx nae de haven toe Appellem te soecken, om hem vriendelijck te gast t’ontfangen, en beleeftlijck met hem gemeensaem kennis te maken. Dit Tafereel is van hun beyden onverandert alsoo tot een ghedachtenis laten blijven, met alleen dees driederley trecken, tot een groot verwonderen van die’t sagen, sonderlinge voor de ghene, die van de Teycken-const oft Schilder-const verstandt hadden. Desen doeck, alsoo hy was, worde namaels te Room gestelt in’t Palleys van Caesar, daer hy, doe den brandt eerstmael in dat Palleys quam, is verbrandt gheworden. Ick hebbe (seyt Plinius) dickwils groote ghenuechte ghenomen dit stuck te besien, want het was seer groot, en van verre te sien gheleeck het, datter eenen rouwen doeck gehangen was midden onder al die costlijcke stucken Schilderije die daer waren: want van verre en costmen niet ghesien datter yet op was: En was costlijcker gheacht als alle d’ander constighe wercken, daer nochtans in soo grooten doeck niet en waren als dry trecken met dry verwen, de welcke oock soo dunne waren, datmense qualijck con sien. Dit is datter Plinius van ghetuyght. maer als ick vryelijck hier van mijn gevoelen soude segghen, en dunckt my niet, dat dit waren slechte recht uytgetrocken linien oft streken, ghelijck vele meenen, die geen Schilders en zijn: maer eenigen omtreck van een arem oft been, oft immer eenich pourfijl van een tronie, oft soo yet, den welcken omtreck sy seer net hebben ghetrocken, en t’sommiger plaetsen door malcanders treck met de verscheyden verwen henen, dat hier doorclieven van Plinio sal gheheeten wesen: ghelijck de Gheleerde, die geen goet verstandt van onse Const en hebben, oock onverstandich daer van schrijven en spreken. En mijn meyninghe bevest ick hier mede, dat Plinius ghetuyght, datter de ghene die hun aen de Schilder-const verstonden, grootlijcx in waren verwondert en verbaest. Waer door wel te verstaen is, dat het constighe omtrecken, en gheen simpel linien en waren, die dese soo uytnemenste opper Meesters in onser Const tegen malcander om strijdt ghetrocken hadden: want een rechte linie uyt der handt henen te trecken, soude menigh Schoolmeester, Schrijver, oft ander die geen Schilder en is, dickwils veel beter doen, als den besten Schilder van de Weerelt, en sulcx en wordt by den Schilders niet veel gheacht: want daer toe ghebruyckt men de rije oft reghel. maer de Const-verstandige verwonderen en ontsetten sich, wanneer sy sien eenen aerdigen en constigen omtreck, die met een uytnemende verstandt behendich is ghetrocken, waer in de Teycken-const ten hooghsten bestaet: maer de rechte linien souden sy onghemerckt voorby gaen. Nu weder keerende tot Appelles, hy was soo vlijtich, en de Const soo toeghedaen, dat hy een onverbrekelijcke aenghewende wijse hadde, alle daghe yet te doen, dat de Schilder-const aen ging, ten minsten yet te teyckenen, oft een trecxken ergens aen te gheven, het zy hoe veel belangs hy hadde, oft andersins verleghen hy wesen mocht: en van daer henen is ghecomen het ghemeen Spreeckwoordt, dat den Gheleerden wel is bekent: Nulla dies sine linea.
Dat niet een dagh voorby most gaen, Oft daer en waer een treck ghedaen.
Marino, Giovanni Battista, Dicerie sacre(publi: 1614), « La pittura, parte seconda » (numéro Diceria I) , fol. 59v (italien)
- [1] Eccl. 17
- [2] Ezech. 7
- [3] Abac. 2
- [4] Ose. 2
- [5] Psal. 73
Ma passando dalla favola alla historia, e continovando l’intrapresa metafora della Pittura, non è fors’ella questa medesima tenzone nel contrasto di due Pittori famosi adombrata ? Apelle tira una sottilissima linea nella tavola di Protogene. Protogene riconosciuto il maestro, divide quella d’Apelle con altra più sottile. Apelle finalmente senza lasciar più luogo alla sottigliezza con un’altra invisibile sega per mezo quella di Protogene. O con quanta gentilezza tirò il Pittor celeste l’invisibile lineamento dell’anima humana creandola innocente. [1] Secundum imaginem suam fecit illum. Ma con quanta sottilità il Pittore infernale interruppe il corso di questa belle linea facendole violare il divino precetto. [2] Imagines abominationum, dice Ezechiello. [3] Conflatibile, et imaginem falsam, dice Abacucco. Et ecco che’l sapere dell’uno abbassa l’audacia dell’altro con l’incomparabile lineatura di questo lino, e rivolgendo in desperatione l’emulatione, finisce il giuoco, e spezza del suo competitore il disegno. [4] Et confringet simulacra eorum, dice Osea. [5] Et imagines ipsorum ad nihilum rediges, dice David.
Tassoni, Alessandro, Pensieri diversi, libri dieci(publi: 1620), « Statue, e pitture antiche e moderni » (numéro libro X, cap. XIX) , p. 387 (italien)
Con lui[Explication : Apelle.] da prima contese Protogene anch’egli famoso di quella età, e dura ancora la memoria di quella tavola loro dipinta solamente d’alcune sottilissime linee, che tirarono a concorrenza; ma divennero poscia amici stretissimi.
Butrón, Juan de, Discursos apologeticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior a las siete que comunmente se reciben(publi: 1626), « Discurso decimoquinto. Donde se muestra la veneracion en que los antiguos tuvieron la pintura, los principes que la professaron, y algunas de las muchas honras, y mercedes que le hizieron », fol. 109r-109v (espagnol)
Fue a Rodas solo por conocer a Protogenes, a quien admirava por sus obras, con quien tuvo aquella contienda delas lineas. Llamando en la casa de Protogenes respondiole un criado, que no estava en casa, pero que dexasse dicho el nombre para que lo dixesse a su dueño : tomò un pincel Apeles, y cogiendo una tabla que estava imprimada tirò una linea en ella, diziendo que aquel era su nombre. Venido Protogenes, conocio el forestero Apeles en la linea, diziendo, que solo el pudo tirarla tan subtil. Mojò Protogenes el pincel con otro color, y tirò tan subtil otra linea, que dividio la primera de Apeles, para que le respondiessen que el que pudo hazer aquello era el pintor a quien buscava. Bolviendo segunda vez Apeles, y corrido de que pudiesse tirarse linea mas subtil que la suya, tirò otra de otro color sobre la de Protogenes, no dexando lugar a mas subtileza, con que quedò vencido Protogenes, y los dos muy amigos. Conservòse esta tabla en señal de milagrosas admiraciones a los professores de la pintura ; y poco antes de los tiempos de Plinio se quemò en cierto incendio que huvo en la casa del Cesar.
Saumaise, Claude de, Cl. Salmasii Plinianae exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistoria. Item Caii Julii Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus(publi: 1629) (t. I), p. 5-6 (latin)
Narrat Plinius lib. XXXV cap. XIII. Apellem cum Rhodum adnavigasset cognoscendi Protogenis causa qui ibi agebat, ad ejus domum ventitasse, quem cum domi non offendisset, arrepto penicillo lineam ex colore duxisse summae tenuitatis per tabulam, quae forte in machina prostabat, quamque anus asservabat, ut Protogenes sic intelligeret a quo quaesitus esset : reversum Protogenem et lineam contemplatum non dubitasse quin Apelles venisset, ipsumque alio colore in eadem illa linea aliam multo subtiliorem duxisse, eamque postea tertio colore ab alia linea sectam ab Apelle, sic ut nullum amplius relinqueret subtilitati locum. Tabulam illam avide a se spectatam refert ibidem Plinius, cum miraculo essent lineae pene visum effugientes. Negat Monjocosius lineas dici de coloritia pictura : negat certamen fuisse inter Apellem et Protogenem de linearum subtilitate ; lineas linearumque adeo tenuitatem in pingendo nihil facere, nec necessariam esse contendit : negatque omnino Plinium vidisse quod viderit. Ad ea quae ille pluribus et subtilius quam verius contendit, paucis ego responderim. Primum omnia illa quae Plinius in ea historia narranda persecutus est, ex Graecorum Latinorumque commentariis hausisse, et eorum auctorum, qui non tantum de pictura scripserunt, sed et ipsi nobilissimi pictores extiterunt, ut Apelles et Melanthius. Quare si Plinius erravit, alii ante ipsum similiter erraverint necesse est. Deinde falsum prorsus est, linearum nomen picturae quae coloribus inducitur, minime convenire. Sane si lineas pictura coloraria non habet, nec ulla erunt corporum vultusque lineamenta, quorum formas pingendi ars aemulatur : quid enim aliud lineamentum quam lineae ductio ? lineamenta porro vultus, et corporis, lineis imitatur et exprimit pictura : quarum aliae extremitates corporum circumscribunt, quae extremae lineae dicuntur : aliae media corpora per partes exprimunt et delineant, quae interiores et mediae appellantur. Hic pictura ipsa linearis appellata, quae primo sine coloribus lineas intus spargebat, postea etiam colores lineis induxit. Primis enim picturae incunabulis umbram hominis lineis circumducebant, nullas intus lineas ad exprimenda lineamenta ducebant. Plinius lib. XXXV cap. 3. Graeci autem alii Sicyone, alii aput Corinthios repertam, omnes umbra hominis lineis circumducta, itaque primam talem, secundam singulis coloribus et monochromaton dictam, postquam operosior inventa erat, duratque talis etiam nunc. inventam liniarem a Philocle Aegyptio vel Cleanthe Corinthio primi exercuere Aridices Corinthius et Telephanes Sicyonius, sine ullo etiamnum hi colore, iam tamen spargentes linias intus. ideo et quos pinxere adscribere institutum. primus inlevit eas colore testae, ut ferunt, tritae Cleophantus Corinthius. Vides linearem picturam eam dici quae ad hominem exprimandum non solam ejus umbram lineis circumscribit et adterminat, quod primi picturae inventores faciebant, sed quae intus etiam lineas spargens, lineamenta corporea effingit. Quae et initio quidem sine colore absolvebatur, postea coloribus expedita est, et colorum usu percrebrescente ars perfecta et iconici homines pingi coepti. Linearis igitur pictura proprie de coloria et lineae in eo pingendae genere dictae tam extremae, quam internae. In lineis extremis, et circumcaesura corporum finienda, palmam Parrhasio veteres dederunt. Plin. Lib. XXXV cap. X. primus symmetrian picturae dedit, primus argutias voltus, elegantiam capilli, venustatem oris, confessione artificum in liniis extremis palmam adeptus. haec est picturae summa suptilitas. corpora enim pingere et media rerum est quidem magni operis, sed in quo multi gloriam tulerint; extrema corporum facere et desinentis picturae modum includere rarum in successu artis invenitur. Quid in re nota pluribus opus est ? Linea non est in pictura, idem quod in geometria, sine latitudine longitudo, sed est penicilli ductus, unde lineamentum, lineas sive lineamenta vultus et corporis tractus appellamus, ut et in pictura. Horatius :
Nulla dies abeat quin linea ducta supersit,
quod proverbium ex Apelle natum, cui perpetua consuetudo fuit, numquam tam occupatam diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem. γραμμῶν ἔκειν Graeci dicunt de pictoribus : nam et γραφεῖν, a quo γραμμῶν factum, proprie Graecis pingere est, et γραφεις pictores, et γραμμα opus pictum. Inde et lineare pro exprimere et effingere Apulejo lib.X. ut adhaerens pressule membrum voluptatis graphice linearet. Ita omnino legendus ille locus. Vulgo scribunt, Membrorum voluptatem graphice linearet, et peius interpretantur, obvelaret. Ventus nunc reflans laciniam tunicae dimovebat, et pubem Deae ostendebat : nunc adspirans ita pressule corpori eam iungebat, ut typum et lineamenta membri voluptatis graphice effingeret. Membrum voluptatis illud est, quo foeminae censentur. Lineare igitur verbum pictorum, ut lineae et lineamenta. Plinius de Veneris Coae tabula quam Apelles imperfectam reliquit : Apelles inchoaverat et aliam Venerem Cois, superaturus etiam illam suam priorem : indivit mors peracta parte : nec qui succedere operi ad prescipta lineamenta inventus est. Et alibi : illud vero perquam rarum ac memoria dignum est, suprema opera artificum inperfectasque tabulas, sicut Irim Aristidis, Tyndaridas Nicomachi, Mediam Timomachi et quam diximus Venerem Apellis, in maiore admiratione esse quam perfecta, quippe in iis liniamenta reliqua ipsaeque cogitationes artificum spectantur. Quintilianus in eadem re exponenda linearum nomine usus est, non repertum scilicet qui praescriptas ab Apelle lineas posset absolvere. Inde omnibus lineis absolutum opus, de consummatissimo : quod ex pictura tractum. Arnobius de pictura : quæ pares lineas principali ab ore traducat. Dioscorides : τὸ δὲ κιννάβασι τοῦτο κομίζεται μὲν ἀπὸ Λιβύης, πιπράσκεται δὲ πολλοῦ, καὶ τοσοῦτον ἐστιν, ὡς μόλις ἐξαρκεῖν τοῖς ζωγραφοις εἰς τὴν ἐν ταῖς γραμμαῖς ποικιλίαν. Vides varietatem linearum in pictura coloria dici ? ἀκριβῆ ἐυγγραμμίαν Graeci etiam appellant, de re per quam scite et exquisite picta. Quod autem negat Monjocosius lineam ex colore ductam alia tenuiore linea secari posse, penitus eum ratio fugisse videtur. Quis enim nescit delicata et suspensa manu ductum penicillum longe subtiliorem lineam efficere, quam si idem pressiore nisu per tabulam trahatur ? Hoc si verum est, quid ni et subtilior linea per minus tenuem duci queat, eamque dividere ? Linearum porro subtilitas non tantum requiritur in extremitatibus circumscribendis, sed etiam in multis aliis interioribus lineamentis effigiandis. Qui subtilitatem et minutias capillamenti exacte repraesentare volet pictor, an non linearum tenuitate cum ipso capillo certare opus habebit ? Nihil sane tenuius aut delicatius capillo. Iam vero illud quale est, quam frivolum, quod illos pictores non de subtilitate linearum certasse vult, sed de commissuris et transitu colorum, quem harmogen dicebant ? Sed nos manum tandem de tabula, ne ultra crepidam. Occasione date, non potuimus facere quin Plinium ab inscitiae et ablepsiae crimine, quod illi impactum ivit Monjocosius, vindicaremus.
Jauregui, Don Juan de , Don Juan de Iauregui, cavallerizo de la Reina nuestra señora, cuyas universales letras, y emenencia en la Pitura, han manifestado a este Reino, y a los estraños sus nobles estudios(publi: 1633), fol. 191v-192r (espagnol)
- [1] Colores lo menos de la pintura
- [2] Competencia de Apeles y Protogenes
Y esta alma y vida no consiste en hermosos colores, ni en otros materiales externos, sono enlo intimo del Arte y su inteligencia; para ajustar preciso el dibujo con seguro contorno, y delineamentos, como lo entendio bien Aristoteles en su Poetica, comparandola con la Pintura: pues avienro propuesto, Quasi anima tragœdiæ est fabula, añade: Perque si alguno manchasse sin artificio una imagen de colores, aunque hermosissimos, menos del citaria que quien con distincion del Artifice delineasse solo dibujo. Supone aquellas lineas artificiosas por alma en la Pintura, como en la Tragedia fabula. [1] Porque se ves que los colores todos, materiales del Pintor son lo minimo, ò nada, y que lo essencial del Arte, es su inteligencia, y teorica. [2] Lineas sola savia en aquella tabla tan grande, magnæ amplitudinis, y tan contemplada de Plinio, la que fue campo de batalla, ò palestra, en la gran contienda de Apeles, y el vencido Protogenes, la que se guardò por milagro a la posteridad, y era de todos admirada, especialmente de los Artifices. Y aunque dize Plinio que eran lineas casi invisibles, no se entiende que serian secillas, y rectas, sino con alma de dibujo: ni me alargo a creer a Demoncioso, que tiene por lineas otras fantasias sin fundamento, de que se burla con razon Salmasio: basta concederles bidujo, y considerar que este solo dio veneracion tan suprema à aquella gran tabla. Y mayor applauso alcançò otra de Apeles, por averla dexado en las lineas de solo el dibujo: porque en este (como dize el agudo Plinio) Lineamenta reliqua, ipsæque cogitationes artificum spectantur.
Commentaires :
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo quinto. Tratase del modo del juzgar de las Pinturas, singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo; y que es Colorido: y pruebase, que los antiguos fueron grandes artifices”, fol. 76v (espagnol)
- [1] Los mayores dibutances antiguos y modernos
- [2] Hencho cientifico y fabio de Micaelangel.
[1] De los antiguos se descollò de entre los demas en esta parte Parrasio, y entre los nuestros modernos el mas que de inmortal fama, Micaelangel Buonaroti, que fin duda estavan doctamente en el conocimiento de las partes del cuerpo, que como dixo un docto, ha de tener for cosamente belleça, donaire, y gracia, para lo perfecto, o fealdad y desgracia para lo imperfecto. Lo qual con particular gracia y biçarría la ostentò en cierta ocasion, que unos cultos humanistas celebraban la de tantos repetida contienda, de Apeles y Protogenes, de las lineas tantas vezes a porfía divididas, de que quedò vencedor el Ateniense Apeles. [2] Y dixo Micael, que no era aquello le que a tales hombres les habia dado opinion, ni era bastante causa para dar muestra de su saber, y tomando (como te conté el tercero dia) un lapizero sobre un papel, delineò una figura desnuda, sin alçar el lápiz desde que empeçó, hasta que cerrò aquella circunscripcion, con admiracion de los circunstantes, y asombro de los Artifices, que despues la vieron y veneraron ; y dixo : Si esto està bien, es de estimar, porque no lo conseguirà el que no fuere dueño de las buenas proporciones y formas y que no estuviere cierto en la perspectiva, mui docto en la anotomia, y no tuviere las manos y vista bien habituadas.
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), fol. 174v (espagnol)
Celebre es la competencia de Apeles y Protogenes, sobre tirar una linea en un plano, y el adagio del mismo Apeles : Nulla dies sine linea : por lo qual la Pittura es toda superficie. Y si como dixe Socrates, tambien professor del Arte, la Pintura imita, y representa lo que se vè : Pictura est imitatio, et repræsentatio eorum, quæ videntur, segundo Xenoph. lib. 3. memor. cap. 29. si representa lo que se vè, y de nigun cuerpo, alomenos denso, vemos mas que la superficie, porque nuestra vista no penetra la cantidad : siguese, que la Pintura solo retrata las superficies.
Commentaires : COMPLETER: Réf du dialogue
Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias(publi: 1633), “Dialogo quinto. Tratase del modo del juzgar de las Pinturas, singularidad de la Perspectiva; que es Dibujo; y que es Colorido: y pruebase, que los antiguos fueron grandes artifices”, fol. 80r (espagnol)
- [1] Competencia de Apeles y Protogenes
[1] Y aquella tan celebrada y referida contienda entre Apeles y Protogenes, sobre el dividir las lineas, que por ser cosa tan socorrida para ejemplos que declaren varios pensamientos, se han conservado tanto en la memoria de los hombres.
Renaudot, Théophraste, Cinquante-huitiesme Conference du mercredy 27. Dec. 1634, dans Seconde Centurie des Questions traitées ez Conferences du Bureau, depuis le 3 novembre 1634. Jusques à l'11 fevrier 1636(publi: 1636), p. 72 (fran)
Il y a plus de merveille en la peinture de representer au naturel avec un trait grossier du charbon (comme on dit que fit Apelles devant Ptolemee pour lui representer celui qu’il ne lui pouvoit former) qu’avec les couleurs, la moindre partie de la peinture : qui ne consiste proprement qu’en la proportion : laquelle estant la plus divine action de l’entendement, il ne faut pas s’estonner s’il y a si peu de bons peintres au prix des autres. Ceux-là s’abusans qui ont colloqué l’excellence de la peinture en la subtilité des traits lors qu’ils feignent que le mesme Apelles fut reconnu de Protogenes pour avoir fait une ligne plus subtile que lui. Car au contraire, les plus excellents traits de maistres sont souvent les plus grossiers. Et cette proportion pour estre exacte ne doit pas seulement imiter les sujets particuliers, mais l’espèce de chacune chose en general. Ce que n’ayant pas fait Michel Caravague il y a 60 ans : et au lieu de suivre les belles regles d’Albert Durer, s’estant arresté à copier seulement apres le naturel, a servi de planche à tous ses successeurs, qui ne s’amusent plus qu’à cette imitation destitüee de ses régles : d’où nous viennent les défauts de la peinture aujourd’hui.
Commentaires : éd. 1968, p. 148-149
Pacheco, Francisco, Arte de la pintura(publi: 1638) (III, 9), t. II, p. 155-156 (espagnol)
Da Apeles refiere Plinio, que [...] habiendo buscado y vencido a Protógenes en la sutiliza y primor de las lineas de diferentes colores primera y tercera vez (como lo confesó el mismo Protógenes).
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (III, 3, 10), p. 174-175 (anglais)
- [2] Lib. XXXV cap. 10.
- [3] In Satyrico.
- [4] In Aristotelis praedicam
[1]
Besides this same Harmoge, which draweth different colours into one by an orderly and pleasant confusion, it is furthermore requisite that an artist should take speciall care about the extreme or uttermost lines; seeing it was ever held one of the greatest excellencies in these arts that the unrestrained extremities of the figures resembled in the worke should be drawn so lightly and so sweetly as to represent unto us things we doe no see: neither can it be otherwise but our eye will alwayes beleeve that behind the figure there is something more to be seene then it seeth, when the lineaments that doe circumscribe, compasse, or include the images are so thinne and fine as to vanish by little and little, and to conveigh themselves quite away out of our sight. All masters doe confesse, sayth Plinie [2], that Parrhasius his chiefe glory was in the uttermost lines, and that indeed is the highest subtiltie in picture: for although it require great skill to paint the bodie and middlemost parts of figures, yet are there many that got credit by it. To make the extremities of bodies and handsomly to shut up the measure of an ending picture, is seldome found in the greatest successe of art; seeing the extremitie ought to compasse her selfe about, ending with a promise of other things behinde, sand setting forth also what shee concealeth. Parrhasius for all that being, compared with himself seemeth to come short in the expression of the middlemost bodies. The following words of Petronius urge the same, I came to a gallery, sayth he [3], much to bewondered at for severall sorts of pictures. I saw Zeuxis his hand, which as yet had escaped the injury of age; as for Apelles his picture, which was known among the Grecians by the name Monocnemos, I did not sticke to adore it: for the extremities of the images were with such a wonderfull subtiltie cut off after the similitude, that you could not but thinke it to be a picture of the spirits and soules it selfe. Seeing that Petronius and Plinie doe urge such a singular subtiltie in the uttermost lines of an exact and absolute picture, wee may very well suspect that they did anciently in these extremities of images require certaine lines approching neere to the subtiltie of the imaginarie geometricall lines; which are nothing else but a length without breadth. That it is not an idle fancy of our brain, sayth Ammonius [4], that there should be a longitude without latitude, but that such a thing is in Nature, the partings betweene enlightened and shadowed places doe manifestly shew: for when it chanceth that the sunne casting his beames upon a wall enlighteneth but some part of the same, the partition betweene the enlightened and shadowed place must needs be a longitude without latitude: for if it hath any latitude, it must needs be either enlightened or else shadowed with the rest; seeing nothing can be conceived betweene these two: and if it be enlightened, it is to be put to the enlightened part: if on the contrary it be shadowed, it is to be added to the shadowed part: but now there is a line manifestly to be seene in the middest, which by her length doth onely distinguish the enlightened part from the shadowed: and if these parts are distinguished one from another, there must of necessitie be something besides them that distinguisheth, which as it shall not be enlightened nor shadowed, so shall it consequently be without any breadth. Whosoever therefore doth but slenderly understand how much a neat and delicate picture abhorreth all maner of grosse and course lines, the same shall easily be perswaded to conceive well of those extreame lines that come something neere the geometricall: neither shall he be very much deceived who guesseth that this was the maine reason why the ancients studied with such an industrious care to draw all manner of lines in colours with a light and easie hand. We shewed above, lib. II, cap. XI, §1, that this was Apelles his daily practice, and that afterwards it grew to be the highest point wherein Apelles and Protogenes made triall of their art.
- [1] voir aussi Parrhasios contours
Junius, Franciscus, The Painting of the Ancient(publi: 1638) (II, 11, 1), p. 197-198 (anglais)
Apelles had this custome, saith Pliny in the same place, that he never would suffer himselfe to be so much imployed a whole day, but that he remembred ever to exercise the art by drawing of a line: and this custome of his became a common proverbe. Yea, we may learn out of the following words also, that Apelles by the meanes of this diligence put downe Protogenes in that most famous strife of drawing subtill lines. It is pretty, what fell out between Protogenes and Apelles, saith Pliny. Protogenes did live at Rhodes; whither when Apelles was come, desirous to know the workes of him whom he knew only by fame, he made haste to goe to his shop. Protogenes himselfe was absent, but an old woman kept a large boord, alreadie sitted upon the asse or scaffold, to have something drawne upon it. The old woman having answered, that Protogenes was gone forth, asked withal, whom shee should say had looked for him. Tell him, said Apelles, that this is the man that sought him: and taking a pencill, hee drew an exceeding thinne line with one or other colour upon the board. The old woman at Protogenes his returne shewed him instantly what was done. And it is reported that the artificer, having considered the finenesse of the line, did forthwith professe himselfe to know that Apelles was come; seeing he held it impossible that such an absolute work should be done by anybody else. It is added also, that Protogenes drew a thinner line with another colour over the said line, bidding the old woman at is going forth, that she should shew this unto him that had asked for him and ell (sic) him that this was the man he did looke for. It fell out so. Apelles returneth: but being ashamed to be overcome, he divided the lines with a third colour, not leaving any further place for subtilitie. Whereupon Protogenes confessing himselfe overcome, did hastily runne to the haven, seeking the stranger: this same boord was left unto the following ages without any change, to the astonishment of all men, but of artificers chiefly. We have greedily viewed it before the first firing of Caesar his house in the palace, where it perished, containing in a more spacious wideness nothing else, but such lines as could hardly be discerned by the eye: so that this boord among the brave works of many artificers did seeme to be emptie, alluring the spetators therefore and being indeed more noble than any other worke. I know well enough that many will not understand these words of Plinie after that plaine meaning the alledged place urgeth; yet does they not perswade us to take these words otherwise, then of the strife of lines most subtilly drawne with a light and gentle hand. But of this, God willing, somewhere else: seeing it is better wee should pursue our intent, by comparing that carefull diligence of the ancients with the carelesse negligence of these our times.
Rampalle, Daniel de, L’Erreur combatuë. Discours académique où il est curieusement prouvé, que le monde ne va point de mal en pis(publi: 1641), p. 137-139 (fran)
Il est impossible que le coloris d’Apelle que Pline met hors de comparaison, fut plus excellent, ny plus vif que celuy du Corregio, que les plus habiles trouvent inimitable ; son pourtrait d’Alexandre tenant à la main une foudre qui sembloit sortir du tableau, n’avoit rien qu’on ne trouve aux merveilleux ouvrages de Raphaël d’Urbin dans le palais du pape. Et si cet ancien prince des peintres, eut veu dans la sale Clementine des figures humaines toutes droites dans le concave de la voûte, sans estre rapetissées par la situation, ny estropiées à cause du racourcissement ; s’il eut veu ces galleries peintes avec un ordre de colomnes, qui par une tromperie de la perspective incognue à l’Antiquité, finissent en des païsages, et des esloignemens qui déçoivent la veüe ; s’il est veu les couronnes, les cercles d’or, les globes, et les estoilles peintes sur les murailles avec tant d’artifice, que les plus entendus estant surpris s’imaginent à tous momens qu’elles tombent ; avec combien plus de raison auroit il tesmoigné l’estonnement qu’il fit paroistre à la veüe de cette ligne fameuse, que Protogenes enfila dans la sienne ?
Vossius, Gerardus Joannes, De quatuor artibus popularibus, de philologia et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur chronologia mathematicorum, libri tres, cap. V, De Graphice(publi: 1650), De Graphice (numéro cap. V, §50 ) , p. 85 (latin)
- [1] p. 251 et seq. edis. Leidensis
- [2] p. 5
Apellis quoque aequalis erat Protogenes. Ejus cognoscendi caussa Apelles, cum Rhodum navigasset, et domum ejus venisset, quam anus adversabat ; penicillo ex colore tenuem duxit lineam. Protogenes domum reversus ex subtilitate vidit ab Apelle ductam : perque Apellis lineam colore alio duxit tenuiorem. Eam postea conspiciens Apelles, per hanc ipsam duxit longe tenuissimam. Refert Plinius lib. XXXV cap. XIII. Sed non convenit, de quo certarint duo hi nobiles artifices. Quid Ludovicus Demontiosius censeat, videre apud eum potes libro de Pictura. [1] Eum vero refellit Salmasius in Exercitationibus Plinianis ad Solinum. [2].
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « Se sia buono, o abuso, che l’artefice si chiuda nel luogo del lavoro » (numéro III, 19) , p. 211 (italien)
Si fonda in questo, che tra gli spettatori delle pitture pochi sono quasi nuovi Protogeni, cioè buoni conoscitori delle linee de’ nuovi Apelli ; e molti sono simili a quel cortigiano del Papa, che dimandando un poco di disegno al famoso pittor Giotto, e questo facendogli quel tondo tanto pari di profilo, che ne venne il proverbio : « Tu sei più tondo che l’O di Giotto », egli non lo stimò, e si tenne quasi beffato. Voglio dire, molti non conoscono l’eccellenza dell’artificio, che sta espresso in una sola parte, anche piccola d’un intiera pittura ; e però i pittori si chiudono al lavoro, ne vogliono, che l’opera si veda, se non compiuta, e perfetta, in cui comparisca, nobilmente campeggiando, una gran moltitudine di bellezze, ed una bellissima varietà d’artificii, co’ quali uniti insieme si fà dolce incanto al giudizio, ed agli occhi di molti spettatori, e si guadagna facilmente l’affetto, l’applauso, e la lode loro.
Ottonelli, Giovanni Domenigo ; Berettini, Pietro, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso loro(publi: 1652), « Degli avvertimenti, e modi, co’ quali può il pittore far opere di probabile, e forse universale sodisfazione », « Quarto avvertimento » (numéro III, 12 ) , p. 177-178 (italien)
E quello, il quale può normarsi compendio di molti avvertimenti : ed io spiegerollo, come fù già spiegato da un valente professore in un famigliar discorso con un amico, « Non porta, disse, il pregio dell’opera, che un artifice dipingendo facci grandissimo conto di tirar una linea, con istraordinaria sottigliezza, o condurre un circolo con squisita rodondità. » L’antica, e famosa linea (se pur fù linea, e non contorno, come crede qualche giudizioso) di quel valente Apelle non era argomento tale, che senza lei mancasse nell’artefice il valore : perché se il polso gli fusse tremato nel tratto del pennello, la linea non riusciva di perfezione, e pure Apelle rimaneva Apelle, cioè pittor di maravigliosa eccellenza : dunque l’operante facci grande stima, ed usi gran diligenza, per saper ben formare le figure delle cose movibili, tutte le parti d’un corpo, i panni, e l’altre cose attenenti alle medesime figure, le quali rimangono guaste ed imperfette per ogni leggier difettuccio : il che non suole avvenire nel dipingere o fiori, o frutti, o simiglianti cose.
Félibien, André, Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes, vol. 1(publi: 1666), IIe Entretien, p. 162-163 (fran)
Ce peintre qui étoit d’un temperament jovial et facétieux, lui fit cet O dont l’on a tant parlé et qui même donna lieu à un proverbe italien.
Je vous prie, me dit alors Pymandre, de m’apprendre l’histoire de cet O, dont je n’ai pû encore sçavoir l’origine.
Je vous la dirai, si vous le voulez, repartis-je : mais je doute que vous en soyiez bien satisfait, car c’est une de ces sortes d’histoires qui ne signifient pas grand’chose, et dont cependant les auteurs font quelquefois grand bruit. Vous sçaurez donc que l’envoyé du pape ayant vu à Sienne et à Florence tous les peintres les plus fameux, s’adressa enfin à Giotto, auquel après avoir témoigné l’intention du S. Siège, il lui demanda quelque dessein pour le montrer au pape, avec ceux qu’il avoit déjà des autres peintres. Giotto qui étoit extrémement adroit à dessiner, se fit donner aussitôt du papier, et avec un pinceau, sans le secours d’aucun autre instrument, il traça un cercle, et en soûriant le mit entre les mains de ce gentilhomme. Cet envoyé croyant qu’il se moquoit, lui repartit que ce n’était pas ce qu’il demandoit, et qu’il souhaitoit un autre dessin. Mais Giotto lui repliqua, que celui-là suffisoit ; qu’il l’envoyât hardiment avec ceux des autres peintres et qu’on en connaîtroit bien la différence. Ce que le gentilhomme fit, voyant qu’il ne pouvait obtenir davantage.
Or on dit que ce cercle étoit si également tracé, et si parfait dans sa figure, qu’il parut une chose admirable, quand on sçut de quelle sorte il avoit été fait. Et ce fut par là que le pape et ceux de sa cour comprirent assez combien Giotto était plus habile que tous les peintres dont on lui envoyoit les desseins. Voilà l’histoire de l’O de Giotto, qui donna lieu aussitôt à ce proverbe italien: Tu se’ più tondo che l’O di Giotto, pour signifier un homme grossier et un esprit qui n’est pas fort subtil.
Il semble par là, dit Pymandre, que le principal sçavoir de tous ces anciens peintres consistât dans la subtilité et la délicatesse de leurs traits. Car ce fut encore par des lignes très-subtiles et très-déliées qu’Appelle et Protogene disputerent à qui l’emporteroit l’un sur l’autre ; et Protogene ne ceda à Appelle que quand celui-cy eut coupé avec une troisième ligne plus délicate les deux qu’ils avoient déjà tracées l’une auprès de l’autre. A vous dire le vrai, repartis-je, ni l’O de Giotto ni ces lignes d’Appelle et de Protogene, ne sont point capables de nous donner une haute idée de leur grand sçavoir. Il est vrai que nous voyons dans les plus anciens tableaux que les ouvriers avaient un soin tout particulier de finir et de marquer les choses fort délicatement, tâchant de représenter jusqu’aux cheveux et aux poils par des traits les plus subtils qu’il leur était possible. Et il n’y eut, comme je crois, que cette délicatesse de trait et cette parfaite rondeur que Giotto décrivit sans l’aide d’aucun instrument, qui fut cause qu’on admira cet O.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Vita di Protogene », p. 158-160 (italien)
- [1] VIII.
- [2] IX.
- [3] X.
[1] E celebre l’avvenimento, e la gara d’Apelle, e di Protogene. Dimorava questi in Rodi, dove sbarcando Apelle ansioso di vedere l’opere di colui, il quale non altrimenti conosceva che per fama, di presente s’inviò per trovarlo a bottega. Non v’era Protogene, ma solamente una vecchia, che stava a guardia d’una grandissima tavola messa su per dipignersi. Costei da Apelle interrogata rispose, che’l maestro era fuori; indi soggiunse: e chi debbo io dir che lo cerchi ? Questi, replicò Apelle, e presso un pennello tirò di colore sopra la tavola una sottilissima linea. Raccontò la vecchia tutto il seguito a Protogene, e dicesi, che egli tosto considerata la sottigliezza della linea affermasse esservi stato Apelle, perchè niun’altro poteva far cosa tanto perfetta; e che con diverso colore tirasse dentro alla medesima linea un’altra più sottile, ordinando nel partirsi, che fosse mostrata ad Apelle se ritornasse, con aggiugnere, che questi era chi egli cercava. Così appunto avvenne, perciocchè egli tornò, e vergognandosi d’esser superato, segò, e divise le due linee con un terzo colore non lasciando più spazio a sottigliezza veruna. Laonde Protogene chiamandosi vinto corse al porto di lui cercando per alloggiarlo. In tale stato senz’altro dipignervi fù tramandata questa tavola a’ posteri con grande stupor di tutti, e degli artefici massimamente. Abbrucciò ella in Roma nel primo incendio del palazzo Cesareo, dove per avanti ciascuno vide avidamente, e considerò quell’amplissimo spazio altro non contenente, che linee quasi invisibili. E pure collocata fra tante opere insigni tirava a se gli occhi di tutti più bella, e più famosa perch’era vota. [2] In questa congiuntura fecero stretta amistà questi due artefici, essendo Apelle cortesissimo eziandio co’ suoi concorrenti. […] [3] E fino a’ tempi di Tiberio si conservarono per le gallerie di Roma i disegni, e le bozze di questo artefice, che facevan vergogna all’opere vere della natura.
Dati, Carlo Roberto, Vite de' pittori antichi(publi: 1667), « Postille alla vita di Protogene », p. 170-175 (latin)
VIII. E celebre l’avvenimento, e la gara d’Apelle, e di Protogene ec.
Tutto questo da Plinio l. 35 c. 10. Scitum est, inter Protogenem, et eum quod accidit. Ille Rhodi viuebat; quo cum Apelles adnauigasset, auidus cognoscendi opera eius, fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petijt. Aberat ipse, sed tabulam magnae amplitudinis in machina aptatam picturae anus vna custodiebat’. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogauitque a quo quaesitum diceret. Ab hoc inquit Apelles : arreptoque penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reuerso Protogeni, quae gesta erant anus indicauit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem, dixisse Apellem venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet adiiceretque, hunc esse quem quaereret, atque ita euenit. Reuertitur enim Apelles : sed vinci erubescens, tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus in portum deuolauit hospitem quaerens. Placuitque, sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam constat priore incendio domus Caesaris in Palatio, auide ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani simile, eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem. So benissimo che il nome di Plinio presso ad alcuni non è di grandissima autorità stante il mal concetto di poca fede addossatogli a gran torto dal volgo. Io non voglio adesso far la difesa di questo gran scrittore contro a certi faccenti, che senza forse averlo mai letto lo tacciano di menzognero. E chi fu mai più di lui curioso del vero ? che per ben conoscerlo non conobbe pericolo, e finalmente morì, onde fu chiamato,
A scriver molto, a morir poco accorto.
Se costoro sapessero quanto sia difficile lo scrivere la storia universale della natura necessariamente rapportandosi ad altri senza poterne fare il riscontro, o non sarebbero così facili a contraddire, o lo farebbero con più modestia, e rispetto. Plinio parla in questo luogo d’una cosa veduta da lui, e da tutta Roma, onde non par verisimile, ne ch’egli dovesse mentire, ne ch’egli potesse ingannarsi. All’incontro la disputa fra gli artefici grandi intorno a sottigliezza di linee pare una seccheria indegna di loro. Ne meno par possibile, che una linea sottilissima possa mostrar maniera da far conoscere un valente maestro: benché Stazio nell’Ercole Epitrapesio dica.
Linea, quae veterem longe fateatur Apellem.
nel qual verso pare appunto che il poeta avesse in mente questo caso, e questa tavola d’Apelle, e di Protogene. Le difficultà per l’una, e per l’altra parte son molte, e forti, ne io mi sento da risolvere così ardua questione. La propongo adunque a tutti i professori, e letterati, supplicandogli del parer loro per farne in altro tempo una raccolta da pubblicarsi con tutta l’opera. Accennerò per ora quanto fu scritto da altri, e particolarmente da Giusto Lessio, nell’Epist. Miscell. Cent. 2 n. 42. Quod quaeris a me de Apellaeis illis lineis, verasne eas censeam, et quales, ad prius respondebo veras, nec fas ambigere, nisi si fidem spernimus historiae omnis priscae. Ad alterum nunc sileo : et censeo, vt prius ab amico illo nostro quaeras, cuius ingenium grande, et capax, diffusum per has quoque artes. Lodovico di Mongioioso nel suo libretto della Pittura antica, che va stampato con la Dattilioteca d’Abramo Gorleo con lungo discorso si sforza di provare, che le linee d’Apelle, e di Protogene non fossero, e non potessero esser linee, e che Plinio s’inganasse in riferire questa contesa, la quale pretende che non fosse di sottigliezza di linee, ma di un digradamento e passaggio da colore a colore, o per dir conforme ad esso dal lume allo splendore, e dallo splendore all’ombra, pigliando la comparazione dalla musica. Il qual discorso per esser sottilissimo stimo bene che ognuno lo vegga, ed esamini da per se presso all’autore, non lo volendo alterare nel riferirlo. S’oppongono al Mongioioso sostenendo il detto di Plinio Francesco Giugni l. 2 c. 11. della Pitt. Ant. e più gagliardamente il Salmasio alla f. 5 della Dissertaz. Pliniane. Paolo Pino nel Dialogo della Pittura a 17. crede che i due pittori contendessero per mostrare in quella operazione maggior saldezza, e franchezza di mano. Vincenzio Carducci nel quinto de Dialoghi della Pittura scritti in lingua spagnuola riferisce che Michelagnolo sentendo parlar con lode delle linee d’Apelle, e di Protogene celebri per sottigliezza si dichiarò di non credere che tal cosa avesse portato riputazione, e fatti conoscere quei valent’uomini, e preso un matitatoio, fece in un tratto solo il dintorno d’un ignudo, che a tutti parve maraviglioso. Quel che si racconta del Buonarruoti l’ho più volte sentito d’altri professori della mia patria, e da me conosciuti, i quali con gran risoluzione e franchezza fecero il medesimo, cominciando da un piede della figura, e ricorrendo senza staccar la mano per tutti i dintorni del corpo. Queste si fatte operazioni son’ abili veramente a far conoscere un bravo artefice. Come pure il perfetissimo Circolo di Giotto mandato per mostra di suo sapere, per quanto dicono il Vasari nelle Vite, e il Borghini nel suo Riposo. La qual cosa appresso di me trova facil credenza per averne veduto segnare un’ altro colla mano in aria su la lavagna tanto esattamente, che più non potea fare il compasso, da un’ amico carissimo, il quale io non nomino, avendo egli troppe belle doti, e frutti d’ingegno, che lo fanno glorioso, senza pregiarsi d’un operazion della mano, benche sufficiente a recar fama al nostro antico pittore. Non è da tacere in questo luogo la tradizione d’un fatto di Michelagnolo secondo che corre per le bocche degli uomini, cioè, che desiderando egli di vedere quel che operava Raffaello nel Palazzo de’ Ghigi, colà s’introdusse travestito da muratore, quasi che avesse a spianar la colla, e dar l’ultimo intonaco: e che partitosi Raffaello, Michelagnolo per lasciar segno d’esservi stato, pigliasse un carbone segnando in una lunetta della loggia verso il giardino dov’è la celebre Galatea, quella gran testa, che ancor si vede sopra la semplice arricciatura. Il racconto più sicuro però si è che quello schizzo fosse fatto da Fra Bastiano del Piombo mentr’era quivi trattenuto dalla generosità d’Agostino Ghigi, mecenate di tutti gli artefici più segnalati. Comunque ciò sia piacque il conservar quel puro disegno fra l’opere insigni di Baldassar da Siena, e di Raffaello, acciò si vedesse che pochi, e semplicissimi tratti son bastanti a mostrare la finezza dell’arte. Torno adunque a pregar tutti, e spezialmente i professori, che si vogliano degnare di rileggere attentamente il luogo di Plinio, il quale non si fidò di se stesso, ne del volgo, e non andò, come si dice, preso alle grida, e perciò concluse, Placuitque sic eam tabulam posteris tradere omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo ; e poi di vedere se da quel racconto si possa trarre un ripiego, che salvi Plinio dalla nota di bugiardo nella storia, e Apelle, e Protogene dalla taccia di balordi dell’arte. Non mi parendo giusto il correre a furia a chiamare insipide quelle linee tanto riverite, come fece Alessandro Tassoni ne suoi pensieri troppo arditamente sfatando tutta l’Antichità.
IX. In questa congiuntura fecero stretta amistà questi due artefici ec.
Bella, e lodevol cosa è il cedere ingenuamente alla verità terminando le gare in virtuosa amicizia. Sia ciò detto a confusione de’ letterati moderni, i quali dovrebbero essere esempio per onestamente vivere agl’ignoranti, e pure in questo possono imparar molto dalla reciproca umanità, e discretezza di due pittori, che non si lasciaron rapire dall’impeto dell’emulazione amando l’uno nell’altro quella virtù, e quella perfezione, la quale ciascheduno andava cercando. O come scarso, e disutile è il frutto delle lettere, e degli studii. s’egli non vale a farci ne costumati, ne buoni, e non è bastante a por freno alle smoderate passioni, che colla veemenza loro ci trasportan lungi e dal vero, e dal giusto: onde nelle controversie erudite, e spesse volte anche sacre non sanno, o non vogliono i più saggi temperarsi dall’ingiurie e dal’improperi, per lo più alieni dalla contesa, i quali recano, a mio giudizio, maggiore offesa, e più vergogna a chi gli dice, che a coloro contro i quali son detti ! Io per me anteporrò sempre un ceder modesto ad una insolente vittoria, e terrò in somma, e perpetua venerazione l’unico, e singolare esempio di due grandi astronomi di questo secolo, i quali avendo non per odio fra loro, ma per amor della verità auto qualche dotto litigio, quello terminarono garreggiando di cortesia, e le dispute si cangiarono in dimostranze di vicendevole affetto. In questa guisa anche perdendo si vine, dove in quell’altra maniera di contrastare arrabbiata, e incivile anche i trionfi son vergognosi. Ma dove mi conduce il veemente desiderio di detestare, e se possibil fosse, d’estirpare così brutto costume ? Condonisi al mio zelo questo improprio, ma vero, e giusto rimprovero.
X. E fino a’ tempi di Tiberio si conservarono per le gallerie di Roma i disegni e le bozze di questo artefice.
Petronio. Protogenis rudimenta cum ipsius naturae veritate certantia non sine horrore tractaui. Così interpreto questo luogo, benche vi sia chi s’ingegni di tirarlo a quelle linee delle quali sì lungamente s’è parlato di sopra.
Pline (Gaius Plinius Secundus); Gronovius, Johann Friedrich (Johannes Federicus), C. Plinii Secundi Naturalis historiae, Tomus Primus- Tertius. Cum Commentariis & adnotationibus Hermolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri. Salmasii, Is. Vossii, & Variorum. Accedunt praeterea variae Lectiones ex MSS. compluribus ad oram Paginarum accurate indicatae(publi: 1669) (vol. 3), p. 581-582 (latin)
Scitum est, inter Protogenem et eum quod accidit. Ille Rhodi vivebat : quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus, fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam magnæ amplitudinis in machina aptatam, anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque, a quo quæsitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles : adreptoque penicillo lineam ex colore duxit summæ tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quæ gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse, præcepisse abeuntemque, si redisset ille, ostenderet, adjceretque hunc esse quem quæreret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, sed vinci erubescens, tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque, sic eam tabulam posteris tradi omnium quidem, sed artificum præcipuo miraculo. Consumptam eam constat priore incendio domus Cæsaris in Palatio, [1]avide ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem.
- [1] Avide ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem.] In apographo nostro, avide a nobis spectatam ante spatiose nihil aliud continentem quam lineas. Scribendum puto, avide a nobis spectatam, tanto spatio nihil aliud continentem quam lineas. Pint.
Huret, Grégoire, Optique de portraicture et peinture(publi: 1670), p. 104 (fran)
Plus, il[Explication : Alberti.] dit qu’il faut portrait delicatement les bords ou franges des superficies (il veut dire les contours des figures) parce qu’autrement cela sembleroit des fentes, rapportant pour appuyer son dire, les trois traits deliez qu’Apellés et Protogene firent l’un dans l’autre, donnant ensuite plusieurs autres avis de nulle importance. Or neantmoins tout ce que dessus est bon, ou du moins passable, mais ce qu’il dit ailleurs ne me semble pas de mesme.
Bellori, Giovanni Pietro, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni(publi: 1672), "Vita di Domenico Zampieri", p. 319 (italien)
Concorse ciascuno a vederle come un duello di due eccellentissimi artefici, nel quale combattevano non Apelle e Protogene di una linea, ma Guido e Domenico di tutta la pittura.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van de derde vrucht der Konst, dat is, wat eer en glory door haer te bekomen is » (numéro IX, 6) , p. 360 (n)
Een eerlijke faem en een loflijk gerucht, dat tot in de volgende eeuwen nagelaete. deurdringt, heeft de glory ziekste gemoederen vernoegt; en te meer, als zy wisten, dat men zelfs haer geringste werken wegens de beroemtheyt haers naems zou in eeren houden. Want om des naems wille is den Rhodiaenschen doek, daer den trekstrijt van Apelles en Protogenes op geschiet was, schoon’er maer drie gebogen linien op stonden, van al de werelt met verwonderinge bezichticht, en onder de grootste rariteyten tot Roma gevoert, en in’t Paleys van Cesar bewaert, tot dat den brant het gebouw en de konst daer inne vernietichde.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Du troisième fruit de l’art – des honneurs et de la gloire qu’il faut attendre grâce à lui » (numéro XI, 6) , p. 516 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Une honorable renommée et une rumeur louable qui traverse les siècles suivants satisfont les âmes les plus assoiffées de gloire, et plus encore lorsqu’elles prennent conscience du fait que l’on honore les moindres de leurs œuvres parce que leur nom est célèbre. C’est en effet par amour du nom que la toile rhodienne sur laquelle avait eu lieu la bataille de traits entre Apelle et Protogène (alors que seules trois lignes courbes s’y trouvaient) fut contemplée avec émerveillement par le monde entier, qu’on l’apporta parmi les plus grandes raretés à Rome et qu’elle fut conservée dans le palais de César, jusqu’à ce qu’un incendie n’anéantît l’édifice et l’art qui se trouvait à l’intérieur.
Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, XI, 6, « Du troisième fruit de l’art – des honneurs et de la gloire qu’il faut attendre grâce à lui », p. 516
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst(publi: 1678), « Van verscheiden aert en gedaente van Schildery, en wijze van schilderen » (numéro IX, 2) , p. 331 (n)
- [1] Geest geen klare opening
- [2] De O. van Giotto
- [3] Spreekwoort
Noch komt ons den trekstrijt tusschen Apelles en Protogenes vreemt voor, maer luister eerst, hoe dit toeging: Apelles door de saem van Protogenes verlokt, begaf zich na Rhodus, om zich door’t zien, van’t geen hem gezegt was wegens de uitnemenheit deezes konstenaers, te vergenoegen, doch aengeland, en op den winkel komende, vond hy Protogenes niet t’huis, maer wel een oude vrouwe, en een bereyt tafereel op den Ezel; des wilde hy wechgaen, maer de oude verzocht hem zijnen naem te melden, op dat haer meester weeten mochte, wie nae hem gevraegt hadde. Apelles hier op, nam een pinseel met verwe, en trok daer mede een wonderlijken fijnen trek, zeggende: Zegt hem, dat het dezen man is, die hem zoekt, en ging wech. Toen nu Protogenes wedergekeert was, de vrouwe gehoort hadde, en’t geen’er geschiet was, zag, bekende hy dadelijk dat het Apelles most zijn: want, zeyde hy, het is onmogelijk, dat iemant anders, als Apelles, zoo volmaekt een trek kon haelen. Maer hy zelve nam een pinseel, met een andere soorte van verwe, en doorkloofde de linie van Apelles, met noch een veel dunneren trek, en uitgaende belaste’t oude wijf, dien aen den vreemdeling, indien hy weder quame, te toonen, en te zeggen: dat dit de hand was van den man, dien hy zocht. Het geviel ook zoo, want Apelles quam andermael, en stond schier beschaemt van zich verwonnen te zien. Dies heeft hy de voorige linien, met een derde verwe zoodanich deursneeden, dat Protogenes bekennen most verwonnen te zijn, en na de haven liep om hem te zoeken, en, gelijk aen edelaerdige konstenaers past, hem minnelijk verwelkomde, en beleefdelijk onthaelde. En dit tafereel, daer niet anders, dan deeze drie trekken op stonden, en van verre niets op te zien was, is langen tijd bewaert geweest, en in’t paleis van Caesar, onder de treffelijkste werken van de grootste meesters, opgehangen, daer het ook, ten [1] tijden van Plinius, noch mede verbrand is. Maer deze historie maekt ons noch niet gerust in’t begrijpen van de wijze van handeling, en’t pinseelvoeren der ouden. Zommige waenen dit alleen maer fijne linien geweest te zijn: linien, gelijk. Junius zegt, die met een vaerdige lichte hand zachtelijk getrokken waren, linien, die met anderverwige linien op’t aldersubtijlste waren deursneeden. En deeze stellen al de prijswaerdicheit in de handgreep, [2] niet boven de O van Giotto te achten; die my hier wel te pas in den zin schiet. Toen Paus Benedictus de negende voorhad eenige stukken in Sint Pieters Kerk te doen maeken, zond hy een hoveling, om tot Siena, Florensen, en elders, de Schilders te bezoeken, en van hen eenige teykeningen te begeeren, om aen zijn Heylicheyt te vertoonen. Dezen hoveling quam eyndelijk ook by den geestig en Giotto, en verzocht ook teykening van zijnder handt. Giotto nam een vel papier, op welk hy trok met een pinseel, den arm vestigende tegen zijn zijde om zoo een passer te weezen, met een draejende hand, zonder den arm te verzetten, een zoo volkomen net getoogen rond, dat het wonder was. Dit gedaen zijnde, gaf hy’t al grenikkende den hoveling, zeggende: Zie daer de Teykeninge; waer over zich den anderen, meenendebespot te zijn, verontwaerdichde. Maer Giotto zeyde, dat het meer als genoeg was, om aen den Paus te vertoonen, en dat hy zien zoude, of men 't zouw kennen. Den anderen vertrok onvernoegt, doch vertoonde dit echter onder de teykeningen, tot groot vernoegen en verwondering van den Paus, en alle verstandigen, als zy verstonden, hoe Giotto zijn O zonder passer gemaekt hadde, waer op hy ook tot Romen ontboden wiert. En hier uit wies het spreekwoort, datmen tegens volk van grof deeg gebakken, gemeenlijk zeyde: Gy zijt ronder dan de O van Giotto. Maer om wederom tot de [3] trekken van Apelles en Protogenes te komen, Karel Vermander geeft 'er, mijns bedunkens, beter oordeel van. My dunkt niet, zegt hy, dat dit slechte recht uitgetrokke linien of streeken (gelijk veele meenen, die geen Schilders en zijn) geweest zijn, maer eenigen omtrek van een arm of been, of wel eenige tronie van ter zijden, of iet dergelijx, welkers omtrek zy zeer net hebben getrokken, en t' sommiger plaetsen door malkanders trek met de verscheidene verwen heenen, dat hier doorklieven van Pliniius zal geheeten weezen, gelijk de geleerden, die geen goet verstant van onze konst hebben, daer ook onverstandich van schrijven en spreeken. En mijn meeninge bevestich ik hier mede, dewijl Plinius getuigt, dat'er de geene, die de Schilderkonst verstonden, grootelijx van verwondert en verbaest waren: waer door wel te verstaen is, dat het konstige omtrekken, en geen simpele linien waeren, die zoo uitnemende oppermeesters in onze konst tegen malkander om strijt getrokken hadden: want een rechte of kromme linie uit der hand heenen te trekken, zouw menich schoolmeester, schrijver, of een ander, die geen Schilder en is, dikwils veel beter doen, als de beste Schilder van de werelt. En zulx wort by den Schilders niet veel geacht; want daer toe gebruiktmen de ry of regel. Maer de konst verstandige verwonderen en ontzetten zich, wanneer zy zien eenen aerdigen en konstigen omtrek, die met een uitnement verstant behendich getrokken is, waer in de Teykenkonst ten hoogsten bestaet; maer de rechte linien zouden zy ongemerkt voor by gaen. Dus verre Vermander.
Hoogstraten, Samuel van, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, « Des différentes natures et sortes de peintures, et des façons de peindre » (numéro IX, 2) , p. 483-485 (fran)(traduction récente d'un autre auteur)
La bataille de traits entre Apelle et Protogène ne nous apparaît pas moins étrange. Ecoutez d’abord comment elle s’est déroulée. Attiré par la renommée de Protogène, Apelle se rendit à Rhodes pour se satisfaire de visu de ce qu’on lui avait dit de l’excellence de cet artiste. Débarqué et arrivé dans l’atelier, il ne trouva pas Protogène chez lui, mais seulement une vieille femme ainsi qu’un tableau préparé sur un chevalet. Il voulut alors s’en aller. Mais la vieille lui de- manda de donner son nom afin qu’elle signifiât à son maître qui l’avait demandé. Apelle prit donc un pinceau avec de la couleur et traça avec une ligne admirable et fine, disant : explique-lui que c’est cet homme qui le cherche. Puis il partit. Lorsque Protogène fut de retour, qu’il eut entendu la femme et ce qui s’était passé, il vit l’œuvre et reconnut aussitôt qu’il devait s’agir d’Apelle : il est impossible, disait-il, que quelqu’un d’autre qu’Apelle puisse faire une ligne aussi parfaite. Mais il prit lui-même un pinceau, avec une autre sorte de couleur, et coupa la ligne d’Apelle d’un trait beaucoup plus mince encore. Repartant, il prescrit alors à la vieille femme de la montrer à l’étranger s’il revenait, et de dire que c’était la main de l’homme qu’il cherchait. Les choses se passèrent comme cela, car Apelle revint et eut presque honte de se voir surpassé. Il refendit encore les lignes précédentes d’une troisième couleur, si bien que Protogène dut se reconnaître vaincu. Il courut jusqu’au port afin de rechercher Apelle et, comme il convient aux artistes de noble caractère, l’accueillit avec amabilité et l’hébergea poliment. Et ce tableau, où il n’y avait rien d’autre que ces trois traits, et duquel l’on ne voyait rien de loin, a longtemps été conservé et accroché dans le palais de César, parmi les plus excellentes œuvres des plus grands maîtres, où il fut aussi détruit lors d’un incendie, avec les autres œuvres, du temps de Pline.
Cette histoire, toutefois, ne nous permet pas de comprendre avec certitude quel était le tour de main et le maniement de pinceau des anciens. Certains croient que ce tableau n’était constitué que de fines lignes, des lignes, comme le dit Junius, qui avaient été doucement tracées d’une main prompte et légère et qui étaient coupées le plus subtilement par des lignes d’autres couleurs. Ceux-là mettent tout le mérite de cette peinture dans le maniement du pinceau, à ne pas considérer supérieur au O de Giotto qui me revient justement en tête. Lorsque le pape Benoît IX eut l’intention de faire faire quelques œuvres dans l’église de Saint-Pierre, il envoya un courtisan rendre visite aux peintres de Sienne, de Florence et d’ailleurs, et leur demander quelques dessins à montrer à Sa Sainteté. Ce courtisan arriva finalement auprès du spirituel Giotto. Il lui demanda un dessin de sa main. Giotto prit une feuille de papier sur laquelle il traça, avec un pinceau, le bras s’attachant contre son côté pour faire ainsi un compas, avec la main tournant, un rond si soigneusement tracé qu’il en était merveilleux. Ayant fait ce dessin, il le donna au courtisan, tout souriant, en lui disant : vois donc ce dessin. Se supposant moqué, l’autre s’en s’indigna. Mais Giotto lui dit que ce dessin était plus que suffisant pour être montré au pape, et qu’il verrait si on le reconnaîtrait. L’autre partit insatisfait. Mais il le montra toutefois, parmi d’autres dessins, pour la grande satisfaction et admiration du pape et de tous les gens intelligents, lorsqu’ils comprirent com- ment Giotto avait fait son O, sans compas. C’est ainsi que le peintre fut appelé à Rome. Et de là vint le dicton que l’on disait habituellement face à des gens grossiers : vous êtes plus rond que le O de Giotto.
Mais pour en revenir aux traits d’Apelle et de Protogène, Carel van Mander en donne, selon moi, un meilleur jugement. Je ne pense pas, dit-il, que ce tableau était constitué par de médiocres lignes ou des traits tracés tout droits – comme le supposent beaucoup qui ne sont pas des peintres – mais par quelque contour d’un bras ou d’une jambe, ou bien quelque visage vu de profil, ou quelque chose de semblable dont ils ont très soigneusement tracé le contour, et qui était à certains endroits traversé par d’autres traits avec des couleurs variées, qui doivent être ce que Pline appelle des « coupures », à la façon de ces savants qui, n’ayant point de bon entendement de notre art, y sont aussi ignorants pour en écrire et en parler. Et je confirme ici mon opinion par le fait que Pline témoigne que ceux qui comprenaient la peinture en étaient grandement admiratifs et étonnés. Par quoi l’on peut bien comprendre qu’il s’agissait de contours habiles et non de simples lignes que des grands maîtres si excellents en notre art avaient tracés pour s’affronter l’un l’autre. Tracer à main levée une ligne droite ou une ligne courbe, en effet, beaucoup de maîtres d’école, d’écrivains, et d’autres encore qui ne sont pas peintres le font souvent mieux que le meilleur peintre du monde. Et ce genre de chose n’est pas beaucoup estimée par les peintres car, pour cela, on peut utiliser un réglet ou une règle. Mais ceux qui comprennent l’art sont émerveillés et stupéfaits de voir un contour charmant et habile, adroitement tracé avec une excellente intelligence, et en lequel consiste un grand art de dessin, mais négligent et ne prêtent pas attention à des lignes droites. Voilà pour Van Mander.
Commentaires : Trad. Jan Blanc, 2006, IX, 2, « Des différentes natures et sortes de peintures, et des façons de peindre », p. 483-485
Germain, Des peintres anciens et de leurs manières(publi: 1681), p. 122-123 (fran)
On sçait la rencontre que ce peintre eut à Rhodes avec Appelles sur ces deux lignes[1] qu’ils tirerent en l’absence l’un de l’autre sur une même toile, et sur la délicatesse desquelles tous deux alternativement se confesserent vaincus. Le même Pline la décrit assez au long dans le 35e livre de son Histoire, c. 9.
- [1] Note de Cochin, 1760 : Cette histoire n’est intelligible qu’en supposant que ces traits représentassent quelque chose, comme seroit une tête de profil. Alors on peut reconnoître à la certitude des formes la science du dessein.
Aglionby, William,, Painting Illustrated in Three Diallogues, Containing Choice Observations upon the Art(publi: 1685), p. 46-47 (anglais)
Protogenes was his contemporary, and chief concurrent in the art; he liv’d in the Island of Rhodes; and the fame of his works was such, that it drew Apelles from home, to go and see the author of them.
Their first interview was remarkable, and past in this manner: Apelles being landed at Rhodes, went straight to Protogenes his shop, or painting-room; where, finding none but an old woman, and a board newly prim’d, and prepared for painting, he, without saying anything, drew a line of admirable fineness of one colour, and so went his way; Protogenes being come home, the old woman shewed him the line; which he guess’d to be Apelles his work; and taking his pencil, drew another over that, finer than Apelles’s, and of another colour; telling the old woman, that if the man came back that drew the first line, she should tell him, that he that drew the second, was the man he look’d for. In a little time Apelles came, and seeing what Protogenes had done, took the pencil again, and with a stroke of a third colour, divided those two lines to subtely, that they were perfectly distinguishable, and so went his way. Protogenes coming home a little after, and seeing what he had done, confess’d himself vanquish’d; and presently ran to find out Apelles, whom he brought to his own house. This very piece, with these three lines, and nothing else in it, was afterwards carried to Rome, and long preserved among the rarities of the imperial palace.
FRIEND – This was a true meeting of two great artists, where skill and ingeniousness were equally eminent, and not envy and ill manners, as our artistes show one another.
Pline l’Ancien; Hardouin, Jean, Caii Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,... in usum Serenissimi Delphini(publi: 1685) (t. V ), p. 208 (latin)
Scitum est inter Protogenem et eum quod accidit. Ille Rhodi vivebat : quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus, fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse, sed tabulam amplae magnitudinis [1]in machina aptatam picturae, anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque, a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles : arreptoque penicillo [2]lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quae gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem dixisse Apellem venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus. Ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adjiceretque hunc esse quem quaereret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, sed vinci erubescens tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam [3]priore incendio domus Caesaris in Palatio audio : spectatam olim tanto spatio nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera [4]inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem.
- [1] In machina. Le chevalet.
- [2] Lineam ex colore. Lineam cave credas in pictura idem atque in geometrice esse, longitudinem sine latitudine. Est penicilli ductus, quem Graeci γραμμήν vocant, ut γραφεῖς pictores, opusque γράμμα. Nos tractum penicilli vocamus : hinc omnibus lineis absolutum opus, de consummato diximus, quod est ex pictura desumptum, καὶ μεταφοράν. Linearum porro tenuitate opus est, in multis lineamentis effingendis, in capillamento, exempli gratia, in venis, similibusque exacte formandis : hic enim non pressiore nisu, sed delicata as suspensa manu geri rem oportet. Statius, in Hercule Vind. Linea quae veterem longe fateatur Apellem.
- [3] Priore incendio. Meminit Tranquillus in Octavio, cap. 57. In restitutionem Palatinae domus incendio absumptae etc. Vide notas et emend. num. XI.
- [4] Inani similem. Ab omni pictura nudam : cum lineas modo tenues, nullam effigiem contineret.
Catherinot, Nicolas, Traité de la peinture(publi: 1687), p. 21 (fran)
[1] Fables des peintres, comme celle de Zeuxis et de Parrhase, celle d’Apelle et de Protogene. Mais enfin elles sont bien insensées. Quant à la derniere c’est une verité, si on veut en croire Pline. On peut encore adjoûter l’ecume du chien que Protogène ne pouvoit peindre, et celle du cheval que Néalcès ne pouvoit peindre pareillement. Et il ne se faut point étonner de ceci, car toutes les histoires anciennes regorgent de fables, et pour les depister il ne faut que supprimer ce qui est de surprenant.
- [1] voir aussi Fortune de Pline, Zeuxis et Parrhasios, Protogène Ialysos
Catherinot, Nicolas, Traité de la peinture(publi: 1687), p. 6 (fran)
Quant à l’O de Giotto, voyez M. Felibien en ses entretiens des peintres. On peut comparer cet O à la ligne d’Apelles.
Perrault, Charles, Le Siècle de Louis le Grand(publi: 1687), p. 12 (fran)
[1]
Et fut-ce un coup de l’art si digne qu’on l’honore,
De fendre un mince trait, d’un trait plus mince encore ?
- [1] voir le reste dans Zeuxis et Parrhasios
[Callières, François de], Histoire poëtique de la guerre nouvellement déclarée entre les Anciens et les Modernes(publi: 1688) (livre onzième), p. 251-252 (fran)
Quoy dit Protogene à Apelles, ce Poëte moderne pretend-il nous avoir convaincus d’ignorance en nôtre art, en disant,
Et fust-ce un coup de l’art si digne qu’on l’honore,
De fendre un mince trait, d’un trait plus mince encore.
Et lors qu’il y ajoûte ces deux autres vers injurieux.
A peine maintenant ces exploits singuliers,
Seroient le coup d’essay des moindres Ecoliers,
En verité, continua Protogene, c’est bien parler luy même en Ecolier dans un art dont il croit pouvoir juger en dernier ressort, ne semble-il par à l’entendre qu’Apelles et moy n’ayons jamais rien fait d’extraordinaire que de tirer trois traits fort minces de differentes couleurs l’un dans l’autre ? et est-ce sur un jeu de cette nature (que je défie cependant les plsu grands Peintres de son temps de pouvoir imiter) qu’il doit decider de nôtre merite ? ne sçait-il pas à quel point mes ouvrages ont esté admirez de toute l’antiquité ?
Perrault, Charles, Parallèle des anciens et des modernes(publi: 1688:1696) (t. I ), p. 203-206 (fran)
L’ABBÉ — Mais que dirons-nous de ce coup de maistre du mesme Appelle qui lui acquit le renom du plus grand peintre de son siecle, de cette adresse admirable avec laquelle il fendit un trait fort delié par un trait plus delié encore.
LE PRÉSIDENT — Je vois que vous n’entendez pas quel fut le combat d’Appelle et de Protogène. Vous estes dans l’erreur du commun du monde, qui croit qu’Appelle ayant fait un trait fort delié sur une toile, pour faire connoistre à Protogene que ce ne pouvoit pas estre un autre peintre qu’Appelle qui l’estoit venu demander, Protogene avoit fait un trait d’une autre couleur qui fendoit en deux celui d’Appelle, et qu’Appelle étant revenu il avoit refendu celuy de Protogène d’un trait encore beaucoup plus mince. Mais ce n’est point là la verité de l’histoire, le combat fut sur la nuance des couleurs, digne sujet de dispute et d’émulation entre les peintres, et non pas sur l’adresse de tirer des lignes. Appelle prit un pinceau et fit une nuance si délicate, si douce et si parfaite, qu’à peine pouvoit-on voir le passage d’une couleur à l’autre. Protogene fit sur cette nuance, une autre nuance encore plus fine et plus adoucie. Appelle vint qui encherit tellement sur Protogene par une troisième nuance qu’il fit sur les deux autres, que Protogene confessa qu’il ne s’y pouvoit rien ajouster.
L’ABBÉ — Vous me permettrez de vous dire que vous avez pris ce galimatias dans le livre de Ludovicus Demontiosius. Comment pouvez-vous concevoir qu’on peigne des nuances de couleurs les unes sur les autres, et qu’on ne laisse pas de voir que la derniere des trois est la plus délicate ? Je ne m’étonne pas que cet auteur ne sçache ce qu’il dit, rien n’est plus ordinaire à la plupart des sçavants quand ils parlent des arts ; mais ce qui m’estonne, c’est la maniere dont il traite Pline sur la description qu’il nous a laissée de ce tableau. Pline asseure qu’il l’a veu et mesme qu’il le regarda avec avidité peu de temps avant qu’il perit dans l’embrasement du palais de l’Empereur. Il ajouste que ce tableau ne contenoit autre chose dans toute son étenduë qui estoit fort grande, que des lignes presque imperceptibles ; ce qui sembloit le devoir rendre peu considerable parmi les beaux tableaux dont il estoit environné, mais que cependant il attiroit davantage la curiosité que tous les autres ouvrages des plus grands peintres. Montiosus ose soustenir que Pline n’a jamais veu aucunes lignes sur ce tableau et qu’il n’y en avoit point, et que le bonhomme s’est imaginé de les voir, parce qu’il avait oüy dire qu’il y en avoit, ou qu’il l’avoit bien voulu dire, pour ne pas s’attirer le reproche de ne voir goutte. N’est-ce pas là une temerité insupportable ; mais afin que vous ne m’accusiez pas de maltraiter un homme qui peut-estre a fait de gros livres, je ne parle qu’après Monsieur de Saumaise qui en dit beaucoup davantage, et qui paroist avoir été plus blessé que moy de cette insolence. Il est donc vrai qu’il s’agissoit entre Protogene et Appelle d’une adresse de main, et de voir à qui feroit un trait plus delié. Cette sorte d’adresse a longtemps tenu lieu d’un grand merite parmi les peintres. L’O de Giotto en est une preuve ; le pape Benoist IX faisoit chercher partout d’excellents peintres, et se faisoit apporter de leurs ouvrages pour connoistre leur suffisance. Giotto ne voulut point donner de tableau, mais prenant une feüille de papier en présence de l’envoyé du pape, il fit d’un seul trait de crayon ou de plume, un O aussi rond que s’il l’eust fait avec le compas. Cet O le fit preferer par le Pape à tous les autres peintres, et donna lieu un proverbe qui se dit encore dans toute l’Italie, ou quand on veut faire entendre qu’un homme est fort stupide, on dit qu’il est aussi rond que l’O de Giotto. Mais il y a desja longtemps que ces sortes d’adresses ne sont plus d’aucun merite parmy les peintres. Monsieur Menage m’a dit avoir connu un religieux qui non seulement faisoit d’un seul trait de plume un O parfaitement rond, mais qui en mesme temps y mettoit un point justement dans le centre. Ce religieux ne s’est jamais avisé de vouloir passer pour peintre, et s’est contenté d’estre loüé de son petit talent. Le Poussin lorsque la main lui trembloit, et qu’à peine il pouvoit placer son pinceau et sa couleur où il voulait, a fait des tableaux d’une beauté inestimable, pendant que mille peintres qui auroient fendu en deux le trait le plus delicat du Poussin, n’ont fait que des tableaux tres-mediocres. Ces sortes de proüesses sont des signes évidens de l’enfance de la peinture. Quelques années avant Raphaël et le Titien, il s’est fait des tableaux, et nous les avons encore, dont la beauté principale consiste dans cette finesse de lineamens, on y compte tous les poils de la barbe et tous les cheveux de la teste de chaque figure. Les Chinois, quoique tres-anciens dans les arts, en sont encore là.
Junius, Franciscus, De pictura veterum(publi: 1694) (II, 11, 1), p. 124-125 (latin)
Apelli fuit perpetua consuetudo, numquam tam occupatam diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem ; quod ab eo in proverbium venit, Plinius ibidem. Vbi etiam discas, Apellem ex quotidiano hoc lineas ducendi exercitio palmam praeripuisse Protogeni in celeberrimo subtilium linearum certamine. Scitum inter Protogenen et eum quod accidit, inquit Plinius. Ille Rhodi vivebat ; quo cum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petiit. Aberat ipse ; sed tabulam magnæ amplitudinis in machina aptatam, anus una custodiebat. Hæc Protogenem foris esse respondit ; interrogavitque, a quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles ; arreptoque penicillo lineam ex colore duxit summæ tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni, quæ gesta erant, anus indicavit. Ferunt artificem protinus, contemplatum subtilitatem, dixisse Apellen venisse : non cadere in alium tam absolutum opus : ipsumque tunc alio colore tenuiorem lineam in ipsa illa duxisse : praecepisse abeuntemque, si redisset ille, ostenderet, adiceretque hunc esse quem quaereret. Atque ita evenit. Revertitur enim Apelles ; sed vinci erubescens, tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quaerens. Placuitque sic eam tabulam posteris trade, omnium quidem, sed artificum præcipuo miraculo. Consumptam eam priore incendio domus Caesaris in Palatio, avide ante a nobis spectatam, spatiosore amplitudine nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani simile, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem. Non latet me, quam multi passim Pliniani hujus loci longe aliam faciant mentem ; minime tamen movent ut verba haec aliter accipienda putem, quam de nudo linearum suspense manu subtilissime ductarum certamine : de quo alibi.
Rosignoli, Carlo Gregorio, La Pittura in giudicio overo il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene(publi: 1697), « La religiosa pietà di riformar le imagini oscene in oneste » (numéro cap. X, §1) , p. 179-180 (italien)
Ciò che ritrae dall’emendar saviamente tali pitture, e farne sante metamorfosi, sì è il pericolo di difformarne la bellezza, storpiarne il garbo, e avvilirne il pregio. Poiche rare volte avviene, che ben riesca il ritoccare le imagini già perfette, il tirare linee sopra linee, colorir di nuovo i colori già vecchi, e campiar le facce d’una in un’altra sembianza. Che però i saggi pittori si guardano bene di non metter mano a’ lavori d’altri eccellenti artefici. Niuno degli antichi volle mai mettere il suo pennello sopra l’Iride d’Aristide, nè sopra l’Elena di Nicomaco, ancorche fossero in qualche parte imperfette. Ma questa scusa non sempre vale. Peroche non di rado avviene, che le pitture col ritoccarle si migliorino ; potendosi pur anche inserir colori sopra colori, e condurre linee sopra linee co, gran perfettione. È nota la gara di Protogene, e d’Apelle : quando questi sconosciuto ito alla casa di quello, e non trovatolo, dipinse sopra la parete una sottile linea, e disse alla fante : Ritornato che sarà il vostro padrone, ditegli, ch’è stato cerco da colui, c’ha tirata questa linea.[1]Protogene al vederne la sottigliezza s’accorse subito, ch’era opera d’Apelle. Poscia, preso il pennello, con diverso colore formò un altra linea in mezzo di quella, e soggiunse alla serva : se ritornasse quel forestiere, gli direte, che il ricercato da lui ha tirata quest’altra linea. Di fatto rivenne Apelle ; ove intesa la replica, e ammirata la più sottil riga, di nuovo con altro minio colorì sopra la seconda una terza linea con tanta sottilità, che tolse all’emolo la speranza di vincerlo. Ecco dunque che non sempre sono inferiori le nuove linee tirate sopra le antiche, e che talvolta riescono più ammirabili, e possono accrescere maggior pregio all’opera. Come lo accrebbe con più onesto decoro Giovanni dei Vecchi alla famosissima pittura del Giudicio, lavoro del Bonarotti, nella quale, per commessione di Pio V. egli riformò in forma decentissima alcune sconvenevoli nudità, che si vedeano in quel prodigio dell’arte.[2]Così anche Rafaello Borghini dimostrò essersi perfettionato in Firenze il famoso ritratto d’un infame cantatrice, che teneva in mano gli stromenti de’ suoi amori, con trasformarla in una Santa Lucia, che mostrava le insegne del suo glorioso martirio.
- [1] Plin. l. 35. c. 10.
- [2] Otton. c. 4. Q. 7.
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 137 (fran)
Le proverbe italien, Tu sei più tondo che l’O di Giotto, dont on se sert pour exprimer un esprit grossier, est fondé sur ce que le pape Benoît IX voulant juger de la capacité des peintres de Florence, qui étoient alors en grande réputation, envoïa quelqu’un sur le lieu pour rapporter un dessein de chacun d’eux ; cette personne s’étant adressée à Giotto, celui-ci fit sur du papier un cercle parfait à la pointe du pinceau, et d’un seul trait de main: Tenez, lui dit-il, portez cela au pape, et lui dites que vous l’avez vû faire. C’est un dessein que je vous demande, répondit l’autre. Allez seulement, repliqua Giotto : Je vous dis que Sa Sainteté ne demande pas autre chose. C’est sur cela que le pape lui donna la préference, et le fit venir à Rome, où il peignit entr' autres choses le tableau de mosaïque dont on vient de parler. Il répresente la Barque de Saint Pierre, agitée par la tempête: et il est connu sous le nom de la Nave del Giotto. Cette histoire du cercle de Giotto fait voir qu’en ces tems-là la hardiesse de la main avoit la meilleure part à l’estime qu’on faisait des Tableaux et des Peintres, et que les veritables principes du coloris n’étoient que peu ou point connus.
Piles, Roger de, Abrégé de la vie des Peintres, avec des reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du Peintre parfait, de la connoissance des Desseins et de l’utilité des Estampes(publi: 1699), p. 119-123 (fran)
La force de son génie et l’assiduité de ses études ne luy donnérent pas cette bonne opinion que les habiles prénnent ordinairement d’eux-mêmes. Il ne voulut juger de sa capacité que par la comparaison de celle des autres qu’il alloit visiter. Tout le monde sait ce qui arriva entre lui et Protogéne. Celuy-cy demeuroit dans l’Isle de Rhodes, où Apelle fit un voyage éxprès pour voir ses ouvrages, qu’il ne connoissoit que de réputation ; mais n’ayant trouvé dans la maison de Protogéne qu’une vieille femme, qui luy demanda son nom ; je vais le mettre sur cette toile, luy dit-il, et prénant un pinceau avec de la couleur, il y a dessina quelque chose d’une éxtréme délicatesse. Protogéne étant de retour, la vieille luy raconta ce qui s’étoit passé, et luy montra la toile. Mais luy, regardant avec attention la beauté de ces traits, dit que c’étoit Apelle qui étoit venu, ne croyant pas qu’un autre fut capable de faire une si belle chose. Et prénant d’une autre couleur, il fit sur les mêmes traits un contour plus correct et plus délicat. Et sortant ensuite, il donna ordre que, si celui qui étoit venu retournoit, on le luy montrât, en luy disant que c’étoit-là celuy qu’il cherchoit. Apelle revint aussi-tôt, et honteux de se voir vaincu, prit d’une troisiéme couleur, et parmi les traits qui avoient été faits, il en conduisit de si savans et de si merveilleux, qu’il y épuisa toute la subtilité de l’art. Protogéne les vit à son tour, et confessant qu’il ne pouvoit mieux faire, quitta la partie, et courut chercher Apelle avec empressement.
Pline qui écrit cette histoire, dit qu’il a vû la toile avant qu’elle eût été consumée dans l’incendie du palais de l’Empereur, et qu’il n’y avoit autre chose dessus que quelques lignes qu’on avoit assez de peine à distinguer ; mais qu’on estimoit cette toile plus qu’aucun des tableaux parmi lesquels elle étoit.
C’est à peu prés de cette sorte qu’il faut entendre cet endroit de Pline : car de l’entendre d’une simple ligne partagée le long de son étenduë, cela est contraire au bon sens, et choque tous ceux qui savent un peu ce que c’est que peinture ; n’y ayant en cela aucune marque de capacité, ni d’intelligence dans cet art.
Ce qui peut avoir donné lieu à cette mauvaise interprétation est à mon avis le mot de linea mal entendu : car linea en cet endroit ne veut dire autre chose que dessein, ou contour. Pline s’en sert luy-même en cette signification dans un autre endroit, où il dit d’Apelle, qu’il ne passoit aucun jour sans dessiner, nulla dies sine linea ; car ce n’est pas à tirer de simples lignes qu’Apelle s’occupoit, mais à se faire une habitude d’un dessein correct.
On doit entendre de même le mot de subtilitas, non pour donner l’idée d’une ligne tres-déliée, mais de la précision et de la finesse du dessin. Ainsi la subtilité n’est pas dans la ligne, simplement comme ligne, mais dans l’intelligence de l’art, qu’on fait connoître par des lignes.
J’avouë cependant que le mot de tenuitas, qui se rencontre dans le même endroit de Pline peut faire quelque difficulté, elle n’est pas néanmoins sans réponse ; car on peut fort bien entendre par ce mot, la finesse et la précision d’un contour. Mais je soûtiens encore qu’il serait tout-à-fait contre le bon sens, d’entendre que la victoire dans le combat d’Apelle et de Protogéne ne consistât qu’à faire une ligne plus déliée qu’une autre ; et que si Pline, qui s’est mal éxpliqué en cet endroit, l’a entendu de cette derniére façon, il avait peu de connoissance des beaux arts : quoy qu’il soit aisé de juger d’ailleurs qu’il les aimoit passionnément.
L’envie, qui se rencontre ordinairement parmi les gens de la même profession, ne trouva point d’entrée dans l’ame d’Apelle, et s’il cherchoit à s’élever, c’étoit par rapport à son art, qu’il connoissoit être d’une grande étenduë, et dont il aimoit la gloire. D’où vient qu’il n’avoit pas moins de soin de l’avantage de ses émules, que du sien propre, et qu’ayant reconnu la capacité de Protogéne, il le rendit recommandable aux Rhodiens, et luy fit payer des ouvrages incomparablement plus que ce peintre n’avoit accoûtumé de les vendre.
Voltaire, Jean-Marie Arouet, dit, Poésies mêlées (redac: 1710:1778) (LII), p. 275 (fran)
RÉPONSE A M. DE FORMONT.
On m'a conté (l'on m'a menti peut-être)
Qu'Apelle un jour vint entre cinq et six
Confabuler chez son ami Zeuxis;
Mais, ne trouvant personne en son taudis,
Fit, sans billet, sa visite connaître:
Sur un tableau par Zeuxis commencé
Un simple trait fut hardiment tracé.
Zeuxis revint; puis, en voyant paraître
Ce trait léger, et pourtant achevé,
Il reconnut son maître et son modèle.
Je suis Zeuxis, mais chez moi j'ai trouvé
Des traits formés de la main d'un Apelle.
Guérin, Nicolas, "Description de l’Académie royale de peinture et de sculpture", lue le 25 novembre 1713 à l'Académie royale de peinture et de sculpture(publi: 1713/11/25), p. 97 (fran)
Qu’auraient servi aux Zeuxis, aux Parrhasius, aux Apelle, les pompeux éloges qui leur sont donnés dans l’histoire, si le marbre n’avait fait passer jusqu’à nous quelques morceaux de sculpture du même temps, pour nous faire juger que le grand goût et la correction du dessein qui s’y trouve, était très apparemment commun aux peintres comme aux sculpteurs ? Sans cela, rien ne nous obligerait de regarder la peinture et la sculpture de ces temps éloignés que comme n’étant alors que dans leur enfance, et les louanges qui sont données à ces premiers maîtres que comme un transport officieux de gens qui n’auraient encore rien vu de plus beau.
Les preuves que Pline nous veut donner de leur habileté, dans le récit qu’il fait de la dispute des deux premiers de ces peintres, Zeuxis et Parrhasius, de même que de celle d’Apelle et de Protogène, ne seraient en effet guère capables de nous en faire naître une plus noble idée. Des raisins, un rideau, quelques lignes tracées sur une toile qui, selon ce qu’il en dit, marqueraient plutôt une subtilité de main qu’une production du génie, sont de trop petits objets pour nous faire valoir le mérite de ces grands hommes.
Coypel, Antoine, "Commentaire de l’Épître à son fils (Vrais et faux connaisseurs)", lu le 5 mai 1714 à l’Académie royale de peinture et de sculpture(redac: 1714/05/05), 103 (fran)
L’histoire des deux tableaux du Guide et du Dominiquin faits en concurrence à Saint-Grégoire de Rome pourront peut-être vous le persuader. Quand ces deux ouvrages furent découverts au public, tout Rome courut pour les voir, comme un duel de deux rares génies différent de celui d’Apelle et de Protogène qui ne combattaient que pour la finesse d’une ligne bien proprement tirée ; car ceux-ci combattaient pour toutes les parties de la peinture.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Propiedades accidentales de la pintura”, §4 (numéro Tomo I, Teórica della pintura, II, 8) , vol. 1, p. 322 (espagnol)
Siendo esto así, no será mucho, que tengan los ojos más abiertos los pintores para juzgar las obras de su arte, que aquellos, que no lo profesan; pues éstos sólo disfrutan el deleite, pero aquéllos la inteligencia. Por eso Nicomaco le respondió a cierto imperito en el arte (que dijo: no le parecía hermosa la Helena que pintó Zeuxis: ) toma mis ojos, y te parecerá una deidad. Mas lo que es digno de reparo, es, que tengan también esta perpicacia para juzgar sus propias obras. Bien sabida es la célebre competencia de las líneas de Apeles, y Protógenes, cuya ingenuidad cedió a la sutileza de la última línea de Apeles.
Palomino, Antonio, El museo pictórico y escala óptica(publi: 1715:1724), “Pintura a el temple” (numéro Tomo I, Teórica della pintura, I, 6, 2) , vol. 1, p. 138-139 (espagnol)
La pintura a el temple, es la que pinta con los colores, liquidados con cola, goma, o cosa semejante; es, a mi ver, aunque entre la cerífica, la más antigua, considerando las pinturas monocromatas, o de un solo color […]. Y así es forzoso que fuese a el temple, cuyos ingredientes nombra, barnizándola después, como acostumbraban; pues la del óleo, es contante, no llegó a noticia de los antiguos: bien, que usaban también los romanos la de las ceras, para en las naves, en que Plinio habla de presente: indicio de ejecitarse en su tiempo. Y discurro, tendría algún otro ingrediente desecante, además de la cera; pues dice, no le ofendía la sal, ni el sol: pero que la usasen los griegos, parece más difícil de probar, por la repetida frase de las ceras, para significar pinturas, como ya dijimos: pero, además de afirmarlo el Vasari, lo hallo con evidencia constante, pues para las líneas de la competencia de Apeles, y Protógenes, con libre y acelerado puylso tiradas y divididas, ni nos dice, que Apeles mandó calentar los colores, cuando la criada le dijo, que no estaba en casa su señor; de que se infiere, estarían heladas las ceras; ni éstas eran materia idónea para la libertad de aquellas líneas; ni el grueso o relieve, que dejaría la cera en tal caso, era capaz de la división y subdivisión, que asegura Plinio: conque es forzoso fuese a el temple, en que los colores corren con libertad.
Durand, David, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l’Histoire naturelle de Pline, liv. XXXV, avec le texte latin, corrigé sur les mss. de Vossius et sur la Ie ed. de Venise, et éclairci par des remarques nouvelles(publi: 1725), p. 64-66 (fran)
Mais à propos de Protogene, ne dirons-nous rien de la maniere, dont ces deux grands peintres vinrent à se connoître et à lier entre eux une amitié d’autant plus loûable, qu’elle est rare entre deux personnes du premier mérite, et qui courent la même carriere ? L’histoire en est trop jolie, pour ne pas trouver ici sa place. Protogene vivoit à Rhodes, connu d’Apelle seulement de réputation et par le bruit de ses tableaux. Enfin, à force d’en entendre parler, celui-ci conçoit le dessein d’aller voir lui-même la personne et les ouvrages dont on lui disoit tant de merveilles. Il s’embarque donc pour Rhodes, et arrivé là, il court incessamment chez Protogene. Mais n’y trouvant qu’une vieille, qui gardoit l’attelier de son maître, et un tableau[1] monté sur le chevalet, où il n’y avoit encore rien de peint, où est Protogene ? dit-il à cette femme, qui ne le connoissoit pas. Il est sorti, répondit-elle ; mais afin que mon maître sache qui l’a demandé, ayez la bonté de laisser votre nom. Le voici, reprit Apelle ; et prenant un des pinceaux, qui étoient là, avec un peu de couleur, il dessina, sur le tableau vuide, les premiers linéamens d’une figure[2], avec beaucoup de délicatesse ; et s’en alla. Protogene étant de retour et ayant appris de sa servante ce qui s’étoit passé, on dit qu’il tomba en éxtase, en voyant les traits qui avoient été dessinez. Mais il ne fut pas longtems à en deviner l’auteur. C’est Apelle, s’écria-t-il ; car il n’y a que lui au monde qui soit capable d’un dessein[3] de cette finesse et de cette legereté ! Sur quoi se sentant piqué d’une noble émulation, il prit lui-même le pinceau, et, avec une autre couleur, il essaya de l’emporter sur ce nouvel émule, en décrivant, sur les mêmes linéamens[4], d’autres contours, encore plus corrects et plus délicats que ceux d’Apelle ; et ordonna à sa gouvernante, que si le peintre revenoit, elle n’avoit qu’à lui montrer ce qu’il venait de faire, et lui dire, en même temps, que c’était là l’homme qu’il étoit venu chercher. Ce qui arriva ainsi ; mais Apelle, ne voulant pas qu’il fut dit qu’il eut été surpassé, dans les premiers principes de la peinture, reprit aussitôt le pinceau, avec un peu de couleur, mais différente des deux autres, et, parmi tous ces traits, qui avoient été tracez, il en conduisit de si savans et de si merveilleux, qu’il y épuisa toute la subtilité de l’art. Protogene étant de retour, et ayant distingué ces derniers traits[5], je suis vaincu, dit-il, et je cours embrasser mon vainqueur ! En effet, il vola au port, à l’instant, où ayant trouvé son rival, et lié avec lui une amitié, qui ne s’est jamais démentie, ils convinrent entr’eux, par rapport au tableau, où ils s’étaient escrimez, de le laisser à la postérité tel qu’il étoit, sans y toucher davantage ; prévoyant bien, comme il est arrivé, qu’il feroit un jour l’admiration de tout le monde, et particuliérement des connoisseurs et des maîtres de l’art. Mais ce précieux monument des deux plus grands peintres, qui furent jamais, a été réduit en cendres au premier embrazement[6] de la Maison d’Auguste, dans le palais, où il était éxposé à la curiosité des spectateurs, toujours nouvellement surpris, au milieu de quantité d’autres des plus excellents et des plus finis, de ne trouver, dans celui-ci, qu’une espèce de vuide, d’autant plus admirable qu’on n’y voyait que trois[7] desseins au simple trait et de la dernière finesse, qui échappaient à la vuë par leur subtilité, et qui par cela même devenoient encore plus rares et plus attrayans pour de bons yeux.
Notes au texte latin, p. 261-263 :
(X) Lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Voici un passage qui a été le sujet de bien des contestations. Saumaise et le P.H. après lui, nous avertissent que linea n’est point une ligne de géométrie, mais un trait de pinceau. Ce n’est pas assez ; il faloit ajouter, que lineam ducere, dans cet endroit de Pline, signifie dessiner, faire un dessein, en tracer les prémiers traits. C’est le stile de notre auteur : Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo, numquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit. Or ce proverbe-là lève la difficulté, nulla dies sine linea, c. à. d. sans dessiner, sans tracer quelques contours, quelque figure, qui signifie quelque chose : car pour ce qui est des traits qui ne signifient rien, comme M. Perrault prétend qu’étoit celui d’Apelle, cela est opposé au bon sens, à l’expérience, et seroit tout à fait indigne d’un homme aussi éclairé que Pline, et qui, selon Félibien, a écrit de cet art avec beaucoup de lumiere.
(Y) Contemplatum subtilitatem. La I. Ed. porte, contemplata subtilitate ; c’est une nouvelle licence des copistes : il n’y a gueres que des auteurs avant Terence, qui aient employé contemplo, are, voyez Nonius, ch. 7 n. 11. Du reste, il ne faut pas s’arrêter ici à subtilitas, comme s’il ne s’agissoit que d’un trait delié : la délicatesse du trait y entroit sans doute pour quelque chose, mais ce n’étoit pas tout, comme Félibien l’a cru, et Perrault après lui. Écoutons le premier : Car ce fut encore par des lignes très déliées qu’Apelle et Protogene disputèrent à qui l’emporteroit l’un sur l’autre ; et Protogene ne ceda à Apelle que quand celui-ci eut coupé (Perrault dit fendu) avec une troisième ligne plus délicate les deux autres qu’ils avoient dejà tracées l’une auprès de l’autre. Voilà où Félibien et Perrault se séparent, Apelle coupa les deux premiers traits, selon le premier, ce qui est plausible ; et selon le second, il les fendit ; ce qui est absurde. Mais ils péchent l’un et l’autre en ce qu’ils ne mettent ici que des lignes. M. de Piles a évité ces deux erreurs : « linea, en cet endroit, ne veut dire autre chose que dessein, ou contour. Pline s’en sert lui-même dans cette signification, nulla dies sine linea. On doit entendre de même subtilitas, non pour donner l’idée d’une ligne très déliée, mais de la précision et de la finesse du dessin : ainsi la subtilité n’est pas dans la ligne, mais dans l’intelligence de l’art, qu’on fait connoître par des lignes. » DE PILES, Vie des peint. grecs, p. 118.
(Z) Non cadere in alium tam absolutum opus. Ce n’étoit donc pas une simple ligne, un seul trait, puisque c’étoit un ouvrage achevé. Croit-on que Pline eut parlé ainsi d’un simple contour, qui ne signifioit rien ? Ni Félibien, ni Perrault, ni Junius, ni Carlo Dati, ni Monjocosio, ni le P.H. n’y ont pas fait attention.
(A) Tenuiorem lineam penicillo duxisse. C’est la leçon de la I. Vénitienne. La leçon commune porte, tenuiorem lineam in illa duxisse ; c.à.d. ligne sur ligne et contour sur contour, ou, comme dit Perrault, un trait d’une autre couleur qui fendoit en deux celui d’Apelle. C’est un bonheur pour les Anciens, qu’il y ait tant de variétez de lecture dans ce trait d’histoire de notre Pline. Voilà déja la plus ancienne de toutes les Edd. faite probablement sur un des meilleurs MSS qui ne reconnoit point cet in illa ipsa, qui a fait une partie de l’achoppement des critiques et des peintres ; et j’ose bien dire que notre Pline ne se connoissoit pas en peinture, s’il a entendu ici trois linéamens les uns précisément sur les autres, en telle sorte que le second en fit trois ; et que le troisième, enchérissant sur les deux autres, en produisit cinq. C’est une éxtravagance qu’on lui prête ; car vous verrez tout à l’heure, qu’il ne reconnoit que trois desseins, quam tres lineas. Il est vrai qu’à l’égard du second, il le nomme tenuiorem lineam ; mais cela ne veut dire autre chose, sinon qu’un dessein d’une plus grande finesse : or il dit que Protogène y employa le pinceau, penicillo duxisse ; ce mot n’est point là hors d’œuvre ; il aurait pû se servir de la plume, du crayon, de la rubrique, etc., mais il trouva à propos de se battre à armes égales.
(B) Adjiceretque hunc esse quem quaereret. Bien attaqué, bien défendu. La servante de Protogene avoit prié son émule de laisser son nom ; le voici, lui dit Apelle, en prenant un pinceau ; comme s’il disoit, voici des caracteres, qui lui diront qui je suis. De même Protogene, ayant appris de sa gouvernante de quelle maniere il avoit ecrit son nom, lui renvoye la bale avec la même urbanité ; si l’étranger revient, dites-lui que voilà l’homme qu’il est venu voir. Bravo.
(C) Tertio colore lineas secuit. C. à d. selon l’explication ordinaire, qu’Apelle étant revenu, il avoit refendu le trait de Protogène d’un trait encore beaucoup plus mince. Ce sont les termes de M. Perrault ; mais s’il vivoit encore, je le prierois de se souvenir que jamais personne n’a parlé plus proprement que notre Pline : toutes les fois qu’il s’agit de fendre, il emploie le mot de findere, qui marque presque toujours une ligne droite, perpendiculaire, parallèle, si j’ose parler ainsi ; au lieu que secare est presque toûjours appliqué à une idée plus générale, qui est l’action de trancher, couper, aller au bout par la voye la plus courte, et dans quelque sens que ce puisse être. Ainsi Virgile a dit, ad naves secare viam ; pour dire couper le chemin, l’abrêger : et en géométrie, le secteur de cercle, le segment, les sections coniques, parce qu’elles tranchent et ne fendent point ; en medecine secare venam, parce qu’on y fait une incision un peu oblique ; et dans notre auteur, sectura formantur gemmae, parce qu’on les taille en facettes. Il est vrai que quelquefois il employe secare dans un sens contraire, et en ligne parallèle, mais alors il en avertit par l’idée de la chose même : comme lorsqu’il dit secare marmor in crustas : lignum in laminas, parce qu’on sçait bien que ces sortes de choses ne souffrent pas l’obliquité : si bien que lineam secare n’est point la même chose que lineam findere ; qu’il n’auroit pas manqué de mettre ici, s’il avoit eu la pensée qu’on lui attribue ; du moins il auroit dit, tertio colore lineas secuit medias. Encore y auroit-il eu de l’équivoque, parce qu’on peut couper des lignes par le milieu, sans les fendre. Après cela, M. Perrault a bonne grâce de triompher, à son ordinaire, en prétendant qu’il ne s’agit ici que d’une adresse de main ; à peu près comme celle de l’O de Giotto, aussi rond que s’il avait été fait avec le compas ; qu’un religieux, ami de M. Mesnage, en faisoit autant quand il vouloit ; que divers peintres, qui auroient fendu en dix le trait le plus délicat du Poussin, n’ont fait que des tableaux très médiocres ; il ne s’agit point ici de cela. Il s’agit d’un dessein, au simple trait, d’une grande finesse ; d’un second dessein, en concurrence de celui-là, d’une plus grande finesse encore ; et enfin d’un troisième, où Apelle se surpassa lui-même et ne laissa rien à desirer ni pour la délicatesse du trait, ni pour l’élégance et la perfection des contours. Et pour ce qui est de fendre un trait délicat du Poussin en dix, c’est là une de ces vivacitez qui échappent dans le dialogue, mais que l’on ne pardonneroit pas à un homme éclairé, comme M. Perrault, s’il l’avoit fait de sang froid. Au défaut de son frère l’architecte, qui étoit si grand dessinateur, M. de Piles, son ami, lui auroit fait entendre qu’un trait délicat ne se fend point, au moins dans le sens qu’il prête à Pline, et que la moindre justice qu’on doive à un homme qui avoit vu et admiré tout ce qu’il y avoit alors de plus beau en peinture, n’avoit pas encore perdu l’esprit sur un sujet, où, de l’aveu de Félibien, il a parlé avec beaucoup de lumiere.
(D) Omnium quidem, sed artificum praecipue, miraculo. C’est la leçon de la I. Venitienne, qui est la véritable. La leçon ordinaire porte, praecipuo miraculo ; mais c’est nous éxposer encore aux insultes des Perraults. Car, diront-ils, s’il ne s’agit là que de 3 lignes qui se surmontent l’une l’autre, et que les connoisseurs de ce tems-là aient crié merveille là-dessus, c’est une marque qu’ils n’y entendoient pas finesse. La leçon de Venise pare ce coup : Omnium quidem, sed artificum praecipue, miraculo : c. à. d. que tout le monde admira ces 3 desseins, mais surtout les peintres et les artisans, qui savoient ce que c’étoit, que de joindre à la finesse des traits, la justesse et la dignité des contours. Chacun pouvoit juger du premier article ; peu de personnes pouvoient juger du second. Lisez donc praecipue, et par la construction, omnium quidem, sed artificum praecipue, et par la nature de la chose même, et d’après un MS. de Dalecamp, et d’après l’ed. de Venise, et enfin d’après la I. ed. de Parme, qui contient de très bonnes lectures.
(E) Consumptam eam priore incendio Caesarear domus in Palatio audio. Voici un des endroits de Pline qui a été le plus mal traité. Le plus ancien MS. porte : consumptam eam priore incendio Caesaris domus in Palatio audi spectatam nobis ante spatiose nihil aliud continentem quam tres lineas, etc. Or il est très possible que du olim tanto les copistes aient fait nobis ante ; qui fait un sens ridicule et contradictoire. La I. ed. n’est point éxempte d’une corruption antérieure au MS. de Voss. voici ce qu’elle porte : ante a nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud continentem quam illineas (si je m’en souviens bien) visum effugientes. Je dis, si je m’en souviens bien, car je n’ai pas marqué cette différence et je n’en ai plus qu’une idée confuse. Quoi qu’il en soit, voilà déjà une corruption plus marquée, SPATIOSIORE amplitudine. La I. ed. de Rome ajouta encore un mot ; consumptam eam CONSTAT, et supprima audio. Les edd. suiv. enchérirent encore sur la falsification ; AVIDE ante a nobis spectatam. Je me détermine pour la correction de Gronovius, ou pour celle que j’ai admise dans le texte, ante a nostris spect. Le P. H. a suivi Gronovius et Pintianus, mais il s’est contenté de quam lineas, au lieu de quam tres lineas, qui éxpliquent si bien le sujet du tableau, savoir trois desseins au simple trait, mais de diverses couleurs, qui les distinguoient les uns des autres, et qui ayant été faits en concurrence par les deux plus grands peintres du monde, devoient être effectivement une des plus grandes curiositez, qu’il y eut alors sur la terre. Écoutons maintenant M. Perrault. Il réfute fort bien Monjocosus, qui avoit entendu trois nüances, et puis il ajoute : « Pline assure qu’il a vu le tableau lui-même, qu’il le regarda avec avidité, peu de tems avant qu’il périt dans l’embrazement du palais de l’Empereur : qu’il ne contenoit autre chose dans toute son étenduë, qui étoit fort grande, que des lignes presque imperceptibles. » Vous voyez que tout cela n’est fondé sur sur des altérations. 1. Le passage est évidemment corrompu, puisque ni les MSS. ni les Edd. ne s’accordent point. 2. Le premier incendie de la Maison des Césars arriva sous Auguste. Suëtone y est formel ; car dans le chap. 57 de sa vie, où pour faire voir combien cet empereur étoit aimé, il rapporte les collectes immenses de cet édifice ; In restitutionem Palatinae domus incendio absumtae, Veterani, Decuriae, Tribus, atque etiam singillatim e cetero genere hominum, libentes ac pro facultate quisque pecunias contulerunt. Voilà donc le I. incendie du Palais des Césars, distinctement marqué, priore incendio Caesaris domus in Palatio. A moins donc que de vouloir faire passer notre Pline pour éxtravagant, il ne faut pas lui faire dire qu’il a vu un tableau, qui n’étoit déjà plus, lorsqu’il est venu au monde. 2. Cette avidité qu’il lui attribue dans l’éxamen du tableau n’est point dans la I. edition ni dans le MS. de Vossius ni dans quelques autres. 3. Ce peu de tems avant qu’il périt, est tout à fait du crû de M. Perrault, et ne se trouve dans aucune édition. 4. Caesarea domus, ou Caesaris, n’est pas bien rendu par le Palais de l’Empereur : car cela voudroit dire, le Palais de Vespasien, qui régnoit alors ; ce qui est une faute d’écolier : car, après Néron, il n’y a plus de Césars. On ne donnoit plus ce nom aux Empereurs : il faloit donc dire la Maison d’Auguste, puisqu’il s’agit du I. incendie arrivé sous son règne ; ou, la Maison des Césars, Caesareae domus. 5. On n’appelle point lignes, des traits qui ont été faits avec le pinceau ; et ce seroit bien mal entendre son Pline, que de lui faire dire qu’Apelle ne passoit aucun jour sans éxercer l’art de tirer des lignes ; quin lineam ducendi exerceret artem ; selon la I. ed. car il est évident que ces lignes sont des desseins. 6. Pline n’en compte que trois, quam tres lineas. Mais si M. Perrault en est cru, il en faudra compter cinq : le trait d’Apelle fendu par celui de Protogene, et ensuite celui-là par un troisième, en voilà assurément cinq. Or qui a jamais ouï parler d’une pareille chose ? Le I. trait étoit déja éxtremement mince, summae tenuitatis et cependant le voilà partagé en bien des parties. De bonne foi, croit-on que Pline éxtravaguoit ? M. Perrault, en se mocquant des Anciens, soupçonne que la plus grande partie de leur art consistoit dans cette finesse de traits ; je le veux : il doit donc convenir qu’Apelle et Protogne y éxcelloient : or, je vous prie, est-ce là un si grand coup pour un Apelle, que d’ouvrir le combat, par un trait si grossier en sa superficie qu’il y aura place pour quatre autres ? Si cela est, il faut convenir qu’il n’étoit pas fort habile et que toute l’Antiquité, avec notre Pline, ont été bien bêtes, d’élever jusques aux nuës un pinceau qui débuttoit si mal.
- [1] Une table d’attente, et non pas une toile, comme disent Félibien, de Piles et quantité d’autres ; car en ce tems-là, on ne peignoit que sur le bois. Voyez ci-dessus, p. 45.
- [2] C’est ainsi qu’il faut traduire ce lineam duxit, comme a fait M. de Piles, et non pas un trait, comme l’entendoit M. Perrault.
- [3] A la lettre : un ouvrage si achevé, TAM ABSOLUTUM OPUS. Ce n’étoit donc pas une simple ligne. Voy. Perrault, Paral. Tom. I p. 203.
- [4] Comme pour rectifier ceux d’Apelle : à peu près comme feroit un professeur de dessein, dans une Academie, sur l’ouvrage d’un élève, qui vient de s’éxercer sur le modelle. Car de supposer, comme le fait M. Perrault, que Protogene se contenta de fendre le trait d’Apelle, et ensuite Apelle, celui de Protogene ; rien n’est plus éxtravagant, ni plus monstrueux. Voy. nos Remarques.
- [5] Par la couleur, différente des deux premieres.
- [6] Arrivé sous l’empire d’Auguste, voy. Suët. ch. 57 et par conséquent Pline n’a point vû ce fameux tableau. Ce qu’il faut bien noter.
- [7] C’est ainsi qu’il faut entendre et qu’il faut lire ce passage, quam tres lineas visum, etc. selon les MS. de Vossius et la correction de Gronovius.
Rollin, Charles, Histoire ancienne, tome XI, livre XXIII(publi: 1730:1738), « De la peinture » (numéro livre XXIII, ch. 5) , p. 168-169 (fran)
La manière dont il fit connoissance et lia une étroite amitié avec Protogéne, célèbre peintre de son tems, est assez curieuse et mérite d’être raportée. Protogéne vivoit à Rhodes, connu d’Apelle seulement de réputation et par le bruit de ses tableaux. Celui-ci voulant s’assurer de la beauté de ses ouvrages par ses propres yeux, fit un voiage exprès à Rhodes. Arrivé chez Protogéne, il n’y trouva qu’une vieille femme qui gardoit l’atelier de son maître, et un tableau monté sur le chevalet, où il n’y avoit encore rien de peint. Le vieille lui demandant son nom, je vais le mettre ici, lui dit-il ; et prenant un pinceau avec de la couleur, il dessina quelque chose d’une extrême délicatesse. Protogéne, à son retour, ayant appris de la servante ce qui s’était passé, et considérant avec admiration les traits qui avaient été dessinés, ne fut pas longtemps à en deviner l’auteur. C’est Apelle, s’écria-t-il ; il n’y a que lui au monde qui soit capable d’un dessin de cette finesse et de cette légéreté. Et prenant une autre couleur, il fit sur les mêmes traits un contour plus correct et plus délicat ; et dit à sa gouvernante, que si l’étranger revenoit, elle n’avoit qu’à lui montrer ce qu’il venoit de faire, et l’avertir en même temps que c’étoit là l’ouvrage de l’homme qu’il étoit venu chercher. Apelle revint bientôt après ; mais honteux de se voir inférieur à son émule, il prit d’une troisième couleur, et parmi les traits qui avoient été faits, il en conduisit de si savans et de si merveilleux, qu’il y épuisa toute la subtilité de l’art. Protogéne aiant distingué ces derniers traits, Je suis vaincu, dit-il, et je cours embrasser mon vainqueur. En effet, il vola au port à l’instant, où aiant trouvé son rival, il lia avec lui une étroite amitié, qui depuis ne se démentit jamais : chose assez rare entre deux personnes du premier mérite, et qui courent la même carriére ! Ils convinrent entr’eux, par raport au tableau où ils s’étoient escrimés, de le laisser à la postérité tel qu’il étoit sans y toucher davantage, prévoiant bien, comme en effet cela arriva, qu’il feroit un jour l’admiration de tout le monde, et particuliérement des connoisseurs et des maîtres de l’art. Mais ce précieux monument des deux plus grands peintres qui furent jamais, fut réduit en cendres au premier embrasement de la maison d’Auguste, dans le Palais où il étoit exposé à la curiosité des spectateurs, toujours nouvellement surpris, au milieu de quantité d’autres des plus excellens et des plus finis, de ne trouver dans celui-ci qu’une espéce de vuide, d’autant plus admirable, qu’on n’y voioit que trois desseins au simple trait et de la derniére finesse, qui échapoient à la vûe par leur subtilité, et qui par cela même devenoient encore plus estimables et plus attraians pour de bons yeux.
C’est à peu près de cette sorte qu’il faut entendre l’endroit de Pline. Dans ces mots arrepto penicillo lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam, par lineam il ne faut pas entendre une simple ligne de géométrie, mais un trait de pinceau. Cela est contraire au bon sens, dit M. de Piles, et choque tous ceux qui savent un peu ce que c’est que peinture.
Pascoli, Lione, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni(publi: 1730), “Vita di Salvator Rosa” (numéro t. I) , p. 74-75 (italien)
E mentrecchè era un giorno in casa sua tutta la brigata, che secon anche pranzato aveva, prese esarruto l’Abati ad amplificare le maraviglie de’ pittori greci, e disse […] : « Che diremo delle celebrate sottilissime loro linee ? Debbiam pure credere, che come Apelle tirò la prima per far vedere a Protogene un portento di sottigliezza, ch’ella fosse sottilissima ? E pure divisa fu con altra più sottile, e di diverso colore da Protogene. E pure vinse Apelle la contesa, perché la divise colla terza più sottile, e d’altro colore della seconda, e della prima. Successe il fatto in casa di Protogene, quando mosso Apelle dalla fama del suo pennello, andò a Rodi per vederlo. Ebbe tanto applauso, e tanta stima questo quadro, che per venerazion delle linee niente altro vi fu da Protogene, che ne era padrone dipinto ; e portato poi in Roma, abbruciò nel primo incendio del palazzo Cesareo, ed in cotal guisa per commune sciagura con universal cordoglio, andò male questa opera portentosa. » Inquieto per quello mi si suppose, era già Salvator divenuto, e non potendo più a lungo soffrire il favellare dell’Abati, astener non si potè dall’interromperlo, e dal rispondergli, e fu detto, che del seguente tenor rispondesse : « Nè voi, nè io dolcissimo signor Abati vedute abbiam queste linee, nè sò, come veder le potessero i Greci, che non avevano l’uso de’ microscropi, se ell’erano così sottili, e minute. E perciò com’io dal vostro soverchio esagerare, e dalla vostra femminea credulità, mi son sentito muovere la compassione, la noia, ed il riso, potreste voi a tempo più proprio riservare la meraviglia, il dolore, e le lagrime ; giacchè mi pare di vedervele spuntare dagli occhi, e che siate in proccinto di prendere il bruno, per dar segni più certi di vostra tristizia. Altre opere, che le linee di questi celebri professori si son perdute : perdessi l’Elena, si perdè il Megabizo, si perdè l’Anadiomene, si perdè il Gialiso, che costarono loro non i momenti, e l’ora, ma gli anni, ed i lustri, e nel mondo si è quasi in ogni tempo dipinto, ed in alcuno, non meno eccellentemente, che nel loro. Andò male il più bel fiore della storia di Crispo : andaron male tutte l’opere di Lucejo, che tanto esalta in alcune di sue lettere Tullio : andaron male moltissime deche di Tito : andaron male con parte della storia alcuni libri degli annali di Tacito ; e tuttochè di più importanza, e di prezzo maggior delle linee, niuno ha mostrato mai di cotal perdita quel dispiacere immenso, che mostrate voi di questa. Ed il leggiadro, e faceto poeta Perugino, che con troppe affettate lagrime mostrar lo volle delle penultime, voi saprete come dall’autor de’ ragguagli di Parnaso fosse messo in ridicolo. Parlan pure in più d’un luogo l’istorie del famoso perfetto circolo fatto in un tratto di matitatojo da Giotto : e parlano similmente del dintorno dell’ignudo, che in altro simil tratto fatto fu da Michelangelo ; ed i Toscani, ed i Latini, e tutti gli altri assennati moderni, quantunque l’una, e l’altra operazione sia più maravigliosa, e che ambedue si sien perdute, non ne fan conto. Ed io che non pretendo d’entrar nel numero de’ professori più sublimi vi farò vedere signor Abati di cominciare dal piede d’una figura, e ricorrere senza staccar mai la mano per tutti i contorni del corpo » ; e preso il matitatojo gliele delineò di botto in sua presenza : « E se io, soggiunse, non sapessi far altro, povero Salvatore, esclamar vorrei, povero Rosa ! Di questa razza di bravura, non mi pregio, e non mi vanto ! Certo che ho letto, che Protogene dipigneva assai bene i volatili ; ma quando leggo, considero nel tempo stesso, e rifletto, se è credibile, e verisimile quel che leggo. Nè corro, come voi senza guida alla cieca, nè come voi guidar mi lascio dall’autorità degli scrittori alla balorda. Parvi egli credibile, che le pernici tra i volatili per natura i più rustichi, e più selvaggi, voglian cantare per vezzo, e per diletto alla palese, allorché ristrette sono o tra lacci, o nelle gabbie ? Se voi foste cacciator come poeta, non credereste tali frottole, e tali baje.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « Éclaircissements sur quelques passages de Pline qui concernent les arts du dessin » (publi: 1753, redac: 1745/06/15) (t. XIX), p. 252-262 (fran)
- [1] Plin. l. XXXV, c. 10
- [2] Centurie 11. N°42
- [3] Pétron. édit. de Burman, cap. LXXXIII, p. 409
- [4] Quintil. L. XII, c. 10
Ainsi l’on ne doit être que plus convaincu de la nécessité de bien posséder sa matière, lorsqu’il est question d’expliquer quelque endroit difficile d’un auteur ancien, et principalement dans ce qui a rapport aux sciences et aux arts. Je ne veux, pour le prouver, que le seul exemple du concours de Protogène et d’Apelle, dont Pline nous a transmis les particularités [1]. À prendre les choses à la lettre, il ne s’agit que de lignes conduites et tracées avec plus ou moins de fermeté et de délicatesse : c’est une ligne ou trait extrêmement délié qu’Apelle trace sur un tableau en l’absence de Protogène ; celui-ci, à la finesse de ce trait, reconnoît la main d’Apelle, trempe son pinceau dans une autre couleur, et décrit, sans sortir du trait d’Apelle, une seconde ligne beaucoup plus déliée que la première : Apelle revient, en est étonné et ne pouvant se résoudre à céder l’avantage, il repasse un troisième trait sur les deux premiers, et ce trait est si fin, qu’il n’y a plus moyen d’aller par delà : Protogène se confesse vaincu, et loin d’en rougir, il court sur le port pour chercher Apelle et lui avouer sa défaite. C’est ainsi que la plus grande partie de ceux qui ont voulu expliquer ce passage de Pline l’ont entendu : il n’y a rien cependant dans toute cette opération qui passe les bornes du méchanisme le plus ordinaire. Un ignorant qui a la main sûre peut de cette façon l’emporter aisément sur le plus habile dessinateur : toutes les fois qu’il ne s’agira que de tirer une ligne ou un trait avec netteté, c’est l’affaire de la main ; l’esprit n’y entre pour rien : comment donc se peut-il faire que deux grands peintres, dont les ouvrages ont mérité les suffrages de toute la Grèce se soient exercés sur un sujet si médiocre et si peu digne d’eux ? Voilà précisément ce qui a scandalisé un grand nombre de savans. On voit dans les lettres de Juste Lipse [2] qu’il n’osoit taxer Pline d’ignorance ni d’un excès de crédulité ; mais qu’il ne pouvoit non plus se résoudre à prendre sa défense : il se contentoit de renvoyer celui qui le consultoit sur ce passage, à ce qui seroit décidé par une personne plus éclairée et plus capable que lui de prononcer sur une matière qui dépendoit de la peinture. On voit bien qu’il avoit en vûe son ami Rubens : c’étoit à ce peintre célèbre qu’il vouloit qu’on s’adressât, et il n’est pas douteux, que si cet homme illustre se fût expliqué, il auroit donné la solution de la difficulté : il auroit parlé en homme de l’art, et ce qu’il auroit dit auroit été fort simple.
Il n’auroit point, à l’exemple de Louis de Montjosieu, dans son Gallus Romae hospes, accusé Pline d’avoir rapporté les choses autrement qu’il ne les avoit vûes. Certainement il faut avoir bonne opinion de soi-même, pour oser espérer que des idées singulières, dans des matières où les preuves manquent, prévaudront sur des faits donnés pour constans par quelqu’un qui mérite croyance, et qui de plus parle pour avoir vû. C’est cependant ce que notre critique ne craint point de faire : il avance bien affirmativement qu’il ne s’agissoit point de lignes dans cette dispute ; mais d’une dégradation de couleurs, du passage de la couleur claire à la couleur brune, de l’ombre à la lumière, si habilement ménagé, que la transition de l’une à l’autre étoit imperceptible. Apelle et Protogène n’avoient successivement trempé leurs pinceaux dans trois couleurs différentes, que pour exprimer les différens et les véritables tons de la lumière, des demi-teintes et des ombres. Mais c’est trop abuser de la patience d’un lecteur, que de lui présenter de tels paradoxes. On n’est guère moins révolté de voir mettre en œuvre de pareilles propositions, que d’entendre toutes les mauvaises plaisanteries que les Tassoni et les Perraults ont osé débiter sur ce sujet, dans l’intention de discréditer les anciens et de les rendre ridicules.
Si tous ces critiques avoient réfléchi sur cette matière, ils auroient vû, qu’en donnant au mot linea la véritable signification qu’il doit avoir, il n’y avoit rien dans le récit de Pline qui s’opposât au bon sens, et qui ne fût digne d’exciter l’émulation de deux peintres aussi célèbres qu’Apelle et Protogène. Linea, en matière de dessein, ne répond pas seulement à notre mot ligne ou trait : il a une plus grande étendue ; il signifie le contour d’une figure de quelque objet que ce soit ; et c’est dans ce sens que Pline dit qu’Apelle ne passoit pas un jour sans dessiner, nullus dies sine linea. S’il eût été question d’une ligne, l’observation eût été misérable, et même absurde. On pourroit citer une infinité d’autres endroits de Pline, où l’expression de linea a un rapport direct avec ce qui concerne le dessein ; mais entrons en matière.
Il y a un grand art à savoir tracer un contour régulier ; c’est ce qu’on appelle dessiner correctement : il n’y a aucun peintre qui ne dessine ; mais il y en a très peu qui dessinent avec goût. De plus, chacun a sa manière de dessiner qui lui est propre : les uns affectent un dessein coulant, et ne paroissent occupés qu’à rendre avec naïveté la souplesse de la chair ; comme je le ferai voir bientôt en éclaircissant un passage de Pline qui regarde la façon de dessiner de Parrhasius : les autres, sans se permettre aucune licence, imitent la nature dans toute sa beauté ; ce qui n’est pas dessiné dans la plus grande pureté leur déplaît : quelques-uns enfin faisant parade d’une connoissance profonde de l’anatomie, chargent leurs contours, font paroître tous les muscles, les mettent en action, et ne craignent point de donner à leur dessein un caractère de sévérité qui a quelque chose d’austère ; c’est l’épithète que l’on donne à cette façon de dessiner. Tels ont été dans ces derniers siècles le Corrège, Raphaël et Michel-Ange. Chacun d’eux, en amenant le dessein à sa plus grande perfection, a suivi une des trois manières dont j’ai tâché de faire connoître le caractère ; et je pense que si les deux derniers, Raphaël et Michel-Ange, étoient entrés en concurrence de dessein, ainsi que Protogène y entra autrefois avec Apelle, ils auroient dirigé leurs opérations de la même manière que le firent ces deux grands peintres de l’antiquité. Raphaël auroit commencé par dessiner un contour avec élégance, avec une délicatesse (car c’est ce qu’il faut entendre par ces mots latins, tenuitas et subtilitas) qui l’auroit décelé à Michel-Ange : celui-ci à son tour auroit redessiné le même contour dans sa manière ; et sans s’écarter de la forme, il y auroit indubitablement pris quelque chose de plus grand et de plus savant : Raphaël qui étoit fait pour saisir le beau partout où il le trouvoit, et qui avoit l’heureux talent de se l’approprier, revenant sur le tout, auroit tellement perfectionné ce contour, en y mettant de nouveau la main, qu’il n’auroit pas été possible d’aller plus loin, et que Michel-Ange, tout jaloux qu’il étoit de sa gloire, auroit été obligé d’en convenir. Ces contours faits, les uns à la pierre noire, les autres au crayon de sanguine ou à la plume, ce qui est l’équivalent des différentes couleurs employées par Apelle et son concurrent, se seroient aisément distingués : mais les manières auroient porté avec elles un caractère plus distinctif pour ceux qui ont des yeux ouverts sur ces sortes de choses. Ce qu’il y a de vrai, c’est que Michel-Ange lui-même, comme on le voit dans Carducci, nel quinto dialogo della pittura, jugeoit qu’on ne pouvoit donner une autre explication à ce passage de Pline ; et que persuadé qu’on ne pouvoit l’entendre que d’une très grande justesse de dessein, il prit un jour son crayon, et pour appuyer son sentiment d’une démonstration sans réplique, il fit d’un seul trait, et avec une hardiesse dont il étoit seul capable, le contour d’une figure, qui remplit d’admiration tous ceux qui étoient présens : on peut bien s’en rapporter à Michel-Ange.
L’explication que je viens de donner de tenuitas et subtilitas, me rappelle que Pétrone, en parlant des tableaux d’Apelle [3], emploie le mot de subtilitas pour exprimer la justesse du dessein qui les rendoit admirables, et qui faisoit paroître vivans les objets qui étoient représentés ; voici le passage : Tanta enim subtilitate extremitates imaginum erant ad similitudinem praecisae, ut crederes etiam animorum picturam. Quintilien dit aussi, en parlant de Parrhasius, ce grand dessinateur : Examinasse subtilius lineas traditur [4].
J’ajoûterai à la décision de Michel-Ange les suffrages unanimes de toute l’antiquité ; car ce tableau sur lequel Apelle et Protogène s’étoient exercés, avoit été conservé précieusement ; il avoit été regardé comme un miracle de l’art : et quels étoient ceux qui le considéroient avec le plus de complaisance ? c’étoient des gens de l’art, gens en effet plus en état que les autres de sentir toutes les beautés d’un simple dessein, d’en apercevoir les finesses et d’en être affectés. Ce tableau, ou si l’on veut ce dessein, avoit mérité de trouver place dans le palais des Césars. Pline qui parle sur le témoignage des gens dignes de foi, qui avoient vû ce tableau avant qu’il eût péri dans le premier incendie qui consuma le palais du temps d’Auguste, dit qu’on n’y remarquoit que trois traits, et même qu’on les apercevoit avec assez de peine ; la grande antiquité de ce tableau ne permettoit pas que cela fût autrement. Il est à remarquer que s’il n’offrait à la vûe que de simples lignes, coupées dans leur longueur par d’autres lignes, ainsi que le bon M. Perrault se l’étoit imaginé, on en devoit compter cinq, et non pas trois. Le calcul est aisé à faire ; la première ligne refendue par une seconde ligne, et celle-ci par une troisième ligne, cela fait bien cinq lignes toutes distinctes, par la précaution qu’on avoit prise en les traçant, d’employer d’autres couleurs. Une telle méprise dans une chose de fait, ne suffit-elle pas pour détruire tous les faux raisonnemens de ceux qui ont voulu rabaisser l’antiquité ? Il n’est pas hors de propos de rapporter ici le texte de Pline ; le voici : tanto spatio nihil aliud continentem quam (tres) lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem. Le sieur Durand a donné cette explication : On étoit surpris, dit-il, de ne trouver dans ce tableau qu’une espèce de vuide, d’autant plus admirable qu’on n’y voyoit que trois desseins au simple trait et de la dernière finesse, qui échappoient à la vûe par leur subtilité, et qui par cela même devenoient encore plus rares et plus attrayants pour de bons yeux. Cette paraphrase, car ce n’est point une traduction du passage de Pline, rend, ce me semble, assez mal le sens de l’auteur. J’ai fait voir que l’excellence du trait, ce que Pline désigne par tenuitas, subtilitas, ne consistoit point dans la simple finesse du trait, en tant que trait ; mais dans l’élégance et la justesse du contour, pris comme dessein. Si ces traits se perdoient dans le tableau, ce n’étoit donc point parce qu’ils étoient trop déliés ; mais c’est que le temps les avoit fait presque disparoître, ou en les effaçant en partie, ou par le changement et l’altération des couleurs. Il est vraisemblable que ces traits, dans leur origine, avoient été tracés sur une impression fort claire, et que par la suite des temps ils devoient se confondre avec leur fond, dont la couleur avoit certainement bruni. Ainsi il ne paroît pas douteux que la vétusté seule empêchoit qu’on ne les pût aisément discerner. Je crois que pour rendre plus exactement ce passage de Pline, on pourroit le traduire ainsi : Le tableau, dont il s’agit, étoit très grand : dans tout ce vaste champ il n’y avoit que trois traits, qui même ne se distinguoient pas trop bien. Les autres excellens tableaux des grands maîtres, au milieu desquels celui-ci étoit placé, le faisoient paroître comme une simple planche préparée pour peindre ; mais c’étoit cela même qui engageoit à le considérer de plus près ; et alors on ne pouvoit s’empêcher de lui donner la préférence. C’est le sort qu’éprouveront quelques jours ces rares desseins de Raphaël, de Michel-Ange, de Polydore et des autres peintres du premier ordre, qui, avec peu de traits, donneront à ceux qui les sauront admirer, une beaucoup plus grande idée de leur savoir, que leurs tableaux les plus terminés.
Au reste si je puis me flatter d’avoir réussi à expliquer un passage de Pline, qui a arrêté un grand nombre de savans, je suis fort éloigné de m’en faire un mérite : je ne veux point dissimuler que j’avois pensé, à peu près, tout ce que je viens d’exposer, lorsqu’ayant consulté M. de Piles, j’ai trouvé qu’il avoit déjà dit presque les mêmes choses dans la vie d’Apelle qu’il a mise en tête de son abrégé de la vie des peintres modernes. Cette conformité d’idées ne m’a cependant point empêché de communiquer les miennes, non seulement parce qu’il les expose fort en bref, mais à cause de l’autorité d’un tel homme, qui ne donne que plus de poids à mon sentiment ; et qui ne me rend que plus hardi à le soûtenir ; elle me confirme aussi de plus en plus dans l’opinion où je suis à l’égard de Pline. Tout me persuade que dans les endroits où il a parlé de peinture il ne sera bien entendu que par les gens qui peignent, ou qui ont du moins quelque notion du dessein, tels qu’étoit M. de Piles. Je lui suis fort inférieur de ce côté-là ; mais j’ai, comme lui, l’avantage de vivre avec les gens de l’art et de pouvoir diriger mes idées sur les leurs.
Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique(publi: 1752), art. « Apelle », p. 30 (fran)
On sçait la maniere dont il se fit connoître à Protogene, peintre de Syracuse ; quelques traits d’une extrême délicatesse dessinés sur une toile sans autre indication, suffirent à Protogène pour sçavoir qu’Apelle étoit venu le voir, quoiqu’il ne l’attendît point et qu’il n’eût vû auparavant aucun de ses ouvrages ; mais il y a des touches qui décelent le grand maître ; c’est un signe auquel les habiles gens ne peuvent gueres se méprendre.
Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts ou abrégé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique(publi: 1752), art. « Protogene », p. 530 (fran)
On sçait la maniere dont Apelle et Protogène firent connoissance. Apelle arrivé à Rhodes, alla chez ce peintre et ne l’ayant point rencontré, il esquissa d’une touche legere et spirituelle une petite figure ; Protogene de retour ayant appris ce qui s’étoit passé, s’écria dans le transport de son admiration, Ah, c’est Apelle ! et prenant à son tour le pinceau, il fit sur les mêmes traits un contour plus correct et plus délicat. Apelle revint, et ne trouva point encore Protogene ; on lui montra ce qu’il venoit de faire ; Apelle se sentit vaincu ; mais ayant fait de nouveaux traits, Protogene les trouva si sçavans et si merveilleux, que sans s’amuser inutilement à jouter contre un si redoutable rival, il courut dans la ville chercher Apelle, le trouva et contracta depuis avec lui l’amitié la plus intime.
La Nauze, abbé de, Mémoire sur la manière dont Pline a parlé de la peinture(publi: 1759, redac: 1753/03/20) (t. XXV), p. 235-236 (fran)
Mais Pline a donné des idées bien plus magnifiques du mérite et de l’excellence du dessein, sans une circonstance qui n’est ignorée de personne. Apelle trace un contour d’une grande élégance, suivant l’interprétation des savans, bien opposée à celle de M. Perrault, Protogène en trace un second encore plus parfait dans l’intérieur du premier, et Apelle un troisième, qui croisoit les deux autres, et qui ne permettoit pas qu’on portât plus loin la finesse et la justesse du pinceau. « On se détermina, dit Pline[1], à transmettre à la postérité ce tableau, comme un prodige pour tout le monde, mais principalement pour les gens de l’art. J’apprends, continue-t-il, qu’il a péri dans les flammes au premier incendie de la maison de César, sur le mont Palatin, après y avoir autrefois occupé si longtemps les yeux des spectateurs : il n’offroit pourtant que des traits presque imperceptibles, avec l’apparence d’un tableau nu, au milieu des beaux ouvrages de plusieurs autres peintres ; mais il piquoit la curiosité par cela même, et se faisoit regarder plus que tout le reste. » L’intelligence et le sentiment n’éclatent pas moins ailleurs, où il dit, tantôt qu’on trouvoit dans les recueils de Parrhasius plusieurs restes de dessein, qui passoient pour être d’un grand secours aux maîtres de l’art ; tantôt qu’Apelle étant mort après avoir commencé le tableau d’une Vénus, il ne se rencontra personne en état d’exécuter le dessin qu’il en avoit tracé.
- [1] Placuitque eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam priore incendio domus Caesaris in Palatio audio ; spectatam olim tanto spatio nihil aliud continentem, quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobiliorem.
Caylus, Anne-Claude Philippe de Tubières, comte de, « De la peinture ancienne » (redac: 1753/11/10), 258-262 (fran)
Je ne crois pas devoir oublier les réflexions que j’ai faites sur le fameux concours de Protogène et d’Apelle, et ne pas vous rappeler les idées indignes de la peinture et de ces grands artistes que tous les savants en ont données. Car en prenant les choses à la lettre, et suivant successivement la même opinion, il ne s’agit que de lignes conduites et tracées avec plus ou moins de fermeté et de délicatesse ; selon eux, c’est une ligne extrêmement déliée qu’Apelle trace sur un tableau en l’absence de Protogène. Celui-ci, à la finesse du trait, reconnaît la main d’Apelle, trempe son pinceau dans une autre couleur et décrit, sans sortir du trait d’Apelle, une seconde ligne plus déliée que la première. Apelle revient, en est étonné, et ne pouvant se résoudre à céder l’avantage, il repasse un troisième trait sur les deux premiers, et ce trait est si fin qu’il n’y a plus moyen d’aller par-delà. Protogène se confesse vaincu et, loin d’en rougir, il court sur le port chercher Apelle et lui avouer sa défaite. Vous sentez, Messieurs, combien une opération de cette espèce se trouve renfermée dans les bornes du mécanisme le plus commun. Un ignorant, dont la main est sûre, peut de cette façon l’emporter aisément sur le plus grand dessinateur. Toutes les fois qu’il ne s’agira que de tirer une ligne ou un trait avec netteté, c’est l’affaire de la main ; l’esprit n’y entre pour rien. Comment donc se pourrait-il que deux grands peintres, dont les ouvrages ont mérité les éloges de la Grèce entière, eussent employé leur temps à une opération si médiocre et si peu digne de leurs talents ? Aussi Juste Lipse, homme très savant, peu satisfait de ces idées du côté de l’esprit, mais arrêté par le défaut de connaissances dans la pratique, donna dans ses lettres une preuve de sa modestie, mais plus encore de la force du préjugé qu’il avait reçu, car il n’osait taxer Pline d’ignorance, ni d’un excès de crédulité ; mais il ne pouvait non plus se résoudre à prendre sa défense. Il se contentait de renvoyer celui qui le consultait sur ce passage à la décision d’un homme plus éclairé et plus capable de prononcer sur une matière qui dépendait de la peinture. On voit bien qu’il avait en vue son ami Rubens, car cet artiste célèbre joignait la connaissance des lettres à la grande pratique de son art ; et il n’est pas douteux que, s’il se fut expliqué, il aurait parlé en homme éclairé. Je ne serais occupé aujourd’hui qu’à le copier et ce qu’il aurait dit eut été fort simple.
Je ne vous rapporterai point toutes les opinions particulières que le passage a fait publier, ni les mauvaises plaisanteries des Tassoni et des Perrault faites dans l’intention de décréditer les anciens et de les tourner en ridicule. S’ils avaient réfléchi sur cette matière, ils auraient vu qu’en donnant au mot linea la véritable signification qu’il doit avoir, il n’y aurait non seulement rien dans le récit de Pline qui s’opposât au bon sens, mais qui ne fut digne d’exciter l’émulation de deux peintres aussi célèbres qu’Apelle et Protogène. Linea, en matière de dessein, ne répond pas seulement à notre ligne ou trait. Ce mot a une plus grande étendue ; il signifie le contour d’une figure ou de quelque objet que ce soit. Et c’est dans ce sens que l’on doit prendre ce que Pline rapporte et traduire qu’Apelle ne passait pas un jour sans dessiner. S’il eut été question d’une ligne, l’observation eut été méprisable et certainement absurde. Il y a même une infinité d’autres endroits de Pline où l’expression de linea a un rapport direct avec ce qui concerne le dessein. Mais voici de quelle façon je conçois un fait célébré et si mal expliqué depuis plusieurs siècles. Il y a un grand art à savoir tracer un contour régulier ; c’est ce qu’on appelle dessiner correctement. Il n’y a aucun peintre qui ne dessine, mais il y en a très peu qui dessinent avec goût. De plus, chacun a sa manière de dessiner qui lui est propre. Les uns affectent un dessein coulant et ne paraissent occupés qu’à rendre avec naïveté la souplesse de la chair, comme je le ferai voir bientôt en expliquant un passage qui regarde la façon de dessiner de Parrhasius ; d’autres, sans se permettre aucune licence, imitent la nature dans toute sa beauté, et tout ce qui n’est pas dessiné dans la plus grande pureté leur déplaît. Quelques-uns enfin, faisant parade d’une connaissance profonde de l’anatomie, chargent leurs contours, font paraître les muscles, les mettent en action et ne craignent point de donner à leur dessein un caractère de sévérité et d’austérité. Tels ont été, dans les derniers siècles, le Corrège, Raphaël et Michel-Ange. Je pense que si ces deux derniers eussent été en concurrence de dessein, ainsi que Protogène y entra autrefois avec Apelle, ils auraient dirigé leurs opérations de la même manière que le firent les deux grands peintres de l’Antiquité. Raphaël aurait commencé par dessiner un contour avec une élégance et une délicatesse qui l’auraient décelé à Michel-Ange. Celui-ci, à son tour, aurait redessiné le même contour dans sa manière et sans s’écarter de la forme. Il y aurait indubitablement mis quelque chose de plus grand et de plus savant. Et Raphaël, qui était fait pour saisir le beau partout où il le trouvait et qui avait l’heureux talent de se l’approprier, revenant sur le tout, aurait tellement perfectionné le contour en y mettant de nouveau la main, qu’il n’aurait pas été possible d’aller plus loin, et que Michel-Ange, tout jaloux qu’il était de sa gloire, aurait été obligé d’en conserver les contours faits, les uns, à la pierre noire, les autres, au crayon de sanguine ou à la plume, ce qui est l’équivalent des différentes couleurs employées par Apelle et son concurrent ; ces contours se seraient aisément distingués, mais les manières auraient porté avec elles un caractère encore plus distinctif pour ceux qui ont les yeux ouverts par les arts. Ce qu’il y a de vrai, c’est que Michel-Ange lui-même, comme on le voit dans le Carducho, persuadé qu’on ne pourrait entendre ce passage de Pline que par une très grande justesse de dessein, prit un jour son crayon et, pour appuyer son sentiment d’une démonstration, il fit d’un seul trait, et avec une hardiesse inconcevable, le contour d’une figure qui remplit d’admiration tous ceux qui étaient présents. On le croira sans peine : Michel-Ange dessinait. J’ajouterai, à l’espèce de décision de ce grand et célèbre artiste, l’unanimité des suffrages de toute l’Antiquité ; car le tableau sur lequel Apelle et Protogène s’étaient exercés avait été conservé avec soin. Il avait été regardé comme un miracle de l’art. Et quels étaient ceux qui l’admiraient ? C’étaient les artistes les plus en état que les autres de sentir toutes les beautés d’un simple trait, d’en apercevoir les finesses et d’en être affectés. Le tableau, ou si l’on veut le dessein, avait mérité de trouver place dans le palais des Césars. Pline, qui parle sur le témoignage de gens dignes de foi et qui avaient vu le tableau avant qu’il eût péri dans le premier incendie qui consuma ce palais du temps d’Auguste, dit qu’on n’y remarquait que trois traits et même qu’on les voyait avec assez de peine. La grande antiquité de ce tableau ne permettait pas que cela fut autrement. Il est à remarquer que, si ce tableau n’offrait à la vue que de simples lignes coupées dans leur longueur par d’autres lignes, ainsi que le bon M. Perrault se l’était imaginé, on devait en compter cinq, et non pas trois. Le calcul est aisé à faire. La première ligne refendue par une seconde ligne, et celle-ci par une troisième encore, cela fait bien cinq lignes toutes distinctes par la précaution qu’on avait mise, en les traçant, d’employer différentes couleurs. Une telle méprise dans une chose de fait ne suffit-elle pas pour détruire tous les faux raisonnements de ceux qui, voulant mépriser l’Antiquité, se sont principalement appuyés sur ce récit ? J’ai fait voir que l’excellence du trait en question ne consistait pas dans la simple finesse du trait en tant que trait, mais dans l’élégance et la justesse des contours pris comme dessein. Si ces traits se perdaient dans le tableau, ce n’était donc point parce qu’ils étaient trop déliés, mais parce que le temps les avait fait presque disparaître, ou en les effaçant en partie, ou par le changement et l’altération des couleurs. Il est vraisemblable que les traits, dans leur origine, avaient été tracés sur une impression fort claire et que, par la suite des temps, ils devaient se confondre avec leur fond, dont la couleur avait absolument bruni. Ainsi, il ne paraît pas douteux que la vétusté seule empêchait qu’on ne les distinguât aisément. Voici la fin du passage de Pline, tel que j’ai cru qu’on pouvait la traduire. Ce tableau était très grand et dans tout le vaste champ, il n’y avait que trois traits qui même ne se distinguaient pas trop bien. Les autres excellents tableaux des grands maîtres, au milieu desquels celui-ci était placé, le faisaient paraître comme une simple planche préparée pour peindre. Mais c’était cela même qui engageait à la considérer de plus près, et alors on ne pouvait s’empêcher de lui donner la préférence. C’est le sort qu’éprouveront quelque jour les rares desseins de Raphaël et de Michel-Ange, de Polydore et des autres peintres du premier ordre qui, avec peu de traits, donneront à ceux qui les savent admirer une beaucoup plus grande idée du savoir de ces grands artistes que les tableaux les plus terminés.
Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), p. 255 (fran)
Il se décéla à Protogene par sa justesse dans le dessein, en traçant des contours d’une figure (lineas) sur une toile.
Jaucourt, Louis de, Encyclopédie, art. « Peintres grecs », tome XII(publi: 1765), p. 264 (fran)
On sçait qu’Apelle et Protogene travaillerent ensemble à un tableau qui fut conservé précieusement. Ce tableau avoit été regardé comme un miracle de l’art ; et quels étoient ceux qui le considéroient avec le plus de complaisance ? C’étoient des gens du métier, gens en effet plus en état que les autres de sentir les beautés d’un simple dessein, d’en appercevoir les finesses, et d’en être affectés. Ce tableau, ou, si l’on veut, ce dessein avoit mérité de trouver place dans le palais des Césars. Pline, qui parle sur le témoignage des personnes dignes de foi, qui avoient vû ce tableau avant qu’il eût péri dans le premier incendie qui consuma le palais du tems d’Auguste, dit qu’on n’y remarquoit que trois traits, et même qu’on les appercevoit avec assez de peine ; la grande antiquité de ce tableau ne permettoit pas que cela fût autrement. Il est à remarquer que s’il n’offroit à la vûe que de simples lignes coupées dans leur longueur par d’autres lignes, ainsi que M. Perrault se l’étoit imaginé, on en devoit compter cinq, et non pas trois. Le calcul est aisé a faire ; la premiere ligne refendue par une seconde ligne, et celle-ci par une troisieme encore, cela fait bien cinq lignes toutes distinctes, par la précaution qu’on avoit prise en les traçant, d’employer différentes couleurs. Une telle méprise dans une chose de fait, n’est que trop propre à faire sentir l’erreur de ceux qui cherchent sans cesse à rabaisser le mérite de l’antiquité.
Dictionnaire portatif des faits et dits mémorables de l’histoire ancienne et moderne, tome 2(publi: 1768), art. « Apelle », p. 119 (fran)
Il fit exprès le voyage à Rhodes, pour voir Protogène, qui demeuroit dans cette ville. Il courut chez ce peintre, en sortant du vaisseau ; mais il ne le trouva pas, et vit dans son attelier un très-grand tableau qu’il peignoit actuellement. Une vieille esclave qui gardoit l’attelier, lui demanda qui il étoit pour le dire à Protogène : « Il l’apprendra de moi », lui dit-il ; et, prenant un pinceau, il traça une ligne très-déliée. Quand Protogène fut revenu, l’esclave lui dit ce qui s’étoit passé. Protogène examinant la ligne, s’écria : « Certainement Apelle est à Rhodes. Nul autre ne peut rien faire d’aussi parfait » ; et, sur le champ, il traça sur la ligne une second ligne plus déliée, et dit à l’esclave, si l’étranger revenoit, de la lui montrer, en lui disant : « Voilà celui que vous demandez. » Apelle revint ; et, rougissant de se voir surpassé, il fendit la seconde ligne d’une troisieme si mince, qu’il étoit impossible de la fendre par une quatrieme. Protogène l’ayant vu, s’avoue vaincu ; court au port, cherche son vainqueur, et l’amene avec joie dans sa maison.
Falconet, Etienne, Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l’Ancien, avec des notes(publi: 1772) (t. I), p. 159-160 (fran)
On sait ce qui arriva entre lui et Protogènes. Celui-ci demeuroit à Rhodes ; où Apelles étant venu, avide de connoître par ses ouvrages un homme qu’il ne connoissoit que par sa réputation, il alla d’abord à son atelier. Protogènes étoit absent, mais il y avoit sur le chevalet une grande tablette que gardoit une vieille femme. Cette vieille lui dit que Protogènes étoit sorti, et lui demanda qui elle diroit qui étoit venu. Le voici, dit Apelles ; et prenant un pinceau, il traça avec de la couleur une ligne (un trait) d’une extrême finesse sur le tableau (46). Protogènes de retour, la vieille lui dit ce qui s’étoit passé. On raporte que l’artiste, ayant examiné la finesse de la ligne, dit qu’Apelles étoit venu, que lui seul étoit capable d’avoir exécuté quelque chose d’aussi parfait : qu’aussi-tôt dans cette même ligne il en traça une encore plus fine avec une autre couleur, et dit à la vieille femme en sortant, que si le même homme revenoit, elle la lui fît voir, en lui ajoutant, que c’étoit là celui qu’il cherchoit. La chose arriva : Apelles revint, et honteux de se voir surpassé, il coupa les deux lignes avec une troisième couleur, de manière à ne plus rien laisser à faire à la délicatesse de la main. Protogènes s’avouant vaincu, courut en diligence au port chercher le nouvel arrivé. On a jugé à propos de conserver à la postérité cette planche qui a fait l’admiration de tout le monde, mais sur tout des artistes. J’ai ouï dire qu’elle fut brûlée dans le premier incendie du palais de César, sur le mont Palatin. On l’a admirée pendant tant de siècles, quoiqu’elle ne contînt autre chose que des lignes qui échappoient à la vue, et qu’elle parut comme vuide au milieu de plusieurs autres ouvrages : mais c’étoit par cela même qu’elle atiroit l’attention, et qu’elle étoit plus renommée que tout autre morceau.
Notes, t. I, p. 349-354 :
(46) Le Père Hardouin, dans ses notes sur ce passage, prétend, qu’il faut bien se garder d’imaginer que c’étoit une ligne semblable à celles de géométrie qui ont de la longueur sans largeur ; il dit, que c’étoit un trait de pinceau. Le Père Hardouin ne devoit pas craindre qu’on s’y méprît, atendu qu’on ne coupe pas deux fois dans sa longueur une ligne sans largeur : mais que signifie un trait de pinceau ? C’est toute la question. Ce trait d’une extrême finesse ne réprésentoit rien, ou il réprésentoit la forme de quelque objet naturel. Au premier cas, ce n’étoit qu’une adresse de la main, semblable à celle qui a produit le fameux O du Ghiotto ; mérite qui sans être méprisable, n’a jamais été regardé que par le Pape Benoît IX comme la preuve du talent d’un grand peintre, puisqu’assurément Ghiotto ne l’étoit pas, et que sa réputation, presqu’oubliée, n’a jamais aproché, même de fort loin, de celle d’Apelles. Au second cas, Pline se serait exprimé de la manière la plus triviale, comme un homme à qui les procédés de l’Art sont absolument étrangers. Car une ligne, ou un trait d’une extrême finesse sur le tableau, lineam summae tenuitatis per tabulam, seroit une façon de parler fort plate (il faut quelquefois nommer les choses par leur nom) de la part d’un connoisseur, s’il s’agissoit du profil d’une tête, par exemple : de la part d’un artiste, elle n’auroit pas le sens commun ; parce qu’il auroit loué deux peintres précisément comme il auroit fallu qu’il louât deux maîtres à écrire. Mais Apelles et Protogènes s’étoient donc reciproquement donné la louange d’un maître à écrire ? Montrez-moi, ou dites-moi ce qu’ils ont tracé sur cette tablette, et je vous répondrai. Si pourtant vous me pressiez trop, je vous dirois : ce n’étoit si bien qu’une adresse de la main, que Protogènes ne fit autre chose que suivre le milieu du trait qu’Apelles avoit tracé, et qu’ensuite Apelles fit une trace dans le milieu du trait qu’avoit fait Protogènes, quelque chose que réprésentât le premier trait. Si vous ne voulez pas croire que ce soit cela, donnez de meilleures preuves de ce que c’étoit : mais en atendant que vous les ayez trouvées, souvenez-vous que l’absurdité d’un conte doit empêcher les hommes de sens de le répéter sérieusement.
Si deux peintres fameux eussent fait un joli petit tour d’adresse avec leur pinceau, qu’on me l’eût dit, et que j’eusse été leur Pline, je me serois bien gardé de l’écrire. Mais s’ils eussent fait quelque chose d’aussi beau que singulier, et que pris à gauche, cela eût pu diminuer la grande idée qu’on auroit eu de leur talent ; je l’aurois si clairement raporté, qu’on ne s’y fût pas trompé. J’aurois aussi pensé que le vaisseau devant être atendu, Apelles pouvoit être anoncé ; que la vieille domestique ne connoissant pas ce peintre, il étoit aussi aisé à Protogènes de le deviner par les nouvelles du port, que par le trait de pinceau : l’un ne pouvoit-il pas le conduire naturellement à l’autre ? En un mot, avant de copier un vieux conte, je l’aurais examiné sous toute ces faces, afin qu’une de ses parties ne rendît pas l’autre incroïable.
(47) Des lignes, des traits qui échapoient à la vuë, lineas visum effugientes ; une planche qui paroissoit vuide, qui étoit admirée, sur-tout des artistes, sont des choses si inconcevables pour les artistes mêmes qui ont le plus de connoissance des ouvrages et des procédés des Anciens, qu’il faut convenir que Pline a voulu nous donner une énigme, ou qu’il a mal entendu son auteur grec, ou qu’il a parlé d’une chose dont lui-même n’avoit aucune idée distincte. Car enfin, que ce fût une ligne, un trait, un contour comme on dit en peinture, ç’auroit été non seulement la légèreté de sa main, mais surtout la beauté de la forme que les artistes eussent admirée ; l’adresse de la section ne devoit pas les toucher autant. Encore une fois, si cela en valoit la peine, et que ce ne fût pas de simples lignes qui ne réprésentoient rien, il falloit le dire clairement. Un connoisseur ou un artiste, n’eussent pas été obscurs ; ils eussent dit ce que les artistes admiroient.
Cette lutte d’Apelles et de Protogènes est fort originalement raportée dans le 12 tome de l’Encyclopédie, parge 264 : on dit que c’est d’après Pline ; il eut été plus exact de dire que c’est d’après Mr. Le Comte de Caylus, tom. 19 des Mém. de l’Acad. Quoiqu’il en soit, voici les paroles de Mr. de Jaucourt ; c’est au lecteur à juger.
« On sait qu’Apelles et Protogènes travaillèrent ensemble à un tableau, qui fût conservé précieusement. Ce tableau avoit été regardé comme un miracle de l’art. Et quels étoient ceux qui le considéroient avec le plus de complaisance ? C’étoit des gens du métier ; gens en éffet plus en état que les autres de sentir les beautés d’un simple dessein, d’en apercevoir les finesses, et d’en être afectés. Ce tableau, ou si l’on veut, ce dessein, avoit mérité de trouver place dans le Palais des Césars. Pline, qui parle sur le témoignage des personnes dignes de foi qui avoient vu ce tableau avant qu’il eût péri dans le premier incendie qui consuma le palais du temps d’Auguste, dit, qu’on n’y remarquoit que trois traits, et même qu’on les apercevoit avec assez de peine : la grande antiquité de ce tableau ne permettoit pas que cela fut autrement ».
Ensuite, après avoir remarqué que M. Perrault avoit eu tort de ne compter que trois lignes, on lui prouve très bien que selon la mauvaise opinion qu’il avoit des Anciens, et en vertu des sections qui avoient réfendu ces trois lignes, il falloit en compter cinq ; et l’on conclut ainsi, une telle méprise dans une chose de fait, n’est que trop propre à faire sentir l’erreur de ceux qui cherchent sans cesse à rabaisser le mérite de l’Antiquité. Aparenment que Pline, qui parle ici comme M. Perrault, cherchoit à rabaisser le mérite de l’Antiquité, ou du moins qu’il en fournissoit les moïens à d’autres. Aparenment que Mr. de Jaucourt, qui compte aussi trois traits ou lignes comme M. Perrault, cherche à rabaisser le mérite de l’Antiquité[1]. Aparenment que cinq lignes ou trois traits que deux peintres ont fait pour se divertir, prouvent le mérite de la peinture des Anciens. Aparenment que cette manière de raisonner et de traduire les Anciens est fort propre à rélever le mérite de l’Antiquité. Je ne sais si elle prouvera bien celui des Modernes, mais toujours est-il certain qu’elle est une preuve du désir que Mr. de Caylus avoit de ne trouver chez les anciens artistes que des traits de sublimité, et dans ceux des anciens qui ont écrit de l’art, que les plus grandes connoissances. Il faut pourtant convenir que dans le tome 25, Mr de Caylus est un peu revenu sur le compte de Pline, et qu’il ne trouve plus qu’il fût un aussi grand connoisseur. C’est avoir fait un pas du côté de la vérité dont on ne sauroit tenir trop de compte à la bonne foi et aux nouvelles lumières de Mr. de Caylus.
Il y a maintenant à Vienne un Juif à qui il ne manque autre chose que d’être peintre et aussi grand peintre qu’Apelles : il en a déjà toute l’adresse et la légèreté de la main. Ce Juif écrit pour vivre, un sonnet sur la tranche d’une feuille de papier à letres batuë très mince, et il vend cette frivolité surprenante un ducat : cependant les historiens n’en disent pas un mot, et l’artiste a du pain tout au plus : mais il doit être bien consolé quand il lit le 11e Numero du chapitre 10. Livre 35 de Pline, et qu’il voit de loin la postérité s’agenouiller devant son sonnet lequel vaut bien les lignes d’Apelles et de Parrhasius. Et ce moine du dernier siècle devoit être un peu plus fier, quand après avoir fait d’un trait de plume un cercle parfait, il y campoit du même jet un point tout juste au centre. On croit sans ôser l’assurer que plusieurs personnes fort adroites de la main, en pourroient faire autant.
- [1] J’avouë cependant que je n’ai vu nulle part dans le Parallèle des Anciens et des Modernes que M. Perrault ait compté trois lignes. Il est vrai que je ne connois que la seconde édition ; la première peut être différente : si je la rencontre, j’y regarderai par pure curiosité.
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776) (t. I), p. 241 (fran)
Perrault, voulant diminuer le mérite de ce trait du Giotto, assure que Ménage lui a dit avoir connu un moine, qui, sans être peintre, faisait non seulement d’un seul trait de plume un O parfaitement rond, mais qui, en même temps, y mettait un point justement dans le milieu[1].
- [1] Parallèle des anciens et des modernes, Tome I.
Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Leprince, Thomas , Anecdotes des beaux-Arts, contenant tout ce que la peinture offre de plus piquant chez tous les peuples du monde(publi: 1776) (t. I), p. 214-215 (fran)
Protogène vivoit à Rhodes, et sa réputation parvint jusqu’à Apelle, qui, à force d’en entendre parler, conçut le dessein d’aller voir lui-même le peintre, et les ouvrages dont on lui rapportoit tant de merveilles. Il s’embarqua pour Rhodes, et, dès qu’il fut arrivé, courut avec empressement chez Protogène ; mais n’y trouvant qu’une vieille esclave, qui gardait l’attelier de son maître, et un tableau monté sur le chevalet, où il n’y avoit encore rien de peint ; « — Dans quel endroit est Protogène ? dit-il à cette femme, qui ne le connaissoit pas. — Il est sorti, répondit-elle, mais afin que mon maître sache qui l’a demandé, ayez la bonté de laisser votre nom. — Le voici, dit Apelle : — prenant alors un des pinceaux qui étaient là, avec un peu de couleur, il dessina sur le tableau, où l’on ne voyoit encore rien de tracé, les premiers linéamens d’une figure : après quoi, il s’en alla. Protogène, étant de retour, fut enchanté des traits qu’il vit dessinés, et ne fut pas longtemps à deviner leur auteur. — « C’est Apelle, s’écria-il ; car il n’y a que lui au monde qui soit capable d’un dessin de cette finesse et de cette légèreté. » — Piqué d’une noble émulation, Protogène prit le pinceau, et, avec une autre couleur, il essaya de l’emporter sur ce nouveau rival, en décrivant d’autres contours, encore plus corrects et plus délicats que ceux d’Apelle ; et ordonna à la vieille esclave, au cas que le peintre reparût, de lui montrer ce qu’il venait de faire, et de lui dire, en même temps, que c’était là l’homme qu’il cherchait. Apelle revint en effet ; et, ne voulant pas qu’il fût dit qu’il eût été surpassé dans les premiers principes de la peinture, il reprit le pinceau, et, avec une couleur différente des deux autres, il conduisit des traits si savants et si merveilleux, parmi ceux qui avaient été tracés, qu’il épuisa toute la subtilité de l’art. Protogène, étant rentré chez lui, n’eut pas plutôt distingué ces derniers traits, qu’il s’écria : — « Je suis vaincu, et je cours embrasser mon maître ». — Il vôla au port, en disant ces mots, où ayant rencontré son rival, il lia avec lui une amitié sincère, qui ne se démentit jamais.
Pline nous assure que ces deux excellents peintres convinrent entr’eux de laisser toujours dans le même état le tableau qui leur avoit servi à se connaître, sans jamais y toucher, prévoyant bien qu’il ferait un jour l’admiration de la postérité, quoiqu’il n’offrît aux yeux que les seules ébauches du dessin. Ce tableau, transporté à Rome longtemps après, sut charmer en effet tous les Romains, pendant plusieurs siècles, jusqu’au temps d’Auguste, où il périt malheureusement dans un incendie qui consuma le palais de ce prince.
Pline affirme qu’il a vu ce tableau, et qu’il a longtemps admiré la délicatesse du pinceau des deux premiers peintres de la Grèce. Mais un certain savant en us nommé Ludovicus de Montiosus, ôse soutenir que Pline n’a jamais vu de lignes sur ce tableau et qu’il n’y en avoit point ; il ajoûte que le bonhomme s’est imaginé les voir, parce qu’il avait ouï dire qu’elles existoient, et qu’il avoit bien voulu penser comme les autres, pour ne pas s’attirer le reproche de ne voir goute[1].
- [1] Perrault, Parallèle des Anciens et des Modernes.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), art. « O du Giotto » (fran)
« C’est une de ces sortes d’histoires qui ne signifient pas grand chose, et dont cependant les auteurs font quelquefois grand bruit. Vous saurez donc que l’envoyé du pape (Benoît IX) ayant vu à Sienne et à Florence tous les peintres les plus fameux, s’adressa enfin au Giotto (pour les ouvrages dont le pontife avoit dessein d’orner l’église de saint Pierre). Après lui avoir témoigné l’intention du pape, il lui demanda quelques dessins pour les lui montrer, avec ceux qu’il avoit déjà des autres peintres. Giotto, qui étoit extrêmement adroit à dessiner, se fit donner aussitôt du papier, et avec un pinceau, sans le secours d’aucun autre instrument, il traça un cercle, et en souriant il le mit entre les mains de ce gentilhomme. Cet envoyé, croyant qu’il se moquoit, lui répartit que ce n’étoit pas ce qu’il demandoit, et qu’il souhaitoit un autre dessin. Mais Giotto, lui repliqua que celui-la suffisoit, qu’il l’envoyât hardiment avec ceux des autres peintres, et que le pape en connoîtroit bien la différence : ce que le gentilhomme fit, voyant qu’il ne pouvoit rien obtenir davantage. »
« Or on dit que ce cercle étoit si également tracé et si parfait dans sa figure, qu’il parut une chose admirable quand on sut de quelle sorte il avoit été fait, et ce fut par-là que le pape et ceux de sa cour comprirent assez combien Giotto étoit plus habile que tous les autres peintres dont on lui envoyoit les dessins. Voilà l’histoire de l’O du Giotto, qui donna lieu aussi-tôt à ce proverbe Tu sei piu tondo che l’O di Giotto, pour signifier un homme grossier et un esprit qui n’est pas fort subtil. » « Il semble par-là que le plus grand savoir de tous ces anciens peintres existât dans la subtilité et la délicatesse de leurs traits ; car ce fut par des lignes très subtiles et très déliées, qu’Apelle et Protogène disputèrent à qui l’emporteroit l’un sur l'autre, et Protogène ne céda à Apelle que quand celui-ci eut coupé avec une troisième ligne plus délicate les deux qu’ils avoient déjà tracées l’une sur l’autre. A vous dire le vrai, ni l’O du Giotto, ni ces lignes d’Apelle et de Protogène ne sont point capables de nous donner une haute idée de leur savoir. (Felibien.) »
On reconnoît, dans le passage que nous venons de citer, le langage d’un homme qui connoît les arts, et qui ne rapporte pas avec admiration ce qui n’est admirable qu’aux yeux de l’ignorance. Tout ce que prouve le cercle tracé sans compas par le Giotto, c’est qu’il avoit la main très sûre, et qu’il pouvoit tracer un beau contour avec fermeté s’il avoit ce beau contour dans la tête, ou s’il savoit le choisir dans la nature : il restoit donc à savoir, et c’étoit le principal, s’il avoit la tête ainsi meublée et s’il étoit capable d’un pareil choix ; à ces conditions, la fermeté de sa main devenoit une qualité estimable. L’officier du pape raisonnoit donc mieux que ce pontife et toute sa cour, quand il demandoit au peintre un autre dessin.
Quand le Poussin traçoit d’une main tremblante le beau tableau du déluge ; quand Jouvenet paralytique peignoit de la main gauche son Magnificat, ni l’un ni l’autre de ces artistes n’auroit tracé un cercle sans compas, et tous deux firent des ouvrages bien supérieurs à ceux du Giotto. L’adresse de la main peut aider un artiste, mais le véritable principe de son talent est dans son esprit. C’est abbaisser les arts, c’est n’en avoir pas le sentiment, que d’élever trop haut la partie purement manuelle.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), art. « Ligne d’Appelles » (numéro vol. 1) , p. 476-477 (fran)
Pline rapporte que ce Peintre, quelqu’occupé qu’il pût être d’ailleurs, ne passoit aucun jour sans tirer quelque ligne : Fuit alioquin perpetua consuetudo numquam tam occupatam diem agendi, ut non, lineam ducendo, exerceret artem. Winckelmann croit que ce passage ne signifie pas qu’il ne laissoit passer aucun jour sans peindre ; mais que chaque jour il étudioit son art, en dessinant d’après nature, ou d’après les grands maîtres qui l’avoient précédé : mais ce n’est point de cela qu’il s’agit dans cet article.
Nous voulons parler de la manière dont, suivant Pline, Appelles fit connoître sa visite à Protogènes. Voici le passage littéralement traduit par M. Falconet.
« On sait ce qui se passa entre lui (Apelles) et Protogènes. Celui-ci demeuroit à Rhodes ; Apelles y étant abordé, avide de connoître, par ses ouvrages, un homme qu’il ne connoissoit que par sa réputation, alla d’abord à son attelier. Protogènes étoit absent ; mais une vieille gardoit seule un fort grand panneau, disposé sur le chevalet, pour être peint. Elle lui dit que Protogenes étoit sorti, et lui demanda son nom. Le voici, dit Apelles, et prenant un pinceau, il conduisit avec de la couleur, sur le champ du tableau, une ligne d’une extrême ténuité (arreptoque penicillo, lineam ex colore duxit summœ tenuitatis per tabulam.) Protogenes de retour, la vieille lui dit ce qui s’étoit passé. On rapporte que l’Artiste, ayant d’abord observé la subtilité du trait, dit que c’étoit Apelles qui étoit venu ; que nul autre n’étoit capable de rien faire d’aussi parfait ; et que lui-même en conduisit un encore plus délie, avec une autre couleur (ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse), et dit à la vieille que, si cet homme revenoit, elle lui fit voir cette ligne, en ajoutant que c’étoit là celui qu’il cherchoit. La chose arriva : Apelles revint, et honteux de se voir surpassé, il refendit les deux lignes avec une troisieme couleur, ne laissant plus rien à faire à la subtilité (vinci erubescens, tertio colore lineas secuit, nullum relinquens amplius subtilitati locum). Protogenes s’avouant vaincu, courut en diligence au port chercher son hôte. Or a jugé à propos de conserver à la postérité cette planche qui fit l’admiration de tout le monde, mais particulièrement des artistes. Il est certain qu’elle fut consumée dans le dernier incendie du palais de César, au Mont Palatin. Je l’avois auparavant considérée avec avidité, quoiqu’elle ne contînt, dans sa plus spacieusé largeur, que des lignes qui échappoient à la vue, et qu’elle parût comme vuide au milieu d’excellens ouvrages d’un grand nombre d’artistes (Nihil aliud continentem quam lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem). »
Pline a vu lui-même le tableau ou plutôt le panneau. Le fait s’étoit conservé avec l’ouvrage, dont il pouvoit seul fournir l’explication, et s’étoit transmis d’âge en âge : ce seroit une critique téméraire que de vouloir le révoquer en doute aujourd’hui.
Il peut d’abord sembler frivole, et il est en effet précieux, puisqu’il nous éclaire sur l’histoire de l’art au temps d’Appelles. On voit que sa dispute avec Protogenes n’étoit qu’un combat d’adresse : c’étoit un défi à qui traceroit le trait le plus subtil, et celui qui fit un trait assez fin pour qu’il fût impossible de le refendre, fut déclaré vainqueur. Les deux rivaux s’admirèrent mutuellement, et se reconnureut mutuellement pour de grands maîtres, sans avoir d’autre base de leur jugement que l’extrême finesse de pinceau qu’ils possédoient tous deux, et que tous deux regardoient sans doute, comme une partie très-importante de l’art.
Que devons-nous inférer de ce fait ? Que du temps d’Apelles et de Protogenes, on faisoit autant de cas de la finesse du pinceau, qu’on en estime aujourd’hui la largeur ; que les peintres de cet âge, qui possédoient sans doute les grandes parties de l’art, qui leur étoient communes avec les sculpteurs, étoient secs, durs et mesquins dans la partie du métier, et qu’enfin leur manœuvre devoit avoir beaucoup de rapport avec celle de nos peintres gothiques. C’étoit avec le pinceau le plus fin, c’étoit avec les traits les plus subtils, qu’ils rendoient certaines parties que, depuis la perfection du métier, on exprime bien mieux par masses ou par touches. Aussi ne trouve-t-on dans Pline aucune expression qui réponde à celle qu’employent les Historiens de l’art moderne en Italie, lorsqu’ils appellent une barbe bien peinte una bella macchia (une belle tache). Jamais dans Pline, on ne trouve aucun terme qui réponde à celui de largeur de pinceau, de faire large, de large exécution ; et lorsqu’il loue des Peintres pour avoir bien rendu les cheveux et les polis, je ne serois pas éloigné de croire qu’il entend que ces peintres rendoient toute la finesse des cheveux, et que, d’un pinceau subtil, ils en comptoient en quelque sorte tous les poils. Les contemporains d’Apelles étoient donc grands de dessin et d’expression, mais petits d’exécution. C’est ce que prouve le terme de sept années entières qu’employa Protogenes à faire un tableau d’une seule figure. Il est vrai qu’Apelles lui reprochoit ce fini excessif ; mais les artistes tiennent toujours plus ou moins à leur siècle, et tout ce qu’ils peuvent faire, c’est d’outrer ce qui est en usage. Le fini excessif de Protogenes semble prouver qu’un fini froid étoit d’usage de son temps. Il fut enfin regardé comme l’un des plus grands peintres de son siècle : sa manière n’avoit donc rien dont on fût très-choqué.
On admiroit encore les lignes d’Apelles & de Protogenes du temps de Pline : faut-il en conclure que, du temps de Pline, on faisoit consister dans l’extrême finesse du pinceau le plus grand mérite de la peinture ? Je ne crois pas cette conséquence nécessaire. Il suffit que ces lignes eussent été admirées du temps d’Alexandre, pour qu’elles le fussent encore du public du temps de Vespasien. Pline étoit du nombre des admirateurs ; mais on sait qu’il n’étoit pas grand connoisseur, et il pouvoit bien partager l’admiration publique, sans savoir bien précisément pourquoi il admiroit. C’étoit un amateur, et les amateurs sont fort sujets à se passer, en quelque sorte, l’admiration de main en main. L’O du Gioto n’étoit qu’un tour d’adresse, comme la ligne d’Apelles, et si cet O existoit encore, et qu’il fût exposé dans une vente, je suis sûr qu’il seroit poussé à un très-haut prix. Les connoisseurs savent cependant aujourd’hui ce qu’ils doivent penser de l’O du Gioto.
De Piles, dans ses Vies des peintres, a changé les lignes d’Apelles & de Protogenes en des contours fins & corrects : c’est altérer l’Histoire ; c’est travestir une histoire ancienne par un costume moderne. Pline seul nous a conservé le fait ; il l’a expliqué clairement ; c’est donc lui qu’il faut suivre, et puisqu’il est clair il ne faut pas l’interpréter. En se permettant d’altérer ainsi les anciens événemens, un ne pourroit en tirer que de faux résultats.
Un ami de Voltaire alla le voir, et ne le trouvant pas, il laissa quelques vers sur son bureau ; voici la réponse que fit Voltaire :
On m’a conté, l’on m’a menti peut-être,
Qu’Apelle un jour vint, entre cinq et six,
Confabuler son cher ami Zeuxis,
Et, ne trouvant personne en son taudis,
Fit, sans billet, sa visite connoître.
Sur un Tableau par Zeuxis commencé,
Un trait hardi fut savamment tracé ;
Zeuxis connut son maître & son modèle.
Ne suis Zeuxis ; mais chez moi j’ai trouvé
Un trait frappé par la main d’un Apelle.
L’histoire est changée, ce qui n’est pas une faute dans un badinage poétique ; mais elle a la vraisemblance qu’exigent nos idées actuelles sur l’art. Il est certain qu’une touche savamment prononcée sur un tableau, pourroit faire juger qu’elle est de la main d’un grand maître.
Watelet, Claude-Henri ; Levesque, Pierre-Charles, article « Peinture chez les Grecs », Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts(publi: 1788:1791), p. 647 (fran)
On a beaucoup parlé de son voyage à Rhodes, de sa visite au peintre Protogenes qui y demeuroit et qu’il ne trouva pas, de la ligne très-fine qu’il traça sur un panneau que Protogenes, de retour, fendit par une ligne encore plus subtile encore. On peut voir, sur ce fait assez peu important, l’article « LIGNE d’Appelles. »
Füssli, Johann Heinrich, Lecture I. On Ancient Art(redac: 1801/03/16), p. 371-372 (anglais)
Grace of conception and refinement of taste were his elements, and went hand in hand with grace of execution and taste in finish; powerfull and seldom possessed singly, irresistible when united: that he built both on the firm basis of the former system, not on its subversion, his well-known contest of lines with Protogenes, not a legendary tale, but a well-attested fact, irrefragably proves: what those lines were, drawn with nearly miraculous subtlety in different colours, one upon the other, or rather within each other, it would be equally unavailing and useless to inquire; but the corollaries we may deduce from the contest are obviously these, that the schools of Greece recognised all one elemental principle; that acuteness and fidelity of eye and obedience of hand form precision; precision, proportion; proportion, beauty; that it is the “little more or less”, imperceptible to vulgar eyes, which constitutes grace, and establishes the superiority of one artist over another: that the knowledge of the degrees of things, or taste, presupposes a perfect knowledge of the things themselves: that colour, grace, and taste are ornaments, not substitutes of form, expression, and character, and when they usurp that title, degenerate into splendid faults.
Füssli, Johann Heinrich, Lectures on Painting, (trad: 1994), Première Conférence, "De l'art antique", p. 32 (trad: "Conférences sur la peinture" par Chauvin, Serge en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Ses éléments étaient la grâce de la conception et le raffinement du goût, et allaient de pair avec la grâce de l’exécution et le goût dans la finition […] son fameux concours avec Protogène, qui n’est pas une histoire légendaire mais un fait bien attesté, en offre une preuve irréfutable : ce qu’étaient ces lignes, dessinées en différentes couleurs avec une subtilité quasi miraculeuse, l’une sur l’autre ou plutôt l’une à l’intérieur de l’autre, il serait aussi vain qu’inutile d’essayer de le savoir ; mais les conclusions que nous pouvons tirer de cette joute sont évidemment que les écoles de la Grèce reconnaissaient toutes un principe élémentaire unique : que la finesse et la fidélité de l’œil, la docilité de la main forment la précision ; la précision, la proportion ; la proportion, la beauté ; que c’est ce « petit peu en plus ou en moins », imperceptible à l’œil du vulgaire, qui constitue la grâce et établit la supériorité d’un artiste sur un autre ; que la connaissance des degrés des choses, qui est le goût, présuppose une connaissance parfaite des choses elles-mêmes ; que la couleur, la grâce et le goût sont des ornements, non des substituts, de la forme, de l’expression et du caractère, et que, si elles en usurpent le titre, elles se dégradent en fautes splendides.
Füssli, Johann Heinrich, Lecture I. On Ancient Art(redac: 1801/03/16), p. 353 (anglais)
Apelles and Protogenes, nearly a century afterwards, drew their contested lines with the pencil ; and that alone, as delicacy and evanescent subtilty were the characteristic of those lines, may give an idea of their excellence.
Füssli, Johann Heinrich, Lectures on Painting, (trad: 1994), Première Conférence, "De l'art antique", p. 15 (trad: "Conférences sur la peinture" par Chauvin, Serge en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
Apelle et Protogène, près d’un siècle plus tard[Explication : que Zeuxis et Apollodore.], dessinaient leurs traits si controversés au pinceau : et cela suffit, tant ces traits se caractérisaient par leur délicatesse et leur subtilité évanescente, à donner une idée de l’excellence de leur technique.
Quatremère de Quincy, Antoine, Mémoire sur le défi d’Apelles et de Protogène, ou éclaircissements sur le passage dans lequel Pline rend compte du combat de dessin qui eut lieu entre ces deux peintres(publi: 1819), p. 390-424 (fran)
- [1] Moniteur, 13 novembre 1807. Note sur un passage de Pline etc., par M. Chazot
- [2] Plin. l. XXXV, ch. X.
- [3] Plin. édition d’Hard. emend. et not. 11, in librum XXXV
- [7] Lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulami
- [8] Alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse
- [9] Tertio colore lineas secuit
- [10] Voyez. pl. I
- [11] Voyez pl. I. fig. I
- [12] Voyez pl. II, fig. 1 et 2
- [13] Voyez pl. II, fig. 1 et 2
Le passage relatif à ce que j’appelle le combat de dessin entre Apelles et Protogènes, offre la preuve de ce que j’avance. Un artiste traduisant Pline en cet endroit pouvoit aisément, ce me semble, sans être taxé de trop de complaisance, donner aux mots de son auteur un sens beaucoup moins absurde : il pouvoit, par exemple, traduire le mot linea par un autre mot français que celui de ligne, dont l’acception, consacrée par l’usage à la géométrie, fait du récit de Pline un conte étranger à l’art du dessin. Poinsinet, qui, dans un esprit différent, n’a pas laissé d’ajouter, d’une autre manière, à l’absurdité dont il s’agit, en la mettant dans tout son jour, a cependant employé les mots de lineament et de trait ; ce qu’auroit pu faire aussi M. Falconet. Je sais que d’autres interprètes sont tombés, en commentant le passage que je vais rapporter, dans un excès opposé : je sais qu’on peut détourner beaucoup trop le sens des mots de Pline ; ce qu’a fait encore dernièrement, à mon avis, dans un article interprétatif de ce passage, un nouveau commentateur. [1]. Cette dernière manière, à la vérité raisonnable, d’entendre Pline, m’a toutefois paru n’être achetée aussi qu’au prix de la fidélité que le traducteur doit aux paroles de son auteur, lorsque rien ne décèle qu’il y ait altération dans le texte : c’est pourquoi j’ai cherché à mettre les propres paroles de Pline d’accord avec un sens à mon gré très-raisonnable ; j’ai pensé qu’à cela devoit se borner le soin du traducteur fidèle et du commentateur éclairé.
Le but de ce Mémoire est donc de prouver que, sans faire la moindre violence aux paroles de Pline, sans en détourner le sens, sans en changer l’acception simple et positive contre l’acception métaphorique et figurée, on peut y trouver une interprétation très raisonnable au jugement d’un artiste ; que cet écrivain, en ne disant que ce qu’il a dit, loin d’avoir rapporté une anecdote imaginaire ou puérile, a raconté un fait véritable et digne de foi, dans le sens et avec les termes dont un homme de l’art pourroit encore aujourd’hui se servir, sans que son récit pût être taxé de puérilité ou d’ignorance.
Je vais d’abord faire connoître en son entier le passage de Pline :
[2] Scitum est inter Protogenem et eum (Apellem) quod accidit. Ille Rhodi vivebat, quo cùm Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera eius famâ tantùm sibi cogniti, continuò officinam petiit. Aberat ipse; sed tabulam amplae magnitudinis in machina aptatam picturae anus una custodiebat. Haec Protogenem foris esse respondit, interrogavitque à quo quaesitum diceret. Ab hoc, inquit Apelles : arreptoque penicillo, lineam ex colore duxit summae tenuitatis per tabulam. Reverso Protogeni quae gesta erant anus indicavit. Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem, dixisse Apellen venisse : non enim cadere in alium tam absolutum opus ; ipsumque alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse, praecepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adiiceretque hunc esse quem quaereret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles ; sed, vinci erubescens, tertio colore lineas secuit nullum relinquens ampliùs subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit hospitem quaerens: placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, sed artificum praecipuo miraculo. Consumptam eam priore incendio domûs Caesaris in Palatio audio, spectatam olim, tanto spatio nihil aliud continentem quàm lineas visum effugientes, inter egregia multorum opera inani similem, et eo ipso allicientem omnique opere nobiliorem.
La leçon du manuscrit de la Bibliothèque du Roi, et des éditions antérieures à celle d’Hardouin, porte :
[3] Consumptam eam constat priore incendio domûs Caesaris in Palatio, avide ante à nobis spectatam, spatiosiore amplitudine nihil aliud etc. (ou) spectatam nobis antè spatiosè nihil aliud etc.
Tout le monde sait ce qui se passa entre lui (Apelles) et Protogènes, qui vivoit à Rhodes. Apelles s’étoit embarqué pour cette île, jaloux de voir les ouvrages d’un homme qu’il ne connaissoit que de réputation. Arrivé à Rhodes, il va droit à son atelier, n’y trouve point celui qu’il cherche, mais seulement une vieille femme, gardienne du local et d’une très-grande table de bois, dressée sur le chevalet et préparée pour être peinte. La vieille femme lui dit que Protogènes étoit dehors, et le pria de laisser son nom. Le voici, répondit Apelles ; et, saisissant un pinceau, il conduisit sur le fond de bois, avec de la couleur, un trait d’une grande finesse. Protogènes de retour fut instruit de ce qui s’étoit passé. On dit que, jugeant avec le coup d’œil d’un artiste le mérite d’un trait aussi délié, il s’écria sur-le-champ : C’est Apelles ; nul autre n’est capable d’une si grande perfection. À l’instant, prenant un autre couleur, il fit sur le trait d’Apelles un trait encore plus délié ; puis il partit, et recommanda, si l’on revenoit, de montrer ce trait, et de dire : Voilà celui que vous cherchez. C’est ce qui eut lieu. Apelle fut confus de se voir vaincu ; et employant une troisième couleur, il en coupa les traits précédens avec tant de finesse, que l’art n’eût pu aller plus loin. Protogènes s’avoua vaincu, courut au port chercher Apelles, et lui offrit l’hospitalité. Ils convinrent de laisser subsister le tableau dans cet état. C’est ainsi qu’il a été transmis à la postérité, objet d’admiration sur-tout pour les artistes. J’ai appris qu’il avoit péri dans le premier incendie de la maison de César, sur le Palatium, où il étoit autrefois un sujet de curiosité pour les spectateurs. En effet, le vaste champ de cette table ne contenoit que des traits qui échappoient à la vue. Au milieu des magnifiques tableaux de grands maîtres qui l’environnoient, on croyoit voir un cadre vide. Toutefois le vide de ce cadre étoit ce qui attirait les regards, et le faisoit remarquer plus que les autres.
J’ai déjà fait observer qu’il y a une autre leçon de la dernière phrase : j’ai suivi ici le texte et la correction d’Hardouin, quoiqu’il ne me paroisse pas trop prouvé que sa correction soit la meilleure. Le passage des éditions antérieures porte, ainsi qu’on l’a vu, J’apprends que ce tableau a péri dans le premier incendie de la maison de César, sur le Palatium, où nous l’avons vu autrefois avec beaucoup de curiosité, etc. Selon Hardouin, domus Caesaris veut dire ici le palais des empereurs ; ce que je ne contesterai pas, quoiqu’il puisse y avoir lieu à quelque doute. Or ce palais, dont il paroît qu’Auguste fut le créateur, fut incendié, pour la première fois, sous son règne. Si donc le tableau des trois traits fut consumé par cet incendie, Pline, postérieur de près d’un siècle à cette époque, n’a pas pu dire qu’il avoit vu ce tableau. C’est pourquoi Hardouin, au lieu du mot constat, met le mot audio, qui prend la place d’avidè, et il change les mots spectatam à nobis, en ceux-ci, spectatam olim : à quoi l’on pourroit objecter que le tout auroit pu s’accorder à moins de frais, et qu’il n’auroit fallu que mettre posteriore, au lieu de priore ; et alors Pline aurait pu parler du tableau comme témoin oculaire ; ce qu’il donne véritablement à entendre par la manière dont il décrit l’effet de ce cadre vide, la singularité de ce champ en quelque sorte désert, et l’impression qu’il produisoit. Mais, en accordant que le tableau des trois traits n’ait pas été vu par Pline, et en admettant la correction assez arbitraire d’Hardouin, il n’est guère plus permis de révoquer en doute l’existence de ce monument singulier, ni par conséquent le fait du combat entre Apelles et Protogènes, fait que quelques-uns ont voulu mettre au nombre de ces historiettes fabriquées jadis par l’ignorance et propagées par la crédulité du vulgaire. De quelque manière qu’on lise le passage de Pline, il faut reconnoître que le tableau a existé et a été vu à Rome. Pline le dit et l’affirme de la façon la plus positive. Son récit, en invoquant le témoignage au moins d’une tradition encore vivante à Rome, devient, au jugement de tout critique éclairé, un gage irrécusable de la réalité de l’ouvrage ; et, dans des choses bien plus importantes, la certitude historique n’a pas toujours d’aussi bons garants.
Si l’histoire du débat entre Apelles et Protogènes eût été racontée, comme plusieurs autres histoires, par Pline, sans être appuyée d’aucune autorité, il conviendroit encore de penser que cet auteur l’avoit puisée dans les ouvrages des historiens grecs, et le manque de témoignages ne seroit pas un motif de rejeter celle-ci plus que les autres. Toutes sortes de circonstances, au contraire, viennent à son appui : non-seulement il est permis d’y croire, puisqu’elle n’a, comme on le verra, rien d’incroyable ; mais le seul fait que le tableau fut transporté de Grèce à Rome, qu’il orna le palais des Césars et excita la curiosité publique, prouve que ce dut être un ouvrage recommandable, et par sa singularité, et par le nom de ses auteurs, et par la légitimité de ses titres. Du reste, il n’est point étonnant que de simples figures au trait se soient conservées depuis Alexandre jusqu’à César, c’est-à-dire pendant un espace de trois à quatre siècles : nous possédons aujourd’hui, dans les cabinets, une multitude de dessins au bistre et de traits à la plume sur papier, qui ont cette ancienneté. Deux tablettes de marbre, trouvées à Pompéia, nous offrent encore, après 1800 ans, de simples traits ou dessins faits au cinabre, et aussi visibles que lorsqu’ils furent tracés. J’ai cru devoir ces observations préliminaires à l’interprétation du récit de Pline, et du fait qu’il renferme. Ce récit, encore qu’il fût une fiction, ne seroit pas totalement à dédaigner, parce qu’en ce genre aussi les fictions se composent des élémens du vrai, ou du moins de quelques-unes de ses parties : cependant on auroit eu droit de regarder comme une occupation futile, toute recherche qui eût tendu à rendre raison d’un fait imaginaire. Quoique le vrai soit quelquefois invraisemblable, il n’en seroit pas moins ridicule de chercher à rendre vraisemblable ce qu’on sauroit n’être pas vrai.
Première partie. Je ne ferai pas ici le recensement de tous les critiques qui ont expliqué et commenté le passage de Pline dont il s’agit : le nombre en est infini, et ce détail deviendroit fastidieux. Ce qui importe à l’interprétation que je proposerai, c’est de savoir que les commentateurs se divisent en deux classes ou deux espèces. Les uns, attachés plus au sens des mots qu’au sens de la chose, ont expliqué les mots et exprimé la chose de la manière la plus strictement littérale[4] ; et, comme en ce genre aussi la lettre tue, ils n’ont fait sortir du texte de Pline qu’un narré vide de sens et dénué de vraisemblance au gré des artistes ; de ce nombre sont Poinsinet et Falconet. Les autres, ayant subordonné l’interprétation des paroles de Pline à une opinion plus relevée sur l’objet du débat entre les deux peintres, c’est-à-dire, ayant voulu que le sujet de ce défi fût digne de deux grands artistes, ils en ont cherché le motif dans la manière dont ils ont conçu qu’un tel débat pourroit avoir lieu et être apprécié aujourd’hui, et ils ont donné aux paroles de Pline une extension dont elles ne sont pas susceptibles. De ce nombre sont Durand, de Piles, Caylus, Mengs sur-tout, dont je rapporterai l’opinion tout à fait hors de mesure, et, en dernier lieu, l’auteur d’un article interprétatif de ce passage dont il a déjà été fait mention.
Et d’abord je ne crois pas qu’il faille beaucoup s’étendre en preuves pour montrer que le mot linea, employé par Pline dans tout son récit, signifie quelque autre chose qu’un trait géométrique ; cette méprise, si c’en est une de la part des traducteurs, ne sauroit être imputée à Pline, qui s’est servi du mot propre en sa langue : la moindre attention à chercher dans cet auteur lui-même le sens de ses paroles, auroit pu facilement prévenir cette espèce de non-sens. À la suite du passage qui nous occupe, il dit, en parlant d’Apelles : Apelli fuit alioquin perpetua consuetudo nunquam tam occupatam diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem. « Du reste, il eut pour habitude constante, quelque occupé qu’il fût d’ailleurs, de ne jamais passer une journée sans s’exercer à faire un dessin. » Ceux qui n’ont vu dans ce passage, comme l’observe Winckelmann, que l’exercice habituel de la peinture, ne se sont pas fait des paroles de Pline une idée juste : Qu’un peintre, dit-il, exerce tous les jours son art, il n’y a rien là de remarquable. Je sais que quelques théoriciens spéculatifs ont proposé, comme un exercice utile dans l’étude du dessin et propre à rendre l’œil juste, d’habituer les commençans à tracer à vue d’œil des lignes droites, des angles et des cercles, et il se peut que certains critiques, fondés sur cette prétendue méthode, aient imaginé que le débat d’Apelles et de Protogènes auroit eu lieu sur un semblable exercice ; comme aussi, qu’Apelle traçoit tous les jours une ligne droite. Quant à la méthode dont on a parlé, nous dirons qu’elle n’a eu pour elle, jusqu’à présent, ni un exemple ni une autorité dans les écoles des modernes ; que rien ne prouve qu’elle ait existé chez les anciens, et que les notions reçues de l’art du dessin tendent à la faire regarder comme vaine et chimérique. À l’égard de l’application qu’on pourroit en faire à l’habitude qu’avoit Apelles de ne pas passer un jour sans lineam ducere, le passage seul de Pline s’y oppose ; car, puisque ce passage dit qu’Apelles s’étoit fait une règle de pratiquer tous les jours cet exercice, quelque occupé qu’il fût d’ailleurs, il faut bien accorder que cet exercice demandoit un peu de temps : or il n’en faut point pour tirer une barre ; mais un trait de dessin, un contour de figure, exige au moins le sacrifice de quelques momens : donc lineam ducere, dans ce passage, ne peut pas se réduire à la pratique de tirer une simple ligne[5]. Il est hors de doute qu’ici lineam ducere signifie exclusivement ce que nous entendons en français par dessiner, pris dans son acception spéciale en peinture ; c’est-à-dire, renfermer entre des contours produits par un trait léger les formes du corps, et particulièrement la configuration du corps humain. Puisqu’ici lineam ducere veut dire dessiner ou tracer avec un simple trait, sans ombre et sans coloris, les contours d’une figure, il étoit tout simple d’imaginer que, dans le combat décrit des deux peintres, il devoit être aussi question de contours de figure, et non d’un trait d’écriture ou de géométrie. Pline ne l’a point dit d’une manière expresse : mais étoit-il nécessaire que Pline, parlant des deux plus habiles peintres de l’antiquité se disputant la prééminence dans l’art du trait, nous avertît que ce trait était un trait de peinture et de dessin ? Quel écrivain moderne se seroit cru obligé d’en faire la remarque en décrivant une pareille lutte, par exemple, entre Léonard de Vinci et Michel-Ange[6] Pline est donc à l’abri de tout reproche. Il s’est servi, dans le récit du défi entre ces deux peintres, des mêmes paroles qu’il emploie pour nous apprendre qu’Apelle ne passoit pas un jour sans donner quelques moments à la pratique de la délinéation ou du dessin. Je ne m’arrête encore un moment sur le rapprochement des deux passages, que pour faire voir quelle importance les peintres antiques mirent à cette pratique. En effet, la notion dont il s’agit, en nous mettant sur la voie de ce qui fit le sujet du débat entre les deux peintres, nous a déjà indiqué l’espèce de mérite dans lequel ils purent se disputer la supériorité que les amateurs durent y admirer. Ce mérite se lioit à beaucoup d’autres ; il tenoit à des habitudes ou à des pratiques méconnues des artistes modernes, et il nous expliquera, je pense, pourquoi, entre les critiques, les uns sont restés en-deçà du vrai sens des mots de Pline, lorsque les autres ont cru devoir en étendre la signification jusqu’à la région de la métaphore.
L’équivoque du mot linea une fois dissipée, je passe à un point qui peut être encore auprès des critiques un objet de difficulté et d’obscurité : je veux parler de ce qui regarde la manière dont les trois traits ou les trois autres dessins furent exécutés, c’est-à-dire, disposés entre eux d’après les paroles de Pline. C’est ici, en effet, que l’on aperçoit dans les traductions une grande incertitude, parce que les paroles de Pline présentent un double sens littéral, qui peut être l’écueil de l’interprétation véritable. La linea prise pour un trait de figure, il n’y a aucun embarras à expliquer le premier contour. Apelle prend un pinceau, et trace sur le fond avec de la couleur un trait d’une grande finesse. [7] Voici où peut commencer l’équivoque : c’est au second trait. Protogène, dit Pline, conduisit sur ce trait, avec une autre couleur, un trait encore plus fin. [8]. Enfin il semble que l’obscurité redouble au troisième trait : Apelle en effet, selon les paroles de Pline, coupa les deux traits avec une troisième teinte [9]. Ma traduction est littérale, et laisse en français l’équivoque dont je vais parler. Je ferai voir ensuite qu’un seul mot pour un autre la dissipe entièrement. En effet, l’équivoque repose ici sur les mots in illa ipsa lineam duxit tenuiorem, etc., lineas secuit. Des commentateurs, tout en accordant que la linea pût être un contour de dessin, ont imaginé que, le contour premier ayant une certaine épaisseur, le travail de Protogènes avoit consisté à repasser avec un trait plus menu sur cette épaisseur, et qu’enfin Apelles auroit encore trouvé moyen d’enchérir de ténuité, en refendant, comme le dit Falconet, les deux teintes du trait par un trait teinté encore plus fin que chacun d’eux. Certes, en admettant qu’il s’agisse d’un contour de figure, et non d’un trait d’écriture, il faut avouer que le jeu de pinceau qui résulte de cette explication a quelque chose de si puéril, que l’esprit se refuse à l’analyser. Après le premier trait, il n’eût plus été question de l’art de dessiner, mais bien de celui de calquer ; et quoique cette légèreté dans le maniement du pinceau, comme je le ferai voir tout-à-l’heure, soit, sinon un mérite en soi, du moins l’indication d’une grande habileté de main, il répugne à la raison, comme au goût, de supposer que ces deux grands hommes se seroient disputé l’honneur d’un mérite qui, appliqué uniquement (selon le sens de cette traduction) à calquer un trait, n’eût vraisemblablement été ici qu’une adresse mécanique de nulle valeur.
Je ne m’arrêterai pas à faire sentir le ridicule de ce débat, qui eût consisté à couper un cheveu en trois ou en cinq ; mais, en tenant toujours au sens ridiculement littéral des paroles de Pline, il y auroit peut-être une manière de décrire le jeu des trois traits, qui offriroit un peu moins d’absurdité, et que je dois exposer. On pourroit, en effet, supposer ces mots in illa ipsa (linea) susceptibles d’un sens moins absolu et moins positif. S’il est contraire à toute vraisemblance que le second trait ait été tracé sur ou dans le corps même (pour ainsi dire) du premier trait, on peut se prêter à imaginer que le second dessinateur auroit, en quelque sorte, doublé le trait du premier, et suivi son contour d’assez près en dehors ou en dedans, répétant avec une grande exactitude celui qui lui servait de patron. Dans ce cas, in illa ipsa lineam duxisse se trouveroit rendu encore d’une manière fort littérale ; et, comme dans cette hypothèse il auroit existé un intervalle quelconque entre les deux contours, le troisième seroit venu occuper cet intervalle et séparer les deux traits. Voilà une explication moins éloignée peut-être de la vérité et du bon sens. On voit qu’alors ces contours, en les supposant praticables, eussent ressemblé à ceux qu’on fait lorsqu’on prend un pinceau à trois pointes.
Je doute que, pour être fidèle au sens propre, et même littéral, des paroles de Pline, il faille avoir recours à de telles interprétations. De ces trois contours, en effet, un seul auroit encore eu le mérite propre à faire juger du talent d’un dessinateur ; c’eût été le premier : les deux autres en eussent été sinon des calques, au moins des copies serviles ; et ce mérite de finesse matérielle dans le trait, qui en est un sans doute lorsqu’il se joint aux autres, loin d’aller ici en croissant dans les deux contours suivants, eût été de moins en moins remarquable, puisque ces deux derniers contours, simples et machinales répétitions du premier, n’eussent été qu’un travail de la main, tout-à-fait indigne d’exciter l’émulation de deux grands peintres et l’admiration des connoisseurs.
Je l’ai dit, un seul mot peut, en français, faire évanouir toutes les difficultés. J’ai déjà prouvé que ducere lineam veut dire dessiner, faire ou conduire un dessin ; il est dès-lors certain que linea, qui veut dire ligne, trait, contour, veut dire, par la même raison, un dessin, mot qui, dans la langue de l’art, est synonyme des précédens. Il paroît que le latin avoit peu de synonymes en ce genre, et linea ou lineamentum sont les seuls mots que Pline emploie : linea vouloit donc dire un dessin dans la langue technique de l’art.
Cela posé, qu’on me permette de reprendre le récit de Pline, en substituant au mot trait, ligne, contour, ou autres qui sont équivoques, le mot dessin, dont le sens est plus déterminé ; et il n’y a plus lieu à la moindre méprise. Apelles voit un fond préparé pour peindre ; il prend un pinceau, et fait sur ce fond, avec une couleur, un dessin d’une grande finesse. Protogènes arrive, et sur le dessin d’Apelle il en fait, avec une autre couleur, un second encore plus fin. Apelles survient, et, avec une troisième couleur, sépare ou coupe les deux dessins par un troisième, qui ne permet pas de supposer une plus grande finesse. Il me semble qu’il n’est guère possible de se méprendre sur ce récit : tout artiste verra là trois dessins, c’est-à-dire, ou trois figures dessinées l’une d’un côté, l’autre de l’autre et la troisième dans le milieu, ou l’une dans l’autre. Tout ce qui étoit équivoque avec le mot trait, cesse de l’être avec le mot dessin. Mais faisons voir qu’avec le mot dessin, qui est aussi une traduction littérale du mot linea, et en interprétant ce mot selon le sens que l’art indique, la manière d’entendre Pline ne sort pas du cercle exact de l’explication grammaticale ; c’est-à-dire faisons voir qu’il y a deux versions littérales de ce passage. Pline a dit in illa ipsa lineam duxisse. Je pense d’abord que l’on peut traduire littéralement le in illa par sur cette ligne, comme dans cette ligne ; sur ce dessin, comme dans ce dessin. Si l’on pouvoit se permettre en ce sujet une légère métaphore, la première idée qui se présenteroit à l’esprit d’un artiste seroit que le in illa, sur ce dessin, signifieroit que le second trait auroit été fait sur le premier, la chose entendue non matériellement, mais moralement, comme lorsqu’on dit tous les jours qu’un dessinateur a fait son dessin sur le dessin d’un autre, c’est-à-dire d’après ce dessin. Dans ce cas, la figure de Protogènes pourroit être supposée avoir été une répétition de la figure d’Apelles, répétition dans laquelle l’imitateur auroit toutefois employé sa manière et son style de dessin : cette façon d’entendre Pline correspondroit au dessin n.°1. Mais on objectera que le in illa linea n’a pas en latin la même latitude de sens que le sur cette ligne du français, ou sur ce dessin, la préposition sur pouvant véritablement se prendre de deux façons, soit au simple, soit au figuré. On dira que in illa doit se traduire par les prépositions dans et sur, en tant que prépositions de lieu, qui n’indiquent ici autre chose que la position du second trait ou dessin, dans son rapport matériel avec le premier.
Eh bien, de quelque manière qu’on l’entende, on va voir qu’il est tout aussi permis de prendre la linea de Pline pour un dessin de figure, que pour un trait géométrique ou un trait d’écriture et de pinceau. Veut-on que in, exprimé par sur, signifie une simple position de lieu ; je place le second dessin, dans son rapport avec le premier, de la façon dont on placeroit le second trait géométrique. Veut-on que ce soit simplement au-dessus ; je suppose deux figures dessinées l’une au-dessus de l’autre, comme dans la démonstration n.°2. [10] Veut-on enfin que in exprime une position intérieure et signifie dans ; je place ce second dessin de manière que véritablement il entre dans la premier ; et l’on peut en voir la démonstration au même n.°2, en supposant le contour de la figure du second trait encore plus bas, et par conséquent plus intérieur. Selon toutes ces combinaisons, le texte de Pline dit ce que je lui fais dire ; il n’en résulte rien que de naturel, rien qui n’exprime la réalité d’une lutte de dessin digne des deux grands peintres. Passons au troisième trait ou dessin, sur lequel l’explication trop positive des paroles de Pline a jeté tant de ridicule. Comment entendrons-nous les mots qui y ont donné lieu, tertio colore lineas secuit ! L’absurdité de la première explication, c’est-à-dire, du trait dont l’épaisseur auroit été découpée en cinq lignes, me paroît assez démontrée pour n’avoir pas besoin d’un supplément de preuves. Je crois avoir prouvé aussi à ceux qui persisteroient dans l’explication du mot seccare par l’intersection d’une ligne ou par un trait refendant deux traits accouplés et collatéraux, que ce dessin à troits traits concentriques ou parallèles est inadmissible en bonne critique d’art ; que si enfin secare doit vouloir dire ici, non pas rescinder ou refendre (comme l’a dit Falconet) deux lignes, mais s’interposer entre elles ou sur elles, la même explication doit valoir, en prenant linea non pour un trait d’épaisseur, mais pour un trait de dessin, c’est-à-dire, une figure dessinée. La rareté des passages anciens où il s’agit de dessin proprement dit, a sans doute causé la bizarrerie de ces interprétations serviles : ce petit nombre d’autorités nous impose aussi la loi de ne pas trop nous livrer à l’arbitraire ; sans cette retenue, on auroit hasardé quelques légers changemens, propres à lever ici toute équivoque. J’avois en effet d’abord eu l’idée, en soupçonnant quelque altération dans le texte, de substituer au mot secuit les mots secutus est ou secùs duxit ; mais j’ai pris l’engagement de ne rien changer à la leçon reçue dans toutes les éditions. Je pense aussi que le mot employé ici au pluriel, lineas, doit s’entendre des deux premiers dessins et non du troisième, quoiqu’à la rigueur on pût aussi bien appeler en latin un dessin par le mot linea au pluriel, et de la manière dont nous disons les traits, les contours d’une figure. Voici donc comment j’interprète les mots de Pline. Si le mot secare veut dire simplement diviser, si l’on veut qu’il exprime l’idée d’un dessin interposé entre deux autres dessins, alors j’entends qu’Apelles, trouvant en pendant de sa figure au simple trait, ou à côté d’elle, ou sur elle, ou en elle, une autre figure dessinée par Protogènes, d’un trait plus fin que le sien, dessina pour la troisième fois la même figure, ou en fit une autre, ce qui est indifférent à la question, au milieu et entre les deux figures précédemment tracées ; ce qui les divisoit : et alors j’explique et j’entends le mot secare dans sens de ceux qui supposent trois traits concentriques ou collatéraux en une seule figure. [11]
Mais la seconde combinaison, à laquelle je n’aperçois pas l’ombre d’une difficulté, est celle-ci. Expliquant le mot secare par couper, de la manière la plus littérale, je me demande de quelle façon le trait d’une figure dessinée peut couper le trait de deux autres figures dessinées ; le simple bon sens me dit que c’est en les traversant, en passant sur eux, en les interrompant. Cela étant, que fit Apelles ? Il prit une troisième couleur, c’est-à-dire, une teinte différente des deux premières, et peut-être d’un ton plus tranchant, et il dessina, ou dans l’intervalle des deux figures au simple trait, ou sur leurs propres traits mêmes, une troisième figure dont le trait, enjambant sur ceux de ses voisines, les coupoit réellement de différentes manières et en différens sens. [12] Quiconque a vu de quelle manière un peintre met son tableau au trait, avant d’appliquer ses couleurs aux figures, de quelle façon, pour se rendre compte de chacune, il la dessine en son entier, de sorte que l’une entre plus ou moins dans l’autre et s’en trouve plus ou moins coupée, a la démonstration de l’explication que je propose. La troisième figure dessinée par Apelle coupoit donc réellement, et dans le sens le plus littéral, les deux autres dessins, tertio colore lineas secuit ; et Pline décrit cet effet fort correctement. Il y a encore moyen de trouver plus propriété à son expression, c’est de supposer qu’Apelles, employant une teinte fort tranchante, telle qu’un rouge vif, à l’effet de faire mieux distinguer le trait de sa nouvelle figure au milieu de ceux des deux autres, auroit dessiné sa figure en hauteur, par exemple, lorsque les deux premières étoient en large, ou vice versâ, de manière que son dessin eût véritablement coupé, traversé dans leur totalité les dessins dont il vouloit surpasser la finesse. [13] Il y a enfin, pour un dessinateur, plus d’une manière de démontrer l’accord de ces trois dessins avec le sens littéral des paroles de Pline ; et les démonstrations ci-jointes en suggéreront beaucoup d’autres. Leur objet est de prouver aux yeux, que Pline n’a dit qu’une chose simple et raisonnable, qu’il n’y a que manière de l’entendre, et que, sans changer son texte, sans détourner ses paroles de l’acception ordinaire, en les traduisant mot à mot, mais en choisissant entre les deux traductions littérales du mot linea celle qui se rapporte à la peinture et à l’art de dessiner, on trouve qu’il a raconté le combat des trois traits avec autant de netteté que de précision, et de la manière dont une pareille chose seroit aujourd’hui rapportée.
Je n’ai parlé de ces trois dessins et de leur exécution que sous le rapport de leur nature et de leur combinaison, double objet de tous les mal-entendus qui, comme on l’a vu, ont été aussi de deux genres. Les uns, dont j’ai tâché de faire sentir l’invraisemblance, appartiennent surtout aux traducteurs qui se sont crus beaucoup trop liés par l’acception primitive et le sens matériel des mots ; les autres sont le fait de certains commentateurs qui, libres des entraves de la traduction, s’étant imaginé que le texte de Pline ne contenoit que des expressions figurées, qu’il falloit y chercher une idée détournée du sens littéral, se sont dès-lors crus en droit de prendre toute liberté dans la manière d’entendre cette histoire, d’en arranger les circonstances, et d’expliquer le mérite qui fut l’objet apparent et réel du défi entre les deux artistes. L’idée que la finesse de trait (ce trait entendu d’un procédé étranger à celui de la délinéation) a paru, en conséquence, à ces derniers commentateurs, une ineptie que l’on ne devoit se permettre d’attribuer, ni aux deux peintres grecs, ni à l’écrivain romain. Débarrassés du soin de chercher à comprendre Pline, ils se sont occupés de celui de le justifier, en lui prêtant leur propre manière d’entendre ce en quoi consista ce défi de finesse dans le trait. Tous, depuis le premier jusqu’au dernier, c’est-à-dire, jusqu’à l’auteur de cet article du journal dont j’ai parlé, ont été d’accord sur ce point ; savoir, qu’il ne falloit entendre dans les qualifications données par Pline aux trois dessins des deux peintres, rien autre chose que ce que nous entendons par élégance et délicatesse. L’opinion de Mengs, dont j’ai déjà fait mention, passe encore toute liberté à cet égard. Il est vrai que ce n’est ni comme traducteur, ni, à proprement parler, en commentateur, qu’il a touché cette matière. Dans son article du dessin des anciens, Mengs a esquissé, en peu de mots, une théorie de l’art des contours chez les Grecs, et a prétendu que, selon les divers caractères que les artistes avoient à exprimer dans leurs figures, ils savoient varier et nuancer à l’infini les modes de leurs contours ; qu’ils avoient beaucoup plus de tons que les modernes en ce genre, c’est-à-dire, que leur diapason de contours étoit beaucoup plus étendu ; qu’ils le divisoient en dix, vingt, cinquante, cent degrés de variétés peut-être, tandis que les modernes, partant de premier saut, comme il le dit, du nombre cinquante, par exemple, ont eu infiniment moins de moyens de varier et de nuancer le caractère de leur dessin. C’est par suite de ce système, dont l’explication m’éloigneroit trop, que Mengs s’est trouvé conduit à penser que le débat de dessin qui eut lieu entre Apelles et Protogènes, pouvoit avoir eu pour objet cet art de varier et de nuancer à l’envi leurs contours ; idée, comme on le voit, par trop systématique pour être applicable au texte de Pline, mais idée tellement défigurée par son traducteur français, qui n’a rien compris à ceci, que l’auteur de l’article du journal dont j’ai parlé, et qui n’a lu Mengs que dans la traduction, l’accuse fort à tort d’augmenter le nombre de ceux qui cherchent la quadrature du cercle. Je puis, au reste, faire connoître, en peu de mots, l’opinion de tous les autres commentateurs qui ont donné un sens figuré à celles des paroles de Pline qui ont pour objet la finesse du trait. Je reproduis ici ces paroles. Pline, en parlant des divers traits dont j’ai donné l’analyse, dit du premier : Lineam duxit summae tenuitatis per tabulam. Il dit du même trait : Ferunt artificem protinus contemplatum subtilitatem. Il dit du second dessin : Alio colore tenuiorem lineam in illa ipsa duxisse. Il dit du troisième : Nullum relinquens ampliùs subtilitati locum. Si l’on excepte Carducci, qui, d’après l’opinion de Michel-Ange, jugea qu’il s’agissoit ici d’un seul dessin dont le contour auroit été deux fois retouché, tous ceux qui ont cherché à se faire une idée du mérite relevé par Pline dans les traits d’Apelles et de Protogènes, ont expliqué tenuitas et subtilitas par des expressions synonymes de pureté, de grâce, d’elégance, et autre qualifications semblables. C’est ainsi, dit M. de Caylus, qu’il faut entendre les mots tenuitas et subtilitas. Tel fut l’avis de De Piles, de Durand, de M. de Jaucourt, et, récemment encore, du dernier commentateur que j’ai cité.
« J’entends, dit-il, le mot subtilitas dans le sens d’élégance, avec Pétrone, Quintilien, et Cicéron, qui, dans plusieurs endroits, joint subtilitas à elegantia, de manière que, s’il ne les considère pas comme des synonymes parfaits, il leur donne cependant une signification très-approximative, comme qui diroit élégance et délicatesse. Le sens que je donne au mot subtilitas, reçoit (ajoute notre critique) une nouvelle force de la circonstance où il est employé, nullum relinquens ampliùs subtilitati locum. Si l’on veut renoncer à toute explication indigne de Pline, et admettre seulement que cet auteur avoit le sens commun, on conviendra, je crois, que ma traduction est la seule admissible et la seule littérale. »
Pour moi, je pense qu’elle n’est ni l’une ni l’autre ; mais je la crois sur-tout inadmissible, parce qu’elle donne aux paroles de Pline un sens figuré qu’elles ne sauroient comporter. Après avoir montré, dans la première partie de cette discussion, qu’on peut être plus raisonnable que les traducteurs, sans être moins littéral qu’eux, voyons s’il n’y auroit pas moyen, dans le second point, d’être plus littéral que les commentateurs, et d’être aussi raisonnable, c’est-à-dire, de donner au texte de Pline un sens que ne puisse rejeter ni dédaigner un artiste instruit.
Seconde partie. Le mot par lequel les interprètes que j’attaque ont imaginé de sauver l’honneur de Pline dans ce récit, est le mot subtilitas, qui s’y trouve employé deux fois. Comme ce mot a un sens simple et un sens figuré, dans le langage de l’art, à peu près de même que notre mot français finesse ; comme ce mot peut exprimer, soit partiellement, soit tout-à-la-fois, et la finesse mécanique ou matérielle d’un contour, et sa finesse sous le rapport moral, c’est-à-dire, l’élégance ou la grâce de la forme, on s’est tout de suite jeté dans la région abstraite de ces qualifications morales, créées ou multipliées par le goût ou le sentiment du beau, pour exprimer les sensations diverses que fait naître la vue d’un beau dessin. En conséquence, selon tous les commentateurs qui ont repoussé l’idée de ligne géométrique, il ne fut question, entre Protogènes et Apelles, que de se disputer à qui dessinoit avec le plus d’élégance, de grâce, de justesse, de vérité, de délicatesse, etc. ; et, selon eux encore, Pline n’a voulu exprimer que ces sortes de qualités, puisqu’il s’est servi du mot subtilitas, qui peut signifier l’élégance dans un contour, aussi bien qu’un trait délié. Mais, n’en déplaise à ces interprètes gratuitement officieux, Pline a usé deux fois aussi, dans son récit, du mot tenuis (lineam summae tenuitatis et tenuiorem lineam) : or je ne sache pas que les mots tenuis, tenuitas, appliqués au trait d’un dessin, puissent avoir d’autre sens qu’un sens matériel, celui qui se rapporte au peu d’épaisseur d’un trait, et ce que nous exprimons par les mots menu, mince, léger, délié, fin. Si donc Pline a employé deux fois le mot subtilis, qui veut dire la même chose, mais qui, à la vérité, peut, au figuré, signifier élégant, il a deux fois aussi employé le mot tenuis, qui n’est susceptible d’aucune interprétation figurée. Et ici, je le demande, le mot qui a deux acceptions, l’une simple, l’autre figurée, peut-il changer le sens du mot qui n’a qu’une acception simple ? Je ne pense pas qu’on puisse l’accorder. La raison et la grammaire veulent, ce me semble, que le mot tenuis, qui n’a point d’acception métaphorique, fasse la loi au mot subtilis, qui a aussi une acception simple. L’expression figurée ne pouvant pas ici communiquer sa vertu à l’expression simple, il est tout naturel que celle-ci fasse rentrer l’autre dans sa signification la plus naturelle. Si le raisonnement et le goût, en peinture et en dessin, ne pouvoient pas s’accommoder de cette convenance rigoureuse, je n’y verrois d’autre remède que de changer les mots de Pline, ou de déclarer son passage inintelligible. Mais il me semble qu’on ne doit ni désespérer si vîte de trouver du bon sens dans les notions de Pline, ni se permettre si facilement de changer les leçons des manuscrits ; que moins encore doit-on, en laissant subsister les expressions d’un auteur, traduire sans en tenir compte, et regarder comme non advenus, les mots qui nous embarrassent. Cela s’appelle couper le nœud. Celui de ce passage se laisse, selon moi, facilement dénouer, pourvu qu’on veuille bien juger les procédés du dessin des anciens autrement que par les habitudes modernes.
Et d’abord, je prétends que Pline a eu sur-tout en vue de relever, dans les dessins des deux peintres, le mérite de la finesse matérielle du trait ; ce à quoi l’on ne peut se refuser d’après les mots tenuis et subtilis qu’il emploie. Je veux montrer ensuite que cette légèreté graphique du trait dut être digne de remarque et d’admiration, s’il est vrai qu’elle dut être l’indication de la plus étonnante habileté. Pour s’en convaincre, il faut réunir toutes les circonstances qui aident à se faire une idée juste des trois dessins en question, et à caractériser le genre de mérite qui leur fut particulier. 1.° Le fond sur lequel ils furent tracés étoit très-spacieux, summae amplitudinis ; ce qui nous laisse à penser, quoique Pline ne l’ait pas dit, que les figures dessinées par ces peintres étoient d’une grande proportion. Tout porte à croire, et la saine théorie de l’art du dessin est d’accord avec cette idée, que les anciens avoient, beaucoup moins que les modernes, l’usage d’enseigner et d’apprendre le dessin, c’est-à-dire, les formes et les proportions du corps humain, sur de petits exemples et dans des dimensions rapetissées. On peut donc raisonnablement penser que, d’après même les habitudes de l’école, les figures dessinées du récit de Pline l’étoient en grand, c’est-à-dire au moins de grandeur naturelle. 2.° Les dessins dont il est ici question, ne furent point le résultat d’une étude faite à loisir, et dans laquelle l’artiste n’arrive que peu à peu à la pureté, à la finesse du trait ; mais, bien au contraire, il furent faits ce qu’on appelle d’un seul jet, les circonstances de l’histoire ne permettant pas de penser qu’Apelles, au lieu de dire son nom, et voulant jouer cette sorte de tour à Protogènes, soit resté assez long-temps pour se laisser surprendre. Protogènes n’étoit absent que pour quelques instans ; il rentre, et, avant de ressortir, ce qu’il fit immédiatement, il dessine une autre figure ; il sort pour n’être pas surpris par le retour d’Apelles : tout cela indique et prouve une très-grande célérité d’exécution. Les trois dessins furent faits dans le même jour, et, avant la fin de ce jour, Protogènes avoit été cherché Apelles sur le port pour lui offrir de venir loger chez lui. 3.° Ces dessins furent faits avec un pinceau, penicillo ; et certes il faudroit avoir peu de connaissance du maniement de cet instrument, pour ne pas comprendre quelle doit être la difficulté de conduire en grand, et du premier coup, un trait fin et léger, avec une couleur, sur un fond de bois. Quiconque appréciera cette circonstance et la joindra aux précédentes, ne tardera pas à se convaincre que, dans toutes ces données, la finesse et la grande légèreté du trait ne pouvoient appartenir qu’aux maîtres les plus exercés dans l’art de la délinéation.
La circonstance de ces trois dessins, tracés avec un pinceau, me paroît aussi une chose des plus instructives et des plus signifiantes pour celui qui cherche à approfondir les arts de l’antiquité, à retrouver leurs documens et les traces de leurs procédés. Si j’avois à développer les résultats de cette notion devant les maîtres de l’art de peindre, je pourrois en faire sortir quelques inductions théoriques, qui ne seroient peut-être pas sans application à la pratique de l’art ; mais, pour ne pas trop sortir du cercle des recherches et des études philologiques, je me bornerai aux réflexions nécessaires pour justifier ma traduction littérale de celles des paroles de Pline qui ont rapport au genre de finesse des dessins d’Apelles et de Protogènes. Nous savons fort peu de choses des procédés de la peinture des anciens ; mais ce que Pline a écrit sur Apelles, suffit pour prouver que la pratique et l’enseignement de l’art se divisoient alors, comme à présent, en deux parties, le dessin et la couleur. Le dessin s’apprenoit dans les écoles, sur des planches de buis, bois dur et compacte (sic), sur lequel l’éponge effaçoit à volonté les essais et les fautes de l’étudiant. Mais avec quoi dessinoit-on ? quel instrument et quelle matière employoit-on ? c’est ce qu’on s’est mis peu en peine de chercher. Cependant l’instrument en ce genre est d’une bien plus grande importance qu’on ne sauroit le dire. Oui, l’instrument qu’on a été habitué à manier dès le commencement, a beaucoup plus d’influence qu’on en le croit sur la manière de chacun, dès-lors sur le goût général et sur toutes ces modifications délicates dont l’art de peindre est susceptible. Il n’est point d’artiste qui ne convienne, par exemple, que, selon la nature seule du genre de crayon qui fut mis dans sa main, et avec lequel il contracta l’habitude de tracer ses première études, sa manière de faire et de sentir fut dirigée avec plus ou moins de force sur tel ou tel autre genre. Un crayon tendre éloigne de la pureté du trait, et porte le goût vers l’effet et l’harmonie. Une pierre dure et aiguë inspire la correction, la sévérité des formes, et détourne du sentiment de la couleur. Nous remarquons que les écoles célèbres du dessin chez les modernes, celles de Florence, de Michel-Ange, de Raphaël, de Jules Romain, employèrent presque uniquement la plume dans les esquisses et les dessins d’étude ; et il est hors de doute que l’habitude de cet instrument, dans ces écoles, est une des choses qui expliquent ce goût héréditaire, et en quelque sorte exclusif, pour la correction et la pureté des contours. Les esquisses, au contraire, et les études qui nous sont parvenues des maîtres de la couleur, sont la plupart à la pierre tendre ou au lavis, et la nature seule dut suggérer aux différens génies le choix des instruments qui étoient le plus en rapport avec le but auquel ils tendoient. Y eut-il, dans la peinture des anciens, une plus étroite alliance que chez les modernes, entre le dessin et la couleur ? nouveau sujet de discussion ou de divination, dans lequel je n’essaierai pas d’entrer ici. Je me contente d’en faire mention, pour avoir l’occasion de dire que beaucoup d’artistes l’ont jugée, cette alliance, et la jugent encore impossible, fondés qu’ils sont sur l’espèce d’incompatibilité qu’ils trouvent entre l’exercice de l’instrument sec et dur qui procure un dessin correct, et ce maniement moelleux du pinceau qu’il faut devoir à un autre genre d’exercice. Toujours est-il certain que, par l’effet de cette inimitié des deux procédés, l’étudiant qui s’est trop habitué à manier le crayon en pierre dure, reste presque toujours étranger aux grâces du pinceau et aux charmes de la couleur. Je ne sais si je me fais illusion sur les résultats qu’on peut tirer à cet égard du passage de Pline que j’interprète ; il me semble, toutefois, qu’il nous apprend que deux des plus célèbres peintres de la Grèce employoient avec une extrême dextérité le pinceau à dessiner, et probablement en grand : du moins est-il certain que, dans le seul passage où il est question de trois dessins tracés sur un fond de bois, ces dessins sont faits au pinceau. Cela fut-il l’effet du hasard ? Je ne saurois le croire. A la cour de Ptolémée, Apelles fit un portrait avec un charbon qui se trouva sous sa main : dans l’atelier d’un peintre, il dut trouver tout ce qui étoit nécessaire pour dessiner ; pourquoi choisit-il un pinceau. J’ajoute que, voulant ici faire montre d’habileté, il n’auroit pas pris, pour improviser un dessin, l’instrument dont il n’eût pas eu l’habitude ; et s’il prit l’instrument qui, pour produire un trait fin et délié, est sans doute le plus difficile à manier, et s’il produisit en effet un trait d’une grande finesse, summae tenuitatis, cela n’indique-t-il pas que le plus célèbre peintre de l’antiquité, le plus versé dans la pratique du dessin, et qui ne passoit pas un jour sans s’y adonner, avoit pour habitude de dessiner au pinceau ? Ce que je viens de dire d’Apelles, s’applique également à Protogènes, qui, acceptant le défi, prend le même instrument, alio colore lineam duxit. Quelle habitude Protogènes ne devoit-il pas avoir de l’art de dessiner au pinceau, pour avoir riposté sur-le-champ par le dessin de la même figure, ou d’une autre, mais exécuté avec un trait encore plus fin ? car cette finesse de trait au pinceau, que les uns ont travestie, et que les autres ont méconnue, est la preuve et d’un prodigieux exercice et d’une habileté non moins merveilleuse. Y auroit-il de la témérité à conclure ces observations, que l’usage des Grecs, dans l’enseignement et dans la pratique de la peinture, étoit de dessiner au pinceau ? et, la chose admise, ne seroit-il pas bien facile de faire voir quelle supériorité le maniement de cet instrument, qui est celui de la couleur, appliquée aussi au dessin, pourroit avoir sur les pratiques contraires ? Ne pourroit-on pas montrer que le pinceau peut surpasser en finesse de contour tous les autres instrumens graphiques, sans cependant porter la main et le goût à cette sécheresse et à cette dureté qui sont les défauts qu’on reproche aux maîtres du dessin ? et ne seroit-il pas permis d’expliquer par-là cette amitié entre la couleur et le dessin, qui paroît avoir existé chez les peintres de l’antiquité ? Mais je sortirois du cercle que je me suis tracé. Je ne crois pas m’être écarté de mon but par cette légère digression, si elle a pu faire sentir en quoi durent consister la perfection mécanique et la difficulté de l’art de dessiner au pinceau, puisque c’est là ce qui explique les paroles de Pline, ou du moins en justifie l’emploi. Je prétends, en effet, que les mots tenuis et subtilis, par lesquels il relève le mérite des trois dessins, sont des mots non seulement très-propres en eux-mêmes, mais qui ne contiennent point un éloge ignorant. Ce genre de mérite, nous le vantons nous-mêmes tous les jours dans les dessins de nos grands maîtres. Nous disons que la plume de Raphaël fut la plus fine de toutes ; nous admirons tous les jours l’extrême finesse des contours à la plume ou au crayon de Michel-Ange ; et cette subtilité de trait nous charme, non qu’on l’admire comme qualité simplement mécanique, mais parce qu’elle ajoute un grand prix à la beauté des formes, à laquelle elle contribue et parce qu’elle donne une haute idée de la sûreté et de la science du dessinateur, de l’imperturbabilité de la main. Mais toutes les difficultés et tous les mérites qu’on admire dans des dessins en petit, faits à loisir avec un trait préparatoire et avec la plume ou le crayon, n’approchent pas du mérite et de la difficulté d’un trait improvisé en grand et sur-tout avec le pinceau. On peut en prendre l’idée, et se confirmer encore dans l’opinion précédemment énoncée sur l’exercice du pinceau appliqué au dessin chez les Grecs, par cette multitude de vases en terre cuite peinte, sur lesquels se trouvent tant d’admirables dessins, tant de traits habiles et savans, tant de contours qui le disputent en correction aux plus belles statues, et qui furent toutefois l’ouvrage d’artistes obscurs, employés dans les fabriques de ces vases. On voit que le trait de ces figures fut fait à la pointe du pinceau, du premier coup, et par l’effet d’une habitude prodigieuse : car on pourroit défier le plus habile peintre d’aujourd’hui de faire à main levée, en ce genre, ce que faisoit le moindre barbouilleur de ces fabriques ; tant la pratique du dessin est diverse à présent de celle des temps anciens. Il y auroit mille leçons, sans doute, à tirer de tous ces dessins ; mais je n’en parle ici que parce qu’ils nous montrent deux choses : l’une, que l’exercice du dessin par le pinceau fut porté au plus haut point chez les Grecs ; l’autre, que la finesse mécanique du trait est encore pour nous, dans ces dessins, et un objet d’admiration, et le caractère généralement distinctif de leur excellence. C’est dans les plus beaux de ces vases, c’est dans ceux des fabriques les plus renommées, et c’est aux figures du dessin le plus élevé et l
- [4] Je dis la plus strictement littérale car, ainsi qu’on le verra, quelques-uns des mots sur lesquels repose la difficulté ont un double sens littéral, l’un hors des procédés de l’art et purement géométrique, l’autre tout-à-fait usuel dans la peinture
- [5] Plinio riferisce come un tratto glorioso della storia d’Apelle, ch’egli non abbia mai lasciato passar giorno in cui non abbia tirato delle linee per far esercicio, ut non lineam ducendo exerceret artem. Quest’ espressione è stata generalmente mal capita. Plinio vuole quì dire che Apelle tutti giorni disegnava qualche cosa o dal naturale o dai lavori de’ più antichi maestri, e così deve spiegarsi la voce linea. Altrondè darebbe ci Plinio una notizia ben insulsa se intendersi volesse della quotidiana occupazione del pittore, poiche di fatti non v’è artista che ogni dì non faccia si poco quanto è il trattar una linea. E qual lode sarebbe gli mai come ben osservò Bayle il dire che adoperava ogni dì il suo penello. (Winckelmann, Storia dell’arte, t. II, p. 248, l. X, c. 1, édit. de C. Fea).
- [6] Voici divers passages où le mot linea est employé par les auteurs anciens dans l’acception de dessin, trait ou contour de figure. Quintilien (Instit. orat. l. X, c.II) : « La peinture en seroit encore à circonscrire les contours des corps par le moyen de l’ombre que produit le soleil » Non esset pictura, nisi quae lineas modò extremas umbrae quam corpora in sole fecissent circumscriberet. Ici linea veut dire contour. Quintilien (Ibid. l. XI, c.III), parlant des monochromes dans lesquelles il y avoit des parties claires et des parties ombrées : Ut qui singulis pinxerunt coloribus, alia tamen eminentioria, alia reductiora fecerunt : sine quo ne membris quidem lineas suas dedissent. « Sans cela, dit-il, ces peintres n’auroient pu donner aux membres leurs véritables formes. » Ici linea veut dire forme. Pline (l. XXXIII, ch. X, au commencement) vante l’habileté de Parrhasius, ainsi que l’art avec lequel il savoit fondre le contour et les traits extérieurs de ses figures, et il dit : Confessione artificum in lineis extremis extremis palmam adeptus. Linea ne veut encore dire ici que le contour d’une figure. C’est dans le même sens que Quintilien (Instit. orat. l. XII, c. X, p. 5) emploie ce mot, lorsqu’en comparant Zeuxis et Parrhasius, il dit du second, qu’il sut fondre avec plus de finesse ses contours, exanimasse subtiliùs lineas. Je lis exanimasse, qui signifie amortir, éteindre, faire disparoître le trait du contour, au lieu d’examinasse, qui ne me paroît faire ni un sens clair, ni sur-tout donner une idée en rapport avec la notion de Pline, rapport que donne exanimasse. La pictura linearis fut appelée ainsi par Pline et par Quintilien, parce qu’elle se formoit par des traits tant dans les contours que dans l’intérieur des figures ; c’est le sgrafitto des Italiens. Nous avons déjà vu que lorsque Pline dit d’Apelles qu’il ne passoit pas un seule jour quin lineam ducendo exerceret artem, cela signifioit qu’il ne passoit pas un jour sans faire un dessin (proprement appelé). Stace (Sylv. l. IV, Hercul. epitrapez. v. 20 à 30), parlant du goût de Nonius Vindex, vante son habileté à discerner les manières des grands maîtres. « Il vous montrera, dit-il, des bronzes de Myron, des marbres de Praxitèle, etc. » et il ajoute, linea quae veterem quondam faeteatur Apellem monstrabit, etc. Il est visible que Vindex avoit non une ligne droite ou courbe, mais bien des dessins d’Apelles ; ou peut-être linea signifieroit ici, plus génériquement encore, le goût de dessin, ce que les artistes appellent le trait d’un maître, pour dire sa manière. Lineamentum a été employé par les anciens non seulement pour désigner les contours de la peinture, mais même des statues. Valère Maxime dit : (l. VIII, Exter. exempl. 4) Muti lapidis lineamentis cupiditatem excitatam videamus ; (l. III, c. VII, Ext. exempl. 4) eboris lineamentis. Pline (l. XXXV), stemma lineis discurrebant ad imagines pictas. Il est question d’arbres généalogiques dont les contours embrassoient les portraits. Sénèque l’explique par ces mots : Et multis stemmata illigata flexuris in parte aedium prima collocant. (Senec. de Beneficiis, lib. III, cap. XXVIII.)
Füssli, Johann Heinrich, Lecture II. On Drawing, p. 493 (anglais)
That he built both[Explication : grace of conception and refinement of taste.] not on the precarious and volatile blandishments of colour, or the delusive charms of light and shade, but on the solid foundation of form, acquired by precision and obedience of hand – not only the confessed inability of succeeding artists to finish his ultimate Venus, but his well-known contest of lines with Protogenes (the correctest finisher of this time), not legendary tale, but a well attested fact, irregragably proves. The panel on which the were drawn made part of the Imperial collection in the Palatium, existed in the time of Pliny, and was inspected by him; their evanescent subtlety, the only trait by which he mentions them, was not, as it appears, the effect of time, but a delicacy, sweep, and freedom of hand nearly miraculous. What they were, drawn in different colours, and with the point of a brush, one upon the other, or rather within each other, it would be equally unavailing and useless for our purpose to inquire; but the corollaries we may deduce from the contest are obviously these: that all consists of elements; that the schools of Greece concurred in one elemental principle – fidelity of eye, and obedience of hand; that these form precision, precision proportion, proportion symmetry, and symmetry beauty: that it is the “little more or less”, imperceptible to vulgar eyes, which constitutes grace, and establishes the superiority of one artist over another: that the knowledge of the degrees of things, or taste, resupposs a comparative knowledge of things themselves: that colour, gace, and taste are companions, not substitues of form, expression, and character, and when they usurp that title, degenerate into splendid faults.
Füssli, Johann Heinrich, Lectures on Painting, (trad: 1994), Septième Conférence, "Du dessin", p. 161-162 (trad: "Conférences sur la peinture" par Chauvin, Serge en 1994)(fran)(traduction récente d'un autre auteur)
J’en[Explication : de la grâce de l’exécution et du goût dans la finition d’Apelle.] veux pour preuve irréfutable non seulement l’incapacité avouée de ses successeurs à finir sa Vénus, dernière de ses œuvres, mais encore son fameux concours de lignes avec Protogène (le plus juste finisseur de son temps), qui loin d’être une légende constitue un fait historiquement attesté. Le panneau sur lequel elles furent tracées faisait partie de la collection impériale du Palatin, où il existait encore du temps de Pline, qui put l’examiner ; leur subtilité évanescente, qui est le seul trait qu’il mentionne d’eux, n’était pas, s’aperçoit-on, l’effet du temps, mais d’une délicatesse, d’une liberté et d’un coup de main quasi miraculeux. Ce qu’elles étaient, dessinées de différentes couleurs, à la pointe du pinceau, l’une sur l’autre, ou plutôt l’une à l’intérieur de l’autre, il serait aussi oiseux que vain pour notre propos d’essayer de le savoir.
Apollinaire, Guillaume, « Du sujet dans la Peinture moderne »(publi: 1912), p. 2-3 (fran)
Beaucoup de peintres nouveaux ne peignent que des tableaux où il n’y a pas de sujet véritable. Et les dénominations que l’on trouve dans les catalogues jouent alors le rôle des noms qui désignent les hommes sans les caractériser.
De même qu’il existe des Legros qui sont fort maigres et des Leblond qui sont très bruns, j’ai vu des toiles appelées : Solitude, où il y avait plusieurs personnages.
Dans les cas dont il s’agit, on condescend encore parfois à se servir de mots vaguement explicatifs comme « portrait », « paysage », « nature morte » ; mais beaucoup de jeunes artistes-peintres n’emploient que le vocable général de peinture.
Ces peintres, s’ils observent encore la nature, ne l’imitent plus et ils évitent avec soin la représentation de scènes naturelles observées et reconstituées par l’étude.
La vraisemblance n’a plus aucune importance, car tout est sacrifié par l’artiste aux vérités, aux nécessités d’une nature supérieure qu’il suppose sans la découvrir. Le sujet ne compte plus ou s’il compte c’est à peine.
L’art moderne repousse, généralement, la plupart des moyens de plaire mis en œuvre par les grands artistes des temps passés.
Si le but de la peinture est toujours comme il fut jadis : le plaisir des yeux, on demande désormais à l’amateur d’y trouver un autre plaisir que celui que peut lui procurer aussi bien le spectacle des choses naturelles.
* * *
On s’achemine ainsi vers un art entièrement nouveau, qui sera à la peinture, telle qu’on l’avait envisagée jusqu’ici, ce que la musique est à la littérature.
Ce sera de la peinture pure, de même que la musique est de la littérature pure.
L’amateur de musique éprouve, en entendant un concert, une joie d’un ordre différent de la joie qu’il éprouve en écoutant les bruits naturels comme le murmure d’un ruisseau, le fracas d’un torrent, le sifflement du vent dans une forêt, ou les harmonies du langage humain fondées sur la raison et non sur l’esthétique.
De même, les peintres nouveaux procureront à leurs admirateurs des sensations artistiques uniquement dues à l’harmonie des lumières impaires.
* * *
On connaît l’anecdote d’Apelle et de Protogène qui est dans Pline.
Elle fait bien voir le plaisir esthétique et résultant seulement de cette construction impaire dont j’ai parlé.
Apelle aborde, un jour, dans l’île de Rhodes pour voir les ouvrages de Protogène, qui y demeurait. Celui-ci était absent de son atelier quand Apelle s’y rendit. Une vieille était là qui gardait un grand tableau tout prêt à être peint. Apelle au lieu de laisser son nom, trace sur le tableau un trait si délié qu’on ne pouvait rien voir de mieux venu.
De retour, Protogène apercevant le linéament, reconnut la main d’Apelle, et traça sur le trait un trait d’une autre couleur et plus subtil encore, et, de cette façon, il semblait qu’il y eût trois traits.
Apelle revint encore le lendemain sans rencontrer celui qu’il cherchait et la subtilité du trait qu’il traça ce jour-là désespéra Protogène. Ce tableau causa longtemps l’admiration des connaisseurs qui le regardaient avec autant de plaisir que si, au lieu d’y représenter des traits presque invisibles, on y avait figuré des dieux et des déesses.