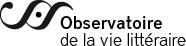Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusqu’à la fin du moyen âge. Tome I : Phèdre et ses anciens imitateurs directs et indirects
Préface de la première édition §
Je me propose de publier, en faisant précéder les textes de leur histoire et de leur critique, tout ce qui reste des œuvres des fabulistes latins antérieurs à la Renaissance. C’est une vaste tâche que personne encore ne s’est imposée, et qui, je le crains du moins, m’expose à être un peu soupçonné de présomption.
Pour me prémunir contre un pareil soupçon, je désire expliquer comment j’ai été conduit à l’assumer.
De tous les auteurs anciens qui guident les premiers pas de l’enfant dans l’étude de la langue latine, Phèdre est celui qui lui laisse les plus agréables souvenirs. Ses fables sont courtes, faciles à comprendre et intéressantes par l’action qui en quelques vers s’y déroule. Plaisir sans fatigue, telle est l’impression qui en reste.
Lorsque, sorti de l’enfance, l’homme lettré, au milieu des luttes de la vie, cherche à se rappeler son premier âge, il est rare qu’il ne trouve pas Phèdre largement mêlé aux travaux qui l’ont rempli.
C’est là ce qui m’est arrivé. Instinctivement, sans m’en rendre compte, me dérobant par moments aux agitations de l’existence {p. VI}positive, j’ai voulu du passé me procurer au moins l’image, et pour cela, à mes heures de loisir, j’ai recommencé à m’exercer sur les fables qui avaient servi de première gymnastique à mon intelligence.
En les traduisant, je remarquai que les divers textes, placés sous mes yeux, différaient beaucoup les uns des autres. Ces différences provenaient-elles des divers manuscrits, isolément suivis par les éditeurs ? Étaient-elles dues au contraire aux écarts variés de leur imagination ? Parmi toutes les éditions, quelle était la bonne ? En existait-il même une qui fût exempte de fautes ? Telles furent les questions qui se formulèrent dans ma pensée, et, quoique ma traduction fût déjà très avancée, je l’interrompis pour chercher le mot de l’énigme.
En le cherchant, j’ai vu qu’il existait plusieurs manuscrits ; j’ai fini par découvrir qu’on en avait connu cinq. Je m’en suis procuré le texte, et, quand je l’ai eu sous les yeux, je n’ai pas tardé à m’apercevoir qu’aucun d’eux ne nous avait conservé dans son intégrité l’œuvre du fabuliste romain.
J’ai essayé, à l’aide des fables de ses imitateurs, de reconstituer son texte perdu, et, pour me les procurer toutes, j’ai visité la plupart des bibliothèques publiques de l’Europe. Copiant moi-même ou faisant copier tous les manuscrits où je rencontrais des collections de fables latines, je me suis ainsi muni de tout ce que, dans cette matière, le moyen âge nous avait laissé, et je me suis en définitive trouvé en possession non seulement des matériaux qui se rapportaient à Phèdre, mais encore de ceux qui lui étaient étrangers. Dès lors je pouvais m’occuper non seulement de lui, mais encore de tous ceux qui, sans le perdre de vue ou sans s’inspirer de lui, s’étaient en grand nombre, au moyen âge, exercés dans la même spécialité littéraire. Ce n’était pas une petite besogne ; mais possédant les éléments nécessaires et craignant que d’autres n’eussent ni la volonté ni la possibilité de les réunir, j’ai considéré comme {p. VII}un devoir de l’accomplir. Bref, ayant étudié tous les fabulistes latins connus et inconnus, j’ai pris le parti de faire profiter le public de mes travaux par une publication qui les comprendrait tous.
Alors s’est forcément posée devant moi la question de savoir quel classement j’allais adopter. Au premier abord, on pensera sans doute que, partant du siècle d’Auguste et ne devant m’arrêter qu’au commencement de la Renaissance, j’aurais dû publier, dans l’ordre de leurs apparitions successives, les œuvres des divers fabulistes latins.
Quoique ce procédé m’eût à première vue paru à moi-même le plus simple et le plus commode, deux raisons m’ont empêché d’y recourir. D’abord je me suis bien vite aperçu qu’il était impraticable ; en effet, il ne faut pas oublier que, parmi les fables que je vais publier, il en est beaucoup qui sont dues à des auteurs anonymes et qu’il est impossible de leur assigner une date même approximative et surtout de savoir, quand rien ne les rattache l’une à l’autre, si telle œuvre est antérieure ou postérieure à telle autre. Ensuite ce qui m’a surtout influencé, c’est que ce procédé, même s’il était praticable, serait incompatible avec une étude véritablement scientifique : il obligerait à ne pas se préoccuper de la filiation des textes et à ne pas les suivre dans le labyrinthe de leurs transformations successives, en un mot, à les examiner isolément.
Sans dédaigner le rang d’ancienneté, je me suis surtout attaché à marcher dans la voie philologique. J’ai bien commencé par m’occuper de Phèdre qui est le premier des fabulistes latins ; mais, après l’avoir étudié, je ne suis pas immédiatement passé à celui qui était le plus ancien après lui ; j’ai préalablement abordé l’étude des fabulistes, qui ont été les imitateurs directs ou indirects de son œuvre.
C’est là, quant à présent, que s’arrête mon ouvrage. Mais je n’ai atteint qu’une première station. Quand, après m’y être suffisamment {p. VIII}reposé, je me remettrai en marche, conciliant l’ordre des temps avec les exigences de la philologie, je porterai mes regards sur le fabuliste qui a été le successeur le plus immédiat de Phèdre, c’est-à-dire sur Avianus ; j’agirai à son égard comme à l’égard de son devancier, et, avant de passer au fabuliste après lui le plus ancien, j’étudierai les imitations de son œuvre, tant en prose qu’en vers, qui nous ont été conservées par de nombreux manuscrits. Ce n’est qu’après, que je me conformerai de nouveau au rang d’ancienneté. En un mot, après avoir étudié un fabuliste, je me demanderai s’il a eu des imitateurs directs ou indirects, et ce n’est qu’après avoir rattaché leurs œuvres à la sienne, que je reviendrai à l’ordre chronologique.
Mais la première étape à laquelle je suis arrivé, fait voir combien la route est longue, et, quoique je me sois mis en mesure de la continuer, j’attendrai, avant de la reprendre, que le public m’ait montré dans quelle mesure il s’intéresse à mon voyage.
Préface de la deuxième édition §
Dans la préface de ma première édition de Phèdre et de ses dérivés directs et indirects, j’ai fait connaître mon intention de ne pas m’en tenir à cette publication et d’exhumer tout ce qui existe encore des œuvres des fabulistes latins antérieurs à la Renaissance.
Cette intention était toutefois subordonnée à l’accueil qui serait fait à mon début. Ayant, pendant de longues années, consacré toute mon activité à l’exercice d’une profession, qui m’avait forcément éloigné des études philologiques, j’étais tout naturellement porté à douter de la valeur de mon œuvre et à craindre pour elle le jugement défavorable, et, qui eût été pis, l’indifférence des véritables érudits.
Ce que j’appréhendais ne s’est pas produit. En France, en Angleterre, en
Allemagne et en Italie, mon livre a été, dans la presse savante, l’objet des appréciations
les plus flatteuses. Parmi les analyses toujours élogieuses qui en furent faites, il y en
eut une à laquelle la compétence exceptionnelle du critique donnait, à mes yeux, un prix
tout particulier : ce fut celle que M. Gaston Paris publia dans les numéros du Journal des {p. X}Savants des mois de décembre 1884 et de
janvier 1885. Dans le second de ces deux numéros, résumant son long et consciencieux
travail, il s’exprimait ainsi : « Ces observations qu’il est du devoir de la
critique de présenter ne doivent pas empêcher de rendre aux mérites de l’auteur
l’hommage le plus sincère. »
Et un peu plus loin il ajoutait : « Il a
réuni des matériaux incomparablement plus riches que ceux qu’on avait amassés avant lui
pour l’histoire de la fable au moyen âge, et il en a souvent tiré très heureusement
parti. Il a procédé partout, il faut le signaler particulièrement, avec la plus entière
bonne foi, reconnaissant toujours ce qu’il devait à ses prédécesseurs, n’exagérant
nullement la valeur de ce qu’il apportait, rendant justice à tous ceux dont il avait à
exposer ou à discuter les opinions. Son ouvrage sera désormais la base de tout ce qu’on
écrira sur le même sujet. Nous voulons surtout espérer qu’il nous donnera bientôt la
suite qu’il nous fait attendre. Un second ouvrage, ayant pour objet Avianus et ses
imitateurs, est presque en état de paraître. L’auteur ne se décidera pourtant à le
publier que si son premier livre rencontre un accueil favorable. Le désintéressement
exceptionnel et le rare dévouement à la science que suppose le travail de M. Hervieux
garantissent assez que ce qu’il attend, ce n’est pas un succès lucratif, auquel ne
saurait prétendre un ouvrage qui a dû coûter si cher à préparer et à publier ; c’est
évidemment l’opinion du public compétent à laquelle il attache du prix. Si le recueil où
nous écrivons peut ajouter assez d’autorité à nos paroles pour qu’elles soient regardées
comme une manifestation de cette opinion, nous serons heureux, en exprimant à
M. Hervieux toute notre estime pour son premier ouvrage, de penser que nous pourrons
contribuer en quelque chose à le déterminer à nous donner bientôt le
second. »
Un tel langage était bien encourageant, et il est probable que si le savant membre de l’Institut l’avait tenu au moment {p. XI}même auquel ce qu’il appelle mon premier ouvrage avait paru, c’est-à-dire au commencement de 1884, je n’aurais pas hésité à me remettre immédiatement à la besogne. Mais, dans l’intervalle, je m’étais engagé dans une autre voie : j’étais entré dans la vie publique, et, pendant six années, mon double mandat de conseiller général de la Seine et de conseiller municipal de Paris, en me prenant mon temps et surtout en changeant le cours de mes pensées, m’a fait suspendre la continuation de mon entreprise.
Mais, suivant un vieux proverbe, on finit toujours par tomber du côté où l’on penche, et, mes goûts littéraires l’emportant, je m’abstins, pour les suivre, de solliciter de mes électeurs en 1890 le renouvellement du mandat qu’ils m’avaient deux fois donné.
En possession de tous les matériaux qui se rapportaient à Avianus et à ses imitateurs, je ne différai plus de les mettre en œuvre. Mais, en les employant, j’étais souvent obligé de me référer à ce que j’avais déjà publié, et ce regard en arrière me fit bientôt apercevoir, dans mes deux premiers volumes, des erreurs qui, pour avoir échappé à la perspicacité des érudits, n’en étaient pas moins réelles et n’en devaient pas moins être rectifiées.
Il me sembla que, si pénible que fût cette tâche, je devais, avant de donner une suite à mon premier travail, en faire paraître une édition nouvelle à laquelle je pusse ensuite, sans regret, rattacher mon étude sur Avianus.
D’ailleurs, d’autres raisons achevèrent de me déterminer.
D’une part, depuis l’apparition de ma première édition, j’avais découvert de nouveaux documents qui la rendaient incomplète et que je désirais ne pas laisser sans emploi.
D’autre part, elle en contenait qu’on pouvait considérer comme n’étant pas dans leur vrai milieu. Pour ne parler que des fables du moine que M. Paul Meyer appelle Eude de Cherrington {p. XII}et de celles des auteurs inconnus que j’avais appelés ses continuateurs, j’avais, en leur donnant asile, éprouvé une hésitation justifiée par le nombre restreint de celles dont les sujets avaient été indirectement tirés de Phèdre. M. Gaston Paris, tout en déclarant qu’il fallait se féliciter de ce que j’eusse compris Eude parmi les imitateurs du fabuliste romain, avait lui-même exprimé un doute sur le point de savoir si, réuni à eux, il se trouvait bien à sa place. Eude, en effet, a rarement emprunté à autrui les sujets de ses fables, et par suite j’ai fini par penser, comme le savant critique, que je devais le distraire des dérivés de Phèdre, pour lui faire, quand son tour serait venu, prendre rang parmi les fabulistes originaux.
Ainsi, indépendamment des corrections, j’avais à faire des additions et des retranchements. À ce point de vue encore, une deuxième édition me parut nécessaire.
En retardant la poursuite de mon entreprise, elle m’empêchera sans doute de l’achever. S’il en est ainsi, j’aurai du moins la consolation d’avoir bien commencé ce que je n’aurai pu finir.
Mais à cette heure, ce n’est pas cette éventualité qui m’inquiète. Je suis dominé par une autre préoccupation : devant la vision plus claire que j’ai maintenant des choses, j’éprouve le très vif regret d’avoir livré au public un premier ouvrage défectueux, et, convaincu que le nouveau donne seul à toutes les questions traitées leur exacte solution, je n’ai plus qu’un désir, qu’en terminant je ressens le besoin d’exprimer, c’est que ceux qui le liront veuillent bien ne pas se souvenir de son devancier.
Étude historique et critique
sur les fables latines de Phèdre et
de ses anciens imitateurs directs et indirects,
Et sur les Manuscrits connus et
inconnus qui les renferment. §
Plan de l’ouvrage. §
L’étude que j’entreprends embrasse un vaste champ de recherches, qui n’a encore été qu’en partie exploré.
Lorsque je l’ai commencée, je me proposais seulement d’en faire la préface de la publication projetée des cinq manuscrits de Phèdre. Mais je n’ai pu me maintenir dans les étroites limites que je m’étais d’abord tracées.
L’œuvre du fabuliste romain ne nous est pas parvenue tout entière. Mais il a eu des imitateurs directs, qui ont mis ses ïambes en prose, et l’on trouve dans leurs imitations des mots et même des lambeaux de vers, qui lui appartiennent et qui, lorsqu’on veut l’étudier sérieusement, ne doivent pas être négligés.
Les imitateurs directs de Phèdre ont à leur tour été imités, et de ces imitations sont nées de nouvelles collections de fables, qui, à défaut de valeur philologique, ont une réelle importance historique et qui, se rattachant de près ou de loin aux imitations primitives, devaient aussi trouver leur place dans un travail véritablement complet.
Amené ainsi à porter mon attention non seulement sur l’œuvre de Phèdre, mais encore sur toutes les œuvres latines qui en ont été l’imitation, j’ai cru devoir diviser mon ouvrage en trois livres consacrés :
Le premier, à l’œuvre de l’auteur primitif ;
Le deuxième, à celles qui, l’ayant suivie pas à pas, peuvent {p. 4}fournir, pour l’amélioration du texte conservé, des leçons utiles, et permettre même dans une certaine mesure la reconstitution du texte égaré ;
Le troisième, à celles qui, indirectement dérivées de la source originaire, s’en écartent trop pour servir à sa restitution, et n’offrent plus d’intérêt que pour l’histoire de la littérature latine au moyen âge.
Livre premier.
Étude sur les fables de Phèdre
et sur les
manuscrits qui les renferment. §
Chapitre premier.
Biographie de Phèdre. §
§ 1. — Circonstances de la vie de Phèdre. §
Ce qu’on sait de la vie de Phèdre se réduit à peu de chose, et cependant il y a peu d’auteurs latins qui aient autant que lui occupé le public de leur personne. Sans cesse il s’interrompt, pour signaler le mal que cherchaient à lui faire des persécuteurs et des envieux plus ou moins hypothétiques, et il faut avouer que, lorsqu’il se met en scène, il tombe dans une prolixité qui contraste avec la concision de ses fables.
Je n’en veux pour exemple que les phrases redondantes, par lesquelles, dans le premier épilogue du livre IV, il prie Particulon de ne pas lui faire attendre la récompense promise et due à sa brièveté. Il est impossible de délayer davantage une idée et de la laisser en même temps plus vague.
Le Père Desbillons1 et, après lui, Schwabe2 et M. Fleutelot3 supposent qu’il sollicite en sa faveur une décision judiciaire {p. 6}longtemps attendue ; c’est une conjecture dont je démontrerai plus loin l’inexactitude.
Mais, si Phèdre s’est beaucoup occupé de lui, aucun de ses contemporains ou du moins de ceux dont les écrits nous sont parvenus, n’a seulement paru se douter de son existence. Aussi ses œuvres sont-elles la source unique à laquelle ont puisé ses biographes. Qu’on ne croie pas pourtant qu’il en soit résulté entre eux une complète harmonie. Sur la vie de l’auteur, comme sur ses œuvres, ils ont émis les opinions les plus divergentes.
1º Véritable nom de Phèdre. — Et d’abord ils n’ont pas même pu se mettre d’accord sur son nom. Je ne parle pas de la traduction française de son nom ; aujourd’hui pour nous il n’y a pas deux manières de l’écrire. Mais quel était son nom latin ? Était-ce Phæder ou Phædrus ? Telle est la première question qui a longtemps divisé les critiques.
Quelle que soit celle des deux formes latines qu’on adopte, il y a un point qui est incontestable, c’est que l’origine de chacune est grecque et que la forme grecque est Φαίδρος. Partant de là, le savant Gude fait observer que les noms grecs, qui ont la même désinence, se terminent en er dans la langue latine. C’est ainsi que des noms grecs Ἀλέξανδρος, Ἀντίπατρος et Σώπατρος on a fait en latin Alexander, Antipater et Sopater4. Après avoir posé le principe, il essaie d’en justifier l’application. Ainsi il rappelle que, dans les Inscriptiones antiquæ de Gruter, publiées à Heidelberg, en 1601 selon Niceron et en 1603 selon Fabricius5, et comprises dans deux volumes, le premier sans date, le second portant le millésime de 1603, on lit, page 1111, nº 3 :
D. PHEDIMO. VESTITORI. MAVGPHAEDER. FRATRI. PIISSIMO
et que lui-même il a dans sa propre collection reproduit cette épigraphe inédite d’une pierre florentine :
RVNCVLANIVS PHAEDER.
{p. 7}Le principe grammatical, posé par Gude, peut
être parfaitement exact ; il faut pourtant reconnaître qu’ici la dérogation n’est
pas douteuse ; dans tous les manuscrits d’Avianus on trouve : Phædrus etiam partem aliquam quinque in libellos resolvit.
Mais ce
qui a tranché indubitablement la question, c’est la publication qu’en 1830 M. Berger
de Xivrey a faite d’un des manuscrits du fabuliste6 : le
prologue du livre III, adressé à Eutyque, y est intitulé Phædrus ad
Eutychum, et dans le livre IV le poète intitule Phædrus les
réflexions que lui suggèrent les attaques de l’envie.
Maintenant je signale, en passant, une hypothèse imaginée encore par Gude, qui suppose que Phèdre reçut son nom d’Auguste7. Cet empereur, on le sait, aimait les belles-lettres, et il se plaisait à donner des noms grecs à ses affranchis et même à ses esclaves. Schwabe fait même observer que, chez ses successeurs, qui pourtant n’avaient pas hérité de ses goûts, cette habitude se maintint, et que Phèdre dédia deux de ses livres à deux affranchis, Eutyque et Philète, dont les noms avaient une étymologie évidemment grecque8.
Mais l’hypothèse de Gude ne me paraît pas trouver ici sa place : Phèdre, étant originaire d’un pays de langue grecque, n’avait pas besoin, pour porter son nom grec, qu’Auguste le lui eût donné. Tout au plus pourrait-on dire que, dans la maison impériale, la forme étrangère de son nom lui avait été conservée et qu’ainsi, au lieu d’être appelé Phæder, il avait été nommé Phædrus.
2º Lieu de naissance de Phèdre. — Le lieu de sa naissance, quelles qu’aient été les divergences d’opinion, ne peut pas être davantage l’objet de la moindre incertitude. Il a soin, dans le prologue du livre III, de l’indiquer en ces termes :
Ego, quem Pierio mater enixa est jugo.
C’est sur le mont Piérus qu’il était né. Il est vrai que plusieurs {p. 8}critiques, parmi lesquels il faut ranger Pagenstecher9, n’ont voulu voir dans ce vers qu’une métaphore poétique ; mais la suite du prologue s’oppose à cette interprétation, qui semble au premier abord assez naturelle. En effet, après avoir parlé d’Ésope le Phrygien et d’Anacharsis le Scythe, Phèdre ajoute :
Ego, litteratæ qui sum propior Græciæ,Cur somno inerti deseram patriæ decus,Threïssa cum gens numeret auctores suos,Linoque Apollo sit parens, Musa Orpheo,Qui saxa cantu movit et domuit feras,Hebrique tenuit impetus dulci mora ?
Ces vers indiquent implicitement quel était le versant du Piérus, sur
lequel il était né ; car ce mont, comme l’Olympe et l’Ossa, était compris dans la
chaîne qui forme la limite de la Thessalie. « Il y a en Thessalie, dit Pline
le naturaliste10, trente-quatre montagnes dont les plus
célèbres sont les Circètes, l’Olympe, le Piérus et l’Ossa. »
Comme la
Thessalie dépendait de la Grèce et que Phèdre se dit né, non pas en Grèce, mais dans
le voisinage, il faut en conclure qu’il avait vu le jour sur le flanc septentrional
de la poétique montagne.
3º Nationalité de Phèdre. — Les critiques étant tombés d’accord pour admettre que Phèdre n’avait pas voulu parler un langage figuré, il semble qu’il n’y avait plus matière à discussion sur sa nationalité. Ils en ont jugé autrement, et, avec une gravité peut-être un peu naïve, ils se sont demandé si Phèdre était Thrace ou Macédonien.
P. Pithou11, Scheffer12 et Gérard Jean Vossius13, se fondant {p. 9}sans doute sur les vers que j’ai cités tout à l’heure, lui donnent la Thrace pour patrie. Mais le Père Desbillons14 et, après lui, Schwabe15, reconnaissant que la face septentrionale du Piérus faisait partie de la Macédoine, font de Phèdre un Macédonien. Ils ne s’en sont pas tenus là : ils ont voulu justifier leur thèse et pour cela ils ont fait appel aux anciens auteurs.
Le Père Desbillons cite d’abord un passage de Strabon, dont voici la
traduction : « La Piérie, l’Olympe, le Pimpla, le Libethrus sont autant de
lieux ou de monts, qui autrefois appartenaient à la Thrace, mais qui aujourd’hui
sont annexés à la Macédoine16. »
Le même critique signale ensuite cette phrase empruntée à Pausanias :
« On dit que dans la suite Piérus Macédonien, celui-là même qui donna son
nom à une montagne de Macédoine, étant venu à Thespies, établit le nombre des neuf
Muses et imposa à toutes les neuf noms qu’elles ont aujourd’hui17. »
Il invoque enfin le langage de Pline le naturaliste, de l’œuvre
duquel il extrait ce membre de phrase : « Phères, derrière laquelle commence
le Piérus qui se prolonge jusqu’en Macédoine18. »
De ces citations il conclut que la Piérie, à l’époque de la naissance de Phèdre, faisait partie de la Macédoine.
Ce premier point établi, le Père Desbillons se demande s’il est {p. 10}bien exact que, dans les vers précités, Phèdre se soit déclaré le compatriote de deux Thraces19.
Suivant lui, si Phèdre avait parlé de la sorte, il aurait tenu un langage inexact. En effet, Diodore de Sicile rapporte qu’Osiris confia à son fils Macédon le gouvernement du pays, qui, à raison de cette circonstance, fut appelé Macédoine20. Or cela se passait avant la naissance de Linus et d’Orphée, qui par conséquent n’avaient pas pu recevoir le jour dans un pays déjà séparé de la Thrace.
Enfin, suivant le Père Desbillons, Phèdre en réalité n’a pas prétendu qu’il était compatriote de Linus et d’Orphée ; les vers en litige ont été mal compris, et il n’a cité les noms de ces deux poètes de la Thrace que pour se justifier, lui né plus près qu’eux de la Grèce, d’être entré dans le sanctuaire des Muses.
Schwabe, qui, en général, se contente de faire un choix dans les opinions de ses devanciers, accepte celle du Père Desbillons : 1º sur l’origine macédonienne de Phèdre ; 2º sur l’interprétation à donner aux vers où il parle de Linus et d’Orphée21.
Pour fournir sur le premier point de nouveaux documents, il n’ajoute aux citations précédentes que deux témoignages assez insignifiants, tirés, l’un de Pomponius Mela, qui dit que c’est en Macédoine qu’est la Piérie, mère et séjour des Muses22, l’autre de Cellarius, qui en fait également une région de la Macédoine23. Je ne m’y arrête pas.
{p. 11}En ce qui touche le deuxième point, il pense, comme le Père Desbillons, que Phèdre a voulu dire que Linus et Orphée, nés en Thrace, n’étaient pas autant que lui voisins de la Grèce.
Je pourrais maintenant analyser la savante dissertation, par laquelle Jannelli, dans son édition des nouvelles fables de Phèdre24, a essayé à son tour de résoudre le même problème. Mais ce serait vraiment trop prolonger l’examen d’un point qui ne comporte pas une si longue discussion.
Je me bornerai, pour la clore, à exprimer brièvement ma pensée. Il est évident que Phèdre était Macédonien d’origine, et je veux bien admettre avec le Père Desbillons et avec Schwabe que Linus et Orphée avaient pu naître dans la partie de la Thrace restée en dehors de la Macédoine. Mais ce que je ne puis comprendre, c’est que, pour soutenir cette thèse, ils aient si fort dénaturé le sens des vers de Phèdre. Oui, ces vers offrent une antithèse ; mais elle n’existe pas entre Phèdre, poète macédonien, et Linus et Orphée, poètes thraces ; elle existe entre Phèdre, poète macédonien, d’une part, et d’autre part Ésope le Phrygien et Anacharsis le Scythe. C’est à eux qu’il fait allusion, quand il dit qu’il est né plus près de la Grèce, et il ajoute que son pays plus voisin du foyer des lettres a vu naître Linus et Orphée. Qu’on lise toute la période qui renferme cette pensée, et il ne restera aucun doute ; voici comment, dans la traduction que j’en ai faite, j’ai moi-même été forcé de la rendre :
Le Phrygien Ésope, Anacharsis le ScytheRendirent immortels leurs noms par leur mérite ;Et moi, plus près des Grecs, dans ma lâche torpeur,De mon pays lettré je trahirais l’honneur,Quand la Thrace parmi ses poètes accuseLinus, fils d’Apollon, et ce fils d’une Muse,Qui charma les rochers et les bêtes des boisEt de l’Hèbre emporté retint l’onde à sa voix25 !
Mais, objectera-t-on, comment se fait-il que Phèdre, né en Macédoine, {p. 12}ait pu se dire le compatriote des poètes, dont il fait lui-même honneur à la Thrace ? La réponse est faite par les textes que le Père Desbillons a pris lui-même la peine de citer, et notamment par le passage fort net de Strabon qui déclare que la Macédoine s’est formée du démembrement de la Thrace. Avant d’être géographe, Phèdre était poète. Si le mont Piérus n’était plus dans la Thrace, il en avait fait partie, et à ce titre on ne doit pas s’étonner qu’il se soit considéré comme le compatriote de Linus et d’Orphée.
4º Époque de l’arrivée de Phèdre à Rome. — Après avoir fait connaître le vrai nom du fabuliste, le lieu de sa naissance et sa nationalité, j’aurais à indiquer la date à laquelle il était né. Mais sur ce point les documents font défaut, et c’est à peine si elle pourrait être approximativement fixée.
Il a été également impossible de savoir s’il était né dans l’esclavage, ou si, né libre, il y était ensuite tombé.
Il en a été enfin de même pour la détermination de l’époque, à laquelle il arriva à Rome. Scheffer, son illustre biographe, et presque tous les critiques qui l’ont suivi, jusqu’au père Brotier lui-même, se sont rappelé que, suivant Suétone26, Octave, père d’Auguste, étant préteur en Macédoine, avait fait la guerre aux Besses et aux Thraces et les avait complètement battus. Ils ont, sans l’affirmer, supposé que Phèdre était au nombre des prisonniers, et que c’était ainsi qu’il était devenu esclave. Mais, ils ont oublié que, l’année où ces peuples furent vaincus, César était consul à Rome et Quintus Cicéron proconsul en Asie ; or, si jeune qu’eût alors été Phèdre, il faudrait admettre que, lorsqu’il composa ses premiers livres, il était déjà âgé de près de quatre-vingt-dix ans, et l’on me concédera, je l’espère, que ce n’est pas à un pareil âge qu’un homme peut s’apercevoir pour la première fois de son génie poétique.
Dans l’ignorance, où Scheffer pouvait être, de la date à laquelle les Besses et les Thraces avaient été battus, je m’explique son hypothèse erronée ; mais j’avoue que je ne puis comprendre comment le Père Brotier a pu l’accepter, au moment même où il faisait observer que la victoire d’Octave remonte à l’année 694 de la fondation de Rome, c’est-à-dire à une époque de soixante ans antérieure à l’ère chrétienne.
{p. 13}Aussi, réfléchissant davantage, Fabricius avait-il rejeté l’hypothèse de Scheffer.
Le Père Desbillons comprit également qu’elle était inadmissible. Pour la combattre plus victorieusement, il cite cette phrase empruntée à l’épilogue de la première partie du livre IV :
Olim senio debilemFrustra adjuvare bonitas nitetur tua.
Il lui semble résulter du mot olim que, lorsque Phèdre parlait ainsi, il était encore loin de la vieillesse. Mais c’est inutilement, je crois, donner de ce mot une interprétation fausse, que combat la phrase précédente :
Languentis ævi dum sunt aliquæ reliquiæ,Auxilio locus est.
On doit donc admettre qu’il était déjà bien avancé en âge. Mais alors, ainsi que je l’établirai, régnait l’empereur Claude, et Phèdre, si vieux qu’il fût, ne pouvait l’être assez pour avoir existé à l’époque de la victoire remportée sur les Thraces et les Besses.
En définitive, il est impossible de dire d’où lui venait sa position d’esclave et quels événements l’avaient amené à Rome.
Ce que l’on peut seulement affirmer, c’est qu’il y avait été conduit bien jeune. On trouve dans ses écrits la preuve qu’il n’était pas encore entré dans l’âge adulte. À la fin du premier épilogue du livre IV, il dit qu’il a toujours eu soin de se rappeler ce vers du Télèphe d’Ennius qu’il avait lu dans son enfance :
Palam muti re plebeio piaculum est.
Il est vraisemblable qu’il n’avait pu le lire qu’à Rome.
Mais il y a quelque chose de plus concluant que cette citation, c’est son œuvre tout entière. N’est-il pas hors de doute qu’un étranger, qui ne se serait pas, comme lui, appliqué de bonne heure à l’étude de la langue latine, n’aurait pu en faire un si habile usage ?
Il ne faut toutefois rien exagérer. Je démontrerai plus loin que, si, lors de son arrivée à Rome, il n’était encore qu’un enfant, il était déjà parvenu à un âge voisin de l’adolescence.
{p. 14}5º Séjour de Phèdre chez Auguste et son affranchissement. — Reconnaissant probablement en lui une intelligence exceptionnelle, Auguste, à qui il avait été vendu, fit ajouter à son instruction grecque l’enseignement des lettres latines, et, couronnant dignement son œuvre, lui donna la liberté. Certains savants ont voulu attribuer son affranchissement à Tibère. Mais leur opinion est en contradiction avec le texte même de ses fables qui parlent de l’un et de l’autre de ces deux empereurs.
Dans la célèbre fable du livre II, où il montre l’esclave obséquieux, qui, à force d’empressement, cherche à obtenir de Tibère les soufflets de la liberté, quel nom donne-t-il à l’empereur ? Dans le titre il l’appelle Cæsar, et, dans le texte même, Cæsar Tiberius, puis Cæsar, puis Dux, jamais Augustus.
Au contraire, ce dernier nom est le seul par lequel il désigne Octave. Lorsque, dans la fable x du livre III, il parle d’un procès soumis par les plaideurs au jugement de cet empereur, il s’exprime ainsi :
A Divo Augusto tunc petiere judices.
Quand donc, en tête de son œuvre, il prend lui-même la qualité d’affranchi d’Auguste, il faut reconnaître que c’est d’Octave qu’il entend parler.
Dira-t-on que la qualité, qui, en tête de ses fables, a été ajoutée à son nom, peut avoir été inventée par les copistes, auxquels nous devons ses manuscrits ?
Je répondrai que leur ignorance rend cette hypothèse invraisemblable.
Mais admettons-la un instant ; il sera encore facile d’arriver à la même démonstration. Le procès dont il parle, il en a eu personnellement connaissance :
Narrabo tibi memoria quod factum est mea.
Est-il supposable qu’il en aurait été instruit, lui qui ne s’occupait que de littérature, s’il n’avait pas lui-même vécu dans le palais impérial d’Auguste ?
Remarquons enfin, avec le Père Desbillons, que Phèdre dut son affranchissement à l’élévation et à la culture de son esprit, {p. 15}c’est-à-dire à des qualités qui, sous le règne de Tibère, n’auraient été utiles à personne, et qui, pendant la vie de Séjan, auraient pu même être fort dangereuses.
6º Causes qui ont fait de Phèdre un fabuliste. — Tant qu’Auguste vécut, Phèdre, malgré son goût pour les lettres, s’abstint de s’y livrer. Indécis devant les différents genres qui s’offraient à lui, il n’avait fait aucun choix. S’il fallait en croire Scheffer, ce serait le désir de la vengeance qui aurait mis fin à son incertitude. Après la mort d’Auguste, son dévouement à la famille de son bienfaiteur lui aurait attiré la haine de Séjan, et il n’aurait écrit ses apologues que pour rendre à son persécuteur le mal pour le mal.
Je ne saurais partager entièrement l’opinion de Scheffer. Phèdre, en se faisant fabuliste, n’avait pas cédé à des idées de vengeance. Ses écrits prouvent qu’il avait des aspirations plus nobles.
L’abaissement des esprits, préparé par l’absolutisme d’Auguste, avait, sous l’odieux gouvernement de Tibère, pris des proportions qui l’avaient ému, et il avait voulu, sans désigner personne, lutter contre une dégradation morale qui devenait chaque jour plus grande.
En entrant dans cette voie, il avait cherché à en supprimer les périls, et, comme il le déclare lui-même, il avait été ainsi conduit à recourir au genre de littérature le plus propre à soustraire le moraliste aux accusations calomnieuses :
Calumniamque fictis elusit jocis.
Quant à des attaques personnelles couvertes du voile de l’apologue, il n’y avait pas songé. Mais prévoyant que ses contemporains pourraient lui attribuer cette intention, que, bien des siècles plus tard, les critiques devaient être portés à lui imputer, il a, dans le prologue de son livre III, eu le soin d’expliquer sa pensée en ces termes :
Neque enim notare singulos mens est mihi,Verum ipsam vitam et mores hominum ostendere.
En somme, il déclare lui-même qu’il s’est abstenu de toute personnalité, et rien n’autorise sur ce point à suspecter sa bonne foi et à voir dans sa déclaration une précaution habile.
{p. 16}Il n’en est pas moins vrai qu’il fut persécuté par Séjan. C’est, puisqu’il l’affirme, un point qu’on ne saurait contester. Mais pourquoi en fut-il ainsi ?
Tacite et Suétone nous montrent les riches constamment accusés par
Séjan et souvent condamnés et dépouillés. Mais on ne peut supposer que, dans les
poursuites qu’il dirigeait contre Phèdre, le ministre de Tibère était mû par le
désir de s’emparer de ses biens. Car, à l’époque où il était traduit en justice, le
fabuliste, dans le prologue de son livre III, écrivait « qu’il avait déraciné
de son cœur l’envie d’amasser du bien »
:
Curamque habendi penitus corde eraserim.
Et plus tard, dans la fable iv du livre V, resté à la fin de sa longue carrière aussi pauvre qu’au commencement, il s’exprimait encore ainsi :
Periculosum semper reputavi lucrum.
La richesse ayant été étrangère à ses malheurs, il faut leur attribuer une autre source, et il n’y a pas de longs efforts à faire pour la découvrir ; car Phèdre lui-même l’indique en ces termes :
In calamitatem deligens quædam meam.
Il suffit, pour la connaître, de bien comprendre ce vers.
Dans la plus ancienne des traductions françaises, publiée en 164727, Isaac Le Maître de Sacy l’a rendu par ce membre de phrase :
« Choisissant quelques sujets pour y peindre mon
infortune. »
Il y avait là un contre-sens. En effet, pour que cette
interprétation fût exacte, il aurait fallu, ce qui d’ailleurs n’aurait pas rendu le
vers faux, que Phèdre eût écrit, non In calamitatem, mais In calamitate. L’erreur du traducteur français n’avait pas échappé
au savant Pierre Burmann, qui, par une note insérée dans sa magnifique édition in-4,
de 172728, avait
eu soin de la signaler et de restituer le véritable {p. 17}sens.
Mais il est vraisemblable que la note de Pierre Burmann ne fut pas aperçue des
traducteurs postérieurs, qui tour à tour firent confiance à leur devancier29, et
moi-même, dans ma traduction littérale en vers libres publiée en 188130,
quoique ayant l’intuition de leur erreur, je ne m’étais pas cru l’autorité
nécessaire pour me permettre de me séparer d’eux. Aujourd’hui, ma conviction
l’emportant sur tout autre sentiment, je n’hésite plus à confesser que, pour donner
au vers de Phèdre son vrai sens, il faut le traduire ainsi : « Adoptant
certains sujets pour mon malheur. »
Si l’on accepte ce sens, il faut admettre qu’il déclare que ce sont ses écrits qui lui valurent les poursuites dirigées contre lui. Et cela {p. 18}ne doit pas sembler étonnant : quoiqu’il n’eût pas eu l’intention d’attaquer Séjan, ce dernier, connaissant l’attachement du fabuliste à la famille d’Auguste et croyant dès lors avoir en lui un ennemi, avait été porté à voir des attaques personnelles dans certaines fables où il pouvait se reconnaître, mais où pourtant il n’avait pas été particulièrement visé.
Il faut en définitive en arriver à cette conclusion que ce n’est pas, contrairement à l’avis de Scheffer, le besoin de rendre le mal pour le mal qui inspira à Phèdre ses fables, mais que ce sont elles, qui, quoique étrangères à tout mauvais sentiment, lui valurent son adversité.
Dois-je maintenant rechercher quelles sont celles dans lesquelles Séjan avait cru deviner des allusions hostiles ? Cela me semble fort dénué d’intérêt ; car sur ce point on ne peut que formuler des hypothèses très incertaines. Pour la plupart les critiques, ainsi que nous le verrons plus loin, ont pensé que c’étaient les fables i, ii et iv du livre I qui avaient éveillé les susceptibilités de Séjan. Je ne partage pas cette opinion, et je crois qu’aucune des fables qui l’avaient irrité, ne nous est connue. Soit que le procès par lui intenté ait abouti à un jugement qui en ordonnait la suppression, soit que, pour s’épargner de nouveaux ennuis, Phèdre ait trouvé bon de ne pas les maintenir dans ses œuvres, il me semble probable que, de son temps même, les scribes ont dû cesser de les faire figurer dans leurs copies. Cette manière de voir n’est pas dénuée de point d’appui. Puisque c’est dans le prologue du livre III qu’il se plaint du procès que Séjan lui intente, il est certain que ce sont ses deux premiers livres qui devaient renfermer les fables incriminées ; or, dans le même prologue, il prétend avoir du sentier d’Ésope fait une route :
Ego illius pro semita feci viam,
et, si démesurée que puisse être cette prétention, quand on songe que le deuxième livre ne comprend que huit fables, on reste convaincu qu’il ne nous est pas entièrement parvenu.
Il est vrai que ce deuxième livre n’est pas le seul qui soit incomplet, et que les livres IV et V offrent aussi des lacunes évidentes. Mais ce qui est significatif, c’est qu’en ce qui touche le livre II rien dans les manuscrits de Pithou et de Reims ne permet de supposer {p. 19}qu’elles soient dues aux copistes du moyen âge, tandis qu’il ressort des lambeaux de fables que présentent les mêmes manuscrits, que c’est bien au moyen âge que les livres IV et V ont été en partie perdus.
En somme, ce qui résulte des propres déclarations de Phèdre, c’est qu’en se faisant fabuliste, il n’avait agi sous l’influence d’aucun sentiment d’animosité personnelle et qu’il avait été guidé par l’unique désir de signaler et de guérir les plaies morales de l’humanité.
Et maintenant, qu’on me permette, avant de passer à un autre ordre d’idées, d’ajouter une dernière observation. Phèdre dit bien que, s’il a opté pour la fable, c’est qu’étant donné son.but elle en rendait pour lui la réalisation moins dangereuse. Or, d’autres moralistes romains avaient dû avoir la même préoccupation que lui, et cependant aucun n’avait songé à recourir au même préservatif. Pourquoi seul y avait-il pensé ? La question me semble facile à résoudre.
Si, lorsqu’il avait été amené à Rome, il était encore enfant, il n’était plus en bas âge ; il possédait déjà trop bien pour l’oublier la langue de son pays natal, et, la possédant, il avait pu dans le palais impérial, en même temps qu’il apprenait la langue latine, acquérir aisément une connaissance approfondie de l’histoire et de la littérature de la Grèce.
Tout dans son œuvre montre avec quel soin il avait étudié les hommes et les choses de ce pays. Quel autre fabuliste, à moins d’être Grec lui-même, eût fait, comme lui, intervenir les grands personnages de l’antiquité grecque, tels que Linus et Orphée31, Simonide32, Pisistrate33, Anacharsis34, Démétrius de Phalère et Ménandre35, Socrate36, Myron et Praxitèle37 ? Quel autre eût placé à Athènes38, à Clazomène39, dans l’île de Céos40, {p. 20}c’est-à-dire en Grèce et dans les pays voisins les scènes de ses apologues ? Quel autre enfin, en nous révélant la vieille légende relative au Castor41, eût pu, comme lui, signaler au passage un des défauts particuliers à la race grecque ?
En définitive, il ressort de son œuvre elle-même, que, si, pour assurer sa sécurité, il avait eu recours à un genre de littérature inusité à Rome, c’est qu’à raison même de son origine il était tout particulièrement initié aux vieilles traditions ésopiques.
7º Dates de la composition et de la publication des fables de Phèdre. — Reste la question de savoir à quelle époque il écrivit et publia ses cinq livres.
L’opinion la plus généralement admise par les critiques, c’est qu’aucun des cinq livres de Phèdre ne fut écrit ou au moins publié pendant la vie de Tibère. Croyant y trouver des attaques dirigées contre Séjan, et songeant à l’abominable réputation que l’histoire avait faite à ce dernier, ils en ont conclu que le ministre de Tibère, attaqué par Phèdre, ne lui aurait pas fait grâce, et l’on ne voit pas qu’en définitive le fabuliste ait eu beaucoup à souffrir de ses accusations.
Gude, par cette manière de voir, est porté à penser que les fables ne furent publiées qu’après la mort de Tibère, pendant la vie duquel Phèdre n’aurait osé y mettre son nom ; il voit dans les fables i et vi du livre Ier de mordantes personnalités. Seulement il prétend qu’elles n’avaient pas trait à Séjan, et qu’elles se rapportaient à l’époque de Caligula, contre qui elles auraient été dirigées42.
Burmann, tout en reconnaissant que Phèdre a vécu sous le règne de Tibère, croit pouvoir induire du premier épilogue du livre IV et de la dernière fable du livre V, qu’il n’a composé ses fables qu’à un âge très avancé43.
Cannegieter suppose que, sous le nom de Séjan, c’est Narcisse qu’il a voulu stigmatiser. Il ajoute que l’époque de Claude se prêtait mieux qu’aucune autre aux licences qu’il voulait se permettre et que la fable Ranæ regem petentes s’applique admirablement à ce {p. 21}prince patient et stupide, qui, au Forum et dans les autres lieux publics, tolérait toute espèce d’injures44.
Sax, précisant davantage, n’hésite pas à dire que c’est au milieu du règne de cet empereur que Phèdre écrivit toutes ses fables, et, donnant une date à leur publication, il leur assigne l’année 48 après J.-C.45.
Quant au Père Desbillons, il n’ose pas fixer une date à l’ouvrage de Phèdre46. Il affirme seulement que les deux fables Ranæ ad Solem et Ranæ regem petentes furent non seulement écrites, mais encore connues avant la chute de Séjan.
Il croit que la première était dirigée contre ce dernier et la seconde à la fois contre son maître et contre Caligula.
Suivant lui, la fable Ranæ ad Solem fut une satire transparente de la conduite criminelle de Séjan. Le ministre de Tibère avait aspiré à la main de Livia Livilla, sœur de Germanicus et femme de Drusus, et pour cela, après avoir consommé l’adultère avec elle, l’avait vivement engagée à s’affranchir de son mari par le poison. Tous deux avaient nourri l’espoir de faire disparaître ainsi l’obstacle qui s’opposait à leur union. Phèdre, par les Grenouilles, dont le Soleil desséchait les marais et qui, pour empêcher son mariage, s’adressaient à Jupiter, aurait voulu désigner les familles romaines, que Séjan accablait de charges et qui recouraient à l’empereur pour entraver ses projets.
Dans la deuxième fable, le Père Desbillons croyait que, par le soliveau, Phèdre avait désigné Tibère, qui, pour mieux se soustraire au fardeau des affaires publiques, s’était lâchement retiré sur un rocher du golfe de Naples, et dans l’hydre il pensait reconnaître Caligula, dont l’empereur se proposait de faire pour les Romains un véritable serpent.
Comme le Père Desbillons, Schwabe n’hésite pas à voir dans la fable Ranæ regem petentes une allusion satirique au gouvernement de Tibère. Seulement il croit qu’il n’était pas désigné par le soliveau, {p. 22}et qu’à raison de sa cruauté, c’était l’hydre qui devait le désigner47.
Mais je ne m’arrête pas à cette petite divergence d’opinion, et je reviens au Père Desbillons. Suivant lui, la première de ces deux fables avait exaspéré Séjan, qui s’y était reconnu. Aussi, la seconde, quoique communiquée confidentiellement à quelques amis, étant parvenue à sa connaissance, s’était-il aussitôt emparé de l’occasion qu’elle lui fournissait de se venger. Tibère s’était déjà, pour n’en plus revenir, retiré dans l’île de Caprée ; le favori, seul maître à Rome, avait profité de sa toute-puissance pour accuser Phèdre de lèse-majesté.
Le Père Desbillons considérait donc les fables ii et vi du livre Ier comme écrites et connues sous le règne de Tibère ; il paraît admettre aussi que ce ne furent pas les seules et que d’autres fables valurent à la même époque de pareils ennuis à leur auteur. Mais il ne fixe aucune date à l’apparition de son œuvre, et il pense que, lorsque Phèdre parvint à la vieillesse, il ne songea qu’au repos et ne s’occupa pas de la publier.
Après avoir analysé les diverses opinions des critiques, je vais maintenant formuler la mienne.
Ne nous occupons d’abord que des deux premiers livres.
Ce qui avait en général empêché les critiques d’admettre qu’ils eussent été publiés ou seulement écrits sous Tibère, c’est qu’ils y avaient vu des allusions que Phèdre à cette époque n’aurait pu, suivant eux, impunément se permettre. Mais ces allusions n’ont existé que dans leur imagination. Phèdre n’avait pas eu l’intention de fustiger Séjan, et dès lors, sous l’administration de ce dernier, il avait pu, sans rien craindre, non seulement écrire, mais encore publier ses deux premiers livres.
Quoi qu’il en soit, si leur publication offrait un danger, il est certain qu’il s’y était exposé. En effet, quand on le voit, dans le prologue de son livre III, déclarer d’une part qu’il a pour son malheur adopté certains sujets, et d’autre part se plaindre, non d’avoir été, mais d’être poursuivi par le ministre de Tibère, on ne peut conserver aucun doute sur l’époque de l’apparition de ses deux premiers livres.
{p. 23}Voilà, je crois, la vérité ; c’est faute de l’avoir ainsi envisagée, que beaucoup de savants ont renvoyé à une époque postérieure leur publication.
Je passe au troisième. Comme les deux premiers, ce fut encore au public qu’il le destina. Le prologue en fournit partout la preuve. Il avait embrassé la carrière littéraire ; il s’y était livré tout entier ; il avait accepté cette pauvreté qui en était déjà l’apanage ; il n’avait pu qu’à force de travail et de patience se faire classer parmi les hommes de lettres :
Quamvis in ipsa pene sim natus Schola,Curamque habendi penitus corde eraserim,Et laude multa vitam in hanc incubuerim,Fastidiose tamen in cœtum recipior.
Il ne pouvait, après tant de sacrifices, consentir à rester ignoré, et, si l’amour du bien inspirait ses écrits, il n’en désirait pas moins que l’immortalité en fût la récompense. Il ne dissimule pas avec une fausse modestie cette idée qui le domine, il l’exprime même avec cette franchise naïve qui lui est familière :
Ergo hinc abesto, Livor ; ne frustra gemas,Quoniam mihi solemnis debetur gloria.
Les deux premiers livres n’avaient sans doute pas eu la faveur qu’il aurait désirée. Pour lui assurer un succès plus grand, il dédie le troisième à un affranchi riche et puissant, Eutyque, dont il paie en monnaie de flatterie le service espéré de lui :
Librum exarabo tertium Æsopi stylo,Honori et meritis dedicans illum tuis.
Quelle époque faut-il assigner à la composition de ce troisième livre ? Si l’on s’en tient aux termes du prologue, l’incertitude n’est pas possible : Tibère vivait encore. Lorsqu’en effet Phèdre se plaint d’avoir Séjan pour accusateur, pour témoin et pour juge, il ne parle pas d’un fait accompli ; il s’exprime ainsi :
Quod si accusator alius Sejano foret,Dignum faterer esse me tantis malis.
{p. 24}Il n’emploie pas le plus-que-parfait fuisset ; il se sert de l’imparfait foret qui indique qu’il est encore en butte à des poursuites et que sa condamnation n’a pas encore été prononcée.
Je crois, pour moi, qu’à défaut de documents contraires, le plus sage parti est de s’en rapporter à Phèdre lui-même.
Schwabe incline vers le même avis ; mais ce qui semble l’embarrasser, c’est le témoignage de l’historien F. Josèphe, qui, ainsi que Sax le fait observer, mentionne, dans le chapitre IV de son livre XIX sur les antiquités juives, un certain Eutyque et en fait un opulent affranchi de Caligula. Pour tout concilier, il suppose que le troisième livre commencé sous Tibère ne fut achevé que pendant le règne de son successeur.
S’il y avait regardé de plus près, Schwabe aurait compris que
l’affranchi de Caligula n’avait eu aucune relation avec Phèdre. Dans le chapitre
précité, F. Josèphe cite bien un affranchi dévoué à cet empereur ; mais voici le
portrait qu’il en fait : « Erat enim hic Eutychus, agitator prasinus, Caio et
militibus circa solemnitates circensium et seditiones atque opera inhonesta
devotus48. »
S’appuyant sans doute sur cette phrase, Chr. Wase en a fait un affranchi, qui jouissait d’une grande fortune et d’un grand crédit à la cour de Caligula49. Mais rien n’autorise Wase à être si affirmatif.
Dans le chapitre XIII du livre XVIII50, F. Josèphe parle bien encore d’un autre Eutyque, affranchi d’Agrippa, dont il était même resté le cocher ; mais quel cocher ? un mauvais drôle, un voleur, qui, après avoir dérobé des vêtements à son maître, se voyant arrêté, l’avait dénoncé à Tibère comme un conspirateur pour se soustraire à ses poursuites. Il est encore moins probable que le vertueux Phèdre ait eu pour protecteur un pareil homme. J’ajoute que, si l’on admettait cette supposition invraisemblable, on devrait encore nécessairement reporter à l’époque de Tibère la composition du troisième livre.
{p. 25}Gude d’ailleurs signale beaucoup d’autres affranchis, appelés tantôt Eutychus comme l’ami de Phèdre, tantôt Eutyches avec la désinence grecque. Ainsi notamment il cite, en la tirant de sa collection épigraphique, cette inscription :
TI. CLAVDIVS. EVTYCHVS51,
qui est relative à un affranchi de Claude, et, en la puisant dans les Inscriptiones antiquæ de Gruter52, cette autre :
ISID. REG.L. PVBLICIVS. EVTYCHESMVN. TAR. LIB.
c’est-à-dire Municipii Tarsensis libertus. Je dois en outre signaler, dans l’ouvrage de Gruter, cette inscription trouvée dans le couvent bénédictin de Capoue :
EVTICHVS. VILLICA PLVMBOEVAGOGVS. A. F : : : : : : : : : :FECERVNT. SIBI. ET. SVIS53,
et cette autre, qui est encore, comme celle conservée par Gude, relative à un affranchi de Claude :
TI. CL. EVTYCHE. TI. FQVI. VIXIT. ANNO. VNOM. VII. D. XXVIII. CLAVDIVSEVTYCHES. FILIODVLCISSIMO54.
Mais aucun des affranchis, dont il est question dans ces inscriptions, ne me paraît être celui dont nous cherchons la trace ; je la verrais plutôt dans celle que le Père Brotier55 emprunte à Bianchini, {p. 26}et qui, placée sur la tombe d’affranchis et d’esclaves d’Auguste, était ainsi conçue :
C. JVLI VTYCHIET QVINTILLIAES AVRAESIMMVNIVM.
C’est aussi judicieusement que Rigault cite une inscription romaine ainsi conçue :
EVTICHVS. AVG. LIB.MERONIANVS. MEDICVSLVDI. MATVTINI56.
Enfin j’ai fait moi-même, dans les recueils spéciaux, des recherches qui ne sont pas restées sans résultat, et j’ai notamment rencontré deux inscriptions se rapportant à deux affranchis qui sont nommés l’un Eutychus et l’autre Eutyches et dont l’un pourrait bien être l’opulent ami de Phèdre. Voici la première :
DIVO. AVGVSTOC. ARRIVS. OPTATVSC. IVLIVS. EVTYCHVSAVGVSTALES57.
La seconde, recueillie par Jean-Baptiste Doni, est ainsi conçue :
D. MEVTYCHES. AVG. LIB. CVBICVLARIVS. HELLADIO. AVG. LIB.DECVRIONI. CVBICVLARIORVMPATRI. DVLCISSIMO. BENEMERENTI. ET. SIBI. ET. CONIVGI. ET. LIBERTISLIBERTABVSQ. POSTERISQVEEORVM58.
{p. 27}Il est en effet bien plus naturel de supposer que Phèdre ait dédié son troisième livre à un affranchi, dont il avait partagé le sort dans le palais d’Auguste, et dont il avait dû, pendant leur commun esclavage, se concilier la sincère affection. Cet affranchi, entré dans une carrière moins ingrate que la sienne, avait pu, pendant la vie de Tibère, devenir riche et puissant, et l’on conçoit que Phèdre, se croyant poursuivi par Séjan, ait pu, avant même d’avoir été condamné, lui adresser le troisième livre de ses fables.
Dira-t-on que tout cela n’explique pas comment, dans le prologue de son troisième livre, Phèdre, au moment même où Séjan l’appelait en justice, a osé stigmatiser son redoutable ennemi ? C’est juste ; mais l’explication me semble facile à donner. Si le vindicatif favori de Tibère avait pu connaître le prologue du livre III, Eutyque aurait été impuissant à protéger son ami ; mais, si le troisième livre avait, comme les deux premiers, été destiné à la publicité, le prologue n’en avait été sans doute adressé qu’à lui, et Phèdre avait pu y laisser échapper des plaintes même amères, sans s’exposer à aucunes représailles.
Je me hâte de passer aux deux derniers livres. Il dédia le quatrième à l’homme qui paraît avoir été son principal protecteur ; j’ai nommé Particulon.
Il est à croire que, comme Eutyque, Particulon était un affranchi, et, si ce fut un affranchi, il est probable que ce fut à Claude qu’il dut la liberté ; car l’appui que Phèdre lui demande, montre qu’il le considère comme un personnage influent, et l’on sait que l’époque de Claude fut pour les affranchis le temps de leur vraie puissance.
Phèdre, depuis longtemps, n’avait plus à redouter la colère de Séjan disgracié et mis à mort. Mais il n’était pas pour cela exempt de craintes. Seulement il ne faut s’y tromper : ce qu’il craignait, ce n’étaient pas les hommes dont la conscience n’était pas pure et qui pouvaient voir dans ses fables un importun et permanent reproche, et, dans leur colère, essayer de se venger de lui. Il est même supposable que les puissants de son époque ne s’inquiétaient pas beaucoup de ses œuvres. Mais ce qui le préoccupait sans relâche, c’était la jalousie que son talent devait inspirer, et c’était surtout pour contre-balancer les critiques des envieux, qu’il recherchait l’appui des gens respectés.
{p. 28}Cette préoccupation, il l’avait déjà laissé apparaître dans l’épilogue de son livre II, quand il avait écrit :
Si livor obtrectare curam voluerit,Non tamen eripiet laudis conscientiam,
et plus loin :
Sin autem ab illis doctus occurrit labor,Sinistra quos in lucem natura extulit,Nec quidquam possunt nisi meliores carpere,Fatale exitium corde durato feram.
Il avait encore obéi à la même pensée, quand il s’était écrié dans le prologue de son livre III, adressé à Eutyque :
Ergo hinc abesto, Livor !
Il en faut, selon moi, conclure que, dans le premier épilogue du livre IV, c’était surtout contre les envieux réels ou imaginaires qu’il invoquait ainsi le secours de Particulon :
Sæpe impetravit veniam confessus reus :Quanto innocenti justius debet dari !Tuæ sunt partes ; fuerunt aliorum prius ;Dein simili gyro venient aliorum vices.Decerne quod religio, quod patitur fides,Et gratulari me fac judicio tuo.
Le Père Desbillons pense qu’il s’agit ici d’un procès, soumis à la décision d’un magistrat, dont Phèdre aurait omis le nom59. Mais, tout en engageant instamment le lecteur à prendre garde de se tromper, il tombe lui-même dans une fâcheuse erreur, qu’il a été entraîné à commettre par la fausse division qu’il a faite des cinq livres de Phèdre. Il a cru que c’était, non le quatrième livre, mais le cinquième, qui était dédié à Particulon.
Pour se fourvoyer à ce point, il avait été obligé d’abord d’altérer ce vers :
Quartum libellum dum Variæ perleges,
{p. 29}et de substituer quintum à quartum, ensuite de ne tenir aucun compte de l’affranchi Philète, dont le nom figure pourtant à la fin de la dernière fable du livre V.
Après avoir ainsi accommodé le texte à sa guise, il a donné carrière à son imagination, et vu, dans les vers cités plus haut, les sollicitations d’un accusé qui demande à son juge une sentence favorable.
La fausseté de son hypothèse aurait dû lui être démontrée par ce vers du même épilogue :
Brevitati nostræ præmium ut reddas peto.
Mais il le passe sous silence. Ainsi que je l’ai déjà dit, Schwabe et M. Fleutelot n’en ont pas moins accepté son avis.
Quant à moi, d’accord avec Hoogstraten60, je le prétends inadmissible. Dans l’épilogue qu’il adresse bien à Particulon, et non pas à un juge, Phèdre réclame la récompense promise à sa brièveté, et l’on me concédera, je l’espère, qu’il n’est pas naturel que cette récompense doive consister dans une bonne décision judiciaire.
Quoi qu’il en soit, ce qui n’est pas douteux, c’est que, en appelant
Particulon : vir sanctissime
, en implorant de sa
bonté la bienfaisante réalisation de ses promesses, en le priant de lire ses fables
dans sa villa de Varia, et en lui demandant pour elles une approbation qui sera son
plus bel éloge, Phèdre fait de son protecteur un homme à la fois intègre, riche et
lettré.
Aussi ne se borne-t-il pas à lui dédier la première partie de son livre IV, et, quand, après avoir renoncé à écrire, il reprend la plume et ajoute à son quatrième livre une seconde partie, est-ce encore à lui qu’il la consacre.
J’arrive enfin au livre V ; c’est également sous l’égide d’un affranchi qu’il le place, et cet affranchi porte, comme Eutyque, un nom grec ; il se nomme Philète. Ici le doute sur la qualité du protecteur n’est pas possible : des inscriptions lapidaires l’établissent. Dans les Inscriptiones antiquæ de Gruter on lit, page 352, nº 4 :
ANEROS. ASIATICVS. VI. VIRSIBI. ET. VALERIAE. Ɔ. L. TRYPHERAEVXORI, ET. PHILETO. LIBERTO
{p. 30}et page 677, nº 2 :
TI. CLAVDI. PHILETIV. A. VI. M. III. D. XXITI. CLAVDIVS. PHILETVS.
Gude signale en outre cette inscription comme se trouvant à Velletri sur l’une des dalles de la cathédrale :
D. M. CL. VICTORINAITI. CL. PHILETVS. LIB. BENEMERENTI61.
De ces inscriptions il ressort que Philète était un affranchi de Claude.
On rencontre encore dans les Inscriptiones antiquæ de Gruler les inscriptions suivantes, qui ne me paraissent pas se rapporter aussi bien au protecteur du fabuliste ; d’abord :
FILETE. ARISTIA. PHILETVS. M. AEMILIVSC. AQVILIVS. M. CAELIVSCLAVDIVS FILINVS62
puis, pages 345, nº 3, et 346, nº 2 :
ET. FILETVS. ACTOR
page 728, nº 10 :
PHILETVS. CVM. NIPHADEMATRE. FECIT
page 1039, nº 1 :
PHILETO. ET. MOSCHIDIQ. VOLSIVS. VICTORINVS
et page 1093, nº 10 :
PHILETVS. ET. FVSCVS. L. F. C.
{p. 31}Le cinquième livre, dédié à Philète, est loin de nous être parvenu tout entier. Par suite de divisions arbitraires, dans les éditions imprimées il se compose de dix fables ; mais en réalité il n’en comprend que cinq. Il est certain qu’il en renfermait d’autres ; mais ce qui est également vraisemblable, c’est que Phèdre, ne l’ayant commencé qu’à un âge très avancé, mourut avant de l’avoir achevé.
8º Date de la mort de Phèdre. — Aucun document ne renseigne sur la date de sa mort. Il est seulement certain qu’il parvint à une grande vieillesse ; sa dernière fable en est la preuve. Pagenstecher63 suppose que son existence se prolongea jusque sous les règnes de Vespasien et de Domitien. Le Père Brotier, au contraire, pense qu’il ne survécut pas à Tibère ; car autrement il n’aurait pas manqué de flageller Caligula ; ce qui ne ressort pas de ses fables64. La vérité est sans doute entre ces deux conjectures extrêmes. Mais il est impossible de fixer une date précise.
§ 2. — Valeur de l’écrivain et caractère de l’homme. §
Une biographie de Phèdre ne serait pas complète, si elle n’était pas accompagnée d’une esquisse rapide de la valeur de l’écrivain et du caractère de l’homme.
Parlons d’abord de la valeur de l’écrivain.
Quand on veut porter un jugement sur un homme de lettres, il faut toujours examiner en lui deux choses, le fond, c’est-à-dire la pensée, et la forme, c’est-à-dire le style.
À la lecture de Phèdre, on est malheureusement pour lui obligé de constater que, dans son œuvre, le fond manque d’originalité. Depuis le commencement de son premier livre jusqu’à la fin de la première partie du IVe, les sujets de ses fables sont presque tous empruntés à Ésope, et dans ceux qui n’en sont pas tirés, il n’a pas davantage le mérite de l’invention ; car alors il n’est plus fabuliste, il est narrateur. Il se borne à reproduire de petites historiettes du genre de celles, qui de nos jours, dans la presse quotidienne, figurent {p. 32}sous la rubrique : Nouvelles et faits divers. C’est là ce qu’on trouve dans les fables v du livre II, x du livre III, v de la première partie du livre IV, vi de la deuxième partie du même livre, ii du livre V, xv et xvi de l’appendice. Quelquefois, si ce ne sont pas des événements contemporains qu’il expose, il raconte des anecdotes plus ou moins anciennes et plus ou moins véridiques ; telles sont celles qu’on lit dans les fables viii, ix et xi du livre III, xi et xxii de la première partie du livre IV, x et xxvii de l’appendice. Souvent aussi il a recours à des traditions qui se rapportent à la vie problématique du vieil Ésope ; de cette catégorie sont les fables iii, v, xiv et xix du livre III, ix, xii, xiii, xvii et xx de l’appendice. Quelquefois enfin Phèdre puise ses récits dans le domaine connu de la mythologie ; tels sont ceux que présentent les fables xvii du livre III, xii, xiv, xv, xviii et xxv de la première partie du livre IV et v de l’appendice.
Ce défaut complet d’originalité dans la pensée est reconnu par lui-même.
Dans le prologue de son premier livre, il déclare qu’il s’est borné à versifier la matière qu’Ésope lui a fournie :
Æsopus auctor quam materiam repperitHanc ego polivi versibus senariis.
Il ajoute dans le prologue du livre II qu’il prend Ésope pour modèle, et que, s’il l’amplifie un peu, ce n’est que pour donner plus de charme au récit :
Sed si libuerit aliquid interponereDictorum sensus ut delectet varietas,Bonas in partes, Lector, accipias velim.
Il est vrai que, dans le prologue du livre III, il prétend, comme je l’ai déjà fait observer, qu’il a fait une route du sentier tracé par Ésope et écrit plus de fables que son devancier n’en avait laissé :
Ego illius pro semita feci viam,Et cogitavi plura quam reliquerat.
Mais l’amour de la gloire et la manie de la persécution, qui étaient ses deux principales faiblesses, l’ont fait tomber ici dans une exagération, qui ressort matériellement d’abord des fables de ses deux {p. 33}premiers livres presque toutes imitées d’Ésope, et ensuite de ses aveux ultérieurs et notamment du poème du livre IV, qui est intitulé Phædrus et dans lequel il avoue que la pensée de ses œuvres appartient à Ésope :
Sive hoc ineptum, sive laudandum est opus,Invenit ille, nostra perfecit manus.
C’est seulement à partir de la deuxième partie de son livre IV, qu’il commence à être original. Du moins, c’est lui qui l’affirme dans la première fable, où il déclare que, s’il se sert encore du nom d’Ésope, ce sera pour donner plus d’autorité à son œuvre, et pour imiter ces artistes qui, afin d’amorcer le public, signent leurs ouvrages du nom de Praxitèle :
Æsopi nomen sicubi interposuero,Cui reddidi jampridem quicquid debui,Auctoritatis esse scito gratia ;Ut quidam artifices nostro faciunt seculo,Qui pretium operibus majus inveniunt, novoSi marmori adscripserunt Praxitelen suo.
Malheureusement on est obligé de le croire sur son affirmation ; car il reste si peu de chose, soit de la deuxième partie du livre IV, soit du livre V, qu’il est impossible de savoir si Ésope n’en avait pas encore fait en partie les frais. Ce qui s’y révèle clairement, c’est la transformation du fabuliste en romancier et en nouvelliste. Peut-on en effet voir des fables dans les anecdotes, où il met en scène Ménandre et le tyran Démétrius (livre IV, 2e partie, fable ii), deux Soldats et un Voleur (livre IV, 2e partie, fable iii), un Bouffon et un Paysan (livre IV, 2e partie, fable vi), un Joueur de flûte nommé Leprince (livre V, fable ii), et le vieillard nommé le Temps (livre V, fable iii) ? Or, comme en dehors de ces poèmes anecdotiques, la deuxième partie du livre IV et le livre V ne renferment que deux vraies fables, on peut dire que, dans l’œuvre de Phèdre, l’originalité de la pensée a été presque nulle.
Il faut le reconnaître, ce qui fait la principale valeur littéraire de Phèdre, c’est la forme. Comme La Fontaine, qui n’a pas eu plus que lui l’originalité du fond, c’est uniquement par le style qu’il s’est rendu remarquable. Si le style a toujours de l’importance, c’est surtout en matière littéraire. La postérité ne garde pas le souvenir de {p. 34}ceux qui, dans leurs écrits, ont mal exprimé les idées même les plus neuves ; elle ne se rappelle que ceux qui, sans les avoir conçues, ont eu le talent de se les approprier et de les présenter avec élégance. Voilà pourquoi La Fontaine, qui dans toutes ses fables n’a été qu’un imitateur, s’est acquis une renommée à mon sens surfaite, mais certainement impérissable, et voilà pourquoi Phèdre, suivant sa propre expression, vivra autant que la littérature latine :
Latinis dum manebit pretium litteris65.
Les deux fabulistes n’ont pas employé les mêmes procédés littéraires : La Fontaine a su se rendre séduisant par l’habile développement de l’idée originale et par la grâce et la finesse des détails dont il l’a ornée ; Phèdre, malgré son origine macédonienne, étant en pleine possession des secrets de la langue latine, a mis toute sa dextérité à présenter sous une forme concise les idées par lui puisées dans les fables de l’auteur antique qu’il appelait le vieux Phrygien, ou simplement le vieillard ; c’est là ce qui fait son infériorité. Tandis que La Fontaine, tout en restant imitateur, fait, dans la mise en œuvre, preuve d’une certaine imagination, Phèdre s’en est montré absolument dépourvu. La Fontaine a été un élégant paraphraste, Phèdre n’a été qu’un traducteur.
Le rôle modeste que le fabuliste latin s’est assigné, ne l’a pas empêché d’avoir de sa personne l’opinion la plus haute qu’un homme puisse concevoir de lui-même. Il éprouve un besoin de parler de son mérite, qu’on ne rencontre au même point chez aucun auteur latin, et chaque fois qu’il se met en scène, ce qui arrive souvent, il n’hésite pas à faire de sa supériorité intellectuelle, un éloge, qui, s’il avait été réellement un écrivain de premier ordre, blesserait encore les lois les plus élémentaires de la modestie, et qui, étant donné son bagage littéraire, le pose en auteur à la fois naïf et vaniteux.
Il déclare, dans l’épilogue du livre II, que les attaques des envieux ne l’empêcheront pas d’avoir conscience de sa valeur, et que, s’il est attaqué par eux, il saura attendre courageusement que le sort rougisse de son crime :
Fatale exitium corde durato feram,Donec fortunam criminis pudeat sui.
{p. 35}Dans le prologue du livre III, il traite bien ses fables de viles bagatelles, viles nænias ; mais ce n’est là que de la fausse modestie ; il ne tarde pas dans le même prologue à se placer au-dessus d’Ésope, et il conclut en déclarant d’un ton emphatique qu’une gloire solennelle lui est due :
Quoniam solemnis mihi debetur gloria.
Dans le poème vii de la première partie du livre IV où il se plaint de la critique, il traite de sots ceux qui se la permettent à son égard :
Hoc illis dictum est, qui stultitia nauseant.
Enfin, dans le prologue de la deuxième partie du livre IV, il se console, en pendant que, s’il est attaqué, ce n’est que par des gens de mauvaise foi, irrités de ne pouvoir l’imiter, et il exprime l’espoir que Particulon son protecteur et tous les lettrés le jugeront digne de l’immortalité à laquelle il aspire :
Hunc obtrectare si volet malignitas,Imitari dum non possit, obtrectet licet.Mihi parta laus est, quod tu, quod similes tuiVestras in chartas verba transfertis mea,Dignumque longa judicatis memoria.Inlitteratum plausum non desidero.
Un tel orgueil est d’autant plus incompréhensible qu’en somme, si l’on recherche sur quoi il le fonde, on s’aperçoit que la seule qualité qu’il s’attribue, c’est la brièveté.
Dans le prologue du livre II, il avertit le lecteur qu’il aura soin d’être bref :
Ita, si rependet illi brevitas gratiam.
Dans le promythion de la fable x du livre I, il annonce une courte fable :
Hoc adtestatur brevis Æsopi fabula.
Quand il fait un récit qui exige quelques développements, il a soin de faire remarquer que c’est une exception à la règle qu’il a adoptée ; il s’excuse en ces termes à la fin de la fable x du livre III :
Hæc exsecutus sum propterea pluribus,Brevitate nimia quoniam quosdam offendimus.
{p. 36}Pour indiquer leur concision, il donne toujours à ses fables la dénomination, non de fabulæ, mais de fabellæ66.
Quand il annonce qu’il va parler du testament expliqué par Ésope, il déclare qu’il ne fera qu’un court récit :
Narratione posteris tradam brevi67.
Dans la fable vii la première partie du livre IV, il ne demande au lecteur qu’un peu de patience :
Parva libellum sustine patientia.
Lorsque, dans le premier épilogue du livre IV, il prie Particulon de lui donner la récompense promise, c’est sur sa brièveté qu’il se fonde pour y prétendre :
Brevitati nostræ pretium ut reddas peto,
et dans le second épilogue, lorsqu’il a obtenu la récompense sollicitée et qu’il n’a plus rien à réclamer de Particulon, c’est encore sa brièveté qu’il fait valoir auprès de lui, pour assurer à ses écrits l’approbation de son protecteur :
Si non ingenium, certe brevitatem adproba.
Ce qui ressort de tout cela, c’est que l’orgueil de Phèdre n’était pas justifié par l’importance de son œuvre. Je suis très porté à croire qu’en réalité il n’a jamais été la victime de l’envie et qu’il n’en a souffert que dans son imagination.
Ce qui me paraît donner un fort point d’appui à cette manière de voir, c’est que, même lorsque, comme Sénèque, ils traitaient de questions qui auraient dû appeler son nom sous leur plume, les écrivains latins contemporains ou postérieurs ne se sont pas occupés de lui. Il est vrai que ses fables avaient acquis assez de notoriété pour parvenir à la connaissance de Séjan, à qui elles avaient servi de grief ; mais il est probable que ce dernier n’y avait pas attaché une grande importance et qu’il n’avait pas donné suite à son action en justice ; car on ne voit pas que Phèdre ait été atteint {p. 37}par le ministre de Tibère ni dans ses biens qui étaient nuls, ni dans sa liberté qu’il paraît avoir toujours conservée. J’en conclus que, pareil à tous les auteurs inaperçus, il a pris un peu pour de l’envie ce qui n’était que de l’indifférence.
Maintenant, hâtons-nous de le dire, Phèdre avait cet honorable orgueil, qui est basé sur la foi, qui ne connaît point la morgue et qui n’inspire que la sympathie.
Il faut d’ailleurs reconnaître que, s’il a eu l’excusable faiblesse d’attacher trop d’importance à son œuvre, il n’a pas non plus été un homme vulgaire, et que, si comme littérateur il a été inférieur à La Fontaine, il lui a peut-être été supérieur comme philosophe.
La fable iii du livre III fait voir que c’était un esprit élevé, sur qui la superstition n’avait point de prise, qui se moquait des sorciers, qui ne croyait pas au merveilleux, et qui pensait que le raisonnement peut seul expliquer les choses en apparence surnaturelles.
Quand on cherche quelles étaient ses idées en métaphysique, on lui trouve encore la même supériorité intellectuelle ; la fable xxxi de l’appendice nous le montre partisan de la métempsycose, c’est-à-dire de la théorie la plus rationnelle parmi celles qui ont pour base l’identité du moi après la mort.
Enfin rendons, en terminant, un légitime hommage à son inébranlable amour du bien, et disons que Phèdre fut une nature honnête, un moraliste convaincu, qui eut, en restant pauvre, le rare mérite de suivre ses propres préceptes, et, en rêvant sans cesse l’immortalité, le courage de ne la demander qu’à la seule valeur de ses écrits.
Chapitre II.
Manuscrits de Phèdre. §
Il est peu d’auteurs anciens, dont les manuscrits soient aussi rares que ceux de Phèdre. On n’en connaît que cinq, dont l’un même n’existe plus ; ce sont :
1º Le manuscrit de Pithou ;
2º Le manuscrit de Reims ;
3º Le manuscrit de Daniel ;
4º Le manuscrit napolitain de Perotti ;
5º Le manuscrit Vatican de Perotti.
Leur examen successif va faire l’objet de ce deuxième chapitre.
Section I.
Manuscrit de Pithou. §
§ 1er. — Histoire du manuscrit. §
Lorsqu’au mois de septembre 1596, parut la première édition des fables de Phèdre, elles étaient entièrement inconnues. Au moyen âge elles avaient bien servi de texte à des traductions latines, qui elles-mêmes avaient été la base de versions en prose et en vers ; mais, destinée singulière des choses humaines, alors que les imitations plus ou moins grossières avaient survécu, l’œuvre originale était tombée dans le plus complet oubli ; personne ne savait ce que Phèdre avait écrit ; on ignorait presque son nom.
Il avait éprouvé le sort qu’ont sans doute subi beaucoup d’autres {p. 39}auteurs latins ; car il ne faut pas se dissimuler que les couvents, qui, dans les temps d’ignorance, ont sauvé un grand nombre de leurs œuvres, en ont aussi détruit beaucoup. Les palimpsestes en fournissent aujourd’hui la preuve la plus irrécusable.
L’honneur de faire revivre Phèdre était réservé à l’illustre Pierre Pithou, que, suivant un ancien bibliothécaire de l’Oratoire, le Père Adry68, son érudition a fait surnommer le Varron de la France.
Si la nature de cette étude ne m’imposait pas d’étroites limites, je tâcherais de peindre ici cette figure qui fut une des plus pures de son époque ; je me bornerai à en tracer une légère esquisse.
La seconde moitié du xvie siècle, à laquelle Pierre Pithou appartient, offre à l’historien qui l’observe un singulier contraste. Au milieu de ces guerres civiles que le fanatisme religieux faisait sans cesse renaître, on voyait, sans rester indifférents aux déchirements de la patrie, des hommes éminents chercher dans les lettres et dans les arts une diversion à leur tristesse, et continuer dans le recueillement la grande œuvre de la Renaissance. Les grands peintres, les grands statuaires, les grands architectes, les grands jurisconsultes, les grands littérateurs, les grands savants, rien n’a manqué à cette brillante période du progrès humain. Leurs noms sont connus ; il est inutile de les rappeler. Ne parlons que de Pierre Pithou.
Son père avait eu, en 1524, d’un premier mariage deux enfants jumeaux, Jean et Nicole, qui embrassèrent l’un, le barreau, l’autre, la médecine. Ayant perdu sa première femme, il avait, en secondes noces, épousé Bonaventure de Chantaloë, fille de Robert de Chantaloë, seigneur de Baire, et de Catherine Dorigny.
Pierre Pithou fut l’aîné des deux enfants issus de cette union. Il était né à Troyes, le 1er novembre 1539. Son père, qui était un des avocats les plus distingués du barreau de cette ville, avait tenu à ce que son éducation fût bien commencée. Il l’avait envoyé à Paris, et l’avait fait entrer au collège de Roncourt, qui était alors en vogue. Ses études classiques terminées, il avait résolu de lui faire {p. 40}embrasser la carrière du barreau, et, pour l’y préparer, l’avait confié à Cujas. Pendant cinq ans, à Bourges et à Valence, Pithou suivit les cours de ce fameux jurisconsulte, qui conçut pour lui une affection toute particulière.
En 1560, il se fit inscrire au barreau de Paris, et, quoique assidu aux audiences, il ne plaida sa première cause qu’en 1564. Il la gagna, et cependant ce succès ne l’encouragea pas à entrer dans des luttes trop contraires à ses goûts. Timide et réfléchi, il ne possédait pas cette rapidité de pensée et cette facilité de parole, qui, bien plus encore que les qualités solides, assurent à l’avocat les triomphes oratoires. Il aimait sa profession, parce que, l’exerçant surtout dans son cabinet par ses consultations écrites, elle lui fournissait l’occasion de se livrer à des travaux vraiment scientifiques et lui laissait en même temps le loisir de suivre ses goûts pour les études littéraires.
En 1567, pressentant les catastrophes dont Paris allait être le théâtre, il le quitta, vint à Troyes, et demanda son inscription au barreau de sa ville natale. Mais la lutte était ouvertement engagée entre l’intolérance religieuse et la liberté de conscience. Pithou avait été élevé par son père dans les croyances de la religion réformée. Le parti catholique, qui était le plus fort, repoussa du barreau troyen le fils de celui qui en avait été l’oracle.
Après être resté un an à Troyes, l’agitation croissant toujours, il se décida à sortir de France. Il se retira à Bâle, y continua sa vie laborieuse, et y séjourna jusqu’en 1570.
Ramené dans sa patrie par l’édit rendu à cette époque, il rentra au barreau de Paris, et publia les 42 Novelles des empereurs Théodose le Jeune, Valentinien et Anthémius, qu’il dédia à Cujas. Puis, sollicité par le duc de Montmorency, qui était chargé d’une mission extraordinaire auprès de la reine Élisabeth, il consentit à le suivre en Angleterre. Mais la prospérité de ce pays lui offrait un contraste trop affligeant ; il n’y passa que deux mois ; il aimait d’ailleurs trop la France pour en rester volontairement éloigné ; il était à Paris pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. La célébrité qu’il devait à ses travaux avait attiré sur lui l’attention des assassins. En gagnant par le toit la maison contiguë à la sienne et en allant ensuite se cacher chez son ami Nicolas Lefebvre, qui logeait dans la même rue que lui, il parvint à leur échapper ; mais {p. 41}ils se vengèrent de sa fuite sur ses manuscrits qui furent pillés.
Après le massacre, il abjura le calvinisme. Personne ne songea à suspecter sa sincérité. Ceux auxquels il se ralliait l’accueillirent sans méfiance, et sa droiture était trop connue de ses anciens coreligionnaires, pour lui attirer leur inimitié. Ainsi, tandis que le Père Sirmond69, qui quelques années après s’était rendu à Rome, y garantissait sa sincérité, il demeurait à Paris en relations intimes avec ceux dont il avait abandonné les croyances. Tous savaient qu’il ne désirait que la vie retirée du travailleur modeste.
Ce désir, il le réalisa. Le bailliage de Tonnerre étant devenu vacant, il le reçut, en 1573, des mains du duc d’Uzès et de sa femme, Louise de Clermont-Tonnerre, et trouva, dans ces fonctions peu absorbantes, les calmes loisirs qu’il recherchait et qui lui permirent d’écrire de nouveaux ouvrages et notamment de publier la loi des Wisigoths.
Pendant cette tranquille période de sa vie, il eut le bonheur de rencontrer une femme digne de lui, Catherine de Palluau, fille de Jean de Palluau, secrétaire du roi et conseiller en l’hôtel de ville de Paris. Il l’épousa, et, pendant quelques mois, put partager ses instants entre ses chères études et sa compagne, que, suivant son expression, il aimait comme lui-même.
Mais, dans les temps d’agitation, les grandes individualités ne peuvent pas rester simples spectatrices des événements. Elles se doivent à leur pays. C’est dans cette pensée qu’en 1580 il consentit à entrer plus franchement dans la vie publique. Il accepta au parlement de Paris les fonctions de substitut du procureur général Jean de la Guesle.
Pendant qu’il les remplissait, des dissentiments graves s’étaient élevés entre le Saint-Père et le roi de France. Aux décisions du Concile de Trente avaient été opposées les ordonnances de Blois.
Le pape dans un bref avait manifesté son irritation. Pithou fut
chargé de répondre. « Il le fit, ajoute son biographe Grosley70, par un mémoire, où, sans sortir du respect dû au Pape, il
démasque les {p. 42}vûes secrètes de ceux qui vouloient l’aliéner du Roi et
défend fortement, et en peu de mots, la cause du Roi et de l’État. »
En 1581, fut provisoirement créée une Chambre souveraine, tirée du
parlement de Paris, pour remplacer celui de Guyenne. Cette Chambre allait avoir
une mission difficile ; il consentit, autant par dévouement pour Henri III que par
amitié pour son ancien condisciple Loysel, à y remplir les fonctions de procureur
général. « Chargé, écrit Grosley, de la correspondance de la Chambre avec
la Cour, il mettoit sous les yeux du Roi les abus qu’il falloit corriger, le
bien qu’il falloit faire et le soin des Peuples. »
Après une dernière séance tenue à Saintes, la Chambre se sépara le 8 juin 1584.
En 1583, les Commissions de substituts des procureurs généraux
avaient été érigées en charges vénales. Pithou renonça à une magistrature qu’il
n’aurait plus due à son seul mérite. « Les traitants eux-mêmes, dit
Grosley, offrirent à M. Pithou des provisions pour la sienne. »
Il les
refusa et retourna au barreau.
Tout en profitant de ses nouveaux loisirs pour répandre sur l’antiquité de nouvelles lumières, il ne se désintéressa pas des événements politiques. Il continua à contempler, avec une tristesse dont ses écrits portent l’empreinte, les sanglantes discordes de la France, et, quoique rentré dans la vie privée, il essaya d’y porter remède.
Quand il vit que, pour satisfaire son ambition, la maison de Lorraine ne craignait pas d’appeler l’Espagne à son aide, il entra dans la lutte, pour soutenir celui des prétendants qui représentait l’indépendance nationale. Sa seule arme était sa plume ; mais, en rédigeant avec quelques amis la fameuse satire Ménippée, il sut la rendre si acérée qu’il frappa d’un coup mortel les meneurs de la Sainte Union.
Henri IV, entré à Paris, sentit qu’il ne lui suffisait pas d’être victorieux et qu’il avait encore à pacifier le pays. Pendant la guerre civile, les membres du Parlement s’étaient retirés à Tours et à Châlons. En attendant qu’ils pussent être ramenés et réunis, il fallait former une Cour souveraine qui rendît la justice. Le 28 août 1594, Pithou en fut nommé le procureur général. Il comprit sa tâche, et travailla avec un succès complet à l’œuvre de conciliation qui lui avait été confiée.
Lorsque le Parlement fut enfin réuni, ne voulant pas d’autre {p. 43}récompense que la satisfaction d’avoir été utile, il quitta ses hautes fonctions, et rentra simplement dans les rangs des avocats.
« Pendant les vacances de l’année 1595, qu’à son ordinaire il étoit venu passer à Troyes, expose Grosley, François Pithou son frère, loi avoit fait présent d’un Exemplaire unique des Fables de Phèdre, qui jusqu’alors s’étoient dérobées aux recherches des Amateurs de l’Antiquité : à peine même soupçonnoit-on leur existence. Il les avoit déjà transcrites de sa main, et données à Patisson, son Imprimeur, lorsque la Peste l’obligea de quitter Paris avec toute sa famille, et de venir à Troyes.
« Pour s’y ménager un amusement de son goût, et mettre ce voyage à profit pour le Public, il avait retiré le Phèdre des mains de Patisson, pour le faire imprimer à Troyes sous ses yeux71. »
La première édition des fables de Phèdre est excessivement rare : peut-être me saura-t-on gré d’en donner ici la description.
Elle forme un petit volume in-12 de soixante-dix pages.
Voici d’abord le titre que porte la première :
Phædri Avg. Liberti fabvlarvm Æsopiarvm libri v, Nunc primum in lucem editi. Avgvstobonae Tricassivm excvdebat Io. Odotivs, Typographus Regius, Anno CIƆ. IƆ. XCVL. Cum privilegio.
La deuxième page est remplie par les vers suivants adressés à Pithou par Florent Chrétien :
petro pithoeo antiqvitatis vindici.
Phrix (sic) ille seruus, mente sanus liberaGræcas iocosus fecit ex re fabulasAdfabulatus quæ docerent Socratem :Græcis trimetris vinxit illas BabriusEt post Latinis Phaedrus olim CesarisLibertus Augusti, stylo atque temporePar proximusue Laberio vel Publio,Quem nunc tenebris erutum Orcinæ specus,Pithoee, superis reddis auris, maximamIniturus à me gratiam, imò ab omnibusSpero eruditis : cæteros nihil moror{p. 44}Quîs prisca sordet litterarum puritas.Tantum ô viderem doctiores PrincipesQuàm litteratos seruolos, quales erantAesopus, et libertus iste Principis.Q. Sept. Florens Christianvs.
Les pages 3 et 4 sont occupées par une épître de Pithou à son frère François.
« Celui-ci, dit M. Berger de Xivrey, avait publié, en 1576, un manuscrit de la bibliothèque de Pierre Pithou, contenant la traduction des Novelles de l’empereur Justinien par Julien, surnommé Antecessor, et il avait dédié à son frère cette édition imprimée à Bâle. C’est à quoi ce dernier fait allusion au commencement de l’épître suivante :
« p. pithoevs francisco fratri.
« Reddo tibi, frater, pro novellis constitutionibus Imperatoris, veteres fabellas imperatorii liberti, et quantum quidem conjicio, Tiberii, atque adeò post Sejanum damnatum. Nam quis istos deinceps laudavit unquam ? Ejus scriptoris qui meminerit ex veteribus nullum dam reperi præter unum Avienum, quem etiam Virgilii fabulas ïambis scripsisse tradunt. Thracem se fuisse innuit et Græciæ vicinum : ut nec ii libelli Senecæ fidem elevent testantis Ӕsopios logos intentatum Romanis ingeniis opus. Senem admodum scripsisse praeter seniles de ætate querellas (sic), vel illa arguunt quod se D. Augustum jus dicentem audiisse, et Cilnii Mæcenatis Bathyllum saltantem vidisse significat. Cuicui vero ille alapas et libertatem debuerit, tibi certe, frater, jam vitam debet, quam temporum injuria pæne sepulto exemplaris a te reperti beneficio restituere conatus sum. Ita tu patronus Phædro, ego adsertor ac vindex vel non idoneus, sine satisdatione tamen venio, et Augusti libertum, vel libertinum potius, privatus hac etiam parte testabilem publicique juris facio ; tu illi adsis ac faveas modò, qui et poeticis voluptatibus aures à forensi asperitate respirare non ignoras, et hoc figmenti genus a veri professoribus usque adeo non esse alienum, ut à Socrate ipso Ӕsopi λόγους versibus redditos Cebes apud Platonem in os laudaverit. Have72, mi frater, et inter istam {p. 45}publicam luem salve ac vale. Tricassib. X. KL. Septembres reb. prolatis, ann. CIƆ. IƆ. XCVI. »
Vient ensuite, à la page 5, un extrait de la préface mise par Avianus en tête de ses fables ; le voici :
« Avienus in præfatione Fabularum suarum Ӕsopicarum ad Theodosium.
« Hujus materiæ ducem nobis Ӕsopum noveris, qui responso Apollinis monitus ridicula orsus est ut legenda firmaret. Verum has pro exemplo Fabulas et Socrates divinis operibus indidit, et poemati suo Flaccus aptavit, quod in se, sub jocorum communium specie, vitæ argumenta contineant : quas Græcis iambis Babrius repetens in duo volumina coartavit ; Phædrus etiam partem aliquam quinque in libellos resolvit. De his ego usque ad XLII in unum redactas fabulas dedi, quas rudi latinitate compositas elegis sum explicare conatus. »
À la page 6 se trouve ce passage de Priscien :
« Prisciani sophistæ ex arte præexercitaminum secundum Hermogenem vel Libanium ac Græcos Rhetores.
« Fabula est oratio ficta verisimili dispositione imaginem exhibens veritatis. Ideὸ autem hanc primum tradere pueris solent oratores, quia animos eorum adhuc molles, ad meliores facilè vias instituunt vitæ. Usi sunt ea vetustissimi quoque auctores, Hesiodus, Archilochus, Plautus, Horatius. Nominantur autem ab inventoribus fabularum aliæ Ӕsopiæ, aliæ Cypriæ, aliæ Libycæ, aliæ Sybariticæ, omnes autem communiter Ӕsopiæ, quoniam in conventibus frequenter solebat Ӕsopus fabulis uti : et pertinent ad vitæ utilitatem. Expositio autem fabularum vult circuitionibus carere et jucundior esse : sed oratio qua utilitas fabulæ retegitur, ἐπιμύθιον vocant, quod nos adfabulationem possumus dicere, à quibusdam prima, à plerisque rationabilius postrema ponitur.
« Vide Fabium, lib. V, Institut. Orat., A. Gell., lib. II, Noct., c. xxviiii, et Macrob., lib. I, Comment. in Somn. Scip. »
C’est seulement à la page 7 que commence le texte de Phèdre. Il est précédé de ce titre :
phaedri avg. liberti fabvlar. aesopiarvm liber i.
Il s’étend jusqu’au milieu de la page 67 ; deux genres de caractères {p. 46}y ont été employés : les caractères romains pour les prologues, les épilogues et la morale de chaque fable, et les caractères italiques pour le reste.
À la suite de la dernière fable arrivent les variantes du manuscrit, qui, quoique incomplètes, remplissent les pages 68 et 69.
Ces deux pages et la dernière ne sont pas numérotées.
La page 70 est consacrée au privilège dont voici la formule :
« Par privilège du Roy, donné à Paris, le 28 iour d’Aoust 1596, il est permis à Maistre Pierre Pithou, y dénommé, de faire imprimer par tel que bon luy semblera, Phædri Augusti liberti libros quinque, avec deffences à tous Imprimeurs et Libraires de ce Royaume, autres que celuy qu’il choisira, de les imprimer pendant six ans, ny en exposer en vente d’imprimez ailleurs dedans ledict tẽps, sinon du consentement du dict Pithou, sur peine de confiscation, et d’amende arbitraire. Et que par l’extraict sommaire dudict privilège mis au commencement ou à la fin de l’impression, il soit tenu pour suffisãment notifié, sans autre signification.
« Je soubs-signé certifie auoir baillé à Jean Oudot, Imprimeur du Roy en ceste ville, Phædri Augusti liberti fabularum Aesopiarum libri quinque, pour les imprimer et mettre en lumière, suyvant la permission et privilège du Roy, dont l’extraict est cy-dessus.
« Faict à Troyes, le dernier iour d’Aoust, Mil cinq cens quatre-vingt-seize.
« Ainsi signé : P. Pithou. »
Telle est l’édition publiée par Pierre Pithou.
Je n’en connais que 14 exemplaires, savoir : deux à la Bibliothèque nationale, le troisième à la Bibliothèque de l’Arsenal, le quatrième à la Bibliothèque Mazarine, le cinquième à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, le sixième et le septième à la Bibliothèque de Troyes, le huitième à la Bibliothèque de Berne, le neuvième et le dixième au British Museum, l’onzième à la Bibliothèque Bodléienne, les douzième et treizième à Cambridge, l’un à la Bibliothèque de l’Université, l’autre à celle du King’s college, enfin le quatorzième à la Bibliothèque Laurentienne de Florence.
Les deux exemplaires de la Bibliothèque nationale portent sur le Catalogue imprimé de 1750, l’un la cote Y 6561, et l’autre la cote Y 6562. Le premier, court de marges et mal relié, n’a rien de remarquable ; {p. 47}le deuxième, quoique très rogné, porte des notes écrites par trois mains différentes.
Je n’ai aucune remarque à faire sur les deux exemplaires de la Bibliothèque de l’Arsenal et de la Mazarine.
Il n’en est pas de même pour celui de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Daunou, dans son article sur l’édition diplomatique de M. Berger de
Xivrey73, publié dans le Journal des savants en
décembre 183074, dit que cet
éditeur ne paraît pas avoir eu connaissance de l’exemplaire de Sainte-Geneviève,
et il ajoute qu’il renferme « les variantes des manuscrits »
. Il
est possible que M. Berger de Xivrey ne l’ait pas connu ; mais à l’égard des
variantes, Daunou se trompe ; car l’exemplaire ne contient que celles du manuscrit
de Pithou écrites par Nicolas Rigault lui-même, qui fut, comme on le sait, le
premier commentateur français des fables de Phèdre.
C’est là du moins ce qu’indique la note suivante tracée au crayon en tête de l’exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève :
« Notæ istæ, meo quidem judicio, sunt propria Nicolaï
Rigaltii manu exaratæ, dum Phædri editionem meditabatur, quæ prodiit Parisiis 1599 in-12, deinde secundis curis
aucta 1617 in-4o, denique 1630 in-12, sed oscitanter
confecta, si fides Niceroni To. 21 habeatur. Has notas mss. eo fidentius
Rigaltio adscribo, quod penes me duo sint exemplaria libelli ab eodem dati sub
titulo : Exhortations chrétiennes etc., 1620, in quibus
Exemplaribus aspersas lego notas mss. eodem plane caractere cum præsentibus ad
Phædrum simillimas. »
Cette note est signée d’un B
avec paraphe. À côté de ce B, à l’encre, une autre main a ajouté
ces mots : Certe Beaucousin75.
La conjecture de Beaucousin est parfaitement exacte. Pour {p. 48}m’en assurer, j’ai collationné les notes manuscrites de cet exemplaire avec celles des éditions de Rigault, et j’ai vu qu’elles étaient presque identiques à celles de la première. Je puis donc affirmer que non seulement c’est Rigault qui a annoté l’exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais qu’encore c’est pour sa première édition qu’il s’est livré à ce travail préparatoire.
Au-dessous de la note de Beaucousin, on lit :
« Voyez la lettre de M. l’abbé de Saint-Léger dans l’Année littéraire, 1787, t. VIII, page 228. »
Cet exemplaire de la première édition de Pithou est passé, en 1765,
dans la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; c’est là du moins ce qui paraît ressortir
de la mention suivante écrite sur le titre, selon l’usage du temps : « Ex libris Sanctæ-Genovefæ, Paris, an. 1765. »
J’ignore
quelles vicissitudes il avait pu auparavant subir.
La Bibliothèque de Troyes possède aussi deux exemplaires de l’édition de Pithou, qui, dans le fonds appelé Cabinet local, portent les nos 221 et 222.
Le premier de ces deux exemplaires, à raison des notes en langue française dont il est pourvu, est plus précieux que le second. Un savant troyen, très initié à tout ce qui touche l’histoire littéraire de sa ville natale, m’a exprimé l’idée que ces notes étaient de Grosley ; mais, quand on les compare à sa signature, on est porté à les attribuer à une main beaucoup plus ancienne. J’ai relevé plusieurs de ces notes ; mais, dans le désir d’abréger cette analyse, je m’abstiens de les transcrire.
Je me permettrai seulement de faire connaître les particularités qui indiquent par quelles mains le volume est successivement passé.
D’abord, sur le frontispice, au-dessus de la vignette centrale, on
aperçoit la signature de Grosley, puis à droite apparaît celle du docteur Carteron
accompagnée du millésime de 1806 et d’un timbre humide portant les mots :
« Ex libris Franc. Carteron doct. medici
Trecis. »
Le frontispice est précédé d’un feuillet blanc, qui a été ajouté
par le relieur et sur lequel on lit : « Ce volume m’a été légué par {p. 49}mon excellent camarade et ami, M. le docteur
Carteron-Corthier. »
Cette mention porte la signature abrégée de Corard
de Bréban, accompagnée d’un timbre humide, dans l’intérieur duquel apparaissent
ces mots : « Ex libris Corard de Bréban,
Trecensis. »
Enfin au-dessous on lit encore : « Offert par
M. Édouard de Blives à la Bibliothèque de Troyes. »
Cette mention est
signée et datée ainsi : « Édouard de Blives, petit-fils de Bréban, le
8 septembre 1871. »
L’exemplaire qui porte le nº 222 est admirablement relié et conservé ; ses marges sont pures de toute annotation. Ce qui en fait le prix, c’est qu’il paraît provenir de la bibliothèque de Pierre Pithou lui-même.
Quant à l’exemplaire de Berne, il a appartenu à Jacques Bongars, savant bibliophile, qui, pendant de longues années, fut auprès des cours d’Allemagne le ministre plénipotentiaire du roi Henri IV. Intimement lié avec les frères Pithou, il avait pu sans peine avoir communication du manuscrit, et, se livrant dessus au travail comparatif qu’entreprit plus tard Dom Vincent sur celui de Reims, il en reporta les variantes sur l’exemplaire imprimé. Aussi a-t-il été d’un grand secours au philologue suisse Orelli pour l’édition qu’en 1831, à Zurich, il a donnée des anciennes fables de Phèdre. Il faut pourtant reconnaître que la publication du manuscrit de Pithou par M. Berger de Xivrey a fait perdre à cet exemplaire, comme à celui de Rigault, une grande partie de son importance scientifique.
J’ai voulu savoir comment il était entré dans la Bibliothèque de Berne, où, pendant l’été de 1870, j’avais été d’Évian l’examiner. Mais l’idée d’éclaircir ce point m’étant seulement venue pendant le siège de Paris, j’ai dû en attendre la fin. Au mois de mars 1871, la capitale de la France étant sortie de sa séquestration forcée et ses communications ayant été rétablies, j’ai écrit, pour me renseigner, au conservateur de la Bibliothèque bernoise, M. de Steiger, qui déjà, l’été précédent, m’avait fait l’accueil le plus empressé.
Voici la réponse qu’il m’a adressée :
« Berne, le 14 mars 1871.
« Monsieur,
« En réponse à votre honorée du 5 courant, j’ai l’avantage de vous faire savoir que Jacques de Bongars, seigneur de Bauldry et la Chesnaye, né à Orléans en 1554, décédé à Strasbourg en 1612, avait {p. 50}tant dépensé pour l’érudition, et avait été si mal appointé par le roi Henri IV, qu’il ne put pas rembourser les avances considérables, faites par son ami René de Gravisette, natif de la Lorraine. Gravisette, peut-être son beau-frère, reçut par conséquent, selon le testament de Bongars, en place de l’argent comptant qu’il ne pouvait lui rembourser, sa bibliothèque personnelle. Cette bibliothèque, ramassée avec beaucoup de soins et de connaissances littéraires, se composait de passés 5 000 volumes d’ouvrages imprimés et d’à peu près 600 volumes manuscrits. Le magistrat de Strasbourg avait refusé à Bongars l’achat de cette précieuse collection.
« René de Gravisette mourut en 1614, et son fils Jacques, homme lettré, vint se fixer à Berne, et fit cadeau de toute cette bibliothèque à la ville de Berne, qui l’obtint en 1632. Les Gravisette n’existent plus que par la descendance féminine.
« Voilà nos droits de propriété.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Veuillez, Monsieur, agréer l’assurance de ma considération distinguée.
« Le bibliothécaire de la ville de Berne,
« Charles-Louis de Steiger. »
Il faut aujourd’hui se féliciter du refus fait par le magistrat de Strasbourg d’acheter la collection de Bongars ; car il est probable qu’elle n’aurait pas été épargnée par les obus allemands plus que le reste de la grande bibliothèque strasbourgeoise.
La lettre de M. de Steiger avait surexcité ma curiosité. L’été qui suivit la date de cette lettre, faisant un voyage nouveau en Suisse, je passai par Berne, et, m’étant rendu à la bibliothèque de cette ville, j’y trouvai M. de Steiger, qui, avec une extrême obligeance, s’empressa de me montrer le superbe fonds de Bongars composé de plus de cinq cents manuscrits sur vélin. Ils contiennent surtout des romans et des chansons de geste et forment une des plus belles collections qu’on puisse voir des monuments de la littérature française au moyen âge.
Le complaisant bibliothécaire voulut bien aussi me communiquer l’exemplaire de l’édition de Pithou ; il portait sur le catalogue le nº 252 et la lettre F. Bongars l’avait fait relier avec d’autres opuscules, dont voici les titres dans leur ordre :
{p. 51}1º Variorum poematum liber I. Lyrica. Auctore Andrea Valladerio…, Parisiis, ex officina Nivelliana apud Sebastianum Cramoisy, via Jacobæa sub Ciconiis MDCX. (Ces poèmes, qui remplissent les 67 premières pages, sont suivis de l’éloge de Henri IV par le même auteur, pages 68 à 85.)
2º Petrine Veletidoschii ; sacrorum liber singularis. Sedani, apud Jacobum Salessium, 1602. (Cet opuscule, qui occupe 44 pages, contient des poèmes latins, dont les sujets sont empruntés à la Bible.)
3º Poëmes chrestiens et moraux. Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris. (Cet opuscule est imprimé en caractères gothiques sans pagination.)
4º Phædri Aug. liberti fabularum Aesopiarum libri V, Nunc primum in lucem editi, etc., etc.
5º Canzone nelle presenti turbationi di stato, MDCVI. (C’est un petit poème en vers italiens, contenu dans six pages.)
Les notes, mises en marge de l’édition de Phèdre, sont d’une écriture très nette et très lisible. Malheureusement, si petit que fût le format de cette édition, il était encore plus grand que celui des autres imprimés, auxquels elle était réunie, et le relieur avait dû rogner les marges au point de tronquer les notes, auxquelles par suite manquent des fragments de mots, des mots entiers et même des lignes. Cet accident n’empêche pas de reconnaître dans ce qui reste les variantes du manuscrit de Pithou.
À la suite de la dernière fable, on lit cette observation qui
montre que le manuscrit avait bien été à la disposition de Bongars : « Seqr. in v. c. libellus de variis monstris ac
portentis ex fabulis Græcorum et al. »
J’aurais maintenant à m’occuper des trois exemplaires de l’édition de Pithou, conservés à Londres et à Oxford ; je me bornerai à en donner le signalement.
Deux de ces exemplaires se trouvent au British Museum. L’un appartient au département des imprimés et figure au Catalogue général sous la cote 685. D. Q. C’est le plus bel exemplaire que je connaisse. Les marges en sont presque entières et la reliure en maroquin rouge en est splendide. L’autre appartient à un fonds spécial qu’on appelle la Grenville Library, et dans lequel le nº 9064 lui a été attribué. Les marges en sont courtes ; mais la reliure en maroquin vert en est extrêmement soignée.
{p. 52}L’exemplaire d’Oxford est conservé à la Bibliothèque Bodléienne, où il est depuis de longues années catalogué sous la cote Auct. L. A. 9. Il est parfaitement conservé, et ses marges, quoique pleines, ne portent aucune note manuscrite.
Je n’ai aucune observation particulière à présenter relativement aux deux exemplaires de Cambridge.
Enfin, je ne dis qu’un mot de celui de Florence. Indépendamment du fonds général qui ne se compose que de manuscrits, la Bibliothèque Laurentienne possède un fonds spécial qui du nom du donateur est appelé fonds d’Elci et qui comprend à la fois des manuscrits et des imprimés. Parmi les imprimés de ce fonds figure l’exemplaire de l’édition originale de Phèdre qui y porte la cote 384 E. 3. Il est remarquable par son parfait état de conservation.
Tels sont les seuls exemplaires que je connaisse de l’édition publiée par Pierre Pithou. Je reviens maintenant à l’éditeur lui-même.
« Dès que l’Édition de Phèdre fut terminée, dit Grosley, M. Pithou, qui l’avoit fait faire à ses frais, l’envoya à Paris à Nicolas Lefebvre qui se chargea de la faire débiter, et qui en distribua des Exemplaires à leurs amis communs. De ce nombre étoit le P. Sirmond : il étoit alors à Rome, où il reçut de la part de M. Pithou l’Exemplaire qui lui étoit destiné76. »
« Les Fables de Phèdre, ajoute Grosley un peu plus loin, furent le dernier présent dont M. Pithou enrichit la République des Lettres ; il ne survécut que deux mois à l’Édition de ces Fables77. »
Il mourut âgé de cinquante-sept ans, à Nogent-sur-Seine, le 1er novembre 1596, jour anniversaire de sa naissance.
« Son corps, dit Adry78, fut transporté à Troyes, où ses compatriotes lui rendirent
des honneurs sans exemple. Toutes les compagnies en corps assistèrent aux
obsèques de Pierre Pithou, et le luminaire était aux armes de la
ville. »
Après sa mort, les apologistes ne lui ont pas manqué. À leur {p. 53}tête il faut placer de Thou, qui a fait de lui le plus brillant éloge79.
Mais personne n’a tracé de lui un portrait plus simple, ni plus touchant, que lui-même dans son testament écrit en langue latine neuf ans avant sa mort, le 1er novembre 1587, jour anniversaire de sa naissance. Je renvoie ceux qui voudront le lire au texte et à la traduction française, qui en ont été publiés par son biographe80.
Après ce que j’ai dit de Pierre Pithou et de l’édition qu’il a donnée des fables de Phèdre, il serait naturel que je fisse connaître ce qu’est devenu son manuscrit. Mais je dois auparavant rectifier les idées erronées qui existent sur l’origine de ce document.
Pierre Pithou, indépendamment de ses deux frères consanguins, avait un frère germain, nommé François et plus jeune que lui de quatre années. Les deux premiers étaient des hommes distingués ; le troisième, s’il n’avait pas son aménité et sa modestie, l’égalait du moins par l’étendue de ses connaissances.
Pendant les guerres de religion il s’était exilé à Bâle, où il avait publié la traduction latine des Novelles de Justinien par le professeur Julien, était revenu en France, s’était, à l’exemple de son frère, converti au catholicisme, et enfin, en 1580, avait été reçu avocat au Parlement de Paris. C’est lui qui, ainsi que je l’ai répété d’après Grosley, avait communiqué à son frère le précieux manuscrit.
Mais de qui le tenait-il ? Telle est la question qu’en présence du
silence des frères Pithou, on a vainement essayé de résoudre. Adry en a cherché
sans succès la solution. Ce savant a imaginé une explication fantaisiste, qui lui
a été sans doute inspirée par le passage suivant de la Nouvelle
Diplomatique des Bénédictins : « Pierre Daniel, bailli de
Saint-Benoît-sur-Loire, qu’il qualifie de plus célèbre et premier collège de
toute la France, profita du pillage de ce monastère par les Huguenots ; après
s’être emparé d’une bonne partie de ses manuscrits, il eut l’adresse d’en
racheter d’autres à vil prix. »
Partant de là, Adry a supposé que François Pithou avait dû tenir de
Daniel le manuscrit de Phèdre, et, à défaut de preuves, il s’est efforcé de
justifier son hypothèse par l’explication suivante : « MM. Pithou étaient
très liés avec Daniel, et ils l’étaient avec plusieurs {p. 54}protestants. Ils étaient helluones librorum, et, comme on le
dit dans le Scaligeriana, ils sentaient les livres, comme le
chat les souris. Ils achetaient tous les manuscrits qu’ils pouvaient trouver, et
sans doute ils ne négligèrent pas une si belle occasion d’enrichir leur librairie (c’était le terme), que celle que leur offrait la
dispersion des livres de la bibliothèque de Saint-Benoît et de plusieurs autres
bibliothèques. Il est à présumer que le vendeur, dont les titres n’étaient pas
merveilleusement constatés, exigea des acheteurs un silence qu’ils lui gardèrent
fidèlement81. »
Avocat à Orléans, sa ville natale, Daniel avait été appelé par le cardinal Odet de Châtillon aux fonctions de bailli de l’abbaye de Saint-Benoît-Fleury.
Il avait fait ce qui était en son pouvoir pour épargner à la bibliothèque de cette abbaye le pillage auquel les calvinistes la livrèrent.
N’ayant pu l’éviter, il avait, en les achetant des pillards eux-mêmes, sauvé beaucoup de livres. Mais il n’en faut pas conclure que le manuscrit avait été une épave sauvée du naufrage par le vigilant Daniel, qui, sans avoir eu de motifs pour la cacher, en aurait laissé longtemps ignorer l’existence. Je ne puis le croire. Qu’on se rappelle les dates. C’est en 1562 que la bibliothèque fut saccagée, et c’est seulement en 1596 que la première édition de Phèdre fut publiée. Celui qui sut, dès 1564, exhumer l’Aulularia, comédie médiocre82, aurait donc laissé trente-quatre ans dormir, dans les rayons de sa bibliothèque, un des auteurs latins qui ont le mieux conservé, à travers les âges, l’empreinte d’une éternelle jeunesse ! Cela n’est pas admissible. On m’objectera sans doute qu’il avait bien eu la même indifférence pour le manuscrit, auquel on a ensuite donné son nom. Cela est vrai ; mais ce manuscrit ne contenait qu’un fragment, à peine huit fables du premier livre. Il est aisé de comprendre qu’il n’ait pas jugé qu’un si mince lambeau méritât les honneurs d’une publication spéciale, et il est permis de supposer qu’il n’aurait pas pensé de même, si, au lieu de ce lambeau, {p. 55}il eût possédé les cinq livres de fables. Au surplus, dans l’édition originale de Pierre Pithou, on trouve la preuve matérielle, fournie par lui, que son manuscrit ne provenait pas de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. En effet, à la fin des variantes qu’il en extrait, il l’appelle vet. ex. Cat., ce qui, suivant Orelli, signifie vetus exemplar Catalaunense ou Catuacense, c’est-à-dire antique exemplaire de Châlons-sur-Marnе ou de Douai. Adry aurait donc pu s’épargner son hypothèse fantaisiste.
Faut-il avoir plus de confiance dans la version dont le Père Brotier, sur la foi des journalistes de Trévoux83, se fit le propagateur irréfléchi ? Il raconte que le Père Sirmond avait trouvé en Lorraine le premier manuscrit de Phèdre, qu’il l’avait envoyé à François Pithou, son ami, et que Pierre Pithou, l’ayant ensuite reçu de son frère, en aurait ainsi publié la première édition.
On comprend, sans que j’aie besoin d’insister, tout ce qu’il y a d’erroné dans ce récit. L’édition de Pithou parut en 1596. Or, à cette époque, le Père Sirmond était à Rome depuis longtemps, et il ne revint en France que douze ans après.
Dans la mauvaise édition de Phèdre qu’il publia en 1809,
Boinvilliers aggrava en ces termes l’erreur de Brotier : « Les fables de
Phèdre demeurèrent fort longtemps ensevelies dans la poussière des
bibliothèques, et peut-être seraient-elles encore ignorées aujourd’hui, si
François Pithou ne les avait découvertes à Reims dans la bibliothèque de
Saint-Remi, et ne s’était empressé de les publier conjointement avec son frère
en 1596. »
La vérité, c’est que le silence des frères Pithou empêche aujourd’hui de remonter à l’origine de leur manuscrit.
Voyons maintenant par quelles mains, depuis 1596, il est successivement passé.
Pierre Pithou avait eu quatre garçons ; mais ils étaient morts en bas âge84.
« II n’étoit resté à M. Pithou, observe Grosley85, que deux filles de son mariage avec Catherine de Palluau. Louise, l’aînée, épousa depuis la mort de son père, Pierre Leullier, sire de Montigni, d’une {p. 56}famille ancienne dans la Chambre des Comptes. Marie, la cadette, fut ensuite mariée à Jean Leschassier, Conseiller au Châtelet, neveu de Jacques Leschassier, jurisconsulte célèbre, dont les Ouvrages sont réunis en un volume in-4º, imprimé en 1649, avec la vie de l’auteur, en Latin et en François. »
François Pithou survécut vingt-cinq ans à son frère, et mourut en 1621, âgé de 78 ans.
« N’ayant pas d’enfants, dit M. Berger de Xivrey, il légua au collège de Troyes, qu’il fonda par son testament, tous ses biens, à l’exception de legs particuliers à quelques personnes et de ses terres seigneuriales qu’il laissa à Pierre Pithou, son neveu, fils d’un troisième frère. Celui-ci, également neveu du fameux Pierre Pithou, prit le nom de Pithou de Bierne, de la seigneurie de Bierne, l’un des fiefs dont il hérita de son oncle François.
« Pithou de Bierne mourut sans postérité ; et ses biens, tant ceux provenant de son père que de son oncle François, retournèrent aux descendants de son oncle Pierre. »
La seconde des filles de P. Pithou, de son mariage avec Jean Leschassier, eut une fille, Marie Leschassier, petite-fille de Pierre Pithou, petite-nièce de François Pithou, nièce de Mme Leullier de Montigny et cousine de Pithou de Bierne.
« De son mariage avec Louis Le Peletier, secrétaire du roi, ajoute Grosley, naquit l’illustre Claude Le Peletier, qui succéda au grand Colbert dans le contrôle général des finances. »
Claude Le Peletier, à son tour, eut pour héritier son frère, Michel Le Peletier de Souzi, conseiller d’État, intendant des finances, directeur général des fortifications et membre honoraire de l’Académie des Inscriptions.
C’est ainsi que le manuscrit des fables de Phèdre passa, au xviie siècle, dans la famille Le Peletier.
Il ne faudrait pas cependant croire qu’il provenait de la succession de François Pithou, et Grosley pense à tort qu’on devra s’étonner de ne pas le trouver dans le catalogue des manuscrits de ce dernier.
Il est probable qu’après l’avoir reçu de lui, son frère l’avait
gardé et laissé, en mourant, à ses héritiers directs. Il n’a pu même en être
autrement ; car François Pithou, ainsi que nous l’avons vu, avait légué une grande
partie de ses biens au collège de Troyes, et, si l’on se réfère à son testament,
on y trouve cette disposition : « Je {p. 57}lègue audict
collège toute ma bibliothèque et tous les livres qui se trouveront en ma
maison. »
Si donc Pierre avait rendu le manuscrit à son frère, il ne serait pas entré dans la famille Le Peletier.
Envoyant apparaître la publication de Pierre Pithou, les savants éprouvèrent un premier sentiment de méfiance. L’authenticité d’un auteur si tardivement découvert leur sembla suspecte, et il faut avouer que le silence des frères Pithou justifiait un peu leur réserve. Mais elle ne dura pas longtemps, et les fables de Phèdre ne tardèrent pas à être l’objet de leurs études. En 1599, Nicolas Rigault, jeune encore, mais déjà savant, songea à refaire le travail un peu précipité de celui dont il avait été l’ami et dont il était resté l’admirateur, et ce ne fut qu’après une étude consciencieuse du manuscrit qu’il en publia une nouvelle édition. Ceux qui douteraient qu’il y eut réellement recours, en allant voir à la bibliothèque Sainte-Geneviève l’exemplaire déjà mentionné de l’édition de Pithou, pourraient mettre facilement un terme à leur incertitude. Il porte écrites de la main de Rigault les variantes du manuscrit avec les initiales V C, c’est-à-dire vetus codex, en avant de chacune d’elles.
Jacques Bongars, en même temps que Rigault, prit connaissance du manuscrit, et, ainsi que je l’ai expliqué, en transporta les variantes en marge d’un exemplaire de l’édition de Pithou.
Mais, après ces deux savants, aucun de tous ceux qui écrivirent sur Phèdre, ne songea à recourir au manuscrit. Schwabe fait bien figurer Gude parmi ceux qui l’ont étudié ; mais son assertion est justement révoquée en doute par M. Berger de Xivrey86 ; car le manuscrit connu de Gude fut celui de Reims. Beaucoup, comme Lessing, croyaient que le manuscrit de Pithou n’existait plus. Il s’était ainsi écoulé presque deux siècles, sans qu’aucun commentateur l’eût examiné, lorsqu’en 1780 il fut communiqué au Père Brotier par M. Le Peletier de Rosanbo, premier président du Parlement de Paris.
La Révolution survint. Sous la Terreur, on trouva ce magistrat
dépositaire d’une protestation de ce Parlement contre la Convention. Ses
collègues, après l’avoir signée, la lui avaient confiée. « Cet {p. 58}honneur dangereux, dont il était digne par son rang et par son
caractère, lui coûta la vie et la confiscation de ses biens87. »
Le manuscrit de Pithou n’avait pas été excepté. Adry, dans sa Dissertation sur les quatre manuscrits de Phèdre88, raconte que M. Le Peletier de
Rosanbo lui avait promis de le lui montrer, et il ajoute : « On l’a vu dans
sa bibliothèque, lorsqu’on s’empara de ses biens ; et, lorsqu’ils ont été rendus
à sa famille, il ne s’est plus retrouvé. »
Heureusement il n’en était pas ainsi ; car, en 1812, Adry lui-même,
dans son Examen des nouvelles fables de Phèdre, indique qu’il
est dans les mains de M. Le Peletier de Rosanbo, fils de l’infortuné président du
Parlement de Paris89, et voici comment il s’exprime dans une des notes, dont il a
enrichi les Disputationes du Père Desbillons : « MM. Le
Pelletier (sic) ont hérité en partie des savants Pithou, dont
ils étaient les parents par une Leschassier, et le manuscrit, actuellement
unique de Phèdre, est encore aujourd’hui dans leur bibliothèque. On m’avait
trompé, en m’assurant qu’il en avait disparu il y a quelques
années. »
En 1806, Schwabe, le croyant perdu, avait, dans son Index codic. manuscript. Phædri90, exprimé le regret que les érudits, qui l’avaient étudié, n’en eussent pas donné une description plus complète et plus exacte.
L’article, dans lequel Schwabe exprimait ce regret, a été
reproduit, en 1826, dans la collection des classiques latins de Lemaire avec une
note de Barbier ainsi conçue : « Ce précieux manuscrit existe encore
aujourd’hui dans la bibliothèque de M. le vicomte Le Pelletier de Rosanbo, pair
de France91. »
{p. 59}Cette note étant parvenue à sa
connaissance, Schwabe « écrivit à M. Hase, membre de l’Institut, pour lui
demander s’il ne serait pas possible d’obtenir communication de ce manuscrit et
de le publier92 »
. M. Hase, trop affairé pour s’occuper de cette
publication, engagea M. Berger de Xivrey à s’en charger.
Celui-ci, plein de déférence pour M. Hase, s’empressa de se rendre à son désir, et, au mois de mai 1828, il écrivit à M. Le Peletier de Rosanbo, pour lui demander l’autorisation d’éditer le précieux manuscrit. Le noble pair ne parut pas d’abord très disposé à accueillir la requête qui lui était adressée ; il répondit une lettre évasive, dans laquelle il disait que le manuscrit était dans sa bibliothèque à la campagne, et que d’ailleurs, avant d’en autoriser l’impression, il désirait consulter un de ses amis qu’il ne devait voir que l’hiver suivant.
L’hiver se passa, et M. Le Peletier ne fit pas connaître l’opinion du savant attendu. M. Berger de Xivrey, rendu plus tenace par la résistance même, pria à son tour M. Hase de lui venir en aide.
Au mois de mai 1829, M. Hase alla trouver M. Le Peletier qui avait
rapporté le manuscrit à Paris. « Il en admira, dit M. Berger de Xivrey, la
beauté et l’antiquité, lui expliqua sommairement de quoi il s’agissait, et
obtint pour moi une entrevue, que des affaires pressantes le forcèrent de fixer
au mois suivant93. »
M. Berger de Xivrey la fit précéder d’une longue lettre, dans
laquelle il lui expliquait comment la mémoire même de Pierre Pithou était
intéressée à une publication, qui devait « la laver d’un doute
injurieux »
.
« M. de Rosanbo, ajoute-t-il94, me répondit aussitôt, en me réitérant l’offre d’une entrevue, qui eut lieu le 16 juin, dont le résultat fut la permission de copier le manuscrit, d’en faire prendre un fac-simile et de lui dédier ce travail. M’ayant exprimé le désir que le manuscrit ne sortît pas de son hôtel, et devant partir pour la campagne le 25 juin, je vins, dès le lendemain 17, travailler à cette copie dans son cabinet, où je continuai à venir travailler pendant quatre heures tous les jours suivants jusqu’au 25, jour où, ayant {p. 60}fini ma copie, j’amenai le dessinateur, qui exécuta sous mes yeux le fac-simile. »
Ce fac-simile a été pris sur la première moitié de la page 70. Ce n’est pas sans intention que M. Berger de Xivrey a reproduit de préférence à tout autre ce passage du manuscrit. Là, en effet, existe une lacune, dont on ignore l’importance. La page commence par ce vers de la fable Leo regnans :
Posquam labare cœpit pœnitentia,
et ce membre de phrase, laissé inachevé, est immédiatement suivi des trois derniers vers d’une autre fable, qui, à en juger par ce qui en reste, devait être fort licencieuse.
Puis vient la fable Rogavit alter tribadas, etc., dont l’écriture est imitée jusqu’au vers :
Sero domum est reversus titubanti pede.
M. Berger de Xivrey, sachant combien cette partie du manuscrit avait donné de peine aux savants, l’avait évidemment choisie dans la pensée de fournir une base bien précise à leurs méditations ultérieures. Il faut l’en remercier.
L’année suivante, il publiait enfin le fameux monument chez l’imprimeur Ambroise Firmin-Didot en un volume in-8º de 268 pages.
La même année, au mois de décembre, M. Daunou, dans le Journal des savants, faisait paraître sur cette publication une notice
justement élogieuse, qui se terminait ainsi : « Cette édition préparée,
disposée, exécutée avec un grand soin, nous paraît mériter l’attention des
hommes de lettres. Elle n’a été tirée qu’à deux cents exemplaires. Ce nombre
devra paraître insuffisant et rendre nécessaire une édition
nouvelle. »
Le succès n’a pas répondu au mérite, et les deux cents exemplaires ont plus que suffi. Tant il est vrai que les œuvres de pure érudition n’intéressent qu’un petit nombre de personnes et que, pour les entreprendre, il faut posséder tout à la fois un grand amour de la science et une forte dose d’abnégation.
§ 2. — Description du manuscrit. §
Avant de charger la librairie Firmin-Didot d’imprimer cette seconde édition, j’ai fait de nombreuses démarches pour être admis à prendre, sinon copie, au moins connaissance du manuscrit de Pierre Pithou. Malgré l’appui qui à cet effet m’a été très obligeamment prêté par un ami de la famille de Rosanbo, ma tentative n’a pas encore réussi. Si, avant que l’impression de mon deuxième volume ait été commencée, j’ai été enfin admis à copier le texte de Phèdre, je l’y publierai diplomatiquement, et, en procédant ainsi, je tâcherai d’éviter les erreurs matérielles qu’à tort ou à raison on soupçonne M. Berger de Xivrey d’avoir commises. Sinon, l’édition que je publierai sera une simple reproduction de la sienne.
Quant à présent, pour la description du manuscrit je ne puis mieux faire que transcrire littéralement celle qu’il en a lui-même donnée.
« Il est, dit-il95, tout entier d’une très belle conservation. L’écriture est de la plus grande régularité ; c’est cette minuscule arrondie du xe siècle que les calligraphes de Florence imitèrent au xvie, mais en diminuant la dimension des lettres, et en ornant leurs majuscules de jolies arabesques ; tandis que les manuscrits des ixe et xe siècles n’ont le plus souvent aucune espèce d’ornements. C’est le cas de celui-ci. Les grandes lettres du commencement des fables sont des majuscules toutes simples, écrites avec pureté et ayant environ trois ou quatre fois la hauteur des autres lettres. Elles sont d’une encre rouge ou tirant sur le violet. Les titres sont d’un beau rouge, ce qui indique facilement à l’œil la séparation des fables. Car du reste ils sont écrits à la suite des derniers mots de la fable précédente, et, par conséquent, ne commencent la ligne que si la dernière ligne de la fable précédente est entièrement remplie. Quant au corps de la fable, il commence toujours avec la ligne, et sa première lettre, qui est, comme nous l’avons dit, une majuscule, est toujours à la marge. Tout ce qui n’est pas titre ou majuscule initiale est d’un brun assez clair, mais cependant toujours facile à voir.
{p. 62}« Il paraîtrait que le calligraphe, après avoir écrit tout son manuscrit, l’a relu et a corrigé tantôt bien, tantôt à contre-sens. C’est ce qu’indiquent certaines corrections d’une encre un peu plus foncée, mais évidemment de la même main. De là les doubles leçons pour le même mot.
« La séparation des vers n’est nullement indiquée. Les mots y sont ou réunis, ou bien séparés tantôt régulièrement, tantôt à contre-sens, comme dès le commencement : Hance go polivi.
« Le seul véritable signe de ponctuation qu’on y rencontre est le point d’interrogation. Quant au point en haut, en bas, au milieu, et même quelquefois joint à la virgule, il ne signifie rien, le calligraphe, qui paraît n’avoir pas compris ce qu’il écrivait, les ayant placés comme au hasard. Quelques-uns servent aussi de ce que les Grecs appelaient διαστολή.
« L’allitération n’y est pas observée dans les mots où nous la plaçons. On la trouve très rarement et justement dans les mots où nous n’en mettons pas, comme ammonere pour admonere, page 39 du manuscrit, ammirans pour admirans, page 44 du manuscrit, sumtus au lieu de sumptus, etc.
« Les lettres l et i ou j au commencement des mots sont absolument pareilles, ce qui fait que jocus ne peut se distinguer de locus que par le sens.
« L’e y est assez souvent substitué à l’i, le b au v et l’o à l’u.
« Les principales abréviations sont un trait au-dessus de la voyelle, à la place de la lettre m, le même trait pour indiquer la duplication des consonnes, et sur l’e pour est, q. pour que, conjonction copulative.
« : pour la terminaison us aux datifs pluriels, après un b.
« Un trait au-dessous de l’e, à peu près de cette forme v (ev) pour æ, diphthongue.
« ꝑ pour per.
« p̃ pour præ.
« ꝓ pour pro.
« & pour et.
« La reliure est en carton recouvert d’un parchemin tout uni. Le manuscrit est écrit sur un parchemin d’une épaisseur moyenne. Il est in-4º et contient 54 feuillets, dont les fables de Phèdre n’occupent que les 38 premiers, qui sont numérotés par pages, c’est-à-dire {p. 63}sur le recto et le verso. Les autres, qui ne sont point numérotés, renferment une espèce d’ouvrage d’histoire naturelle fabuleuse, ou description d’êtres comme les Centaures, etc.
« Au commencement ont été reliés 32 feuillets en papier, qui sont la copie du manuscrit, de la main de Pierre Pithou. Cette copie offre cela de très remarquable que l’on y voit, en même temps, la distribution par vers96, les leçons du manuscrit, les corrections et tâtonnements de Pithou, et ses observations en français pour le prote. Ainsi cette seule copie renferme tout le travail de son édition. Une aussi brillante facilité explique les immenses travaux de quelques savants de cette époque. Elle démontre aussi la fausseté de plusieurs idées que l’on s’était formées sur le manuscrit, d’après l’édition de Pithou, qui est la reproduction fidèle, non pas du manuscrit, mais de cette copie.
« M. Adry, jugeant du manuscrit par l’édition, a établi une comparaison très fautive entre le manuscrit de Pithou et celui de Reims. “Dans celui-ci, dit-il97, les lacunes ne sont point indiquées ; tous les mots se suivent, lors même qu’il est évident que plusieurs vers sont omis ; et on lit à la fin : Phædri Aug. liberti liber V explicit feliciter, quoique le P. Brotier n’en fasse pas mention. Dans le manuscrit de M. Pithou, au contraire, rien n’annonce une fin ; il y en avait même un feuillet déchiré à la fin, et il y en avait d’autres dans le corps de l’ouvrage. M. Pithou en fait la remarque, et il indique ces lacunes par des lignes ponctuées.”
« Pithou, ainsi que les autres savants de son temps, ne mettait pas à la fidèle transcription des textes cette exactitude sévère de l’érudition moderne. Comme le prouve sa copie, que j’ai sous les {p. 64}yeux, il copiait le manuscrit, le corrigeait dans les endroits corrompus pour lesquels il trouvait des corrections, indiquait par des étoiles les lieux où, d’après le sens, il devait y avoir des lacunes, sans rendre compte de son travail par aucune note, et en se contentant de mettre à la fin une liste incomplète des variations du manuscrit (vetustissimi codicis scriptura). Ainsi, ces lignes ponctuées n’indiquent nullement des lacunes observées dans le manuscrit, où tout se suit aussi bien que dans le manuscrit de Reims. De plus, Pierre Pithou ne fait nulle part l’observation, comme le dit M. Adry, qu’il y ait des lacunes dans le corps de l’ouvrage. Quant à ce prétendu feuillet déchiré, après la dernière page, voici la phrase de Pithou : “Post hanc postremam lineam abscissi sequentis proxime folii vestigia extant.” Il n’en reste plus la moindre trace aujourd’hui, ce qu’explique cette réunion de la copie de Pithou sous la même reliure que le manuscrit. On aura ôté, en reliant, ce lambeau de parchemin, qui très probablement était déchiré d’assez près pour n’offrir qu’une partie de la marge sans aucune lettre. Je suis même porté à croire que c’était un feuillet blanc, et voici pourquoi.
« Il semble, à la dernière page, que le calligraphe ait espacé davantage les mots, afin de faire arriver jusqu’au bas de la page ce qui lui restait à copier. Il a même laissé en blanc la fin des deux dernières lignes de l’avant-dernière fable et la fin de la dernière ligne de la dernière fable ; ce qui n’a lieu nulle part ailleurs, le titre suivant s’écrivant toujours à la suite des derniers mots ; et ce qui me semble prouver que l’original dont se servait le copiste n’en contenait pas davantage. Ensuite, le petit traité, qui vient dans le manuscrit après les fables de Phèdre, semble assez complet. Il commence ainsi :
« “Primo namque de his ad ortum sermo prorumpit quæ leviore discretu ab umano (sic) genere distant, daturus operam de singulis quæ terra fovet mortalium nutrix aut quondam fovisse fertur. Quia nunc humano genere multiplicato, et terrarum orbe repleto sub alstris (sic) minus producuntur monstra. Quæ ab ipsis per plurimos terre (sic) angulos eradicata funditus et subversa legimus, etc…”
« L’écrivain avait peut-être commencé à copier ce traité De Monstris avant d’avoir achevé Phèdre ; et il avait laissé, pour achever celui-ci, la quantité de parchemin qu’il supposait nécessaire. Quand {p. 65}ensuite il le termina, il se trouva une feuille de trop, qui plus tard aura pu être arrachée comme ne servant à rien en cet endroit, et dont les dernières traces ont disparu, lorsque Pithou a fait relier sa copie avec le manuscrit. »
Cette citation me semble suffisante pour donner une idée complète du manuscrit, et je n’y ajouterais rien, si je n’avais pas à rectifier deux erreurs.
D’abord le feuillet déchiré, dont le relieur de Pithou a fait disparaître la trace, n’était pas un feuillet blanc. Lorsque j’aurai à examiner le manuscrit de Wissembourg et la lettre latine, par laquelle le professeur allemand Tross en a donné l’analyse au professeur français Fleutelot98, je montrerai que le feuillet déchiré n’était pas dépourvu d’écriture et qu’au contraire il contenait le commencement du Liber monstrorum, qui, contrairement à la supposition de M. Berger de Xivrey, ne débutait pas par les mots Primo namque.
Ensuite je dois signaler l’erreur qu’en voulant critiquer la
division en cinq livres adoptée par Pierre Pithou, M. Berger de Xivrey a lui-même
involontairement commise. Après avoir émis la pensée que le feuillet disparu était
blanc, il ajoute : « Quoi qu’il en soit de cette conjecture, il ne pouvait
toujours y avoir sur cette feuille, comme le suppose M. Schwabe99, Phædri Aug. liberti liber quintus
explicit, d’abord parce que la division en cinq livres (confirmée, il est
vrai, par le manuscrit de Reims) est une correction de Pithou ; ensuite, parce
qu’on ne trouve pas ordinairement dans les manuscrits ces mots-là ainsi rejetés
au haut d’une autre feuille. Le calligraphe s’arrange plutôt pour serrer un peu
son écriture. Or ici, au contraire, comme je l’ai fait observer, il semble avoir
eu plutôt l’intention de l’espacer davantage, afin de remplir toute la
page. »
M. Berger de Xivrey fait remarquer que la division en quatre livres rend très facile l’interprétation de ce vers de la fable Poeta ad Particulonem, qui a fait le désespoir des commentateurs :
Quartum libellum dum Variæ perleges.
{p. 66}Suivant lui, ce vers s’explique, si les fables qui suivent appartiennent au livre IV. La fable Poeta ad Particulonem devient, dans ce livre d’abord interrompu, un nouveau prologue, par lequel Phèdre, après avoir quelque temps cessé d’écrire, commence la seconde série de fables qui doit le compléter.
Cela est fort juste ; mais en faut-il conclure que tout le reste du
manuscrit appartienne au quatrième livre ? Ici, malgré ma déférence pour l’auteur,
je suis obligé de m’écarter de son opinion. Sans doute rien dans le manuscrit ne
révèle l’existence d’un cinquième livre ; mais, quand on prend la peine de
chercher en dehors les renseignements qu’il ne fournit pas, on ne tarde pas à la
découvrir. Avianus, dans sa préface à Théodose, en parlant des auteurs qui ont
imité les récits d’Ésope, s’exprime ainsi : « Phèdre d’une partie a formé
cinq livres. »
Pithou, guidé par ce renseignement, a divisé le manuscrit en cinq livres, et la découverte de celui de Reims a montré qu’il avait eu raison de s’en rapporter à Avianus.
Ce manuscrit, qui était à peu près identique à celui de Pithou et qui contenait le même nombre de fables dans le même ordre, se terminait par ces mots :
Phædri Augusti liberti Liber quintus explicit feliciter.
Mais où finissait le quatrième livre et où commençait le cinquième ? Voilà ce que Pithou, après avoir été si clairvoyant, ne me semble pas avoir entrevu.
Il arrête le quatrième livre à la fin du prologue, qui est intitulé Poeta ad Particulonem, et qui commence par ce vers :
Cum destinassem terminum operi statuere,
et, comme ce prologue est conçu dans des termes qui ne permettent pas de le mettre en tête du livre V, il le laisse dans le livre, auquel il appartient.
Puis il fait commencer le cinquième livre par la pièce de vers Æsopi nomen, etc. Il ne remarque pas qu’elle porte pour titre les
mots : Idem Poeta
, et que ces mots, qui la
rattachent à la précédente, ne permettent pas de la considérer comme le
commencement d’un livre nouveau.
Les éditeurs l’ont en général si bien compris qu’ils ont, les uns, {p. 67}supprimé le mot Idem, les autres, en substituant le mot quintum au mot quartum, fait du prologue Poeta ad Particulonem le commencement du cinquième livre. N’étant pas dans la bonne route, ils n’ont pu se tirer d’embarras, les uns qu’en supprimant un mot, les autres qu’en en changeant un autre. Certains, tels que Nicolas Rigault, n’ont pas pris tant de peine ; tout en plaçant le prologue en tête du livre V, ils ont laissé subsister le mot quartum.
Quel était donc le vrai chemin ? Il était facile à trouver : il suffisait pour cela de respecter l’ordre du manuscrit : on aurait vu que le quatrième livre se divise en deux parties bien nettement séparées. Après avoir écrit la première qu’il avait adressée à Particulon, Phèdre s’arrête, et, dans un premier épilogue qui commence par ce vers :
Supersunt mihi quæ scribam, sed parco sciens,
il lui déclare, que, quoique la matière soit encore fort abondante, il ne veut pas, dans la crainte de l’importuner, écrire davantage.
Puis, comme il est rare qu’un poète qui fait un pareil serment soit capable de le tenir, il reprend la plume, et ajoute à son livre IV une seconde partie, que, comme la première, il dédie à Particulon. Dans la pièce de vers, qui en est le prologue, il lui avoue qu’il s’est tout bas reproché sa détermination, et qu’il ne peut davantage résister au désir de composer de nouvelles fables. Il s’excuse de manquer à la parole donnée dans l’épilogue qui précède.
Quand on voit ainsi l’enchaînement des idées, on se demande comment des éditeurs tels que Pithou ont pu, terminant le quatrième livre par le prologue de la deuxième partie, attribuer au cinquième livre des fables et un épilogue qui appartenaient à la deuxième partie du quatrième.
Quoi qu’il en soit, voyons où se termine cette deuxième partie. Remarquant à la fin de la fable Demetrius rex et Menander poeta une lacune, dont l’étendue était impossible à connaître, mais qui était certainement considérable, j’avais d’abord supposé qu’elle embrassait toute la deuxième partie du quatrième livre moins cette fable encore incomplète, et les trois quarts ou au moins les deux tiers du cinquième livre. Mais un examen plus attentif ne m’a pas permis de persister longtemps dans cette première idée ; car le manuscrit ne laisse pas même place aux conjectures : la fin {p. 68}de la deuxième partie du quatrième livre s’y trouve nettement indiquée par un épilogue intitulé Poeta ad Particulonem, qui commence par ce vers :
Adhuc supersunt multa quæ possim loqui.
À partir de cet épilogue les deux manuscrits de Pithou et de Reims ne contenaient plus que cinq fables. Il en résulte dans le nombre des fables de chaque livre une disproportion fort grande, et je ne doute pas qu’elle ne soit la seule cause des divisions plus égales, mais absolument fausses, imaginées par Pithou et par tous les éditeurs qui l’ont suivi.
M. Berger de Xivrey avait bien vu ce qu’il y avait d’arbitraire dans le bouleversement, que souvent ils n’avaient pas craint de substituer à l’ordre des manuscrits ; mais, en reconnaissant leur erreur, il n’avait pas aperçu la véritable division, qui pourtant était facilement visible.
Voilà la vérité ; il était, je crois, important de la révéler. Car, ainsi qu’on le verra, si M. Berger de Xivrey a fourni aux savants des éléments certains, qui doivent leur servir à déterminer le véritable auteur des fables anciennes, à mon tour, en signalant les lacunes du manuscrit, je leur ai un peu procuré les moyens de fixer leur opinion sur l’authenticité des fables nouvelles.
Section II.
Manuscrit de Reims. §
§ 1er. — Histoire du manuscrit. §
J’ai dit qu’à la fin du xvie siècle le jésuite Sirmond s’était rendu à Rome, et qu’il y avait obtenu du Saint-Père, en faveur de Pierre Pithou converti, l’absolution pontificale.
Arrivé dans cette ville en 1590, il y remplissait auprès du Père Aquaviva, général de sa compagnie, les fonctions de secrétaire, lorsque furent publiées les fables de Phèdre.
Comme on l’a vu, Pierre Pithou lui en avait fait adresser un exemplaire.
{p. 69}En 1608, lorsqu’il rentra en France, le
Père Sirmond n’avait pas oublié la découverte des frères Pithou. Il traversa la
Lorraine et la Champagne, fit partout sur son passage des recherches minutieuses,
et s’arrêta à l’abbaye de Saint-Remi. C’est là qu’il avait le plus de chances
d’obtenir un résultat. Elle avait été, au moyen âge, un des principaux abris, dans
lesquels s’était conservé l’héritage du passé. « Les belles-lettres, dit
l’abbé Pluche100, étaient cultivées dans les écoles de
cette abbaye et dans celles de la cathédrale pendant que l’ignorance se
répandait partout. »
Dans la Bibliothèque de Saint-Remi se trouvait un
second manuscrit ; le Père Sirmond le découvrit.
Malgré sa très grande ressemblance avec celui de Pithou, ce
manuscrit présentait quelques variantes. Il les copia en marge d’un exemplaire de
l’édition de Pithou, et les communiqua à Rigault, qui s’en servit pour l’édition
in-4º, imprimée par Robert Étienne, qu’il publia en 1617, sous ce titre :
« Phædri Aug. liberti fabularum Æsopiarum libri V, nova
editio. »
Dans sa troisième édition, publiée en 1630, chez
Sébastien Cramoisy, édition in-12 qui n’a été qu’une réimpression de la seconde
augmentée des fables d’Avianus, Rigault répéta les mêmes variantes.
Ceux qui n’auront dans les mains que ces deux éditions, pourront
être portés à croire que Rigault se servit des variantes du manuscrit de Reims,
même pour sa première édition in-12, publiée à Paris chez Drouart à la fin de
1599. En effet, les éditions de 1617 et de 1630 sont précédées d’une lettre au
président Jacques-Auguste de Thou, datée des calendes de septembre 1599, et dans
la première phrase de cette lettre Rigault fait allusion en ces termes au
manuscrit de Reims, découvert par le Père Sirmond et utilisé pour la publication
de ces deux éditions : « Phædri libellos, a me nuper ad fidem Pithœani
codicis et alterius item vetustissimi, quem nobis et Remensi bibliotheca
doctissimi viri Jac. Sirmondi cura deprompsit, recognitos, ut tibi, Præses
amplissime, offerrem, tuoque nomini devoverem, fecit amicissimi tui Petri Pithœi
non sine ingenti desiderio relicta bonis omnibus recordatio. »
Il serait naturel de conclure de cette phrase que ce fut non pas en 1608, mais au plus tard en 1599, que le Père Sirmond découvrit {p. 70}le manuscrit de Reims, et pourtant cette conclusion serait bien fausse ; car, en 1599, le Père Sirmond était depuis longtemps à Rome.
Pour trouver le mot de l’énigme, il faut se référer à la première édition de Rigault. Imprimée dans le format in-12 chez Ambroise Drouart à la fin de 1599, elle se compose de deux catégories d’exemplaires, les uns portant ce millésime, les autres, celui de l’année suivante ; ce qui, soit dit en passant, a fort embarrassé Schwabe, et l’a porté à croire à l’existence de deux éditions distinctes, qu’il suppose l’une in-8º, et l’autre in-12101.
Cette première édition, comme celles de 1617 et de 1630, portait en
tête la lettre au président de Thou. Seulement il n’y était pas encore question du
Père Sirmond, et la phrase que je viens de citer, plus simplement conçue, se
formulait ainsi : « Phædri libellos nuper a me dum aliud ago Notis aliquot
illustratos, ut tibi, Præses amplissime, offerrem, tuoque nomini darem ac
devoverem, fecit amicissimi tui Petri Pithœi non sine desiderio relicta bonis
omnibus recordatio. »
Quant aux notes que Rigault avait insérées dans sa première édition, elles relevaient bien les variantes du manuscrit de Daniel dont j’aurai bientôt à m’occuper ; mais elles gardaient le plus absolu silence sur le manuscrit de Reims.
Il faut en conclure que ce manuscrit était encore ignoré, et que plus tard, conservant en tête de ses éditions de 1617 et de 1630 sa lettre au président de Thou, Rigault, pour la mettre en harmonie avec son nouveau travail, modifia les termes de la première phrase, mais laissa subsister la date de 1599, et opéra ainsi une confusion, qui est maintenant expliquée.
Le manuscrit de Pithou, étant resté la propriété particulière d’une famille, était peu accessible aux savants. Il était donc naturel qu’ils se servissent de préférence de celui de Reims, et cependant, sauf le docte Gude, ils ne prirent pas la peine d’y recourir.
Vers 1745, l’abbé Pluche se faisait bien communiquer un spécimen de l’écriture par Dom Le Vacher, alors bibliothécaire de Saint-Remi ; mais ce spécimen, qui ne contenait que la fable Vulpis ad рersопат tragicam, ne pouvait servir qu’à faire connaître l’âge du manuscrit ; c’était même, pour servir au petit traité de {p. 71}paléographie publié en 1770 dans son Spectacle de la nature102, qu’il se l’était fait adresser. Il lui suffisait d’avoir reconnu que l’écriture était du ixe ou du xe siècle et il ne songea pas à se rendre à Reims, ni à faire, sur le manuscrit même, une étude approfondie de Phèdre.
En 1769, un savant, attaché aux manuscrits de la bibliothèque du roi, M. de Foncemagne103, pria de même Dom Vincent, nouveau bibliothécaire de Saint-Remi, de lui adresser un fac-simile de l’écriture du manuscrit. Dom Vincent s’était empressé de lui donner cette satisfaction, et lui avait envoyé une copie, faite sur papier transparent : 1º du prologue du premier livre, 2º de la morale de la fable xvi du livre I, intitulée Ovis, Cervus et Lupus, 3º de trois vers environ de la fable xxx du même livre, intitulée Ranæ metuentes Taurorum prælia.
En envoyant à M. de Foncemagne cette copie, qu’il avait eu soin de prendre dans trois endroits présentant des leçons différentes de celles du manuscrit de Pithou, Dom Vincent y avait ajouté une lettre ainsi conçue :
« Le 31 octobre 1769.
« Monsieur,
« Je n’ai point oublié le spécimen que vous m’avez fait l’honneur de me demander, de notre manuscrit de Phèdre, et de la comédie intitulée : Querolus ou Aulularia, qui y est jointe. Je crois que vous n’aurez point de peine à vous persuader que l’écriture est du viiie siècle, au plus tard du commencement du ixe. J’ai copié, monsieur, ligne par ligne et le moins mal qu’il m’a été possible ; j’ai conservé la grosseur des lettres, laquelle varie quelquefois : mais peu accoutumé à ce genre d’écriture et la plume glissant naturellement sur les papiers transparents, je n’ai pu donner à la lettre du manuscrit toute la netteté qu’elle présente. Du reste la ponctuation, l’orthographe, etc., tout est exactement copié. Ces papiers mêmes forment, dans leur longueur, la page écrite. Que ne puis-je, monsieur, vous donner des marques plus étendues et plus circonstanciées des sentiments de mon estime et de la reconnaissance que j’ai aux lumières que vous avez répandues sur notre histoire ! J’y joins en {p. 72}particulier mes remerciements pour la complaisance avec laquelle vous avez bien voulu vous occuper de mes brouillons.
« J’ai l’honneur d’être, etc.
« D. X. Vincent. »
Le bibliothécaire de Saint-Remi avait, on le voit, adressé à M. de Foncemagne un fac-simile non seulement de l’écriture des fables, mais encore de celle du Querolus ou Aulularia, comédie manuscrite, qui s’y trouvait réunie.
Mais M. de Foncemagne n’avait voulu que satisfaire un sentiment de curiosité savante, et, comme l’abbé Pluche, il n’avait nullement songé à donner une édition de Phèdre.
En définitive, Gude et les bibliothécaires de Saint-Remi avaient seuls, depuis le Père Sirmond, vu le manuscrit de Reims, lorsqu’en 1774 les trésors bibliographiques du couvent bénédictin furent anéantis en quelques heures par un violent incendie.
Le manuscrit de Phèdre périt comme les autres. Heureusement le fac-simile, dû à la complaisance de Dom Vincent, restait et permettait de déterminer l’âge du manuscrit.
Ce fac-simile, et la lettre qui l’accompagnait, avaient été par M. de Foncemagne placés en tête d’un exemplaire du Phèdre, in-4º, de Rigault, publié en 1617 par Robert Étienne. Cet exemplaire était passé des mains de M. de Foncemagne dans celles de M. Dacier. Il a ensuite appartenu à lord Stuart de Rothesay, et, à la vente des livres de ce dernier, le hasard me l’ayant fait rencontrer, je m’en suis rendu acquéreur. Il contenait et il contient encore le papier transparent, sur lequel Dom Vincent avait imité l’écriture du manuscrit.
Il porte en outre au commencement, sur la face intérieure de la
couverture, cette note, qui est de la main de M. de Foncemagne, et que la notice,
imprimée en tête du Phèdre de M. Ernest Panckoucke, attribue à tort à M. Dacier :
« La bibliothèque de Saint-Remi de Reims possédait, avant l’incendie
qu’elle a éprouvé en 1774, un manuscrit de Phèdre autre que celui de Pithou. On
trouvera à la tête de ce volume un échantillon de l’écriture du manuscrit, qui
m’a été envoyé autrefois de Reims par Dom Vincent, bibliothécaire de Saint-Remi.
J’y ai joint la lettre, par laquelle il m’annonçait en même temps un pareil
échantillon de l’écriture du manuscrit du {p. 73}Querolus, qui a péri comme le Phèdre. J’ai placé cet
échantillon à la tête de mon exemplaire du Querolus. Ces deux
morceaux sont aujourd’hui tout ce qui reste de ces deux
manuscrits. »
Après avoir attribué à M. Dacier cette note, qui, évidemment, ne peut avoir été écrite que par M. de Foncemagne, l’auteur de la notice en reproduit une seconde, placée probablement par M. Dacier au-dessous de la première, et, en l’attribuant à M. de Foncemagne, il achève de rendre son récit de plus en plus inintelligible. En voici le texte :
« Depuis que cette note a été écrite, on a recouvré à la Bibliothèque du Roi l’exemplaire de Reims, qui avait été tiré de la bibliothèque de Saint-Remi longtemps avant l’incendie. Il m’a été communiqué, l’écriture est la même que celle de l’échantillon ci-joint. Mais ce manuscrit est incomplet, les deux dernières fables et l’épilogue du quatrième livre et tout le cinquième y manquent. »
Il est évident qu’une pareille note, qui contient autant de faussetés que de mots, ne peut avoir été écrite par M. de Foncemagne.
Attaché à la Bibliothèque du Roi, M. de Foncemagne, si le manuscrit s’y fût trouvé, n’aurait pas eu, pour le voir, besoin qu’il lui eût été communiqué.
Quant au véritable auteur de la note, ce qu’il dit du manuscrit démontre qu’il ne l’a pas vu ; en effet, il n’était pas plus incomplet que celui de Pithou ; l’un et l’autre renfermaient les mêmes fables des IVe et Ve livres. On pourrait objecter que le manuscrit, sur la route de Reims à Paris, avait pu être mutilé et que la fin avait pu en être arrachée. C’est là une explication ; mais la Bibliothèque nationale heureusement n’a pas encore été incendiée ; ce qui en restait s’y trouverait encore, et elle n’en possède rien.
La vérité, c’est qu’il n’a pas été apporté de Reims à Paris avant l’incendie, et que par conséquent il y a péri. Cela ne fait de doute aujourd’hui pour personne.
Le manuscrit ayant péri, comment vais-je pouvoir en faire la description, et comment devront procéder ceux qui voudront en reproduire le texte exact, avec ses moindres fautes ? Voilà ce qu’il s’agit maintenant d’expliquer.
Avant l’incendie de la bibliothèque, Dom Vincent, sur un exemplaire
classique in-12 de Phèdre, publié en 1743 à Paris par la {p. 74}veuve Brocas, avait eu la patience de transcrire en marge avec un soin
méticuleux les variantes du manuscrit de Reims. L’édition Brocas, étant une
édition de classe, ne contenait pas les fables considérées comme immorales. Dom
Vincent n’en avait pas moins voulu que son travail fût complet : pour faire
exactement connaître les variantes du manuscrit relatives aux fables bannies de
l’édition Brocas, il n’avait pas été sans doute jusqu’à transcrire, d’après le
manuscrit, le texte entier de ces fables ; mais il avait du moins indiqué les
variantes, par lesquelles elles différaient du texte de l’édition bien connue de
Pierre Danet, publiée en 1675 dans le format in-4º « par ordre du Roi très
chrétien à l’usage du sérénissime Dauphin »
.
En 1776, pendant un voyage qu’il avait fait à Paris, il promit à l’un des gardes de la Bibliothèque du Roi l’exemplaire de l’édition de la veuve Brocas, et, rentré à Saint-Remi, il s’empressa de le lui envoyer avec la lettre suivante :
« Monsieur,
« Aussitôt mon arrivée, je me suis fait un véritable plaisir de tenir ma parole. Je vous envoie le texte de notre Phèdre, avec les fautes et les bévues de notre copiste.
« À sa façon d’écrire vous jugerez aisément qu’il avait sous les yeux un manuscrit ancien. Ainsi, par exemple, donnant au c le son du q, et mettant des o pour des u, il a écrit qui ou qoi, quoi pour cui ; ainsi il dit intellego pour intelligo, etc., ingrabantibus pour ingravantibus, etc. J’avais jugé, par le caractère, que notre manuscrit devait être de la fin du viie siècle ou du commencement du suivant. J’en envoyai un spécimen à M. de Foncemagne. Je crus même qu’il ne serait pas inutile d’en donner une courte notice, ainsi que de l’Aulularia qui y était jointe. Elle se trouve dans l’almanach de Reims, 1774.
« Je suis avec respect,
« Monsieur,
« Votre très humble et très obéissant serviteur.
« D. X. Vincent.« Saint-Remi de Reims, le 6 octobre 76. »
{p. 75}Le précieux volume, qui faisait revivre le manuscrit brûlé, fut déposé dans la Bibliothèque du Roi.
Malheureusement il présentait une lacune. Alors que le premier livre des fables commençait à la troisième page de l’exemplaire de la veuve Brocas, Dom Vincent n’avait inscrit qu’à partir de la cinquième les variantes du manuscrit ; sans s’en apercevoir, il avait omis toutes celles qui s’appliquaient au prologue et à la première fable tout entiers, et à la deuxième fable jusqu’au vers Qui dissolutos mores, etc.
Lorsque avant de l’envoyer au garde de la Bibliothèque du Roi, à
qui il l’avait promis, il jeta un dernier coup d’œil sur l’imprimé qui portait les
variantes écrites de sa main, il s’aperçut de son omission, et au bas de la
page 3, sur laquelle commençait le livre I, il écrivit : « J’ai manqué dans le temps, et je ne sais comment, de vérifier ce prologue et
la page suivante. »
Il y a donc là une lacune qui porte sur les
34 premiers vers.
Malgré cette lacune, on peut dire que le texte était sauvé ; et il l’était pour tout le monde ; car l’exemplaire de la veuve Brocas se trouvait dans une bibliothèque publique dont l’accès était facile.
Aussi voit-on le Père Brotier, qui, tout en commettant quelques erreurs, a eu le mérite de recourir aux sources, s’en servir pour composer l’édition qu’il publia en 1783.
Adry l’étudia à son tour, et en prit même une copie entière, dont
il comptait faire usage, pour écrire « l’histoire de toutes les disputes
qui se sont élevées au sujet de Phèdre et de ses manuscrits104 »
. Mais il mourut, avant d’avoir pu exécuter son projet.
Après sa mort, s’il faut en croire Barbier, ses manuscrits furent achetés par
M. Renouard ; j’ignore ce qu’ils sont devenus.
M. Berger de Xivrey fut plus heureux. Pendant qu’il s’occupait de faire paraître le manuscrit de Pithou, profitant de sa position de conservateur adjoint des manuscrits à la Bibliothèque royale, il se fit communiquer par son collègue M. van Praet, alors conservateur du département des imprimés à la même bibliothèque, le précieux exemplaire de l’édition classique de la veuve Brocas, et il en {p. 76}publia, avec un soin remarquable, toutes les variantes manuscrites en regard des mots correspondants du texte imprimé. Ce fut une inspiration providentielle, dont il faut le féliciter sans réserve. Car, peu de temps après, l’exemplaire qui avait conservé, malgré l’incendie, les leçons du manuscrit, a disparu à son tour.
Malheureusement M. Berger de Xivrey, qui a pris la peine de publier les variantes signalées par Dom Vincent, n’a pas cru devoir reproduire en même temps dans son intégralité le texte de l’édition Brocas. Il s’est borné à indiquer les mots du texte imprimé qui étaient en désaccord avec les variantes manuscrites.
Ce procédé offre des inconvénients notables. Il résulte de son application que l’ouvrage de M. Berger de Xivrey montre bien en quoi le manuscrit de Reims différait de l’édition Brocas, mais ne laisse pas apparaître ce qui, dans ce que l’un et l’autre avaient de commun, pouvait s’écarter des leçons du manuscrit de Pithou. Quel était le texte exact de cette édition ? Voilà ce qu’il était important de savoir.
Dans ce but j’ai longtemps essayé de découvrir un exemplaire de l’édition de 1743. Mais la veuve Brocas était le libraire classique de son temps ; elle ne publiait guère que des éditions à l’usage des élèves des collèges ; celle de 1743 était destinée à l’enseignement ; elle n’avait par elle-même aucune valeur ; tout ce qui n’en a pas été utilisé a dû être détruit, et aujourd’hui elle ne se rencontre ni dans les bibliothèques publiques, ni chez les marchands de livres anciens.
En l’absence de l’édition de la veuve Brocas, ceux qui voudront reconstituer le texte du manuscrit de Reims n’ont qu’une voie à suivre, c’est de prendre pour base le manuscrit de Pierre Pithou et de substituer à ses leçons toutes les variantes signalées par Dom Vincent. On ne tarde pas, en procédant ainsi, à s’apercevoir que ces variantes se réduisent à peu de chose. En effet, dans la plupart des endroits où le manuscrit de Reims était en désaccord avec l’édition Brocas, il était conforme au manuscrit de Pithou, dont, comme je l’établirai, il ne différait que très peu.
Le procédé, suivi par M. Berger de Xivrey, offre des inconvénients non seulement pour le texte même des fables, mais encore pour leurs titres.
Il n’indique que ceux qui ne sont pas conformes. On pourrait {p. 77}donc, au premier abord, craindre que ceux qui, à raison de leur conformité dans le volume imprimé et dans le manuscrit, sont omis, ne fussent pas eux-mêmes réellement identiques à ceux du manuscrit de Pithou. S’il en avait été ainsi, il serait impossible de fournir exactement les variantes des titres. Heureusement, en examinant de plus près les variantes du manuscrit de Reims, j’ai remarqué que, toutes les fois que le titre, indiqué d’après le manuscrit de Reims, était en désaccord avec celui donné à la fable dans l’imprimé, le premier des deux était conforme à celui qu’elle portait dans le manuscrit de Pithou. Cette observation m’a fait acquérir la certitude qu’il suffirait, pour se procurer le texte exact des titres, d’emprunter à ce manuscrit chacun de ceux qui manquaient.
Il faut néanmoins reconnaître que, tout en se servant avec discernement des variantes de Dom Vincent, on ne pourrait, si l’on n’employait qu’elles, arriver à une reconstitution mathématiquement exacte du manuscrit de Reims.
D’abord, ainsi que je l’ai dit, Dom Vincent avait oublié de reporter sur l’édition imprimée les variantes des trente-quatre premiers vers du manuscrit. Ensuite, depuis le trente-cinquième vers, il les avait bien relevées ; mais, malgré son exactitude scrupuleuse, ainsi que le savant Orelli l’a fait remarquer, il avait omis d’en signaler un certain nombre, soit qu’elles lui eussent échappé, soit qu’il n’y eût pas attaché d’importance, soit enfin qu’il y eût eu conformité entre l’édition Brocas et le manuscrit de Reims dans des endroits, où ce dernier s’éloignait de celui de Pithou.
Pour parvenir à une restitution complète, il faut nécessairement recourir à d’autres documents : d’abord, pour le prologue compris dans les 34 premiers vers, au fac-simile, dont j’ai parlé, et qui a été reproduit dans l’édition Panckoucke105, ensuite, pour le surplus, aux variantes, que, d’après le Père Sirmond, Rigault a publiées, et à celles que Gude a prises lui-même sur le manuscrit.
Rigault ne me paraît pas avoir vu le manuscrit de Reims ; il n’en a connu les variantes que par les notes écrites de la main du Père Sirmond en marge d’un exemplaire de l’édition de Pithou, et {p. 78}il ne s’est même pas préoccupé de reproduire toutes les leçons nouvelles qui lui étaient révélées.
Gude, au contraire, vers 1663, pendant sa longue exploration des bibliothèques de la France, avait attentivement examiné, non pas le manuscrit de Pithou qui n’était accessible à personne, mais celui de Reims que tout savant pouvait étudier dans l’abbaye de Saint-Remi. Les notes de Gude fournissent donc des renseignements plus précieux ; elles n’en sont pas moins de nature à causer à leur tour une grande perplexité à ceux qui s’en serviront.
En premier lieu, Gude, dans l’indication de la source à laquelle sont prises ses variantes, manque très souvent de précision. En général, elles sont simplement précédées des lettres MS. Comme les leçons précédées de ces deux lettres se retrouvent presque toutes dans le manuscrit de Pithou, on est tout d’abord porté à penser que c’est à ce manuscrit que se rapporte l’abréviation MS., et ce qui confirme dans cette première idée, c’est que de place en place on trouve dans ses notes des variantes précédées de cette autre abréviation MS. Rem. Les lettres MS semblent donc désigner le premier manuscrit connu, le manuscrit fondamental, par opposition à celui de Reims découvert plus tard. Si l’on suivait cette première idée, on ne devrait tenir compte, pour combler les vides laissés par Dom Vincent, que des variantes qui porteraient avec elles l’indication expresse de leur origine.
Mais telle n’était pas l’opinion d’Orelli. « Il faut tenir
pour bien constant, écrit-il dans son édition de 1831, que toute variante tirée
par Gude de MS, quoiqu’il n’ait pas toujours ajouté Rem. (ce que pourtant il fait souvent), n’est pas puisée
ailleurs que dans le manuscrit de Reims106. »
Suivant lui,
Gude n’a pu puiser les variantes du manuscrit de Pithou que dans l’appendice de
l’édition originale et dans les notes des diverses éditions de Rigault. Or, pour
prendre quelques exemples au début seulement du premier livre, les variantes queris et gravis, portant l’une sur le vers 7 de
la fable i, l’autre sur le vers 7 de la fable ii, ne sont,
dans ses notes, précédées que des simples lettres MS. Ne lui
ayant été signalées {p. 79}ni par l’appendice de l’édition
originale ni par les notes de Rigault comme appartenant au manuscrit de Pithou,
elles ont dû, dans sa pensée, ne concerner que celui de Reims, et c’est là ce
qu’il a dû par les deux lettres MS avoir l’intention
d’exprimer ; ce qui le prouve, c’est, dans le vers 8 de la fable Ranæ
regem petentes, la variante omnino insueti sonus, qui,
quoique n’appartenant qu’au manuscrit de Reims, n’est signalée par Gude qu’avec
les lettres MS ; ce qui le prouve encore, c’est que, lorsqu’au
contraire une variante lui est indiquée comme commune aux deux manuscrits, il a
soin de le mentionner ; ainsi l’appendice de l’édition originale lui montrant que,
dans le vers 12 de la même fable, la leçon ut compesceret était
identique dans les deux manuscrits, il a eu soin de la faire précéder dans ses
notes, page 223, de cette mention : MS. Rem. et
Pith.
Sans avoir une confiance aussi robuste qu’Orelli dans l’intention bien arrêtée de Gude de ne désigner par les lettres MS que le manuscrit de Reims, je crois qu’on doit accepter cette hypothèse comme vraie, et il faut avouer qu’elle ne fait pas courir de grands dangers d’erreur ; car les deux manuscrits sont tellement semblables que rarement une leçon tirée de l’un n’appartient pas à l’autre.
Au surplus, ce qui est prudent, c’est en général de n’accepter la leçon de Gude que lorsque celle de Dom Vincent fait défaut.
En second lieu, à côté de l’incertitude que fait éprouver l’insuffisance des indications données par Gude sur l’origine des variantes, on est plongé par lui dans un embarras d’un autre genre. Ainsi, sur telle variante donnée, il lui est arrivé assez fréquemment d’être en désaccord avec Dom Vincent. Pour ne citer que deux exemples tirés du livre I, tandis que Gude avait lu dans la fable x la variante forte et dans la fable xi la variante ut ipse, Dom Vincent a cru apercevoir forti et ipse ut. Quand on est obligé d’opter entre eux, on doit en général donner la préférence aux indications fournies par Dom Vincent ; en effet, lorsqu’il a annoté l’exemplaire de la veuve Brocas, il avait mieux l’accès du manuscrit de Reims, et par suite il a dû moins que le savant allemand être exposé à se tromper. Ce n’est pas à dire non plus qu’il faille accepter aveuglément les variantes de Dom Vincent ; car le volume qui portait ses notes manuscrites a disparu, et il est possible que, dans l’édition de {p. 80}M. Berger de Xivrey qui nous les a conservées, il se soit glissé quelques fautes typographiques qui les aient un peu dénaturées.
En somme, il est encore possible aujourd’hui de publier le texte rigoureusement exact du manuscrit de Saint-Remi.
§ 2. — Description du manuscrit. §
Après avoir montré par quels moyens on peut opérer la restitution du manuscrit brûlé, je dois faire connaître ce qu’il était.
Dans une note manuscrite par lui placée au bas de la troisième page
de l’exemplaire de la veuve Brocas, où commence le premier livre des fables, Dom
Vincent s’exprime ainsi : « Le Phèdre de Saint-Remi était un in-8o allongé107. »
C’était donc un in-8º. Je ne saurais dire de combien de feuillets
il se composait ; mais ce qui est certain, c’est qu’ils étaient en parchemin,
qu’aucun n’avait été déchiré, que, comme dans le manuscrit de Pithou, les lacunes
du texte ne correspondaient pas à des pages arrachées, et qu’enfin, ainsi que
l’atteste Dom Vincent108, le copiste, sans se préoccuper des vers, les avait écrits
comme de la prose. « Les vers, dit-il, n’y sont pas distingués »
,
et le fac-simile qu’il avait adressé à M. de Foncemagne démontre que son assertion
est parfaitement vraie.
L’indifférence du copiste avait été plus loin encore ; comme celui du manuscrit de Pithou, il était passé d’une fable à une autre sans indiquer la transition et probablement sans l’apercevoir ; c’est ainsi qu’à la suite des premiers vers de la fable Leo regnans, il copie, sans noter la lacune, les deux derniers vers d’une autre fable, dont l’obscénité fait d’ailleurs peu regretter la perte. Il en est de même de la fable Demetrius rex et Menander poeta, qui, avant d’avoir été achevée, avait été si bien rattachée à la fin d’une suivante, que les mots Et vindicabit, qui commençaient la seconde, étaient sur la même ligne que les mots Mutatus statim qui terminaient la première.
Enfin, comme dans le manuscrit de Pithou, le passage d’un livre {p. 81}à un autre n’était pas non plus toujours observé. Il
n’était indiqué qu’au commencement du second livre par ces mots : Phædri Augusti liberti liber secundus
.
À la fin du manuscrit, le copiste, heureux sans doute d’avoir
achevé son travail, avait écrit : « Phædri Aug. liberti Liber
quintus explicit feliciter. »
Comme, dans l’exemplaire de l’édition de 1743, le cinquième livre
était suivi des fables dont Gude avait emprunté le sujet à Romulus, qu’il avait
mises en vers ïambiques et que Burmann avait découvertes et publiées, Dom Vincent
avait craint qu’on ne s’imaginât qu’elles existaient dans le manuscrit. Pour
éviter cette méprise, il avait, à la fin de la dernière fable du livre V, ajouté
cette observation : « Ici finit le cinquième livre ; et ces autres fables
qui suivent ne sont pas dans notre manuscrit. Il n’y a point de feuillet perdu
qui puisse faire juger que d’autres fables aient été aussi perdues ; les
feuillets ne sont point séparés, et le tout fait suite109. »
J’en aurais fini avec le manuscrit de Saint-Remi, s’il n’avait pas été l’objet d’une erreur longtemps commise, qui a déjà été savamment réfutée et que je voudrais faire tout à fait disparaître.
J’ai signalé l’hypothèse foncièrement inexacte, risquée par Boinvilliers, qui, brodant sur l’erreur du Père Brotier et dans le manuscrit de Pithou et dans celui de Reims n’en voyant qu’un seul et même, prétendait qu’il était passé de l’abbaye de Saint-Remi dans les mains du savant qui l’avait publié. Confondant de même les deux manuscrits, certains philologues avaient déjà bâti sur cette erreur une autre hypothèse, qui, pour différer de la précédente, n’en est pas moins fausse. Ils avaient cru que Pithou avait publié les fables de Phèdre d’après un vieux codex, qui, légué au collège de Troyes, serait ensuite passé à l’abbaye de Saint-Remi. Cette erreur était, d’après Dom Vincent, formulée dans les Éphémérides troyennes de l’année 1765. Il la combattit, en publiant, en 1774, dans l’almanach de Reims, un article malheureusement très fautif, intitulé : Notice sur le manuscrit de Phèdre qui est dans la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Remi110.
{p. 82}Il faut avouer que l’idée fausse qui s’était propagée n’avait rien qui dût surprendre.
Le soin avec lequel les descendants de Pithou avaient, en silence, soustrait son manuscrit à tous les regards, avait dû porter à penser qu’ils ne le possédaient pas, et la similitude qui existait entre les deux manuscrits pouvait faire croire que celui de Reims n’était autre que celui qui avait servi à Pithou.
Il existait entre eux une communauté d’origine, sur laquelle l’examen le plus superficiel ne saurait laisser le moindre doute.
Au premier abord, lorsqu’on aperçoit le nombre considérable des variantes relevées par Dom Vincent en marge de l’édition classique de 1743, on est tenté de croire que les deux copistes avaient dû puiser à deux sources différentes. Mais ceux qui se hâteraient d’en tirer cette conclusion seraient dupes d’un mirage trompeur. Le grand nombre des variantes ne vient que de ce que la veuve Brocas, adoptant les altérations ou améliorations successives des éditions antérieures, s’était écartée du manuscrit de Pithou. Il existe donc beaucoup de différences entre l’édition de 1743 et le manuscrit de Reims ; mais les mêmes différences ne se retrouvent pas entre ce manuscrit et celui de Pithou. Quand on y regarde de près, on remarque que presque toujours la leçon indiquée par Dom Vincent est conforme au texte du manuscrit de Pithou, dont l’imprimé s’était au contraire éloigné. Il y a mieux : quand le même mot figure dans le texte imprimé et dans la variante manuscrite et que la différence provient de leur orthographe, c’est l’orthographe de la variante qu’on retrouve dans le manuscrit de Pithou. Ce qui revient à dire que dans les deux manuscrits les mêmes mots présentent les mêmes barbarismes.
Les titres des fables sont identiques, et lorsqu’ils auraient dû
subir une rectification, elle fait dans l’un et dans l’autre également défaut.
Ainsi, par exemple, la fable v du livre II, dans les deux manuscrits,
est intitulée : « Item Cæsar ad Atriensem. »
Ce
mot Item ou manque de sens, ou, ce qui est plus probable,
suppose une fable perdue, qui devait la précéder et porter pour titre le mot Cæsar. Il y avait lieu de supprimer le mot Item.
Néanmoins les deux copistes le conservent ; ce qui, soit dit en passant, démontre
leur égale ignorance.
Il y a aussi deux lacunes, que j’ai déjà signalées et qui rendent {p. 83}la ressemblance encore plus frappante. Ainsi le manuscrit de Pithou, dans le livre IV, ne renferme de la fable Leo regnans que les neuf premiers vers, et à la suite, sans interruption, s’ajoutent les deux derniers vers d’une autre fable, dont le premier mot est sur la même ligne que les derniers de la précédente. Il en est de même de la fable Demetrius rex et Menander poeta : le dernier vers manque, et les deux, qui devraient commencer la fable suivante, sont également absents. Cependant le tout est réuni, comme s’il ne faisait qu’une seule fable. Le copiste, à qui est dû le manuscrit de Reims, n’a pas davantage aperçu ces lacunes, et, comme l’autre, il a ajouté, sans ponctuation séparative, au commencement de la première fable la fin de la suivante.
Enfin, pour en terminer avec tous ces points de ressemblance, j’ajoute que, contrairement à ce que déclare Dom Vincent dans l’almanach de Reims, les vers n’ont été observés ni par l’un ni par l’autre. Ils les ont écrits comme de la prose. Dom Vincent, en voyant dans l’édition de Pithou une ligne consacrée à chaque vers, avait naturellement supposé qu’il n’avait fait que suivre la disposition du texte reproduit. C’était une fausse supposition. À ce point de vue encore les deux manuscrits étaient pareils.
On s’explique maintenant l’erreur qui s’était accréditée. Cependant il y avait bien deux manuscrits. Il ne peut y avoir d’incertitude à cet égard. Les variantes qui les différencient, quoique peu importantes et peu nombreuses, n’en sont pas moins la preuve certaine, et les échantillons que je reproduis de l’écriture de chacun ne laissent pas la moindre place au doute.
Mais, s’il y avait deux manuscrits, il faut reconnaître qu’il existait entre eux une parenté incontestable. Il me paraît évident qu’ils ont été copiés ou l’un sur l’autre ou tous les deux sur un troisième aujourd’hui disparu. En un mot, pour employer une image qui rende ma pensée, ou bien ils descendent l’un de l’autre en ligne directe, ou bien ils descendent d’une souche commune en ligne collatérale.
Laquelle de ces deux hypothèses est la vraie ? Je ne puis le dire ; mais j’incline vers la première. J’ai expliqué que dans l’un et dans l’autre la ligne ne se terminait pas à la fin de chaque vers, et que chaque vers nouveau était sans interruption écrit à la suite du précédent. Il est vraisemblable que, si l’un des deux copistes, {p. 84}pour économiser le parchemin, a eu l’idée de ne pas s’inquiéter des vers, l’autre n’a pas eu la même préoccupation. Le plus ancien des deux, seul sans doute, a voulu ménager l’espace et pour cela a fait toute sa copie sans rompre la ligne, et le second, s’étant servi de cette copie, ne s’est pas aperçu qu’il copiait des ïambes et les a écrits comme de la prose.
Ce qui me confirme dans cette hypothèse, c’est que, dans le manuscrit de P. Daniel, chaque vers occupe seul la ligne où il est écrit. Or ce manuscrit, qui paraît être du xie siècle, a été copié sur les textes primitifs ; ce qui montre que les vers y étaient bien observés, et que, si, au lieu de copier le manuscrit de Reims, le copiste de celui de Pithou les avait eus sous les yeux, il n’aurait pas manqué de consacrer une ligne entière à chacun des ïambes.
Le savant philologue Orelli reconnaît que les deux manuscrits ont
entre eux un air de famille, qui ne permet pas de douter de leur communauté
d’origine, et, s’il ne déclare pas nettement opter pour l’hypothèse qui me semble
la plus probable, il laisse apercevoir qu’il penche vers elle. Ainsi il fait
observer que le manuscrit de Reims présente quelques leçons préférables à celles
du manuscrit de Pithou, telles que dos au lieu de mos, et fauce au lieu de face ; une
variante surtout lui semble significative : dans les éditions imprimées, conformes
en cela au texte de Perotti, à celui de Romulus et aux conjectures de Gude, le
premier vers de l’épilogue du deuxième livre commence par les mots : Æsopi ingenio
, qui sont la véritable leçon ; dans le
manuscrit de Reims qui l’altérait, on lisait les mots : Æsopi
ingentem
, qui laissaient voir la trace du texte primitif ; celui
de Pithou portait les mots : Æsopo ingentem
, qui
aggravaient la première altération. Orelli en conclut que le manuscrit de Reims
était le plus ancien ; mais, s’il s’est arrêté à cette conséquence, il faut avouer
qu’elle le menait à celle que j’ai moi-même déduite.
On sera peut-être porté à croire que la solution du problème n’exigeait pas tant de peine. En effet, au premier abord, il semble que l’écriture des manuscrits devait révéler leurs âges respectifs. Cependant sur ce point les appréciations des savants ne sont pas en parfaite harmonie.
Dans sa lettre à M. de Foncemagne, Dom Vincent estime que
l’écriture du manuscrit de Reims est du viiie siècle ou au plus tard {p. 85}du commencement du ixe ; sa notice, insérée dans l’almanach de Reims111, indique
que, dans sa pensée, elle ne dépasse pas le viiie ;
enfin, dans la lettre qui accompagnait le volume de la veuve Brocas, il exprime
l’idée qu’elle est de la fin du viie siècle ou du
commencement du viiie. En résumé, Dom Vincent place
le manuscrit de Reims entre la fin du xviie siècle
et le commencement du ixe, et, pour prendre un
moyen terme, lui assigne le viiie siècle. Au
contraire le Père Brotier crut reconnaître que celui de Pithou était du ixe siècle, et M. Berger de Xivrey affirme qu’il
« n’est pas plus récent que le xe »
. Il semblerait en résulter qu’il est de cent ans environ
le moins ancien. Mais les spécimens que je publie ne présentent pas des
différences assez grandes pour qu’on puisse être si affirmatif. Les deux écritures
semblent être à peu près de la même époque, et, suivant l’âge du copiste, le
manuscrit le plus récent peut être celui qui présente l’écriture la plus ancienne.
Pour parvenir à se créer une opinion raisonnable, il faut donc, tout en tenant
compte des renseignements paléographiques, en revenir à ces fautes de copiste,
qui, dans le manuscrit de Pithou, n’ont été que l’aggravation de celles commises
dans celui de Reims.
Tel était le manuscrit de Reims. Mais, au moyen âge, il était rare qu’un manuscrit fût relié seul. Nous avons déjà vu que celui de Pithou était suivi d’un traité De Monstris ; à celui de Saint-Remi avait été annexée une comédie latine intitulée Querolus sive Aulularia. C’était celle dont Pierre Daniel, sur un autre manuscrit sans doute, avait, en 1564, donné l’édition originale.
Il n’entre pas dans mon plan de parler de cette comédie ; d’ailleurs, quoiqu’elle ne soit pas de Plaute, ceux qui désireront la lire, la trouveront dans les éditions de ses œuvres et notamment dans la collection des classiques latins de Lemaire. Mais j’ai trop de fois cité le nom de Dom Vincent, pour ne pas profiter ici de l’occasion qu’elle m’offre de le faire parler lui-même. Voici ce qu’au sujet de cette comédie, il écrivait, en 1774, dans l’almanach de Reims112 :
« “Au Phèdre, ajoute M. Grosley, est jointe une comédie latine intitulée Aulularia, qui n’a pas été imprimée, et qui au jugement de M. l’abbé d’Olivet, qui l’a vue, ne mérite pas de l’être… On {p. 86}pourrait aussi examiner si l’ancienne comédie jointe au Phèdre, ne serait point le Querolus sive Aulularia, publié par P. Daniel en 1564, comédie que l’auteur des Recherches pour servir à l’histoire du droit français, a crue du siècle de Théodose, et que les auteurs de la Nouvelle Diplomatique renvoient au siècle de la meilleure latinité. Le jugement de M. l’abbé d’Olivet serait une pièce à joindre à ce procès, si la comédie jointe au Phèdre était en effet le Querolus.”
« Je dirai tout simplement : 1º que M. l’abbé d’Olivet qui voulut voir cette comédie, n’en porta d’autre jugement, sinon que “ce fut celle-là même qui fut publiée en 1564 par le savant P. Daniel, d’Orléans, qui l’accompagna de ses notes, et il faut convenir que c’est un ouvrage qui paraîtrait peu digne aujourd’hui d’une grande estime.
« 2º Les auteurs de la Nouvelle Diplomatique ne pensent pas cependant de même. “Ce poète dramatique, disent-ils (t. II, p. 94, not. col. 2), s’il paraît s’attribuer un discours barbare, ce n’est pas sans doute parce qu’il était lui-même barbare, ou parce qu’il tombait dans de fréquents barbarismes, puisqu’il écrit en latin, et qu’il s’exprime en bons termes.” En accordant ces derniers mots à nos diplomaticiens, on pourrait ne pas convenir de ce qui précède, et dire que ces paroles du Querolus, qu’ils ont en vue, Qui Græcorum disciplinas ore narrat barbaro, ne représentent qu’un étranger (un Grec) qui s’exprime dans une langue étrangère (la latine). Ces mêmes auteurs le croient Grec, et peut-être un Marseillais, antérieur à la fin du premier siècle et postérieur à Tibère (ibid.), contre le sentiment de D. Rivet, qui le place, disent-ils, au commencement du ve siècle (ibid. p. 93, not. col. 1). “Vossius, écrit en effet D. Rivet, croit que c’est à Rutilius (Claudius Rutilius Numatianus, poète du ve siècle et préfet de Rome) que le poète Flavius adressa la comédie intitulée le Plaintif de Plaute ou l’Aulularia.” (H. lit., t. II, p. 73). C’est aussi le sentiment de Tillemont qui l’a suivi (Till., Hist. emp., t. V, p. 662, art. 67).
« Mais 1º notre auteur dramatique était Grec : j’en ai donné la preuve : il dit encore dans le même Querolus : “Sic nostra loquitur Græcia.” 2º Il est à remarquer qu’il cite Cicéron : “De istis (anseribus) quondam magnus dixit Tullius : Anseribus cibaria publice locantur, etc.” Or Cicéron est mort 43 ans avant la naissance de Jésus-Christ. {p. 87}De plus, il est fait mention dans l’Aululaire de la manière dont les Gaulois rendaient la justice : Vade ad Ligerim, etc. On sait que du temps de César les Gaulois s’assemblaient tous les ans dans le pays chartrain, pour y décider leurs querelles et leurs procès : ils s’en rapportaient aux jugements et aux décisions des Druides… (Cæs., de Bell. Gall., L. VI, c. 13. Vid. Cicer., lib. I de Divin. ; Plin., lib. XXX, c. 1). Or, Pline rapporte que les Druides furent chassés de l’empire sous Tibère (Claude). Suétone en dit autant (in Claud., p. 372), et Aurélius Victor le confirme aussi (de Cæsarib., cap. 4) : c’est-à-dire que cela arriva l’an 43 de J.-C.
« On pourrait donc, ce semble ; pour nous rapprocher de nos diplomaticiens, attribuer à Phèdre l’Aululaire. Il était Grec ; il a vécu sous Tibère ; et, comme il est mort âgé, il a pu survivre à ce prince, qui a cessé de régner l’an 27 de J.-C. ; mais il aurait écrit à coup sûr avant l’édit donné contre les Druides. Enfin le mot quondam, dont il se sert en parlant de Cicéron, pourrait trouver un intervalle suffisant pour l’autoriser : il ne suppose pas toujours des temps fort reculés : on en a des exemples.
« Quel était ce Rutilius à qui cette pièce est dédiée ? C’est ce qu’on ignore encore : ce nom était assez commun ; le portrait qu’en fait notre auteur dramatique est assez flatteur. C’était un protecteur généreux, un ami des lettres : “Sermone illo philosophico, ajoute-t-il, ex tuo materiam sumpsimus. Meministine ridere te solitum, illos qui fata deplorant sua… Nos fabellis atque mensis hunc librum scripsimus.” »
En reproduisant ainsi en partie la notice de Dom Vincent, je me suis permis une digression un peu longue. Mais la conclusion à laquelle il arrive me servira d’excuse. Il est vrai qu’elle est toute gratuite, qu’il n’y a aucun rapport entre le style des Fables et celui du Querolus, et que, si, parce que cette comédie les suivait dans le manuscrit de Reims, Dom Vincent a cru pouvoir l’attribuer à Phèdre, la raison qui l’a déterminé avait bien peu de valeur. À ce compte-là il faudrait dire aussi que Phèdre est l’auteur du traité De Monstris et Belluis, qui, dans le manuscrit de Pithou, se trouve également à la suite de ses Fables. Il est évident que Dom Vincent a été entraîné un peu légèrement à formuler une hypothèse invraisemblable. Mais, par cela même qu’il l’avait imaginée, on trouvera peut-être que j’ai pu, sans trop m’écarter de mon sujet, parler un peu du Querolus.
Section III.
Manuscrit de Daniel. §
§ 1. — Histoire du manuscrit. §
J’ai maintenant à m’occuper du troisième manuscrit des fables de Phèdre, et, pour être sincère, j’avoue tout de suite que j’éprouve à remplir cette partie de ma tâche une satisfaction toute particulière.
Le manuscrit est généralement connu sous le nom de Vetus Danielis chartula. Bien des bibliographes s’en sont occupés. Mais, sauf Rigault, Isaac Vossius, l’Allemand Gœttling, l’abbé et cardinal Angelo Maï et M. F. Guessard, aucun d’eux ne l’a vu. Tout ce qu’ils en ont dit devait nécessairement fourmiller d’erreurs.
J’ai voulu faire et j’ai fait ce qu’ils auraient dû faire : je l’ai vu et lu, et j’en ai pris une copie littérale qui n’est pas dénuée d’intérêt : car l’abbé Maï, en corrigeant les fautes du manuscrit, l’a légèrement dénaturé113.
Ce qui a été écrit sur son origine est exact : il dépendait de la bibliothèque de Saint-Benoît-sur-Loire. C’est là le point de départ qu’Adry assigne à ses pérégrinations.
Le manuscrit avait ensuite appartenu à Pierre Daniel, avocat d’Orléans, et comme Pierre Daniel était en même temps bailli de la justice temporelle de l’abbaye de Saint-Benoît et qu’il avait pu sauver bien des livres du pillage de la bibliothèque, Adry avait dû naturellement penser que le manuscrit, possédé par lui, provenait de ce sauvetage.
Cette supposition était appuyée sur l’autorité des Bénédictins
eux-mêmes, qui, dans leur Nouveau Traité de diplomatique,
s’exprimaient ainsi114 :
« Pierre Daniel, bailli de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire qu’il
qualifie de plus célèbre et premier collège de toute la France, profita du
pillage de ce monastère par les huguenots ; {p. 89}après
s’être emparé d’une bonne partie de ses manuscrits, il eut l’adresse d’en
racheter d’autres à vil prix. »
Mais ce n’était là qu’une supposition ; l’examen qu’il m’a été donné d’en faire ne permet plus l’incertitude.
Voici en effet l’inscription que j’ai lue sur le manuscrit :
« Hic est liber sancti Benedicti Floriacensis ; quem si
quis furatus fuerit vel aliquo ingenio tulerit, anathema sit. »
Ce qui, d’après M. Gaston Paris115, veut dire : « Ce livre appartient à Saint-Benoît-Fleury ; si quelqu’un le dérobe,
ou l’enlève à l’aide de quelque engin, anathème sur lui. »
Il paraît que le premier nom de Saint-Benoît-sur-Loire était Floriacum, en français Fleury. L’abbaye fondée dans cette ville par les Bénédictins, pour se distinguer des autres, prit le nom de Saint-Benoît-de-Fleury ou Saint-Benoît-Fleury.
On sait par quelle filière le manuscrit arriva à Rome. Après la mort de Pierre Daniel, il fut, en 1603, acheté par le savant antiquaire Paul Petau. Quoique le nom de ce savant soit encore connu des bibliophiles, l’oubli injuste dans lequel il est tombé me fait un devoir de rappeler ce qu’il a été.
Il était né à Orléans, en 1568, c’est-à-dire dans la ville et dans le temps où le manuscrit qui devait plus tard lui appartenir était soustrait au pillage. Il s’était livré consciencieusement à l’étude du droit, et à l’âge de vingt ans était devenu conseiller au Parlement de Paris.
Cette position lui avait laissé des loisirs qu’il avait occupés à collectionner des médailles et surtout des livres rares et des manuscrits précieux, parmi lesquels le manuscrit de Daniel acquis par lui prit le nom de Petaviensis codex.
Il mourut le 17 septembre 1614, laissant un fils, Alexandre Petau, qui hérita de ses fonctions au Parlement et de son goût pour les antiquités.
Sa bibliothèque passa à son fils Alexandre Petau, et après le décès de ce dernier elle fut mise en vente.
Les richesses paléographiques qu’elle renfermait furent dispersées. Le manuscrit de Phèdre passa dans les mains de la reine Christine. Ce nouveau changement de maître le fit appeler Schedæ {p. 90}regiæ. Plein d’une foi aveugle dans les assertions du Père Desbillons116, Schwabe affirme, d’après lui, que la reine de Suède le communiqua à Gérard-Jean Vossius117. Il ne s’aperçoit pas qu’il confond ainsi le père avec le fils. En effet, l’illustre savant n’existait déjà plus. En 1649, Isaac Vossius, son fils, était devenu bibliothécaire de la reine et avait été chargé par elle de lui enseigner la littérature grecque. Il conserva cette situation jusqu’en 1651, date à laquelle ses dissentiments avec Saumaise le firent tomber en disgrâce. En 1650, la reine l’avait chargé d’aller dans les Pays-Bas, en France et en Allemagne acheter pour elle des livres précieux et surtout des manuscrits. C’est alors qu’il acquit, moyennant quarante mille livres, une grande partie de la bibliothèque de Paul Petau et par suite le manuscrit de Daniel, qui en dépendait, et qui prit, avec la dénomination de Schedæ regiæ, celle de Vossianus codex.
Il paraît que les divers noms donnés au manuscrit de Daniel avaient jeté une certaine confusion dans l’esprit des savants, et que longtemps ils ne surent pas exactement s’ils s’appliquaient à un seul ou à plusieurs. Le Père Desbillons, sans avoir cependant vu le manuscrit, fit cesser l’incertitude118. Schwabe lui rend à cet égard un hommage mérité119.
Après l’achat fait par Isaac Vossius, le manuscrit de Daniel dut être envoyé en Suède. Mais il ne trouva pas dans ce pays le terme de ses vicissitudes. La reine Christine, que l’amour du plaisir autant peut-être que celui de l’étude avait fait renoncer au trône de Suède, n’avait pu se résigner à rester dans un pays où elle n’eût que difficilement trouvé la satisfaction de ses goûts. Ayant abdiqué en 1654, elle se rendit en Allemagne, abjura sa religion à Insprück, passa en Italie en 1655 et s’y lia avec le marquis de Monaldeschi, dont elle fit son écuyer et son amant. L’année suivante, venue avec lui en France, elle le fit, en dévote vindicative, un jour, au palais de Fontainebleau, dans la galerie des Cerfs, confesser par le {p. 91}curé d’Avon et tuer à coups d’épée par deux de ses gardes120. Obligée à la suite de ce meurtre d’abréger son séjour en France, elle se retira à Rome, où sa conversion lui concilia toutes les sympathies du pape Alexandre VII, et où elle passa le reste de son existence peu édifiante à regretter son abdication irréfléchie. Je renvoie ceux qui me trouveront trop sévère pour elle au livre intitulé : Histoire des intrigues galantes de la reine Christine de Suède et de sa cour pendant son séjour à Rome121. Ils verront que j’use de ménagement dans mes appréciations.
« En 1660, écrit M. Rochefort122, le
trône de Suède étant devenu vacant par la mort de Charles-Gustave, elle fit des
tentatives pour y remonter. Le pape Alexandre VII eut la complaisance d’écrire
en cette occasion à Louis XIV, pour lui recommander les affaires de la reine
Christine, comme étant liées à celles de la religion catholique123. Il ne paraît pas que Louis XIV ait voulu se prêter aux
fantaisies de Christine, et il fit bien. »
L’intervention pontificale
n’ayant eu aucun succès, Christine dut rester à Rome. En mourant, elle laissa une
riche bibliothèque qui fut achetée par le pape Alexandre VIII, et ses livres
entrèrent au Vatican.
Mais la Bibliothèque Vaticane possédait-elle encore le manuscrit de Daniel ? Voilà ce que n’avaient pu m’apprendre ni Schwabe, ni Adry, ni les autres savants dont je consultai les travaux.
Le Père Desbillons, dans sa deuxième dissertation sur les fables
{p. 92}de Phèdre, s’était exprimé ainsi : « Ea demum
post mortem Reginæ delata est ad bibliothecam Vaticanam, ubi hodieque
servatur124. »
Il était, comme on le voit, assez affirmatif ; mais il avait écrit
avant les événements dont la Révolution de 1789 avait été le point de départ.
Aussi Schwabe, dans son édition de 1806, était-il moins fixé sur le sort du
manuscrit, et dans son Index codicum manuscriptorum Phædri il
manifestait ses doutes en ces termes : « Qui an hodie exstet in bibliotheca
Vaticana an nuper a Gallis cum aliis cimeliis Parisios transmissus sit, non
constat125. »
Partageant probablement la même incertitude, Adry, dans son Examen des nouvelles fables de Phèdre, écrit en 1812, disait :
« Il a peut-être été apporté à Paris. »
En effet, sous le Directoire, le général Bonaparte était entré à Rome avec l’armée de la République française, et avait imposé au pape vaincu le traité de Tolentino. Le gouvernement pontifical n’ayant pas les ressources nécessaires pour payer l’indemnité de guerre, il avait été convenu que cinq cents manuscrits seraient livrés à la France. En exécution de cet accord, ils avaient été remis, le 23 messidor an V (13 juillet 1797), aux commissaires de la République, qui les avaient ensuite expédiés à Paris.
La nomenclature de ces cinq cents manuscrits, parmi lesquels figure
le manuscrit de Daniel, a été donnée dans un petit volume in-8º, intitulé :
Recensio manuscriptorum codicum qui ex universa
bibliotheca Vaticana… procuratoribus Gallorum traditi fuere
, et
publié à Leipzig en 1815 chez le libraire Paul Gotthelf Kummeri.
Pour me renseigner, ignorant l’existence de ce petit volume, je
consultai les autres ouvrages qui me parurent le plus propres à m’éclairer. Je
songeai d’abord à la collection des classiques latins de Lemaire ; je consultai le
Phèdre qui a été publié en 1826 dans cette collection et qui
n’est avec quelques additions que la réimpression de l’édition de Schwabe, et j’y
trouvai une note du bibliophile Barbier, ainsi conçue : « Ce manuscrit ne
s’est pas trouvé parmi ceux de la Bibliothèque du Vatican, qui ont été apportés
à Paris. »
J’avoue que j’avais peine à comprendre comment des savants sérieux
avaient pu se résoudre à rester dans une pareille ignorance, {p. 93}et j’étais convaincu que les éditions de Phèdre
plus récentes me fourniraient le renseignement cherché. Je recourus à la
consciencieuse publication de M. Berger de Xivrey. Il parle bien du manuscrit dans
sa préface ; mais lui qui, à force de patiente volonté, avait fait revivre le
manuscrit de Pithou, il n’avait, pas plus que ses devanciers, eu le courage de
s’inquiéter de ce qu’était devenu celui de Daniel. Et, quand se posa devant lui
l’inévitable question de savoir si ce manuscrit était encore au Vatican, il
l’éluda en laissant tomber de sa plume ces mots empreints d’une étonnante
nonchalance : « Y est-il encore ? N’y est-il plus ? C’est une question dont
M. l’abbé Maï pourrait peut-être donner la solution. »
Ces lignes étaient écrites depuis quelques mois à peine, que l’abbé Maï la donnait. Si j’avais songé à recourir à ses instructifs travaux, je l’aurais trouvée dans le troisième volume, publié à Rome en 1831, de sa collection des auteurs classiques édités d’après les manuscrits du Vatican126.
Sans même fouiller cette vaste collection, j’aurais pu puiser des renseignements précis soit dans le supplément ajouté par Orelli, en 1832, à son édition de Phèdre publiée à Zurich l’année précédente, soit dans la remarquable notice de M. Jules Fleutelot, qui figure en tête du Phèdre publié en 1839 dans la collection des classiques latins de M. Nisard, soit dans l’histoire de la fable ésopique publiée par M. Edelestand du Méril en 1854, soit enfin dans le volume de la collection des anciens poètes français, qui contient la chanson de geste intitulée Otinel et qui a été publié par MM. Guessard et Michelant en 1859.
Malheureusement ma mauvaise étoile me fit diriger mes regards du
côté de la collection Panckoucke. Les fables de Phèdre y sont précédées d’une
étude sur les manuscrits de cet auteur. Je la consultai ; mais cette étude n’était
qu’une mauvaise compilation, et je n’y trouvai pour tout renseignement que cette
phrase : « Il est bien probable que ce manuscrit est aujourd’hui au
Vatican127. »
{p. 94}La forme peu affirmative de ce renseignement n’était pas de nature à me tirer de mon incertitude, d’autant plus qu’il était accompagné d’une note, suivant laquelle Dom Cl. Étiennot de la Serre, dans une lettre où il fait l’historique de Saint-Benoît-sur-Loire128, aurait dit que les livres de P. Petau étaient encore à Stockholm. Toutes mes recherches ne servaient donc qu’à augmenter ma perplexité.
J’avais une dernière ressource : c’était d’aller à la Bibliothèque nationale. Je m’y rendis ; mais ma démarche fut infructueuse. Le manuscrit ne figurait pas sur le catalogue imprimé du fonds latin, et les bibliothécaires ne purent même me dire s’il était dans la Bibliothèque.
N’espérant plus le découvrir à Paris, je pris le parti de le chercher ailleurs. Mais où aller ? Était-il à Rome ou à Stockholm ? J’optai pour la direction qui me souriait le plus. Le 11 octobre 1869, je partis pour la ville éternelle. Le jour même de mon arrivée, je me rendis au Vatican. Mais il était impossible d’entrer dans la bibliothèque. C’était l’époque des vacances ; elle était fermée.
J’appris que le conservateur était un savant bénédictin français, le cardinal Pitra. J’allai le trouver dès le lendemain matin. Je lui exposai l’objet de ma visite, et les raisons qui me faisaient penser que le manuscrit était au Vatican. Il ignorait, lui aussi, si le manuscrit s’y trouvait. Mais, comme les livres, provenant de la reine Christine, n’avaient pas été fondus dans la bibliothèque et qu’ils y occupaient une division spéciale, formant dans l’immense galerie un fonds qui portait encore son nom, il m’assura que la recherche serait promptement faite. Il était dix heures du matin. Il me promit que, si le manuscrit existait, il serait à onze heures à ma disposition sur une des tables de la salle de travail.
À l’heure dite, j’étais à la bibliothèque. Le manuscrit m’attendait, ouvert à la page où commençaient les fables de Phèdre.
§ 2. — Description du manuscrit. §
Le manuscrit de Phèdre, que j’avais sous les yeux, était relié avec deux autres d’âge et d’écriture très différents, et le tout {p. 95}formait un petit volume in-8º, qui, marqué à deux endroits de l’estampille rouge de la Bibliothèque nationale, avait évidemment été apporté à Paris dans les beaux jours de la République, rapporté à Rome après la chute du premier Empire, et réintégré sous le nº 1616 dans le fonds de la reine Christine.
La couverture est en carton revêtu de vélin.
Les 123 feuillets des trois manuscrits sont également en vélin.
Le premier des trois, celui qui est au commencement du volume, en occupe les 16 premiers feuillets. L’écriture paraît du xiie siècle. Elle est très lisible. La première lettre de chaque chapitre est ornée d’arabesques.
C’est un traité de musique. Il commence par un préambule intitulé :
Proœmium magistri Guidonis Augensis super tractatum suum
de musica.
Le préambule se compose de quelques lignes ; puis
vient le traité lui-même précédé de cet autre titre : Incipit
tractatus magistri Guidonis Augensis super musica.
J’appelle, en passant, l’attention sur ces deux titres. Le maître
Guido, dont ils donnent le nom, était un moine du xie siècle, qui est encore aujourd’hui célèbre sous le nom de Gui
d’Arezzo, et que souvent aussi on nomme l’Arétin. Or, le surnom d’Augensis, qui lui est donné dans le manuscrit copié à une époque
relativement peu éloignée de sa mort, a porté Angelo Maï à croire qu’il ne devait
pas être originaire d’Arezzo et que la petite ville d’Eu pouvait revendiquer
l’honneur de lui avoir donné le jour : dans une note ajoutée à la préface qui
précède sa publication du manuscrit de Daniel129, il fait observer que Sigebert qui a donné à Guido
l’épithète d’Arétin, s’est pour cela fondé sur ce qu’il avait dédié son œuvre à
Théobald, évêque d’Arezzo. « Mais, dit-il, les moines sont les hommes qui
renoncent le plus à leur pays natal, »
et il cite comme exemple Gerbert,
qui, Français de naissance, fut en Italie placé à la tête de l’abbaye de Bobio.
M. Fleutelot n’a pas hésité à accepter l’opinion du savant cardinal130, et moi-même, dans la première édition de cet
ouvrage, j’avais exprimé le même avis. J’ignorais que, dans sa {p. 96}Biographie universelle des musiciens131, le savant
Fétis avait examiné à fond la question et irrévocablement démontré qu’Arezzo avait
bien été la patrie de l’homme remarquable qui a été le véritable inventeur de la
musique moderne132.
Le second manuscrit est celui qui porte les fables de Phèdre. L’écriture est du xie siècle. Elle est fine, mais très lisible.
Ce manuscrit ne comprend que les feuillets 17, 18, 19 et 20 ; les fables de Phèdre ne remplissent que le recto et le verso du feuillet 17 et le recto du feuillet 18, c’est-à-dire les trois premières pages.
Ces trois pages ne contiennent que huit fables du premier livre ;
c’est par erreur que MM. Guessard et Michelant, peu préoccupés d’ailleurs de
Phèdre qu’ils ne cherchaient pas dans ce manuscrit, en signalent seulement sept
dans leur édition de la chanson de geste, intitulée Otinel133. Leur
erreur provient de ce que la septième {p. 97}fable du manuscrit,
écrite, sans titre à l’encre rouge, à la suite de la précédente, échappe à
l’observateur qui n’y regarde pas de près, et, comme ils ne songeaient à extraire
du volume que la chanson d’Otinel dont je parlerai tout à l’heure, on conçoit
qu’ils ne l’aient pas aperçue. Au moins auraient-ils dû lire exactement les
titres ; et c’est ce qu’ils n’ont pas fait ; car, jetant sur eux comme sur le
reste un coup d’œil trop superficiel, ils intitulent la première fable :
De Boue et Asino134.
Les huit fables du premier livre, conservées dans le manuscrit de Daniel, étaient :
1º La xie, intitulée : De Leone et Asino
,
2º La xiie, intitulée : Cervus ad fontem laudat cornua
,
3º La хiiie, intitulée :
Vulpis ad Corvum
,
4º La xviie, intitulée : Canis ad Ovem. Lupus testis commodasse contendit
,
5º La xviiie, intitulée : Mulier parturiens ad virum
,
6º La xixe, intitulée : Canis parturiens ad alteram
,
7º La xxe, sans titre,
8º La xxie, intitulée : Leo deficiens, Aper, Taurus, Asellus
.
Le premier vers manque à la première fable. Il ne faudrait pas en
conclure qu’un premier feuillet a disparu. Tout prouve le contraire. En effet, la
fable est précédée de son titre De Leone et Asino, et au-dessus
du titre se trouve la désignation générale de l’ouvrage dans les termes suivants :
Phedi Aug. Liber. L. Œsophiarum Incip.
feliciter.
La première page se termine par ce vers de la fable Cervus ad fontem :
Utilia mihi quam fuerint quæ despexeram,
et la deuxième page par cet autre de la fable Mulier parturiens ad virum :
Onus naturæ melius quo deponeret.
Le reste remplit la troisième page.
{p. 98}Les vers, dont les manuscrits de Pithou et de Reims n’avaient tenu aucun compte, sont au contraire ici scrupuleusement séparés. Seulement, comme dans tous les manuscrits de la même époque, de nombreuses abréviations y attestent l’économie de parchemin et surtout de travail, à laquelle visaient toujours les copistes.
Le verso du feuillet 18 est occupé par une prière en prose latine rimée. Angelo Maï dit que c’est la prière d’Hincmar. Elle est d’une écriture du xiie siècle.
Elle est intitulée : Oratio sancta quam
composuit…
Le dernier mot, qui était le nom de l’auteur, a subi
un grattage qui le rend illisible.
Cette prière remplit la quatrième page et le commencement de la
cinquième. En voici les premiers mots : O mi custos, mi heros,
mi pater misericors.
Sans intervalle, elle est suivie du psaume LXXXV en grec, qui
commence au premier tiers du recto du feuillet 19 et qui s’étend jusqu’au bas du
recto du feuillet 20. Les mots, quoique grecs, sont écrits en caractères romains
du xiie siècle, et souvent l’orthographe en est
altérée. Ainsi on lit : olin tin imeran
(tota
die) au lieu de : olèn tèn èmeran
, — tin suchim
(animam) au lieu de tèn
psuchèn
, — tin proseuchin
(orationem) au lieu de : tèn proseuchèn
,
— ke
(et) au lieu de cai
, — simion
(signum) au lieu
de sèméion
. Le texte grec est accompagné, en
interligne, de la traduction latine écrite en lettres de moindre grosseur. Cette
traduction commence par cette phrase qui diffère également des deux versions
connues du même passage de la Bible : « Inclina, Domine, aurem
tuam, et exaudi me, quia pauper et obscurus sum. »
Au verso du feuillet 20 se trouve l’ех-libris que j’ai déjà signalé et dont l’écriture est du xiie siècle. Dans la pensée du moine à qui il est dû, il a servi à utiliser la dernière page qui autrement serait restée blanche.
Enfin, un peu plus bas, a été tracé ce singulier vers, qui semble être, sinon de la même main, au moins de la même époque :
Sepe comesta, bovis caro plus placet, auget amorem.
Tel est le second manuscrit.
Le troisième que renferme le volume, est le plus considérable, il s’étend du feuillet 21 au feuillet 124. Il est occupé jusqu’au feuillet 92 {p. 99}par un fragment du roman de Fier-à-bras en vers français de dix syllabes. Ce fragment porte la date de 1318. Puis vient la chanson de geste intitulée Otinel, dont l’écriture est également du xive siècle. Elle a, comme je l’ai déjà dit, été, en 1859, publiée par MM. Guessard et Michelant qui ont pris la peine d’aller la copier au Vatican.
Voici ce que, dans leur préface, ils disent du roman d’Otinel :
« Ce poème est incomplet. On y remarque une première lacune dès le début,
au fol. 93 vo du manuscrit. Une seconde lacune, plus
considérable, s’ouvre au fol. 103. Ce feuillet et les suivants, jusques et y
compris le feuillet 108, appartiennent au roman de Fier-à-bras
et ont été reliés par erreur avec le roman d’Otinel135. »
Quant au sujet de ce dernier roman, il se rattache à l’histoire
légendaire des exploits de Charlemagne. « La chanson d’Otinel, disent MM. F. Guessard et H. Michelant136, est le récit d’une expédition de
Charlemagne en Lombardie contre le Sarrasin Garsile ou Marsile. Otinel, le héros
de ce poème, y apparaît d’abord comme messager de Garsile. À ce titre, il vient
à Paris sommer Charlemagne de rendre hommage au roi son seigneur et d’abjurer la
foi chrétienne ; mais, par un effet miraculeux de l’intervention divine, c’est
lui-même qui bientôt renie sa croyance et abandonne la loi de Mahomet pour celle
de Jésus-Christ. Filleul de Charlemagne, qui le fiance à sa fille Bélisent,
Otinel prend place parmi les douze pairs, marche avec eux contre Garsile dont il
devient l’ennemi le plus acharné et le plus implacable, et, après avoir
contribué autant que personne à la défaite du païen, reçoit pour récompense la
main de Bélisent et la couronne de Lombardie. »
La fin du poème est annoncée par ces mots : Explicit le Romans de Otinel.
Ce sont les derniers du
volume.
Le manuscrit de Daniel étant maintenant connu, je vais brièvement signaler et réfuter, en ce qui touche les fables de Phèdre, les erreurs commises par les critiques, qui, faute de l’avoir vu, ou de l’avoir suffisamment examiné, se sont étrangement trompés sur son contenu.
Ce qu’ils ont écrit à cet égard montre quelles incroyables fautes on est exposé à commettre, lorsqu’en matière de philologie, au {p. 100}lieu de recourir aux sources, on s’en rapporte aux assertions des savants même les plus justement estimés, et même, lorsqu’en recourant aux sources, on ne les étudie pas avec toute l’attention qu’elles exigent.
Voyons d’abord les erreurs relatives au nombre même des fables.
Depuis la publication de l’édition de Pithou jusqu’à la mort d’Alexandre Petau, c’est-à-dire pendant un demi-siècle, le manuscrit avait pu être à la disposition des savants français. Mais, sauf Rigault, nul ne s’en était servi. Dans son édition de 1599, il en avait signalé les variantes qui lui paraissaient les plus importantes. Quant aux autres savants, qui, après lui, voulurent en parler, ils ne prirent pas même la peine d’y recourir. Aussi ont-ils commis, les uns après les autres, les erreurs les plus étranges.
Si l’on consulte l’édition de Phèdre due au Père Desbillons, on l’entend affirmer, dans sa Disputatio secunda137, que le manuscrit de Daniel embrassait à peine le tiers du premier livre.
Cela était vrai ; mais Adry, habitué à tout éplucher, n’accepta pas
d’emblée la déclaration, d’ailleurs un peu vague, du Père Desbillons ; il la
discuta et, en la discutant, ne fut pas très bien inspiré. « Parmi ces
manuscrits, écrit-il en parlant des livres de l’ancienne abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire, il s’en trouvait un, non pas de toutes les fables de
Phèdre, mais d’une partie du premier livre, un tiers, selon le P. Desbillons,
qui devrait dire deux tiers, puisqu’on cite des variantes depuis la première
jusqu’à la xxie fable inclusivement. »
Adry avait remarqué que jusqu’à la xxie fable les
éditions savantes révélaient des variantes tirées du manuscrit de Daniel, et il en
avait conclu qu’il contenait les 21 premières fables. En y regardant d’un peu plus
près, il aurait vu que, s’il se terminait à la xxie, il ne commençait pas à la première, qu’il partait de la xie, dont il ne donnait pas même le premier vers, et
qu’enfin il ne contenait pas toutes les fables comprises entre la xie et la xxie.
Schwabe, plein de confiance dans le Père Desbillons, reproduit purement et simplement son assertion138.
En 1829, pour la première fois depuis I. Vossius, un Allemand, nommé Goettling, prit au Vatican connaissance du manuscrit de {p. 101}Daniel ; mais il n’en fut guère plus avancé. Il n’eut pas l’hallucination qui avait fait voir à Rigault une fable étrangère au manuscrit. Mais il commit l’erreur inverse, et, n’y jetant qu’un coup d’œil superficiel, il n’aperçut que sept fables.
En 1830, le consciencieux éditeur du manuscrit de Pithou ne fit
qu’aggraver le chaos. Dans sa préface, d’ailleurs fort instructive, parlant de la
Vetus Danielis charta ou chartula, il
s’exprime ainsi : « Ce n’était qu’un fragment contenant seulement les
21 premières fables du IIe livre139. »
À lire ces lignes, on croirait que le manuscrit
n’existait plus. Comme aucun savant ne l’avait vu depuis cent cinquante ans,
M. Berger de Xivrey pouvait avoir cette pensée. Mais ce qui ne s’explique pas,
c’est que, dans sa préface, il déclare qu’il ne contient que des fables du IIe livre, quand lui-même, au bas des huit fables du premier
livre, dont se compose la Vetus Danielis Chartula, il a soin
d’insérer dans des notes spéciales les variantes du manuscrit qu’il déclare avoir
transcrites d’après Schwabe.
L’incohérence est telle, que je ne puis me résoudre à penser que M. Berger de Xivrey l’ait réellement commise, et j’avoue que j’aime mieux n’y voir qu’un accident, dont sa pensée fut innocente et dont sa plume fut seule coupable. Il est donc entendu que c’est du premier livre qu’il a voulu parler.
Malheureusement, en dehors des fausses variantes qu’il avait si
ingénument reproduites, il avait commis une autre erreur, qui cette fois n’était
pas un lapsus calami ; elle avait consisté à répéter, sur la foi
d’Adry, que le manuscrit de Daniel embrassait les 21 premières fables, et comme
une erreur, surtout à l’abri d’un nom sérieux, est toujours plus aisée à propager
qu’une vérité même élémentaire, tous les écrivains, qui, après lui, ont parlé de
Phèdre, ou l’ont répétée, ou l’ont compliquée encore. Ainsi l’illustre Daunou, en
donnant dans le Journal des Savants140 son appréciation sur la publication du manuscrit de
Pithou, déclare que « ce n’est qu’un fragment qui ne paraît pas très
ancien, et qui ne présente qu’un peu plus de la deuxième moitié du premier
livre »
.
Il y a là deux erreurs nouvelles : d’abord l’écriture du manuscrit démontre qu’il n’est pas plus récent que le xie siècle, c’est-à-dire {p. 102}qu’il est presque aussi ancien que celui de Pithou. Ensuite il ne comprend que le quart environ du premier livre, et les huit fables dont il se compose, sont celles du milieu, et appartiennent les unes à la première moitié, les autres à la seconde.
Bientôt après l’apparition du manuscrit de Pithou, la librairie
Panckoucke commença à éditer sa traduction des classiques latins. Phèdre méritait
d’y trouver place ; il y figura, précédé de la notice que j’ai déjà plusieurs fois
citée. Il va sans dire que l’auteur de cette notice adopte les indications de ses
devanciers ; seulement, comme il est rare qu’une idée fausse soit parfaitement
comprise de celui même qui l’accepte, en voulant la reproduire il la transforme et
la rend plus inexacte encore. « Ce manuscrit, dit-il, n’est réellement
qu’un fragment ; car il ne contient qu’une partie du premier livre et des
variantes depuis la première jusqu’à la xxie fable141. »
Voilà maintenant le manuscrit de Daniel,
qui présente encore des variantes applicables aux vingt et une premières fables.
C’est à n’y plus rien comprendre.
On peut dire, à la décharge de M. Panckoucke, que vingt ans après lui MM. F. Guessard et H. Michelant ne se montraient pas plus infaillibles que lui. Mais, ainsi que je l’ai dit, Phèdre n’était pas l’objet de leurs recherches et ce n’était qu’incidemment qu’ils avaient fait mention de ses fables.
Après avoir examiné les graves erreurs relatives au nombre des fables, il me reste à relever, au sujet des prétendues variantes tirées du manuscrit de Daniel, les incroyables bévues qui ont été commises.
Les huit fables qu’il renferme étant celles que j’ai précédemment indiquées, il s’ensuit qu’elles ne comprennent pas la fable xvi, Ovis, Cervus et Lupus. Il n’en est pas moins vrai que de graves critiques ont été jusqu’à présenter sur cette fable, comme tirées du manuscrit de Daniel, des variantes, qui dès lors ne pouvaient qu’être purement imaginaires.
Depuis la publication de l’édition de Pithou jusqu’à la mort d’Alexandre Petau, c’est-à-dire pendant un demi-siècle, il avait pu être à la disposition des savants français ; mais, sauf Rigault, nul ne s’en était servi.
{p. 103}Dans son édition de 1599, ce dernier,
qui en avait d’ailleurs assez exactement relevé les leçons, a commis cependant une
énorme faute : il a indiqué les mots nomen cum
locat
comme fournis par le manuscrit, au lieu des mots homines cum avocat
, qui, dans celui de Pithou,
appartiennent au premier vers de la fable xvi. Or cette fable n’existe
dans le manuscrit de Daniel ni en entier ni en fragment. Rigault, en mettant ses
notes en ordre, a attribué au manuscrit de Daniel des mots qu’il avait dû tirer
d’une autre source142. Puis, s’étant aperçu de son erreur, il avait, dans ses deux
dernières éditions publiées en 1617 et en 1630, supprimé l’indication par lui
inexactement donnée dans la première.
Malheureusement les critiques n’ont pas compris la cause de cette suppression. Il en est résulté que Meursius, sur la foi de la première édition de Rigault, a, dans ses notes sur Phèdre, en l’attribuant également au manuscrit de Daniel, reproduit la même variante143, et qu’en suite Schwabe, faisant confiance à ses devanciers, l’a rééditée à son tour. Après avoir fait observer que, dans le manuscrit de Pithou, le premier vers est ainsi écrit :
Fraudator homines cum avocat sponsore improbo,
il s’empresse d’ajouter qu’au contraire on lit dans le manuscrit de Daniel :
Fraudator nomen quum locat sponsu improbo.
Se servant enfin des travaux de Schwabe, M. Berger de Xivrey signale, dans une note, la même variante et lui attribue la même source144.
Après avoir ainsi implicitement admis l’existence de la
fable xvi, les commentateurs ne se sont pas arrêtés en si beau
chemin, et le même M. Berger de Xivrey, dans une autre note, indique une {p. 104}autre variante qui serait fournie par le second vers, et
suivant laquelle, au lieu des mots mala videre
,
le manuscrit de Daniel porterait ceux-ci : mala
dare.
C’est encore sur la foi de Schwabe, appelé par lui vir summus, qu’il produit sa nouvelle assertion. Ce dernier, il
est vrai, dans son Excursus sur la fable xvi145, avait écrit cette phrase : « Grævius è Schedis
Dan. legendum existimat : mala dare expetit. »
Mais
Schwabe s’était lui-même basé sur le témoignage de Burmann, à qui il avait renvoyé
le lecteur par la note suivante : « Burmanni Syllog. Epp., t. IV,
p. 42. »
Quant à Burmann, dans l’ouvrage cité par Schwabe, il avait publié une lettre écrite à Utrecht en 1658, dans laquelle Grævius disait à Heinsius :
« Phædrum Schefferi avide expecto. Excerpsi ex observationibus meis unam atque alteram conjecturam, quas, si videbitur, cum viro doctissimo communicabis. Lib. I, fab. xvi :
Fraudator nomen cum locat sponsu improbo,Non rem expedire, sed mala videre expetit.Hunc locum in variis suis lucubrationibus mire vexavit Salmasius. Sed legendum est ex scidis Petri Danielis, mala dare expetit146. »
L’assertion remontait en somme à Grævius. Il faut avouer que de la part de cet illustre savant elle était au moins étrange. Il n’avait pas commis là une simple erreur provenant de l’indication d’un manuscrit pour un autre. En effet, la leçon attribuée au manuscrit de Daniel n’appartient pas davantage à celui de Reims. Elle est sortie de l’imagination de Grævius.
De tout ce qui précède que résulte-t-il ? C’est qu’il n’était pas inutile, au milieu de tant d’assertions aussi fausses que contradictoires, que je fisse connaître exactement les fables du manuscrit de Daniel. Il est vrai qu’ainsi que je l’ai dit, elles ont été déjà éditées en 1831 par le cardinal Angelo Maï. Mais, comme il n’en a pas fait l’objet d’une publication séparée et qu’elles figurent noyées dans un immense ouvrage, elles ont le plus souvent échappé à {p. 105}l’attention des personnes, qui, cherchant à se renseigner, s’adressent naturellement aux livres spéciaux.
Ce n’est sans doute qu’un court fragment. Mais le très petit nombre des manuscrits de Phèdre, contenant son vrai texte, lui donne une importance relative, qui justifie amplement l’étendue de cette étude.
§ 3. — Apographe du manuscrit. §
On sait qu’à la mort de Daniel, arrivée en 1603, ses livres, mis en vente, furent achetés en partie par Paul Petau et en partie par Bongars. On sait aussi comment ceux acquis par ce dernier sont aujourd’hui conservés dans la bibliothèque de la ville de Berne et comment, par suite, la plupart des manuscrits qu’elle possède proviennent de l’abbaye de Saint-Benoît-Fleury.
Parmi ces manuscrits il en est un portant la cote 268 dont je dois dire ici quelques mots. Lorsque j’ai publié la première édition de cet ouvrage, je ne l’avais pas encore rencontré. Si je l’avais connu, je ne l’aurais point passé sous silence.
C’est un cahier du format in-4º, dont les feuillets sont en papier et qui ne contient que 44 pages d’écriture. On y trouve onze extraits empruntés aux œuvres des anciens auteurs latins.
Ce recueil, qui est de la main de Daniel, avait été commencé par lui avant la destruction de l’abbaye de Saint-Benoît-Fleury qui fut saccagée en 1562, et ne fut complété qu’après et, sans doute en grande partie, à l’aide des manuscrits qui en provenaient. En effet la page 10 porte la date de 1560, et, sur les pages 33 à 35 a été transcrit le fragment des fables de Phèdre qui avait été conservé dans le fameux manuscrit soustrait au pillage.
Le texte de ce manuscrit a été religieusement respecté par Daniel qui en cela a été plus scrupuleux que ne devait l’être plus tard le cardinal Angelo Maï. Ainsi l’altération du nom de Phèdre dans le titre général a été maintenue, les titres particuliers des fables ont été littéralement reproduits, et il n’a pas été suppléé à l’absence de celui de l’avant-dernière ; enfin, comme le manuscrit, l’apographe comprend au total 83 vers qui ont été copiés avec une exactitude mathématique, et si, dans la première édition de {p. 106}cet ouvrage, je n’avais pas déjà, par la publication des variantes, fait ressortir les particularités du modèle, les critiques désireux de les bien connaître, au lieu d’entreprendre le voyage de Rome, pourraient se contenter de se rendre à Berne.
Section IV.
Manuscrit napolitain de Perotti. §
§ 1. — Histoire du manuscrit. §
J’ai dit que les fables de Phèdre n’avaient pas été au moyen âge entièrement ignorées, et que quelques hommes lettrés les avaient eues dans les mains et s’en étaient servis. Lorsque je m’exprimais ainsi, c’était surtout Niccolo Perotti que j’avais en vue. En copiant celles qui lui semblaient contenir les meilleures maximes, il nous en a conservé soixante-quatre, sur lesquelles trente-deux ne se trouvent pas dans les trois premiers manuscrits déjà examinés.
J’ai donc à m’occuper du sien ; mais, avant de parler de l’ouvrage, je crois devoir dire d’abord quelques mots de l’auteur.
Il naquit, en 1430, à Sassoferrato, sur les confins de l’Ombrie et de la marche d’Ancône. Envoyé tout jeune à Bologne, il y reçoit les leçons de Nicolas Volpe et de Vittorino de Feltre. Son ardeur au travail et son instruction lui valent bientôt l’honneur de succéder à ses maîtres, et il devient professeur de rhétorique et de poésie dans l’Académie où il avait étudié. Quand l’empereur d’Allemagne Frédéric III passe par Bologne, c’est lui qui est chargé de lui adresser la harangue officielle.
En 1456, appelé à Rome, il y remplit les fonctions de secrétaire apostolique, et est nommé comte du palais de Latran.
En 1458, le siège archiépiscopal de Siponte était vacant. Il y est promu. De là vient son surnom de Sipontinus. Mais Siponte avait été ruinée, et l’archevêché avait été transféré à Manfredonia, petit port situé sur les bords de l’Adriatique, dans cette partie de la Pouille qu’on nomme la Capitanate, et au pied de ce Monte Gargano, qui, en s’avançant dans l’Adriatique, forme l’éperon de la botte italienne.
{p. 107}Manfredonia est bien loin de Rome, et comme ses talents rendent dans la capitale sa présence utile, il y reste auprès du souverain pontife.
Puis, il est successivement nommé, en 1465 et en 1474, gouverneur de l’Ombrie et de Pérouse, et meurt le 13 décembre 1480, auprès de Sassoferrato, dans l’île de Centipera, où il avait toujours aimé à passer ses moments de liberté.
Il avait été un des premiers philologues de son temps. Il a laissé de nombreux ouvrages, dont la nomenclature nous a été donnée d’abord par Léon Allatius, puis par Jacobilli et enfin par Apostolo Zeno.
Avant d’écrire les œuvres d’érudit qu’il a laissées, il avait copié ou composé même, pour se distraire, des vers qu’il n’avait conservés que pour lui et les siens.
Il avait à sa disposition deux manuscrits, l’un de Phèdre, l’autre
d’Avianus. À ses heures de loisir, il les lisait et en extrayait tantôt une fable,
tantôt une autre, sans ordre ni méthode, ou bien il composait tantôt une
épigramme, tantôt une épître à un ami. Un seul et même cahier les recevait les
unes à la suite des autres. Il l’avait commencé dans sa jeunesse ; c’est lui-même
qui nous en fournit la preuve, d’abord dans son Cornu copiæ,
lorsqu’il déclare, en parlant de la fable Arbores in tutela
deorum, l’avoir, jeune encore, tirée d’Avianus et traduite en vers
ïambiques, ensuite dans sa préface adressée à Titus Mannus Veltrius147, son
compatriote, lorsqu’il s’exprime ainsi : « Sunt enim, ut ad te alias de
Epistolis scripsi, inter versiculos nostros aliqui, quos olim adolescentes lusimus, qui si hac ætate et professione nostra scripti a
nobis viderentur, iure fortasse reprehensione digni putaremur… Da igitur operam,
ut intelligant legentes, quæ adolescentibus nobis et nulla
adhuc dignitate præditis exciderint, quæ hac ætate scripta sint. »
Malheureusement, quoiqu’il eût, dès sa jeunesse, commencé sa
compilation poétique, et qu’il l’eût reprise à des intervalles plus ou moins
longs, il l’abandonna de bonne heure. S’il l’avait continuée, non pas jusqu’à la
vieillesse qu’il ne connut pas, mais jusqu’à la fin prématurée de son existence,
il est probable que nous {p. 108}posséderions aujourd’hui
l’œuvre entière de Phèdre. Dans l’âge viril, des occupations sans doute plus
importantes et plus multipliées l’obligèrent à renoncer à ceux de ses travaux
littéraires qui n’étaient pour lui qu’un délassement de l’esprit. On trouve,
jusque vers la fin de son recueil, des épigrammes grivoises qu’il n’avait pu
écrire qu’avant sa promotion au siège de Siponte, et il n’avait que vingt-huit
ans, lorsqu’il y fut élevé. Il existe même un document qui permet de fixer
l’époque à laquelle il cessa sa compilation ; c’est la lettre suivante qu’un de
ses amis, François Philelphe, l’un de ses précurseurs italiens dans la science
philologique, lui adressa, le 15 décembre 1463, pour le féliciter de sa traduction
latine en vers élégiaques d’un vieil oracle d’Apollon : « Franciscus
Philelphus Nicolao Archiepiscopo Sipontino, sal. Apollinis oraculum quoddam,
quod dicitur περὶ τοῦ ἰσθμοῦ e Græco abs te nuper, Pater humanissime, traductum
luculentissimis perpolitisque versibus, divertit ad me, perinde atque ad
hospitem amantissimum tuî. Excepi id sane, ut par fuerat, liberaliter,
honorificeque ; sumque non minus ejus eloquentia quam prædictione futurorum
delectatus, miratusque quod Græce et natum et educatum, tam apte, tamque
eleganter Latinam linguam didicisset. Nec enim intelligo fieri posse, ut Græco
sermone, aut pulchrius loquatur aut eruditius, quam à te Latine loqui edoctum
sit. Itaque plurimum desidero lectitare istiusmodi oraculum, etiam Græce. Quod
ut cures, te majorem in modum rogo. Vale. Ex Mediolano, xviii Kal.
Januarias MCCCCLXIV. »
Quand Perotti reçut cette lettre, il n’avait que trente-trois ans, et la traduction à laquelle elle fait allusion est placée presque à la fin de son recueil, auquel il n’a ainsi presque rien ajouté pendant les seize dernières années de sa vie.
Il le dédia à son neveu Pirrho Perotti, pour qui il avait une très vive affection, et à qui il donnait dans sa dédicace l’épithète la plus tendre et la plus flatteuse.
Il est cependant probable, contrairement à l’opinion de Ginguené148, qu’il n’avait pas eu, en le commençant, la pensée de l’écrire pour son éducation.
{p. 109}Si le manuscrit renferme beaucoup de fables bonnes à être mises sous les yeux d’un enfant, il faut avouer aussi qu’il s’y mêle çà et là des compositions licencieuses qu’un enfant ne peut lire. Aussi, comme cela résulte de la dédicace elle-même, Pirrho Perotti, quand son oncle songea à lui destiner son recueil, était-il déjà grand garçon, et, suivant l’expression de ce dernier, adolescentem suavissimum.
D’autre part, il me paraît constant que la dédicace de Perotti à son neveu fut par lui composée sept ou huit ans avant sa mort ; car elle se signale par une parfaite ignorance du rythme ïambique et par suite a dû précéder la publication de son livre sur les différents genres de mètres poétiques, que lui-même dit avoir écrit à une époque où, depuis une dizaine d’années, il ne s’occupait plus de poésie latine149.
Pirrho Perotti ne fut pas ingrat envers son oncle. Il s’occupa après sa mort de publier ses ouvrages, et ce fut lui qui, en 1489, fit imprimer à Venise le Cornu copiæ, qui était son œuvre capitale. Mais, soit qu’il n’attachât qu’une importance très secondaire à l’Epitome fabellarum Æsopi, Avieni et Phædri, soit, comme l’état du manuscrit permettra plus loin de l’affirmer, qu’il n’eût pas reçu de son oncle l’exemplaire qui lui était destiné, il ne lui fit pas le même honneur, et le manuscrit resta ignoré.
Aussi Torquatus Perotti, évêque d’Amera, qui avait réuni en un seul volume les écrits connus de Niccolo, avait-il omis son Epitome.
Dans ses Apes Urbanæ, publiées à Rome en 1633 et rééditées à Hambourg en 1711150, Léon Allatius, donnant la nomenclature des œuvres de l’archevêque de Siponte qu’il ne connaissait que par la publication de Torquatus, avait à son tour gardé le silence sur le recueil de poésies latines.
{p. 110}Il en avait ensuite été de même de Louis Jacobilli151, qui, dans son Catalogus scriptorum provinciæ Umbriæ, publié à Foligno en 1658152, ne l’avait pas signalé davantage.
Enfin, en 1713, dans son Giornale de’ Letterati d’Italia153, Apostolo Zeno154 ne paraissait pas non plus en avoir soupçonné l’existence. Voici tout entière la nomenclature qu’il y donnait des ouvrages de Perotti :
1. Polybii libri V priores, e græco in latinum translati,
2. Oratio D. Basilii de invidia, e gr. in lat. versa,
3. Monodiæ Aristidis, Libanii et Bessarionis,
4. Aristoteles de virtutibus et vitiis,
5. Epicteti philosophi Enchiridion,
6. Hippocratis jusjurandum,
7. Plutarchi libellus de Fortuna Romanorum,
8. Un’ altra versione dal greco di un certo Oracolo di Apollo fatta dal Sipontino in versi latini nel 1463,
9. Cardinalis Bessarionis vita,
10. Commentaria rerum suæ patriæ,
11. Orationes,
12. Epistolæ,
13. In Georgium Trapezuntium,
14. In Poggium Florentinum,
15. Cornu copiæ, sive commentariorum linguæ latinæ liber primus,
16. In C. Plinii Secundi Proœmium. Commentariolus,
{p. 111}17. In P. Papinii Statii sylvas expositio,
18. In Horatii odas commentarius,
19. Rudimenta grammatices,
20. De generibus metrorum,
21. De Horatii Flacci ac Severini Boetii metris,
22. De conscribendis epistolis,
23. De puerorum eruditione.
On voit que Zeno ne mentionnait pas l’Epitome155.
Cependant, au commencement du xviiie siècle, sans qu’on ait pu savoir quelle filière le manuscrit avait suivie, il se trouvait dans la bibliothèque du duc de Parme. À cette époque, un jeune Hollandais, riche et savant, parcourait l’Europe. Il se nommait Jacques-Philippe d’Orville. Né le 28 juillet 1696, il avait d’abord été confié à Hoogstraten, puis avait suivi à l’Université de Leyde les cours de Jacques Gronovius et de Burmann. Après avoir été reçu docteur en droit, cédant à son goût pour les études purement littéraires, il avait, contre le vœu de ses parents, renoncé au barreau, et, profitant de leur grande fortune pour voyager, il avait successivement visité les bibliothèques des Pays-Bas, de l’Angleterre et de la France.
Dans les premiers mois de l’année 1727, il était passé en Italie, et c’est alors qu’il découvrit à Parme le manuscrit ignoré. D’Orville, transporté d’enthousiasme, s’empressa d’en copier un passage et de l’envoyer à son professeur Burmann, qui était devenu son meilleur ami. Il lui écrivit en même temps qu’il se mettait à sa disposition pour lui faire, s’il le désirait, des extraits plus étendus du manuscrit.
Burmann achevait sa dernière édition des fables de Phèdre, et il
allait livrer son travail à l’imprimeur, quand lui arriva cette bonne nouvelle. Je
renvoie à sa préface ceux qui voudront savoir avec quelle joie il la reçut. Il
suspendit sa publication et pria son élève de lui adresser une copie du manuscrit.
Après de longues semaines d’attente, au mois d’avril 1827, elle lui parvint par la
poste. Il ouvrit l’enveloppe, en palpitant d’émotion ; mais quel fut son
désappointement, quand la copie lui eut donné une idée de ce qu’était l’original !
« Elle me révélait, dit-il, un manuscrit non {p. 112}seulement atteint par le temps, mais encore mutilé et presque anéanti, et je
fus vivement affligé à la vue de l’écriture, extraite cependant avec un soin
extrême et avec une superstitieuse attention. Au commencement et à la fin,
Perotti avait laissé blanches quelques pages, destinées à d’autres fables qu’il
se proposait d’écrire et à l’index qui devait d’autant s’augmenter. Il avait
employé une espèce d’encre, qui n’avait pas résisté au temps, et les lettres
qu’elle avait servi à tracer, en partie avaient verdi, et, en partie disparues,
s’étaient si bien évanouies qu’il était impossible de les lire. En outre, le
manuscrit, peu soigneusement garanti soit de l’eau filtrant sans doute par les
fentes d’un toit, soit de quelque autre cause d’humidité, s’était à tel point
altéré qu’au milieu du papier les lettres sur une large surface étaient ou tout
à fait détruites ou presque entièrement effacées156. »
On voit quelle fut la déception de Burmann. Il aurait pu, et nul autre n’en eût été plus capable, restituer par de sages conjectures les passages anéantis ; il n’en eut pas le courage ; d’ailleurs il avait mis la dernière main à l’œuvre. Il se contenta d’allonger sa préface, et, négligeant les fables nouvelles, de signaler les variantes qu’offraient les anciennes dans le manuscrit de Perotti. Sa dernière édition put ainsi paraître en 1727.
Quant à d’Orville, il passa d’Italie en Autriche, voyagea encore trois années, et, en 1730, rentra à Amsterdam. Là il aurait peut-être songé à compléter le texte des trente-deux fables nouvelles ; mais il ne put jouir des loisirs qu’il rêvait. À la sollicitation de ses concitoyens, il dut accepter les fonctions de professeur à l’Université. En 1730, Burmann le prit en même temps pour collaborateur de ses Miscellaneæ observationes, qu’à partir de 1740 il continua seul. Enfin, en 1751, âgé de 55 ans, il mourut de la pierre.
Il laissa de nombreux manuscrits qui sont entrés, et qui,
aujourd’hui encore, sont conservés dans la Bibliothèque Bodléienne ; les plus
précieux sont ceux qui concernent l’Anthologie grecque et Théocrite. Parmi les
autres figure une copie du manuscrit napolitain de Perotti, qui dans le fonds
d’Orville, porte la cote X. 2. infra 2.23. {p. 113}Dans le
catalogue157 de ce fonds imprimé à Oxford en 1806, cette copie à la page 84 est
mentionnée en ces termes : N. Perotti Epitome Fabularum Æsopi, Avieni, et
Phædri. Ms. in-4o, pp. 56
.
Adry n’en a pas moins affirmé que la copie adressée par d’Orville à Burmann était sortie des mains de ce dernier et entrée dans la Bibliothèque du collège Louis-le-Grand à Paris158. Après lui, Jannelli159 et Ginguené160, moins affirmatifs, ont émis l’avis qu’elle pourrait bien n’être pas celle que Burmann avait possédée, mais avoir été prise en Hollande sur cette dernière. Ils n’ont pas d’ailleurs songé à contester que le Collège ait possédé une copie tirée directement ou indirectement du manuscrit.
Voici sur cette copie le petit conte, dont Ginguené, en
l’empruntant à Adry, s’est fait le narrateur : « Valart et Philippe la
consultèrent avec fruit pour leur élégante édition de Phèdre, chez Barbou, 1748.
Après l’abolition des jésuites, Gabriel Brotier devint possesseur de cet extrait
de d’Orville, et s’en servit utilement dans son édition de Phèdre, donnée à
Paris en 1783. Après sa mort elle passa entre les mains de son neveu, et s’est
définitivement perdue dans les troubles de la Révolution ; perte qui paraissait
d’autant plus déplorable que ni Burmann n’avait dit au public dans sa préface,
ni d’Orville n’avait écrit en tête de son extrait, dans quelle bibliothèque
d’Italie il avait découvert le manuscrit de l’Epitome de
Perotti161. »
Dans la première édition de mon ouvrage sur les Fabulistes latins, je n’avais pas complètement accepté ce récit, et, après y avoir signalé quelques erreurs de détail, j’avais nettement exprimé l’opinion que la copie du collège Louis-le-Grand n’était pas l’autographe {p. 114}de d’Orville162. Aujourd’hui je vais plus loin : je crois que le collège n’en a possédé aucune.
Rétablissons d’abord les faits. Sur quoi est basée la croyance à l’existence de cette copie ? Sur ce que, dans leurs éditions de Phèdre, Étienne André Philippe et le Père Gabriel Brotier en auraient fait usage pour noter les variantes du manuscrit de Perotti.
Il est vrai que Philippe avait relevé ces variantes dans l’édition qu’il publia, non pas, comme le dit le Père Desbillons163, chez l’éditeur Barbou en 1747, mais chez l’éditeur Jean-Auguste Grangé et avec les caractères de l’imprimeur G.-F. Simon, en 1748164.
Dans le Delectus variarum lectionum que contient son édition, Philippe, lorsqu’il signale les variantes du manuscrit de Perotti, en indique la source par les abréviations MS. Par., ou MS. P. Mais a-t-il ainsi voulu se référer à un Manuscriptus Parisiensis ? Je ne le crois pas, et je suis persuadé que c’est le manuscrit de Parme qu’il a entendu désigner. On se rappelle que c’est à Parme que d’Orville découvrit le manuscrit de Perotti. Peut-être, à raison de cette circonstance, Philippe a-t-il cru naturel de l’appeler Parmensis. Il ne faut pas, en effet, oublier que, s’il n’en a pas fait l’aveu, il ne s’en était pas moins servi des notes inédites d’Étienne Sanadon165, et de l’active collaboration de Valart166, qui, l’un et l’autre sans doute, savaient où d’Orville avait pris sa célèbre copie.
Mais alors comment, s’il n’existait pas à Paris de copie du manuscrit de Parme, Philippe a-t-il pu en extraire les variantes ? La réponse est facile : il lui a suffi de les puiser dans l’édition, dans laquelle, en 1727, Burmann avait pris la peine de les publier à la fin de la préface, et c’est ce qu’il me paraît avoir fait. Il est vrai que dans la fable ii du Livre III intitulée Panthera et Pastores, au {p. 115}lieu de la variante irati du vers XVI indiquée par Burmann, Philippe attribue au texte de Perotti la leçon innato. Mais cette divergence n’ébranle pas ma conviction et ne me détermine pas à penser qu’ils ont eu à leur disposition deux copies distinctes. Burmann n’avait, des variantes du texte de Perotti, publié que celles qui concernaient les fables anciennes de Phèdre. Il me semble que, si Philippe avait eu sous les yeux la copie de d’Orville ou une copie de cette dernière, y trouvant nécessairement les fables nouvelles, il y aurait fait quelque allusion. Or, il n’en dit pas un mot. Et, quant aux fables anciennes, il peut reproduire plus ou moins fidèlement les variantes publiées par Burmann ; mais il n’en découvre aucune qui puisse faire supposer qu’il avait en sa possession autre chose que ce que son devancier avait fait connaître.
À l’égard du Père Brotier, il semble ressortir clairement de ses
notes qu’il n’a pas prétendu avoir une copie du manuscrit de Perotti. Comme
Philippe, il ne vise que les variantes déjà révélées par Burmann, et chaque fois,
par les mots Ms. Perotti
, il fait suffisamment
comprendre qu’il n’est pas en situation de consulter une copie spéciale du texte
de l’archevêque de Siponte167.
Maintenant, comme ce dernier, avait-il un neveu, et sur quel document se sont fondés ceux qui ont prétendu que la copie du collège Louis-le-Grand était passée dans ses mains et des siennes dans celles de ce neveu qui lui-même l’aurait perdue dans les troubles de la Révolution ? Je l’ignore, et, jusqu’à preuve contraire, je n’hésite pas à voir dans ce récit un simple roman.
Ce qui est certain, c’est que longtemps on ignora où se trouvait le manuscrit de Perotti.
D’Orville pourtant n’avait pas cherché à faire un mystère de sa
découverte. En voyageant en Autriche, il avait rencontré à Vienne Apostolo Zeno,
et la lui avait révélée. Aussi ce savant s’était-il hâté de combler la lacune
qu’il avait laissée dans son Giornale de’ Letterati : il avait,
dans ses Dissertazioni Vossiane, donné une nouvelle nomenclature
des ouvrages de Perotti, dont il avait élevé le nombre de vingt-trois à vingt-six,
et dont le vingt-sixième était énoncé dans {p. 116}les termes
suivants : Epitome fabularum Æsopi, Avieni et Phædri ad
Pyrrhum Perottum, fratris filium, adolescentem suavissimum168.
Ayant mal compris ou retenu ce
que d’Orville lui avait expliqué, il avait indiqué la Bibliothèque Ambrosienne à
Milan comme détenant le manuscrit169. Aucun renseignement exact ne mettait
donc les savants sur sa trace.
Cependant, puisque la copie en était perdue, il était important de le retrouver. Le savant abbé Andrès, auteur de l’Histoire générale de la Littérature, fut un de ceux qui s’occupèrent le plus sérieusement de l’exhumer. Sur la fausse indication donnée par Apostolo Zeno, il avait écrit au comte Mazzuchelli, pour le prier de faire de minutieuses recherches dans la Bibliothèque Ambrosienne. Mais ce dernier, après avoir accédé à ce désir, n’était parvenu à aucun résultat.
Qu’était donc devenu le manuscrit, et comment fut-il enfin
retrouvé ? Voici la réponse que Ginguené fait à cette double question :
« Ce manuscrit de Perotti, environ dix ans après la découverte que le
savant hollandais en avait faite, avait été transporté de Parme à Naples avec
tous les livres appartenant aux Farnèse. Il y resta longtemps enfermé dans une
caisse, comme tous les autres. Lorsqu’il en fut tiré, ce fut pour être livré à
des mains ignorantes ; on y mit même pour titre : Perotti
fabulæ, au lieu de Veterum fabularum epitome ; et ce
fut sous ce titre inepte qu’il fut porté, dix autres années après, sur le
catalogue des manuscrits provenant de la riche bibliothèque Farnèse. Mais celle
de Naples ayant enfin reçu une organisation fixe, et l’abbé Andrès ayant été mis
à la tête de cette bibliothèque, il y a retrouvé lui-même le précieux
manuscrit ; il l’a reconnu à sa parfaite conformité avec la description donnée
par Burmann, aux variantes placées par celui-ci à la fin de sa préface, et qui
se trouvent toutes sans exception dans le manuscrit, aux lacunes indiquées dans
l’une et qui sont exactement dans {p. 117}l’autre, enfin à
tous les signes de conformité que des yeux exercés peuvent saisir170. »
Ce fut donc l’abbé Andrès, conservateur de la bibliothèque de
Naples, qui fit la seconde découverte du manuscrit. Ayant bien reconnu que c’était
celui que d’Orville avait déjà trouvé, il avait chargé un sieur Gargiulli d’en
faire une copie. Mais, si l’on en croit Cassitto, ni l’un ni l’autre n’avaient
aperçu qu’il contenait de nouvelles fables de Phèdre, et ce fut lui qui fit cette
découverte ; voici comment il la raconte : « M. Andrès avoit chargé
Gargiulli de copier le manuscrit, qui n’étoit presque plus lisible ; mais ni
M. Andrès, ni Gargiulli, n’avoient découvert le trésor que renfermoit le
manuscrit, je veux dire les nouvelles fables. Gargiulli avoit à peine copié les
premières pages, que j’entre par hasard dans la bibliothèque. Je demande à voir
le manuscrit, et Gargiulli me le remet. À peine l’ai-je ouvert, que je tombe sur
la fable de Asino ad Lyram, et sur plusieurs fables inédites.
Je m’écrie aussitôt : “O suavis anima ! Voici Phèdre ! je
tiens Phèdre !” Andrès, d’un ton modeste, témoigne ses doutes. “Non, lui dis-je,
c’est bien Phèdre, je le connois parfaitement.” Pour convaincre ceux qui étoient
présents, je lis quelques fables. Outre MM. Andrès et Gargiulli, il y avoit
Perotti, Justiniani, Jordano, qui pourront me servir de témoins. Je copie
aussitôt toutes les fables inédites, et le lendemain je reviens collationner ma
copie avec le manuscrit171. »
Nous verrons plus loin, par les explications de Jannelli, que Cassitto ne prit pas lui-même copie des fables nouvelles, et que ce fut son frère qui, en venant travailler à la bibliothèque, les copia à la hâte.
Quoi qu’il en soit, Cassitto, à la fin de l’année 1808, publia les
trente-deux fables nouvelles que contenait le manuscrit. C’est une édition in-8º
de 23 pages, sans l’épître et sans l’index. On lit au frontispice : Ivl. Phaedri | Fabvlarvm | liber novvs | e M. S. cod. Perottino |
regiae bibliothecae | nvnc primvm edit | I. A. Cassittvs | {p. 118}Neapoli |cIɔ Ӏɔ ccc viiI. | Excudebat Dominicvs
Sangiacomo. | Praesidum venia.
L’épître porte la date du seizième
jour avant les calendes de décembre 1808.
Cette édition n’a été tirée qu’à 50 exemplaires. Elle est, on le conçoit, fort rare ; j’ai eu le bonheur d’en trouver à Naples un exemplaire chez le libraire Giuseppe Dura, qui possède une immense collection de livres anciens. Elle n’a qu’une valeur de curiosité bibliographique.
Avant cette première apparition des nouvelles fables de Phèdre, l’abbé Andrès, ignorant à quelle besogne se livrait Cassitto, avait engagé un savant récemment attaché à la bibliothèque, Cataldi Jannelli, à publier le manuscrit retrouvé de Perotti.
Entré à la bibliothèque au mois de juin 1808, Jannelli ne savait pas que déjà une copie en avait été prise. Il s’était mis à l’œuvre, et son édition, en vertu d’un décret qu’il avait sollicité et obtenu, était déjà dans les mains des imprimeurs du roi, lorsque parut celle de Cassitto.
En se voyant ainsi devancé, il éprouva le plus vif désappointement ; on en jugera tout à l’heure. Mais il ne se découragea pas, et, stimulé au contraire par cet incident, il voulut, si Cassitto l’avait surpassé en vitesse, l’emporter sur lui à son tour par la supériorité du travail.
Cassitto n’avait publié qu’un extrait du manuscrit ; il entreprit de le faire paraître tout entier. Ce n’est pas tout : pendant que sa copie était sous presse, il rédigea en latin trois longues dissertations, qu’il comptait faire imprimer en tête de son édition.
La première intitulée : Dissertatio I. qua de Perottino codice in universum agitur, deque iis quae in eo edendo sunt praestita, avait pour objet le manuscrit considéré en lui-même. Elle en fait l’histoire et la description, montre le soin que Jannelli a mis à lire le texte et à en combler les lacunes ; elle explique le but que s’est proposé Perotti, et le défend contre l’épithète de plagiaire, dont il avait été, suivant lui, injustement gratifié.
La deuxième dissertation intitulée : Dissertatio II.
de auctore fabellarum novarum Phaedro, avait pour objet de démontrer que
Phèdre était bien l’auteur des trente-deux fables nouvelles. « Elle est,
dit Ginguené, divisée en deux chapitres ; dans le premier, l’auteur prouve, avec
beaucoup de méthode, d’érudition et de clarté, {p. 119}que de
tous les fabulistes qui ont écrit depuis le siècle d’Auguste jusqu’au temps où
vivait Perotti, aucun autre que Phèdre ne peut être l’auteur de ces fables : ce
sont des preuves négatives très fortes. Il prouve de même, dans le second, mais
par des preuves affirmatives et positives, que Phèdre en est bien réellement
l’auteur. »
La troisième dissertation était intitulée : Dissertatio III. qua Petronii Arbitri aetas constituitur, ut alio et gravissimo inde argumento ostendatur Phaedrum revera esse auctorem Fabellarum novarum. Elle avait pour objet de déterminer l’époque à laquelle vécut Pétrone, afin d’en tirer un argument propre à établir que Phèdre était bien l’auteur des fables nouvelles.
Dans un premier chapitre qui a pour titre ces mots : Petronii aetas Claudii et Neronis aevo pluribus argumentis
constituitur
, Jannelli commence par démontrer que Pétrone
florissait sous Claude et sous Néron ; puis il consacre un second chapitre, qui
porte pour titre ces mots : In constitutam Petronii aetatem
obiecta dissolvuntur
, à réfuter les opinions suivant lesquelles
Pétrone aurait vécu à une autre époque.
Voici maintenant quel intérêt offrait, pour l’authenticité des nouvelles fables, la fixation de l’âge de Pétrone. Il avait pris pour sujet de sa satire intitulée Eumolpe, l’histoire de la matrone d’Ephèse. Eumolpe, en la racontant, déclare que c’est un événement dont il se souvient, rem sua memoria factam. Or, dans la quinzième des fables nouvelles, le même événement est présenté, suivant Jannelli, comme remontant à quelques années, per aliquot annos. Donc l’auteur des fables nouvelles est bien, d’après lui, contemporain de Pétrone, et, comme il a démontré que ce dernier appartenait à l’époque de Claude et de Néron, il en conclut que c’est aussi celle qu’il faut leur assigner. Il explique alors que Phèdre, quoiqu’il eût vécu sous Tibère, n’écrivit que pendant les règnes de ses successeurs, et il n’hésite pas à admettre que, composées au temps où il versifiait lui-même ses fables anciennes, elles ne peuvent être sorties que de sa plume.
Il est vrai que, si l’on entend comme la plupart des traducteurs la
phrase Per aliquot annos quædam dilectum virum
amisit
, l’édifice si laborieusement construit par Jannelli
s’écroule. Si l’on a recours à la traduction en prose de M. Bagioli, publiée en
1812, on y trouve : « Une femme perdit son époux, qu’elle avait aimé
pendant {p. 120}plusieurs années172 »
; et si l’on consulte la traduction en vers de
M. de Joly, on y lit :
D’un époux adoré pendant assez longtempsLa dame devint veuve173.
Cette façon de comprendre le texte, qui d’ailleurs me semble la plus exacte, et que dans ma traduction j’ai moi-même adoptée174, ne permet pas de déduire des mots per aliquot annos une indication bien positive. Aussi, quand j’examinerai l’authenticité des fables nouvelles, n’en tirerai-je aucun argument. Mais j’aime à reconnaître que, si Jannelli a mal compris les premiers mots de la fable Mulier vidua et Miles, le contre-sens qu’il a commis lui a fourni l’occasion d’exhiber les richesses de sa magnifique érudition.
Pour que ses trois dissertations parussent en tête du texte de Perotti, Jannelli, quoiqu’il fût imprimé dès 1809, en différa la publication.
Mais l’Imprimerie royale, occupée de travaux plus pressants, ne put se consacrer activement aux siens, et, au mois de février 1811, après une vaine attente, il dut se décider à livrer au public, telle que deux ans auparavant elle avait été imprimée, son édition du fameux manuscrit.
Le temps n’avait pas calmé son dépit, et, pour avoir attendu, Cassitto s’aperçut qu’il n’avait rien perdu. Les trois dissertations furent remplacées par un avertissement en trois pages écrit à la Bibliothèque même, et daté des ides de février 1811. Pour montrer comment Jannelli y fustige son rival, je vais en extraire une partie.
« Notre travail sur le manuscrit de Perotti, dit-il, était entièrement achevé, et non seulement plusieurs savants avaient lu la copie des fables nouvellement découvertes, mais encore les typographes du roi, en vertu d’un décret royal, les avaient reçues et les imprimaient, quand apparaît, lecteur, une brochure de quelques petites pages qui contenaient ces mêmes fables publiées par {p. 121}J.-Ant. Cassitto. Cette apparition m’émut, non pas que je me crusse devancé dans la conquête de je ne sais quelle petite gloire ; mais je songeais au temps bien long que, sur l’écriture évanouie ou décomposée, j’avais employé et perdu à me torturer l’esprit et à me fatiguer les yeux. Je n’aurais jamais mis la main à une si pénible besogne, si j’avais su qu’un autre l’eût exécutée ou s’y fût seulement engagé. Pourtant, après avoir lu et relu la brochure, je ne me repentis plus de l’avoir entreprise et supportée. Le dirai-je même ? je m’en félicitai sans réserve ; à tel point que, si auparavant elle m’avait semblé utile, dorénavant je la considérais non plus seulement comme fort opportune, mais même comme absolument nécessaire. Je m’aperçus que les fables publiées par Cassitto s’écartaient et différaient du genre de Phèdre et du texte du manuscrit de Perotti, de telle sorte que l’honneur de la Bibliothèque royale et mon devoir m’obligeaient à leur opposer les fables elles-mêmes ou du moins les leçons du manuscrit que j’avais transcrites avec l’autorisation spéciale des premiers magistrats.
« Et, à vrai dire, beaucoup de vers facilement lisibles dans le manuscrit manquent entièrement dans l’édition de Cassitto. Puis d’innombrables fragments de vers, des mots, des syllabes, des éléments et des vestiges de lettres, qui très souvent conduisent à des leçons parfaitement certaines, tout cela fait défaut. En troisième lieu, dans les passages visibles et apparents, Cassitto s’est plus d’une fois permis d’introduire ses conjectures substituées à l’aventure. En quatrième lieu, les titres des fables que Perotti avait rédigés en prose dans un style incompatible avec celui de Phèdre, il en a fait des espèces d’ïambes, et pour cela a souvent torturé l’auteur. Enfin, soit par sa faute, soit par celle d’autrui, les signes et les lettres ayant été transposés, souvent ce qui est de Cassitto est indiqué comme étant de Phèdre, et ce qui appartient à Phèdre est départi à Cassitto.
« De tout cela il résulte que des fables, si profondément modifiées, si chargées de compléments, et, comme on dit, d’interpolations aussi opposées à l’esprit qu’au style de Phèdre, devaient tantôt être altérées, et tantôt, par la forme et le fond, se trouver tout à fait travesties. Mais que cela ne surprenne personne. En effet, Cassitto n’a pas copié lui-même les fables sur le manuscrit de Perotti ; il ne l’a ni feuilleté, ni lu. C’est son frère, qui, en allant et {p. 122}venant de temps en temps à la Bibliothèque royale, pour y déchiffrer des manuscrits liturgiques et théologiques, à je ne sais quels moments perdus, très rapidement et comme à la dérobée, m’a-t-on dit, en fit la copie. Il y a plus : Cassitto ne vit le manuscrit qu’une seule fois en tout, et encore sur l’indication du célèbre Andrès. Quant à son éditeur, il ne le vit pas du tout ; c’est lui-même qui me l’a avoué. Ainsi ces fables, dont l’écriture était altérée, effacée, évanouie, furent avec précipitation copiées par un autre. Quant à Cassitto, qui habitait dans le Samnium, se hâtant pour nous devancer, il osa les compléter, corriger, rectifier et publier, et il en confia la publication à un éditeur qui ne connaissait pas même la couverture du manuscrit.
« Quand tout cela eut été chose bien avérée, et que tout le monde eut reporté son attention sur notre édition, la brochure de Cassitto fut presque entièrement oubliée, et, pendant le long espace de temps écoulé, nul n’a, à son sujet, rien recherché, soulevé ni débattu. Aussi m’étais-je proposé de garder sur cet incident un silence absolu, alors surtout que ni Cassitto lui-même dans la suite, ni son éditeur, ni qui que ce fût, hormis moi seul, n’avaient eu, pour le lire et l’étudier, accès auprès du manuscrit : sous serrure et sous clé comme de raison, je l’avais seul constamment gardé. Cependant j’appris que des exemplaires de la brochure avaient été envoyés à Paris et jusqu’au fond de l’Allemagne ; cette circonstance, jointe, ainsi que je l’ai dit, aux retards si prolongés subis par mon édition, m’ont fait penser que, pour te détourner de porter un jugement trop sévère contre moi et contre les hommes et magistrats supérieurs, qui, comme protecteurs et patrons de mon œuvre, ont reçu mes éloges dans mes dissertations, je devais, lecteur, te faire apprécier au préambule de ce livre quelle était l’importance de mon travail. »
Quoique les commentateurs aient en général peu d’égards les uns pour les autres, il faut avouer que Jannelli avait, dans sa préface, usé, pour critiquer l’œuvre de Cassitto, un peu trop largement des libertés de langage qui leur sont habituelles.
Mais cela n’était rien encore, comparé à ce qui suivit.
Dans sa première édition, sauf treize petites poésies épigrammatiques qu’il avait négligées comme illisibles ou immorales, Jannelli avait publié le manuscrit tel qu’il l’avait lu, laissant en blanc {p. 123}les mots ou fragments de mots indéchiffrables et indiquant ses conjectures dans des notes courantes.
Quelques semaines après, il publia une nouvelle édition qui ne contenait que les fables de Phèdre anciennes et nouvelles. Mais elles n’offraient plus de lacunes, et ses conjectures, d’ailleurs souvent modifiées, étaient passées dans le texte.
Soit que le décret qu’il avait obtenu en 1808 ne s’appliquât point à ce travail, soit qu’il fût las des lenteurs de l’Imprimerie royale, il avait confié son nouveau travail à l’imprimeur même auquel, dix-huit mois auparavant, Cassitto avait eu recours.
Le frontispice portait ces mots : Phaedri
fabulae | ex | codice Perottino MS. | regiae bibliothecae Neapolitanae |
emendatae, suppletae, et commentario | instructae | a Cataldo Jannellio |
eiusdem regiae bibliothecae scriptore. | Praefixa est de Phaedri vita |
Dissertatio. | Neapoli 1811. | Typis Dominici Sangiacomo. | Praesidum
veniâ.
Les fables, on le voit, étaient précédées d’une dissertation sur la vie de Phèdre, dissertation savante et consciencieuse, qui sur les 296 pages du volume en occupait 62.
Mais il y avait autre chose, et la dissertation sur la vie de Phèdre ne venait elle-même qu’après une préface en huit pages, écrite encore à la bibliothèque et datée des calendes de mars 1811.
Au moment où il la rédigeait, il était au comble de la colère. Il venait de découvrir une nouvelle brochure de Cassitto ; composée de quatre pages, elle apportait de nombreux changements à ses premières conjectures. Elle avait paru vers les nones de février 1811, c’est-à-dire à peu près en même temps que le Codex Perottinus de Jannelli, et, comme son édition spéciale des fables de Phèdre tirées du manuscrit de Perotti n’avait pas encore été livrée au public, il semblait que Cassitto n’avait pu rien emprunter à ces deux ouvrages. Mais, soit qu’il connût quelque employé de l’imprimerie trop complaisant pour lui, soit qu’étant en relations avec l’imprimeur Sangiacomo, il eût pu faire prendre ou pu prendre lui-même, dans l’atelier de ce dernier, pendant l’impression, des extraits du travail de Jannelli, le fait est qu’il parvint à avoir connaissance, avant leur publication, des leçons que son rival avait proposées ou adoptées.
On comprend sans peine la colère de Jannelli, voyant paraître en même temps que son Codex Perottinus, la brochure de Cassitto qui contenait ses propres conjectures pillées par ce dernier.
{p. 124}Jannelli ne se contraint plus ; il accuse Cassitto de plagiat inepte. Pour lui, Cassitto est moins qu’un plagiaire ordinaire ; c’est un plagiaire qui cherche, par toutes sortes de mauvais artifices, à dissimuler sa fraude, et, pour le démontrer, il cite plusieurs exemples.
« Fable i, vers 5, dit-il, il a édité :
Quam partem quam vis parvam impartiar tibi.comme s’il avait suppléé lui-même le mot parvam et voulu ne pas attribuer à l’auteur latin ce qui ne pouvait avec certitude lui être imputé, tandis qu’en réalité le manuscrit porte :
Quam tibi impartiar parvam quamvis pa…« Fable iii, vers 6, il a donné Cornicis, comme si l’on ne pouvait du manuscrit tirer que C.r..cis ; ce qui est absolument faux ; car on en extrait facilement Corpus. Nous, à la vérité, après de longues recherches, nous sommes arrivé à Cornicis ; mais c’est une correction que, comme de juste, nous avons proposée à titre de conjecture. Cassitto ne pouvait-il pas faire de même ? À quoi bon déguiser maladroitement la leçon du manuscrit ?
« Fable v, vers 3, il écrit :
Ut jura possent veritatem dare,comme si à la leçon apparente du manuscrit il avait, comblant la la lacune, ajouté la lettre n. Mais dans le manuscrit on lit très nettement :
Ut jura posset inter homines reddere,ce qui seul est vraiment naturel, etc.
« Nous n’aurions pas cru que cela pût avoir de l’intérêt ni pour nous, ni pour les lettres, si Cassitto avait du moins averti les lecteurs qu’il ne s’était pas proposé de publier les fables sur la foi de leur texte, mais qu’il avait plutôt entrepris de les corriger, de les polir et de les refaire à sa guise. Alors nous l’aurions laissé se complaire dans son œuvre, et corriger, polir ou refaire ce qui lui aurait convenu. Mais tout le monde ne sait pas que Cassitto n’a jamais lu directement le manuscrit de Perotti, qu’il ne l’a jamais directement copié, et que seul, pendant trois ans, grâce à mon emploi, je l’ai feuilleté, copié, interprété et soigneusement gardé. Il nous importe, {p. 125}à nous et aux lettres, que les leçons de Cassitto, la plupart du temps ineptes et absurdes, ne soient pas confondues avec celles du manuscrit lui-même. »
On voit à quel point, au mois de mars 1811, Jannelli était irrité contre Cassitto.
Le mois suivant parurent enfin les trois dissertations dont j’ai
déjà donné l’analyse. Elles formaient un grand in-8º de 323 pages, en tête duquel
on lisait : In Perottinum codicem MS. | regiae bibliothecae
Neapolitanae, | quo | Duae et triginta Phaedri Fabulae iam notae, totidem |
Novae, sex et triginta Aviani vulgatae, et ipsius | Perotti carmina inedita
continentur, | Cataldi Iannellii | eiusdem regiae bibliothecae scriptoris |
Dissertationes | tres. | Neapoli 1811. | Ex regia
typographia.
Cette édition était précédée d’un avis au lecteur en cinq pages, écrit comme les précédents à la Bibliothèque royale, et daté du lendemain des ides d’avril 1811. Jannelli y continue les mêmes attaques. Il est passé de la colère à l’exaspération. Il avait appris que Cassitto préparait une troisième édition d’une vingtaine de pages de petit format, dans la préface de laquelle son rival commettait les plus audacieux mensonges, et bientôt il avait pu s’assurer de l’exactitude de cette nouvelle par quelques pages imprimées qui lui en avaient été apportées et qui, sous la date des nones de mars, contenaient, selon lui, maintes faussetés aussi impudentes qu’absurdes. Pour que le public soit bien fixé sur les faits, il en entreprend le récit complet. Il raconte que c’est au mois d’avril 1808, que le frère de Cassitto a pris à la bibliothèque quelques extraits du manuscrit, que Cassitto ne l’a pas même lu, qu’avant lui d’Orville et Andrès y avaient remarqué les fables nouvelles, et que, quant à les avoir attribuées à Phèdre, quoiqu’il n’était pas pour cela nécessaire d’être bien instruit, ce n’est pas lui qui en aurait été capable ; car il avait, dans la publication des fables nouvelles, pris pour des vers de Phèdre ce qui n’était que de la prose arrangée par Perotti.
Et pour qu’on ne puisse l’accuser d’avoir été aveuglé par la passion, Jannelli, à la suite de sa préface, place un tableau qui permet de comparer ensemble :
1º Le texte de la première édition de Cassitto publiée en 23 pages à la fin de l’année 1808 ;
{p. 126}2º Le texte de son édition imprimée en 1809 et publiée en 287 pages aux ides de février 1811 ;
3º Le texte de la deuxième édition de Cassitto, publiée en 4 pages aux nones de février 1811.
Désirant, sans tomber dans des longueurs inutiles, faire voir combien malheureusement les accusations de Jannelli étaient fondées, je vais donner seulement les trois versions de 5 vers, appartenant à la fable Mercurius et duæ mulieres et figurant dans le tableau comparatif :
Première édition de Cassitto, fable iv, vers 13 et s. :
Ideo quum forte meretrix ridet validius,Incumbens lecto, sequitur lectus, omniaEt quæ tangebat, magno flentem incommodo.Novitate vero cogens multitudinemBarbarus ille verba ridenda extulit.
Codex Perottinus de Jannelli, fable iv, vers 13 et s. :
Id quum forte meretrix ridet validius,Nares replevit humor, ut fieri solet,Emungere igitur se volens, prendit manu,Traxitque ad terram nasi longitudinem,Et alium ridens, ipsa ridenda extitit.
Deuxième édition de Cassitto, fable iv, vers 13 et s. :
Ideo quum forte meretrix ridet validius,Nares replevit humor, ut fieri solet,Emungere igitur se volens prendit manu,Traxitque ad terram nasi longitudinem,Et alium ridens, ipsa ridenda extitit.
Il est difficile, après cette comparaison, de ne pas reconnaître que la dure épithète de plagiaire adressée à Cassitto n’était pas précisément calomnieuse.
Les attaques qui avaient été dirigées par Jannelli, avant même
qu’elle n’eût été livrée au public, contre la troisième édition de Cassitto,
n’avaient pas empêché ce dernier d’en faire continuer l’impression et de lui
donner même des proportions inattendues. Elle parut au cours de l’année 1811. En
voici le frontispice : Jul. Phaedri Aug. lib. fabvlae ineditae
XXXII, qvas in Codice Perottino bibliothecae regiae Neap. primvs invenit,
descripsit, edidit Joannes-Antonivs {p. 127}Cassittvs,
Elector ex colleg. possessor. in R. vtrivsque Siciliae, reg. soc. Georg. acad.
italicae, atque pontinianae sodalis ordinarivs, editio tertia. Neapoli, 1811,
ex officina monitoris vtr. Siciliae.
Cette troisième édition forme un volume in-8º de 274 pages, qui sont chiffrées par trois séries de numéros et qui se décomposent ainsi :
P. 3 à 5. — Cassittus lectori.
P. 6. — Index.
P. 7 à 29. — Juli Phædri fabvlæ a Cassitto repertæ.
P. 31 à 75. — Parafrasi in vario metro Italiano delle nuove favole di Fedro | trovate da Gio : Ant. Cassitto | da lui stesso eseguita.
P. 3 à 6. — Emendationes novissimae in Phaedrum Cassittianum.
P. 7 à 15. — Vindiciae priores Phaedri Cassittiani.
P. 16 à 40. — Coniecturae de Polybio qui et Phaedrus.
P. 41 à 92. — Chronologia fabvlarvm Phaedri.
P. 1 a 88. — Cassitti parva scholia175.
P. 89 à 107. — Judicia virorum illustrium.
De plus en plus furieux, Jannelli voulut porter à son adversaire le dernier coup : il songea à soumettre le débat à des juges impartiaux et compétents. Fort de son droit, il sentait que c’était le moyen de s’assurer définitivement le triomphe de sa juste cause. Il adressa au conseiller d’État Zurlo, ministre de l’intérieur, une requête tendant à obtenir une enquête académique.
Déférant à sa demande, le ministre la transmit au conseiller d’État Rosini, président de l’Académie royale d’histoire et d’antiquités, avec prière de faire examiner par elle les faits principaux qui concernaient le différend.
Une commission, immédiatement formée, se met à l’œuvre et bientôt fait à l’Académie un rapport dans lequel elle expose :
Que l’encre du manuscrit est verdâtre soit par l’effet du temps, soit par l’effet de l’humidité ; que beaucoup de lettres ont complètement {p. 128}disparu et que de beaucoup d’autres il ne reste que des fragments ;
Qu’il a fallu beaucoup de temps et un travail soutenu pour prendre copie des fables, et que, malgré l’affirmation formulée par Cassitto dans sa Mantissa, page 14, quelques heures étaient absolument insuffisantes ;
Que, dans la première édition de Cassitto, les nouvelles fables sont en désaccord avec le manuscrit non seulement dans les passages obscurs, mais encore dans ceux qu’il était aisé de déchiffrer ;
Que l’édition de Jannelli s’est au contraire trouvée conforme au manuscrit ;
Que, comme par la comparaison on pourra s’en convaincre, les deuxième et troisième éditions de Cassitto s’écartent profondément de la première et se confondent presque entièrement avec l’édition de Jannelli ;
Que, dans les endroits où des différences existent, ce sont les éditions de Cassitto qui sont contraires au texte du manuscrit ;
Que les leçons de Jannelli, que Cassitto rejette comme fausses, sont exactes, et qu’au contraire le manuscrit condamne celles qu’il proclame vraies et sincères ;
Qu’enfin, après examen très attentif du manuscrit et spécialement
des fables nouvelles, les lettres en ont été trouvées intactes dans leur
ancienneté et exemptes de ces altérations et de ces retouches, que, dans ses Scholies, à la page 86, Cassitto, calomniant son rival, lui
imputait en ces termes : « Vitiatis quoque a Jannellio, ut fama est, hac
illac literarum vestigiis in contextu. »
Cette sentence était écrasante pour Cassitto. Il aurait dû suffire à Jannelli de l’avoir obtenue ; mais il voulut encore lui en infliger la publicité.
Il ne faut pas oublier qu’il avait été blessé dans son amour-propre de savant, et l’amour-propre blessé ne pardonne pas.
Il publia donc à Naples, vers le mois d’avril 1812, sous forme de
conversations, un nouveau volume intitulé : Cataldi Jannellii
| regiae Neapolitanae bibliothecae | scriptoris | in Cassittianam novarum
fabularum | editionem | Colloquia176.
Le volume, précédé d’une préface et des documents de l’enquête {p. 129}qui occupent huit pages, se compose en outre de cent vingt pages consacrées à quinze conversations, dans lesquelles Jannelli, mettant en scène trois interlocuteurs, Critobulus, Philaléthès et Memnon, joue avec Cassitto sans plus de pitié que le chat avec la souris.
Il suffit d’en indiquer les titres, pour faire apprécier l’esprit qui y règne ; les voici :
| Colloquium | I. | — Res gesta. | 1 |
| — | II. | — Calumniae. | 8 |
| — | III. | — Mendacia. | 13 |
| — | IV. | — Plagium. | 16 |
| — | V. | — Fides sublesta. | 27 |
| — | VI. | — Supplementa spuria. | 33 |
| — | VII. | — Emendata inepte. | 43 |
| — | VIII. | — Scholiastes. | 57 |
| — | IX. | — Davus non Oedipus. | 66 |
| — | X. | — Gustus illiteratus. | 70 |
| — | XI. | — Funus Polybii Phaedri. | 78 |
| — | XII. | — Clavis stuppea. | 95 |
| — | XIII. | — Canius Rufus ridens. | 105 |
| — | XIV. | — Versio hypobolimaea. | 110 |
| — | XV. | — Graculus Aesopicus. | 118 |
Je pourrais donner l’analyse de chacune de ces conversations ; mais je m’aperçois que je me suis déjà trop occupé de la querelle de Cassitto et de Jannelli, et je ne m’y arrête pas davantage.
Pendant que Cassitto et Jannelli soutenaient ainsi l’un contre l’autre une polémique si acrimonieuse, les savants de la France et de l’Allemagne se livraient à des discussions plus pacifiques.
Le savant Heyne, à qui Cassitto avait envoyé un exemplaire de sa première édition, manifestait des doutes, que les fautes dont elle fourmillait ne rendaient que trop légitimes.
Mais lorsque parurent les travaux de Jannelli et qu’on put juger du texte par une publication exacte, on commença à croire à l’authenticité, et partout, dès l’année 1812, on s’empressa d’en publier de nouvelles éditions. Adry en cite trois, publiées à Paris au cours de cette année177, la première, in-12, les deux autres in-8º. J’ai en ma possession un exemplaire de chacune d’elles.
La première, en 42 pages sans la préface, ne porte que le texte {p. 130}latin des fables nouvelles. Elle a été imprimée chez Crapelet et porte
pour titre : Phaedri | Augusti liberti | Fabellae Novae | duo
et triginta | ex codice Perottino | regiae bibliothecae Neapolitanae, | juxta
editionem Cataldi Iannellii. | Parisiis, | apud Ant. Aug. Renouard. |
M.DCCC.XII.
La préface en cinq pages est signée de Renouard. Les
fables sont suivies des variantes du manuscrit sous ce titre : Perottini codicis scriptura.
La deuxième, en 194 pages sans la préface et la vie de Phèdre en
latin qui en occupent 16, se divise en deux parties : la première, contenant le
texte des fables nouvelles, et la seconde, celui des anciennes. Les unes et les
autres sont accompagnées de notes courantes en latin. Au frontispice on lit :
Julii Phædri | fabulæ novæ et veteres : | novæ, | juxta
collatas Cassitti et Jannellii | editiones Neapoli nuper emissas, | cum
selectis ex utriusque commentario notis ; | veteres, | juxta accuratissimam
editionem bipontinam, | cum selectis doctissimi viri Schwabe ex commentario
notis. | Ex typis Leblanc. | Parisiis, | H. Nicolle, via Sequanæa, no 12 | MDCCCXII.
En tête du volume que je possède, une main inconnue a écrit :
« Édition donnée par les soins de M. Chambry. »
La troisième édition, en 228 pages sans compter la dédicace à M. le
baron de Pommereul et la préface qui en occupent 23, comprend la traduction en
vers italiens des trente-deux fables nouvelles, leur texte latin en regard, la
traduction française en prose ajoutée au bas, et les notes latines de Jannelli
rejetées à la suite de chacune d’elles. Le frontispice est ainsi formulé :
Nouvelles Fables | de Phèdre | traduites en vers italiens
| par M. Petronj | et en prose française | par M. Bagioli | avec les notes
latines de l’édition originale | et précédée[s] d’une préface française | par
M. Ginguené | membre de l’Institut impérial de France. | A Paris | de
l’imprimerie de P. Didot l’aîné. | М.DCССХӀӀ.
Dans la préface datée du 25 mars 1812, Ginguené n’hésite pas à
affirmer que les trente-deux fables nouvelles « sont réellement de Phèdre
et ne peuvent être que de lui »
.
Cette opinion s’était à peine formée qu’Adry vint l’ébranler. En
tête de l’exemplaire, que j’ai entre les mains, de l’édition Petronj, se trouve,
sur la page blanche en regard du titre, une note manuscrite ainsi conçue :
« Voir Examen des nouvelles fables de Phèdre, Paris,
Egron, 1812, in-12. L’auteur, M. Adry, conteste l’authenticité
{p. 131}de ces fables et cette opinion a
prévalu. »
Cette note n’est pas exacte ; mais je ne m’expliquerai
sur ce point que plus tard ; car l’examen que j’en pourrais faire ici ne serait
pas à sa vraie place.
Je continue la nomenclature des éditions publiées en 1812.
En Italie, où sans doute on était fier de la découverte et des
travaux de Jannelli, une édition de luxe, dans le format in-folio, fut
immédiatement publiée. Elle se compose de 80 pages consacrées, savoir : les
pages 1 à 42 au texte latin, les pages 43 à 78 à des notes extraites de celles de
Jannelli et de Cassitto, et les pages 79 à 80, à la table des matières. Le tout
est précédé de douze pages numérotées en chiffres romains, contenant le
frontispice, une dédicace et une préface. Au frontispice on lit : Julii Phaedri | Augusti liberti | Fabulae triginta | nuperrime
detectae | e manuscripto codice | R. bibliothecae Neapolitanae | cum notis. |
Mediolani | Typis F. Fusii et socior. | M.DCCC.XII.
Une édition plus modeste fut en même temps publiée dans le format
in-12 avec ce frontispice : Phædri fabellæ novæ duo et
triginta ex cod. Perottino reg. bibl. Neapol. juxta editionem Cataldi
Jannellii. Patavii, 1812.
En Allemagne, dès le commencement de la même année, il fut, comme
en Italie, publié une édition in-folio, assez mal imprimée d’ailleurs et composée
seulement de douze pages. Sur la première on lit : Q. D. B. V.
| Novi | Prorectoratus | auspicia | die
VIII Februarii cIɔӀɔcccxii | rite capta | civibus
| indicit | Academia Jenensis. | Insunt | Phaedri quae feruntur fabulae XXXII
| in Italia nuper repertae | nunc primum in Germania editae | adjunctis
Dorvillii et Burmanni emendationibus. | Ex officina Caroli
Schlotteri178.
Puis, comme en Italie, fut publiée une édition courante, in-8º, de
46 pages, qui ne contenait que le texte latin et en tête de laquelle on lisait :
Noviter detectæ | Phædri fabulæ | triginta | ex
manuscripto bibliothecæ regiæ Neapolitanæ | codice nuperrime editæ ; | ad
commodiorem lectitantium usum hanc in formam recusæ. | Stuttgartiæ et Tubingæ,
| apud J. G. Cottam, 1812179.
Les années suivantes, de nouvelles éditions continuèrent à être publiées. Mais je m’abstiens d’en donner ici la nomenclature.
§ 2. — Description du manuscrit. §
Pour se faire une idée exacte sur l’authenticité des fables nouvelles, il faut avoir vu les manuscrits qui les renferment. J’avais le sentiment de cette nécessité. Aussi une fois à Rome, encouragé par le premier succès de mes recherches, n’hésitai-je pas à continuer mon voyage jusqu’à Naples où j’arrivai le 22 octobre 1869.
Le lendemain, mon premier soin fut d’aller au palais du Museo Borbonico. La porte de la bibliothèque était ouverte. Un travailleur familier du lieu, M. Padiglione était dans la salle, où il semblait si bien chez lui que je le pris pour un des bibliothécaires.
À Naples, comme à Rome, le temps des vacances n’était pas encore passé, et le public n’était pas admis à travailler. Il m’engagea à demander par lettre au conservateur alors en villégiature l’autorisation spéciale qui m’était nécessaire, se chargea de lui faire parvenir ma requête que je rédigeai à l’instant même, et m’assura que le mardi suivant, si le manuscrit existait, il serait mis à ma disposition.
Le jour indiqué, je me rendis à neuf heures du matin à la bibliothèque ; j’y retrouvai le même travailleur, qui me le confia, et immédiatement j’en entrepris la copie ; mais, comme il ne m’était permis de rester à la bibliothèque que jusqu’à midi, je ne pus terminer mon travail le même jour, et je dus pour l’achever revenir les jours suivants.
C’est donc en parfaite connaissance de ce qu’il est, que je vais donner la description du manuscrit.
Le manuscrit a la dimension d’un in-8º ordinaire. L’écriture est sur papier. Elle est très fine, mais très nette. Quoique l’encre soit devenue d’une couleur vert d’eau très pâle, les caractères, partout où ils n’ont pas cessé d’exister, sont très lisibles ; malheureusement l’humidité, à laquelle le manuscrit a été exposé, en a détruit beaucoup. Elle semble être partie du dos du volume, et s’être développée en rayonnant ensuite, de manière à laisser au milieu de chaque page une empreinte demi-circulaire, sous laquelle l’encre a complètement disparu.
Les titres et la première lettre de chaque vers, écrits à l’encre rouge, ont un peu mieux résisté ; mais dans les endroits même où {p. 133}l’eau ne les a pas touchés, la couleur a tellement pâli qu’on devine plutôt qu’on ne voit qu’elle a été rouge.
L’état dans lequel se trouvait le manuscrit en rendait la copie très longue et très difficile, et, limité par le temps, j’aurais dû renoncer à la prendre, si M. Padiglione lui-même ne m’en eût donné les moyens. Il m’indiqua l’adresse du libraire Giuseppe Dura, chez qui je trouvai un exemplaire de l’édition du manuscrit publiée en 1809 par Jannelli. Il me servit à lire sans effort tous les mots que je ne pouvais instantanément déchiffrer, et je parvins ainsi, dans le court délai que j’avais, à exécuter entièrement ma copie.
Le manuscrit se compose de deux parties bien distinctes reliées ensemble.
La première consiste dans un cahier de quatorze feuillets. Le premier feuillet est rempli par une épître en prose, dont voici le titre :
NICOLAVS PEROTTVS
PONTIFEX SIPONTINVS,
TITO MANNO VELTRIO
VITERBIENSI CONCIVI SVO
SAL. P. D.
Les neuf feuillets qui suivent cette épître sont occupés par un index ou table des matières, qui reproduit dans leur ordre, avec de légères modifications, les titres des diverses pièces de vers contenues dans le manuscrit. Les quatre derniers feuillets du cahier sont restés blancs.
La deuxième partie du manuscrit comprend soixante-quatorze feuillets, savoir : 57 écrits et 17 blancs. Elle commence par un prologue, ou dédicace adressée par Niccolo Perotti à son neveu et surmontée d’un titre, dont voici le texte et la disposition :
NICOLAI PEROTTI EPI-
TOME FABELLARVM
AESOPI AVIENI ET PHE-
DRI AD PYRRHVM PEROT-
ТVМ FRATRIS FILIVM
ADOLESCENTEM SVAVIS-
SIMVM INCIPIT FOELI-
CITER.
{p. 134}Cette dédicace, dont j’ai déjà parlé et dont j’aurai encore à m’occuper, est immédiatement suivie de compositions très diverses, qui sont numérotées de 1 à 157, avec de l’encre bien noire, à une époque relativement récente, quoique antérieure aux travaux de Jannelli.
Celle qui porte le nº 35 et qui est intitulée : De divitiis et paupertate ad Andream Contrarium Venetum
,
comprend deux parties distinctes, un préambule composé par Perotti, qui y formule,
à l’adresse de son ami Contrario180, les compliments les plus hyperboliques, et cette ancienne fable
de Phèdre qui porte généralement pour titre : Muli et
Latrones.
Après le nº 46, il y a dans le manuscrit une fable intitulée :
Pulcher modus judicandi.
C’est l’ancienne
fable de Phèdre, ordinairement désignée par ces mots : Apes et
Fuci, Vespa judice.
Comme elle avait déjà fait l’objet du nº 27, où elle est précédée
de ce titre : Ubi dubia est sententia, astu utendum
esse
, celui qui a inscrit les numéros, apercevant la répétition qui
avait échappé à Perotti lui-même, s’est borné à tirer sur la fable Pulcher modus judicandi un trait très fin, mais très visible ; car il est
de la même encre noire que les numéros eux-mêmes.
Après le numéro 86 vient de même un distique, qui n’est pas
numéroté. Ici Perotti n’avait pas fait de double emploi, et l’erreur ne vient que
de la personne qui a inscrit les chiffres. Ce distique est intitulé : De asparagis et lacte.
Il contient une de ces triviales
facéties, familières à Perotti ; en voici le texte :
Meiere Valla cupit nec quit, cupit Anna cacare ;Ille edat asparagos, lac bibat ista capræ.
Je pourrais traduire ce distique ; mais le lecteur français veut être respecté. Je ferai seulement observer que cette épigramme confirme l’opinion que j’ai émise, lorsque j’ai dit que le recueil de Perotti était l’œuvre de sa jeunesse. Il me paraît indubitable que {p. 135}c’est du philologue Laurent Valla qu’il se moque sans pitié, lorsque, pour remédier à une infirmité cruelle, il lui conseille de manger des asperges. Or Valla mourut à Naples, le 14 août 1457, et à cette époque Perotti avait à peine 27 ans.
Toutes les compositions qui constituent son recueil, sont écrites en vers, sauf une épître en prose qui y porte le nº 67.
En définitive, si aux 157 numéros on ajoute d’une part l’épigramme De asparagis et lacte, et si d’autre part on en retranche l’épître en prose que je viens d’indiquer, on arrive toujours à un nombre total de cent cinquante-sept poésies.
Elles sont ajoutées les unes aux autres sans classement méthodique, et probablement sans autre ordre que l’ordre chronologique. Elles comprennent des fables de Phèdre et des fables d’Avianus, un fragment d’un hymne d’Aurelius Prudentius, et enfin des poésies généralement épigrammatiques composées par Perotti lui-même, le tout, encore une fois, mélangé sans préoccupation ni des sources diverses ni de la nature variée des sujets. Quand on cherche à mettre un peu d’ordre dans ce chaos, on s’aperçoit qu’il y a :
| 1º Trente-deux fables anciennes, ci | 32 |
| 2º Trente-deux fables nouvelles, ci | 32 |
| 3º Trente-six fables d’Avianus, ci | 36 |
| Soit un total de | 100 |
fables qui n’appartiennent pas à Perotti, sur les 157 poésies dont son manuscrit se compose.
Il n’est pas nécessaire de l’examiner longtemps pour se convaincre que c’est un autographe. Les pages blanches, qui se trouvent tant à la suite de l’index qu’à la fin du manuscrit lui-même, en sont la preuve convaincante. S’il était dû à la plume d’un copiste, le premier de ces espaces blancs n’existerait pas. Le copiste n’eût pas manqué de copier, sans intervalle, la seconde partie du manuscrit à la suite de la première. Il est probable aussi que les trente-quatre pages, laissées en blanc à la fin, n’existeraient pas davantage. Il aurait pris les précautions nécessaires pour n’employer à sa copie que le papier indispensable.
Le manuscrit est donc un autographe de Perotti lui-même. Il pourrait cependant m’être fait une objection, au-devant de laquelle je désire aller. Dans son épître à son concitoyen Veltrius, il déclare qu’il avait commencé de bonne heure à écrire le recueil de vers {p. 136}qu’il lui adresse et qui avait été pour lui un amusement de jeune homme, et il explique ainsi que ses compositions ne soient pas toujours en harmonie avec la gravité de ses fonctions archiépiscopales. Lors même que nous ne posséderions pas sa propre déclaration, le double emploi que j’ai signalé suffirait à établir que son recueil fut souvent abandonné et repris par lui, et qu’avant d’en avoir écrit la moitié il avait perdu de vue le commencement. Il n’est donc pas douteux qu’il le composa dans des temps et dans des lieux divers, et l’écriture, si c’est un autographe, devrait nécessairement se ressentir de cette absence d’unité dans l’exécution. Cependant les caractères qui n’offrent aucune variation de forme, et l’encre qui est partout la même, semblent démontrer que le manuscrit a dû être copié d’un seul trait, et que, partant, on aurait tort de le considérer comme un autographe.
Comment expliquer cette contradiction ? La réponse me semble facile. Après avoir ainsi écrit, à des intervalles plus ou moins longs, dans ses rares heures de loisir, sur un premier cahier qui n’existe plus, les diverses poésies qui forment son recueil, il les dédia à son neveu Pirrho Perotti, pour qui il avait une tendresse toute spéciale.
Sans doute il s’y trouvait bien quelques poésies fort légères. Mais, quand il l’avait commencé, il ne pensait pas à son neveu, et plus tard, quand il songea à le lui dédier, l’enfant était devenu un grand garçon, probablement assez initié aux choses de la vie pour qu’il fût inutile d’en rien retrancher. Il dut donc faire de son recueil lentement formé une première copie pour son neveu ; mais ce n’est pas celle que possède la bibliothèque napolitaine ; c’est une seconde copie qu’il avait dû faire pour Veltrius.
Après l’ayoir faite sur l’exemplaire destiné à Pirrho Perotti, il voulut sans doute la faire précéder d’une épître à l’ami qui allait la recevoir. De là vient le premier cahier de quatorze feuillets, qui contient cette épître, et, à la suite, la table des matières.
Seulement il est probable qu’il ne donna ni à Pirrho Perotti, ni à Veltrius les copies qu’il leur destinait, et que c’est là ce qui explique que son neveu n’ait pas, avec ses autres œuvres, publié son recueil de poésies. Il voulait auparavant y faire des additions, pour lesquelles ensuite le temps a dû lui manquer. Voilà pourquoi la copie, qui est devenue le manuscrit de Naples, avait été exécutée {p. 137}par lui sur un cahier assez volumineux pour lui permettre d’y reporter les additions qu’il projetait, et, comme l’index devait grandir dans la même proportion, il avait dû aussi y consacrer un cahier assez fort pour recevoir ultérieurement d’autres titres.
Tel est le manuscrit, ou plutôt, car, malgré le sentiment contraire du cardinal Angelo Maï181, je puis maintenant l’appeler ainsi, l’autographe de Niccolo Perotti.
Après ce coup d’œil général jeté sur le manuscrit, je laisserais ma tâche incomplète, si je n’entrais pas dans l’examen plus spécial des fables de Phèdre qu’il renferme. Je dois donc dire, en terminant, quelques mots sur l’état dans lequel elles se présentent.
Perotti en a supprimé les promythions et les épimythions, et, les mettant en prose, il en a fait des titres qu’il a substitués à ceux des manuscrits. On peut regretter qu’il ait procédé ainsi ; mais on aurait tort de lui en faire un grand reproche.
Ainsi que je l’ai déjà dit, je ne crois pas qu’il ait de prime abord destiné son recueil à l’éducation de son neveu ; les crudités dont il est émaillé ne me permettent pas de le penser. Si, comme il l’affirme, il en réunit, pour lui être utile, les divers éléments :
Quos collegi, ut essent, Pyrrhe, utiles tibi,
il ne l’entreprit à l’origine qu’à titre de passe-temps littéraire. Mais, lorsque nous suivons librement nos goûts, nous n’oublions pas complètement ce qu’a fait de nous la profession que nous avons embrassée. Perotti s’étant livré à l’enseignement, l’habitude professionnelle l’avait dû conduire vers les moralistes, et parmi eux Phèdre avait arrêté ses regards. Aussi était-ce à lui qu’il avait fait ses premiers emprunts. Mais le fabuliste latin n’avait pas non plus complètement satisfait ses vues. Il ne tire pas toujours explicitement de ses fables la conclusion qui en découle ; le plus souvent, il est vrai, il la déduit, mais la rend systématiquement {p. 138}obscure ou banale ; c’est ce que, dans la fable ii du livre IV, il déclare lui-même en ces termes :
Rara mens intelligitQuod interiore condidit cura angulo.
De là vient la substitution que Perotti a opérée. La morale, mise en tête de chaque fable, frappe la vue, et, présentée sous une forme plus explicite, s’impose mieux à la pensée. Il l’avait compris et avait été ainsi conduit à commettre une altération systématique du texte de Phèdre.
Malheureusement ce ne fut pas la seule, et ce n’est pas tout à fait à tort que Burmann l’a accusé d’avoir dénaturé le corps même des fables182. Sa critique ne porte pas très juste, quand, par exemple, il l’accuse d’avoir, dans la fable vi du livre III, substitué le mot tardandum au mot strigandum ; c’est une supposition que les manuscrits ne justifient pas ; car M. Berger de Xivrey, dans sa publication du manuscrit de Pithou, a édité tricandum, et c’est ce mot que Gude et dom Vincent déclarent également avoir lu dans celui de Reims. Mais c’est au contraire avec raison que Burmann lui impute d’avoir dans la fable x du même livre remplacé ce vers :
A divo Augusto tunc petiere judices,
par celui-ci :
Pontificem maximum rogarunt judices.
Jannelli repousse cette critique, et, pour en démontrer l’inanité,
il reproduit d’abord une lettre adressée par Perotti à l’un de ses amis, nommé
Garnerius ; l’archevêque de Siponte y donne à Auguste l’épithète de Divin.
« Primam Veneris imaginem Divus Augustus dicavit in
delubro patris Cæsaris183. »
Ces expressions de Divus
Augustus, puisqu’il les rappelait sans nécessité, ne lui étaient pas aussi
antipathiques qu’on pourrait le croire. Pourquoi {p. 139}donc,
s’il avait trouvé les mêmes mots dans le manuscrit qu’il avait sous les yeux, ne
les aurait-il pas maintenus ?
Jannelli fait encore remarquer que, dans la même lettre, il se montre absolument opposé à toute interpolation des textes anciens.
Enfin, suivant lui, on ne comprendrait pas qu’après avoir, dans ses commentaires, été si religieux observateur des textes de Martial et de Stace, Perotti, à l’égard de Phèdre, eût pu fouler aux pieds ses propres principes.
Je crois que Jannelli s’est laissé aller à le défendre outre mesure. Il est supposable que, dans un livre qu’à l’origine il n’avait pas entrepris pour l’éducation de son neveu, mais où du moins il avait entendu, non pas, en philologue, reproduire dans leur pureté les textes anciens, mais, en simple ecclésiastique, les mettre d’accord avec les idées chrétiennes, Perotti a voulu supprimer ce qui rappelait trop les croyances du paganisme, et qu’il a dû, prêtre et futur pontifex Sipontinus, être tout naturellement conduit à substituer les mots pontificem maximum à la véritable leçon.
En étudiant les variantes que les fables anciennes présentent dans ses manuscrits, on pourra d’ailleurs se convaincre que cette substitution n’est pas un fait isolé, et que sans doute dans l’intention de rajeunir l’original il en a commis beaucoup d’autres.
On remarquera alors que ce qu’il a fait à l’égard des fables anciennes, il a dû le faire à l’égard des nouvelles, et que, si nous devons nous féliciter qu’il nous en ait conservé le texte, nous sommes fondés à regretter qu’il ne nous l’ait pas transmis dans toute sa pureté.
Section V.
Manuscrit Vatican de Perotti. §
Pendant que Cassitto et Jannelli faisaient de pénibles efforts pour déchiffrer les caractères évanouis du manuscrit de Naples, il existait à Rome, dans la bibliothèque du Vatican, un autre manuscrit parfaitement lisible, qui contenait identiquement le même texte, mais dont ils ignoraient l’existence.
Vers 1830, à l’époque où il publiait les anciens classiques d’après les manuscrits du Vatican, le cardinal Angelo Maï le découvrit {p. 140}dans le fonds de Frédéric Veterani d’Urbin, où il portait la cote 368.
Après toutes les explications que j’ai données sur le manuscrit de Naples, on comprendra que je ne dise que quelques mots de ce second manuscrit qui en est la copie exacte.
C’est un petit in-folio, dont les feuillets sont en vélin, et dont l’écriture est d’une grande beauté.
Le frontispice est couvert d’ornements d’or et de couleurs variées, qui représentent des génies, des fleurs, des oiseaux et des animaux plus ou moins sauvages.
Sur la première page sont dessinés sept cercles fort enluminés. Ils
en entourent un huitième plus grand, qui, en lettres d’or et d’azur, porte
l’avertissement suivant : « In hoc pulcherrimo codice continentur nonnulli
poetæ Latini juniores, qui in circumpictis circulis sunt annotati. »
Dans les autres on lit la nomenclature suivante des ouvrages contenus dans le manuscrit :
1º Christophori Landini Xandra.
2º Callimachi epigrammata.
3º Nicolai Perotti epigrammata et fabulae.
4º Antonii Panormitae Hermaphroditus.
5º Bartholomei Contradae ecloga.
6º Francisci Patritii ecloga.
7º Marasii Siculi elegiae.
Le texte de Perotti commence au recto du feuillet 100 et s’étend jusqu’au verso du feuillet 146. L’ordre des diverses poésies est absolument le même que dans le manuscrit de Naples. Le texte commence par la lettre en prose à Titus Mannus Veltrius de Viterbe, que suivent la table des matières et la dédicace poétique à Pirrho Perotti. Ensuite viennent les fables de Phèdre anciennes et nouvelles, celles d’Avianus et les poésies de l’archevêque de Siponte, le tout réuni avec ce remarquable désordre que j’ai déjà signalé.
Le manuscrit Vatican est si bien conforme à celui de Naples, qu’il porte même la note, qui, dans ce dernier, figure en marge d’un ancien oracle de Delphes et que Jannelli a eu soin de publier.
Le cardinal Angelo Maï, lorsqu’il fit cette découverte, n’avait encore publié que les deux premiers volumes de son ouvrage intitulé Classicorum auctorum è Vaticanis codicibus editorum, etc. Dans {p. 141}le tome III, qui fut, comme les autres, imprimé avec les caractères typographiques du Vatican et qui fut publié à Rome en 1831, le célèbre savant inséra l’épître à Veltrius, la dédicace au neveu de Perotti, les 32 fables nouvelles et les mots, qui, extraits du manuscrit Vatican, devaient combler dans les poésies de Perotti les lacunes de celui de Naples.
Il fit précéder ces extraits d’une préface, dans laquelle il donnait quelques indications sur le manuscrit Vatican.
Quant à l’âge de ce manuscrit, si l’on n’avait pour se guider que son écriture, on pourrait dire qu’il est ou de la fin du xve siècle ou du commencement du xvie. Mais on y trouve l’indication approximative de l’époque qu’il faut lui assigner : à la fin du volume, sur le feuillet 188 et dernier, Frédéric Veterani d’Urbin, qui était bibliothécaire, a inscrit la date de 1517 et ajouté, d’une écriture différente du reste et un peu plus récente, une épigramme sur la mort de son maître, qu’il nomme Feretrus. En voici le texte :
Fredericus veteranus urbinas bibliothecarius ad memoriam.
Ne careat lacrymis liber hic post fata Feretri,Hic me subscripsi cumque dolore gravi.Hunc ego iamdudum Fredericus stante FeretroTranscripsi ; gratus vel fuit ille mihi,Quem modo vel semper fas est lugere parentemEt dominum qui me nutriit, atque diuPagina testis erit lacrimis interlita multisHaec tibi qui mesta haec carmina legis,Et si dissimilis conclusit littera librum,Scriptorem ignarum me dolor ipse facit.
Il paraît ressortir des cinq distiques élégiaques qui précèdent, que c’est Veterani d’Urbin, qui, à une époque antérieure, a écrit le volume, et que, si l’écriture de son épigramme est moins bonne, la cause en est imputable au chagrin qui fait couler ses larmes sur la page et qui paralyse ses facultés de calligraphe.
En 1831, au moment où le cardinal A. Mai faisait paraître à Rome le troisième volume de sa collection des classiques du Vatican, le philologue Orelli, à Zurich, publiait une édition de Phèdre, dans laquelle il avait fait figurer, d’après Jannelli, les 32 fables nouvelles. La publication du conservateur de la bibliothèque Vaticane lui révéla le véritable texte et le détermina à {p. 142}ajouter à son ouvrage un supplément, qui parut, également à Zurich, en 1832, et qui lui permit de substituer les vraies leçons aux hypothèses quelquefois fausses de Jannelli.
La découverte du manuscrit du Vatican a fait perdre aux travaux de Jannelli une grande partie de leur intérêt ; mais il n’en a pas moins droit à l’estime des savants ; car elle a démontré, à son grand honneur, l’exactitude de presque toutes ses conjectures.
Chapitre III.
Authenticité des fables de Phèdre. §
J’arrive à la partie la plus aride de ma tâche, à la question de l’authenticité des fables contenues dans les différents manuscrits que j’ai fait connaître.
En écrivant la vie de Phèdre, j’ai imité mes devanciers : j’ai considéré ces manuscrits comme contenant son œuvre, et j’ai puisé, dans le texte incomplet qu’ils nous ont conservé, les renseignements relatifs à sa personne.
L’hypothèse, que j’ai provisoirement admise, était-elle exacte ? Telle est la question qui est débattue depuis la fin du xvie siècle et que je vais discuter à mon tour.
Dans cette discussion une division s’impose : la partie des fables de Phèdre qui a été d’abord publiée par Pierre Pithou et celle qui, deux siècles après, a été publiée par Cassitto et Jannelli, ayant été puisées à des sources différentes, il faut nécessairement faire un examen séparé de la première, c’est-à-dire des fables primitivement découvertes dites Fables anciennes, et de la seconde, c’est-à-dire des fables postérieurement découvertes dites Fables nouvelles.
Section I.
Fables anciennes. §
De tous les ouvrages que l’antiquité nous a légués, il n’en est pas un seul, dont l’authenticité ait, autant que les fables anciennes, donné lieu à des controverses longues et passionnées.
{p. 144}La victoire a fini par rester aux partisans de l’authenticité, de sorte que le débat n’offre plus qu’un intérêt purement historique. Mais il a été si long et si ardent que, même aujourd’hui, dans une étude sur Phèdre, il ne saurait être négligé.
« Je m’en souviens, écrit le Père Vavasseur dans son livre intitulé De ludicra dictione184, le Père Sirmond m’a souvent raconté que, lorsque Pierre Pithou eut édité pour la première fois les cinq livres de Phèdre, et par égard pour leur vieille amitié les lui eût envoyés à Rome à titre de cadeau, les Romains furent d’abord surpris de la tardive publication du volume, et, comme c’est un peuple
emunctæ naris,Natura nunquam verba cui potuit dare,ils furent assez portés à croire récente et supposée une production qui se révélait au bout de tant de siècles et qui était restée si longtemps cachée. Mais personne, après la lecture complète du livre, ne douta plus qu’il n’appartînt à l’époque d’Auguste. »
Il y avait vingt-quatre ans que Pierre Pithou avait publié son précieux manuscrit, et personne, depuis longtemps, ne songeait plus à épiloguer sur l’âge des fables, quand un audacieux critique, Pierre Schryver, plus connu sous le nom de Scriverius, déclara hardiment qu’ils étaient insensés ceux qui les considéraient comme l’œuvre d’un auteur contemporain d’Auguste et de Tibère.
S’étant livré à l’étude critique des œuvres de Martial, il avait dû nécessairement recourir au volumineux commentaire, que, sous le titre de Cornu copiæ, Niccolo Perotti en avait fait avant lui.
Dans l’épigramme 77 du livre Ier, adressée à Valérius Flaccus, on lit ce distique :
Quid possent hederæ Bacchi dare ? Palladis arborInclinat varias pondere nigra comas185.
Arrivé là, Schryver se reporta au commentaire de Perotti, dans lequel il put lire ce qui suit :
{p. 145}« Arbor Palladis. Olea Palladi sacra. Allusit ad fabulam, quam nos ex Avieno in fabellas nostras adolescentes iambico carmine transtulimus :
Olim quas vellent esse in tutela sua,Diui legerunt arbores : quercus Ioui,Et myrtus Veneri placuit, Phæbo (sic) laurus (sic),Pinus Neptuno, populus celsa Herculi.Minerua admirans, quare sterileis sumerent,Interrogauit causam, dixit Iuppiter :Honorem fructu ne videantur (sic) vendere.At me hercules inquit quod quisque voluerit,Oliva nobis propter fructus (sic) est gratior.Тunc sic deorum genitor, atque hominum sator :O nata merito sapiens dicere omnibus,Nisi vtile est quod facimus, stulta est gloria186. »
Cette note de Perotti était doublement inexacte : d’abord ce n’était pas à Avianus, mais à Phèdre qu’il avait emprunté la fable qui précède, et ensuite, en l’empruntant à ce dernier, il n’avait fait que la copier et n’avait pas eu besoin de la traduire en vers ïambiques.
Sans parler des vieux manuscrits de Pithou et de Reims dont le témoignage est irrécusable, je pourrais, par bien des preuves tirées de ceux de Perotti, démontrer la fausseté de sa malencontreuse déclaration. Je n’en veux donner qu’une. Si l’on pouvait attribuer à Perotti la fable xvii du livre III, il faudrait admettre que toutes les autres fables anciennes sont son œuvre. Car leur identité d’origine est évidente. En revanche, si l’on prouve que l’une des fables anciennes n’est pas son œuvre, aucune ne doit lui appartenir. Eh bien, dans le manuscrit de Naples, sous le nº 27 et à la suite du nº 46, la fable Apes et Fuci, Vespa judice, se trouve deux fois répétée. Après l’avoir extraite une première fois du manuscrit qu’il possédait, Perotti a pu oublier sa première copie, et, sans s’en douter, en faire une autre. Mais c’est un double emploi qui ne peut pas échapper à la plume d’un auteur. En effet, j’admets encore qu’un auteur et surtout qu’un traducteur puissent {p. 146}oublier ce qu’ils ont composé. Cela m’est arrivé à moi-même à l’égard d’une fable de Phèdre : ne me rappelant plus que je l’avais déjà traduite, j’en ai fait une seconde traduction ; mais la seconde n’était pas identique à la première. En effet, si l’on a oublié une première composition et que, sans s’en apercevoir, on la recommence, il est impossible que la seconde s’en trouve précisément la copie littérale. Cet argument est bien simple ; mais il me semble si concluant que je n’en ajoute pas d’autre.
Malheureusement Schryver ne pouvait pas connaître le recueil poétique de Perotti. Si cependant il avait pris la peine de réfléchir, il aurait tout de suite aperçu que l’archevêque de Siponte se trompait. Comment Perotti avait-il pu emprunter à Avianus la fable Arbores in tutela deorum ? Avianus n’avait écrit que quarante-deux fables ; on ne peut en douter ; car lui-même il le déclare dans sa dédicace à Théodose187. Or ces quarante-deux fables, au temps de Schryver qui lui-même s’y réfère, étaient parfaitement connues, et parmi elles aucune n’avait pu servir de texte à la traduction que Perotti prétendait avoir faite en vers ïambiques. Donc, avant même que la découverte du manuscrit de Naples n’eût éclairé la question, il était facile, avec un peu d’attention, de s’apercevoir que l’affirmation de Perotti ne pouvait pas être exacte et que dès lors les fables anciennes n’étaient pas son œuvre.
Schryver n’y regarda pas de si près : à la lecture du commentaire erroné, il ne songea pas, comme d’autres qui plus tard versèrent sur la pente opposée, à douter de sa sincérité, ni à lui infliger l’épithète de plagiaire. Il prit à la lettre la déclaration du prélat, et, le considérant comme l’auteur d’une fable qui figurait dans les œuvres de Phèdre, il en conclut qu’il avait dû également composer toutes les autres.
Voici en quels termes tranchants il s’exprimait sous l’influence d’une conviction, dont il faut reconnaître la sincérité :
« Peuvent-ils davantage perdre le jugement et se tourmenter à plaisir, les savants qui pensent que le fabuliste Phèdre, édité par le fameux Pithou et rappelé par un certain Avienus à Théodose dans la préface de ses fables ésopiques, est le même que celui dont {p. 147}parle Martial ? Ils veulent nous faire croire qu’il fut affranchi de César Auguste, que par le style et l’âge il se confond avec Laberius et Publius Mimus ou qu’il s’en rapproche, et même, autant qu’ils le conjecturent, qu’il vécut sous Tibère, et, qui plus est, après la condamnation de Séjan. Plaisanteries. Certes, à moins que je ne m’abuse étrangement, il ne peut nullement être considéré comme digne de cette époque, cet écrivain, à qui d’ailleurs qu’il ait dû les soufflets de la liberté. Je m’abstiens de produire en détail les arguments qui me frappent, qui me forcent à être d’un avis si particulier, et qui me poussent à déclarer sa production si étrangère à ces jeux de Phèdre dont Martial fait mention. Peut-être le montrerai-je pleinement ailleurs, quand j’en aurai le loisir et quand le cœur me dira de m’occuper de ces frivolités. En attendant, réfléchissez à ce qu’autrefois Perotti, archevêque de Siponte, dans ses commentaires sur le premier livre de Martial, déclara au sujet de ce passage, Quid possunt hederæ Bacchi dare, etc. “Allusit, dit-il, ad fabulam quam nos ex Avieno in Fabellas nostras adolescentes Iambico carmine transtulimus :
Olim quas vellent esse in tutela sua.”Et ce qui suit forme un total de douze vers qui finissent ainsi :
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.Ces vers sont absolument les mêmes que ceux de Phèdre, mis au jour d’abord par Pithou et ensuite par Rittershuys, Rigault et autres, et éclairés de leurs notes et de leurs scholies. Ils se trouvent livre II, fable lvi188. »
On le voit, Schryver ne produit qu’un seul argument à l’appui de son opinion : il se base uniquement sur la déclaration de l’archevêque de Siponte qui s’attribue la paternité de la fable xvii du livre III.
Avant de trancher avec tant d’assurance une question si importante, Schryver aurait dû remarquer qu’il traitait implicitement de mystificateurs P. Pithou, qui, en publiant les fables de Phèdre, {p. 148}avait déclaré qu’il les avait tirées d’un manuscrit fort ancien, et Rigault, qui avait ensuite, dans ses éditions, donné les variantes de ce manuscrit et de ceux de Daniel et de Reims. Il est évident que, s’il avait pris la peine de se rendre à l’abbaye de Saint-Remi, il aurait reconnu l’erreur volontaire ou involontaire que Perotti avait commise et qui était devenue la cause de la sienne.
Il déclare, il est vrai, qu’il pourrait fournir bien d’autres arguments ; il promet presque de les faire connaître plus tard ; mais il est permis de supposer que ces arguments, que d’ailleurs il n’a jamais produits et qui n’étaient que secondaires, n’avaient pas plus de valeur que le principal.
Le coup, porté par le grand critique de Harlem, n’en avait pas été moins rude. L’autorité, qui s’attachait à son nom, fit naître des doutes, et, il faut bien le dire, ils furent un peu favorisés par la négligence des premiers éditeurs, qui n’avaient pas pris la peine de donner sur les manuscrits des notions précises.
Quelques philologues, tels que Farnaby en Angleterre et Schrevelius en Hollande, s’inclinèrent donc devant le nouveau dogme qui leur était, pour ainsi dire, imposé sans discussion ; mais presque tous les autres résistèrent à cette pression si cavalièrement exercée sur leur conscience : les ouvrages qu’ils publièrent en font foi.
À défaut des manuscrits, qui auraient pu leur permettre de la repousser victorieusement, mais que, vu la difficulté des voyages alors si grande, ils ne prenaient pas la peine d’examiner, ils durent chercher d’autres documents et finirent par en trouver un qu’ils s’empressèrent d’employer à combattre la thèse de Schryver. C’était une inscription lapidaire, découverte par Étienne Zamoyski, à Wissembourg en Transylvanie, sur la pierre d’un ancien tombeau, publiée par lui à Padoue, en 1593, dans ses Analecta lapidum vetustorum et aliarum in Dacia antiquitatum189 et ensuite rapportée d’après lui par Gruter dans ses Inscriptiones antiquæ190 et par Gude dans ses notes sur Phèdre191. Cette inscription, qui, d’après {p. 149}Jean Troster192, existait encore en 1666, contenait ce vers de la fable xvii du livre III :
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.
Basilius Faber notamment le cite dans son Thesaurus eruditionis scholasticæ193.
Mais, en défendant Phèdre, ils furent obligés de reconnaître. l’inexactitude de la déclaration de Perotti, et même, avant d’avoir mis la main sur l’inscription lapidaire, ils n’hésitèrent pas à l’accuser de plagiat.
Ainsi, dans ses Adversaria publiés à Francfort en 1624, Barth réfutant Schryver professa qu’il ne doutait pas que Perotti n’eût voulu en imposer à ses lecteurs dans la pensée que le manuscrit de Phèdre tombé dans ses mains était unique, et qu’il pouvait, par suite, se vanter impunément d’en avoir composé les fables. Suivant lui, l’absence dans Avianus de toute fable pareille à celle que Perotti prétendait avoir traduite en vers ïambiques, démontrait sa mauvaise foi évidente194.
Heinsius195, Hoogstraten196,
Baillet197, Niceron et beaucoup d’autres
n’hésitèrent pas à partager ce sentiment. Voici notamment comment Niceron
s’exprime : « On accuse Pérot d’avoir copié les autres sans les nommer.
Martinius le lui reproche, après l’avoir convaincu d’avoir dérobé un passage de
Laurent Valla. Il n’est pas étonnant que Pérot en ait usé ainsi, puisqu’il a pillé
Phèdre, dont {p. 150}les fables n’étaient pas encore imprimées et qu’il en
rapporte une comme un ouvrage de sa façon198. »
Burmann lui-même ne sut pas, dans cette circonstance, garder son
sang-froid. Dans la préface de son édition in-4º de 1727, il commence par supposer
que Perotti a eu dans les mains un manuscrit semblable, sinon à celui de Pithou, du
moins à ceux de Romulus et de l’anonyme de Nilant, et qu’il a rétabli en vers
ïambiques le texte dénaturé de Phèdre199. Cette hypothèse, à laquelle, pour avoir procédé de même, il
avait sans doute été conduit, était, comme l’observe Jannelli200, absolument invraisemblable. Mais, au moins,
elle excluait l’idée du plagiat. Burmann aurait dû le comprendre. Pourtant il oublie
presque immédiatement sa première hypothèse, et, reconnaissant sans doute que les
fables extraites de son manuscrit sont bien l’œuvre de Phèdre, il lui reproche ce
qu’il appelle ses larcins. La copie du manuscrit que d’Orville lui
avait adressée était de nature à lui donner de l’incertitude ; mais sa prévention
était trop forte pour ne pas l’emporter, et c’est dans la préface précitée qu’il
l’accuse sans ménagement. « Il est aujourd’hui évident, dit-il, que Perotti a
commencé dès sa jeunesse à copier dans son recueil des fables de différents
genres, qui ensuite parurent sous son nom201. »
Et plus loin, parlant de d’Orville, il ajoute :
« Le bonheur de rechercher et de déterrer cette fraude était réservé à un
jeune homme très remarquable202. »
Je me borne à ces courts extraits. Ce qui
en ressort, c’est que Burmann croit trouver dans le manuscrit découvert par
d’Orville la preuve manifeste du plagiat.
C’est surtout la dédicace à Pirrho Perotti, qui lui paraît la fournir. La déclaration, par laquelle elle commence, annonce bien {p. 151}une certaine bonne foi ; mais il ne s’en inquiète pas. Il ne se préoccupe que des vers, qui, dans la dédicace, ont été empruntés aux prologues des livres III et ӀV des fables de Phèdre et qui, suivant lui, montrent clairement que Perotti a commis une fraude volontaire.
Si, en effet, l’on se reporte au texte de Phèdre, on trouve ces vers dans le prologue du livre III :
Honori et meritis dedicans illum tuis :Quem si leges lætabor ; sin autem minus,Habebunt certe quo se oblectent posteri.Nunc fabularum cur sit inventum genusBrevi docebo. Servitus obnoxia,Quia quæ volebat non audebat dicere,Affectus proprios in fabellas transtulit,Calumniamque fictis elusit jocis.
Dans cette poésie intitulée Poeta, que tous les éditeurs ont transposée et dont, avec une égale impéritie, ils ont fait, les uns, le prologue du quatrième livre, les autres, le prologue du cinquième, on lit les vers suivants :
Hunc obtrectare si volet malignitas,Imitari dum non possit, obtrectet licet.Mihi parta laus est, quod tu, quod similes tui,Vestras in chartas verba transfertis mea,Dignumque longa judicatis memoria.
Enfin, si l’on examine la petite poésie, qui suit immédiatement, qui, dans le manuscrit de Pithou, est intitulée Idem Poeta, et qui peut être considérée comme servant de préambule à la fable Demetrius rex et Menander poeta, on y lit in fine ces deux phrases :
Fabulæ exaudiantAdeo fucatæ. Plus vetustis nam favetInvidia mordax quam bonis præsentibus.
Qu’on rapproche de la dédicace de Perotti les trois citations qui précèdent, et l’on s’apercevra que l’archevêque de Siponte ne s’est donné que la peine de copier. Et si l’on songe que c’est vers la fin de sa vie qu’il a rédigé sa dédicace, on verra qu’alors il possédait encore le manuscrit de Phèdre, dans lequel il avait, jeune homme, {p. 152}puisé la fable Arbores in tulela deorum, et qui devait lui rappeler que cette fable n’était pas son œuvre.
J’ai, on le voit, reproduit, sans en dissimuler les bases, l’accusation dirigée contre lui. Doit-on l’accueillir, et, en se fondant tant sur la fausse déclaration contenue dans son Cornu copiæ que sur les emprunts faits à autrui dans son recueil poétique, faut-il dire qu’il n’a pas été un simple copiste et le flétrir de l’épithète de plagiaire ?
Il y a un abîme entre ces deux substantifs. Ils ont une portée très différente qui se comprend et sur laquelle je n’ai pas besoin d’insister, et je me hâte d’examiner ce qu’a été Niccolo Perotti.
Il est certain que dans son Cornu copiæ les apparences sont contre lui. Il a fait une déclaration dont la fausseté saute aux yeux, et l’on ne comprend pas au premier abord comment il a pu dire qu’il avait dans sa jeunesse tiré d’Avianus et traduit en vers ïambiques une fable qu’en réalité il avait empruntée à Phèdre. S’il n’a pas été plagiaire, il faut avouer qu’il a singulièrement manqué de mémoire.
Je n’en suis pas moins porté à croire à un oubli. La découverte de
son manuscrit a jeté sur la question un jour lumineux. « Comme je l’ai écrit
ailleurs au sujet de mes lettres, disait-il dans son épître à Mannus Veltrius de
Viterbe, parmi mes petites poésies il y en a quelques-unes, qui autrefois ont été
pour moi un amusement de jeunesse, et que mon âge et ma profession, si on les
supposait récemment écrites, pourraient à bon droit peut-être faire juger
répréhensibles. Au contraire, reportées à leur date, elles n’auraient plus rien
que tu pusses incriminer. Car il y a longtemps qu’on laisse cette liberté de se
distraire non seulement aux jeunes gens, mais aussi aux poètes plus sérieux. Mais
on pourrait peut-être encore me la contester à cause de ma dignité épiscopale.
Veille donc à ce que les lecteurs distinguent bien ce qui, lorsque je n’étais
encore pourvu d’aucune dignité, a échappé à ma jeunesse, de ce qui appartient à
mon âge actuel203. »
C’est donc, suivant sa {p. 153}propre déclaration, dans sa jeunesse qu’il avait commencé son recueil, et, ainsi
que je l’ai expliqué, c’est à des intervalles relativement courts qu’il y avait fait
des additions successives. J’ajoute que probablement il n’a jamais adressé son
recueil à Mannus Veltrius, que son épître, d’ailleurs non datée, avait sans doute
été écrite par anticipation, que les additions contemporaines de cette épître
auxquelles il fait allusion n’existaient qu’à l’état de projet, que, si
quelques-unes dataient des derniers temps de sa vie, elles étaient certainement fort
peu nombreuses, et qu’en conséquence on peut considérer son recueil tout entier
comme une œuvre de jeunesse.
Cela dit, je rappelle qu’on y voit deux fois reproduite la fable des Abeilles et des Bourdons jugés par la Guêpe. Perotti avait évidemment, avant de la recopier, oublié sa première copie, et cependant c’était vraisemblablement peu de temps auparavant qu’il l’avait faite.
Si maintenant on remarque que son commentaire sur Martial fut une œuvre de son âge mûr, on pourra admettre que la mémoire lui ait encore fait défaut, que, de même qu’il avait oublié la première copie par lui faite d’une autre fable et l’avait une seconde fois transcrite, de même, alors qu’il s’était écoulé un bien plus long intervalle, il avait pu commettre un oubli analogue à l’égard de la fable Arbores in tutela deorum et ne pas se rappeler qu’il en était, non le traducteur, mais le copiste, et l’on comprendra que, retrouvant cette fable après bien des années dans un recueil, où à des poésies simplement transcrites par lui se mêlaient aussi ses propres compositions, il ait pu à la légère, mais de bonne foi, formuler une affirmation fausse, que probablement, s’il avait pu publier lui-même son ouvrage, il aurait aperçue et rectifiée. Malheureusement son commentaire sur Martial ne fut pour la première fois imprimé qu’en 1489204, neuf ans après sa mort, par les soins pieux d’un neveu {p. 154}dévoué à sa mémoire, mais sans doute incapable de corriger les fautes d’un manuscrit posthume.
S’il avait voulu donner le change au public, il aurait pris les précautions habiles que tout homme de mauvaise foi emploie, et il n’aurait pas, en déclarant avoir emprunté à Avianus le sujet de la malencontreuse fable, rendu sa fraude immédiatement évidente. Il est, à mon sens, très probable que, dans sa fausse affirmation, sa seule faute a été de s’en rapporter à des souvenirs confus qu’il n’a pas pris immédiatement la peine d’éclaircir.
Maintenant je ne dois pas perdre de vue que ce n’est pas seulement sa fausse déclaration, et que c’est encore sa dédicace à Pirrho Perotti, qui sert de point d’appui à l’accusation dirigée contre lui. Il est vrai que, dans cette dédicace par lui composée à l’époque à laquelle il travaillait à son Cornu copiæ, c’est-à-dire vers les dernières années de sa vie, il a encore complètement pillé Phèdre. Mais c’est justement cette dédicace qui semble affirmer son innocence. La première chose, en effet, qu’il y déclare, c’est qu’il n’est que copiste. En voici le commencement :
Non sunt hi mei, quos putas versiculi,Sed Æsopi sunt et Avieni et Phædri :Quos collegi, ut essent, Pyrrhe, utiles tibi,Tuaque causa legeret posteritas,Quas edidissent viri docti, fabulas.Honori et meritis dicavi illos tuis,Sæpe versiculos interponens meos,Quasdam tuis quasi insidias auribus.
Après de pareilles explications, il me semble qu’il faut être bien prévenu contre un homme qui a été un savant philologue, pour lui maintenir l’épithète dont sa mémoire a été flétrie.
Comment ! il expose à Pirrho Perotti que les vers qu’il va lire ne sont pas son œuvre, qu’il les a tirés d’Ésope, ce qui n’était qu’indirectement vrai, mais aussi de Phèdre et d’Avianus, ce qui était rigoureusement exact, qu’il les a ensuite réunis pour être utiles à son neveu et pour transmettre, à cause de lui, à la postérité les fables que ces hommes éminents avaient composées, qu’il les lui a dédiées à raison de ses bonnes qualités, et qu’enfin, pour tendre à son entendement des pièges instructifs, il y a intercalé souvent ses propres compositions ! Tout cela est nettement dit, et {p. 155}Perotti serait un plagiaire ! Non, je ne puis me résoudre à le croire.
Et quant aux vers, qui complètent la dédicace et qu’il a empruntés à Phèdre, est-ce qu’il ne faut pas y voir l’emploi immédiat de ces pièges instructifs, par lesquels il a déclaré vouloir mettre à l’épreuve la sagacité de son neveu ?
Cela ne me paraît pas douteux, et, lorsque je considère en outre que Perotti avait, à l’origine, formé son recueil sans but arrêté, et que ce ne fut qu’après l’avoir composé qu’il songea à en faire un livre d’éducation, je me sens de plus en plus convaincu de sa sincérité.
Si maintenant je voulais aller plus loin, et si, en dehors de la
dédicace, je cherchais d’autres indices dans le texte du manuscrit, je n’aurais que
l’embarras du choix. Un tel travail serait aussi fastidieux qu’inutile ; je ne
l’entreprendrai pas. Seulement, puisque j’ai parlé d’une ancienne fable de Phèdre
que Perotti a copiée deux fois, j’y chercherai un nouveau témoignage de sa bonne
foi. Or savez-vous comment, dans l’index du manuscrit, cette seconde copie est
intitulée ? Elle porte ce titre moral : De Judicio ferendo in
rebus dubiis pulcherrima fabella.
Pourquoi donne-t-il à cette fable
la qualification de pulcherrima ? Évidemment parce qu’il n’entend
pas se l’attribuer. S’il avait voulu faire prendre le change, il aurait affecté une
modestie apparente, qui lui aurait fait omettre un mot si ambitieux. Il n’y a que
l’œuvre d’autrui qui puisse s’apprécier ainsi.
En voilà assez, je crois. S’il existe encore des sceptiques, je les engage à lire attentivement la première des trois dissertations publiées en 1811 par Jannelli205. Il est probable qu’après il ne leur restera aucune incertitude.
Mais que Perotti ait été copiste ou qu’il ait été plagiaire, ce qui est certain, c’est qu’il n’a pas été l’auteur des fables de Phèdre. Si Schryver avait pu voir le manuscrit de Naples, il en aurait été assurément convaincu. Quant à Burmann, lorsqu’il semble regretter que Perotti n’ait pas été plus servilement copiste, je partage ce sentiment206. Mais il ne devait pas, sous l’influence de ce regret, qualifier {p. 156}de plagiaire un des hommes les plus lettrés de son temps.
La conclusion de tout cela, c’est que l’opinion de ceux qui attribuaient à Perotti les fables de Phèdre et le sentiment de ceux qui le traitaient de plagiaire, étaient entachés d’une égale fausseté. Les uns et les autres auraient pu reconnaître aisément leur erreur. Mais l’homme mêle ses passions à toute chose, et il ne faut pas trop s’étonner de les retrouver jusque dans la philologie ; car elle repose sur la discussion, et toute discussion les surexcite.
Il est assez probable que, si les incrédules n’avaient pas eu d’autre point d’appui que la fausse déclaration faite par Perotti dans son Cornu copiæ, la lutte aurait cessé. Malheureusement ils avaient pour eux un document qui, en l’absence de toute production des manuscrits, leur donnait une arme puissante, et qui leur permettait de continuer à attribuer les fables à l’archevêque de Siponte ou tout au moins de prétendre qu’elles ne remontaient pas au siècle d’Auguste et que par suite elles ne pouvaient avoir été écrites par l’affranchi de cet empereur.
Le chapitre xxvii des Consolations, que
Sénèque a adressées à Polybe, commence par cette phrase : « Non audeo te
usque eo producere, ut fabellas quoque et Æsopeos logos, intentatum
romanis ingeniis орus, solita tibi venustate connectas. »
Pierre Pithou était trop versé dans l’étude des auteurs anciens, pour
que l’affirmation de Sénèque pût lui échapper. Elle n’avait pas troublé sa
conviction. Pressentant néanmoins l’argument qui pourrait en être tiré contre
l’ancienneté des fables de Phèdre, il avait pris les devants, et, pour prévenir les
attaques, il s’était empressé de formuler, dans son épître à son frère François, sa
réponse à l’argument qu’il prévoyait. « Phèdre lui-même, lui écrivait-il207, a fait connaître qu’il était né en Thrace, dans la
partie de ce pays voisine de la Grèce ; ses livres ne donnent donc aucun démenti
au témoignage de Sénèque qui affirmait que les apologues ésopiques étaient un
genre de littérature inexploré par l’esprit romain. »
Cette explication,
que je pourrais appeler géographique, avait paru aux {p. 157}savants et notamment à Lipse208,
parfaitement satisfaisante, et, jusqu’au jour où Schryver formula sa protestation,
personne n’avait songé à exprimer le moindre doute.
Mais, aussitôt qu’elle leur fut connue, fascinés probablement par son audace, quelques-uns s’empressèrent de relever le passage oublié et crurent y trouver la justification de sa thèse. Si les fables de Phèdre avaient été composées sous les règnes de Tibère et de Claude, Sénèque, suivant eux, n’aurait pas écrit que les fables ésopiques étaient un genre de littérature dans lequel les Romains n’avaient pas encore essayé leur intelligence.
Ceux, plus nombreux, à qui une étude plus approfondie des fables de Phèdre, avait donné une foi inébranlable dans leur ancienneté, cherchèrent la réponse, et ce fut à qui trouverait la bonne.
Ils essayèrent tour à tour d’expliquer la phrase de Sénèque :
G.-J. Vossius, dans son ouvrage intitulé De poetis latinis et
publié en 1654 après sa mort209, en adoptant, comme Lipse,
l’interprétation de Pierre Pithou, et en soutenant qu’uniquement préoccupé des
écrivains latins il n’avait pu classer parmi eux un affranchi d’origine
macédonienne ; le Père Vavasseur, dans son livre De ludicra
dictione publié en 1658210, en supposant que les fables
de Phèdre qui flétrissaient les tyrans de son époque, avaient dû être à {p. 158}ce titre signalées par les délateurs, supprimées et enfin oubliées
à l’époque de Sénèque ; Bayle, dans son Dictionnaire historique et
critique publié en 1697211, en affirmant que « Sénèque avait oublié qu’il
y eût un livre au monde qui s’appelât les fables de Phèdre »
; Fabricius,
dans sa Bibliotheca Latina publiée à Hambourg en 1697212, en prétendant qu’il n’avait songé
qu’aux apologues en prose ; Cannegieter, dans sa Dissertatio de ætate
et stilo Aviani, publiée à Amsterdam en 1731213,
en considérant les Consolations à Polybe, écrites au commencement
du règne de Claude, comme antérieures aux fables qui n’auraient été composées que de
la septième à la onzième année du même règne ; Gellert, dans sa Dissertatio de poësi Apologorum eorumque scriptoribus, publiée à Leipzig en
1744214, en alléguant qu’il avait considéré Phèdre
non comme un fabuliste latin, mais comme un interprète des fables grecques du vieil
Ésope ; d’autres enfin, en s’appuyant sur d’autres raisons encore.
La querelle dura ainsi de longues années ; mais le temps apaise tout ; elle commençait à se calmer, lorsqu’en 1746, un professeur de Leipzig, qui fut un des plus grands érudits de son temps, J. Christ reprit l’audacieuse opinion de Schryver. Dans une thèse où la science et l’imagination débordent et qui forme un volume in-4º215, {p. 159}il réunit les nombreuses raisons, qui, suivant lui, ne permettaient pas d’attribuer à un auteur ancien les fables de Phèdre.
Comme l’examen de ses arguments n’a plus aujourd’hui d’intérêt scientifique, je m’abstiendrai d’en donner l’analyse complète et je me bornerai à indiquer les principaux.
Le premier, sur lequel il s’appuie, c’est le silence qu’ont gardé à l’égard des fables de Phèdre tous les écrivains de l’antiquité romaine. Nul philosophe, nul critique, nul historien ne les ont mentionnées. Il y a même quelque chose de plus probant que leur silence, c’est le langage de Sénèque, qui fut, on le sait, l’esprit le plus lettré de son époque, et qui n’aurait pas ignoré, si obscur qu’il pût être, l’existence d’un fabuliste contemporain.
Il est vrai que Christ est un peu gêné par les témoignages de Martial et d’Avianus. Mais, avec une remarquable dextérité, il les interprète en faveur de sa thèse.
Dans l’épigramme xx de son troisième livre, Martial, demandant à sa muse ce que fait son cher Canius Rufus, s’exprime ainsi :
Dic, Musa, quid agat Canius meus Rufus ?Utrumne chartis tradit ille victurisLegenda temporum acta Claudianorum ?An quæ Neroni falsus adstruit scriptor ?An æmulatur improbi jocos Phædri ?
Dans ce dernier vers, il fait, selon Christ, allusion au philosophe épicurien qui eut l’admiration d’Atticus et l’estime de Cicéron. Canius était sans doute aussi un philosophe de la même école ; il a dû se livrer au même genre d’études et rivaliser de science et de talent avec son devancier.
Du reste, les mots improbi et jocos montrent encore que Martial ne peut avoir eu en vue un fabuliste. L’épithète improbus ne peut convenir qu’à l’homme qui se livre à un travail persévérant et l’auteur des fables n’a écrit que des choses vulgaires dans un style obscur et barbare comme lui. Quant au mot jocos, il ne peut se rapporter à l’œuvre d’un fabuliste, qui peut, sous une forme agréable, critiquer les vices de la société, mais qui en général n’excite pas le rire. Au contraire, Phèdre le philosophe, dans sa lutte contre la doctrine stoïcienne, avait dû nécessairement recourir à l’arme toujours puissante de la raillerie.
{p. 160}Dans son étude sur Stace, Jean-Frédéric Gronovius avait, plus d’un siècle auparavant, démontré que le Phèdre cité par Martial ne pouvait être que le fabuliste romain, et sa démonstration simple et limpide était absolument concluante.
« Martial, avait-il écrit216, a appelé Phèdre improbus, c’est-à-dire légèrement audacieux, soit parce que, comme il le déclare au début de son œuvre, il avait mis en scène et fait parler les arbres et les bêtes, soit parce que, sous cette fiction, il avait révélé les mœurs des puissants de son temps. En effet, lorsque Martial parle des jeux de Phèdre, qui est-ce qui n’aperçoit pas clairement qu’il fait allusion à ce vers :
Fictis jocari nos meminerit fabulis ? »
Il y avait, en effet, entre les expressions de Phèdre et celles de Martial une conformité, qui ne pouvait laisser d’incertitude sur le véritable personnage que ce dernier avait eu en vue, et le savant Christ, pour qui l’observation de Gronovius n’avait pu passer inaperçue, aurait bien dû en faire son profit. Mais il n’y a pas, on le sait, de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Le témoignage plus précis et par suite plus embarrassant d’Avianus
n’arrête pas davantage le docteur allemand. Dans l’épître dédicatoire qu’en tête de
ses fables il adresse à Théodose, Avianus s’exprime ainsi : « Hujus ergo
materiæ ducem nobis Æsopum noveris, qui responso Delphici Apollinis monitus
ridicula orsus est, ut legenda firmaret. Verum has pro exemplo fabulas et Socrates
divinis operibus indidit, et poemati suo Flaccus aptavit ; quod in se, sub jocorum
communium specie, vitæ argumenta contineant ; quas Græcis ïambis Gabrias repetens,
in duo volumina coarctavit, Phædrus etiam partem aliquam quinque in
libellos resolvit217. »
En présence de ce texte, voici comment il se tire d’affaire. D’abord il lui semble évident qu’Avianus en parlant de Phædrus fait allusion à un auteur grec ; la forme de ce nom est grecque ; la {p. 161}forme latine serait Phæder. Il lui paraît même assez probable que ce Phèdre n’était autre que le très remarquable ami de Cicéron.
D’ailleurs, ce qu’Avianus dit de son œuvre ne permet pas de la confondre avec les fables connues ; car il ne prit qu’une portion, aliquam partem, des fables d’Ésope, qu’il développa, resolvit, de manière à en former cinq livres, tandis que les fables connues sont très nombreuses et pour la plupart on ne peut plus concises.
Faut-il ajouter qu’Avianus, si ses modèles avaient été des auteurs latins, n’aurait pas dit qu’il avait écrit ses fables rudi latinitate218 ? Le Phèdre dont il parle était un fabuliste grec, qui probablement n’était autre que le philosophe.
Enfin est-il possible d’admettre qu’Avianus ait songé aux fables latines que nous connaissons, quand on voit qu’il en a composé quarante-deux réunies en un seul livre, et qu’aucune des siennes n’a le moindre rapport avec celles de Phèdre ?
Après avoir développé ces raisons, Christ ne s’en contente pas. Il sent bien que l’ancienneté des manuscrits, si elle est établie, peut renverser son échafaudage. Alors, sans les avoir jamais vus, il en conteste l’âge et prétend que leur titre et leur texte sont sortis de l’imagination de Perotti. Il avoue pourtant que tout ce que Perotti a écrit n’est pas original, qu’il transporta dans ses compositions des ïambes antiques épars dans divers manuscrits et que c’est ainsi qu’il employa les lambeaux qui s’en rencontraient dans les œuvres de Romulus.
Puis, comme il comprend que le manuscrit de Romulus, conservé à Dijon, devient contre lui une arme qu’il faut briser, voici comment il essaye de l’anéantir. Il est, dit-il, incontestable que les fables contenues dans le manuscrit de Dijon ne sont que la traduction en prose de fables originairement écrites en vers ïambiques, et que cette traduction, ayant été en partie reproduite par Vincent de Beauvais, ne saurait être moins ancienne que le xiiie siècle. Mais c’est à tort que le manuscrit de Dijon porte le nom de Romulus. Ce Romulus, surtout s’il était Athénien, n’a pas pu écrire un latin si barbare. Il est l’auteur de fables, qui ont été composées par lui en vers, qui ont ensuite été grossièrement mises en prose, et qui, sauf quelques fragments conservés dans {p. 162}la traduction en prose et mis en œuvre par Perotti, ont été enfin entièrement et irrévocablement perdues. De là vient que les fables de Romulus semblent être la traduction en prose de celles qu’on attribue à Phèdre. Mais en définitive c’est Perotti qui est l’auteur des fables qu’il lui a plu d’attribuer à un affranchi d’Auguste.
Enfin, pour faire accepter cette idée, il cherche par de nombreux exemples à démontrer que les fables, que nous possédons, fourmillent d’expressions ou d’idées qui ne permettent pas de les confondre avec la latinité si pure du siècle d’Auguste.
Phèdre, on le voit, avait été vivement attaqué. Il ne manqua pas de défenseurs, et leur réponse ne se fit pas attendre. Elle fut faite dès l’année suivante par un autre savant allemand, Funck (de Marbourg), connu aussi sous le nom de Funccius. Il publia, en 1747, sous le titre Apologia pro Phædro eiusque fabulis, une dissertation, qui, comme celle de Christ, est devenue aujourd’hui très rare219.
Mais Christ était un jouteur avec lequel il n’était pas facile
d’avoir le dernier mot. La même année, il adressa à Funck une volumineuse réplique,
intitulée : De Moribus, simul de Phædro eiusque fabulis uberior
expositio220.
Funck garda le silence ; mais son duel avec Christ avait eu trop de retentissement, pour ne pas allumer entre les savants une guerre générale : ranimée en Allemagne, la discussion fut reprise dans toute l’Europe lettrée.
En Hollande, d’Orville, dans son commentaire sur le Chariton d’Aphrodise publié en 1750221, combattit l’opinion de Christ.
En France, un jeune auteur que la mort ravit prématurément aux lettres, Boulanger de Rivery, entra à son tour dans la lice. Voici comment il s’exprime dans la préface de sa traduction en {p. 163}vers, publiée en 1754, des fables et contes allemands de Gellert222 :
« Phedre a fait un choix heureux dans les apologues d’Ésope et leur a donné une grâce nouvelle par sa précision élégante que l’on a comparée avec raison à celle de Térence. Mais un des plus sçavans hommes de l’Europe, M. Christ, dans un ouvrage qui est un jeu pour lui, et qui seroit pour tout autre un travail immense, a entrepris, il y a quelques années, de révoquer en doute l’authenticité du Phedre recouvré par notre M. Pithou aussi connu dans la Littérature que dans la Jurisprudence. Comme la sagacité de M. Christ et la haute estime que l’on a pour son érudition sont très-propres à donner du poids à son sentiment, il ne sera pas inutile d’examiner ici les raisons sur lesquelles il le fonde. Séneque a dit : Æsopios logos intentatum romanis ingeniis opus. Mais ou Séneque a ignoré que Phedre ait fait des fables, ce qui est très possible, ou bien il a entendu par-là que personne parmi les Latins n’en avoit fait de nouvelles dans le genre d’Ésope, ce qui est très-vrai, Phedre lui-même avoit prévu que ses contemporains lui reprocheroient de n’être point véritablement Auteur.
Quidquid putabit esse dignum memoriaÆsopi dicet.« Le silence de Séneque ne prouve rien contre Phedre dont Martial et Avien font mention. Avien en a fait, dit M. Christ, un Fabuliste Grec. Il est vrai qu’il le cite après Gabrias ou Babrias. De même on pourroit dire qu’il fait d’Horace un Poëte Grec, parce qu’il le cite dans le même endroit après Socrate.
« On trouve dans la Corne d’Abondance de l’Archevêque de Siponte, imprimée en 1496, la Fable des Arbres protégés par les Dieux, à peu près telle qu’elle est dans le Phedre qui n’a paru qu’en 1596. Mais on a trouvé un des Vers de cette même Fable sur un monument très-antique dont parle Zamosius. Et cependant Pérotti prétend qu’elle est un des amusements de sa jeunesse. À Dieu ne plaise que je veuille accuser de mauvaise foi cet Archevêque : il se peut très-bien qu’il ait mis alors cette Fable parmi ses Ouvrages, et que l’y ayant retrouvée dans un âge avancé il ait cru {p. 164}réellement l’avoir faite. Ce qui est d’autant plus vraisemblable qu’il dit avoir tiré ce sujet d’Avien qui ne l’a jamais traité. Ajoutez a cela que Pérotti connoissoit Phedre et qu’il en parle dans cette même Corne d’Abondance. Faudra-t-il sur un seul passage d’un Auteur du xve Siécle supprimer à la fois les deux Fabulistes Latins qui nous sont restés ?
« Mais pourquoi vouloir ôter à Phedre cinq Livres entiers par ce qu’on y auroit inséré une seule Fable qui ne seroit pas de lui ? Faudroit-il les attribuer toutes à Pérotti qui en auroit fait une ? Un Manuscrit donne celle-ci à Phedre, un autre la donne à Pérotti. Pour décider il faut la lire dans les deux Ouvrages et reconnoître son auteur en comparant les stiles. Une présomption très-forte encore contre l’Archevêque de Siponte, c’est que plusieurs Vers de cette Fable courte et correcte ont été totalement altérés par ce respectable Commentateur de Martial, Phœbo laurus pour Phœbo laurea. Ne videantur, etc.
« M. Christ relève dans Phedre quelques expressions qui lui paroissent peu latines, et qu’il prétend n’avoir pas été employées dans le même sens par les meilleurs Auteurs du Siécle d’Auguste. De-là il conclut que le Phedre est un Ouvrage supposé. Mais comme il y a dans chaque Auteur bien des tours et même des expressions qui lui sont propres, on pourroit par cette méthode prouver également que Ciceron n’est pas de Ciceron.
« Et cette entreprise ne seroit pas entierement nouvelle. Un Ecrivain du dernier Siécle a déjà voulu prouver que Ciceron ne sçavoit pas le Latin.
« Lorsqu’on annonça en Europe la première édition de Phedre, cette découverte d’un Manuscrit qui avoit été perdu si longtemps, parut d’abord suspecte à tous les Sçavans. Mais après avoir lû l’Edition que venoit de donner M. Pithou, il ne resta aucun doute dans les esprits. Le petit nombre d’expressions que trouve à y reprendre aujourd’hui un des plus ingénieux Critiques, est une nouvelle preuve de toute la pureté de Phedre…
« Il y a dans Phedre plusieurs traits qui dénotent clairement un Siécle poli. Qui pourroit concevoir que dans les Siécles barbares on eût peint si agréablement l’indifférence philosophique de Ménandre et ce luxe voluptueux dont on n’avoit point d’idée ? Ce que Phedre nous a dit des mœurs et du génie de Ménandre doit, {p. 165}ce me semble, nous faire regretter encore plus les Comédies de ce Poëte Grec. »
Les premières réponses, adressées à la thèse de Christ, n’empêchèrent pas qu’elle ne fût adoptée par quelques critiques. Dès l’année 1749, dans son Thesaurus linguæ latinæ, Gesner n’avait pas hésité à attribuer au philosophe épicurien, contemporain de Cicéron, le vers si discuté de Martial223. En 1772, un jésuite italien, nommé Étienne Marcheselli, alla plus loin : en s’appuyant sur des arguments que Schwabe appelle ineptes, il prétendit que les fables de Phèdre étaient l’œuvre, non d’un écrivain ancien, mais de l’archevêque de Siponte224. Quant au Phèdre cité par Martial, Ziegler, en 1788, adoptant l’opinion professée au siècle précédent par Farnaby et Schrevelius, déclarait, dans son Commentaire sur les mimes des Romains, que c’était quelque comédien plaisant225.
La lutte continua donc ; mais les partisans du fabuliste restèrent
les plus nombreux. Diderot, sans se mettre en frais d’imagination, déclara que le
passage de Sénèque était une pièce controuvée. « Aucun critique, dit-il, n’a
tiré cette conséquence qui se présentait naturellement. »
Le Père Brotier, dans son édition des fables de Phèdre publiée à Paris en 1783, adoptant une des explications déjà fournies par quelques-uns de ses devanciers, prétendit que Sénèque avait considéré Phèdre, non comme un Romain, mais comme un Thrace, {p. 166}que c’était bien de l’affranchi d’Auguste que Martial avait parlé et qu’il était seulement regrettable que ce flatteur de Domitien l’eût qualifié de méchant homme226.
Le judicieux Père Desbillons dans son édition des fables de Phèdre,
publiée à Mannheim en 1786, se fit à son tour le défenseur du fabuliste.
« Vers l’année 31 de l’ère chrétienne, dit-il, alors qu’il n’était pas
encore, malgré la mort de Séjan, sorti de ses misères, il écrivait à l’un de ses
protecteurs, à la fin de son livre IV, qu’il était loin d’être affaibli par la
vieillesse. On en peut conclure qu’il arriva facilement à la troisième année du
règne de Claude, année pendant laquelle Sénèque écrivit ses Consolations à Polybe. Car, de la mort de Séjan à cette date, il ne
s’était pas écoulé plus de douze ans. Dans l’intervalle, se voyant affranchi de
tout péril, à quoi pouvait-il aspirer avant tout et de préférence à tout, si ce
n’était à passer sa vieillesse dans les douceurs du repos ? Après avoir été
assailli par tant de chagrins, et s’être par ses fables attiré une si grande
infortune, pouvait-il songer à les publier ? Tout ce que nous venons de rappeler
démontre assez qu’il fut d’un autre sentiment. Aussi ne faut-il pas déjà tant
s’étonner que Sénèque n’ait pas connu les fables de Phèdre ou qu’il ait parlé
comme s’il ne les avait pas connues… Et il n’est pas nécessaire de recourir à la
pauvre raison donnée par Vossius et par les autres critiques… Car Phèdre lui-même,
dans l’épilogue de son deuxième livre, établit bien qu’il est un écrivain
romain227. »
Vint ensuite le savant Eschenburg, qui, dans son Manuel
de littérature classique228, s’exprimait ainsi
sur Phèdre : « Nonobstant le peu de connaissance que nous avons de lui et le
silence de tous les anciens écrivains à son égard, on ne saurait pourtant point
douter qu’il n’ait existé, comme l’a fait M. Christ qui prétendait que ses fables
étaient une production moderne de Perottus au xve siècle. »
Au commencement de ce siècle, Jacobs, professeur au gymnase de Gotha,
partageait le même sentiment et le motivait dans une {p. 167}dissertation savante, intitulée Lateinische Fabulisten, dans
laquelle il s’exprimait ainsi sur les fables de Phèdre : « Celui qui connaît
cette œuvre sait qu’elle contient plus que de simples fables, c’est-à-dire une
foule de passages concernant l’auteur et ses affaires personnelles, qu’il y parle
de ses adversaires et de ses amis, qu’il y raconte même plusieurs histoires du
temps d’Auguste et de Tibère, comme si elles s’étaient passées sous ses yeux. Ce
n’est pas un ouvrage, comme il y en a beaucoup, qu’on peut, faute de repères
historiques, placer à n’importe quelle époque ; ce n’est pas une trouvaille
incertaine qu’on reporte à l’antiquité par simple prédilection pour ce temps229. »
Et plus loin il ajoute : « Ainsi, à en
juger sur les simples inductions de la plus vulgaire vraisemblance, les doutes
élevés contre l’authenticité de Phèdre ne tiennent pas230. »
Je devrais peut-être m’arrêter davantage à la dissertation de l’éminent critique. Mais, pressé de parvenir au but, je passe immédiatement à son compatriote Schwabe, et, à raison de l’autorité spéciale qui s’attache à son nom, je m’empresse de jeter un coup d’œil rapide sur les arguments par lesquels, dans son édition des fables de Phèdre, publiée en 1806, il a revendiqué pour le fabuliste romain un bien si longtemps contesté. Comme en définitive il n’a guère fait autre chose que résumer ceux qui avaient été successivement invoqués par les précédents critiques, cet aperçu aura l’avantage de les faire connaître en quelques pages231.
Le silence des auteurs latins, relativement à Phèdre, n’a, suivant Schwabe, rien qui doive étonner. Il est constant que beaucoup d’autres écrivains de l’antiquité ont eu le même sort, et, comme exemple, il cite Quinte-Curce, auteur dont aucune personne compétente ne conteste l’authenticité, et dont cependant aucun ouvrage ancien ne fait mention.
Il est vrai que Sénèque ne se borne pas à garder le silence et qu’il affirme que les Romains ne se sont jamais essayés dans l’apologue. Mais il n’est pas besoin de supposer qu’il n’a voulu parler {p. 168}que des auteurs nés à Rome pour trouver dans son langage une explication satisfaisante.
Il suffit d’adopter l’opinion fort rationnelle de Gellert, qui pense que, si Sénèque oublie Phèdre, c’est qu’il le considère non pas comme un fabuliste original, mais comme un simple traducteur des fables d’Ésope. Ce qui porte Schwabe à se rallier à cet avis, c’est que Sénèque a dû écrire ses Consolations à Polybe vers la troisième année du règne de Claude, pendant son exil dans l’île de Corse. Or, à cette époque, il ne pouvait connaître que les deux premiers livres, les seuls qui, suivant lui, fussent alors composés et publiés232, et, comme les fables qu’ils renfermaient étaient pour la plupart empruntées à Ésope, il s’ensuit qu’il a pu considérer l’apologue comme un genre de littérature étranger aux Romains.
La phrase de Sénèque ainsi expliquée, les témoignages de Martial et d’Avianus reprennent toute leur force. Contrairement à l’opinion de Christ, partagée par Gesner et Marcheselli, Schwabe ne peut admettre que Martial ait, en parlant de Phèdre, nommé le philosophe épicurien. L’ensemble de l’épigramme ne permet pas d’être d’un autre avis. Martial suppose bien que Canius peut s’occuper d’études critiques sur Claude et sur Néron ; mais il faut reconnaître qu’il n’y a pas loin de là aux allusions satiriques que, dans ses fables, Phèdre fait à Tibère et à Séjan. Quant aux mots improbi jocos Phædri, si l’on en recherche le sens, on acquiert la conviction qu’ils ne sauraient convenir au philosophe.
Pour les lui appliquer, Christ est obligé de faire de l’adjectif improbi le qualificatif du substantif jocos, et alors il suppose que Martial veut parler de ces dissertations à la fois savantes et railleuses, par lesquelles le disciple d’Épicure avait essayé de réfuter les théories des autres écoles philosophiques. Mais il faut laisser le texte tel qu’il est, et, tel qu’il est, il ne se rapporte pas à Phèdre le philosophe. Au contraire, le mot improbi appliqué au fabuliste, qu’il soit pris en bonne ou en mauvaise part, devient parfaitement rationnel. Il y a dans Phèdre des fables obscènes, qui peuvent le {p. 169}faire appeler improbus dans la mauvaise acception du mot ; il y a aussi des pensées fines, qui peuvent lui mériter la même épithète employée dans son meilleur sens.
Quant au mot jocos, il faut avouer qu’il n’est
guère propre à désigner des dissertations philosophiques même moqueuses, et que les
fables, si, en dirigeant l’homme, elles ont un but sérieux, sont en elles-mêmes un
moyen plaisant de le conduire. La fable doit amuser : risum
movet
, dit Phèdre lui-même dans le prologue de son livre Ier. Partant de là, lui-même appelle ses écrits jocos et pour lui le mot jocari est presque
sacramentel.
Les raisons, données par Christ pour écarter le témoignage d’Avianus,
semblent à Schwabe encore plus détestables. Christ ne le rejette qu’en donnant une
fausse interprétation à ces mots : « Phædrus etiam partem
aliquam quinque in libellos resolvit. »
Suivant lui, le mot resolvere, qu’il torture à plaisir, signifie étendre, augmenter,
écrire en termes plus prolixes, tandis qu’en réalité il n’implique que l’idée de
traduction, et Schwabe, cherchant dans Sénèque lui-même l’interprétation du mot en
litige, extrait de sa trentième consolation à Polybe le passage suivant :
« Agedum illa, quæ multo ingenii tui labore celebrata sunt, in manus sume
utriuslibet auctoris carmina : quæ tu ita resolvisti, ut quamvis
structura illorum recesserit, permaneat tamen gratia. Sic enim illa ex alia lingua
in aliam transtulisti, ut quod difficillimum erat, omnes virtutes in alienam te
orationem secutæ sint. »
Resolvere, c’est donc traduire ; ce n’est pas autre chose. Il ne
faut donc pas dire que la concision des fables connues soit un obstacle à ce que ce
mot s’applique à leur auteur.
Il n’y a pas lieu davantage de prendre garde à l’argument basé par
Christ sur ce qu’Avianus prétendrait avoir tiré ses fables de Phèdre233. Cet argument est
encore appuyé sur une fausse interprétation de son texte, dans lequel on lit bien :
« De his ergo usque ad quadraginta et duas in unum redactas fabulas
dedi »
, mais qui fait allusion aux fables d’Ésope et non à celles de
Phèdre. Il suffit de lire les lignes qui précèdent pour voir qu’il déclare prendre
Ésope pour guide, et que, s’il parle ensuite de Socrate, d’Horace, de Gabrias et de
Phèdre, c’est pour indiquer {p. 170}qu’en agissant ainsi, il suivra leur
exemple. Il est même supposable que c’est avec intention qu’Avianus n’a rien
emprunté à Phèdre, ne voulant sans doute pas mettre en vers élégiaques ce que ce
dernier avait déjà traduit en ïambes.
Comment Christ n’a-t-il pas vu cela ? Comment, après avoir appliqué l’apostrophe de Martial à un Phèdre, qui ne s’occupait que de philosophie, a-t-il pu attribuer au même philosophe les cinq livres de fables dont parle Avianus ? Ne devait-il pas trouver au moins bien singulière cette division identique en cinq livres, adoptée par le philosophe et par l’auteur des fables connues ? Pour n’y pas voir plus clair, il fallait qu’il eût préalablement pris le parti de fermer les yeux.
À ces textes de Martial et d’Avianus, Schwabe ajoute le monument épigraphique, dont Basile Favre et Boulanger de Rivery avaient déjà fait usage, et qui consistait dans cette inscription gravée à Wissembourg en Transylvanie sur la pierre d’un ancien tombeau.
Mais il s’appuie surtout sur l’âge des manuscrits. Sans doute aucun des savants qui les avaient vus et qui en avaient attesté l’ancienneté, n’en avait donné la description ; mais leur parole devait suffire. Ne pas y croire, ce n’était pas seulement avoir à leur égard une méfiance injurieuse, c’était aussi accuser de mauvaise foi l’archevêque de Siponte lui-même, qui, auteur véritable des fables, aurait, en les attribuant dans son Epitome à un écrivain antique, joué volontairement le rôle de mystificateur.
Les fables de Romulus, qui contiennent des lambeaux de vers ïambiques, et qui, reproduites partiellement par Vincent de Beauvais, ne peuvent être plus récentes que le xiiie siècle, montrent combien cette accusation serait injuste ; car le modèle a dû précéder la copie et Perotti n’a vécu qu’au xve siècle.
Il est vrai que Christ suppose que ce qu’on appelle les manuscrits de Romulus contient non pas l’œuvre de Romulus, mais la traduction en prose de fables qu’il avait auparavant traduites en vers latins, ce qui explique qu’on y trouve des fragments d’ïambes. Mais cette supposition est une pure fantaisie que rien ne justifie.
Enfin, dit-il, procédant encore comme Boulanger de Rivery, qu’on examine les fables en elles-mêmes ; on y trouvera quelques taches, que l’altération du texte primitif expliquera facilement ; {p. 171}mais la pure latinité du siècle d’Auguste s’y révèle partout. Elles respirent en outre une connaissance des temps et des lieux, qu’un ancien seul pouvait avoir. Qu’on lise, par exemple, la fable v du livre II : la belle peinture des ardélions, cet esclave court vêtu de l’atrium, cette description de la villa impériale de Misène, tout ce qu’on y trouve enfin n’a pu sortir que de la plume d’un auteur contemporain de Tibère.
Telle est en résumé la réponse de Schwabe. Elle réfutait assez
victorieusement tous les arguments des adversaires de Phèdre, pour ne plus laisser
de doutes ni sur l’ancienneté des fables, ni sur la personnalité de leur auteur.
Cependant il considérait avec raison que la question ne serait pas définitivement
tranchée, tant que des preuves matérielles n’auraient pas été produites. Il avait
bien déjà à cet effet publié un fac-simile de l’écriture du
manuscrit de Reims ; mais il l’avait copié sur le mauvais spécimen qui figure dans
le Spectacle de la nature234, et nous savons que l’abbé Pluche lui-même l’avait reproduit,
non d’après l’original, mais d’après une copie, qui lui en avait été envoyée par dom
Le Vacher, bibliothécaire à l’abbaye de Saint-Rémi. Il aurait donc voulu retrouver
au moins un des deux manuscrits connus qui restaient encore. Il raconte lui-même
quelles démarches il fit faire dans ce but par un savant antiquaire français,
Ch. Millin, qui, si le manuscrit de P. Pithou se retrouvait dans la bibliothèque de
l’ancien président du Parlement de Paris, devait en faire une étude spéciale
destinée à être publiée avec un fac-simile de l’écriture.
Malheureusement il fut avisé par Ch. Millin « que le manuscrit était perdu,
et qu’il avait échappé à toutes les recherches »
.
À défaut de ce manuscrit, il était possible de voir celui de Daniel qui était alors à Paris à la Bibliothèque impériale ; mais, ignorant sans doute cette circonstance, il n’y eut pas recours.
N’espérant plus se procurer les éléments de preuve que les manuscrits lui auraient fournis, il passa outre et rédigea la dissertation dont j’ai donné l’analyse.
Publiée à Brunswick, en 1806, dans sa seconde édition des fables de
Phèdre, elle atténua les doutes, mais ne les dissipa pas entièrement. Les savants
allemands surtout semblèrent systématiquement {p. 172}décidés à
ne pas ajouter foi à l’ancienneté d’une œuvre, qui peut-être avait un peu à leurs
yeux le tort d’avoir été découverte par un Français. Ainsi, en 1807, Frédéric
Hülsemann n’hésitait pas à dire, en parlant des fables : « C’est à peine si
nous en lisons une sous sa forme primitive ; toutes en effet ont été refondues par
Perotti235. »
Néanmoins la dispute aurait peut-être cessé. Mais la découverte du manuscrit de Perotti, qui eut lieu en 1808, donna à la discussion une vivacité nouvelle plus tard attestée par le savant Daunou236.
« À l’égard de Phèdre, écrivait Eichstædt en 1812, j’ai toujours pensé qu’il fallait plutôt s’en tenir aux arguments victorieux et aux ingénieux raisonnements de Christ qu’aux pauvretés de ses adversaires237. »
« En 1813, dit M. Fleutelot238, Docen, reprenant la thèse de Scriverius et de Christius, fit remarquer que plusieurs vers de Phèdre étaient imités de Martial, et, comme Perotti avait commenté Martial, il n’était pas étonnant, disait Docen, qu’on trouvât dans les poésies de l’archevêque de nombreuses réminiscences de son auteur favori.
Phèdre. — Aper fulmineis ad eum venit dentibus.Martial. — Fulmineo spumantis apri sum dente perempta.
Phèdre. — Particulo, chartis nomen victurum meis.Martial. — Si victura meis mandantur nomina chartis.« On doit savoir gré à Docen d’avoir indiqué ces rapprochements ; car ils prouvent que Martial s’était involontairement attribué quelques expressions de l’improbus Phædrus. Du reste, Docen, avec son bon sens et son impartialité, ajoutait que la question serait une fois tranchée, si l’on savait au juste à quoi s’en tenir sur les trois manuscrits de Phèdre, celui de Pithou, {p. 173}celui de Reims, celui de Daniel ; si des juges compétents pouvaient prononcer en dernier ressort sur l’âge et la nature de ces manuscrits. Il regrettait que ces pièces importantes du procès fussent perdues. »
Elles furent enfin retrouvées. L’édition que Schwabe avait publiée en 1806, fut rééditée par le professeur Gail, en 1826, dans la Collection des classiques latins de Lemaire, avec des notes de Barbier, dont l’une239 indiquait que le manuscrit de Pithou existait dans la bibliothèque de M. Le Peletier de Rosanbo, fils de l’ancien président du parlement de Paris, et bientôt après l’Allemand Gœttling écrivit qu’il avait feuilleté au Vatican le manuscrit de Daniel.
Schwabe, ayant, par les notes de Barbier, appris qu’on savait enfin où était celui de Pithou, ne voulut pas que les preuves matérielles qu’il devait fournir demeurassent plus longtemps dérobées aux regards.
Octogénaire, il était trop vieux pour pouvoir donner lui-même satisfaction à son désir : il sollicita vivement M. Hase de publier le manuscrit. Celui-ci, trop affairé pour se charger de cette tâche, la confia à M. Berger de Xivrey. J’ai assez parlé de son édition diplomatique pour n’avoir pas besoin de redire ce qu’elle renferme : par sa préface, dans laquelle il a donné sur le manuscrit, sur son état, sur sa forme et sur son âge les détails les plus précis, par le texte qu’il en a fidèlement reproduit avec toutes les fautes du copiste, par le fac-similé de l’écriture qu’il a ajouté à la fin de son travail, il a enfin fourni aux sceptiques ces preuves matérielles, que Schwabe, malgré toute sa persévérance, n’avait pu leur procurer. Le savant Daunou, dans l’article qu’il a consacré à cette édition et qui a paru dans le Journal des savants au mois de décembre 1830, lui a rendu sur tous ces points l’hommage à la fois le plus honorable et le plus mérité.
Après M. Berger de Xivrey, M. E. Panckoucke, malgré toutes les erreurs que j’ai signalées dans son édition, a eu le mérite d’y joindre un second document, destiné aussi à parler aux yeux des sceptiques : il a publié le fac-similé de l’écriture du manuscrit de Reims, que dom Vincent avait exécuté sur papier transparent pour {p. 174}M. de Foncemagne. Ce fac-similé, attaché par un fil à la première page d’un exemplaire du Phèdre de Rigault imprimé par Robert Estienne240, est aujourd’hui entre mes mains, et je puis affirmer qu’il a été exactement reproduit dans l’édition Panckoucke.
Lorsque parut la publication de M. Berger de Xivrey, le vieux Schwabe existait encore ; il eut, avant sa mort, la consolation d’assister au triomphe de la cause à laquelle il avait consacré sa vie.
Personne ne songea plus à élever de doutes sur l’ancienneté des fables de Phèdre, et les philologues ne mentionnèrent plus la discussion que pour faire ressortir davantage la puissance des arguments victorieux.
Il s’en rencontra un pourtant, qui essaya de faire revivre la question définitivement résolue : je veux parler de M. Édélestand du Méril, qui a été un philologue très instruit, mais aussi très porté par une imagination trop vive à inventer d’aventureuses hypothèses. Quoique sa dissertation sur Phèdre n’ait pas réussi à émouvoir le monde savant, je vais la faire connaître.
C’est dans son Histoire de la fable ésopique241 qu’il a, en la motivant, indiqué son opinion. Il admet en partie ce que les discussions antérieures avaient démontré : Schryver et Christ, il le reconnaît, se sont trompés en prétendant que Phèdre n’avait pas existé, que les fables, attribuées à cet auteur, suivant eux, imaginaire, n’étaient pas une œuvre ancienne, et qu’elles étaient dues à la plume presque moderne de Perotti.
Voici d’abord comment il apprécie le fameux passage de Sénèque :
« Le silence des anciens sur Quinte-Curce, Velleius Paterculus, les Astronomiques de Manilius et les Nuits attiques, n’autorise point non plus, dit-il, à supposer sans témoignage d’aucune sorte l’existence de fabulistes tombés dans le même oubli : il ne s’agit pas ici seulement d’une réticence peu significative en elle-même ; c’est une assertion formelle, complètement désintéressée, et par le temps où il écrivait et la ville qu’il habitait, par son opulence et l’éclat de sa fortune littéraire, l’écrivain de qui nous la tenons devait {p. 175}être mieux renseigné qu’aucun autre. L’auteur dont les fables nous sont parvenues n’était pas d’ailleurs un de ces écrivains obscurs dont le nom et les œuvres pouvaient se dérober aux recherches d’un simple amateur, plus vieux que lui seulement de quelques années : la vanité elle-même a ses bornes, et il disait dans un de ses prologues si remplis de détails historiques :
Mihi parta laus est, quod tu, quod similes tui,Vestras in chartas verba transfertis meaDignumque longa judicatis memoria.Ce n’est pas là une de ces vagues assertions si familières aux poètes, et plusieurs passages moins vaniteux ne permettent pas de douter que, du vivant même de l’auteur, la plupart de ses apologues n’eussent au moins acquis une certaine notoriété242. »
Ainsi, d’une part M. du Méril n’admet pas que Sénèque ait pu se tromper, et d’autre part il lui paraît constant qu’il existait alors un fabuliste nommé Phèdre. Comment explique-t-il cette contradiction apparente ? Très simplement : oui, Phèdre a existé ; oui, il a été l’affranchi d’Auguste ; oui, il a été le contemporain de Sénèque ; oui, Sénèque a connu ses fables. Mais il n’en a pas parlé, parce que Phèdre, Macédonien d’origine, les a écrites dans la langue de son pays.
Le genre même qu’il avait adopté montre que c’est à la littérature grecque qu’il avait demandé ses inspirations ; car la fable était, suivant l’aveu même de Sénèque, un genre inconnu aux Romains, et cela s’explique aisément : elle a été, à leur enfance, la première littérature des peuples, comme elle est aujourd’hui, à son enfance, la première littérature de l’homme. Elle a précédé l’art de l’écriture, et c’est d’abord par la tradition qu’elle s’est conservée. Née dans l’Inde, elle.se trouve dans les plus anciens monuments de la langue sanscrite. Elle a passé ensuite chez les peuples sémitiques ; les contes arabes, qu’on peut considérer comme des apologues, portent la trace de leur origine indienne. Elle pénétra également dans la Grèce héroïque : Ésope, qui sans doute ne savait pas écrire, ne fit qu’appliquer aux circonstances de la vie usuelle les apologues que la tradition lui avait fait connaître ; {p. 176}il se bornait en général à un simple récit, sans en déduire la conclusion qui ressortait du fait lui-même. Il ne dut sa popularité qu’à l’habileté, avec laquelle il savait se servir du fonds commun. Ce ne fut que longtemps après sa mort que ses fables s’écrivirent et que, pour leur donner une application plus étendue, on y ajouta une conclusion morale, qui les transformait en véritables maximes. C’est ainsi que la fable devint un des éléments de la littérature grecque.
Mais Rome, quoi qu’ait pu chanter Virgile, ne remontait pas aux temps héroïques, et la fable était un élément trop primitif pour convenir à la civilisation du peuple romain. Dans les premiers âges de son histoire elle avait été quelquefois employée : Ménénius avait raconté au peuple irrité contre le Sénat l’apologue des membres et de l’estomac ; Ennius et les poètes comiques avaient fait quelques allusions rapides aux fables ésopiques ; on en trouve quelques-unes dans Horace ; enfin, à la tribune aux harangues et au barreau, les orateurs s’en étaient servis quelquefois pour donner un corps à leur pensée. Mais elles avaient toujours été un moyen dédaigné, auquel les Romains n’avaient recouru que dans de très rares circonstances.
Ne rencontrant dans la littérature latine aucun devancier qui pût le guider, Phèdre ne se borna pas à emprunter à la Grèce le genre, dans lequel il voulait s’exercer : Grec lui-même, il dut être naturellement porté à en adopter la langue et la prosodie.
Si cela est vrai, comment alors ses fables grecques nous sont-elles parvenues sous la forme d’ïambes latins ? Telle est la question que M. du Méril se pose et qu’il s’empresse de résoudre.
Il paraît qu’à Rome, dans les écoles publiques, les maîtres
recouraient à des procédés d’éducation encore aujourd’hui appliqués. Ils
collectionnaient les versions les mieux réussies de leurs élèves. C’était à la fois
une satisfaction pour le professeur et un encouragement pour les enfants qu’il était
chargé d’instruire. Ces procédés avaient été recommandés par Quintilien dans les
termes suivants : « Igitur Æsopi fabellas, quæ fabulis nutricularum proxime
succedunt, narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente, deinde eamdem
gracilitatem stylo exigere condiscant : versus primo solvere, mox mutatis verbis
interpretari ; tum paraphrasi audacius vertere, qua et breviare quædam et
exornare, {p. 177}salvo modo poetæ sensu, permittitur. Quod
opus, etiam consummatis professoribus difficile, qui commode tractaverit cuicumque
discendo sufficiet243. »
Sénèque, dans sa trentième
consolation à Polybe, lui avait à peu près donné les mêmes conseils. Les fables de
Phèdre, par leur dimension restreinte, se prêtaient admirablement à l’exercice ainsi
recommandé. Phèdre les avait écrites en vers ïambiques peu usités dans la prosodie
latine. Les écoliers, en les traduisant en vers, conservaient dans leur traduction
le rythme de l’original, et la meilleure traduction était portée ensuite sur le
cahier d’honneur.
De là vint cette collection de fables latines qu’on attribue à Phèdre, et qui ne sont que la traduction de son œuvre grecque.
Est-ce là une hypothèse fantaisiste ? Non ; la forme grecque
conservée au nom de Phèdre, telle qu’elle se trouvait sans doute en tête de ses
fables ; ces lacunes qu’offrent les manuscrits et qui, aucun feuillet ne manquant,
ne peuvent provenir que des traductions jugées indignes du cahier d’honneur ; ce
vers Phædri libellos legere si desideras
, qui
révèle une main étrangère à l’auteur lui-même ; cet emprunt fait au Télèphe
d’Ennius :
Palam mutire plebeio est piaculum,
emprunt contraire aux habitudes de tout auteur qui se respecte ; cette imitation du style de Térence qui avait vécu deux siècles avant Phèdre, et dont la langue ne se parlait plus que dans les écoles ; ces imitations de quelques passages de Martial qui n’écrivit qu’après lui ; cet ïambe presque prosaïque, qui ne se rencontre chez aucun poète latin ; ces nombreuses inégalités de style que Pithou lui-même avait aperçues et corrigées, tout en un mot démontre que les fables que nous possédons ne sont pas l’œuvre originale de Phèdre.
C’est une traduction presque aussi vieille que le texte grec ; mais c’est une traduction.
Mais alors où est le texte grec ? Il a disparu, répond M. du Méril, et il ne faut pas s’en étonner ; car Phèdre a eu le sort de bien d’autres auteurs, dont les œuvres ne nous sont pas parvenues. {p. 178}Plutarque et Nicostrate n’avaient-ils pas, comme lui, composé des fables grecques qui sont entièrement perdues ?
La vérité ainsi rétablie, tous les textes s’expliquent sans peine.
Les témoignages de Martial et d’Avianus ne sont plus en contradiction avec celui de
Sénèque. L’ambiguïté disparaît de ce passage si tourmenté par les critiques :
« Quas [Æsopi fabulas] græcis iambis Babrius repetens in duo volumina coarctavit ; Phædrus etiam partem aliquam
quinque in libellos resolvit. »
Phèdre n’a pas, selon
l’interprétation de Schwabe, traduit le vieil Ésope ; il n’a pas non plus, comme le
prétend Christ, développé en cinq livres une partie de son œuvre. « Resolvere, dit-il, ne peut évidemment signifier ici, ni mettre en
prose, ni développer des fables ; c’est donc une simple opposition à coarctavit, qui indique seulement un recueil plus considérable que celui
de Babrius, et, comme l’exprime etiam, comme le ferait déjà
supposer le petit nombre de fables qui leur sont communes, Phèdre s’était sans
doute ainsi que Babrius servi de l’ïambe grec. »
Ici, s’appuyant sur l’édition diplomatique de M. Berger de Xivrey, M. du Méril cherche à en tirer, au profit de sa thèse, un nouvel argument. Dans le manuscrit de Pithou, auquel aucun feuillet utile ne manque, le texte est divisé en quatre livres ; or, si c’était l’œuvre de Phèdre, il serait, comme Avianus l’atteste, divisé non en quatre livres, mais en cinq. Mais j’ai démontré que M. Berger de Xivrey s’était trompé, et l’argument que M. du Méril tire de sa publication, manque de base.
À part cette erreur de détail et quelques autres auxquelles je ne veux pas m’attarder, faut-il admettre le moyen terme, la théorie éclectique hardiment jetée par M. du Méril entre les opinions les plus opposées ? C’est sans la moindre hésitation que je réponds négativement.
Phèdre était Macédonien, c’est vrai ; mais c’est encore enfant qu’il était arrivé à Rome ; la langue romaine était devenue sa langue naturelle, et, comme ses fables s’adressaient aux Romains dont il voulait corriger les mœurs, il est évident qu’il n’avait pas pu songer à écrire en grec.
Sans doute la fable ésopique était étrangère aux Romains, et son origine explique qu’il ait emprunté à la littérature grecque un genre auquel un Romain n’aurait peut-être pas pensé. Mais ce n’est {p. 179}pas une raison pour en conclure qu’il avait composé ses fables dans la langue de son modèle. Importateur d’un genre nouveau, il avait dû, pour le vulgariser, se servir de la langue latine. C’est d’ailleurs ce que dit expressément Avianus, et, quand M. du Méril reconnaît avec raison que le mot resolvere ne signifie ni mettre en prose, ni développer, et signale ainsi l’erreur de Christ, il en commet une autre à peu près semblable, en disant que par le mot resolvere Avianus a voulu indiquer un recueil plus considérable que celui de Babrius. Car, encore une fois, resolvere signifie traduire.
Le passage de Quintilien, cité par M. du Méril, est également mal interprété par lui. Jannelli, qui, ainsi que d’autres érudits, l’avait commenté avant lui, admet bien qu’il puisse s’appliquer à l’œuvre de Phèdre ; mais il fait observer judicieusement que Quintilien parle non de traductions proprement dites, mais de ces paraphrases, qui consistent à mettre en prose un texte d’abord écrit en vers, dont les ïambes phédriens auraient pu être la base, et qui n’auraient pu leur donner naissance244.
Quant aux preuves matérielles tirées des fables elles-mêmes, il faut avouer qu’elles sont peu convaincantes.
Les ïambes adoptés par Phèdre ne lui sont pas spéciaux ; la forme grecque conservée à son nom n’est pas le seul exemple qu’on trouve de cette anomalie, et d’ailleurs il est au contraire supposable que, si ses œuvres avaient été traduites par des écoliers, ils auraient traduit son nom comme le reste ; nous le connaîtrions aujourd’hui sous le nom de Phæder ; les lacunes observées laissent subsister des fragments de fables ; ce qui ne s’expliquerait pas s’il s’agissait de corrigés ; car le maître n’aurait pas porté sur le cahier d’honneur des fragments de fables ; il se rencontre aussi des fables licencieuses qui n’existeraient pas ; les maîtres n’auraient pas voulu les laisser traduire. Il n’y a rien d’étonnant à ce que Phèdre ait une fois parlé de lui à la troisième personne ; le vers latin tiré d’Ennius n’a pu entrer que dans une poésie latine ; un poète qui se respecte peut citer un autre poète : Regnard a emprunté plus d’un vers à Molière ; le style de Térence {p. 180}s’explique dans les écrits d’un affranchi grec, qui, instruit dans les écoles, avait dû moins que les Romains eux-mêmes adopter les nouvelles formes de leur langage ; Martial, qui connaissait Phèdre, a pu imiter quelques-uns de ses vers ; enfin les imperfections qui se rencontrent dans les fables n’auraient pas existé dans des corrigés qui devaient être exempts de fautes, et ne s’expliquent que par l’incurie ou l’ignorance des copistes du moyen âge.
Ainsi aucun argument de M. du Méril n’est concluant ; au contraire, si, comme lui, on s’attache au texte, on y trouve la preuve irrécusable que Phèdre fut un auteur latin ; c’est lui-même qui le déclare en ces termes dans l’épilogue du livre II :
Quod si labori faverit Latium meo,Plures habebit quos opponat Græciæ.
Et pour qu’on n’en doute pas, il le répète encore, lorsque dans le livre IV il dit à Particulon :
Quare, vir sanctissime,Particulo, chartis nomen victurum meis,Latinis dum manebit pretium litteris.
M. du Méril passe ces textes sous silence ; il est trop instruit pour les ignorer ; mais il comprend qu’il lui serait impossible de les mettre en harmonie avec sa thèse.
Sans doute elle est séduisante ; elle fournit un moyen commode de concilier la phrase de Sénèque avec l’existence de Phèdre attestée par Martial et par Avianus ; mais, quelque regret qu’on en ressente, on ne peut sérieusement l’accueillir. Aussi n’a-t-elle pas eu le pouvoir de rouvrir un débat qui n’avait que trop longtemps duré.
On connaît maintenant les discussions auxquelles a donné lieu l’authenticité des fables anciennes. Ce qui en ressort, c’est que Phèdre fut l’auteur des fables qui portent son nom, qu’affranchi d’Auguste il les écrivit sous les règnes de ses successeurs, qu’il les composa en ïambes latins, et que, si Sénèque, son contemporain, a, dans une phrase inexplicable, implicitement nié tous ces faits, ils ne doivent pas moins être considérés comme entièrement conformes à la vérité.
Section II.
Fables nouvelles. §
Les fables nouvelles ont eu le même sort que les anciennes ; elles sont passées par les mêmes péripéties, avec cette différence pourtant qu’aujourd’hui l’incertitude à leur égard n’a pas aussi bien disparu. Il importe donc de ne plus, en ce qui les concerne, se borner à retracer l’histoire des discussions dont elles ont été l’objet, et d’examiner doctrinalement le degré de confiance qu’elles doivent inspirer.
Prévoyant les doutes qui ne manqueraient pas de les accueillir, Jannelli, en même temps qu’il en préparait la publication, avait, ainsi que je l’ai expliqué, rédigé, pour en démontrer l’authenticité, trois dissertations fort savantes et malheureusement peu connues.
Je ne m’occuperai que de la seconde ; c’est celle dans laquelle sont formulés les principaux arguments. Elle se divise en deux parties.
Dans la première est traitée la thèse suivante : Fabulatorum qui ab Augusti ævo ad Perotti usque ætatem floruerunt, nemo ullus,
præter Phædrum, Fabellarum novarum Auctor haberi potest
; en tête
de la seconde, la thèse à discuter est ainsi formulée : Singillatim argumenta afferuntur quibus Phædrum revera Fabellarum novarum
Auctorem habendum esse demonstratur.
Je suis trop pressé d’en finir pour exposer les arguments à l’aide desquels il cherche à démontrer qu’aucun auteur autre que Phèdre n’a pu écrire les fables nouvelles. Je me hâte de parcourir ceux par lesquels il prétend établir qu’en réalité c’est bien Phèdre qui les a composées.
1º Les fables, s’occupant des mœurs, des institutions et de la religion, doivent en être le reflet. Les nouvelles fables qui parlent de Jupiter, de Mercure, de Junon, de Vénus, de Castor et de Prométhée, doivent nécessairement se rapporter à une époque où ces divinités étaient encore en honneur ; rappelant les oracles et les peines du Tartare, elles doivent être contemporaines de ces croyances ; enfin, si elles font allusion à l’esclavage et aux jeux du {p. 182}cirque, c’est qu’elles ont été écrites dans un siècle où ils étaient encore en usage. Pour retrouver un tel état social, il faut remonter plus haut que le règne de Constantin, et avant lui quel autre que Phèdre a pu écrire les fables nouvelles245 ?
2º La fable De Pompeio magno et ejus milite se réfère à un fait trop peu important, pour qu’on ait pu longtemps s’en souvenir ; Phèdre, qui vivait sous Auguste, peut seul l’avoir connu246.
3º La fable De oraculo Apollinis ne peut être aussi que de Phèdre ; elle n’est pas écrite dans un esprit d’incrédulité ni de moquerie. Or le prestige de la Pythie ne survécut pas à son temple que Néron fit impitoyablement détruire. Juvénal, qui vivait sous Domitien et sous Trajan, fait l’allusion suivante à la disparition de l’oracle de Delphes :
..... Quoniam Delphis oracula cessant,
et Porphyrius sous Sévère développe la même pensée en ces termes :
Ablata est Pythii vox haud revocabilis ulliTemporibus longis, etenim jam cessit Apollo247.
4º On trouve dans les fables nouvelles l’élégance, la finesse, l’habileté, la pureté et la concision qui font les principales qualités des anciennes. Sous ces rapports elles sont les mêmes ; or il est, suivant Sénèque lui-même, très malaisé de refaire exactement ce qui a été déjà fait. On y trouve, sur le destin, sur la pauvreté, sur la fortune, des idées identiques qui ne peuvent avoir été conçues que par le même auteur. Il est vrai qu’après avoir, dans les fables anciennes, fait l’éloge de la littérature grecque, il traite, dans les nouvelles, les Grecs de gens loquaces. Mais, comme il a rendu hommage à leurs qualités, il est naturel qu’il signale aussi leurs défauts, et que, se considérant comme un auteur latin, il ne prenne pas, pour les dire, de bien grandes précautions248.
5º Comme dans les fables anciennes, on rencontre dans les nouvelles {p. 183}des anecdotes, telles que celle de Pompée et de son soldat249.
6º Ésope, souvent mis en scène dans les anciennes, reparaît plus souvent encore dans les nouvelles, et, hormis Phèdre, aucun fabuliste n’a recouru à ce procédé littéraire250.
7º Phèdre, dans ses fables anciennes, emploie quelquefois des expressions abstraites, et leur fait jouer le même rôle que si elles étaient concrètes ; ainsi, pour ne citer qu’un exemple, il dit dans les anciennes fables :
Gulæque credens colli longitudinem,
et dans les nouvelles on lit :
Traxitque ad terram nasi longitudinem.
C’est encore là une forme de langage qui n’est familière à aucun autre poète de son époque251.
8º Lorsque les lettres latines furent tombées en décadence, les fables ésopiques furent considérées comme se prêtant mieux que les autres monuments anciens à l’instruction de la jeunesse. Mais les maîtres ne respectèrent pas le texte de Phèdre. Ils le transformèrent, donnant une forme plus intelligible à ce qui leur semblait trop difficile à saisir, plus claire à ce qui leur semblait trop obscur, et surtout plus explicite à ce qui leur semblait trop concis. De là sortit un genre tout nouveau de fables composées en prose. L’ensemble en était grossier ; mais dans les détails on apercevait des lambeaux de vers, disjecti membra poetæ. Deux collections de ces fables en prose attribuées à deux Romulus furent publiées, l’une par Rimicius ou plutôt Rinucius Tettalus vers le milieu du xve siècle, l’autre par Nilant au commencement du xviiie avec des fables plus anciennes qu’il adjuge à un auteur anonyme. Salon de Parme252 enfin en composa également soixante. Toutes ces collections ne contiennent que des fables de Phèdre un peu transformées. Or, comme on y retrouve les sujets de huit des fables nouvelles, il est indubitable que Phèdre en est l’auteur ; quant aux autres, {p. 184}douées davantage encore de ses qualités, elles doivent aussi lui appartenir253.
9º La dédicace de Perotti lui attribue d’ailleurs les fables nouvelles :
Non sunt hi mei quos putas versiculi,Sed Æsopi sunt, et Avieni, et Phædri.
Il est évident qu’Ésope n’a pu les écrire, et que Perotti ne le cite que comme la source à laquelle ont puisé Phèdre et Avianus, et ce n’est qu’à ce titre qu’il peut considérer le vieux Phrygien comme étant l’auteur des fables contenues dans son recueil.
Toutes les fables d’Avianus sont connues ; il n’en a écrit, de son propre aveu, que quarante-deux, et dans aucune l’ïambe n’est employé. Il ne reste donc plus que Phèdre254.
10º L’assertion d’Avianus, qui déclare que Phèdre n’a composé que cinq livres, ne prouve rien. Phèdre ne les publia que les uns après les autres, et peut-être, alors qu’ils étaient plus nombreux, Avianus n’en a-t-il connu que cinq. Mais il est probable que les cinq livres que nous possédons nous sont parvenus incomplets. Tels sont notamment le deuxième et le cinquième qui ne devaient pas être aussi courts. Phèdre lui-même nous apprend qu’il ne s’était pas contenté de mettre en œuvre la matière laissée par Ésope :
Ego porro illius semitam feci viam,Et cogitavi plura quam reliquerat.
Or nous ne connaissons guère de Phèdre que 90 fables. Quand il s’inspira d’Ésope, la matière connue de son devancier était considérable, et, comme il l’a employée, sinon tout entière, au moins en très grande partie, il faut en conclure que toutes ses compositions ne nous sont pas parvenues.
Les lacunes qu’elles présentent sont au surplus prouvées par les interprétations en prose, écrites au moyen âge. On y trouve beaucoup de fables qui ne figurent pas dans les manuscrits connus de Phèdre, mais qui trahissent la même origine. Aussi Gude et Burmann se sont-ils ingéniés à les rétablir en vers ïambiques.
Les fables elles-mêmes portent les traces de leurs lacunes. {p. 185}Après la fable xiii du livre IV, il y en a une qui saute aux yeux : le prologue du livre V, qui se termine par ce vers :
Sed jam ad Fabellam talis exempli feror,
est suivi d’une fable qui ne s’y rapporte pas ; celle qui en était la mise en action est absente.
Le manuscrit de Pithou offrait des pages déchirées au milieu et à la fin. En manquât-il seulement sept ou huit, que cela suffirait pour qu’il eût contenu les fables nouvelles.
Enfin, soit par l’injure du temps, soit par l’audace des grammairiens et des pédagogues, les fables de Phèdre ne nous sont parvenues qu’à l’état de morceaux choisis, et les manuscrits mêmes montrent que leur classement ne peut provenir de l’auteur.
De tout cela il ressort que, pour lui attribuer les fables nouvelles, il n’est pas nécessaire de supposer qu’il écrivit plus de cinq livres, et qu’au contraire y trouvant naturellement leur place, elles en sont l’indispensable complément255.
11º Elles présentent des expressions, des alliances de mots, des tours de phrase, qui ne se rencontrent pas dans les autres auteurs latins. Mais toutes les formes de langage, usitées à Rome, ne nous sont pas connues, et, si l’on pouvait lire tout ce qui a été perdu des œuvres d’Ennius, de Lucile, de Caton, de César et des autres auteurs, on observerait sans doute le même phénomène. Ces particularités qu’on remarque dans Phèdre, ne s’écartent pas d’ailleurs des règles de la syntaxe latine256.
12º C’est précisément parce que les écrivains plus récents, ne rencontrant pas ces particularités dans les ouvrages connus des anciens, n’ont pas pu les reproduire, que l’origine antique en est incontestable.
Elles ont dû, il est vrai, n’être pas ignorées des auteurs qui furent les contemporains de Phèdre, ou qui le suivirent à Rome, et l’on devrait les retrouver dans leurs écrits. Mais chaque écrivain éminent n’a-t-il pas son cachet et n’est-ce pas par là qu’il reste inimitable257 ?
13º Enfin, relativement aux imperfections indignes de Phèdre, {p. 186}il faut se rappeler que ses fables ne sont pas arrivées sans altérations jusqu’à nous. Les passages remarquables prouvent même qu’il ne peut être responsable de ceux qui sont défectueux. Les fautes qui nous choquent, il faut les attribuer non pas aux simples copistes, mais aux grammairiens et aux pédagogues. Les premiers ont transposé, redoublé ou supprimé des lettres, mais cela n’a pas altéré le texte. Les seconds ont transposé, changé ou corrompu des mots entiers, et il en est résulté des taches qui le déparent.
Quintilien avait conseillé d’employer les fables ésopiques dans l’enseignement scolaire ; il considérait comme excellent l’exercice qui consistait à les faire mettre en prose et paraphraser par les élèves, et il est probable que, lorsqu’il engageait les maîtres à user de ce procédé, c’était dans sa pensée les fables de Phèdre qui devaient leur en fournir les moyens. Elles durent donc peu de temps après sa mort être employées à cet usage. Puis il se continua au moyen âge. Mais, dans ce temps d’ignorance, les maîtres n’avaient qu’une instruction relative, et, en voulant les rendre plus intelligibles à leurs élèves, ils y firent des changements maladroits, qui les déparent, mais qui ne les empêchent pas d’être l’œuvre de Phèdre258.
Tels étaient les arguments par lesquels Jannelli avait établi l’authenticité des fables nouvelles. En les lançant dans le monde littéraire, il leur avait donné un certificat d’identité assez en règle pour les croire à l’abri de tous les soupçons. Malheureusement l’esprit de scepticisme rendit sa précaution presque inutile. À peine, depuis la publication de ses trois dissertations, une année s’était-elle écoulée qu’en France l’ancien oratorien, nommé Adry, dans un opuscule aussi pauvre par la forme que par le fond259, exprima sur l’authenticité des fables nouvelles des doutes, qui jetèrent le trouble dans toutes les consciences.
Il importe donc d’examiner les raisons sur lesquelles ils étaient fondés. Je les réfuterai une à une.
1º Il commence par prendre à la lettre les deux vers de Perotti :
Non sunt hi mei quos putas versiculi,Sed Æsopi sunt, et Avieni, et Phædri.
{p. 187}Suivant lui, Perotti affirme qu’il a puisé à trois sources : Ésope, Avianus et Phèdre ; comme on donnait, en général, au moyen âge le nom d’Ésope aux collections de fables latines en prose, il a dû par Ésope vouloir désigner Romulus. Il faudrait donc admettre que les trente-deux fables nouvelles seraient des fables de Romulus que Perotti aurait traduites en ïambes latins ; mais le langage de Perotti ne permet pas de faire cette supposition.
2º Adry prétend ensuite qu’elles n’ont pas toutes l’élégance du style
de Phèdre, et, au lieu de le démontrer, il se borne à citer l’opinion suivante, que
Heyne formulait lui-même, au mois de mai 1811, dans une lettre datée de Göttingen et
adressée à Cassitto : « De ipso autem fortunæ munere, ita statuo, profectum
quidem illud esse ab aliquo viro docto ex superioribus ætatibus, Phædri quidem
æmulo, ingenio tamen et sermonis castitate, proprietate et elegantia multum
inferiore, fabulæ quoque Æsopiæ non satis perspectam habente indolem. Vel sic
tamen dignum fragmentum esse arbitror quod inter ceteram fabularum farraginem
aliquo loco sit habendum. »
Ici donc, c’est non sur son sentiment personnel, mais sur l’appréciation d’autrui qu’il se fonde. Mais d’abord, le savant allemand reconnaît que l’auteur est un ancien, un émule de Phèdre ; c’est déjà beaucoup, et, s’il ne va pas plus loin, il est évident que c’était la faute de Cassitto, qui, ayant rempli à la hâte dans sa première édition les lacunes du manuscrit, avait soumis à Heyne un texte profondément altéré. Il est vrai que ses leçons étaient imprimées en lettres italiques ; mais, dans la précipitation qui avait présidé à la publication, cette précaution avait été très mal observée. Il en résulte que, si, au lieu de lire les fables nouvelles dans la première édition de Cassitto, Heyne les avait examinées dans celle de Jannelli, il n’aurait pas hésité à déclarer que ces fables, dont il reconnaissait d’ailleurs l’ancienneté, étaient bien l’œuvre de Phèdre.
3º Adry avoue bien « qu’on y trouve quelques expressions
familières à Phèdre »
; seulement il se hâte d’en tirer une conclusion
contraire à l’authenticité : « Sans doute, dit-il, il ne s’est pas volé
lui-même. »
Une pareille raison révèle le parti pris. Si c’est parce
qu’elles ressemblent aux anciennes qu’elles ne doivent pas être du même auteur, il
n’aurait pas fallu commencer par baser les doutes sur ce qu’elles en diffèrent.
{p. 188}4º C’est, suivant Adry, une opinion
hasardée que de prétendre « que depuis Phèdre jusqu’à Perotti inclusivement
on ne trouve personne qui ait été capable de composer les nouvelles
fables »
. Mais, pour démontrer qu’avant Perotti d’autres que Phèdre ont pu
les écrire, il ne découvre pas d’autres exemples à citer que l’Éloge de
la ville de Gênes, la Description de la vie champêtre, et
le Tableau de la tyrannie de Nicolas de Clémengis.
5º Après ces critiques générales, Adry examine isolément chaque fable.
Il accuse de dureté le dernier vers de la première fable, qui, à la fois altéré et en partie illisible dans le manuscrit, avait été par Jannelli restitué ainsi :
Quam parvam quamvis partem impertiar tibi.
Qu’on transpose les mots parvam et partem, et que, à l’exemple de Jannelli, on substitue impertiar à impartiar, le vers, selon Adry, sera toujours entaché de la même cacophonie. J’admets qu’il vaudrait mieux que la syllabe par n’y figurât pas trois fois ; mais avouons que c’est là une de ces petites fautes d’élégance que Phèdre a très bien pu commettre.
Adry reconnaît que la fable iii, Auctor,
n’est pas indigne de Phèdre. « Mais, dit-il, ce n’est point un
apologue. »
Or, c’est là un reproche qui pourrait s’adresser à plus d’une
ancienne.
Il trouve absolument ridicule la fable iv, Mercurius et Mulieres, qui, suivant lui, pourrait tout au plus figurer à côté du conte de Perrault si connu des enfants. Mais pourquoi, si Perotti l’a inventée, y a-t-il, lui prélat romain, introduit une divinité du paganisme ? Perrault, dans son conte, n’a pas fait intervenir Mercure. Quant à l’idée, elle n’est pas plus ridicule que celle qui se trouve développée dans la fable ancienne Canum legati ad Jovem.
Adry trouve que la fable v finit très mal et que les derniers vers
n’en ont pu être clairement traduits. Mais par sa composition elle rappelle
complètement la fable licencieuse du livre IV, intitulée : Idem
Prometheus.
Passant sous silence la fable vi qui n’est que la morale d’une fable perdue, il arrive à la viie, De significatione pœnarum Tartari, et est obligé de confesser qu’elle est irréprochable.
{p. 189}Il trouve la fable viii, De oraculo Apollinis, « très belle et sublime même »
.
Il remarque seulement que le vers
Delicta vindicate ; castigate impios,
n’est pas sur ses pieds. Cela est vrai ; il est d’un demi-pied trop
long ; mais, tout en y voyant matière à plaisanterie, il n’en tire, d’ailleurs,
aucun argument contre l’authenticité de la fable, qu’il regrette seulement
« de ne pas trouver en meilleure compagnie »
.
La fable ix peut n’être qu’une épigramme ; mais il est incontestable qu’elle ressemble beaucoup sous ce rapport aux anciennes, dans lesquelles Phèdre fait intervenir Ésope.
En sa qualité d’ancien moine facile à offusquer, Adry donne la qualification de turlupinade à la fable x, Pompeius Magnus et ejus miles. Le récit n’est sans doute pas à la hauteur du personnage mis en scène ; mais Jannelli s’est expliqué sur ce point et je me réfère à ce qu’il en dit lui-même.
La fable xi, Juno, Venus et Gallina, paraît à Adry contraire au but que Phèdre s’était proposé et qu’il avait formulé par ce vers :
Et quod prudenti vitam consilio monet.
Je ne sais pas où le critique aperçoit cette contradiction. Le fabuliste donne son opinion sur la vertu des femmes ; bien des gens penseront sans doute qu’en les montrant incorrigibles, il donne aux hommes un salutaire avis.
Adry néglige prudemment la fable xiie, et, passant à la хiiie, il n’y voit qu’une réflexion très sensée. Bien des fables anciennes ne contiennent pas autre chose. N’est-ce pas d’ailleurs assez ?
Suivant lui, dans la fable xiv, Asinus ad
lyram, « la réflexion morale ne devrait pas être faite par l’âne
lui-même. »
Mais Phèdre a suivi là un procédé qui lui est familier ; on le
trouve appliqué par exemple dans la fable ancienne, Gallus ad
Margaritam.
La fable xv, Mulier vidua et Miles, semble à Adry un conte plutôt qu’une fable. Il a raison ; mais ce n’est pas non plus un conte, c’est un événement contemporain, que Phèdre rapporte comme celui dont la fable x du livre III contient le récit.
Adry ne parle pas de la fable xvi ; il prétend
la xviie, Æsopus et Domina,
« très obscure et fort mal racontée »
; ces deux reproches {p. 190}ne me paraissent pas fondés. Le sens s’en comprend bien, et
la leçon qu’elle donne est bonne à ne pas oublier.
Dans la fable xviii, Gallus lectica a Felibus vectus, il trouve peu intelligible, et, dans tous les cas, bizarre le dernier vers ainsi conçu :
Discerpsit dominum, et fecit partes facinoris.
Il est pourtant aisé de comprendre que la bande de chats
« déchira son maître et se partagea le produit de son crime »
.
Enjambant ensuite la fable xix, Adry reconnaît que
la xxe, Servus profugus, et
Æsopus, « contient une excellente morale »
, mais elle ne lui
paraît pas élégante, et, suivant lui, ce vers :
Has propter causas, et quas longum est promere,
ressemble un peu au dispositif d’un arrêt, qui finit toujours par :
« à ces causes et autres à ce nous mouvant,
etc. »
Mais Adry devait bien admettre que cette formule n’était pas connue
de Perotti, et que, même si on voulait lui attribuer cette fable, on ne pourrait
supposer que le vers critiqué lui a été inspiré par la procédure de son temps.
Il ne parle pas de la fable xxi, et prétend que
la xxiie, Ursus esuriens, ne
renferme « qu’un trait d’histoire naturelle »
sans intérêt. Il ne
s’aperçoit pas qu’elle se termine par cette conclusion morale qui ne manque pas de
bon sens :
Ergo etiam stultis acuit ingenium fames.
Dans la fable xxiii, Viator et Corvus, il trouve un peu singulier ce vers :
Et perdidisset tempus aliquot millium.
La forme en est pourtant irréprochable. Le Corbeau, en disant bonjour au voyageur, ne lui avait pas fait perdre peut-être autant de temps que ce vers semble le dire ; mais un poète n’est pas tenu à tant d’exactitude.
Il retrouve dans la fable xxiv les qualités de Phèdre.
Passant de là à la fable xxvii, Servus et
Dominus, il la proclame « inintelligible »
. Cela est vrai ;
mais il oublie qu’elle était une des plus illisibles du manuscrit de Naples, que
Jannelli a {p. 191}été obligé de substituer ses hypothèses au texte détruit, et
que, si les vraies leçons en étaient connues, elle n’aurait peut-être pas le double
défaut d’être obscure et de ne pas se trouver en harmonie avec son titre moral. En
effet, elle a été retrouvée dans le manuscrit du Vatican exempte des défauts qu’Adry
lui impute.
Adry avoue que la fable xxviii, Lepus et Bubulcus, est très belle ; il était impossible de prétendre le contraire.
Il n’en critique plus que deux, la xxxie, Papilio et Vespa, dont les premiers vers, illisibles dans le manuscrit, ont été rétablis à l’aide de conjectures plus ou moins heureuses, mais dont le dernier vers :
Non qui fuerimus, sed qui nunc simus, vide,
a une grande analogie avec cet autre de Phèdre :
Quod fuimus laudasti, jam damnas quod sumus,
et ne peut être évidemment que du même auteur, et la xxxiie, Terraneola et Vulpes, qu’il considère comme digne de Lycophron, mais qui, s’il avait voulu prendre la peine d’en lire la traduction par M. Bagioli publiée à Paris en 1812 et citée par lui-même, ne lui aurait pas sans doute paru aussi entachée de l’obscurité qu’il lui reproche ;
6º Après avoir ainsi passé en revue les fables nouvelles, Adry critique la réponse faite par Cassitto aux objections de Heyne, qui avait remarqué que plusieurs fables ne constituaient pas de véritables apologues. Cassitto avait répondu en citant des fables de la même nature dans le livre IV des anciennes. Adry n’est pas touché de cette comparaison, et ce qui, lorsqu’il s’agit de ces dernières, n’ébranle pas sa foi, lui inspire des doutes à l’égard des autres.
7º En ce qui touche les éditeurs français qui ont adopté l’opinion de
Cassitto et de Jannelli, il les traite un peu cavalièrement. Il suppose qu’ils n’ont
fait qu’analyser les raisons invoquées par les éditeurs italiens et qu’ils n’ont pas
pris la peine « de lire attentivement les fables nouvelles »
. Cette
manière de voir toute hypothétique n’a pas même besoin d’être réfutée.
8º En définitive, sur les 32 fables nouvelles il n’en voit que {p. 192}douze qui soient, à proprement parler, des apologues, et
que cinq ou six qui présentent des qualités réelles. Il en conclut que l’on doit y
reconnaître au moins deux mains différentes, et pour lui rien ne démontre que l’une
des deux soit celle de Phèdre. Je n’ajoute qu’une réflexion : pour arriver à cette
conclusion, il est obligé, oubliant les deux vers de la dédicace cités par lui-même
au début de son opuscule, d’affirmer que Perotti « n’a dit nulle part que les
nouvelles fables fussent de Phèdre »
. Cette affirmation me dispense de
prolonger ma réfutation : quand on nie ainsi l’évidence, on est jugé.
Lorsqu’on considère ainsi en eux-mêmes les arguments d’Adry, on ne
comprend pas comment ils ont pu exercer sur les esprits une si profonde influence ;
il faut croire que c’est sa réputation de savant consciencieux qui les a troublés.
Il me semble évident que la même critique, écrite par tout autre, n’aurait pas
produit le même effet. Il n’en est pas moins vrai que, pendant quinze ans, l’opinion
d’Adry s’imposa aux érudits. En 1826, dans l’édition des fables de Phèdre, publiée
par Gail sous la direction de Lemaire, Barbier, dominé par cette influence, écrivait
encore : « Un homme aussi profondément versé que M. Adry dans la lecture de
Phèdre n’a pu se montrer favorable aux nouvelles fables publiées en Italie. Son
opinion est partagée par tous les amis de la bonne littérature260. »
Mais il en est de la philologie comme de la politique : toute théorie fausse n’obtient qu’un triomphe temporaire ; tôt ou tard elle est suivie d’une réaction, et cette réaction commençait déjà à se faire sentir ; car, dans la même édition de Phèdre, Gail, faisant précéder d’une préface les fables nouvelles, y déclarait qu’il n’osait ni les refuser ni les attribuer au fabuliste latin261.
Vers la même époque, M. Robert trouve bien qu’Adry a pris le parti le
plus sage, « en examinant toutes les fables nouvelles les unes après les
autres et en prononçant sur chacune d’elles un jugement particulier262 »
. Mais, après avoir approuvé son procédé,
il n’accepte pas ses appréciations, et voyant qu’Adry, pour {p. 193}refuser à Phèdre la fable xvi, Duo juvenes
sponsi, dives et pauper, se fonde sur ce qu’on y rencontre un vers qui en
rappelle un autre des fables anciennes, il n’hésite pas à combattre son opinion.
« Il me paraît, dit-il, en parlant de cette fable, n’avoir hésité à
attribuer celle-ci à Phèdre que parce que plusieurs vers lui ont paru calqués trop
exactement sur ceux qui terminent l’ancienne fable de Simonide
préservé par les Dieux. Phèdre, dit-il, ne s’est pas sans doute volé
lui-même. Mais ne trouvons-nous pas des vers entiers des Géorgiques transportés
dans l’Énéide ? »
L’opinion d’Adry a encore moins touché le cardinal Angelo Maï. En
1831, en publiant, d’après le manuscrit du Vatican, les nouvelles fables de Phèdre,
il n’a manifesté aucun doute sur leur âge véritable. Il prétend même trouver, dans
les deux vers qu’on a qualifiés de fable vi, la preuve que Perotti n’est
pas l’auteur des fables nouvelles. Il considère ces deux vers comme l’épimythion
d’une fable absente, et il ajoute : « Si Perotti, comme certaines personnes
le supposent, avait tiré ses fables de sa propre imagination, pourquoi aurait-il
laissé cette lacune ? Il est donc évident qu’il a copié le fragment tel qu’il
existait dans le manuscrit ancien. J’affirmerais pourtant que c’était l’épimythion
de la fable ive, si dans le manuscrit de Perotti
n’avaient été interposés plusieurs autres poèmes263. »
L’authenticité des fables nouvelles ne parut pas plus douteuse à Orelli ; il remarque bien dans leur texte des fautes soit de syntaxe, soit de versification ; mais il les attribue soit au manuscrit défectueux dont Perotti s’est servi, soit aux changements maladroits qu’il y a introduits264.
Ainsi, en France, en Italie et en Suisse, malgré l’attaque d’Adry, l’authenticité des fables nouvelles avait été acceptée.
Mais en Allemagne la chose avait été différente, et l’on comprend {p. 194}sans peine qu’aux savants de ce pays qui n’avaient pas cru à l’authenticité des fables anciennes, les nouvelles aient dû inspirer moins de confiance encore. Aussi voit-on, en 1832, le savant Jacobs les attribuer à quelque versificateur moderne, qui, suivant lui, aura pris Phèdre pour modèle265.
Je me hâte de dire pourtant que l’Allemagne n’a pas été unanime dans son scepticisme. Ainsi, en 1838, on voit, à Bautzen, Dressler reconnaître si bien dans les fables nouvelles la main de Phèdre qu’il en fait un livre VI266.
Je suis surpris que, tandis que cet éditeur se rendait à l’évidence,
M. Fleutelot ait eu l’incertitude qu’il exprime ainsi dans sa notice : « Je
n’ai point traduit les fables de Perotti, et ne retracerai point les débats
auxquels elles ont donné lieu. M. Maï les croit de Phèdre ; mais il en serait plus
sûr, dit-il, s’il découvrait un manuscrit complet de Phèdre, où se trouveraient
ces fables. Attendons comme M. Maï267. »
Il me
semble n’avoir pas voulu prendre la peine d’étudier la question ; cela est
regrettable, car son opinion aurait été d’un grand poids.
Heureusement son abstention n’a pas été imitée par les éditeurs qui
l’ont suivi. Dübner notamment, dans la préface de sa petite édition classique,
n’hésite pas en 1847 à proclamer en ces termes l’authenticité des fables nouvelles :
« Je n’ai jamais douté, quant à moi, dit-il, que ces fables ne fussent bien
réellement de Phèdre, et une publication postérieure du cardinal Angelo Maï est
venue fortifier ma conviction. Le doute ne serait plus permis, si Angelo Maï, au
lieu de se borner, ainsi que ses prédécesseurs de Naples, à extraire de l’Epitome de Perotti les fables inédites, eût publié le recueil tout
entier : par là chacun aurait su comment Perotti procéda dans sa compilation ; on
aurait pu voir que cet écrivain s’est permis, dans les anciennes fables, des
changements plus ou moins maladroits. Mais les critiques qui n’ont pas voulu
reconnaître la main de Phèdre dans les nouvelles fables ont cité, comme preuves
{p. 195}principales, les passages déparés sans aucun doute
par les changements de Perotti. Cependant le dessein et l’exécution, dans ces
nouvelles fables, ne peuvent appartenir qu’à Phèdre268. »
On voit combien la conviction de Dübner est profonde, et cependant, pour l’acquérir, il n’a pas recouru aux manuscrits, et le regret qu’il formule montre qu’il n’a pas même eu connaissance de la publication complète qu’au mois de février 1811, Jannelli a faite de celui de Naples. Comment donc a-t-il pu avoir une foi si ferme ? C’est qu’en dehors des révélations toutes particulières que fournit l’inspection de l’Epitome de Perotti, l’authenticité des trente-deux fables nouvelles considérées en elles-mêmes ne peut pour les connaisseurs impartiaux être l’objet d’aucun doute ; c’est qu’enfin, pour faire usage de la figure aussi juste qu’expressive, employée par M. L. Müller, les fables nouvelles ressemblent aux fables anciennes, comme un œuf ressemble à un œuf269.
Mais, lorsqu’on a pu avoir sous les yeux les deux manuscrits ou seulement l’un d’eux, la confiance est encore plus grande. Qu’on me permette, à moi qui ai vu et copié celui de Naples et qui possède une copie littérale de celui de Rome, de signaler ici les éléments de certitude absolue qu’ils m’ont fournis.
Je l’ai expliqué : le recueil de Perotti est formé de poésies diverses, ajoutées les unes aux autres, sans ordre, à des intervalles plus ou moins éloignés.
Si Perotti avait adopté un classement tel que celui auquel, dans son
édition du manuscrit de Naples270, Jannelli a eu recours, si notamment des fables les plus
anciennement connues il avait, dans un groupement séparé, distingué celles qu’on est
convenu d’appeler nouvelles, on comprendrait qu’à chaque groupe pût être attribuée
une origine différente. Mais il n’en est pas ainsi : le tout est mêlé. Après la
dédicace à Pyrrhus, la première pièce de vers qu’on rencontre est la fable Simius et Vulpis, qui est la première des {p. 196}nouvelles ; puis vient le fragment qui porte pour titre : De
his qui legunt libellum
et dont les éditeurs ont fait l’épilogue
d’une sorte de sixième livre ; ensuite arrive un petit poème : De virtute ad Lentulum
, composé par Perotti. La même confusion
continue jusqu’à la fin.
Il y a plus : les fables que Perotti a empruntées à Phèdre ont toutes été traitées par lui de la même manière. Ainsi aux anciennes comme aux nouvelles il a enlevé le titre, qui, n’exprimant par lui-même aucune idée morale, ne répondait pas au but qu’il se proposait. Puis, séparant du texte même de chaque fable la moralité et la traduisant en prose, il en a fait un titre nouveau, destiné à remplacer celui qu’il avait supprimé.
Dans le texte il s’est permis aussi quelques changements d’expressions, dont l’objet évident était de mettre les fables de l’auteur païen en harmonie avec ses idées chrétiennes. C’est ainsi que, dans la fable x du livre III, il a, comme je l’ai déjà dit, remplacé le vers :
A divo Augusto tunc petiere judices
par celui-ci :
Pontificem maximum rogarunt judices.
Quand on voit l’état identique dans lequel, par suite de ces opérations uniformes, se trouvent dans son manuscrit les fables soit anciennes, soit nouvelles, on demeure convaincu qu’elles ont une origine commune.
Supposons maintenant que les manuscrits de Phèdre n’aient jamais été retrouvés et qu’on ne connaisse que ceux de Perotti ; il est clair qu’à raison de cette similitude absolue, les sceptiques devraient contester à Phèdre les fables anciennes aussi bien que les nouvelles. Les unes et les autres auraient dû nécessairement être l’objet de la même appréciation. Or, puisqu’il est aujourd’hui avéré que les premières ne peuvent lui être enlevées, il est impossible de lui refuser les secondes.
Ces remarques, qui frappent à première vue, sont loin d’être les seules. Perotti ne s’est pas contenté d’emprunter des fables à Phèdre ; il a, comme il le déclare, agi de même à l’égard d’Avianus, et l’on sait que celles de cet auteur sont en vers élégiaques. {p. 197}Si, à côté des fables anciennes appartenant incontestablement à Phèdre et des fables d’Avianus, on fait des fables nouvelles un troisième groupe et qu’on l’attribue à Perotti, on verra qu’après avoir placé sous ses yeux deux rythmes différents, il aurait perpétuellement donné la préférence au vers ïambique.
Au premier abord cet exclusivisme doit sembler au moins singulier. Mais il devient inadmissible, quand on examine les pièces de vers qui sont incontestablement de lui. Presque toutes sont écrites dans le rythme élégiaque qu’il aimait et qu’il maniait avec dextérité ; quelques-unes sont en vers phaléciens ; aucune n’est en vers ïambiques.
Il existe, dans l’Epitome de Perotti, un document qui prouve que si, en dehors des fables qu’il copiait, il avait voulu lui-même en composer, il aurait recouru au rythme élégiaque ; c’est une fable de son recueil qui seule est de lui, qui est une imitation de celle de Phèdre intitulée Socrates ad amicos, et avec laquelle, soit dit en passant, il a dû confondre plus tard dans son Cornu copiæ la fable Arbores in tutela deorum. Elle porte dans le manuscrit de Naples le numéro 70 et la rubrique Quanta sit verorum amicorum penuria. Elle est certainement l’œuvre de Perotti ; or elle est écrite dans ce rythme élégiaque qui. avait toute sa prédilection et qu’évidemment, s’il en avait traduit d’autres, il aurait toujours adopté.
J’ai dit qu’il n’avait composé aucune de ses poésies en vers ïambiques. Je m’empresse de confesser que j’ai peut-être tenu un langage trop absolu. Car il est vrai que sa dédicace à son neveu est en vers ïambiques271 ; mais, comme elle est aux trois quarts empruntée à Phèdre, il est évident qu’il a dû écrire dans le même rythme les vers qui émanent de lui. Il est encore vrai qu’il a mis en tête de la fable ancienne : Muli et Latrones, qui dans les éditions de Phèdre est la viie du livre II, quinze vers également composés dans le rythme ïambique ; mais, comme ces quinze vers servaient d’introduction morale à la fable elle-même, il est encore évident qu’ils devaient être écrits dans le même mètre.
Il y a mieux : ces exemples eux-mêmes me fournissent de précieux arguments ; en effet, ils dénotent une ignorance presque {p. 198}complète de la composition du vers ïambique. J’ai déjà reproduit la dédicace à Pyrrhus ; j’y renvoie. Quant aux quinze vers qui précèdent la fable Muli et Latrones, les voici :
Contrari, indoctis omnibus contrarie,Et gratus doctis, et cui grati sunt docti,Quem tot simul ornant naturæ munera,Ingenium cui dives et ubertas linguæ,Qui tam dulci immites voce placares feras,Et imis mortuos traheres sepulchris,Qui quodcumque libet docta pingis manu,Polygnoto major, atque Aglaophonte,Et Zeuxim superas atque Parasium (sic),Protogenemque, Pamphilumque, et Melantium,Theonemque Samium, Euphranoremque,Cui sponte doctus palmam daret Apelles :Quid sævam tantum paupertatem quereris ?Nec facit bonos illa nec facit malos,Obsuntque sæpius, quam prosunt divitiæ.
Qu’on scande ces vers et qu’on me dise si l’on croit encore que Perotti a pu écrire les fables nouvelles !
Ce n’est pas tout ; le manuscrit de Perotti me fournit une troisième
preuve de son ignorance en matière d’ïambes ; c’est l’extrait qu’il a fait de
l’hymne dixième de Prudence περὶ Στεφανῶν272, et qu’il a
adressé à Pomponius sous ce titre : De vero Deo, et vera Fide ac
Religione ad Pomponium.
Pour donner à son extrait l’apparence d’une
œuvre complète, spécialement faite pour Pomponius, il a été obligé d’en modifier les
deux premiers vers. Mais, ignorant la mesure, il a substitué à ce premier vers
original :
Vos eruditos miror et doctos viros,
ces mots qu’il est impossible de scander :
Vos doctos decet atque eruditos viros,
et à ce second vers original :
Perpensa vitæ quos gubernat regula,
cet autre, dans lequel, contrairement à la règle toujours suivie {p. 199}par Prudence, il remplace par un spondée l’ïambe du second pied :
Pomponi, vitæ quos gubernat regula.
Je sais bien, et j’ai été le premier à le proclamer, que Perotti a été un des hommes les plus versés de son temps dans la littérature latine. Je vais même plus loin, et je n’hésite pas à ajouter qu’il a peut-être été aussi, dans la prosodie latine, l’homme le plus expert de son époque. Parmi les ouvrages didactiques dont il fut l’auteur, il en est deux qui révèlent une connaissance très approfondie de la versification latine.
Dans le premier, qui est intitulé De generibus metrorum273, il s’occupe d’abord de la composition des diverses espèces de pieds. Il en signale vingt-huit, savoir : quatre de deux syllabes, huit de trois, et seize de quatre. Parmi ceux de deux syllabes il n’oublie pas l’ïambe, et il a bien soin de dire qu’il se compose d’une brève et d’une longue. Les différentes espèces de vers appellent ensuite son attention : il indique quels sont les pieds qui peuvent et quels sont ceux qui ne peuvent pas concourir à la formation de tel mètre déterminé, et quelles sont les positions qu’ils y doivent et celles qu’ils n’y doivent pas occuper.
Il sait quel rôle important le vers ïambique joue dans la littérature des Romains, et il s’y arrête avec une évidente complaisance.
Il examine d’abord l’ïambe antique, auquel il reconnaît cinq variétés, et, pour montrer leurs points de dissemblance, il analyse la composition particulière de chacune d’elles.
Il prend la même peine pour l’ïambe nouveau.
Puis il conclut en observant que le vers ïambique par excellence est
celui dont l’ïambe est l’unique pied : Optimum tamen esse metrum
quod uno duntaxat pedum genere a quo denominatur constat
274,
et, à l’appui de sa thèse, il cite, en altérant, il est vrai, le second, ces deux
vers bien connus d’Horace :
Beatus ille qui procul negociisPaterna iura bobus optat propriis.
{p. 200}Mais Perotti ne s’est pas borné à écrire ainsi un traité général de versification ; il s’est aussi, dans un second opuscule dédié à son frère Celius Perotti, livré à une étude toute spéciale des mètres qu’Horace a employés dans ses odes ; il en signale dix-neuf, parmi lesquels figure encore avec ses variétés le vers ïambique.
Perotti a donc bien connu l’ïambe, et cependant il s’en est servi dans son Epitome, comme s’il n’en avait pas eu la moindre idée. Mais cette contradiction n’est qu’apparente.
L’homme, en avançant dans la vie, s’instruit à chaque pas qu’il y fait, et cela est surtout vrai du travailleur. Beaucoup des notions qu’il possède au jour de sa mort n’ont pas été l’apanage de sa jeunesse. Il faut admettre qu’il en a été de Perotti comme de tous les savants, qu’il n’a été que fort tard initié aux rythmes compliqués de la poésie latine, et que c’est seulement après être parvenu à l’âge mûr qu’il a composé ses traités de versification. De pareils écrits, qui sont avant tout des ouvrages de patience, ne peuvent guère sortir d’une plume juvénile. Au contraire, un recueil d’opuscules poétiques est presque toujours un travail de jeune homme, et Perotti n’avait dû créer le sien qu’à une époque où, déjà très versé dans le mètre élégiaque, il ne savait rien encore du vers ïambique.
Et ce n’est pas là une pure hypothèse. J’ai démontré ailleurs qu’il
devait avoir renoncé à la poésie vers l’âge de trente ans ; je trouve, dans les
traités dont je viens de parler, la preuve qu’il ne les composa que dix ans plus
tard. Ainsi, dans la dédicace à son ami Jacob275, placée
en tête de son traité De Generibus metrorum, {p. 201}il se félicite de l’invitation que ce dernier lui a faite de se
livrer à une étude qui, en le reportant de plus de dix ans en arrière, lui rappelle
le temps le plus heureux de sa vie : Nam et beneficio tuo in
illam dulcissimam ætatem videmur revocari, qua decimum ante annum his studiis
una operam dabamus.
Mais ce traité n’était pas la mise en œuvre dans l’âge mûr de notions
acquises dans la jeunesse. Non, car il avoue encore que son ouvrage lui a coûté une
peine infinie : Qua in re incredibile dictu est quos sustinuimus
labores : adeo quippe omnia non solum præcepta, verum etiam pedum ac metrorum
nomina corrupta erant.
Il me semble évident que, si, à l’époque où
il avait entrepris son travail, il avait été bien initié à la versification latine,
il n’aurait pas éprouvé des difficultés si grandes, et qu’il n’a eu à les surmonter
alors, que parce qu’au moment de se mettre à l’œuvre, il avait presque tout à
apprendre.
Je pourrais m’en tenir là ; mais je désire répondre d’avance à une
objection in extremis que je prévois. « De ce que Perotti
n’est pas l’auteur des fables nouvelles, il ne s’ensuit pas, me dira-t-on, qu’on
doive en attribuer à Phèdre la paternité ; nous prouvons même qu’on ne le doit
pas. En effet, comme dans l’édition de Dressler276, elles formeraient un sixième livre, ce qui est
impossible ; car Avianus déclare que Phèdre n’en a écrit que cinq, et le manuscrit
de Pithou, auquel, quoi qu’on en ait dit, aucun feuillet ne manque, n’en contient
pas davantage. »
Il est vrai que Dressler a eu tort d’en faire un sixième livre ; mais il a ainsi commis une faute sans importance, qui a sans doute plus existé dans la forme de la publication que dans la pensée de l’éditeur. Obligé de les grouper, il en a fait un sixième livre ; mais il est probable qu’il n’a jamais cru que Phèdre en eût écrit plus de cinq.
Il est vrai aussi qu’aucun feuillet ne manque au manuscrit de Pithou ; mais il est constant que, s’il n’a pas été copié sur le manuscrit de Reims, il a du moins, comme ce dernier, été copié sur un troisième plus ancien, duquel malheureusement bien des feuillets avaient disparu.
{p. 202}J’ai déjà dit quelques mots de ces lacunes277 ; j’y reviens. Le livre II est d’une brièveté qui ne permet pas de le croire complet. Si même on s’en tenait purement et simplement au texte du manuscrit de Pithou, on pourrait prétendre qu’il ne nous en est rien parvenu. Car, dans ce manuscrit, le copiste n’a fait suivre d’aucune fable le titre du livre II et a fait commencer le livre III, non pas par le prologue intitulé Phædrus ad Eutychum, mais par le prologue intitulé Auctor qui fait suite à la dernière fable du livre I, attribuant ainsi au livre III les fables, dont, à l’exemple de Pithou, tous les éditeurs ont cru devoir former le livre II. Dans le second volume de cette édition je m’expliquerai plus complètement sur ce point. Quant à présent, je m’en tiens à la division adoptée ; mais au moins faut-il admettre que, si nous possédons quelque chose du livre II, ce qui en est resté n’en est qu’une faible partie.
La fable v de ce livre porte pour titre ces mots :
Item Cæsar ad Atriensem.
Le mot Item indique que dans la fable précédente il devait être question du même
empereur. Or cette fable manque. Manque-t-elle seule ? Non. Quelle est l’étendue de
la lacune ? Il est impossible de le savoir ; mais la brièveté du livre permet de la
supposer très considérable.
Le prologue même du livre III en fournit la preuve évidente. Ne fallait-il pas que les deux premiers fussent bien longs, pour que Phèdre pût écrire :
Ego illius pro semita feci viam,Et cogitavi plura quam reliquerat ?
Dans la première partie du livre IV, les huit premiers vers de la fable Leo regnans, qui, dans le manuscrit de Pithou, se terminent au milieu d’une ligne achevée par le premier des trois derniers d’une fable suivante, trahissent encore une lacune évidente, dont les proportions seules sont inconnues.
La deuxième partie du livre IV est encore plus incomplète. Ainsi que je l’ai expliqué, elle commençait par le prologue Poeta ad Particulonem, dont le premier vers est ainsi conçu :
Quum destinassem terminum operi statuere.
{p. 203}De cette seconde partie nous ne possédons,
outre ce prologue, que le préambule d’une fable disparue, intitulée : Idem poeta
, une partie de la fable Demetrius
rex et Menander poeta, une partie de la fable Viatores et
Latro, les trois qui suivent cette dernière et l’épilogue. Il y a dans le
manuscrit de Pithou et il y avait dans celui de Reims entre les deux fables
incomplètes, privées l’une de sa fin et l’autre de son commencement, une nouvelle
lacune, qu’il est impossible de connaître exactement ; mais, comme la seconde partie
du livre IV devait, par ses dimensions, être à l’origine en rapport avec la
première, il est certain que la lacune doit être de forte taille.
Quant au cinquième livre, il est évident, puisqu’il se réduit aux cinq dernières fables des deux manuscrits de Pithou et de Reims, que, même si nous le supposons plus court que les autres, nous n’en possédons encore qu’une très faible partie.
La conclusion, c’est que, pour attribuer à Phèdre les trente-deux fables nouvelles, il n’est pas nécessaire de supposer que, contrairement à l’affirmation d’Avianus, il en avait composé un sixième livre.
L’objection tirée de la nécessité de supposer un sixième livre qui n’a jamais existé, est ainsi complètement détruite, et les arguments que fournit l’examen des manuscrits, conservent toute leur valeur.
Si maintenant, en dehors des particularités qu’ils présentent, je cherche de nouveaux éléments de conviction, je n’ai encore que l’embarras du choix, et, pour abréger, je n’en vais signaler que quelques-uns.
Il y a d’abord une remarque, que les fables anciennes suggèrent à première vue : c’est que Phèdre ne se borne pas, comme les autres fabulistes anciens, à tirer ses fictions des traditions ésopiques ; il met en scène Ésope lui-même ; il le montre blâmant un homme qui, mordu par un chien, lui jette du pain imbibé de son sang, donnant de l’argent à un fou qui lui a envoyé une pierre, et qui, ainsi encouragé, en lance une autre à un passant et se fait bâtonner, expliquant sa conduite à un badaud surpris de le voir jouer avec des enfants, fermant d’un mot la bouche à un bavard qui le dérange, interprétant un testament obscur, consolant enfin un malheureux qui se plaint à lui de ses infortunes. Cette manière {p. 204}de procéder était si anormale que les imitateurs de Phèdre s’en sont écartés, et l’on ne trouve que rarement reproduites dans les divers Romulus ces fables, dans lesquelles Phèdre fait agir ou parler son modèle.
Au contraire, si l’on regarde de quoi se composent les fables nouvelles, on voit que sur les trente (je dis sur les trente, parce que les fables ii et iv ne sont réellement que les épimythions de fables disparues), il y en a cinq, dans lesquelles Ésope est encore le principal personnage du récit. Ce sont les fables : Æsopus et scriptor, Pater familias et Æsopus, Æsopus et Victor gymnicus, Æsopus et Domina, et Æsopus et servus profugus ; on le voit dans ces fables bafouer un mauvais auteur qui se vante, engager un père à dompter la fougueuse nature de son fils, réprimer la jactance d’un athlète victorieux, se venger par son silence des mauvais traitements par lesquels une vieille coquette l’a châtié de sa franchise, engager enfin un esclave fugitif à réintégrer la maison d’un maître brutal. N’y a-t-il pas là une ressemblance frappante, qui trahit une origine commune ?
Mais ce n’est pas la seule ; les autres fabulistes anciens se renferment dans leur rôle. Phèdre, dans ses fables anciennes, se sépare encore d’eux. Par une habitude qui lui est particulière, et qu’en écrivant sa vie j’ai déjà signalée, il alterne ses fictions avec des récits d’événements, pareils à ceux qui, de nos jours, remplissent dans les journaux les colonnes consacrées aux nouvelles diverses ; c’est ainsi qu’il raconte le meurtre involontaire commis au temps d’Auguste par un père sur son fils, et la ridicule erreur du joueur de flûte Leprince, qui prend pour lui les honneurs rendus à l’empereur et se fait jeter la tête la première hors du théâtre. Précisément parce qu’elles n’ont pas le caractère de fables, les collections de fables issues de celles de Phèdre les laissent de côté. Au contraire, les fables nouvelles nous offrent des récits semblables : tels sont, par exemple, l’anecdote du soldat de l’armée de Pompée et l’histoire de la matrone d’Éphèse. N’y a-t-il pas là encore plus qu’un simple hasard ?
Enfin, quand j’étudierai les fables de Romulus, je montrerai que, si le plagiaire qui a pris ce pseudonyme a épuisé la collection de laquelle il les a tirées, cette dernière était elle-même due à un compilateur, qui s’était borné à mettre en prose celles qu’il {p. 205}avait empruntées au poète romain. Lors même qu’aucune des fables nouvelles ne se rencontrerait dans la collection de Romulus, on n’en pourrait tirer aucun argument contre leur authenticité ; car elles pourraient appartenir à celles que le compilateur a négligées ; si au contraire on voit que plusieurs des nouvelles ont indirectement servi de modèle au plagiaire, alors le doute n’est plus possible. Or, que l’on compare, et l’on remarquera que les huit fables nouvelles, qui dans les éditions sont intitulées : De Scrofa et Lupo, De Junone, Venere et aliis feminis, De Muliere et Marito mortuo, De Meretrice et Juvene, De Patre et filio sævo, De Simea et Vulpe, De Lupo et Bubulco, De Cornice et Ove, se retrouvent en prose parmi celles de Romulus.
Je pourrais faire valoir encore d’autres raisons. Après celles que je viens d’exposer, je ne les crois pas nécessaires et je les néglige. Le bon sens public a d’ailleurs réagi contre les doutes que Heyne et Adry avaient trop légèrement formulés. Les Allemands eux-mêmes ont si bien compris qu’ils n’étaient pas fondés, que non seulement dans la plupart de leurs éditions de Phèdre ils n’ont pas cessé de publier les fables nouvelles à la suite des anciennes, mais qu’ils ont encore continué à faire des nouvelles des éditions spéciales, qui sont en quelque sorte le désaveu implicite de leurs prétendues incertitudes. C’est ainsi qu’elles ont, isolées des autres, paru à Heidelberg et à Spire en 1822, à Trente en 1827, à Stuttgart en 1834 et à Berlin en 1868.
En somme, aujourd’hui les doutes sont presque entièrement dissipés, et dans les éditions du fabuliste romain les fables nouvelles sont placées à la suite de celles de Gude, quelquefois sous le titre ambigu Fabulæ Phædro attributæ, mais plus souvent sous la simple rubrique Appendix, qui semble contenir l’aveu de leur triomphe définitif.
Chapitre IV.
Éditions des fables de Phèdre. §
Dans ce dernier chapitre sur Phèdre je devrais peut-être énumérer toutes les éditions et toutes les traductions de ses fables. Mais le nombre en est infini. De plus, Schwabe dans sa seconde édition et Gail dans celle de la collection Lemaire ont essayé d’en donner une nomenclature complète, arrêtée par l’un à l’année 1806 et poussée par l’autre jusqu’à l’année 1822. Comme leurs deux éditions sont dans toutes les mains, je crois pouvoir m’abstenir de mentionner celles qu’ils ont déjà signalées. Je me bornerai jusqu’à l’année 1822 à indiquer celles qu’ils ont omises, et à partir de 1822 à faire connaître, aussi complètement que je le pourrai, celles qui ont paru jusqu’à nos jours.
Pour procéder avec ordre, je vais diviser ce chapitre en deux sections, consacrées ; la première aux éditions qui ne contiendront que le texte latin, la seconde à celles dans lesquelles le texte latin sera accompagné d’une traduction.
Section I.
Éditions du texte latin. §
1713. §
Phædri Fabulæ, quibus adjiciuntur Fabulæ Græcæ et latinæ, ex variis Authoribus, cura T. Dyche. Seconde édition. In-12.
1721. §
Phædri Augusti Liberti et Avieni fabulæ cum adnotationibus Davidis Hoogstratani. Accedunt Fabulæ Græcæ Latinis respondentes et Homeri Batrachomyomachia. In usum scholarum Seminarii Patavini. Patavii, Ex Typographia Seminarii. Apud Joannem Manfrè. Superiorum permissu, et Privilegio (1721, 1732, 1740, 1745, 1750, 1769, 1775 Venetiis, Remondini, 1815 Venetiis, Bernardi). In-18 de 232 pages, précédées de 5 feuillets non paginés contenant une gravure au verso du premier, une dédicace aux élèves du Séminaire et la table.
Corpus omnium veterum poetarum latinorum tam prophanorum quam ecclesiasticorum ; cum eorum, quotquot reperiuntur, fragmentis. Tomus I. Londini, prostant vero Hagæ Comitum, apud Isaacum Vaillant. 2 vol. in-fº grand format, à 2 col., composés, le premier, de 6 feuillets non paginés suivis de feuillets paginés de 1 à 803, et, le second, de feuillets paginés de 805 à 1752 et suivis de 6 non paginés occupés par un Index poeticus universalis et de 4 non paginés occupés par les Omissa.
Le premier des deux volumes, p. 786-799, renferme la vie de Phèdre par Scheffer et ses fables.
1728. §
Phædri fabulæ, with English Notes by William Willymot. Londres. In-8º.
1729. §
Phædri Augusti liberti et Avieni fabulæ cum annotationibus Davidis Hoogstratani. Accedunt fabulæ Græcæ Latinis respondentes. Et Homeri Batrachomyomachia cum latina versione Recens addita. Expensis Josephi Ponzelli. Patavii, apud Joannem Manfrè. Superiorum permissu. In-12 de 241 pages numérotées, précédées de 10 non numérotées et suivies de 3 dernières pages occupées par l’Index.
1732. §
Phædri Augusti Cæsaris liberti fabularum Æsopiarum libri V. {p. 208}Nova editio emendata, Notis Gallicis selectissimis, Appendice ad ejusdem Fabulas, Publii Syri, aliorumque Veterum Sententiis aucta. Parisiis, sumptibus Fratrum Barbou. In-12 de vi-162 pages.
1741. §
Phædri Augusti Liberti Fabularum Æsopiarum Libri V. Cum annotationibus Leonardi Targionii in usum scholarum. Editio quarta auctior et emendatior. Cum indice et Italica explicatione præcipuorum Vocabulorum et Phrasium. Puerili Institutioni nullus magis Scriptor convenit. Jo. Lud. Prasch. in Fab. Phædri. Venetiis, Apud Simonem Occhi. Superiorum facultate (1780). In-18 de 132 pages chiffrées, ne contenant que le texte de Phèdre.
1755. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, in gratiam studios. juvent. notis illustr. cura Dav. Hoogstratani. Amstelædami. In-8º.
1764. §
Phædri Liberti Augusti fabulæ. Ad optimam quamque editionem emendatæ. Ad usum Collegiorum Lugdunensium. Accesserunt notæ ad calcem. Lugduni, apud fratres Perisse. In-12 de 86 pages précédées de 8 pages non numérotées.
1765. §
Phædri fabulæ. P. Syri sententiæ. Faerni fabularum libri quinque. Nova editio, cui accesserunt notæ Gallicæ ad usum scholarum accommodatæ. Parisiis, apud Barbou, via Mathurinensium. In-12.
1766. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V et novarum fabularum appendix. Cur. et studio Petri Burmanni. Berolini, Reimer. In-12.
1771. §
LXXIII auserlesene Fabeln Phædri sammt einer daraus gezogenen Sylloge Vocabulorum, und Sammlung der vornehmsten {p. 209}Phrasium und Sententiarum, den ersten Anfängern in der lat. Sprache zum Besten mit Vocabular. Herausgegeben von Joh. Jac. Schatz. Jena, Croeker. In-8º.
1773. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, recens. suasque adnotatt. adj. Jh. Mch. Heusinger. Eisen. In-8º.
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, cum commentario Petri Burmanni. Ulm. In-8º maj.
1776. §
Phædri Augusti Cæsaris liberti fabularum libri quinque. Carpentorati. In-8º.
1777. §
Phædri selectæ fabulæ (xxxiv) ad usum scholarum. Selectas interpret. animadvers. suasque adj. Hnr. Braun. Münch. In-8º.
1778. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, ex recens. Burmanni ; acced. novarum fabularum appendix. Wien, Wimmer. In-8º.
1783. §
Phædri Fabulæ, with an Ordo, English Notes, and a copious Parsing and Construing Index by N. Bailey. Dublin. In-8º.
1785. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri quinque, cum notis gallicis. P. Syri sententiis parallelisque fabulis… Parisiis, Barbou. In-12.
1786. §
Phædri, etc., Ed. J. G. Müller. Moguntii. In-8º majore.
1793. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, recte tandem captui {p. 210}puerorum accommodati. Mit Noten deutsch u. latein. Registern v. Em. Sincerus. Frankf. a. M., Brönner. In-8º.
Phædri, etc…, ad usum scholarum piarum. Warschau. In-12.
1799. §
Fables choisies de Phèdre et de Faerne et autres pièces relatives à la morale, présentées aux jeunes étudiants dans l’ordre qui doit leur être le plus utile (par Depons, professeur de langues anciennes à l’école centrale du Puy-de-Dôme). Riom et Clermont, Landriot et Rousset, an VII. In-12 de 203 pages.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, ex rec. Petr. Burmanni. Würzeburgi, Stahel. In-8º.
Phædri, etc., mit grammat. u. erklärt Anmerkgn. von Chr. H. Paufler. Leipzig, H. Fritzsche (1826). In-8º maj.
1805. §
Phædri fabulæ Æsopiæ ad opt. edit. coll. juvenumque instruct. accomm., quibus append. tripart. fabularum Aviani et Anonymor. veter. addita est ; c. J. J. Bellermann. Erford. In-8º.
Phædri Augusti Liberti Fabulæ cum adnotationibus ad usum scholarum. Mediolani, Apud Jacobum Agnelli Successorem Marelli. In-12 de 96 pages contenant les fables anciennes de Phèdre et les cinq restituées par Gude.
1806. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, ex opt. recens. iuventuti ed. cur. et quadripartita fabular. appendice ad comparandum instr. Guil. Leps. Posnon., Kühn. In-8º.
1807. §
Phædri Augusti Liberti Fabularum Æsopiarum Libri V. Cum annotationibus Leonardi Targionii ad usum scholarum. Editio decima auctior et emendatior, Cum Indice tum Latino, tum Italico præcipuorum Vocabulorum et Phrasium. Puerili institutioni nullus magis Scriptor convenit. Jo. Lud. Prasch. in fab. Phædri. Venetiis, Apud Simonem Occhi. Superiorum facultate. (Florence 1834, 1855). In-24 de 144 pages, contenant le texte de Phèdre, {p. 211}un Index præcipuorum Vocabulorum et Phrasium quæ in his Phædri fabulis continentur, cum Italica eorumdem explicatione, et un Index fabularum.
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri quinque. Cum notulis gallicis in loca difficiliora. Parisiis. In-12.
Phædri fabularum libri V, quibus accedunt fabulæ xxxiv. Notulis instruxit E. F. C. Pertelius. Ansbaci. In-8º.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V. Acc. appendix fabularum a recentioribus apologorum auctoribus compositarum. Darmst. (Giessen, Heyer’s verl.). In-8º.
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, quibus acced. fabulæ xxxiv. In usum schol. adornavit notulisque ingenio acuendo inservientibus instruxit Euch. Ferd. Chr. Oertel. Onoldi. In-8º.
1808. §
Phædri fabulæ Æsopiæ novissime recognit. et emendatæ. Wien. In-8º maj.
Jul. Phædri fabularum liber novus e ms. cod. Perottino regiæ bibliothecæ nunc primum edit J. A. Cassittus. Editio L exemplarium. Neapoli, Dominicus Sangiacomo. In-8º de 8 et 23 pages.
1809. §
Codex Perottinus MS. regiæ bibliothecæ Neapolitanæ Duas et triginta Phædri fabulas iam notas, totidem Novas, sex et triginta Aviani vulgatas, et ipsius Perotti carmina inedita continens, Digestus, et editus a Cataldo Jannellio eiusdem regiæ bibliothecæ scriptore, qui variantes etiam Lectiones adposuit ; tum deficientes et corruptas tentavit. Neapoli, 1809, ex regia typographia. In-8º.
Phædri, Augusti liberti, fabularum Æsopiarum libri quinque et novarum fabularum appendix. Ad usum scholarum. Hannov., Hahn’s Hofb. In-8º.
1811. §
Phædri fabulæ ex codice Perottino ms. regiæ bibliothecæ Neapolitanæ emendatæ, suppletæ, et commentario instructæ a Cataldo Jannellio eiusdem bibliothecæ scriptore. Præfixa est de Phædri {p. 212}vita dissertatio. Neapoli, typis Dominici Sangiacomo. Præsidum venia. In-8º de 64 et 296 pages.
Julii Phaedri Aug. Lib. Fabvlae ineditae xxxii Qvas in codice Perottino Biblioth. regiae Neap. primvs invenit descripsit edidit Joannes Antonivs Cassittvs elector ex colleg. possessor, in r. vtrivsque Siciliae reg. societ. Georg. Academ. Italicae atque Pontanianae sodalis ordinarivs. Editio tertia. Neapoli, CIƆ IƆ CCCXI. Ex officina Monitoris vtr. Siciliæ. In-8º de 75-92-107 pages, comprenant : 1º Cassittus lectori (p. 3 à 5), Index (p. 6), Juli Phaedri fabvlae a Cassitto repertae (p. 7 à 29), Parafrasi in vario metro Italiano delle nvove favole di Fedro trovate da Gio. Ant. Cassitto da lui stesso eseguita (31 à 75) ; 2º Emendationes novissimae in Phaedrum Cassittianum (p. 3 à 6), Vindiciae priores Phaedri Cassittiani (p. 7 à 15), Coniecturae de Polybio qui et Phaedrus (p. 16 à 40), Chronologia fabvlarvm Phaedri (p. 41 à 92) ; 3º Cassitti parva scholia (p. 1 à 88), Judicia virorum illustrium (p. 89 à 107).
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, cum appendice fabularum. Mit Anmerkungen und einem vollständigen Wörtregister für Schulen. Herausgegeben von K. F. A. Brohm. Berl. (1817, 1823, 1832, et 1850). In-8º.
1812. §
Phædri, Augusti liberti, fabularum Æsopicarum libri V, nova editio, cui accesserunt Publii Syri et aliorum veterum sententiæ ; editio stereotypa. Paris, P. Didot l’aîné et F. Didot (1813). In-18 de 3 feuilles.
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopicarum libri V, cum numeris ad explanandam verborum constructionem accommodatis. Avignon, Aubanel (1819). In-18 de 2 feuilles et demie.
Fabulæ selectæ e J. Phædro, Cæs. Augusti liberto ; cum notis et emendationibus, quas in usum Scholæ Genevensis edidit C. Malan. Genève, Mauget. In-12 de 6 feuilles et demie.
Phædri, Augusti liberti, fabularum Æsopicarum libri V, cum notulis Gallicis in loca difficiliora ; curante C. P. Lutetiæ Parisiorum institutore. Paris, Belin (1813, 1822, 1825, 1832). In-18 de 3 feuilles 5 sixièmes.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V ; cum notis gallicis, {p. 213}Publii Syri sententiis, parallelisque fabulis Joannis de La Fontaine. La Flèche, Delafosse. In-12 de 6 feuilles et demie.
Phædri Augusti liberti fabellæ novæ duo et triginta ex codice Perottino regiæ bibliothecæ Neapolitanæ, juxta editionem Cataldi Jannellii. Parisiis, apud Ant. Aug. Renouard. In-12 de 2 feuilles un tiers.
Julii Phædri Augusti liberti fabulæ triginta nuperrime detectæ e manuscripto codice r. bibliothecæ Neapolitanæ, cum notis. Mediolani, typis F. Fusii et socior. In-folio de 80 pages.
Phædri fabellæ novæ duo et triginta ex codice Perottino reg. bibliothecæ Neapolitanæ, juxta editionem Cataldi Jannellii. Patavii. In-12.
Q. D. B. V. Novi Prorectoratus auspicia die viii Februarii 1812 rite capta civibus indicit Academia Jenensis. Insunt Phædri quæ feruntur fabulæ xxxii in Italia nuper repertæ nunc primum in Germania editæ adjunctis Dorvillii et Burmanni emendationibus. Ex officina Caroli Schlotteri. In-folio de 12 pages.
Noviter detectæ Phædri fabulæ triginta ex manuscripto bibliothecæ regiæ Neapolitanæ codice nuperrime editæ ; ad commodiorem lectitantium usum hanc in formam recusæ. Stuttgartiæ et Tubingæ, apud J. G. Cottam (1834). In-18 de 46 pages.
Julii Phædri Fabulæ novæ et veteres : novæ, juxta collatas Cassitti et Jannellii editiones Neapoli nuper emissas, cum selectis ex utriusque commentario notis ; veteres juxta accuratissimam editionem Bipontinam, cum selectis doctissimi viri Schwabe ex commentario notis. Parisiis, H. Nicolle. In-8º de 13 feuilles un quart.
1813. §
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopicarum libri V, cum notulis gallicis in loca difficiliora. Toulouse, Douladoure. In-18 de 3 feuilles.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, cum notis gallicis, P. Syri sententiis parallelisque fabulis Joannis de La Fontaine, juxta G. Brotier sextam editionem : editio nova. Limoges, Ardant. In-12 de 8 feuilles.
Phædri Augusti liberti Fabularum Æsopicarum libri V. Paris, Belin. In-18 de 4 feuilles.
{p. 214}Phædri Aug. lib. fabularum libri V, cum notis gallicis, Faerni fabulis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editionem G. Brotier ; nova editio. Accedunt xx fabulæ Phædro attributæ, e codice Perottino desumptæ, ad usum scholarum accommodatæ ; curante N. L. Achaintre. Paris, Delalain (1822, 1824, 1827, 1830, 1832 sans addition, et 1833, 1834, 1837, 1841 avec les fables de Faerne et les Sentences de P. Syrus). In-12 de 10 feuilles.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V cum appendice. In commod. stud. iuvent. recogn., introductionem de auctoris vita, scriptis et usu agentem, nec non Joach. Camerarii libellum de vita Æsopi præmisit, notas crit. et æsthet. adiecit Fr. Nik. Titze. Pragæ, Widtmann. In-8º.
Phædri Augusti Liberti fabularum Æsopiarum libri V. Accedunt fabulæ Flavii Aviani, Anonymi Neveleti, Romuli et Anonymi Nilantii. Patavii, Typis Seminarii. In-8º.
1814. §
Phædri Augusti liberti fabulæ. Nova editio, cæteris emendatior ; cum notis gallicis et dictionario. Angers, Pavie. In-8º de 5 feuilles.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, et novarum fabularum ex ms. Divionensi appendices duæ. Norimbergæ, Riegel et Wiessner (1773). In-12.
1815. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, cum notis gallicis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editionem G. Brotier. Lille, Lefort (1823). In-12 de 6 feuilles.
1816. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V. Cum notis gallicis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta G. Brotier sextam editionem : editio nova ad usum scholarum Academiæ Lugdunensis. Lyon, Cabin. In-12 de 7 feuilles et demie.
1817. §
Phædri fabularum Æsopicarum libri V. Notulas gallicas addidit {p. 215}A. Thiel, in collegio regio Metensi professor. Accedunt fabulæ a de La Fontaine imitatæ ; P. Syri sententiae ; Faerni fabulæ centum. Metz, veuve Thiel et L. de Villy (1833, Lamort). In-12 de 9 feuilles un tiers.
Phædri Aug. lib. fabularum Æsopicarum libri V, et P. Syri aliorumque vett. sententiæ ex recensione Bentleji passim codicum manuscriptorum auctoritate nec non metri et rhythmi musici ope. reficta. Præmissa est dissertatio de rhythmo musico a veteribus Romanis etc. Additum est Glossarium scholarum usui accommodatum a Conrado Gtlo. Anton. Post mortem patris ed. Carolus Theophilus Anton. Zittaviæ et Lipsiæ, Schöps. In-8º de xxxiv et 148 pages.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, ex recens. R. Bentleji. Ictus per accentus expressi sunt discent. commodo. Berolini, Rücker et Püchler. In-8º.
1818. §
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopicarum libri V. Nova editio cui accesserunt Publii Syri et aliorum veterum sententiæ ; ad usum scholarum. Avignon, F. Seguin. In-18 de 2 feuilles.
Phædri Augusti liberti fabulæ. Notis gallicis, numerisque vocabulorum seriem indicantibus, illustraverunt D. D. Lallemant, Dictionarii gallico-latini auctores. Decima editio ceteris emendatior, ad usum scholarum. Paris, Aug. Delalain (1842). In-18 de 3 feuilles deux neuvièmes.
1819. §
Fabulæ Phædri selectæ, gallis versibus redditæ a domino de La Fontaine, ad usum collegiorum. Toulouse, Bellegarrigues. In-18 de 2 feuilles deux tiers.
1820. §
Phædri Augusti liberti Fabularum Æsopicarum libri V, ed. stereotypa. Brunsvigæ, Reichard. In-8º.
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri V, ad ed. Burmanni. Leyden, Luchtmans. In-12.
1821. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, juxta editionem {p. 216}G. Brotier ; cum P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine. Additæ sunt notæ gallicæ ad usum studiosæ juventutis, diligenter elaboratæ. Poitiers, Et. P. J. Catineau. In-18 de 6 feuilles.
1822. §
Phædri Augusti liberti fabularum libri V. Acced. 1º Vocabularium latino-german., etc., 2º Index personarum alphab. Coloniæ, Rommerskirchen. In-8º.
Julii Phædri fabulæ nuper publicatæ in Italia quas emendatius edidit animadversionibusque instruxit Fridericus Henricus Bothe. Heidelbergæ et Spiræ, August. Oswald. In-12.
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri V, ad optimorum libror, fidem accur. editi. Editio stereotypa. Leipz., Tauchnitz. In-12.
Fabulæ Æsopiæ. Acced. J. Phædri et Aviani fabulæ, P. Syri sententiæ et Dyonis. Catonis Disticha, cur. G. H. Lünemann. Gottingæ, Deuerlich (1823). In-8º.
1823. §
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri V. Paris, Jules Didot aîné. In-folio de 30 feuilles, tiré à 125 exemplaires.
Phædri Augusti liberti fabularum libri V, cum notis gallicis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editionem G. Brotier. Nova editio : accedunt viginti fabulæ Phædro attributæ, e codice Perottino desumptæ et ad usum scholarum accommodatæ, curante Gouriet. Tours, Mame (1826, 1833). In-12 de 7 feuilles.
Phædri, Aug. liberti, fabularum libri V, cum notis gallicis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editiones recentiores. Paris, Detrez. In-12 de 10 feuilles et demie, comprenant les fables de Faerne.
1824. §
Phædri Augusti liberti fabulæ. Nova editio studiose emendata, notis gallicis et optimis fabulis antiquorum scriptorum utiliter ditata. Ad usum collegiorum Lugdunensium. Lyon, Perisse, et Paris, Méquignon junior. In-18 de 3 feuilles un sixième.
{p. 217}Phædri Aug. lib. fabularum libri V cum notis gallicis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editionem G. Brotier. Paris, Carez (1825). In-12 de 8 feuilles et demie.
Phædri fabul. Æsopiar. libri V, ad opt. libr. fidem accur. editi. Heilbronnæ, Class. In-8º.
Phædri etc., mit Anmerkgn, u. einem vollständ. Wortregister, worin alle vorkommende Wörter erklärt werden, für Schulen. 2. Aufl. von W. Lange. Halle, Schwetschke u. Sohn. In-8º.
Phædri, etc. Mit einem vollständigen Special-Lexicon für Schulen, herausgegeben von H. L. J. Billerbeck. Hannov., Hahn (1833, 1838). In-8º.
1825. §
J. Phædri, C. Aug., Romanor. imper., liberti, fabulæ, in quatuor libros æquo divisæ, ab omni genere obscenitatis expurgatæ, ad intelligentiam tironum difficultatibus gradatim expositis quam accuratissime cum notis gallicis accommodatæ, editore et auctore J. S. J. F. Boinvilliers. Sexta editio. Paris, Delalain. In-12 de 9 feuilles un tiers.
Phædri fabular. Æsop. libri V, cum notis et emend. Fr. J. Desbillons ex ejus comment. pleniore desumptis. Ed. et animadvers. adjecit. F. H. Bothe. Manhemii, Löffler (1786). In-8º.
Phædri Aug. Liberti Fabularum Æsopiarum libri V. Oder, etc. Magdebourg. In-18. Édition accompagnée de notes allemandes.
1826. §
Phædri Aug. Lib. fabul. Æsop. libri V, cum appendice duplici. Acced. et Aviani et Faerni fabulæ. Accurate edid. ictibusque metricis instrux. C. H. Weise. Editio stereotypa. Lipsiæ, C. Tauchnitz (1829, 1843, 1866 Holtze). In-12.
Phædri fabularum Æsopiarum libri V cum selectis variorum anctorum fabulis et locis ad idem genus pertinentibus, ad usum nobilis juventutis regio sumptu institutæ. Paris, Maire-Nyon (1835). In-12 de 11 feuilles.
Phædri fabularum Æsopiarum libri V, quales omni parte illustratos publicavit Joann. Gottlob. Sam. Schwabe. Accedunt Romuli fabularum Æsopiarum libri quatuor quibus novas Phædri fabellas cum notulis variorum et suis subjunxit Joann. Bapt. Gail. Parisiis, {p. 218}Julius Didot. 2 vol. in-8º, le 1er de 37 feuilles un quart et le 2e de 41 feuilles un huitième.
1827. §
Phædri Aug. lib. fabularum libri V, cum Faerni fabulis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine. Accedunt viginti fabulæ Phædro attributæ, e codice Perottino desumptæ et ad usum scholarum accommodatæ. Paris, Belin-Mandar et Devaux. In-18 de 7 feuilles deux tiers.
Phædri Aug. lib. fabularum libri V. Ad optimorum codd. et edd. fidem recensuit et brevibus notis illustravit L. Quicherat : accedunt novæ fabulæ Phædro attributæ et gallicæ J. de La Fontaine imitationes. Paris, Hachette (1834, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1850). In-12 de 6 feuilles trois quarts.
Phædri fabular. Æsopiar. libri V. Edit. II. Arnstadt, Mirus. In-12.
Phædri fabul. æsop. libri V. Mit grammat. u. erklärt Anmerkk. v. L. Ramshorn. Leipzig, Leo (1846, Herm. Fritzsche). In-8º maj.
1828. §
Phædri fabulæ Æsopiæ, ad optim. libror. fidem editæ cum variarum lect. delectu et nondum vulgatis Desbillonii notis. Cur. Karl Zell. Stuttg., Hoffmann. In-8º.
Phædri etc. Mit einem Wortregister u. mit beständigen Hinweisungen auf Zumpts Grammatik, von Fr. Ad. Beck. Coblenz, Hergt. In-8º.
Phædri Avgvsti Cæsaris liberti Fabvlæ brevibvs illvstratæ adnotationibvs ad vsvm regiarvm scholarvm. Tavrini, Ex typographia regia. Cum Privilegio (1838). In-18 de 140 pages.
1829. §
Phædri Aug. lib. fabulæ. Nova editio, selectis P. Desbillons fabulis, notis gallicis et prosodiæ signis adornata. Lyon, Rusand (1817, 1851). In-18 de 3 feuilles 7 dix-huitièmes.
Phædri Aug. lib. fabularum libri V, cum Faerni fabulis, P. Syri sententiis, parallelisque fabulis J. de La Fontaine. Nouvelle édition suivie de notes grammaticales, etc. Par une société de professeurs et sous la direction immédiate de M. Em. Lisfranc. {p. 219}Paris, Belin-Mandar et Devaux. In-18 de 4 feuilles cinq sixièmes.
Phædri, Flavii Aviani et Anonymi fabulæ Æsopiæ. Accedunt P. Syri Mimi et Aliorum sententiæ, Dyon. Catonis Disticha ; omnia ad optimas editiones collata notisque brevioribus illustrata. Bruxellis, Tencé. In-18 maj.
Phædri fabulæ ex rec. Burmanni cum nova fabular, append. Sine notis. Halæ, Libr. orphan. (1755). In-8º.
1830. §
Quinti Horatii Flacci opera, ex optimis editionibus recensita et emendata. Paris, Renouard. In-8º de 21 feuilles un quart.
Cette édition contient aussi les fables de Phèdre.
Phædri Aug. lib. Fabular. Æsopiar. libros quatuor, ex codice olim Pithœano, deinde Peletteriano, nunc in bibliotheca viri excellentissimi ac nobilissimi, Lud. Le Peletier de Rosanbo, marchionis, paris Franciæ, amplissimo Senatui a secretis, cæt., cæt., Contextu codicis nunc primum integre in lucem prolato, Adjectaque varietate lectionis e codice Remensi, incendio consumpto, a dom. Vincentio olim enotata, cum prolegomenis, annotatione, indice, edidit Julius Berger de Xivrey. Parisiis, Ambrosius Firminus Didot. In-8º de 16 feuilles 5 huitièmes.
Phædri fabularum Æsopiarum libri quinque cum novis adnotationibus. Accedunt novæ Phædri fabellæ cum notulis variorum. Florentiæ, ex typis Borghi et soc. In-12 de 255 pages contenant la vie de Phèdre par Schwabe et le texte latin des fables anciennes et nouvelles.
1831. §
Phædri Aug. lib. fabulæ Æsopiæ. Prima editio critica cum integra varietate codd. Pithœani, Remensis, Danielini, Perottini et editionis principis, reliqua vero selecta. Acced. Cæsaris Germanici Aratea, etc., Pervigilium Veneris, etc., exactum ab Jo. Casp. Orellio. Turici, typis Orellii, Fuesslini et sociorum. In-8º de 243 pages.
Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum tomus III. Curante Angelo Maï. Romæ, typis Vaticanis. In-8º. Ce vol. contient, p. 278-314, les 32 fables nouvelles de Phèdre.
1832. §
Phædri fabula nova xxxii. E codice Vaticano redintegratæ ab {p. 220}Angelo Maio. Supplementum editionis Orellianæ. Accedunt Publii Syri codd. Basil. et Turic. antiquissimi cum sententiis circiter xxx, nunc primum editis. Turici, typis Orellii, Fuesslini et sociorum. In-8º de 60 pages.
1833. §
Phædri Aug. lib. Fabularum libri V, cum notis gallicis, fabulis novis Phædro attributis parallelisque fabulis J. de La Fontaine, juxta editionem Brotier, quibus accedunt P. Desbillons, Faerni fabulæ et P. Syri sententiæ. Lyon, Perisse (1835, 1858). In-18 de 8 feuilles.
Phædri Aug. liberti fabulæ. Ed. G. E. Weber, s. Corpus poetarum lat. unter : Poetæ.
Phædri fabulæ Æsopiæ. Nach Orelli’s Textes recension mit einem vollständ. Wortregister u. mit beständ. Hinweisungen auf die Grammatiken von Zumpt, Ramshorn u. Schulz zum Schulgebrauche herausgeg. Leipz., Brüggemann, jetzt Krappe. In-8º.
1834. §
Phædri Augusti Liberti fabularum Aesopiarum Libri V, ad exemplar Leonardi Targionii Sch. piar. Editio IV auctior et emendatior. Novis curis illustrata ad usum scholarum piarum. Florentiæ, typis calasanctianis (1855). In-12 de 144 pages, contenant les fables anciennes de Phèdre, une partie des nouvelles et les Publii Syri et aliorum veterum sententiæ.
Phædri Fabvlæ Qvæ exstant omnes ex recensione Io. Gottl. Sam. Schwabii cvm notis et indicibvs. Avgvstæ Tavrinorvm, ex typis Josephi Pomba. In-8º grand format de 466 pages, qui, n’étant que la réimpression partielle de la deuxième édition de Schwabe, comprend seulement : La vie de Phèdre, les trois Dissertations du Père Desbillons et la dissertation De eo quod pvlchrvm est in Phædro, le texte des fables de Phèdre anciennes et nouvelles, les 34 fables restituées par Gude et par Burmann, et celles du Romulus ordinaire.
1835. §
Phædri Aug. lib. fabularum Æsopiar. libri V, avec des remarques grammaticales et philologiques ; à l’usage des collèges et de {p. 221}ceux qui aspirent à l’agrégation. Par F. H. J. Albrecht. Paris, Firmin Didot frères, Hachette, Maire-Nyon. In-8º de 15 feuilles et demie.
1836. §
Classiques latins illustrés. Cornelius Nepos, Phèdre. Paris, Henriot. In-8º de 8 feuilles.
Phædri fabulæ Æsopiæ ad optim. libror, fidem editæ, adjectis præter fabulas Gudianas et Burmannianas fabulis novis xxx, ex integerrimo cod. Vaticano nunc primum suppletis in usum scholar., novum ictum metricum dipodias demonstrantem induxit, regulas grammaticorum Schulzii, Zumptii, Ramshornii prosodicas citavit, Lexicon plenam syllabarum quantitatem continens adjunxit Car. Joa. Hoffmann. Berolini, Libr. Plahn. In-8º.
1838. §
Phædri Aug. liberti fabulæ Æsopiæ cum veteres tum novæ atque restitutæ. Ad fidem codicum Pithœani, Remensis, Danielini et Perottini utriusque, quorum integra adjecta est varietas, et optimas editiones recognovit, lacunas explevit, versus a Nic. Perotto solutos refecit, fabulas a Marq. Gudio et Petro Burmanno in versiculos redactas locis plurimis emendavit, quas hic prætermisit, libro singulari comprehensas addidit Christianus Timotheus Dressler, etc. Accedunt Ugobardi Sulmonensis fabulæ Phædrianæ e codice Hæneliano et Duacensi cum utriusque varietate accurate editæ. Budissæ, in libraria Welleriana (1850, 1856). In-8º de xvi-207 p.
1839. §
Phædri Aug. lib. fabulæ. Nova editio selectis P. Desbillons fabellis, etc. Lyon, Pelagaud (1841, 1860, 1862, 1863, 1867, 1876). In-18 de 3 feuilles et demie.
Phædri fabulæ Æsopiæ selectæ. Monachii, libr. scholar. Regia. In-8º maj.
1840. §
Fabularum A. L. Phædri libri V. Nouvelle édition par A. de Savary. Paris, Maire-Nyon. In-12 de 12 feuilles et demie.
Phædri Aug. lib. fabular, libri V. Nouvelle édition d’après les {p. 222}meilleurs textes avec sommaire et notes en français par M. Vérien. Paris, Dezobry, E. Madeleine et Cie (1841, 1853). In-12 de 4 feuilles trois quarts.
1841. §
Phædri Aug. lib. fabular, libri V. Nova editio. Paris, Pillet aîné. In-12 de 7 feuilles.
Phædri fabulæ selectæ. Mit Anmerkgn. von J. R. Koene, s. C. Nepos.
Fedro. Le Favole con note italiane precedute da un discorso sulla favola e sui favolisti di Atto Vannucci. Alber Ghetti e C., Prato, tipografia Aldina (1853). In-8º de li-152 pages contenant une dissertation en langue italienne sur la Fable et les Fabulistes et le texte des fables anciennes de Phèdre enrichi de nombreuses notes.
1842. §
J. Phædri, Aug. lib., fabulæ veteres ex recensione Frid. Henr. Bothe ; edidit J. A. Amar. Paris, Leclère (1821). In-32 d’un quart de feuille.
1846. §
Phædri Aug. lib. fabul. libri V. Nova editio notis selectis illustrata, parallelisque fabulis J. de La Fontaine aucta, accurante N. A. Dubois in Academia Parisiensi professor. Ad usum soholarum. Paris, Delalain (1852, 1858, 1861, 1865, 1868, 1872, 1875, 1880, 1886). In-12 de 6 feuilles un sixième.
1847. §
Fables de Phèdre tant anciennes que nouvelles publiées par Angelo Maï et les fables correspondantes de La Fontaine, avec Notice et notes en français par M. F. Dübner. Paris, chez F. Didot et chez Lecoffre (1852, 1859, 1861, 1866, 1874, 1876). In-18 de 5 feuilles.
1848. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V. Ad opt. exemplaria recognov. et in usum scholar. ed. Geo. Aenoth. Koch. Accedunt fabulæ novæ xxx e cod. Perottino restitutæ. Editio stereotypa (Bibliotheca classica latina, II). Lipsiæ, Ph. Reclam. jun. In-8º.
1850. §
Phædri fabularum Æsopiarum libri V cum Publi Syri aliorumque veterum sententiis. Mit erklärenden Anmerkungen u. besondern grammat. Regeln zum Gebrauche der Studirenden Jugend von Ignatz Seibt. Prag. In-8º maj. v. 208 s.
1851. §
Phædri fabularum libri V cum fabellis novis. Nouvelle édition publiée avec des notes en français et suivie des imitations de La Fontaine et de Florian, par E. Talbert, etc. Paris, L Hachette et Cie (1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864, 1866, 1867, 1869, 1871, 1874, 1880, 1882, 1885, 1887). In-12 de 164 pages.
1853. §
Ausgewählte Fabeln des Phædrus erklärt von F. E. Raschig. Leipzig, Weidmann (Berlin, 1861 et 1871). In-8º v. viii-87 s.
Favole scette di Fedro corredate di note per cura del Prof. A. Lace approvate dal consiglio superiore, e dal ministero del l’instruzione publica ad uso delle scuole di grammatica lingua. Seconda edizione. Torino, Dalla stamperia reale. In-8º de 107 pages, contenant le texte latin de Phèdre divisé en 3 livres et suivi de longues notes en langue italienne.
1854. §
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri quinque cum argumentis et notis italicis et indice latinarum formularum. Brixiæ, typis Petri L. Gilberti bibliopolæ. In-12 de 112 pages numérotées, suivies de 4 pages intitulées : Indice.
1855. §
Phædri fabularum libri V. Nouvelle édition d’après les meilleurs textes, renfermant des notes historiques, grammaticales et littéraires en français, avec les Imitations de La Fontaine, une vie de l’auteur, une appréciation de ses œuvres et un précis sur les principaux fabulistes par M. Ch. Aubertin. Paris, E. Belin (1857, 1872, 1876, 1877, 1878, 1882, 1884, 1886). In-12 de 4 feuilles 1 sixième.
{p. 224}Phædri Augusti lib. fabularum libri V. Nouvelle édition d’après les meilleurs textes, avec une vie de Phèdre et les Imitations de La Fontaine et de Florian par L. W. Rinn. Paris, Dezobry, E. Madeleine (1858, 1860, 1862, 1865, 1866, 1867, 1875, 1877, 1878 ; Delagrave 1882, 1885). In-12 de 6 feuilles et demie.
Phædri Aug. lib. fabular. Æsopiar. libri V. Accedit fabularum novarum atque restitutarum delectus. Erklärt von C. W. Nauck. Berlin, Jonas’ Sorthdig. In-8º.
1856. §
Phædri Augusti liberti fabularum Æsopiarum libri V cum argumentis et notis italicis et indice latinarum formularum. Brixiæ, typis Petri L. Gilberti Bibliopolæ. In-12.
Le Favole di Fedro corredate di Spiegazioni e note italiane per cura di Carlo Gatti. Firenze, Felice Le Monnier. In-8º de 103 pages ne renfermant que les fables anciennes.
Phædri fabularum libri V, cum fabellis novis. Accessit appendix de diis. Nova ediçao, publicada com varias notas em portuguez, pelo J. I. Roquette. Paris, Aillaud, Monlon (Guillard Aillaud et Cie, 1879, 1882). In-18 de 6 feuilles.
1858. §
Phædri Aug. lib. fabularum libri. Édition classique précédée d’une notice littéraire par D. Turnèbe. Paris, J. Delalain (1864, 1867, 1871, 1874, 1876). In-24 de 96 pages.
1861. §
Phædri Aug. lib. fabularum libri V. Nouvelle édition avec des notes, un dictionnaire et les fables de La Fontaine en regard de celles qu’il a imitées de l’auteur latin, revue avec soin et corrigée par M. Tissot et par M. Morand. Limoges et Isle, Martial Ardant frères. In-32 de viii-254 pages.
1862. §
Phædri fabulæ Æsopiæ, cum notis. Pest, Lauffer’s Verlag. In-8º, v. 152 s.
{p. 225}1865. §
Phædri fabular. Æsopiarum libri V, et appendices fabularum iii. Ex ms. Divionensi, Rimicio, Romulo et codice Perottino, vestigiis Burmanni et Billerbeckii. Queis completum dictionarium latino-hungaricum accommodatum, curante Ferdinando Kovács. Pest, Heckenast’s Verlag. In-8º v. 334 s.
Phædri fabular. Æsopiar. libri V cum triplici appendice fabularum novarum. Für den Schulgebrauch ausgewählt u. mit einem Wörterbuche versehen von Otto Eichert. Hannover, Halm’sche Hofbuchh. In-8º maj. v. viii-133 s.
1867. §
Phædri fabulæ. Franc. Eyssenhardt recognovit. Berlin, Weidmann’sche Buchh. In-8º maj. v. 84 s.
1868. §
Phædri Aug. lib. fabulæ Æsopiæ. Recognovit et præfatus est Lucianus Mueller. Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri (1871, 1877, 1879). In-8º v. xiv-66 s.
Anthologia latina sive poesis latinæ supplementum. Carmina in codicibus scripta recensuit Alexander Riese. Lipsiæ, in ædibus B. G. Teubneri. In-18. Ce recueil de poésies latines contient les 32 fables nouvelles.
1870. §
Phædri, etc. Mit einem Wörterbuch für den Schulgebrauch hersg. von A. Schaubach. Ebend. In-8 v. xviii-120 s.
1871. §
Phædri fabulæ. Recensuit ac notis illustravit J. Lejard, in minori seminario Sagiensi professor. Tours, Poussielgue frères (1883, 1887). In-18 de xv-144 p.
1873. §
Phædri Aug. lib. fabularum libri V. Nouvelle édition, publiée avec des notes en français et un choix de fables du P. Desbillons, par un Père de la compagnie de Jésus. Paris et Lyon, Pelagaud fils et Roblot. In-18 de x-117 p.
{p. 226}Phædri Augusti liberti fabularum libri V. Nouvelle édition, publiée avec des notes en français et des fables choisies de Desbillons, par le P. H. Delavarenne, de la compagnie de Jésus. Paris, Albanel (1877). In-18 de x-117 p.
1877. §
Phædri Aug. liberti fabularum libri V. Édition classique, à l’usage des élèves de sixième avec des notes grammaticales, prosodiques, critiques et historiques, suivie d’un appendice contenant des rapprochements littéraires en diverses langues par Édouard Malvoisin. Paris, Baltenweck. In-18 de xi-154 p.
1878. §
Phædri Aug. lib. fabular. Esopiar. libri V, juxta editiones Brotier, Desbillons, Lemaire, Dressler, probatissimorumque Phædri interpretum, quibus accesserunt selectæ. P. Desbillons fabulæ. Tours, Mame et fils (1884, 1886). In-16 de 93 p.
1879. §
Phædri Aug. lib. fabular. libri V. Nouvelle édition, d’après les meilleurs textes, précédée d’une notice sur Phèdre, accompagnée d’un commentaire et de notes, suivie des imitations de La Fontaine, etc., et de thèmes d’imitation par M. A. Garon. Paris, Belin (1881, 1883, 1884, 1886, 1887). In-12 de xii-200 p.
1880. §
Phædri fabul. libri V. Nouvelle édition classique avec les fables de La Fontaine en regard par Ed. Rocherolles… Paris, Garnier frères (1882, 1883). In-18 jésus de vi-162 p.
Phædri Avgvsti liberti Fabvlarum Æsopiarvm libri qvinqve cvm adnotationibvs cvrante Oswaldo Berrinio. Stamperia reale di Torino di G. B. Paravia e comp. Editori-librai, Roma-Torino-Milano-Firenze. In-8º de 96 pages contenant les fables anciennes et vingt-deux des nouvelles.
1882. §
Fables de Phèdre. Nouvelle édition publiée par M. l’abbé {p. 227}Frette. Paris, impr. Lahure, libr. Palmé. In-18 jésus de viii-184 p.
Le Favole di Fedro. Testo annotato per le scuole da G. Rigutini. In Firenze, G. C. Sansoni editore. In-16 de xii-87 pages.
1883. §
Phædri Augusti liberti Fabularum libri. Édition classique précédée d’une notice littéraire par M. Deltour, inspecteur général de l’Instruction publique. Paris, impr. et libr. Delalain frères. In-18 de xvi-76 pages.
1884. §
Fables choisies de Phèdre. Nouvelle édition classique abrégée, graduée et annotée, contenant 50 fables, dont 30 avec les imitations de La Fontaine en regard, précédée d’une notice sur Phèdre et suivie d’un lexique par E. Darras, professeur à l’École Albert-le-Grand à Auteuil. Paris, lib. Gaume et Cie (1885), In-18 jésus de ix-144 pages.
1887. §
Le poesie di Fedro publicate per cura di Salvatore Concato. Bologna, Società tipografica Azzoguidi. In-8º grand format de 139 pages, contenant : 1º Studio sulla favola di Fedro (pages 7 à 95) ; 2º Le Poesie, comprenant seulement une partie des fables anciennes (pages 97 à 138).
Section II.
Éditions des traductions. §
§ 1. — Traductions françaises. §
Les fables de Phèdre affranchy d’Avgvste traduites en françois, avec le latin à costé. Pour servir à bien entendre la langue Latine, et à bien traduire en François. Septième édition reveüe et corrigée. A Paris, chez Claude Thiboust, libraire juré de l’Université, {p. 228}sur la terre de Cambray, devant le College des trois Evesques. In-24 de 122 feuillets numérotés, précédés de 10 et suivis de 6 non numérotés, contenant le texte des fables anciennes et la traduction en prose en regard.
Les fables de Phèdre affranchy d’Avgvste, Traduites en François avec le Latin à côté. Pour servir à bien entendre la Langue Latine, et à bien traduire en François. Cinquième édition. A Lyon, chez F. Larchier, proche l’hôpital. Avec Permission. In-12 de 153 pages, suivies de 6 pages de table non numérotées.
Les Fables de Phèdre affranchy d’Avgvste traduites en François avec le Latin à côté, etc. Sixième édition. A Lyon, chez Antoine Molin, vis-à-vis le grand Collège. Avec permission. In-12 de 153 pages, suivies de 6 pages de table non numérotées. Réimpression de la précédente édition.
Les Fables de Phèdre affranchy d’Avgvste, tradvites en françois avec le latin à côté. Pour servir à bien entendre la langue Latine et à bien traduire en François. A Avignon, chez François Mallard, Imprimeur de l’Université et Marchand libraire. A la place S. Didier.
Phædri fabulæ et P. Syri Mimi sententiæ. Hac sexta Editione auctiores, cum Notis et Emendationibus Tanaquilli Fabri. Accedit et Gallica Versio fere de novo reficta. Hagæ Comitum, apud Petrum Gosse. In-12 de xxiv-274 pages, contenant une préface, la vie de Phèdre, les jugements des auteurs modernes, le texte du fabuliste et les fables restituées par Gude accompagnés d’une traduction en prose française en regard, et les sentences non traduites de A. Sénèque et de Syrus Mimus. Cette édition, quoique citée par Schwabe, est mentionnée ici, parce qu’il n’en a donné qu’une analyse inexacte, notamment en la prétendant sans nom de libraire.
Les fables de Phèdre, affranchy d’Auguste, traduites en François {p. 229}avec le latin à côté… A Rouen, chez Sébastien de Caux, rue des Jésuites. In-36.
Les Fables de Phèdre, affranchi d’Auguste, traduites en françois, augmentées de huit fables qui ne sont pas dans les Éditions précédentes, expliquées d’une manière très facile. Avec des remarques… A Paris, chez Paul Denis Brocas. In-12 de 467 pages, précédées de 12 feuillets non chiffrés.
Les fables de Phèdre, affranchi d’Auguste, en latin et en françois. Nouvelle traduction, avec des remarques, dédiée à Mgr le Duc de Bourgogne. Rouen, Rich. Lallemant. In-12.
Fables de Phèdre, affranchi d’Auguste, traduites en français avec le texte à côté, et ornées de gravures. Paris, P. Didot l’aîné. 2 vol. in-12.
Fables de Phèdre, divisées en quatre livres égaux, enrichies de notes et traduites en français, conformément à l’édition latine donnée en faveur des étudiants, avec les suppressions commandées par la décence. Par J. E. J. F. Boinvilliers. Paris, Delalain (1818, 1820). In-12.
Les Fables de Phèdre, avec la traduction interlinéaire par M. Maugard, professeur de langues anciennes et modernes. Paris, 1º C. Joyant, 2º Tardieu-Denesle et Cie. In-8º de 18 feuilles.
Nouvelles Fables de Phèdre, traduites en vers italiens par M. Petronj et en prose française par M. Biagioli…, et précédée[s] d’une préface française par M. Ginguené. Paris, P. Didot l’aîné. In-8 de 16 feuilles et demie.
Traduction en vers français des fables complètes de Phèdre, et des trente-deux nouvelles fables publiées d’après le manuscrit de {p. 230}Perotti ; avec le texte en regard et des notes. Paris, Louis Duprat-Duverger. In-8º de 24 feuilles.
Fables de Phèdre, traduites en vers français et précédées d’une Épître à un écolier de sixième. Paris, Duprat-Duverger. In-18 de 5 feuilles.
Fables de Phèdre, traduction nouvelle avec des notes, par M. l’abbé Paul, ancien professeur d’éloquence de l’Académie de Marseille. Lyon, Tournachon-Molin. In-12 de 11 feuilles et demie.
Les Fables de Phèdre affranchi d’Auguste, traduites en français. Dernière édition, revue et augmentée. Avignon, J.-A. Joly. In-18 de 5 feuilles.
Fables complètes de Phèdre affranchi d’Auguste, traduites par Auguste de Saint-Cricq, avec le texte en regard. Paris, Égron. In-8º de 20 feuilles.
Traduction et examen critique des fables de Phèdre comparées avec celles de La Fontaine, par M. Beuzelin père, ancien chef d’Institution à Paris ; ouvrage revu et continué par l’abbé Beuzelin, officier de l’Université, Proviseur du collège royal de Limoges… Paris, Belin-Mandar. In-8º d’un quart de feuille.
Fables de Phèdre, traduction nouvelle avec des notes. Par M. l’abbé Adolphe Masson, professeur dans l’Académie de Paris. Paris, Brunot-Labbé. In-12 de 8 feuilles 5 sixièmes.
Fables anciennes et nouvelles de Phèdre, traduites en français avec le texte en regard revu sur les meilleures éditions. Par M. G. Duplessis, inspecteur de l’Académie royale de Caen. Paris, Maire-Nyon. In-12 de 11 feuilles.
Fables de Phèdre, latin-français, traduction de l’abbé Paul. {p. 231}Nouvelle édition adaptée à celle de Brotier, augmentée de la traduction des nouvelles fables attribuées à Phèdre, et suivie des fables imitées par La Fontaine. Paris, Delalain (1837). In-12 de 10 feuilles 5 sixièmes.
Fables de Phèdre, affranchi de l’empereur Auguste ; traduction fidèle et littérale en vers français avec le texte en regard. Par M. Bouriaud aîné… Seconde édition… Paris, L. Hachette, et Limoges, Ardant (1re édition, 1819). In-12 de 11 feuilles.
Nouvelles Fables attribuées à Phèdre, latin-français. Traduction nouvelle. Par M. Genouille. Paris, Aug. Delalain. In-12 d’une feuille 1 tiers.
Fables de Phèdre. Traduction nouvelle par M. Ernest Panckoucke. Paris, C.-L.-F. Panckoucke (1839, 1864, 1877). In-8º de 25 feuilles.
Fables de Phèdre, expliquées en français suivant la méthode des collèges, par deux traductions, l’une littérale et interlinéaire, avec la construction du latin dans l’ordre naturel des idées, l’autre conforme au génie de la langue française ; précédées du texte pur et accompagnées de notes explicatives, d’après les principes de MM. de Port-Royal, Du Marsais, Beauzée et des plus grands maîtres. Par E.-L. Frémont. Paris, Delalain. In-12 de 11 feuilles.
Fables de Phèdre, en latin et en français, avec version interlinéaire en regard. Nouvelle édition conforme à celle de Brotier, augmentée : 1º d’un double appendice, etc., etc., par V. Parisot. Paris, Poilleux. In-12 de 17 feuilles 1 sixième.
Le Phèdre de la Jeunesse, ou traduction en vers des fables de Phèdre ; par M. Boyer-Nioche. Paris, Igonette (1843). In-18 de 5 feuilles.
Œuvres complètes d’Horace, de Juvénal, de Perse, de Sulpicia, de Turnus, de Catulle, de Properce, de Gallus et Maximien, {p. 232}de Tibulle, de Phèdre, de Syrus, avec la traduction en français ; publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, Dubochet (1850). In-oct. maj. de 52 feuilles et demie.
Traduction des fables de Phèdre, précédée d’une notice sur la vie et les œuvres de ce poète, par A. de Chevallet. Paris, Ebrard. In-18 de 6 feuilles.
Fables de Phèdre, traduites en français avec le texte latin en regard et des notes par M. D. Marie (1858, 1882, 1886). Paris, Hachette. In-12 de 4 feuilles 1 sixième.
Fables de Phèdre. Traduction nouvelle en vers français, texte en regard par M. A. Scribe. Paris, Dezobry, E. Madeleine et Cie, Comptoir des imprimeurs unis, et Moreau. In-12 de 13 feuilles et demie.
Fables de Phèdre, traduites en vers par Hippolyte d’Aussy (de Saint-Jean d’Angely). Saint-Jean d’Angely, Sandeau. In-8º de xii-112 pages.
Traduction en vers français des хххii nouvelles fables attribuées à Phèdre, d’après le manuscrit de Perroti, par M. J. H. Rossand. Saint-Étienne, Théolier (1858). In-8º de 46 pages.
Fables de Phèdre. Traduction en vers français par M. C. Macaigne, professeur. Première partie : livres I et II. Château-Thierry, Renaud. In-16 de 86 pages.
Fables de Phèdre, latin-français en regard. Traduction nouvelle par A. Lebobe, ancien professeur. Paris, Jules Delalain et fils. In-12 de 148 pages.
Les auteurs latins expliqués, d’après une méthode nouvelle, par deux traductions françaises, l’une littérale et juxta-linéaire présentant le mot à mot français en regard des mots latins correspondants, l’autre correcte et précédée du texte latin avec des sommaires et des notes par une société de professeurs et de latinistes. Phèdre, Fables. Paris, librairie Hachette et Cie. In-12 de iv-236 pages.
Fables de Phèdre, traduites en vers par Mmes Nancy Mary Lafon. Paris, C. Lévy. In-18 de viii-184 p.
Fables de Phèdre anciennes et nouvelles, éditées d’après les manuscrits et accompagnées d’une traduction littérale en vers libres par Léopold Hervieux. Paris, E. Dentu. In-18 de l-258 pages.
Fables classiques de Phèdre, vers pour vers, principalement suivant l’édition petit in-18 de Jules Delalain, par Domeck, chef d’institution. Paris, librairie Didier et Cie. In-18 jésus de xix-67 pages.
§ 2. — Traductions allemandes. §
Phæders, Æsopische Fabeln ganz deutsch mit lat. Anmerkgn. Halle, Renger. In-12.
— Æsopische Fabeln neu übers, von Frz. Xav. Sperl. Grätz, Ferstl. In-8º.
— Neu entdeckte Fabeln. Aus dem Latein, übers, v. C. Ant. Gruber v. Grubenfels. Mit den Latein. Texte u. Anmerkgn. Wien, Gerold. In-12.
— Æsopische Fabeln metr. übers, v. J. L. Schwarz. Halle, Schimmelpfennig. In-8º maj.
— Æsopische Fabeln in Trimetern übers, von Ch. Alb. Vogelsang. Leipzig, Steinacker (1823). In-8º maj.
— Æsopische Fabeln im Versmasse des Originals übers. von Fried. Heinzelmann. Salzwedel (Magdeburg, Creutz). In-8º maj.
— Æsopische Fabeln 5 Bücher. Uebers. u. mit. Anmerkgn. begleitet von H. J. Kerler. 2 Bdchen. Stuttgart, Metzler. In-16.
Phædri Augusti Liberti fabulæ. Für Schüler mit erläut. u. eine richtige Uebersetzung fördernden Anmerkungen versehen von Johs. Siebelis. Leipzig, Teubner (1860, 1865, 1874). In-8º maj. v. xii u. 75 s.
Des Phædrus, Freigelassenen des Augustus, Æsopische Fabeln. Uebersetzt von A. R. v. A. Leipzig, Teubner. In-8º v. xx u. 172 s.
§ 3. — Traductions anglaises. §
Phædrus’ Fables, latin and english, on the Hamiltonian System. London. In-12.
Phædrus with a litteral english translation. London. In-8º.
Phædrus fables construed into english for Grammar Schools. London, Simpkin. In-12.
Phædrus’ fables, literally translated by H. T. Riley ; also Smart’s Metrical version of Phædrus, together with Terence literally translated by Riley, in one vol. London, Bohn’s Classical Lib. In-8º.
§ 4. — Traductions espagnoles. §
Fabulas de Phædro, liberto de Augusto, traducidas al castellano en verso, y prosa, con la explicacion de los accidentes de cada palabra, á fin de facilitar su intelligencia en el grado posible, por Don Rodrigo de Oviedo, catedrático de buena-version de los reales estudios de la corte. Con licencia. En Madrid, por Don Blas Román (1801). 2 vol. in-12.
Fabulas de Phedro, liberto de Augusto, traducidos al castellano en verso y prosa, con la explicacion de los accidentes de cada palabra, á fin de facilitar su inteligencia en el grado posible. Por D. Rodrigo de Oviedo, catedrático de buena version de los reales estudios de la corte. Madrid, imp. de la calle de la Greda, lib. de la Publicidad. 2 vol in-8º.
Fabulas de Phedro, liberto de Augusto, en latin y castellano, illustradas con algunas notas mas de las que tenian, para las mas fácil inteligencia y uso de los principiantes en los estudios de gramática, y corregidas con mayor exactitud. Por de Francisco de Cepeda, maestro de latinidad en los reales estudios de S. Isidro é individuo de la real Academia matritense. Madrid, imp. de la V. de Bario Lopez, lib. de la V. de Razola. In-8º.
Fabulas de Fedro, liberto de Augusto, en latin y Castellano, illustradas con algunas notas mas de las que tenian, para la facil inteligencia y uso de los principiantes en los estudios de gramática, y corregidas con mayor exactitud por D. Francisco de Cepeda, maestro de latinidad en los reales estudios de S. Isidro é individuo de la real academia matritense. Madrid, imp. y lib. de J. Viana Razola. In-8º.
Fabulas de Fedro, liberto de Augusto, en latin y castellano. Paris, Pillet aîné. In-18 de 6 feuilles et demie.
Fabulas de Fedro, liberto de Augusto, en latin y castellano. Paris, Rosa (1856, 1861, 1876). In-18 de 7 feuilles.
Fabulas de Fedro, liberto de Augusto, en latin y castellano Paris, Garnier frères (1860). In-18 de 7 feuilles.
§ 5. — Traductions italiennes. §
Le Favole di Fedro, Liberto d’Augusto, tradotte in versi volgari da D. Giovanni-Grisostomo Trombelli, Canonico Regolare del Salvadore. In Venezia. Appresso Francesco Pitteri, In Merceria all’ Insegna della Fortuna Trionfante. Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio (1735, 1739, 1762, 1775, 1781, 1784 Napoli, Cristoforo Migliaccio, 1792 Venezia, Pietro Zerletti, 1862 Napoli, Societa della bibliotheca Latina Italiana). In-8º de xvi-237 pages, contenant, pages 2 à 145, les fables anciennes de Phèdre et les cinq restituées par Gude, avec la traduction en vers italiens en regard : Les pages 146 à 229 sont occupées par un Index vocabulorum, et les pages 230 à 237, par un Index fabularum.
Saggio sopra Fedro di un Pastore Arcade. In Napoli per Michele Morelli. Con Licenza de’ Superiori. In-8º de 229 pages numérotées, suivies d’un errata de 3 pages non numérotées. Le volume comprend d’abord une étude sur Phèdre divisée en 113 paragraphes et les fables elles-mêmes, dont chacune est suivie : 1º de notes ; 2º de cinq traductions italiennes composées par Malaspina, Trombelli, Migliarese, un anonyme et un dernier auteur non indiqué, mais sans doute éditeur du volume ; 3º de Riflessione morale ; 4º d’Osservazioni sulle traduzioni.
Phædri et Aviani fabulæ. Accedunt M. Aur. Olymp. Nemesiani Cynegeticon et Bucolicon, itemque Gratii Falisci Cynegeticon et Halieutica. Cum appositis italico carmine, interpretationibus, ac notis. Mediolani, Typis lmp. Monast. S. Ambrosii Majoris. Superiorum permissu. In-8º grand format de xxiv-431 pages.
Le Favole di Fedro in volgar prosa tradotte con annotazioni del sacerdote Antonio Millo. Edizione seconda. A Spese di Annania Coen di Reggio. In-16 de 148 pages contenant, sous le texte latin, la traduction en prose italienne des Fables de Phèdre et de celles restituées par Gude. Au bas de la page 148 on lit : Parma ; Per i fratelli Gozzi.
Traduction de Petronj, mentionnée page 229 ci-dessus.
Le Favole di Fedro liberto di Augusto, ripurgate in volgar prosa Toscana recate a riscontro del testo latino ed illustrate con note di varie maniere per Sebastiano M. Zappala, professore di lingua greca e di umane lettere ad uso delle Scuole del Vescovil Seminario di Catania. Quarta edizione Veneta. Bassano, dalla tipografia Remondini (1823). In-12 de xxiv-285 pages, contenant le texte {p. 238}de Phèdre et des cinq fables restituées par Gude avec la traduction en prose italienne placée en regard.
Tutte Le favole di Fedro liberto d’Augusto tradotte in anacreontiche dal professore Abate Cervelli. Milano, presso Gio-Pirotta. In-12 de 434 pages, précédées de 12 pour le frontispice, l’avis au lecteur, la vie de Phèdre et la table, et suivies de 2 consacrées aux variantes.
Fedro recato in versi italiani di vario metro, coll’aggiunta delle favole del Codice Perottino di quelle de manoscritto di Digione e di cento sentenze morali di varj antichi autori dal Co. Lauro Corniani d’Algarotti Vinizianio. Venezia, Coi tipi di Francesco Andreola. In-8º de xxiv-173 pages contenant une Prefazione et la Vita di Fedro en italien, et, sans texte latin, la traduction en vers italiens des fables de Phèdre anciennes et nouvelles.
Delle favole Esopiane di Fedro Liberto di Augusto Libri cinque con Appendice di XXXIV favole Riportate dal Burmanno ed altra di XXXII publicate in Napoli nel MDCCCXI. Traduzione di Ludovico Antonio Vicenzi. Modena, per gli eredi Soliani tip. reali. In-8º de x-246 pages, contenant la traduction en vers italiens des fables anciennes, des fables restituées par Gude et Burmann et des fables nouvelles.
Favole Esopiane exposte in vario metro da Cesare Cavara. Aggiuntovi l’elegante volgarizzamento delle nuove favole di Fedro e dell’Appendice lavoro del chiarissimo signor professore Domenico Vaccolini. Bologna, Tipografia di Giuseppe Tiocchi. In-12 de 146 pages numérotées, contenant (p. 87 à 116) la traduction en vers italiens des trente-deux nouvelles fables de Phèdre.
Le Favole di Fedro voltate in rime semi-giocose, con note istoriche da Giovanni Pasquale Professoro di Rettorica. Biella, Presso Ignazio Feria librajo editore. Con permiss. In-12 de 130 pages.
Le Favole di Fedro volgarizzate in rima dal professore Giuseppe {p. 239}Giacoletti D. S. P. Socio de diverse Academie. Torino, Tip. G. Favale e Compagnia. In-16 contenant, sans le texte latin, la traduction en vers italiens des fables anciennes de Phèdre, dans un premier appendice celle des cinq fables restituées par Gude, et, dans un second appendice intitulé : Appendice seconda come nell’edizione Torinese, MDCCCXXXVIII, celle de huit des fables nouvelles.
§ 6. — Traductions illyriennes. §
Phædri Augusti Liberti Fabulæ Æsopiæ versibus illyricis a Georgio Ferrich Ragusino redditæ. Ragusii, Superiorum permissu. — Fedra Augustova. Odsujcgnika pricize esopove u pjesni slovinske prinesene od ghjura ferrichja Dubrovcjanina. U Dubrovniku. S’do-pustjenjem starjescina. Godiscta. In-24 de xii-167 pages contenant les Fables de Phèdre avec la traduction en vers illyriens en regard.
§ 7. — Traductions chinoises. §
Fedro, Aniano, etc. Favole Tradotte d’all’inglese in chinese de Roberto Thom (Anglico et Sinice). Canton, all’officio tipografº. In-4º.
Livre II.
Étude sur les fables des imitateurs directs et
quasi-directs de Phèdre et sur les manuscrits qui les renferment. §
Prolégomènes. §
Une étude sur Phèdre ne serait pas complète, si l’on s’en tenait à son œuvre et si l’on négligeait les collections de fables qui n’en sont que l’imitation plus ou moins servile. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, ces collections doivent nécessairement se diviser en deux classes : les unes, qui sont en même temps les plus intéressantes au point de vue philologique, contiennent les fables directement dérivées du texte primitif et celles presque littéralement extraites de ces dernières ; les autres, les fables qui, n’étant que des altérations successives des premiers plagiats, s’écartent nécessairement davantage de la source originale.
C’est seulement des premières qu’il sera question dans ce deuxième livre, qui ne pourra être que très court. Car, si les imitations indirectes sont très nombreuses, celles qui ont dû être faites sur le texte primitif ont presque toutes disparu. On n’en peut plus citer que deux, celle qui, conservée à la Bibliothèque de Leyde, a été publiée par Nilant sous le titre de Fabulæ antiquæ, et celle à laquelle M. Lucien Müller a donné le nom d’Æsopus ad Rufum278. Encore le texte exact de la seconde ne nous est-il pas parvenu et ne pouvons-nous nous rendre compte de ce qu’il a été que par les deux collections qui en ont été tirées.
Chapitre premier.
Fabulæ antiquæ. §
Section I.
Examen des Fabulæ
antiquæ. §
De toutes les collections, celle des fables appelées Fabulæ antiquæ est la plus conforme au texte de Phèdre.
Comme beaucoup de celles qui en sont dérivées, elle a été un plagiat commis au moyen âge par un moine, qui, pour les faire servir à l’enseignement, les a mises en harmonie avec le goût et les idées du temps. Il faut avouer d’ailleurs que, pour atteindre son but, il n’a pas fait grand effort ; car sa prose est la copie presque littérale des vers de l’auteur latin. Pour qu’on en puisse juger, je vais prendre au hasard une des fables de Phèdre, et, après l’avoir transcrite, je copierai celle des Fabulæ antiquæ qui y correspond.
Voici comment est conçue dans le manuscrit de Pithou la fable Graculus superbus et Pavo :
Ne gloriari libeat alienis bonis,Suoque potius habitu vitam degere,Æsopus nobis hoc exemplum prodidit ;Tumens inani Gragulus superbiaPennas Pavoni quæ deciderant sustulit,Seque exornavit : deinde contemnens suos,Immiscuit se Pavonum formoso gregi.Illi impudenti pennas eripiunt avi,Fugantque rostris. Male multatus GragulusRedire merens cœpit ad proprium genus ;A quo repulsus tristem sustinuit notam.{p. 243}Tum quidam ex illis quos prius despexerat :« Contentus nostris si fuisses sedibus,Et quod natura dederat voluisses pati,Nec illam expertus esses contumeliam,Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas. »
Si maintenant on se reporte à la même fable dans les Fabulæ antiquæ, voici ce qu’on y lit :
Tumens inani Graculus superbiapennas Pavonum, quæ deciderant, sustulit,seque exinde ornavit ; contempnens suosmiscuit se Pavonum formoso gregi.Illi imprudenti pennas eripiunt avi,effugantque miserum. Male multatus Graculusrediit mœrens ad proprium genus ;a quo repulsus luctificam iterum sustinuit notam.Tunc quidam ex his, quem pridem despexerat :« Contentus nostris si fuisses sedibus,et pati quod natura dederat voluisses,nec illam expertus contumeliam fuisses,nec ad hanc repulsus pervenire potuisses miseriam.Ne libeat gloriari quenquam bonis alienis,suis quin potius vivere malle. »
J’ai divisé la prose en autant de lignes qu’il y a de vers imités, et l’imitation était tellement plate qu’en procédant ainsi j’ai rétabli quelques vers du texte original ; en opérant quelques faibles corrections, je les aurais tous reconstitués. La même épreuve comparative, faite sur une autre fable, aurait à peu près donné le même résultat. Les Fabulæ antiquæ sont donc moins l’imitation que l’altération des fables de Phèdre.
Mais ce qui pour les philologues fait leur importance, c’est qu’elles sont loin de se rapporter toutes au texte connu de l’auteur ancien. Sur 67 il n’y en a dans ce cas que 37, de sorte que les 30 autres sont la copie presque littérale de celles qui ne nous sont pas parvenues.
Et il ne faudrait pas croire que c’est là une supposition risquée. La
découverte du manuscrit de Naples en démontre au contraire l’exactitude. On y
reconnaît les trois fables du manuscrit de Leyde, qui, sous les numéros 46, 50
et 55, ont été par Nilant intitulées : Simia et
Vulpis
, Lupus, Pastor et Persecutor
,
et Ovis et Cornix
. {p. 244}N’en
doit-on pas conclure que, si la découverte, au lieu d’être partielle, avait été
complète, on retrouverait aujourd’hui dans les fables de Phèdre tous les originaux
des Fabulæ antiquæ ? Évidemment oui, et l’on peut dès lors
considérer le manuscrit de Leyde comme ayant sauvé un important débris de l’œuvre
originale.
Voici la nomenclature des 67 fables qui forment la collection, avec l’indication des fables correspondantes de l’auteur primitif :
| Leyde. | Phèdre. |
| 1. Le Coq et la Perle. | iii, 12. |
| 2. Les Chiens affamés. | i, 20. |
| 3. Le Loup et l’Agneau. | i, 1. |
| 4. Le Rat et la Grenouille. | |
| 5. Le Chien et la Brebis. | i, 17. |
| 6. Les deux Coqs et l’Épervier. | |
| 7. Le Chien et l’Ombre. | i, 4. |
| 8. Le Limaçon et le Singe. | |
| 9. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | i, 5. |
| 10. Le Soleil qui se marie. | i, 6. |
| 11. Le Serpent mourant de froid. | iva, 19. |
| 12. L’Âne et le Sanglier. | i, 29. |
| 13. Le Rat de Ville et le Rat des Champs. | |
| 14. L’Aigle et le Renard. | i, 28. |
| 15. Le Corbeau et le Renard. | i, 13. |
| 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | i, 21. |
| 17. L’Âne qui caresse son maître. | |
| 18. Le Lion et le Rat. | |
| 19. La Grue, la Corneille et le Maître. | |
| 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | |
| 21. Les Grenouilles qui demandent un roi. | i, 2. |
| 22. Les Colombes et le Milan. | i, 31. |
| 23. Le Chien et le Voleur | i, 23. |
| 24. Le Chauve et le Jardinier. | |
| 25. Le Hibou, le Chat et la Souris. | |
| 26. Le Geai vaniteux. | i, 3. |
| 27. La Mouche et la Fourmi. | iva, 24. |
| 28. Le Loup et le Renard, jugés par le Singe. | i, 10. |
| 29. L’Homme et la Belette. | i, 22. |
| 30. La Perdrix et le Renard. | |
| 31. Le Chien et le Crocodile. | i, 25. |
| 32. Le Chien et le Vautour. | i, 27. |
| 33. La Grenouille qui s’enfle. | i, 24. |
| 34. L’Âne, le Bœuf et les Oiseaux. | |
| 35. Le Lion et le Berger. | |
| {p. 245}36. Le Taureau et le Moucheron. | |
| 37. Le Cheval et l’Âne. | |
| 38. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | |
| 39. Le Rossignol et l’Épervier. | |
| 40. Le Renard et le Loup. | |
| 41. Le Cerf à la Fontaine. | i, 12. |
| 42. La Vipère et la Lime. | iva, 8. |
| 43. Les Loups et les Brebis. | |
| 44. La Hache et les Arbres. | |
| 45. Le Loup et le Chien. | iii, 7. |
| 46. Le Singe et le Renard. | App. 1. |
| 47. Le Marchand et l’Âne. | iva, 1. |
| 48. Le Cerf et les Bœufs. | ii, 8. |
| 49. Le Lion roi et le Singe. | iva, 13. |
| 50. Le Loup et le Berger. | App. 28. |
| 51. Les deux Hommes, l’un véridique, l’autre menteur. | |
| 52. L’Homme et le Lion. | |
| 53. La Cigogne, l’Oie et l’Épervier. | |
| 54. La Chienne qui met bas. | i, 19. |
| 55. La Corneille et la Brebis. | App. 26. |
| 56. La Fourmi et le Grillon. | |
| 57. Le Lièvre, le Moineau et l’Aigle. | i, 9. |
| 58. Le Cheval, l’Âne et l’Orge. | |
| 59. Le Lion malade et le Renard. | |
| 60. La Puce et le Chameau. | |
| 61. Le Loup et le Chevreau. | |
| 62. Le Chien vieilli et son Maître. | v, 5. |
| 63. Le Renard et la Cigogne. | i, 26. |
| 64. Le Loup et la Grue. | i, 8. |
| 65. Le Serpent et le Pauvre. | |
| 66. Le Chauve et la Mouche. | ivb, 4. |
| 67. L’Aigle et le Milan. |
De ces fables les 30 qui ne se trouvent pas dans les manuscrits de Phèdre, sont celles qui portent les numéros 4, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 65 et 67.
Je termine ici ce premier aperçu des Fabulæ antiquæ. Pour mieux en faire apprécier l’importance, j’aurai à les comparer à l’Æsopus ad Rufum. Mais cet examen comparatif suppose connues les deux collections de Wissembourg et du Romulus primitif. Je suis donc obligé de le différer.
Section II.
Histoire et description du manuscrit des Fabulæ antiquæ. §
§ 1. — Manuscrit Vossianus latinus in-8º, 15. §
Le manuscrit qui renferme la collection des Fabulæ antiquæ se trouve aujourd’hui à la bibliothèque de Leyde. Il fait partie du fonds Vossius, et, parmi les manuscrits de ce fonds appelés Vossiani Latini in-8º, il figure sous le nº 15.
On sait qu’après la mort d’Isaac Vossius le gouvernement hollandais
fit acheter en Angleterre et transporter à Leyde la bibliothèque de ce savant,
dont ce manuscrit faisait partie et dans laquelle il portait le numéro 294. Il est
probable qu’il l’avait lui-même reçu de la reine Christine, pour qui il avait dû
l’acheter à la vente de la bibliothèque de Paul Petau. Car ce dernier, en tête du
feuillet 195 où commencent les fables ésopiques, avait écrit cette note :
Harum quæ sequuntur fabularum quædam sunt e Phædro
verbatim desumptæ.
Il paraît que le manuscrit avait primitivement
appartenu à l’abbaye de Saint-Martial de Limoges ; mais j’ignore par suite de
quelles vicissitudes il en était sorti.
C’est non pas un in-8º, comme l’indique sa cote, mais un in-4º, dont l’écriture sur vélin, s’il faut en croire Tross279, remonte au xe siècle. Cette appréciation de l’âge du manuscrit a été également adoptée par M. Oesterley dans la préface de son édition du Romulus Burnéien, et m’a été à moi-même exprimée par M. le {p. 247}Dr W. N. du Rieu, conservateur des manuscrits de la bibliothèque de l’Université, que je ne saurais ici trop remercier de sa franche et cordiale obligeance.
Mais cette appréciation n’est pas tout à fait exacte. Je puis à bon escient affirmer que le manuscrit, qui est un volume formé de pièces très diverses reliées ensemble, est en partie de la fin du xe siècle et en partie du commencement du xie. Car je l’ai vu et j’ai eu la possibilité de l’examiner à loisir. Je dois même avouer qu’il a été pour moi une cause de déception assez vive. Au mois de juillet 1876 ayant fait, dans l’unique but de l’étudier, le voyage de Hollande, j’appris par M. du Rieu que le manuscrit était absent, qu’un savant français était venu le voir, qu’à la suite de son voyage un autre érudit de Paris l’avait demandé, qu’il lui avait été adressé par la voie diplomatique, et qu’il devait être momentanément déposé aux Archives nationales.
M. du Rieu, qui depuis longtemps attendait ma visite, avait fait démonter la reliure du manuscrit, et ne s’était d’abord dessaisi que des quaternes, dans lesquels ne se trouvaient pas les fables ésopiques. Mais la partie qu’il avait conservée ayant ensuite été réclamée, il l’avait envoyée aux Archives, de sorte qu’à mon arrivée il ne possédait plus le moindre feuillet du manuscrit. On conçoit quel fut mon mécompte : pour le chercher à Leyde où il n’était pas, j’avais quitté Paris où il était. Mais ce n’était là qu’un de ces petits ennuis qui aiguillonnent la curiosité et qui rendent ensuite plus agréable le succès définitif des recherches.
Lorsque je fus de retour à Paris, muni de l’autorisation écrite de M. du Rieu, je pus sans difficulté prendre communication du manuscrit.
Qu’on me permette, avant d’en donner l’analyse, de parler du copiste à qui sont dus, sinon en totalité, au moins en grande partie, les divers éléments dont il se compose. J’ai dit plus haut que le manuscrit avait appartenu à l’abbaye de Saint-Martial. J’ajoute qu’il y avait pris naissance. C’est là qu’avaient été écrites les pièces dont la réunion l’avait constitué. Presque toutes sont de la même main, et cette main était celle d’un moine nommé Adémar.
Adémar, qu’on appelle aussi Aymar, naquit vers 988, à Chabanais,
localité située à distance à peu près égale d’Angoulême et de Limoges, entra tout
jeune, pour y faire ses études, au monastère {p. 248}de
Saint-Cibard établi dans la première de ces deux villes, puis devint moine de
l’abbaye de Saint-Martial établie dans la seconde. Vers 1029, entraîné par sa
ferveur religieuse, il partit pour la Terre-Sainte où il mourut. Ses biographes ne
sont pas d’accord sur la date de sa mort. Dans la Biographie universelle de
Michaud280 et dans la
nouvelle Biographie générale de MM. Firmin Didot frères281, les notices qui le concernent la fixent à
l’année 1030, et, dans le Dictionnaire de Patrologie282, l’abbé Sevestre s’en rapporte à eux. Moreri283 et l’auteur de la notice qui lui a été consacrée dans
l’Histoire littéraire de la France284 admettent au contraire qu’il à pu vivre jusqu’en 1031. Aucune
de ces dates n’est exacte : c’est en 1034 qu’il mourut ; et il ne peut y avoir de
doute à cet égard ; car voici ce qu’on lit dans la Chronique de Bernard Itier,
moine de Saint-Martial, qui fut secrétaire du chapitre de cette abbaye :
« Anno gracie Mo.XXX.iiij, obiit Ademarus monacus,
qui jussit fieri vitam sancti Marcialis cum litteris aureis et multos alios
libros, et in Jherusalem migravit ad Christum285. »
Adémar avait consacré à l’étude tous les loisirs de sa vie monastique, et écrit plusieurs ouvrages, dont, avant son départ, il avait disposé en faveur de son couvent. Le principal paraît être une chronique de l’histoire de France. Commençant à Pharamond, elle se continue jusqu’à l’année 1029, date de son départ pour la Palestine, est considérée aujourd’hui encore comme une source importante et, surtout à partir du temps de Charles Martel, fournit de précieux renseignements. Le savant P. Labbé l’a corrigée et {p. 249}publiée dans la Nouvelle Bibliothèque des manuscrits. C’est des ouvrages d’Adémar à peu près le seul qui ait vu le jour ; sauf une lettre sur l’apostolat de saint Martial et quelques vers acrostiches, conservés dans les Analecta de Mabillon, ses autres ouvrages n’ont pas été imprimés286.
Le manuscrit, que je vais maintenant décrire, montre que, comme tous les moines lettrés du moyen âge, Adémar, s’il a été auteur, n’a pas non plus dédaigné de se faire simple copiste.
Le manuscrit est complet et en bon état ; mais l’écriture n’en est
pas partout également lisible. D’après M. Pertz, dont l’appréciation est
heureusement fort exagérée, le texte serait presque indéchiffrable et la lecture
en serait rendue plus pénible encore par le désordre qui s’y remarque ; il ne se
composerait que de lambeaux d’œuvres très diverses, réunis ou plutôt confondus
ensemble par diverses mains du xe siècle, de sorte
que sur la même ligne, sans épigraphe ni disjonction, une œuvre nouvelle ferait
suite à une autre toute différente. « C’est, ajoute M. Pertz, une espèce de
collection d’extraits ou de recueil de notes où se mêle tout ce qui est passé
par la tête de l’écrivain. »
Il y voit ce qu’on appellerait aujourd’hui
un keepsake.
Il s’est complètement fourvoyé, et son erreur paraît provenir de ce qu’il n’a pas su qu’à la reliure on avait réuni en un seul volume des pièces, qui isolément ne contenaient pas des extraits ajoutés pêle-mêle les uns aux autres, mais qui, étant sans corrélation entre elles, ont donné au manuscrit une fausse apparence de désordre.
L’analyse de tous ces fragments se trouve dans les Catalogues des manuscrits de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, imprimés à Oxford en 1697, en deux volumes in-folio287, dans l’ancien catalogue des livres de la Bibliothèque de l’Université de Leyde288, {p. 250}et, avec plus de détails, dans les Archives de la Société des antiquaires allemands, publiées à Hanovre par M. Pertz289. Enfin M. du Rieu a rédigé et mis en tête du manuscrit une table des matières, accompagnée de références nombreuses et véritablement instructives.
J’aurais pu me borner à recopier ici une de ces nomenclatures ; j’ai cru devoir m’aider de toutes, me servir en même temps de mes propres notes et de ces éléments réunis faire une analyse nouvelle.
La reliure ayant été démontée, je me suis trouvé à Paris, non devant un seul manuscrit, mais en face de 28 cahiers ou quaternes, composés, le premier de la table dressée par M. du Rieu, et les 27 autres, des anciens feuillets en parchemin.
Premier quaterne.
Table des matières dressée par M. du Rieu.
Deuxième quaterne (Fol. i).
Fol. i a. — Le manuscrit commence par un feuillet qui ne dépend pas des autres, et qui devait plutôt appartenir à la couverture. L’écriture plus récente est du xiiie siècle. Voici ce qu’on y lit :
Anno gratiæ 1221. mense Augusto insurrexerunt milites Lemovicensis pagi contra Guidonem Lemovicensem cum armis : omnes simul sacramento firmo astricti, erant : P. et G. de Malamort. Otto de Bre. Gui et Segui Lastors. P. la Porcharic cum filiis suis. Hugo vig. W. de Gordo. P. b. Gui de Peiregnes, Joscinev Audoi de Perulla. Seg. Helias cum fratre suo. et multi alii. Sed pace inter eos reformata, quidam ex ipsis O. scilicet S. Cotet, P. de Malamort, Gui Lastors. Segui Lastors captus est ab Ademaro fratre Guidonis vice-comitis. Hanno obiit abbas de Charras. Raols de Cuilēc. Audebert Oliver efficitur prepositus sancti Vatc̄i cum Simone Malafaida. et debebant libr. IX.
Au verso du fol. i, à la suite du récit qui précède, se trouve une liste de noms des abbés de Saint-Martial. Elle est d’une autre {p. 251}écriture que le fragment précédent, et l’encre en est beaucoup plus noire.
Troisième quaterne (Fol. ii à xi).
Fol. ii a à iv a. — Ces feuillets sont occupés par des figures bibliques, qui, quoique grossières, sont cependant supérieures à celles qui se rencontrent plus loin dans le texte des fables. Cette différence semblerait indiquer que le manuscrit est l’œuvre de plusieurs copistes. Il est néanmoins possible qu’il soit presque entièrement écrit de la main d’Adémar, et que la différence dans les dessins tienne à ce que ceux des fables qui sont les plus grossiers sont son œuvre et à ce qu’il a copié sur d’autres ceux des feuillets 2 à 4.
Fol. iv b. — Romulus thiberino filio civitate atlica. Esopus, etc. C’est la dédicace de Romulus, qui occupe les six premières lignes de la page.
La septième ligne commence par ces mots, qui, dans le texte du
premier livre de Romulus, servent de titre à la fable du Milan malade : Qui semper blasfemat, in angustia quid rogat ?
Puis à la
suite, sans interruption, le copiste a transcrit l’hymne à saint Benoît dont voici
le premier vers :
Ordiar unde tuos, sacer o Benedicte, triumphos.
C’est, comme on le sait, l’œuvre du diacre Paul, auteur de l’hymne à saint Jean plus connue encore290.
La page se termine par quelques maximes des sept Sages, en partie formulées en langue grecque.
Fol. v a. — Incipiunt Simphosii enigmata. L’opuscule placé sous ce titre a été publié dans le Jahrb. f. Philol. 1866, pages 266 et s., par M. L. Müller, qui pour son édition a eu recours au texte de ce manuscrit.
Fol. v b à viii a. — Incipit liber fabularum Teodosii, imo Avieni. Dubitanti mihi, optime Theodosi, etc. — Rustica deflentem, etc. M. L. Müller s’est occupé, dans le Rheinisches Museum für Philologie, 1867, p. 507, de ce texte des fables d’Avianus.
{p. 252}Fol. viii a in medio. — Epigramma de laboribus herculis.
Fol. viii b à x a. — Inc. versus Hilarii de Martirio Maccabeorum. Rex fuit Antiochus Siriæ, etc.
Fol. x a. — Remmi Favini epistola de ponderibus ad Symmachum. Riese, dans son Anthologia Latina, a publié ce petit poème, sous le nº 486.
Fol. x b à xi b. — Eiusdem periegesis e Dionysio. Annue rex cœli, etc.
Quatrième quaterne (Fol. xii à xiii).
Fol. xii a. — Donati quædam. Primo nobis interrogandum est quod nomen habeat ista prefacio. Au texte écrit par une première main une seconde a ajouté en marge un très grand nombre de gloses.
Fol. xiii b. — Gloses qui se rapportent au même texte.
Cinquième quaterne (Fol. xiv à xix).
Le cahier qui constitue ce quaterne, moins grand que les autres, n’a que les proportions du petit format in-8º.
Fol. xiv a à xv a. — Ici se place une œuvre philosophique, qui occupe les trois premières pages du quaterne, et que le copiste a laissée incomplète. Elle commence par ce distique :
Hæc quicumque legis diversaque verbula ca[r]pis :Que pascunt animo, si vis intendere sensum.....
Fol. xv b à xix b. — Gloses sur l’Ancien Testament. Elles paraissent d’une autre main que les écritures qui précèdent.
Sixième quaterne (Fol. xx à xxi et xxx à xxxii).
Fol. xx a. — Sermon commençant par ces
mots : Festiva beatissimi B. solemnitas Christo Domino
propitiante refulget
, etc.
Fol. xx b. Martyrologium Bedæ. C’est un petit poème en vers hexamètres dont le prologue commence ainsi :
Bis sena mensum vertigine volvitur annus.
Fol. xxi b. Virgilius de vere et hieme. Voici le commencement :
Conveniunt subito cuncti de montibus altisArboreas pariter lætas celebrare camenas.
{p. 253}Epitaphium Virgilii.
Mantua me genuit, Parthenope sepelit, etc.
Fol. xxx a. — Suite de l’épitaphe de Virgile.
Fol. xxx b. — Prisciani de Est et non. C’est une œuvre en vers dont voici le premier :
Est et non cuncti monosillaba nota frequentant.
Fol. xxx b à xxxii b. — Opuscule cosmographique, où se trouvent beaucoup de mots arabes.
Septième quaterne (Fol. xxii à xxix).
Ici une explication est nécessaire. Ce quaterne, composé de huit feuillets, avait été intercalé dans le précédent. C’est ainsi que, tandis que les nos 20, 21, 30, 31 et 32 avaient été donnés aux cinq feuillets du précédent, celui-ci avait reçu, à raison de la position qu’il occupait, les nos 22 à 29.
Fol. xxii a. — Gloses sur Perse.
Fol. xxii b à xxix b. — Ici commence une seconde copie de l’œuvre, dont la première copie incomplète débute en tête du fol. xiv par ce vers :
Hæc quicumque legis diversaque verbula ca[r]pis.
Cette seconde copie, qui paraît complète et qui semble être de la main d’Adémar, occupe tout le quaterne et se termine au verso du fol. xxix. C’est sans doute sur elle que M. Pertz a dû surtout baser le reproche de désordre qu’il a adressé à Adémar, et qui ici était plutôt à faire au relieur.
Huitième quaterne (Fol. xxxiii à xxxvi).
Fol. xxxiii a à xxxv a. — Sermon commençant par ces mots : Legimus
sanctum Moysen populo Dei precepta dantem
, etc.
Fol. xxxv b à xxxvi b. — Pages blanches.
L’écriture de ce quaterne paraît étrangère à Adémar.
Neuvième quaterne (Fol. xxxvii à xliv).
Fol. xxxvii a à xliii b. — Les sept premiers feuillets de ce quaterne sont remplis par des dessins à la plume destinés à servir {p. 254}d’illustrations à l’ouvrage de Prudence connu sous le nom de Psychomachia seu pugna Virtutum.
Voici quelques-unes des légendes, qui accompagnent ces illustrations : Fol. 37. Loth capitur ab hostibus ; Fides interficit Perfidiam ; Socios coronat ; Pudicitia contra Libidinem pugnat. — Fol. 38. Ira gladio suo se interficit ; Pacientia victrix Iram mortuam increpat. — Fol. 39. Superbia equitat ; Equum incitat ; Superbia in foueam cadit ; Luxuria prandet. — Fol. 40. Voluptas per spinas fugit. — Fol. 41. Largitas procedit in campum ; Largitas invadit Avaritiam ; Largitas spolia distribuit. — Fol. 42. Discordia vulnerat Concordiam ; Discordia inter gladios virtutum. — Fol. 43. Sapientia in solio residens.
Le dernier dessin, au-dessous duquel on lit ces mots : Auctoris graciarum actio
, représente le dessinateur sous
la figure d’un moine, qui n’est autre qu’Adémar. Son portrait a donc été
conservé ; mais l’inexpérience du dessinateur permet de douter de la
ressemblance.
Fol. xliv a. — Opuscule, en prose latine rimée, en l’honneur du Christ.
Fol. xliv b. — Porphirius. Et au-dessous un poème, commençant par ces mots : In quattuor versus omnis
, etc. C’est celui qui est à la
fin des éditions de l’auteur.
Après viennent des annotations diverses.
Dixième et onzième quaternes (Fol. xlv à liv et lv à lxii).
Fol. xlv a à lx b. — Psychomachia de Prudence. Voici le titre :
Incipit liber Aurelii Prudencii Clementis qui grece
psichomachia dictus, latine pugna virtutum. Incipit psichomachia.
Puis vient ce premier vers du prologue :
Senex fidelis, prima credendi via.
La Psychomachia elle-même commence ensuite par ce premier vers :
Christe graves hominum semper miserate labores.
Enfin au fol. lx b se lit cette
souscription : Aurelii Prudentii Clementis viri clarissimi
psichomachia explicit quod latine dicitur animæ certamen.
{p. 255}Fol. lxi a à lxii a. — Versus de sphera cœli.
Hæc pictura docet quicquid recitavit Iginus, etc.
Cette pièce de vers a été publiée par Riese dans son Anthologia Latina291.
Fol. lxii a. Versus Prisciani de signis cœli.
Ad Boreæ partes arcti vertuntur et anguis.
À cet opuscule il est intéressant de comparer les œuvres analogues contenues dans le même manuscrit, notamment : 1º le petit traité d’astronomie qui occupe les fol. xxx b à xxxii b ; 2º l’ouvrage d’Hyginus, qui s’étend du fol. clv a au fol. clxxxviii a, et les dessins, par lesquels le copiste, du fol. clxxii a au fol. clxxxi a, a voulu représenter les constellations.
Fol. lxii b. — Incipit prologus libri Catonis. Cum animadverterem quam plurimos graviter in via morum errare, succurrendum opinioni eorum et consulendum fore existimavi, etc.
Au bas de la même page on lit : Explicit
prologus. Incipit liber eiusdem.
Ces derniers mots montrent
qu’à la suite du prologue venait le livre même de Caton écrit sur un autre cahier
qui n’aura pas été retrouvé par le moine de Saint-Martial chargé de classer les
manuscrits d’Adémar.
Douzième et treizième quaternes (Fol. lxiii à lxxi et lxxii à lxxxii).
Fol. lxiii a à lxxxii b. — Explication de l’apocalypse, qui occupe deux quaternes. Le premier, qui se compose des feuillets lxiii à lxxi, est dans le format d’un in-8º allongé ; l’autre, dans celui d’un in-4º. L’écriture des deux est la même, mais n’est peut-être pas celle d’Adémar.
Quatorzième, quinzième et seizième quaternes (Fol. lxxxiii à xc, xci à xcviii, xcix à cvi).
Fol. lxxxiii a. — En tête de ce
feuillet on lit : Prologus.
Ce prologue se
compose de dix vers ; à la suite vient l’ouvrage lui-même, dont la nature est,
avec le nom de l’auteur, explicitement {p. 256}indiquée par ce
titre : Incipiunt epigrammata Prosperi eruditissimi, ex
dictis Augustini deflorata, in Christi nomine, amen.
L’écriture ne paraît pas être d’Adémar. L’ouvrage est entier ; il se termine au recto du fol. cvi.
Fol. cvi b. — Page blanche.
Dix-septième quaterne (Fol. cvii à cxiv).
Ce quaterne, quoique du format in-4º, est de plus petite dimension que les autres.
Fol. cvii a. — Gloses grecques et latines.
Fol. cvii b à cxiv b. — Prisciani exercitamina. Incipiunt Prisciani Præexercitamina. De Fabula.
Dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième quaternes (Fol. cxv à cxxii, cxxiii à cxxx, cxxxi à cxxxviii, cxxxix à cxlvi, cxlvii à cliv).
Comme on le verra plus loin, ces quaternes sont tous indubitablement de la main d’Adémar et donnent une base certaine pour apprécier quelles sont les autres parties du manuscrit également écrites par lui. Il y a réuni des traités divers, qui en font une sorte de Nomenclator universalis. Je vais ici donner, d’après la table de M. du Rieu, l’indication de chaque traité.
Fol. cxv a à cxix a. — Explications très variées à l’usage des écoliers.
Fol. cxix a à cxx a. — Fragments de rhétorique et de grammaire tirés de Marius Victorinus.
Fol. cxx b à cxxi a. — Éléments de mathématiques, accompagnés de figures de géométrie.
Fol. cxxi b à cxxvii b. — Fragments géographiques, glossographiques et chronologiques, empruntés au Livre des étymologies d’Isidore.
Fol. cxxviii a à cxxx a. — Gloses et mots classés par ordre alphabétique.
Fol. cxxx a à cxxxi a. — Chronologie depuis Adam jusqu’à Héraclius.
Fol. cxxxi b et suivants. — Gloses sacrées et explication de divers mots grecs ; noms d’animaux, de plantes, de minéraux, d’édifices, de mesures, de vêtements et de monnaies.
{p. 257}Fol. cxxxviii a à cxliv a. — Noles concernant l’histoire des couvents de Saint-Cibard d’Angoulême et de Saint-Martial de Limoges292.
En tête du verso du feuillet cxli, Adémar ayant laissé
une demi-page blanche, un moine de Saint-Martial, au xie siècle, en a profité pour y écrire le précieux renseignement qui
suit : Hic est liber sanctissimi domini nostri Marcialis
Lemovicensis ex libris bone memorie Ademari grammatici. Nam postquam multos
annos peregit in Domini servitio ac simul in monachico ordine in eiusdem
patris cœnobio, profecturus Hierosolimam ad sepulchrum Domini, nec inde
reversurus, multos libros, in quibus sudaverat, eidem suo pastori ac nutritori
reliquit, ex quibus hic est unus.
Fol. cxliii a à cxlvii a. — Longue suite de mots grecs concernant la géométrie, la grammaire et la rhétorique, avec la traduction latine.
Fol. cxlvii b. — Deux médicaments.
Fol. cxlvii b à cxlviii a. — Fragment contenant des notions sur la grammaire.
Ce fragment commence ainsi : Theodorus monacus
quidam a Tharso Cililiæ atque Adrianus abbas, scole Grecorum Rome quondam
positi simulque grecis ac latinis litteris, liberalibus quoque artibus
instituti, a papa Romano Britanniarum insule sunt directi ac eandem tam
salubribus fidei documentis quam etiam secularis philosofie inlustrarunt
disciplinis
, etc. Il se termine par ces mots : Theodorus monachus et abbas Adrianus Adelmo instituerunt grammaticam
artem.
M. L. Müller s’est occupé de ce fragment dans le Rheinisches Museum für Philologie, année 1867, page 634.
Fol. clviii a. — Liste des noms qui sont ceux des abbés de Saint-Martial.
Fol. cxlviii
a à cliii
b. — Adhelmi ænigmata. C’est un poème en vers
hexamètres, à la fin duquel on lit cette souscription : Expliciunt enigmata de variis rebus.
Fol. cliii b à cliv b. — Adelmi episcopi Incipit de metrica arte. Domino glorificando regi Osualdo Althelmus salutem.
{p. 258}Vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième quaternes (Fol. clv à clxii, clxiii à clxx, clxxi à clxxviii, clxxix à clxxxvi et clxxxvii à cxciv).
Ces cinq quaternes paraissent avoir été les cinq premiers d’un autre codex.
Fol. clv
a à clxxxviii
a. — Ces feuillets contiennent une des œuvres d’Hyginus, le Poeticon astronomicon, précédé d’une épître dédicatoire, qui
commence ainsi : Higinus M. Fabio plurimam salutem. Etsi te
studio grammaticæ artis inductum
, etc.
L’œuvre se termine au bas du recto du feuillet clxxxviii
par la souscription Explicit.
Le 25e quaterne et le 26e jusqu’au feuillet clxxxi offrent au milieu du texte de nombreux dessins à la plume, par lesquels le copiste a essayé de représenter les signes du Zodiaque et les diverses constellations. Il y en a 14 dans le 26e quaterne.
Enfin dans le 27e quaterne le recto du premier feuillet, c’est-à-dire du feuillet clxxxvii, porte des notes relatives aux choses qui, arrivées en 1028, pouvaient intéresser particulièrement le couvent de Saint-Martial.
Fol. clxxxviii
b à cxc
a. — Extrait de Pline. Une main plus récente que celle du
copiste en a exactement déterminé l’étendue par ces mots : Quæ
sequuntur ex Plinio excerpta, Libro II, Cap. xv,
xvi.
Cet extrait se termine au haut du recto du
fol. cxc, par le mot Pisces
,
au-dessous duquel on lit : Duos extremi veraces mundi quos
appellant polos.
Fol. cxc
a. — Entre ce dernier membre de phrase et le mot Pisces
, un copiste moins ancien qu’Adémar a écrit ce
titre d’une liste de moines de Saint-Martial : Monasterium
Sancti Martialis lx monachi.
Au-dessous le même copiste a écrit,
tant dans le milieu de la page qu’en marge, 60 noms de moines.
Fol. cxc b à cxci a initio. — La première de ces deux pages et le commencement de la seconde ne portent aucune écriture.
Fol. cxci a à cxciv a. — Calendrier précieux pour la détermination de l’âge exact du manuscrit. Il commence à l’année 1007 ; cette date doit être celle à laquelle la copie a été faite. Mais il ne faut pas oublier que le manuscrit a été formé d’éléments divers, et que par suite le calendrier ne peut donner que l’âge des éléments {p. 259}auxquels il appartient, c’est-à-dire des cinq avant-derniers quaternes.
Il est interrompu au fol. cxcii
a, par des Sententiæ præsagientes, dont la
première commence par ces mots : A. quicquid videris, in
gaudium convertitur, et si te videris vinci, vinces tamen
,
etc.
Le calendrier reprend au fol. cxciii b, est accompagné des noms des abbés de Saint-Martial écrits en marge, et se termine au fol. cxciv a.
Fol. cxciv b. — Liste des noms des évêques de Tours.
Vingt-huitième et dernier quaterne (Fol. cxcv à ccxii).
Fol. cxcv a à cciii b. — Le dernier quaterne est le seul qui se rapporte à mon étude ; mais il a pour la restitution du texte de Phèdre une importance capitale, attestée par la note de Paul Petau écrite en tête du recto du fol. cxcv. Par les dessins à la plume dont il est illustré, il est intéressant également pour l’histoire de l’art.
En tête de la première page, à gauche de la note de P. Petau, le copiste, qui est certainement Adémar, a placé le portrait du vieil Ésope sous la forme d’un homme assis dans un fauteuil, ayant devant lui un livre et un encrier, tenant une plume à la main et paraissant méditer et écrire.
Ce premier dessin n’est pas le seul. Au milieu du texte de chaque fable il en existe un, qui est toujours à la plume et qui a pour objet d’interpréter la fable elle-même, mais qui est quelquefois tellement grossier qu’on a besoin de lire le texte pour savoir quel animal est représenté.
Quant aux caractères, ils sont presque indéchiffrables, et quand on essaie de les lire, on s’explique les plaintes dont ils ont été l’objet de la part de Nilant. Ce qui les rend illisibles, c’est moins leur défectuosité, que l’étude, faite par de nombreux philologues, de cette partie du manuscrit. Au contact de leurs doigts le parchemin s’est encrassé et les lettres se sont effacées.
Les fables se terminent au fol. cciii b vers le milieu de la page.
Fol. cciii b à ccv b. — À la suite des fables, sans interruption, se placent des problèmes d’arithmétique.
Voici le premier, qui fait si bien suite à la dernière, et qui {p. 260}est orné d’un dessin d’un genre si identique, qu’au premier aspect j’avais cru y voir une fable oubliée par Nilant.
Limax ab hirundine invitatus ad prandium fuit infra leuvam unam. In die non plus potuit ambulare quam una untia. Dic in quot dies ad prandium pervenit. In leuva una silicet mille quingenti passus, septem milia pedes, nonaginta milia untia. Quot untie tot dies, scilicet : anni CCXLVI, dies CCXI, menses VII.
Voici quelques spécimens des problèmes qui suivent ; je les emprunte à M. Pertz :
Bos qui tota die arat, quot vestigia facit in ultima riga ? L. Nullum. — Quidam vidit sibi obviantes, et dixit : O fuissetis quanti estis et medietas medietatis, tunc essetis centum. — Quidam debebat transvadare lupum et capram et fasciculum fœni, etc. — Tres fuerunt qui singulas sorores habebant et fluvium transire volebant, etc. — Quidam moriens reliquit, etc. — Quidam vidit pascentes oves, et ait, etc. — Quidam habuit porcos CCC, et iussit ut tot porci numero impari in III dies occiderentur. L. Hæc ratio indissolubilis ad increpandum composita est. Hæc fabula est tantum ad pueros increpandos.
Fol. ccvi a. — Formule de mariage dite en latin Osculum et appelée Oscle dans les chartes françaises du moyen âge.
Fol. ccvi b à ccvii a. — Exercices de calcul accompagnés de quelques figures de géométrie.
Fol. ccviii a à ccx a. — Autres problèmes avec figures.
Fol. ccx b. — Formule de mariage différente de la précédente. Modèle de lettres et d’ornements marginaux.
Fol. ccxi a. — Dessins dans lesquels figurent des animaux.
Fol. ccxi b. — Adam et Ève avec le serpent ; Jésus-Christ ou un autre personnage.
Fol. ccxii a. — Le recto de ce dernier feuillet porte une écriture peu lisible qui n’est pas celle d’Adémar. Voici ce que M. Pertz y lit :
Mensuram crucis fac delãt pollicem ungula. Latit de a… sinistram fac unum plenum dornum. Similiter de articulis pedum… nares unum dornum et fac simplam cmcem. De gula usque ad frontem capillorum, ubi ipsi desinunt, unum pollicem unde… læsi… mensuram crucis. Cerebrum contra sūm in verticem dimidium pollicis. Diadema in tres locos ubi crux est. terciam pariem pollicis ungulæ. Crux in diade… na est lata duas partes pollicis, tercia remanente. Duo spacia {p. 261}diadematis… ramum crucis supernum et dextrum et levum similiter habet duas partes pollicis habet in tribus ramis diadematis hinc et inde granos et in medio granorum virgulam similiter in circuitu diadematis grannos 9 foris et inter virgulas singulas diadema foras de capillis usque ad rotunditatem non plus lata quam tercia parte pollicis. De naribus usque ud summitatem verticis habet unum pollicem. habet frontem bene discoopertam. In capillos dextros 6 plexiones inter totas. in sinistros capillos 7 divisiones, octava et nona sunt in crines duas et inchoant super auriculam.
Le reste est dans le même goût, c’est-à-dire aussi inintelligible.
Au milieu de toutes ces phrases incohérentes apparaissent les traces d’un dessin
qui représente une draperie, et à la suite duquel on lit : Similiter est tantum latum vestimentum contra genua. Barba modica
6 cincinnulos de sinistro.
Fol. ccxii
b. — Un dessin occupe cette dernière page. Au-dessus une main du
xiiie siècle a écrit cette phrase : Raimondus de Begonac me furatus fuit.
Tel est le manuscrit curieux, qui, dans la bibliothèque de Leyde, porte la cote Vossianus Latinus in-8º, 15. Comme on le sait, bien d’autres que moi s’en sont occupés. Mais ceux qui voudront étudier leurs travaux éprouveront peut-être un peu de peine à les trouver. J’achève donc mon analyse, en leur donnant, pour leur venir en aide, les noms des philologues avec l’indication des publications dans lesquelles on pourra lire ce qu’ils ont écrit.
1º J. F. Nilant. — Fabulæ antiquæ, etc. Lugd. Batav., apud Theodorum Haak, 1709, in-12.
2º G. H. Pertz. — Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, herausgegeben von G. H. Pertz. Hannover, in der Hanschen Hofbuchhandlung, 1839 et 1843, in-8º. (Voyez le tome VII, p. 137, et le tome VIII, pages 574 à 577.)
3º A. F. Naekius. — Carmina Valerii Catonis cum Augusti Ferdinandi Naekii annotationibus. Accedunt eiusdem Naekii de Virgilii libello Iuvenalis ludi, de Valerio Catone eiusque vita et poesi, de libris tam scriptis quam editis, qui Carmina Catonis continent, Dissertationes IV. Cura Ludovici Schopeni. Bonnæ, apud H. B. Kœnig, MDCCCXLVII, in-8º. (Voyez pages 239 et 240.)
4º Lucien Mueller. — 1º Jahrbücher für classische Philologie. Herausgegeben {p. 262}von Alfred Fleckeisen. Zwölfter Jahrgang, 1866…, in-8º. (Voyez pages 266 à 272.) — 2º Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcher und F. Ritschl. Frankfurt a. M., J. D. Saverländer’s Verlag, 1867, in-8. (Voyez, pages 500 à 509, l’étude intitulée : « Zu den versus Scoti cuiusdam de alphabeto, einem Gedicht des Damasus und den äsopischen Fabeln Nilants », et, pages 634 et suiv., l’étude sur le moine Théodore, intitulée : « Zur Geschichte der latinischen Grammatik im Mittelalter »). — 3º De Phædri et Aviani fabvlis libellvs. Lipsiæ, in ædibvs B. G. Teubneri, A. MDCCCLXXV. In-8 (Voyez page 33).
5º. O. Ribbeck. — P. Vergilii
Maronis opera recensuit Otto Ribbeck. Vol. IV. Appendix Vergiliana. Lipsiæ,
In ædibus B. G. Teubneri, MLCCCLXVIII. (Voyez, pages 185 à 187, le petit poème en
25 vers intitulé Est et non et notamment, au bas de la page 185,
une note dans laquelle l’éditeur, donnant la nomenclature des titres qu’il porte
dans les divers manuscrits, déclare que le titre, fourni par le manuscrit Woss.
in-8º, 15, est : Prisciani de est et non.
)
6º Hermann Oesterley. — Romulus die paraphrasen des Phædrus und die Aesopische Fabel im Mittelalter. Berlin, Weidmann, 1870, in-8º. (Voyez Einleitung, pages xviii à xxi.)
7º A. Riese. — Anthologia latina, sive poesis
latinæ supplementum. Pars prior : Carmina in codicibus scripta recensuit A. Riese,
Fasciculus II… Lipsiæ, in ædibus B. C. Teubner, MDCCCLXX, in-18. (Voyez, pages 27
à 37, sous le nº 486, le petit poème de Remus Favinus, intitulé : De Ponderibus et Mensuris
, édité d’après un manuscrit de
Vienne, et, au bas de la page 27, la note dans laquelle l’éditeur indique comment
il est intitulé dans le manuscrit Woss. in-8º 15. — Voyez encore, pages 96 à 98,
sous le nº 645, le petit poème Est et non en 25 vers, attribué à
Ausone et édité d’après plusieurs manuscrits et notamment d’après le manuscrit
Woss. lat. in-fol. 111. — Voyez aussi, pages 145 à 148, sous le nº 687, le petit
poème intitulé Conflictus veris et hiemis et édité d’après un
manuscrit de Turin. — Voyez enfin, pages 221 à 223, sous le nº 761, le poème De Sphera cœli en 76 vers commençant par ces mots : Hæc pictura docet
, etc.)
8º Baehrens. — 1º Rheinisches
Museum für Philologie Herausgegeben von Friedrich Ritschl, Otto Ribbeck,
Anton Klette, Neue Folge. Ein und dreissigster Band. Frankfurt-am-Main, Verlag von
Johann {p. 263}David Sauerländer, 1876 (Voyez, page 100, les lignes relatives
au manuscrit Woss. in-8º 15, dans l’article Zur lateinischen
anthologie, écrit à Iéna au mois d’août 1875). — 2º Poetæ
latini minores. Recensuit et emendavit Aemilius Baehrens. Volumen V.
Lipsiæ, in aedibus B. G. Teubneri MDCCCLXXXIII. 5 vol. in-18. (Voyez les pages 31
à 70 du tome V, qui contiennent les fables d’Avianus. L’éditeur signale entre
autres, comme lui ayant servi pour leur publication, les manuscrits Vossiani
in-4º 86 et in-8º 15. — Voyez, à la page 352 du même volume, le petit poème en
17 vers commençant par les mots Bis sena mensum
,
et, au bas de la même page, la note de l’éditeur qui expose que, dans le manuscrit
Vossianus Q. 75, il est suivi du Martyrologium Bedae, et qu’il
est, dans le manuscrit Vossianus in-8º 15, placé en tête de même, comme s’il en
était le prologue. — Voyez enfin le petit poème de Sphera cœli,
commençant à la page 380 du même volume, au bas de laquelle on lit en note :
« Primus ex P(arisino 12 117) saec. XI, fol. 138, edidit Bursianus in
Fleckeis. ann. a. 1866, p. 786 sqq., præterea ego inveni in V(ossiano O 15)
saec. XI fol. 61. »
)
9º. O. Holder-Egger. — Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Reförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelallers. Siebenter Band. Hannover, Hahn’sche Buchhandlung, 1882. (Voyez, pages 630 à 637, la notice sur Saint-Éparche d’Angoulême et Saint-Martial de Limoges par O. Holder-Egger. Cette notice est suivie du texte même des notes marginales qui, dans le manuscrit, occupent les feuillets 138ª à 144ª et le recto du feuillet 187.)
Dans ma première édition, je terminais cette analyse en exprimant le regret que M. Robert de Lasteyrie, qui a fait du manuscrit de Leyde une étude complète, ne l’eût pas publiée. Si actuellement elle n’a pas encore vu le jour, il est bien désirable qu’il ne diffère pas davantage de la faire paraître.
§ 2. — Apographe du manuscrit Vossianus latinus in-8º, 15. §
Le catalogue in-folio de la Bibliothèque de l’Université de Leyde, publié dans cette ville par Pierre Vander Aa, fait mention d’un manuscrit qui, dans les Vossiani varii argumenti, porte la {p. 264}cote 19 et dont les feuillets en papier sont occupés par des opuscules écrits par des mains diverses au xvie et au xviie siècles.
Je m’abstiens de reproduire d’après le catalogue imprimé, que chacun d’ailleurs peut consulter, la nomenclature des opuscules contenus dans le manuscrit. La voici, telle que je l’ai trouvée, écrite en tête du volume par une main qui est probablement celle du conservateur en fonctions à l’époque de l’entrée des livres d’Isaac Vossius dans la bibliothèque de l’Université.
Epistola magistri Jacobi Achoriensis, quæ post captam Damietam Christianis acciderunt, et de prosperis fere incredibilibus successibus regis David (fol. 1 a à 8 b).
Arithmeticæ question es ludicræ (fol. 10 a à 19 b).
Romuli epistola ad Tiberinum filium (fol. 23 a).
Æsopi fabulæ (fol. 27 a à 29 a).
De monumento nuper invento 1685 gallice (35 a à 37 b).
Hispanica lingua chartula quædam (fausse désignation).
Emendationum quarundam pagina singularis (39 a à 42 b).
Liber de mensura orbis terræ (fol. 50 a à 55 b).
Le manuscrit, qui forme un volume in-4º, se compose de 57 feuillets anciens, dont plusieurs sont blancs. Le relieur en a ajouté trois au commencement et trois à la fin, qui sont également dépourvus d’écriture.
Les divers éléments dont le manuscrit est formé et qui comprennent une copie malheureusement incomplète des Fabulæ antiquæ, doivent avoir été réunis en un volume par les soins d’Isaac Vossius. Ce qui me paraît le démontrer, ce sont, parmi les pièces qu’il renferme, celle qui se réfère à une exhumation effectuée en 1685, et celle qui, consistant dans la copie partielle des Fabulæ antiquæ, paraît par son écriture être à peu près de la même époque. Les diverses pièces qui forment le volume n’ont donc pu être réunies avant la date de 1685, et alors elles étaient sa propriété.
Quand la copie qu’on y trouve des Fabulæ antiquæ a été faite, le vieux manuscrit d’où elle a été tirée devait déjà appartenir à Vossius, et cependant elle ne m’a pas paru être de sa main. Pendant que j’étais en Hollande, il m’a été facile de m’en assurer. La bibliothèque de Leyde n’a pas hérité seulement des manuscrits de Vossius, elle a aussi acquis ses imprimés. L’un d’eux, catalogué {p. 265}sous la cote 763, c. xiii, est un exemplaire de la deuxième édition de Phèdre, publiée par Rigaut et imprimée par Robert Estienne en 1617. Sur cet exemplaire Isaac Vossius, qui avait eu le manuscrit de Daniel en sa possession, en a transcrit les variantes et a laissé ainsi un spécimen de son écriture, qui, différant de celle de la copie des Fabulæ antiquæ, ne permet pas de la lui attribuer. Elle est également trop récente pour appartenir à Paul Petau dont l’écriture, d’ailleurs encore plus dissemblable, m’a été également révélée par la mention par lui mise sur le manuscrit Vossianus latinus in-8º, 15, en tête des Fabulæ antiquæ.
Mais il importe peu de découvrir de quelle main est cette copie ; ce qui est plus intéressant, c’est de savoir de quoi elle se compose. Malheureusement elle ne comprend que 17 fables, qui sont même dépourvues de leurs titres.
Les voici dans leur ordre :
| v. v. a. 19. | v. l. in-8º, 15. |
| 1. Gallus ad Margaritam. | 1. |
| 2. Lupus et Agnus. | 3. |
| 3. Mus et Rana. | 4. |
| 4. Canis, Ovis, Lupus, Milvus et Accipiter. | 5. |
| 5. Canes famelici. | 2. |
| 6. Galli duo et Accipiter. | 6. |
| 7. Canis super fluvium carnem ferens. | 7. |
| 8. Cochlea et Simia. | 8. |
| 9. Vacca, Ovis, Capella et Leo. | 9. |
| 10. Femina et Coluber. | 11. |
| 11. Asinus irridens Aprum. | 12. |
| 12. Mus Urbanus et Rusticus. | 13. |
| 13. Aquila et Vulpis. | 14. |
| 14. Corvus et Vulpis. | 15. |
| 15. Leo senex, Aper, Taurus et Asinus. | 16. |
| 16. Asinus domino blandiens. | 17. |
| 17. Leo et Mus. | 18. |
À la suite de ces 17 fables il y a plusieurs pages blanches qui montrent que le copiste avait l’intention de compléter son travail.
J’ai moi-même transcrit sa copie, et, comme elle diffère du texte de Nilant par quelques variantes intéressantes, j’ai cru devoir lui donner une place dans cette étude sur les Fabulæ antiquæ.
Section III.
Éditions des Fabulæ
antiquæ. §
{p. 266}Malgré son importance, la collection de Leyde n’a été qu’une seule fois imprimée.
En passant en revue les livres de la bibliothèque de l’Université de cette ville, le savant Jacob Gronovius, au commencement du siècle dernier, avait aperçu le manuscrit Vossianus Latinus, in-8º, 15, et l’avait immédiatement signalé à Jean-Frédéric Nilant, son neveu. Ce dernier, ému de cette découverte, pria le bibliothécaire, nommé Volf. Senguerd, de le lui confier, et, quoique l’écriture déjà fort effacée l’eût rendu presque illisible, il parvint à la déchiffrer et à donner du manuscrit une édition, qui parut à Leyde chez Théodore Haak en 1709293 et que j’ai déjà mentionnée. C’est cette édition, publiée dans le format in-12, qui a fait souvent donner le nom d’Anonyme de Nilant à l’auteur maintenant connu des Fables antiques.
Le titre du volume était ainsi formulé : Fabulæ
antiquæ, ex Phædro fere servatis ejus verbis desumptæ, et soluta oratione
expositæ. Inter quas reperiuntur nonnullæ ejusdem auctoris et aliorum antea
ignotæ. Accedunt Romuli fabulæ Æsopiæ, omnes ex manuscriptis depromptæ, et
adjectis notis editæ ab Joh. Frederico Nilant.
Après une dédicace à un très généreux et très brillant comte et
seigneur, nommé Adolphe-Henri, venaient un long avertissement au lecteur, puis les
67 fables en prose désignées par le titre de Fabule antiquæ,
ensuite 45 fables de Romulus précédées de la dédicace à Tiberinus, enfin, pour les
compléter, quinze autres fables empruntées à l’édition d’Ulm et précédées de cet
avis : Sequentes fabulæ reperiuntur quoque apud editum Romulum,
cujus ne quid desideretur, et quia nonnullæ Phædri phrases diserte exhibent, eas
in postremo agmine collocavi.
Cette édition de Nilant est assez rare ; j’ai pu néanmoins m’en procurer deux exemplaires que j’ai achetés l’un à Genève, l’autre à Nuremberg.
Chapitre II.
Æsopus ad Rufum. §
M. Lucien Müller, dans son opuscule intitulé : De Phædri et Aviani fabulis libellus294, a exprimé cette opinion qu’aux premiers siècles du moyen âge, toutes les fables latines connues avaient été mises en prose et réunies en une sorte de Corpus, qui avait été intitulé Æsopus et dédié à un certain Rufus, d’où étaient directement ou indirectement issues les collections ultérieures et qui lui-même n’avait pas tardé à disparaître.
Si l’on considère cette hypothèse comme fondée, je crois qu’il ne faut l’admettre que dans certaines limites que j’indiquerai plus loin, et que notamment il faut partir de cette idée qu’on ne connaît et qu’il n’existe que deux collections qui soient la copie ou plutôt l’imitation directe des fables de ce Corpus, celle du fameux manuscrit de Wissembourg aujourd’hui à Wolfenbüttel et la plus ancienne de celles auxquelles a été donné le nom de Romulus. Il s’ensuit que, selon moi, c’est seulement en recourant à elles qu’on peut se faire une idée plus ou moins précise de ce qu’était l’Æsopus ad Rufum.
Pour établir la nomenclature exacte des fables qu’il comprenait et donner une idée aussi nette que possible de leur texte, je vais donc être obligé de commencer par étudier minutieusement les deux dérivés auxquels il a directement donné naissance.
Section I.
Fables du manuscrit de Wissembourg. §
§ 1. — Recherche du manuscrit et analyse des études antérieures. §
Schwabe, dans son édition de Phèdre publiée en 1806, nous apprend bien que le manuscrit de Wissembourg renfermait des fables ésopiques en prose ; mais il avoue qu’il ignore si ces fables sont identiques soit à celles du Romulus ordinaire, soit à celles de l’anonyme de Nilant, soit à celles du Romulus de ce critique, ou si, quoique tirées de Phèdre, elles forment un recueil différent de ceux déjà connus295. De la part d’un savant qui avait presque sous la main le manuscrit de Wissembourg, une pareille ignorance était peu excusable.
Lorsqu’en 1837 Dressler travaillait à l’édition qu’il a donnée de Phèdre, il voulut éclaircir ce que son devancier avait laissé dans l’ombre. De toutes les villes du nom de Wissembourg il était certain que celle qui avait donné son nom aux manuscrits, c’était cette petite sous-préfecture du Bas-Rhin, à laquelle la guerre de 1870 a procuré une célébrité si lugubre. En effet, elle avait possédé une riche abbaye, qui en avait été dépositaire et dont les livres, à l’époque de la grande Révolution, avaient pu être transportés dans une des bibliothèques de la ville.
Supposant que ces bibliothèques plus ou moins imaginaires avaient
des conservateurs, il écrivit au maire de la ville pour le prier de lui faire
faire par eux une copie du manuscrit. La lettre fut reçue par l’adjoint, qui,
après des recherches inutilement faites, lui répondit « qu’il ne s’était
point retrouvé dans la bibliothèque de la ville, ni dans celles des autres
établissements publics, et que le sort en était complètement
inconnu »
.
Cette réponse n’était pas très affirmative. Il en résultait bien que la petite bibliothèque de Wissembourg ne possédait pas le manuscrit. {p. 269}Mais il n’était pas certain qu’il eût péri. Tout d’abord je supposai qu’il pouvait bien être passé dans l’immense fonds de la belle Bibliothèque de Strasbourg. Au mois de juillet 1870, comme je me disposais à faire une tournée en Suisse, je songeai à utiliser scientifiquement ce voyage d’agrément. J’écrivis au conservateur de la Bibliothèque, pour savoir de lui si, par hasard, à l’époque de la Révolution, le manuscrit de Wissembourg n’y était pas entré. Avec un empressement auquel je me plais à rendre hommage, il me fit la réponse suivante :
« Strasbourg, le 4 juillet 1870.
« Monsieur,
« J’ai le regret de vous faire savoir que je ne connais nullement ni à Strasbourg, ni à Wissembourg, le Codex Wissemburgensis fabularum Æsopiarum, au sujet duquel vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. À Wissembourg, chef-lieu de l’une des sous-préfectures du Bas-Rhin, il n’existe qu’une modeste petite bibliothèque, que je n’ai d’ailleurs jamais visitée, mais que je sais ne renfermer aucun manuscrit, et dans le riche dépôt de notre bibliothèque de la ville de Strasbourg je ne connais aucun volume qui réponde aux indications que vous me donnez. Toutefois, si nous ne possédons pas le Codex Wissemburgensis que vous réclamez, je trouve, parmi nos manuscrits, quatre volumes du xve siècle, renfermant des collections de fables, trois en langue allemande et l’un en latin, qui pourraient vous intéresser peut-être. Les trois premiers volumes contiennent trois exemplaires des Fables d’Ésope et de Phèdre mises en vers allemands par Bohner (Bonerius), l’une de ces copies portant la date de 1411. L’autre volume contient une série de fables d’Ésope en langue latine.
« Si, en vous rendant en Suisse, vous vous détourniez un peu afin de passer par Strasbourg, je me ferais un plaisir de mettre ces recueils à votre disposition.
« La bibliothèque de la ville est ouverte au public les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 2 à 5 heures de l’après-midi.
« Recevez, etc.
« Aug. Saum,
« Bibliothécaire. »
{p. 270}Cette lettre me combla de joie. En me révélant l’existence d’un manuscrit qui contenait une collection latine de fables ésopiques, elle me porta à penser que ces fables étaient peut-être celles que je cherchais, et ne rendit que plus vif mon désir de visiter le grand fonds bibliographique de l’Alsace. J’annonçai donc à M. Saum que, le 9 juillet 1870, à midi, je me trouverais à la bibliothèque. Mais c’était un dimanche, et, comme il devait le passer à la campagne, il me répondit qu’il ne pouvait accepter le rendez-vous. Je pris alors le parti d’aller directement en Suisse et de ne m’arrêter à Strasbourg qu’en revenant de ce pays. Mais, hélas ! des événements terribles firent avorter mon plan. Après un mois de séjour en Suisse, le 7 août, comme je m’acheminais vers la France, j’appris à Lausanne nos premiers désastres, et je rentrai directement à Paris, sans avoir vu le manuscrit, qui, quelques semaines plus tard, devait, avec la Bibliothèque elle-même, périr dans l’incendie allumé par les obus de l’armée allemande.
Je continuai mes recherches ; mais je dus leur donner une autre direction. Le manuscrit avait-il appartenu à Gude, et était-il entré avec les autres manuscrits de ce philologue dans la bibliothèque du duc de Brunswick ? c’est ce qu’alors je me demandai et ce qu’il ne me fut pas possible de savoir tout de suite. On ne marche que lentement dans le chemin des découvertes.
Ce qui en somme me préoccupait, c’était d’en connaître le contenu. Sachant que Gude l’avait étudié, je cherchai dans ses notes sur Phèdre ce qu’il avait dû en dire, et bientôt il me fut possible d’apercevoir que la collection du manuscrit de Wissembourg différait sensiblement des autres dérivés connus. En effet Gude, qui en avait révélé l’existence, en avait cité quelques fragments dans ses notes sur la fable xiii du livre I de Phèdre, intitulée Vulpis et Corvus. Cette fable est, de toutes peut-être, celle qui, dans les divers manuscrits, est le plus altérée. Sur le cinquième vers notamment tous les manuscrits sont en désaccord. Ainsi on lit dans les manuscrits de Pithou et de Reims :
Vulpis hunc vidit, dehinc sic cœpit loqui,
et dans celui de Daniel :
Vulpes ut vidit, deinde sic cœpit loqui.
{p. 271}Enfin, pour achever le désaccord, l’édition sur laquelle Gude travaillait formulait ainsi le cinquième vers :
Hunc vidit vulpes, dehinc sic occœpit loqui,
ce qui substituait un vers faux à toutes les variantes ; car, à moins de contracter en une syllabe le mot dehinc, il est visible qu’il y a un demi-pied de trop.
Au milieu de ce chaos, Gude avait demandé la solution à d’autres textes, et, consultant le manuscrit de Wissembourg, il y avait trouvé cette phrase qu’il s’était empressé de signaler, la considérant comme la vraie leçon :
Vulpis hunc vidit, deinde sic cœpit loqui.
Il avait fait remarquer que le mot Vulpis, par une erreur de copiste, était ainsi écrit pour Vulpes, mot qui rend le vers irréprochable, et, comme, suivant lui, l’adverbe deinde était à la fois plus conforme au sens et à la mesure que l’adverbe dehinc, et qu’enfin le verbe cœpit était plus que le verbe occœpit en rapport avec le langage ordinaire du fabuliste, il en avait conclu que le manuscrit de Wissembourg donnait la véritable formule.
Si Gude s’était borné à cette citation, j’aurais été conduit à croire que le manuscrit de Wissembourg contenait le texte de Phèdre conservé en vers ïambiques.
Mais il ne s’en était pas tenu là. Arrivé à la fin de la fable Vulpes et Corvus, c’est-à-dire à la partie qui en avait été le plus altérée, c’était encore à l’aide du manuscrit de Wissembourg qu’il avait cherché à rétablir l’ancien texte.
Là encore tous les manuscrits étaient en dissidence ; ils portaient, celui de Pithou :
Tunc demum ingemuit Corvi deceptus stupor.Hac re probatur quantum ingenium valet,Virtute semper prævalet sapientia,
celui de Reims :
Tum demum ingemuit Corvi deceptus stupor.Hac re probatur valet quantum ingeniumVirtute, semper prævalet sapientia,
{p. 272}celui de Daniel :
Tunc demum ingemuit Corvus : cur dolosisFuisset deceptus fraudibus ut ignavus.
Enfin l’édition dont Gude se servait présentait ainsi les deux derniers vers :
Hac re probatur quantum ingenium valet,Virtuti et semper prævalet sapientia.
Suivant lui, le premier de ces deux vers, qui se trouvait dans les manuscrits de Pithou et de Reims, était l’œuvre d’un moine ignorant, qui n’avait pas compris que Phèdre avait voulu faire prononcer par le Corbeau ce vers sentencieux :
Virtuti semper prævalet sapientia.
En effet la fable Vulpes et Corvus est précédée d’un promythion, c’est-à-dire d’une maxime mise au commencement. Or Phèdre, se conformant d’ailleurs en cela aux principes du bon sens, ne fait jamais suivre d’un épimythion, c’est-à-dire d’une maxime finale, un apologue qu’il a déjà au début pourvu d’une affabulation. Tout au plus fait-il répéter par l’un des personnages qu’il met en scène, dans un seul vers et sous une forme nouvelle, l’idée morale qu’il a tout d’abord exprimée ; mais la répétition ne va jamais plus loin. Il paraît que le moine glossateur n’avait pas fait cette facile remarque ; voulant compléter ce qu’il considérait comme une affabulation tronquée, il fit précéder le dernier vers de la fable de cet autre :
Hac re probatur quantum ingenium valet.
Il s’était rappelé le distique sur Sévère, dans lequel Ausone, le comparant au renard, l’avait montré aspirant au pouvoir suprême, et, malgré la distance qui l’en séparait, en atteignant la hauteur à force de courage et de ruse :
Punica origo illi, sed qui virtute probaretNon obstare locum, quum valet ingenium.
Puis, pour éviter la répétition, remplaçant virtute par hac re, et quum par quantum pour la mesure, oubliant qu’on ne dit pas quantum {p. 273}valet, mais qu’on doit dire quantum valeat, et condensant enfin en un seul les deux vers d’Ausone, il avait écrit en marge du texte :
Hac re probatur quantum ingenium valet.
Après avoir ainsi expliqué l’origine de ce vers inutile, Gude
s’était efforcé de démontrer qu’en effet il n’existait pas dans les anciens
manuscrits, et notamment dans ceux qui, tout en paraphrasant Phèdre, en avaient
suivi pas à pas le texte, et, cherchant dans cet antiquissimus
codex de Wissembourg, in quo Phædri fabulæ pleræque satis
ampla paraphrasi explicantur, il y avait trouvé ce qui suit : Tunc vero Corvus ingemuit stupore deceptus… ; multi, quod viribus non
possunt, sapientia explicant.
La dernière phrase, dans laquelle
le mot viribus est substitué au mot virtuti,
est, suivant lui, la traduction un peu développée de ce vers unique :
Virtuti semper prævalet sapientia.
Tout cela était fort bien pensé et surtout fort savant ; mais ce n’était pas ce qui m’importait. En suivant Gude dans son argumentation, j’avais été uniquement préoccupé de savoir si le manuscrit de Wissembourg, comme sa première citation aurait pu le faire croire, contenait le texte de Phèdre, ou si au contraire il n’en renfermait que la paraphrase en prose. Sa deuxième citation avait à cet égard dissipé le doute que la première m’avait laissé.
Ce qui était encore intéressant pour moi, c’était de savoir si le manuscrit était un recueil de fables connues, tel que ceux du Romulus ordinaire et de l’anonyme de Nilant, ou si au contraire c’était une autre paraphrase des fables de Phèdre.
Gude avait en apparence rendu cette question facile à résoudre : on pouvait croire en effet que, pour être édifié, il suffisait de comparer à ses deux citations les textes correspondants de Romulus et de l’anonyme.
Au lieu de : Vulpis hunc vidit, deinde sic
cœpit loqui
, on lit dans les manuscrits de l’anonyme de Nilant :
Vulpis hunc quum fuisset intuita, sic alloqui
cœpit
, et dans les manuscrits de Romulus : Vulpis ut hæc vidit, e contra sic ait Corvo.
Au lieu de :
Tunc vero Corvus ingemuit stupore deceptus… ; multi, quod
viribus non possunt sapientia explicant
, on trouve dans les
manuscrits de l’anonyme de Nilant : {p. 274}Tunc demum Corvus ingemuit, quia dolo esset deceptus, ut ignarus. Qui se
laudari verbis subdolis gaudent, ferunt pœnas turpi pœnitentia
indiscretas
, et dans les manuscrits de Romulus : Tunc Corvus ingemuit et stupore detentus deceptum se pœnituit. Sed
post irrecuperabile factum damnum quid juvat pœnitere ?
La comparaison ainsi faite m’avait induit en erreur, en me faisant croire que le manuscrit de Wissembourg contenait une œuvre également éloignée de celle des manuscrits de l’anonyme de Nilant et de Romulus.
Cette conviction accrut mon désir d’en connaître le contenu. Je repris mes recherches qui eurent enfin un heureux résultat : en lisant l’Étude historique de M. E. du Méril sur la fable ésopique, j’appris que non seulement le manuscrit de Wissembourg existait encore, mais qu’il était conservé dans la bibliothèque de Wolfenbüttel, et qu’il avait été l’objet d’une longue dissertation latine publiée en Allemagne, sous forme de lettre, par le savant Tross.
Je me mis en quête de l’opuscule de Tross. Malheureusement il n’avait été tiré qu’à 50 exemplaires, et ses fils, libraires à Paris, n’en avaient conservé aucun. Le seul que leur père leur eût laissé, ils l’avaient complaisamment donné à M. E du Méril. Mais ce dernier, pendant le siège de Paris, était allé mourir en Normandie. J’appris par le libraire Vieweg qu’il avait légué sa bibliothèque à la municipalité de Passy, et j’eus un instant l’espoir de trouver la dissertation de Tross à la mairie du XVIe arrondissement de la ville de Paris. Mais, quand je demandai au maire l’autorisation de visiter les livres de M. E du Méril, il me répondit qu’ils étaient restés dans des caisses fermées, que l’on attendait, pour les en retirer, l’achèvement de la nouvelle mairie, et que, provisoirement du moins, il était impossible de me les laisser voir.
J’étais trop impatient de connaître l’opuscule de Tross pour attendre qu’il eût plu à la municipalité du XVIe arrondissement de l’exhumer de la caisse qui devait le renfermer. J’en continuai la recherche, et je finis par en découvrir un exemplaire broché à la bibliothèque du British Museum, où il porte la cote 12 305 e296.
Comme la lettre de Tross est l’étude la plus complète qui ait été
{p. 275}faite du manuscrit de Wissembourg, et que les exemplaires en sont
devenus presque introuvables, je ne puis me dispenser de m’y arrêter. Elle est
précédée d’un frontispice ainsi conçu : Ludovici
Trossii | ad | Julium Fleutelot | collegii regii Borbonici
quod Parisiis floret | professorem meritissimum | De codice | quo amplissimus
continetur Phaedri paraphrastes | olim Wisseburgensi, | nunc Guelpherbytano, |
Epistola. | Hammone, | Typis Schulzianis, | MDCCCXLIV.
Dans la lettre elle-même, Tross commence par expliquer que c’est M. Fleutelot qui, en rappelant que Gude avait fait mention du manuscrit de Wissembourg, lui avait donné l’idée de le rechercher ; que Lessing ayant attentivement examiné les manuscrits de Gude et n’ayant pas parlé de celui de Wissembourg, il avait d’abord été porté à croire qu’il ne pouvait se trouver dans la bibliothèque de Wolfenbüttel où tous les siens étaient conservés ; qu’enfin il lui avait été signalé par le catalogue de F.-Ad. Ebert, intitulé : Bibliothecæ Guelpherbytanæ codices græci et latini classici ; Lipsiæ, 1827 ; p. 3, nº 15 ; et qu’il en avait aussitôt demandé communication à M. Schönemann, conservateur de la bibliothèque ducale, qui s’était empressé d’accéder à son désir.
Après cette entrée en matière, Tross donne du manuscrit la
description que voici : « Le ms. (Gud. 148), qui est de forme presque
carrée, a 9 pouces de haut et 7 de large. Les feuillets sont en vélin, tantôt
mince, tantôt épais, d’une blancheur dont ni la vétusté, ni l’humidité n’ont
modifié la nuance naturelle. Leur écriture lombarde du commencement du xe siècle se distingue par la très grande élégance des
caractères arrondis et pleins, telle qu’elle se montre d’ordinaire dans les plus
beaux manuscrits de cette époque. Les lettres initiales et presque toutes celles
des titres sont écrites à l’encre rouge, et occupent une hauteur de trois
lignes, excepté dans les titres où, quoique toujours en rouge, elles sont un peu
plus petites, mais toujours élégantes et très semblables à celles que présente
le très ancien Virgile des Médicis, reproduit, à l’aide de la typographie, par
les soins de Pierre-François Foggini, en l’année 1741. Les lettres qu’on nomme
minuscules sont à l’encre noirâtre, mais claires et nettes. Les abréviations
sont moins nombreuses, et les signes de ponctuation sont entièrement les mêmes
que ceux observés par Berger [de Xivrey] dans le manuscrit de Pithou ; les
échanges de lettres sont également semblables. Souvent inquit
{p. 276}s’écrit inquid, et atque, adque ; ce que les personnes compétentes savent usuel dans tous
les manuscrits très anciens. Le manuscrit se compose de 124 feuillets, dont le
premier a été par une main récente marqué de la lettre A, et dont les autres
sont numérotés de 1 à 123. Chaque page a 27 lignes, excepté quand il a été
laissé entre les fables, ce qui est fréquent, un espace blanc de 5 lignes et
même davantage. La couverture du livre se distingue par des plats en bois,
couverts de cuir et ornés de clous ronds en cuivre ; elle paraît remonter
presque au xve siècle. Du même âge est
l’inscription suivante, qui apparaît en tête du premier feuillet : Liber monasterii scōrum petri pauli aplor. in wisszenburg. In
claustro297. »
Tross fait ensuite observer que le manuscrit a été tout entier écrit par la même main, et cela, malgré les ouvrages très dissemblables qu’on y trouve et dont il donne la nomenclature suivante :
Fol. 1 a à 59 b. — Ouvrage
intitulé : Juliani Toletani prognosticorum futuri seculi libri
tres.
Fol. 60 a. — Courtes explications des mots Allegoria, Ænigma, Tropologia, Parabola, Paradigma, Prosa, Dialogus et Apologeticus, et petit traité De Octo vitiis.
{p. 277}Fol. 60 b à 82 a. — Fables latines commençant par ce titre : Incipit liber Esopi : magis-|tro rufo298 æsopus | sa — lu
— tem.
Fol. 82 b à 98 a. — Glose d’un anonyme sur le Cantique des Cantiques.
Fol. 98 b à 108 a. — Livre d’un anonyme sur la nature de certains animaux.
Fol. 109 a et suivants jusqu’à la fin. — Deux
traités : 1º De diuersis monstrorum generibus LVII
capita
, 2º De belluis et serpentibus LX
capita.
Abordant alors l’examen des fables, Tross observe qu’elles sont
divisées en cinq livres, composés : le premier d’un prologue et de 14 fables, le
deuxième, de 11 fables, le troisième, de 11, le quatrième, de 16, et le cinquième,
de 11. De leur division en cinq livres il conclut que toutes ont bien leur origine
dans l’œuvre de Phèdre, dont le copiste a suivi la division. À l’appui de sa thèse
il puise un nouvel argument dans le titre même du deuxième livre qui est ainsi
conçu : Incipit liber secundus Aesopi Fabri. « Quel est,
s’écrie-t-il, celui qui, sous ce dernier mot, ne reconnaît pas immédiatement le
nom de Phèdre lui-même299 ? »
Si j’avais à discuter les raisons fournies par Tross, je dirais peut-être qu’elles sont un peu puériles. La division en cinq livres du manuscrit de Wissembourg ne pourrait servir d’argument, que si celles des fables connues de l’auteur ancien qui s’y retrouvent appartenaient aux mêmes livres ; et l’on verra plus loin qu’il n’en est nullement ainsi. Et quant au mot Fabri, Tross, avant d’être si affirmatif, aurait pu au moins se demander si ce n’était pas une expression figurée, employée pour caractériser l’esprit inventif et créateur du vieil Ésope, ou plutôt, comme l’ont supposé M. Hermann Oesterley et, après lui, M. Lucien Müller300, l’abréviation irrégulière du mot fabularum. Mais je ne m’attarde pas à ces détails, d’autant plus qu’au fond je reconnais avec Tross que les fables du manuscrit de Wissembourg sont bien toutes dérivées de Phèdre.
Une autre vérité incontestable, dont j’ai ailleurs fait la démonstration, {p. 278}c’est que l’œuvre du fabuliste romain n’a jamais eu de sixième livre, et que, si le manuscrit de Wissembourg, comme les autres, renfermait des fables étrangères au manuscrit de Pithou, cela tenait à ce que ce dernier était incomplet. Tross veut que cette vérité ressorte de la division de son manuscrit en cinq livres ; mais, ainsi que je l’ai déjà fait observer, le défaut d’accord entre les deux manuscrits dans le groupement des fables ôte ici encore toute valeur à son raisonnement.
Après avoir ainsi voulu démontrer et n’avoir en réalité que constaté la provenance phédrienne de ces fables, il entre dans le cœur de son sujet, et se demande quelle est leur importance philologique. Il est obligé d’avouer que deux circonstances très graves leur ont été bien funestes.
La première, c’est l’ignorance du copiste, sur laquelle il insiste
avec raison, et, pour en donner une idée, il cite, parmi les titres de fables, les
suivants : De mus parturiens
, de naturale genus
, de taciturnitate
hominibus
.
La seconde circonstance a été la fièvre de correction, éprouvée au xie siècle par un copiste moins ignorant, qui, dans le désir de donner un sens à ce qui était incohérent, a quelquefois métamorphosé des lignes entières. À cet égard il appelle l’attention sur les fables 5, 8 et 12 du livre I, 1, 4, 8 et 10 du livre II, 2, 3, 5, 8 et 14 du livre III, 4 et 12 du livre IV, et 5, 7 et 9 du livre V.
Ces deux circonstances l’empêchent de considérer le manuscrit de Wissembourg comme susceptible d’offrir un point d’appui solide pour la restauration du texte de ceux de Pithou et de Reims ; mais il estime néanmoins qu’il n’est pas non plus le moins du monde à dédaigner, tamen minime esse spernendum. Suivant lui, à tout versificateur qui veut reconstituer les ïambes phédriens, ce manuscrit donne des facilités qui ont manqué à Gude, à Burmann et à Dressler. En parlant ainsi pour Burmann et pour Dressler, il a raison ; mais à l’égard de Gude il oublie évidemment que ce dernier a été propriétaire du manuscrit.
Voulant justifier sa proposition, lui-même il restitue ainsi, sans presque rien changer, la fable intitulée Vulpis in hominem versa :
Naturam turpem nulla fortuna obtegit.Humanam in speciem quum vertisset IupiterVulpem, legitimis ut consedit in toris,{p. 279}Scarabeum vidit prorepentem in anguloNotamque ad prædam celeri prosiluit gradu.Superi risere, magnus erubuit paterVulpemque repudiatam thalamis expulit,His prosequutus : Vive, quo digna es, modo,Quia digne nostris meritis uti non potes.
Tross propose pour ce dernier vers cette variante :
Quia digna nostris meritis uti non potes.
Passant ensuite aux derniers opuscules du manuscrit, il prétend qu’il jette un jour complet sur la question du feuillet arraché de celui de Pithou. Il ne déclare pas seulement, comme M. Berger de Xivrey, que, si ce feuillet a existé, il ne contenait rien qui se rapportât à Phèdre ; il va plus loin : non seulement, suivant lui, l’affirmation de Pithou ne permet pas de contester qu’il ait existé, mais encore il affirme qu’il contenait le commencement du traité De Monstris, dont les premiers mots n’étaient pas et ne pouvaient pas être les mots primo namque.
Pour qu’on n’en doute pas, il transcrit le titre du traité ainsi
conçu : Incipit liber mons|trorum de diversis | ge — ne — ri
— bus
, et à la suite le prologue dont voici les premiers mots :
De occulto orbis terrarum situ interrogasti, et si tanta
monstrorum esse genera credenda
, etc.
Tross ajoute qu’entre ce prologue et la partie de l’ouvrage que M. Berger de Xivrey a prise à tort pour le commencement, se place la table des 57 chapitres qui traitent des Monstres, et il prend le soin de la transcrire ; il donne même quelques extraits de certains chapitres.
Passant enfin au traité De Belluis ac Serpentibus, il en extrait aussi quelques passages, qui n’ont ici aucun intérêt et que je m’abstiens de reproduire.
Il termine sa lettre, en expliquant que, si Lessing a gardé le silence sur le manuscrit, cela tient à ce que, à cause de l’ouvrage de Julien Toletan et de quelques autres opuscules théologiques, il avait été, à Wolfenbüttel, classé parmi les livres de théologie, dans lesquels, à défaut d’un catalogue soigneusement dressé, il n’avait pu le découvrir.
Telle est la savante lettre latine que Tross écrivit de Hamm à M. Fleutelot au mois de mai 1844.
{p. 280}En somme, elle contenait une analyse consciencieuse du manuscrit. Mais cela ne me suffisait pas. Je sentais bien que je devrais finir par surmonter la répugnance que, sous l’influence d’événements encore récents, j’éprouvais à me mettre en relation avec un Allemand même érudit ; mais, avant de m’y décider, je voulus voir si je ne pourrais pas trouver dans quelque autre ouvrage des renseignements plus complets.
Je me rappelai que, quoique je ne lui eusse pas encore fait la visite qu’un peu plus haut j’ai racontée, je m’étais déjà mis par lettre en rapport avec le conservateur des manuscrits de la bibliothèque de Leyde, et qu’il m’avait engagé à prendre connaissance de la petite brochure, dans laquelle M. H. Oesterley avait publié le Romulus de Burney301. À l’époque où il m’avait donné ce conseil, je m’étais empressé de me faire expédier plusieurs exemplaires de l’ouvrage qui m’était signalé. J’y recourus, et je trouvai, dans la préface allemande qui précède le texte du manuscrit de Burney, une description et une appréciation du manuscrit de Wissembourg.
Malheureusement ce n’était qu’une analyse de l’analyse de Tross,
ainsi qu’on va pouvoir en juger par cette traduction du passage qui concerne le
manuscrit : « Ce manuscrit, malgré les. efforts faits pour attirer
l’attention du public, n’a pas encore été utilisé complètement pour la critique
de Phèdre. Il est écrit en beaux caractères, mais déplorablement fautif, et date
du commencement du xe siècle. Les fables qui y
figurent sous le nom d’Ésope remplissent les feuillets 61 à 82 ; le titre Incipit liber Ysopi et l’épigraphe Magistro Rufo
Æsopus salutem sont au bas du feuillet 60 b. Les fables
sont divisées en 5 livres ; chacun d’eux, sauf le premier, est précédé d’une
table spéciale. Le premier contient 14 chapitres ; le deuxième et le troisième,
11 ; le quatrième, 16, et le cinquième, 11, bien qu’intitulé inexactement comme
en contenant 12. Cette division en 63 numéros est inexacte, attendu que
plusieurs morceaux sont partagés en deux chapitres, soit par suite de
l’ignorance du scribe, soit par suite du désordre de son modèle. Les nos IV, 5 et 13, comme Tross l’a fait remarquer, ne forment
qu’une fable ; le no V, 6 n’est que l’introduction du
morceau suivant ; le no V, 8 est {p. 281}un morceau détaché de la préface primitive, ainsi qu’en justifie le numéro
correspondant IV, 23 du manuscrit de Burney et de celui de Dijon. Cette
composition est dans sa division, comme dans la suite des chapitres, tout à fait
différente du manuscrit de Phèdre et du texte original de Romulus ; mais elle ne
contient rien qu’on ne trouve dans Romulus, excepté les deux morceaux V, 9 et 10
qui précèdent immédiatement l’épilogue. Ces deux morceaux sont particulièrement
importants, en ce sens que quelques changements fort légers suffisent à rétablir
les ïambes primitifs, ainsi que Tross l’a démontré pratiquement, pages 13 et 31.
Les autres fables du manuscrit de Wissembourg sont très voisines de celles de
Phèdre ; elles s’en rapprochent même beaucoup plus que les plus anciens
manuscrits de Romulus. C’est bien certainement, non pas une copie modifiée de
Romulus, mais une paraphrase particulière et plus délicate. J’ose même prétendre
que le modèle sur lequel le précédent copiste a travaillé était simplement une
copie maladroitement faite de quelque manuscrit de Phèdre défectueux ou
incomplet, et que ce copiste, peu habitué aux ïambes et les considérant comme de
la simple prose, détruisait les vers et les altérait à sa fantaisie. Je parle
ainsi du texte sur lequel a été fait ensuite le manuscrit de Wissembourg, et non
pas de ce manuscrit lui-même ; car celui qui l’a fait savait évidemment trop peu
le latin pour y introduire à dessein le moindre changement. Ce qu’il a altéré
l’a été involontairement, et ne doit être attribué qu’à son ignorance
véritablement incroyable. »
J’aurais bien ici quelques erreurs à signaler dans cette
appréciation de M. H. Oesterley ; mais, comme j’aurai ailleurs l’occasion
naturelle d’exprimer ma pensée, je ne veux pas interrompre davantage cette
citation et je la continue : « Quelque rapprochée de l’original que soit
cette antique paraphrase, ajoute le critique allemand, elle ne donnait pas à
Tross le droit de s’écrier à propos de l’épigraphe du livre II Incipit liber II Æsopi fabri : “Qui ne voit pas à l’instant même le nom
de Phèdre caché dans ce dernier mot ?” Je prétends en toute modestie que ce mot
fabri n’est que l’abréviation mal comprise du mot fabularum, qu’on trouve aux endroits correspondants de tous les
autres livres. Pourtant la délicatesse de la paraphrase donne à ce manuscrit une
véritable valeur pour la critique du poète romain ; elle est bien supérieure en
effet à celle de {p. 282}Romulus, le deuxième paraphraste, et la
publication de ce texte aurait été pour cette raison une tâche très méritoire.
Malheureusement un obstacle invincible s’y oppose. Le manuscrit est tellement
défectueux, et copié avec une si profonde ignorance de la langue, qu’il est
impossible de songer à l’éditer sans le métamorphoser par un travail de critique
préalable, qui pourrait bien réduire à rien son importance philologique. Ce
travail ne pourrait même s’exécuter qu’en allant contre le but de l’éditeur,
parce qu’une main du xie siècle a jadis entrepris
la critique du manuscrit sur le manuscrit lui-même. Cette seconde main a corrigé
avec tant d’ardeur et elle a été notamment si prodigue de ratures sur lesquelles
elle a fait ses corrections, qu’il est presque impossible de rétablir les mots
primitifs, qui, en certains endroits, ont presque entièrement disparu. Ces
corrections se continuent jusqu’à la fin du IVe livre ; dans
le Ve il n’en existe que d’insignifiantes, encore bien
qu’il aurait eu aussi grand besoin d’être révisé. Peut-être ce travail a-t-il
fini par paraître trop pénible. En beaucoup de cas, le correcteur s’est guidé
sur une autre paraphrase et notamment, comme les épigraphes l’établissent, sur
le texte de Romulus. Aussi ses corrections atteignent-elles souvent la valeur
d’un manuscrit, tandis que quelquefois elles sentent un peu la fantaisie, et
vont même jusqu’à supprimer des leçons indubitablement exactes. »
Ces observations n’ajoutaient rien à ce que la dissertation de Tross m’avait déjà appris. De plus en plus surexcitée par les obstacles, ma curiosité l’emporta sur tout autre sentiment, et je dois, pour rendre hommage à la vérité, dire que je n’ai pas eu lieu de me repentir de ma démarche. J’écrivis à M. von Heinemann, conservateur de la bibliothèque de Wolfenbüttel, pour le prier de faire exécuter pour moi, moyennant rémunération pécuniaire, la copie du manuscrit de Wissembourg. Ses notions paléographiques lui ayant permis de la prendre lui-même, il s’empressa de répondre personnellement à mon désir et de m’adresser une copie littérale des fables, accompagnée des ratures et des corrections du manuscrit reproduites avec une scrupuleuse fidélité.
C’est ainsi que j’ai pu le publier dans ma première édition. Mais, comme, malgré toute ma vigilance, je n’étais pas bien sûr d’en avoir reproduit toutes les particularités avec une parfaite exactitude, je me suis, en 1890, décidé à me rendre à Wolfenbüttel, {p. 283}et là j’ai fait du manuscrit une étude attentive qui me fournit aujourd’hui les moyens d’éviter, en l’étudiant de nouveau, les inévitables erreurs de détail, que, faute de l’avoir vu, j’avais nécessairement commises.
§ 2. — Étude directe du manuscrit. §
Ainsi que Tross l’avait déjà fait remarquer, le manuscrit de Wissembourg porte la cote 148 Gud. Pour m’en faire connaître le sens, M. von Heinemann a bien voulu me donner, sur l’organisation de la bibliothèque de Wolfenbüttel, quelques renseignements qu’il n’est peut-être point inutile de consigner ici.
Les manuscrits s’y divisent en sept classes, basées sur leur origine. Suivant la classe à laquelle ils appartiennent, on les appelle Gudiani, Augustei, Helmstadienses, Blankenburgenses, Weissemburgenses, Extravagantes et Novi, et, par abréviation, Gud., Aug., Helm., etc. Chacune de ces classes a sa série de numéros indépendante, de sorte que, pour désigner un manuscrit quelconque, il faut à la fois indiquer son numéro et sa classe.
Pour les livres imprimés un système tout différent a été adopté : ce sont les matières qui ont été prises pour base, et l’on a créé, dans cet ordre d’idées, les classes appelées Juridica, Theologica, Historica, Ethica, Poetica, etc. Cette classification, qui remonte à la création de la bibliothèque, a été imaginée par Auguste le Jeune, duc de Brunswick, qui en fut le fondateur et qui mourut en 1666.
La cote du manuscrit de Wissembourg montre que non seulement Gude l’avait connu, mais qu’encore il en avait été propriétaire. De qui le tenait-il ? Il n’est pas supposable que les moines de l’abbaye des saints Pierre et Paul, à qui il avait appartenu, aient consenti à le lui donner ni même à le lui vendre. Il est probable que, bien avant d’entrer dans ses mains, le manuscrit était plus ou moins régulièrement sorti de celles de ses propriétaires légitimes, et que Gude, l’ayant trouvé dans le commerce, en avait pu faire ainsi l’acquisition.
En 1710, après sa mort, Leibnitz, alors bibliothécaire du duc de Brunswick, avait en cette qualité acheté sa bibliothèque au prix de mille thalers, et c’est ainsi que le précieux manuscrit est passé dans celle de Wolfenbüttel.
{p. 284}Quant au volume lui-même, depuis la publication de ma première édition ayant été à Wolfenbüttel en prendre connaissance, c’est à bon escient que je vais à mon tour l’analyser.
Les 123 feuillets numérotés dont il se compose sont précédés de deux autres. Le premier des deux qui avait été ajouté par le relieur et qui, collé par lui sur la face interne du premier des plats, en a été ensuite détaché, a été à bon droit négligé dans le numérotage. Il en est autrement du second, qui, portant en gros caractères rouges et noirs le titre du premier ouvrage du manuscrit, n’aurait pas dû être omis. Il a été pourvu de la lettre A.
Je passe aux feuillets numérotés.
Fol. 1 a. — Au haut de la page le bibliothécaire
Ebert a donné, de sa main, au premier ouvrage le titre suivant : Juliani episcopi toletani prognostica futuri seculi.
Fol. 59 b. — Fin du premier ouvrage terminé par
cette souscription en capitales à l’encre rouge : Explicit
liber prognostico|rum feliciter | dō gratias. amen.
Fol. 60 a à 60 b. — Grammatica quædam de octo vitiis.
Fol. 60 b. — Le bas de la page porte, à l’encre
rouge, en lettres capitales ce titre annonçant les fables : Incipit liber ysopi.
Fol. 82 a. — Fin des fables closes par cette
souscription en grosses lettres rouges : Expliciunt aesopi
fabularum libri numero quinque. Deo gratias. Amen.
Au bas de la
même page, en lettres semblables écrites avec la même encre, on lit l’hexamètre
suivant qui sert de titre à un nouvel ouvrage : Hunc cecinit
| Salomon mira dulcedine librum.
Fol. 82 b. — Au haut de la page, trouvant sans
doute trop vague le titre qui précède, le bibliothécaire Ebert a ajouté celui-ci :
Scholia in canticum canticorum.
Ces scholies
se terminent au bas du feuillet 98 a.
Fol. 98 b. — Le titre suivant a été écrit par
Ebert au haut de la page : Anonymi liber de monstris, belluis,
serpentibus
, etc. Il s’est trompé. L’opuscule qui commence en cet
endroit, est un autre traité sur la nature de certains animaux qui s’achève au
fol. 108 b.
Fol. 108 b. — Au bas de la page le traité De Monstris est annoncé par cette phrase écrite à l’encre rouge en
gros caractères : Incipit liber monstrorum de diversis | ge
ne ri bus.
Fol. 109 a. — La page est tout entière occupée
par le prologue {p. 285}transcrit par Tross. Il se termine à la
première ligne du verso du même feuillet. La même ligne est complétée par ce titre
à l’encre rouge : Incipit capitulum
monstrorum.
Fol. 109 b à 110 a. — Table des
chapitres au nombre de 57, qui, au bas du fol. 110 a, est suivie
de cette souscription en lettres rouges : Finiunt capitula
monstruorum (sic).
Fol. 110 b. — Le commencement du feuillet est
occupé par ce second préambule : Primo namque de his ad ortum sermo
prorumpit. quae leuiora discreto ab humano genere distant daturus operam. de
singulis quae terra fouet mortalium nutrix aut condam fouisse fertur. quae nunc
humano generi multiplicata. et terra orbe repleto sub astris minus producentur
monstraque ab ipsis per plurimos terrae angulos eradicata funditus et sub terra
legimus et nunc reuulsa litoribus prona torquentur ad undas quaeque turbidine
poli uerticae (sic) sub arduo ac totius giri ambitu et omni terrarum ad hanc
uastam gurgitis se uoraginem uertunt.
Fol. 110 b à 115 b. — Ces
feuillets sont remplis par les 57 chapitres, clos, au bas du feuillet 115 b, par cette souscription à l’encre rouge : Finit liber de monstruis (sic).
Ces mots sont
eux-mêmes suivis de ces autres : Incipit liber secundus de
belluis
, qui écrits avec la même encre en grosses capitales
occupent la dernière ligne de la page.
Fol. 116 a. — Table des 55 chapitres du deuxième
livre, close par cette souscription en grosses lettres à l’encre rouge :
Expliciciunt capitula de marinis
belluis.
Fol. 120 b. — Fin du deuxième livre, terminé au
milieu de la page par ces mots à l’encre rouge : Finit de
belluis
, suivis de ce titre du troisième livre en grosses
capitales écrites avec la même encre : Incipit de
serpentibus.
Ce troisième livre n’est précédé d’aucune table.
Fol. 123 b. — Fin du troisième livre, au milieu
de la page, par cette souscription en grosses capitales rouges : Finit de serpentibus dō | gra | tias | a | m | e |
n.
On a sans doute deviné pourquoi j’ai donné un tel développement à l’analyse du manuscrit de Wissembourg. J’ai ainsi implicitement résolu le problème relatif au contenu du feuillet qui manque au manuscrit de Pithou. Ce feuillet très certainement ne portait aucune fable de Phèdre. Le manuscrit de Reims qui {p. 286}était identique à celui de Pithou et qui s’arrêtait au même point, en eût au besoin fourni la preuve. Ce que le feuillet enlevé ne contenait pas, nous le savions ; ce qu’il contenait, le manuscrit de Wissembourg nous l’apprend : c’est le Prologue et la Table des 57 chapitres du traité De monstris, qui, tandis que, dans ce manuscrit, ils occupent trois pages, n’en remplissaient que deux dans celui de Pithou ; ce qui semble tout naturel, quand, grâce au fac-similé qui existe dans l’édition de M. Berger de Xivrey, comparant les deux écritures, on voit que celle du manuscrit de Wissembourg est sensiblement la plus grosse.
Je reviens maintenant à ce qui dans ce manuscrit m’intéresse plus particulièrement, c’est-à-dire aux fables. Je vais d’abord en donner la nomenclature avec l’indication de celles du poète romain, dont elles sont indirectement issues.
| Wissembourg. | Phèdre. |
| Prologue. | |
| I, 1. Le Loup et l’Agneau. | i, 1. |
| I, 2. Le Chien et la Brebis. | i, 17. |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | |
| I, 4. Les Lièvres et les Grenouilles. | |
| I, 5. Le Loup et le Chevreau. | |
| I, 6. Le Chien et l’Ombre. | i, 4. |
| I, 7. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | i, 5. |
| I, 8. Le Soleil qui se marie. | i, 6. |
| I, 9. Le Loup et la Grue. | i, 8. |
| I, 10. La Chienne qui met bas. | i, 19. |
| I, 11. L’Âne et le Sanglier. | i, 29. |
| I, 12. Le Serpent et le Pauvre. | |
| I, 13. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | i, 16. |
| I, 14. Le Chauve et la Mouche. | ivb, 4. |
| II, 1. Le Rat de ville et le Rat des champs. | |
| II, 2. L’Aigle et le Renard. | i, 28. |
| II, 3. Le Renard et la Cigogne. | i, 26. |
| II, 4. Le Geai vaniteux. | i, 3. |
| II, 5. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | ii, 6. |
| II, 6. La Mouche et la Mule. | iii, 6. |
| II, 7. Le Corbeau et le Renard. | i, 13. |
| II, 8. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | i, 12. |
| II, 9. L’Homme et la Belette. | i, 22. |
| II, 10. L’Âne qui caresse son maître. | |
| II, 11. Le Lion et le Rat. | |
| III, 1. Le Lion et le Berger. | |
| {p. 287}III, 2. Le Lion médecin. | |
| III, 3. Le Cheval et l’Âne. | |
| III, 4. Le Rossignol et l’Épervier. | |
| III, 5. Le Renard et le Loup. | |
| III, 6. La Tête sans cervelle. | i, 7. |
| III, 7. Les Grenouilles qui demandent un roi. | i, 2. |
| III, 8. Les Colombes et le Milan. | i, 31. |
| III, 9. Le Chien et le Voleur. | i, 23. |
| III, 10. Le Cerf à la Fontaine. | i, 12. |
| III, 11. Junon et Vénus. | App. 11. |
| IV, 1. La Courtisane et le Jeune homme. | App. 29. |
| IV, 2. Le Serpent mourant de froid. | iva, 19. |
| IV, 3. La Puce et le Chameau. | |
| IV, 4. Le Loup accoucheur. | App. 19. |
| IV, 5. Le Marchand et l’Âne. | iva, 1. |
| IV, 6. Le Cerf et les Bœufs. | ii, 8. |
| IV, 7. Le Loup et le Chien. | iii, 7. |
| IV, 8. La Vipère et la Lime. | iva, 8. |
| IV, 9. Les Loups et les Brebis. | |
| IV, 10. La Hache et les Arbres. | |
| IV, 11. L’Estomac et les Membres. | |
| IV, 12. Le Singe et le Renard. | App. 1. |
| IV, 13. (Voir IV, 5.) | |
| IV, 14. La Montagne en mal d’enfant. | iva, 23. |
| IV, 15. Le Père et le mauvais Fils. | App., 12. |
| IV, 16. (Voir IV, 6.) | |
| V, 1. Le Chien vieilli et son maître. | v, 5. |
| V, 2. Le Lion roi et le Singe. | iva, 13. |
| V, 3. Les Raisins trop verts. | iva, 3. |
| V, 4. Le Paon et Junon. | iii, 18. |
| V, 5. La Panthère et les Paysans. | iii, 2. |
| V, 6. Le Coq et la Perle. | iii, 12. |
| V, 7. (Voir V, 6.) | |
| V, 8. (Voir le Prologue.) | |
| V, 9. Le Renard changé en homme. | |
| V, 10. Le Taureau et le Veau. | v, 4. |
| V, 11. La Statue d’Ésope. | ii, Epil. |
Du tableau comparatif qui précède il résulte que le manuscrit de Wissembourg contient, en outre de celles de Phèdre actuellement connues, dix-sept autres fables qui ont la même origine ; ce sont les fables i 3, i 4, i 5, i 12, ii 1, ii 10, ii 11, iii 1, iii 2, iii 3, iii 4, iii 5, iv 3, iv 9, iv 10, iv 11 et v 9. Ajoutons que cinq de ces dix-sept {p. 288}fables n’existent pas dans les Fabulæ antiquæ ; ce sont celles intitulées : les Lièvres et les Grenouilles, le Loup et le Chevreau, le Lion médecin, la Hache et les Arbres, l’Estomac et les Membres.
On comprend dès lors l’intérêt que présente le manuscrit de Wissembourg ; car, la collection des Fabulæ antiquæ étant muette et le texte du Romulus primitif, malgré une parenté très proche avec celui de Wissembourg, s’écartant quelquefois davantage de celui de Phèdre, il s’ensuit que, pour la restitution de ce dernier dans les fables ci-dessus énumérées, le manuscrit qui nous occupe devient un document précieux.
Et cependant il ne faut pas non plus se faire trop d’illusion ; car, s’il se rapproche beaucoup de l’œuvre originale, on ne doit pas oublier qu’il est lui-même l’œuvre d’un copiste ignorant, qui, en commettant les fautes les plus grossières, a beaucoup nui à sa valeur philologique. Il est bien vrai que ses fautes ont été corrigées au xie siècle par une seconde main moins illettrée ; mais le correcteur tantôt s’est borné à rétablir à sa fantaisie, sans le secours d’aucun texte, les phrases défigurées, tantôt a recouru au texte qu’il avait sous la main et qui par malheur n’était ni celui de Phèdre, ni même celui du Romulus primitif. L’examen comparatif auquel je me suis livré m’a clairement démontré qu’il s’est servi d’une collection dérivée du Romulus primitif dont je parlerai plus tard et à laquelle je donnerai le nom de Romulus de Vienne. Il en est résulté que le remède a été en certains endroits pire que le mal.
Comme dans l’examen des Fables antiques, je prends encore pour terme de comparaison la fable intitulée le Geai vaniteux. La voici telle qu’elle existe dans le manuscrit de Pithou :
Ne gloriari libeat alienis bonis,Suoque potius habitu vitam degere,Æsopus nobis hoc exemplum prodidit.Tumens inani Gragulus superbia,Pennas Pavoni quæ deciderant sustulit,Seque exornavit. Deinde contemnens suos,Immiscuit se Pavonum formoso gregi.Illi impudenti pennas eripiunt avi,Fugantque rostris. Male multatus GragulusRedire merens cœpit ad proprium genus ;{p. 289}A quo repulsus tristem sustinuit notam.Tum quidam ex illis quos prius despexerat :« Contentus nostris si fuisses sedibus,Et quod natura dederat voluisses pati,Nec illam expertus esses contumeliam,Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas. »
Je passe maintenant à la fable correspondante du manuscrit de Wissembourg, et, pour faciliter les rapprochements, je la divise en autant de lignes qu’il existe de vers dans l’œuvre de Phèdre. La voici d’abord avec ses leçons primitives telles qu’on les aperçoit sous les corrections de la seconde main :
Ne que de alienis bonis dum magnum se vellit proferre,suaque pocius modico ornetur.Æsopus enim hoc exemplum per fabula prodidit nobis.Tumens garulus inanis superbia,pennas pavonis que ceciderant sustulitet se optime ornavit. Deinde contemnens suos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .innoto et inprudenti vano pennas iratusinjuriosas eruit. Male acceptus ille garulus dixit :Redire me ad propriam genus ibi multos ornatum contempserim.Tunc tristem sustenuit notam sumpsitque iniquam famam.Tunc quidam unus ex illis ait quos prius injuriis dispexerat :Contemptus nostri fuisset sedibus,et quod natura dederat voluisset nobiscum pati.Ne illam sustineres injuriamnec a nobis pulsus dolores.
Voici maintenant la même fable modifiée par la deuxième main sur le même manuscrit :
De alienis bonis dum magnum se vellit proferre,suaque pocius modico ornetur.Æsopus enim hoc exemplum per fabulam prodidit nobis.Tumens graculus inanis superbia,pennas pavonis que ceciderant sustulit,et se optime ornavit. Deinde contemnens suos,gregi pavonum se miscuit.Sed illi ignoto et impudenti vano pennas irati{p. 290}injuriose eripiunt. Male acceptus ille garulus dixit :Redire erubesco ad proprium genus ubi multos ornatus contempseram.Tunc tristem sustinuit notam sumpsitque iniquam famam.Tunc unus ex illis ait, quos prius injuriis dispexerat :Si contemptus nostris fuisses sedibus,et quod natura dederat voluisses nobiscum pati,nec illam sustineres injuriam,nec a nobis pulsus doleres.
La première impression que doivent laisser ces rapprochements,
c’est que, malgré les graves altérations du texte primitif, il se révèle partout
ostensiblement, et en certains endroits avec assez d’exactitude, pour laisser
apparaître les ïambes antiques. Il est donc tout d’abord impossible de méconnaître
l’importance philologique du manuscrit. Mais en même temps, dès qu’on entre un peu
dans les détails, on s’aperçoit que malheureusement cette valeur réelle est
amoindrie par cette double circonstance que le copiste était absolument étranger à
la langue latine, et que le correcteur n’a pas pris la peine de recourir à la
vraie source que d’ailleurs il ne connaissait peut-être pas. Ainsi, par exemple,
le copiste avait écrit Garulus et inprudenti
; le correcteur ensuite y substitue bien les mots
Graculus et impudenti
, qui,
si le bon sens ne les lui a pas suggérés, ont pu lui être fournis par toutes les
collections de fables latines ; mais, deux lignes plus loin, c’est à sa seule
imagination que, dans son désir de faire avec des mots incohérents une phrase
intelligible, il emprunte le mot doleres qui n’existe ni dans
l’œuvre originale ni dans ses dérivés directs ou indirects.
Je pourrais faire sur d’autres fables des remarques semblables ; mais je ne veux pas me livrer en cet endroit à une étude comparative qui trouvera ailleurs sa place naturelle. Ici je me borne à ces premières observations que j’aurai plus loin l’occasion de compléter.
§ 3. — Apographe du manuscrit de Wissembourg. §
Comme le manuscrit de Leyde, celui de Wissembourg a eu son apographe.
{p. 291}Bien longtemps avant qu’il n’eût été acquis par Gude, il en avait été fait une copie que j’ai retrouvée depuis la publication de ma première édition et qui m’a paru remonter, sinon à la fin du xvie siècle, au moins au commencement du xviie.
Cette copie est d’une rigoureuse exactitude, et les fautes du modèle, soit par ignorance, soit plus vraisemblablement par système, y ont été religieusement respectées.
Malheureusement, avant de former avec d’autres cahiers le manuscrit auquel aujourd’hui elle appartient, les deux ou les quatre premiers feuillets, qui contenaient le Prologue et les huit premières fables du Livre I, n’existaient déjà plus, et avant la reliure ce qui manquait n’a pas été reconstitué.
J’aurais voulu savoir par qui cette copie avait été écrite, et, par cette voie indirecte, comment le manuscrit lui-même était parvenu à Gude. Mais, pour contenter mon envie, je n’aurais pu faire que de vaines recherches. Je m’en suis tout de suite aperçu et je ne les ai pas tentées.
Lorsqu’on examine quel a été dans le passé le sort de la copie, on ne peut pas se reporter à plus de deux siècles en arrière. C’est à cela que je vais me borner.
Le manuscrit dans lequel la copie a été englobée existe aujourd’hui, sous la cote 783, à la Bibliothèque du Lambeth palace où il fait partie du fonds Tenison.
Le Catalogue imprimé des manuscrits de cette Bibliothèque en donne
la courte analyse que voici : « Codex chartaceus
in-quarto, Æsopica ex Cod. Vet. Isaaci Vossii ; et Collectanea
Etymologica ad Glossarium Franco-Theotiscum, Gothicum, et Anglo-Saxonicum
spectantia. »
Le rédacteur du Catalogue qui avait ainsi décrit le manuscrit,
n’avait pas pris la peine d’en examiner le contenu ; il s’en était rapporté, en la
copiant littéralement, à cette mention placée en tête du volume : « Æsopica
ex Cod. Vet. Isaaci Vossii. | Item collectanea Etymologica | ad Glossarium
Franco-Theotiscum, | Gothicum et Anglo-Saxonicum spectantia. »
Or l’auteur de cette mention avait fait une singulière confusion : ce qu’il avait pris pour la copie du manuscrit de Leyde, c’était la copie du manuscrit de Wissembourg.
Cette erreur s’explique aisément, quand on sait par qui elle a {p. 292}été commise. Les manuscrits de la Bibliothèque du Lambeth palace ont plusieurs origines. Celui dont il s’agit ici est de ceux que le Catalogue appelle Codices Tenisoniani et qui sont ainsi nommés parce qu’ils proviennent de Thomas Tenison, archevêque de Cantorbery, mort en 1716. Légués par lui à la Bibliothèque, ils y portent les cotes 639 à 928.
C’est lui qui est l’auteur de la mention erronée. Le bibliothécaire actuel, M. Kershaw, à qui je l’ai montrée, a parfaitement reconnu l’écriture de l’archevêque. On conçoit aisément que Tenison se soit trompé. D’une part le manuscrit de Wissembourg n’était alors connu que de Gude qui n’en avait révélé l’existence que par deux citations dans ses notes sur Phèdre publiées après sa mort en 1698 par le savant Pierre Burmann. D’autre part il est probable que Tenison s’était lié avec Isaac Vossius qui, dans la dernière phase de son existence, avait longtemps habité l’Angleterre, et, s’il n’avait pas été en relations avec lui, il avait au moins, par le Catalogue des manuscrits des Bibliothèques de l’Angleterre et de l’Irlande, imprimé en 1697, pu se rendre compte du contenu de celle de l’illustre bibliophile. Il avait pu y lire l’analyse sommaire du manuscrit des Fabulæ antiquæ et croire que ce qu’il possédait en était bien l’apographe. Quant au texte même du manuscrit, il n’avait pas dû le lire ; car il n’aurait pu en prendre connaissance, sans apercevoir la diversité d’origine.
Cela m’autorise à ajouter que la mention écrite par lui doit remonter à une date antérieure à 1709 ; car à cette date la publication par Nilant des Fabulæ antiquæ lui aurait complètement ouvert les yeux. Peut-être même l’avait-il rédigée avant la publication des notes de Gude sur Phèdre, c’est-à-dire avant 1697. Il ne faut pas, en effet, oublier qu’à cette date il était depuis deux ans en possession de son siège archiépiscopal ; ce qui fait supposer qu’il était alors d’un âge assez avancé pour avoir déjà pu former une grande partie de sa bibliothèque.
Mais de qui Tenison tenait-il son apographe, où avait-il été écrit et à quel copiste était-il dû ? Voilà ce que rien n’indique, de telle sorte que l’histoire des pérégrinations du manuscrit de Wissembourg, depuis sa sortie du monastère des saints Pierre et Paul jusqu’à son acquisition par Gude, est et sans doute restera enveloppée d’une impénétrable obscurité.
Section II.
Fables du Romulus primitif. §
{p. 293}Il a été expliqué que l’Æsopus ad Rufum ayant péri, il était nécessaire, pour savoir ce qu’il avait été, de bien connaître ses deux dérivés directs. Le premier a été étudié. Il s’agit maintenant de passer au second.
Malheureusement il a éprouvé le même sort que sa source : il a disparu, et c’est en m’aidant surtout du texte du dérivé qui dans cet ouvrage portera le nom de Romulus ordinaire, que je vais l’examiner.
§ 1. — Dissertation sur Romulus. §
Romulus ! Voilà un singulier nom, qui a fait perdre le sommeil à bien des philologues. N’en trouvant nulle part l’explication, ils se sont livrés aux suppositions les plus invraisemblables. Néanmoins, comme elles ont été imaginées par des hommes vraiment savants, j’ai le devoir d’en présenter au moins un aperçu rapide.
Le nom de Romulus rappelle involontairement le premier roi de Rome et son dernier empereur. Je n’ai pas besoin de dire que personne n’a songé à faire du frère de Remus un fabuliste. Mais ce qui paraîtra presque aussi excentrique, c’est que des critiques fort recommandables n’aient pas été éloignés d’attribuer cette qualité à Romulus Augustule. Il ne faut pas être trop prompt à les railler ; car leur erreur ne manquait pas de points d’appui.
Le plus ancien était le texte du Romulus de Nilant, dans lequel la
dédicace placée en tête des fables commence par ces mots : Romæ imperator Tiberino filio suo salutem.
Ce titre pompeux d’empereur, ainsi ajouté au nom de Romulus, lui fut maintenu dans les diverses collections de fables dérivées de celle de Nilant. Nous verrons plus loin que le Romulus que j’appellerai anglo-latin et qui en était issu, la lui avait conservée, que le traducteur anglais de ce Romulus agit de même, qu’enfin la femme supérieure, nommée Marie de France, qui fit en langue {p. 294}française la paraphrase poétique de la version anglaise, écrivit ces mots en tête de sa préface :
Romulus qui fu emperere,
Le Romulus anglo-latin n’avait pas été seulement traduit en
anglais. Il avait encore servi de base à des imitations latines, dont la plus
importante sera étudiée dans cet ouvrage sous la dénomination de Dérivé complet. En tête de ce Dérivé figure un prologue dans lequel on
peut lire ce qui suit : Liber igitur iste primo græce conscriptus est ab
Æsopo ; post hæc a Romulo imperatore romano ad instruendum
Tyberium filium suum, in Latinum venit.
Le prologue qui contient ces lignes paraît avoir été en grande faveur au moyen âge ; car il fut imprimé souvent au xve siècle en tête des éditions scolaires des fables de l’Anonyme de Névelet, qui n’étaient que l’imitation latine en vers élégiaques des trois premiers livres du Romulus ordinaire302.
Il me semble que cette qualification d’empereur romain donnée à un Romulus qui lui-même pouvait bien n’être qu’un personnage imaginaire n’aurait pas dû être prise au sérieux. Pourtant il en fut autrement : elle parut aux érudits digne d’être discutée.
À la fin du xviie siècle Gude, ayant l’intuition de la vérité, avait émis l’avis qu’elle n’avait été qu’un appât offert à la crédulité publique, et qu’elle devait par les critiques sérieux être considérée comme un de ces petits moyens de réclame, qui ont été de tout temps à la mode et dont Phèdre lui-même, en renvoyant à Ésope l’honneur de ses fables, avait, dans les vers suivants, déclaré faire un très large usage :
Æsopi nomen sicubi interposuero,Cui reddidi jampridem quidquid debui,Auctoritatis esse scito gratia,{p. 295}Ut quidam artifices nostro faciunt seculo,Qui pretium operibus majus inveniunt, novoSi marmori adscripserunt Praxitelen suo.
Cette idée, qui se faisait jour, n’empêcha pas Nilant, au
commencement du xviiie siècle, d’éprouver quelques
doutes d’ailleurs faciles à comprendre. Dans le manuscrit de la bibliothèque de
Leyde qui porte aujourd’hui la cote Vossianus latinus in-8º 46,
il avait lu, en tête de la dédicace à Tiberinus, cette phrase qui l’avait un peu
ébranlé : Romulus urbis Romæ imperator Tiberino filio suo
salutem mittit303.
Se fondant sur ce texte, il avait raisonné de la
manière suivante : ou bien foi est due au manuscrit, et alors il faut admettre que
l’auteur des fables est bien Romulus Augustule, ou bien le manuscrit ne doit pas
inspirer confiance, et alors il ne faut voir dans le nom même de Romulus qu’une
pure fiction.
Il faut avouer que ce dilemme était assez logique, et lorsque, laissant voir qu’il en préférait le second terme, Nilant le formulait, il mettait instinctivement les savants sur la voie de la vraie solution. Mais personne n’y entra. Porté par la nature de son esprit à se passionner pour les thèses les plus excentriques, Christ adopta le premier terme du dilemme. Il en fut de même de Hauptmann304. Eschenburg, plus clairvoyant, se rallia à l’opinion de Gude. Enfin celle qui prévalut au xviiie siècle, fut que l’auteur des fables ne devait pas être confondu avec le dernier empereur romain, mais qu’il avait bien existé sous le nom de Romulus.
Schwabe s’était soumis à cette idée généralement admise, et, pour la fortifier, il avait fait remarquer que, chez les Romains, le nom de Romulus était fort répandu, et que, comme le démontrait la chronique de Pierre Aubin, il avait continué pendant tout le moyen âge à être fort commun en Italie305.
{p. 296}Non seulement Schwabe avait cru à
l’existence d’un fabuliste nommé Romulus, mais encore, à
l’imitation de Lessing, il avait cru devoir démontrer qu’il ne fallait pas le
confondre avec un écrivain plus récent, qu’on appelle vulgairement Rimicius et quelquefois Rimiccius, Remicius, Rinucius,
Rainutius, Rinuncius et Rynuncius, mais dont le véritable
nom est Ranutio d’Arezzo306. Pour établir la distinction entre les deux auteurs, il s’était
appuyé sur un ouvrage publié à Venise, en 1513, sous ce titre : Supplementum supplementi Chronicarum ab ipso mundi exordio usque ad
redemtionis nostræ annum MCCCCCX editum et novissime recognitum : et
castigatum a venerando patre Jac. Philippo Bergomate ordinis
heremitarum
, et il avait extrait de la page 75 de ce livre le
passage suivant : « Harum (c’est des Fables d’Ésope qu’il
s’agit) nonnullas quum Romulus quidam ad eruditionem filii
Tyburtini versum in latinum jam diu transtulerit : novissime eas omnes una cum
ipsius Æsopi vita Rainutius quidam, eruditus vir, ad Antonium tituli
S. Chrysogoni presbyterum Cardinalem latinas accuratissime
fecit. »
Ce cardinal Antoine, à qui Ranutio avait dédié sa
compilation, mourut en 1439 ; le manuscrit de Dijon, qui contenait les fables de
Romulus, remontait au xiie siècle. Schwabe avait
ainsi établi que plusieurs centaines d’années séparaient les deux écrivains, qui,
par suite, ne pouvaient plus être considérés comme n’en formant qu’un seul sous
deux noms différents.
Il faut ajouter qu’il lui avait été bien facile d’arriver à cette
conclusion, et que, s’il avait, au lieu de puiser ses renseignements dans le Supplementum supplementi Chronicarum, ouvert une des éditions
anciennes de la traduction latine de la vie d’Ésope par Ranutio d’Arezzo, il
aurait pu donner à son raisonnement une base plus sûre et plus précise. En effet,
en tête de ces éditions se trouvent généralement deux épîtres dédicatoires, dans
lesquelles Ranutio d’Arezzo lui-même détermine exactement la date de son
œuvre307. Je ne parle pas de la première qui est
adressée à Laurent de Médicis surnommé le Magnifique308, et qui commence par {p. 297}ces mots :
Magnifico domino Laurencio Javina Rynuncius
felicitatem.
Mais la seconde étant précisément celle qui a été
écrite pour le cardinal Antoine, abbé du titre de Saint-Chrysogone, on me
pardonnera, à raison des dates qu’elle fixe, d’en donner ici, malgré sa longueur,
la traduction suivante :
« À son très révérend père en Jésus-Christ, et à son maître et éminent seigneur, Antoine, cardinal et abbé du titre de Saint-Chrysogone, Ranutio se recommande.
« Dans le temps où notre très saint chef, le pontife Nicolas V, fut élevé des degrés inférieurs à la dignité de cardinal, en son nom exhorté et persuadé par vous, j’ai traduit la vie d’Ésope du grec en latin. Mais je ne l’avais pas encore achevée que Sa Sainteté avait été promue au faite du souverain pontificat. Vous n’en avez pas moins renouvelé vos exhortations pour m’engager à traduire non seulement la vie d’Ésope, mais encore ses fables ; ce que j’ai fait volontiers, mais non pas dans le délai où je le désirais, interrompu que j’étais par mon mauvais état de santé. Ajoutez à cela les retards du libraire, qui a fait sa copie, non pas quand il le devait, mais quand il l’a pu, pour ne pas dire, quand il l’a voulu. Enfin, lorsque j’eus mis à mon œuvre la dernière main, considérant que de plus grands présents convenaient à la majesté pontificale, je suis resté, jusqu’à ce jour, sans trop savoir à qui je dédierais mon œuvre, et je ne l’ai point publiée. Aujourd’hui que votre domination est parvenue à cette même dignité du cardinalat par la volonté du Dieu tout-puissant, qui permet quelquefois que la vertu et les véritables travaux périclitent, mais jamais qu’ils périssent, il m’a semblé qu’il serait trop absurde de dédier et de consacrer notre Ésope à un autre qu’à celui dont les encouragements, joints à mes veilles et à mes efforts, ont produit sa traduction latine. Si votre domination accepte volontiers la dédicace de sa vie, elle justifiera ce que le roi des Perses Artaxercès avait coutume de dire et ce que les sages ont admis, à savoir qu’il n’est pas {p. 298}moins royal d’accepter de bon cœur de petits présents que d’en prodiguer aux autres de grands et de magnifiques. En outre, si, quand elle en aura le loisir, votre domination prend la peine d’en faire une simple lecture, je suis convaincu que cet Ésope, que je n’ai mis en latin qu’à votre instigation, deviendra pour vous non pas seulement un visiteur passager, mais plutôt un ami intime. Dieu vous garde309 ! »
Il résultait ainsi de la déclaration de Ranutio d’Arezzo lui-même qu’il avait commencé son œuvre au moment où Nicolas V, n’étant pas encore pape, venait d’être nommé cardinal, qu’au moment où ce même Nicolas V l’était devenu, elle n’était pas encore terminée, et qu’elle n’avait été achevée qu’après des retards encore augmentés par la négligence du copiste. Si maintenant on veut bien se rappeler la date de l’intronisation de Nicolas V et celle de sa mort, on verra que Ranutio a dû avoir commencé son œuvre avant le 6 mars 1447 et l’avoir menée à fin avant le 24 mars 1455.
Ainsi pas de confusion possible. S’il avait existé un auteur du nom de Romulus, il n’avait eu rien de commun avec Ranutio.
L’autorité dont Schwabe jouissait au commencement de ce {p. 299}siècle avait entraîné M. de Roquefort à se ranger à son avis.
« Pourquoi, s’écrie l’éditeur de Marie de France, ce nom serait-il
supposé ? En est-il un de plus commun parmi ceux qui entendent et qui parlent la
langue latine310 ? »
Animé d’un esprit plus indépendant, M. E. du Méril ne subit pas la
même influence. Pour lui, Romulus était un nom supposé, auquel, par une sorte
d’accord tacite, un sens avait été attribué. « Ce mot, dit-il311, ne signifiait d’abord que le petit
fabuliste romain ; puis par un de ces jeux de mots si chers au moyen âge et aux
écoliers de tous les temps, on en fit un empereur, et, comme dans plusieurs
autres enseignements moraux des xiie et
xiiie siècles, on supposa qu’il avait adressé
ses apologues à son fils qu’en souvenance du Tibre, pour indiquer son origine
romaine, on appela Tyberinus. »
Mais, si vraisemblable que fût cette manière de voir qui découlait de celle de Gude et même de Nilant, il ne paraît pas qu’à l’époque où M. E. du Méril la formula, elle ait été adoptée. Il resta bien entendu que l’auteur des fables était un personnage à la fois étranger à Romulus Augustule et à Ranutio d’Arezzo ; mais on continua à penser qu’il avait porté le nom de Romulus. Cette pensée ne pouvait pas prédominer sans qu’on fût entraîné à aller plus loin et à essayer de déterminer la nationalité de Romulus et l’époque de sa vie.
Sur la nationalité de Romulus, sa dédicace à son fils avait été
pour les savants le principal élément de discussion. Dans la vieille édition
d’Ulm, imprimée par Zeiner, elle commence par ces mots : « Romulus Tiberino
filio de Civitate Attica. S. Æsopus quidam homo græcus et
ingeniosus fabulis suis docet homines, etc. »
Christ et plusieurs autres
critiques en avaient conclu que Romulus était Athénien. Mais Eschenburg avait fait
remarquer que l’adjonction des mots de Civitate Attica au nom de
Tiberinus n’était que le résultat d’une mauvaise ponctuation, et Schwabe avait cru
y voir une transposition maladroitement faite par l’imprimeur. Les critiques {p. 300}avaient en définitive admis que c’était à Esope que s’appliquait la
qualification d’Athénien, que c’était par une transposition de mots que, dans
l’édition d’Ulm, elle avait été donnée à Romulus et qu’en définitive le lieu
véritable de sa naissance était impossible à déterminer.
Tout à l’heure j’examinerai si l’on doit considérer les mots de civitate Attica comme indiquant un lieu de naissance. Auparavant, puisqu’il y a eu dissidence sur le point de savoir à qui ils se rapportent, on me permettra de faire connaître les divers documents qui peuvent servir à le résoudre.
Dans le manuscrit Burnéien, c’est-à-dire dans le plus ancien de
ceux contenant les fables du Romulus ordinaire, la dédicace commence ainsi :
Romulus Tyberino filio. De civitate attica Esopus quidam homo
græcus
, etc.
La copie que Gude avait sans doute soigneusement prise du vieux
manuscrit de Dijon, porte également : Romulus Tyberino filio. De civitate
Attica Æsopus quidam homo græcus
, etc.
En outre l’extrait des fables de Romulus que Vincent de Beauvais
avait inséré dans son Miroir historial312 commence ainsi : De
civitate Attica Æsopus quidam homo græcus
, etc.
De même les manuscrits qui renferment la collection de fables
appelée Romulus de Nilant, appliquent à Ésope les mots : De civitate
Attica.
Ainsi, dans le manuscrit latin Dïgbey 172 du xiiie siècle que j’ai publié dans ma première édition, le
prologue est annoncé en ces termes : Incipit Prologus in tres libros
fabularum Æsopi Atheniensis
; puis il commence ainsi : Romæ
Imperator Tiberino filio suo salutem. Æsopus quidam græcus sapiens
, etc.
Quant au manuscrit de Leyde Voss. lat. in-8º 46, que Nilant a publié, son titre
est ainsi conçu : Incipit liber fabularum Æsopi Atheniensis
313, et voici comment débute le prologue
qui le suit : Romulus urbis Romæ Imperator Tiberino filio suo salutem
mittit. Æsopus quidam græce sapiens
, etc.
Enfin le manuscrit de Munich, d’après lequel, dans ma première édition, j’ai publié le Romulus primitif, présente une particularité significative. Non seulement les mots de civitate Attica y {p. 301}ont été appliqués à Ésope ; mais encore le copiste, se rappelant sans doute que, d’après la tradition, Ésope n’était pas Athénien, a substitué au qualificatif Attica le qualificatif Phrigia314.
Si, pour trancher la question, il n’existait pas d’autres textes que ceux que je viens de relever, il faudrait évidemment admettre que c’est à Ésope que l’auteur a donné le titre de citoyen d’Athènes. Mais, si dignes de foi que soient les manuscrits présentant les leçons qui précèdent, je ne crois pas qu’on doive s’y arrêter.
D’abord il convient de remarquer qu’il suffit qu’une faute de ponctuation ait été commise par le copiste du manuscrit Burnéien, pour que le sens des premiers mots du prologue ait été altéré, et l’on n’ignore pas combien les copistes du moyen âge se préoccupaient peu de ponctuer exactement leurs copies. Il ne faut donc tirer aucun argument du texte du plus vieux manuscrit.
On le peut d’autant moins que, dans le manuscrit Voss. lat. in 8º,
15 qui est à peu près du même temps, et qui offre la même leçon, non seulement la
ponctuation, mais encore l’écriture ne peuvent laisser le moindre doute sur
l’intention du copiste de placer les mots de civitate attica
dans l’en-tête du prologue. Le texte y est disposé de cette façon : Romulus Thiberino filio de Civitate atlica. Esopus (sic) quidam homo grecus
, etc.
En outre il y a un Romulus qui remonte au xie siècle. Le manuscrit 303 de la Bibliothèque impériale de Vienne
qui nous l’a conservé ne semble pas lui-même antérieur au xive siècle ; mais rien n’indique que la copie qu’il renferme,
quoique beaucoup moins ancienne que l’œuvre elle-même, ne soit pas parfaitement
fidèle. Or cette copie porte : Romulus Tyberino filio de Civitate salutem.
Æsopus quidam homo græcus
, etc.315. Il est vrai que cette
collection n’est qu’une imitation du Romulus primitif, mais une imitation qui
s’éloigne fort peu du modèle et qui dès lors a beaucoup plus d’autorité que la
longue paraphrase appelée Romulus de Nilant.
Il y a aussi à la Bibliothèque Laurentienne, dans le fonds {p. 302}Ashburnam, sous la cote 1555, un manuscrit de la fin du xiie siècle ou du commencement du xiiie contenant un dérivé dont le texte s’éloigne peu de celui du
Romulus primitif. Il porte ce titre : Incipit liber esopi quem transtulit Romulus
de greco in latinum ad Tyberium filium suum de civitate Attica, et la dédicace
commence par ces mots : Romulus filio suo Tyberio de civitate Attica.
Esopus quidam homo grecus
, etc.
Dans le manuscrit du xiiie siècle
qui, dans la bibliothèque de la ville du Mans, porte la cote 84, c’est encore la
même ponctuation qui a été observée. On y lit : Romulus Tyberino filio de
civitate Attica. Isopus homo quidam grecus
, etc.
Enfin, à Oxford, dans le manuscrit 42 du collège du Corpus Christi,
la séparation n’est pas opérée par un simple point ; le mot salutem s’interpose de cette façon : Romulus Tyberino filio de
civitate Attica salutem. Esopus quidam homo grecus
, etc., et cette leçon
a été accueillie dans l’édition originaire de Jean Zeiner dans laquelle on lit :
Romulus tyberino filio de Civitate athica. S. Esopus quidam homo
grecus
, etc.
En somme, si l’on s’en tient à l’apparence extérieure des textes manuscrits et imprimés, on voit qu’ils sont plutôt contraires que favorables à l’opinion qui fait servir les mots de civitate Attica à la détermination de la nationalité d’Ésope. Si l’on va au fond des choses, on voit également qu’ils n’ont trait ni à celle de Romulus, ni à celle de Tiberinus. En effet, comme M. Gaston Paris l’enseigne avec raison316, ce que le compilateur a voulu, c’est montrer Romulus, après avoir à Athènes traduit en latin le texte grec d’Ésope, envoyant, de cette ville où il se trouvait encore, sa traduction à son fils Tiberinus.
Et maintenant, pour en revenir à la nationalité de Romulus, on peut affirmer que, lorsque les érudits ont voulu, dans les mots de civitate Attica, trouver l’indication du lieu de sa naissance, ils en ont mal compris le sens, et qu’en supposant que ce personnage eût existé, ces mots ne permettraient pas de le dire né à Athènes.
Au moins l’époque de sa vie était-elle demeurée dans des ténèbres moins épaisses ? Pas davantage. On avait bien pu affirmer {p. 303}qu’il avait vécu avant le xiiie siècle. En effet Vincent de Beauvais, qui écrivit sous le règne de saint Louis et qui mourut en 1264, avait, comme on l’a vu plus haut, transcrit, dans son Speculum historiale et dans son Speculum doctrinale, vingt-neuf des fables du Romulus ordinaire, et Gude, dont la compétence en matière paléographique ne pouvait être suspectée, avait déclaré que le manuscrit de Dijon remontait à plus de cinq cents ans, et, comme il l’avait copié en 1662, il s’ensuivait que Romulus ne pouvait avoir vécu après le xiie siècle. Mais c’était tout. Suivant Schwabe, il était permis de supposer qu’il avait existé à une époque beaucoup plus ancienne ; mais il lui était impossible de dire à quelle limite, en remontant dans le passé, il fallait raisonnablement s’arrêter317.
Bref, toutes les recherches des savants n’avaient servi qu’à accréditer cette idée qu’il avait existé vers le xiie siècle un écrivain, nommé Romulus, qui avait mis en prose une partie des fables de Phèdre. C’est ainsi que cette idée généralement reçue fut accueillie par MM. Michaud frères et que Romulus est présenté par eux dans leur Biographie universelle.
Dire que Romulus avait vécu au xiie siècle, c’était commettre une erreur manifeste. En effet, dans le
manuscrit de Leyde Vossianus latinus, in-8º, 15, d’après lequel
Nilant avait publié ses Fabulæ antiquæ, il y avait beaucoup
d’autres œuvres dont j’ai précédemment donné une analyse détaillée. Au verso du
quatrième feuillet se trouvait notamment la dédicace de Romulus à son fils.
Nilant, en homme judicieux, n’avait pas cru devoir la mettre en tête des Fabulæ antiquæ, auxquelles elle ne lui semblait pas se rapporter,
et que non seulement il ne considérait pas comme issues de Romulus, mais qui, dans
sa conviction à mon sens erronée, avaient encore dû lui servir de base. Mais si,
dans cette pensée, il ne leur avait pas donné pour préambule la fameuse dédicace,
il n’en avait pas moins eu soin de la publier en note à la page 65, et d’indiquer
qu’elle était tirée du même manuscrit. Or l’âge de ce manuscrit est connu : on
sait qu’il n’est pas plus récent que le commencement du xie siècle. Nilant qui écrivait au commencement du xviiie ne lui avait, il est vrai, attribué que cinq cents ans
à peine : Est enim {p. 304}fere
quingentorum annorum.
Mais cette erreur avait été définitivement
reconnue par M. Pertz, qui lui avait assigné le xe siècle. Or si, à cette époque, la dédicace existait, il en était
évidemment de même des fables de Romulus. Car il est impossible de supposer
raisonnablement qu’elles n’ont pas été composées par le même écrivain.
M. Oesterley, publiant le manuscrit Burnéien et lui assignant le
xe siècle, ne pouvait tomber dans l’erreur qui
avait consisté à faire vivre Romulus au xiie.
Convaincu qu’il a existé un fabuliste de ce nom, voici comment il s’exprime sur
son âge : « La découverte du plus ancien manuscrit de Romulus a modifié la
question relative à sa personne, non à vrai dire pour ce qui est de savoir si
son nom est supposé ; car la fréquence de ce nom et de celui de Tiberinus, son
fils, ne donnent pas lieu de supposer que ce soient des pseudonymes, mais bien
pour ce qui est de savoir quel est, de tous ceux qui ont porté ce nom de
Romulus, celui qu’on peut le plus vraisemblablement considérer comme l’auteur de
nos paraphrases : c’est tout ce qu’on peut espérer obtenir. Je me contente
d’indiquer que l’âge du manuscrit de Burney permet de supposer que ce Romulus a
pu être celui “de via Ardeatina, civis Romanus”, qui signait
en 964 un document schismatique (voir Baronius, Annal. 964,
x). Mais je m’abstiens de toute autre hypothèse318 »
.
En somme M. Oesterley déclare bien que Romulus n’a pas pu exister plus tard qu’au xe siècle et réduit bien le champ des recherches relatives à la fixation de l’époque de sa vie ; mais, comme {p. 305}ses devanciers, il ne peut pas plus déterminer son âge que sa nationalité.
Ce qui ressort de tout cela, c’est que personne n’avait pu donner la plus légère indication sur un auteur dont les copistes et les compilateurs du moyen âge, en nous conservant son œuvre ou en l’imitant, avaient pourtant fait le plus grand cas.
Il y avait là une situation étrange, et il fallait l’aveuglement de la routine pour n’en pas découvrir la cause. Avec un peu de réflexion indépendante, les critiques auraient compris que, s’il était impossible de se procurer le moindre renseignement sur Romulus, c’est qu’il n’était qu’un personnage imaginaire, inventé par un compilateur inconnu.
Son œuvre, ou plutôt celle qui en dériva la première, eut un tel
succès qu’elle fit oublier Phèdre et que le nom de Romulus finit par être une
sorte de terme usuel employé à exprimer non pas un nom d’auteur, mais bien un
genre spécial de littérature ; ce qui le démontre, c’est que, dans les manuscrits,
on le voit servir de titre, non pas seulement aux collections qui n’ont été que
des copies altérées du type primitif, mais encore à celles dont les fables ont été
en partie puisées à d’autres sources. Je pourrais citer comme exemple la
collection contenue dans le manuscrit du collège Merton, qui porte ce titre :
« Ex fabulis Esopi sapientis uiri moralis quas transtulit Romulus quidam in latinum »
, et qui cependant renferme bien des
apologues étrangers au Romulus primitif.
Après cela, quel était l’obscur plagiaire qui avait eu le premier l’idée baroque de se revêtir du pseudonyme de Romulus ? on conçoit que la solution de cette question n’offre qu’un médiocre intérêt, et, comme aucun document ne permet de la résoudre, je ne m’y attarderai pas davantage.
§ 2. — Examen des fables du Romulus primitif. §
En abordant l’examen des fables du Romulus originaire, je dois faire pour ordre une observation préliminaire. On a abusé un peu du nom de Romulus qu’on a pris l’habitude de donner à presque toutes les collections de fables latines datant du moyen âge. C’est un exemple que je ne suivrai pas. On ne peut raisonnablement appeler Romulus les collections de fables, qui, comme {p. 306}celles des manuscrits de Leyde et de Wissembourg, ne sont pas dérivées soit du type primitif, soit de la collection presque identique qui figure dans la vieille édition d’Ulm, ni les collections qui ont bien l’une de ces deux origines, mais qui, ayant été écrites en vers, constituent par cela même des œuvres toutes personnelles. Il est donc bien entendu que toutes les fois que je donnerai le nom de Romulus à une collection, il s’agira, sinon de la plus ancienne de celles auxquelles il a été appliqué, au moins d’une de celles qui en sont en totalité ou en partie l’imitation prosaïque. Encore aurai-je soin, s’il est question de la plus ancienne, de la qualifier de Romulus originaire ou de Romulus primitif, et, si c’est un de ses dérivés en prose, d’ajouter au terme générique une dénomination spéciale.
Le Romulus primitif a péri ; mais, à l’aide du Romulus ordinaire et du Romulus conservé à Vienne, on peut dresser la table des fables qu’il renfermait et affirmer qu’il en comprenait 84.
Ce qui, pour être discutable, ne m’en paraît pas moins vraisemblable, c’est que ces fables étaient comprises, non pas, comme dans le Romulus ordinaire, dans quatre livres, mais dans trois seulement. On saura, quand on aura entièrement parcouru ce volume, qu’en dehors du Romulus ordinaire aucun des dérivés directs du Romulus primitif n’est divisé en quatre livres. Ou, comme dans le Romulus de Vienne, la division n’existe pas, ou, comme dans le Romulus de Nilant, elle est seulement en trois livres ; on en peut conclure que cette dernière était celle qui avait été adoptée par l’auteur du Romulus primitif.
Quoi qu’il en soit, la collection était précédée de la fameuse dédicace à Tiberinus. En ayant déjà cité des extraits, ayant encore à la relater dans l’analyse que je ferai plus loin de la vieille édition d’Ulm, et devant enfin la publier dans cet ouvrage avec les fables elles-mêmes, je m’abstiens de la transcrire ici, et je m’empresse de passer à la nomenclature des fables contenues dans chacun des trois livres, avec l’indication de celles de Phèdre dont elles sont dérivées :
| Romulus. | Phèdre. |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | iii, 12. |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | i, 1. |
| I. 3. Le Rat et la Grenouille. | |
| {p. 307}I, 4. Le Chien et la Brebis. | i, 17. |
| I, 5. Le Chien et l’Ombre. | i, 4. |
| I, 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | i, 5. |
| I, 7. Le Soleil qui se marie. | i, 6. |
| I, 8. Le Loup et la Grue. | i, 8. |
| I, 9. La Chienne qui met bas. | i, 19. |
| I, 10. Le Serpent mourant de froid. | iv a, 19. |
| I, 11. L’Âne et le Sanglier. | i, 29. |
| I, 12. Le Rat de ville et le Rat des Champs. | |
| I, 13. L’Aigle et le Renard. | i, 28. |
| I, 14. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | ii, 6. |
| I, 15. Le Corbeau et le Renard. | i, 13. |
| I, 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | i, 21. |
| I, 17. L’Âne qui caresse son maître. | |
| I, 18. Le Lion et le Rat. | |
| I, 19. Le Milan malade. | |
| I, 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | |
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un roi. | i, 2. |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | i, 31. |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | i, 23. |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | App. 19. |
| II, 5. La Montagne en mal d’enfant. | iv a, 23. |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | iii, 15. |
| II, 7. Le Chien vieilli et son maître. | v, 5. |
| II, 8. Les Lièvres et les Grenouilles. | |
| II, 9. Le Loup et le Chevreau. | |
| II, 10. Le Serpent et le Pauvre. | |
| II, 11. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | i, 16. |
| II, 12. Le Chauve et la Mouche. | iv b, 4. |
| II, 13. Le Renard et la Cigogne. | i, 26. |
| II, 14. La Tête sans cervelle. | i, 7. |
| II, 15. Le Geai vaniteux. | i, 3. |
| II, 16. La Mouche et la Mule. | iii, 6. |
| II, 17. La Mouche et la Fourmi. | iv a, 24. |
| II, 18. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | i, 10. |
| II, 19. L’Homme et la Belette. | i, 22. |
| II, 20. La Grenouille qui s’enfle. | i, 24. |
| III, 1. Le Lion et le Berger. | |
| III, 2. Le Lion médecin. | |
| III, 3. Le Cheval et l’Âne. | |
| III, 4. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | |
| III, 5. Le Rossignol et l’Épervier. | |
| III, 6. Le Renard et le Loup. | |
| III, 7. Le Cerf à la Fontaine. | i, 12. |
| {p. 308}III, 8. Junon et Vénus. | App. 11. |
| III, 9. L’Inconstance de la Femme. | App. 15. |
| III, 10. La Courtisane et le Jeune Homme. | App. 29. |
| III, 11. Le Renard changé en homme. | |
| III, 12. Le Taureau et le Veau. | v, 4. |
| III, 13. Le Père et le mauvais Fils. | App. 12. |
| III, 14. La Vipère et la Lime. | iv a, 8. |
| III, 15. Les Loups et les Brebis. | |
| III, 16. La Hache et les Arbres. | |
| III, 17. Le Loup et le Chien. | iii, 7. |
| III, 18. L’Estomac et les Membres. | |
| III, 19. Le Singe et le Renard. | App. 1. |
| III, 20. Le Marchand et l’Âne. | iv a, 1. |
| III, 21. Le Cerf et les Bœufs. | ii, 8. |
| III, 22. Le Lion roi et le Singe. | iv a, 13. |
| III, 23. Le Renard et les Raisins. | iv a, 3. |
| III, 24. La Belette et les Rats. | iv a, 2. |
| III, 25. Le Loup et le Berger. | App. 28. |
| III, 26. Le Paon et Junon. | iii, 18. |
| III, 27. La Panthère et les Paysans. | iii, 2. |
| III, 28. Les Moutons et les Béliers. | |
| III, 29. L’Oiseleur et les Oiseaux. | |
| III, 30. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | |
| III, 31. Le Cheval et le Cerf. | iv a, 4. |
| III, 32. L’Âne et le Lion. | i, 11. |
| III, 33. Le Corbeau et les Oiseaux. | |
| III, 34. Le Lion malade et le Renard. | |
| III, 35. La Corneille altérée. | |
| III, 36. L’Enfant et le Scorpion. | |
| III, 37. L’Âne et le Loup. | |
| III, 38. Les Trois Boucs et le Lion. | |
| III, 39. L’Homme et le Lion. | |
| III, 40. La Puce et le Chameau. | |
| III, 41. La Fourmi et le Grillon. | |
| III, 42. Le Glaive perdu. | |
| III, 43. La Corneille et la Brebis. | App. 26. |
| III, 44. La Statue d’Ésope. | ii, Épil. |
| Épilogue. Rufus. |
Le tableau qui précède permet de voir quelles sont les fables de Romulus qu’on retrouve dans Phèdre.
Sur les 20 fables du livre I, 14 sont tirées de celles de Phèdre anciennement connues ; ce sont les fables 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16.
{p. 309}Sur les 20 fables du livre II, il y en a 16 qui ont été empruntées aux anciennes de Phèdre ; ce sont celles qui portent les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La quatrième est la mise en prose d’une des nouvelles.
Enfin le livre III et dernier embrasse 44 fables, dont quatorze seulement existent dans les anciennes de Phèdre. Elles portent les numéros 7, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32 et 44. Il y en a, en outre, 7, auxquelles les fables nouvelles de l’affranchi d’Auguste ont servi de modèle ; ce sont les fables 8, 9, 10, 13, 19, 25 et 43.
Les fables du Romulus primitif, qui ne correspondent à aucune de celles de Phèdre anciennes ou nouvelles, sont au nombre de 32. Ce sont celles qui, dans le livre I, portent les numéros 3, 12, 17, 18, 19 et 20 ; dans le livre II, les numéros 8, 9 et 10 ; dans le livre III, les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 18, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
De ce qui précède il ressort que la collection du Romulus primitif possède un grand nombre de fables se rapportant soit à celles de Phèdre qui ont survécu, soit à celles qui ont péri. Mais l’importance du nombre n’est pas la seule que présente cette collection ; c’est encore par sa grande ressemblance avec l’original qu’elle est intéressante. Qu’on me permette encore, pour être méthodique, de prendre pour exemple la fable qui m’a déjà, pour les collections précédemment étudiées, servi de terme de comparaison.
La voici d’abord telle qu’elle est dans le manuscrit de Pithou :
Ne gloriari libeat alienis bonis,Suoque potius habitu vitam degere,Æsopus nobis hoc exemplum prodidit.Tumens inani Gragulus superbia,Pennas Pavoni quæ deciderant, sustulit,Seque exornavit : deinde contemnens suos,Immiscuit se Pavonum formoso gregi.Illi impudenti pennas eripiunt avi,Fugantque rostris. Male multatus GragulusRedire merens cœpit ad proprium genus ;A quo repulsus tristem sustinuit notam.Tum quidam ex illis, quos prius despexerat :Contentus nostris si fuisses sedibus,Et quod natura dederat voluisses pati,{p. 310}Nec illam expertus esses contumeliam,Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas.
Voyons maintenant comment la même fable a été formulée dans le Romulus primitif. Je rappelle ici que, ce Romulus n’existant plus, ce n’est pas son pur texte que je vais exhiber, et que je vais, comme j’ai déjà eu soin de l’annoncer, avoir recours à celui de son plus connu et plus proche dérivé, c’est-à-dire à celui du Romulus ordinaire, et cela, en me servant du plus ancien des manuscrits qui l’a conservé, c’est-à-dire du manuscrit Burnéien. De cette façon, si le Romulus primitif n’est pas produit dans sa parfaite intégrité, les leçons substituées différeront assez peu des vraies, pour qu’on puisse se croire devant un spécimen à peu près exact de son texte. Voici donc la fable du Geai vaniteux extraite du manuscrit Burnéien et divisée, comme précédemment, en autant de lignes qu’il existe de vers dans le texte antique :
Ne qvis de alienis magnvm se proferat bonis,Svoqve modico potivs oportet vt ornetvr…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gracculus tumens superbia et uana audacia,sumens pauonis pennas que ceciderant sustulitet se ornauit, et cœpit contempnere suosmiscuitque se gregi pauonum.Illi ignoto et impudenti pennas iniuriosi eripiunt ;calcibus et morsibus fatigant. Semiuiuus ab eis relictus, et grauiter maleque sauciatus,redire timuit miser ad proprium suum genus,Vbi cum esset ornatus et multos iniuriose terreret,tunc unus ex illis ait illi : Dic nobissi non erubesceres ut et tuas uestes amasseset quod natura dedit hoc tibi sufficeret ?Nec ab aliis passus es iniuriam, nec a nobis pulsus es uel fuisses.Hoc tibi bonum fuit, si ad quos habebas uiueres.
On le voit, ce ne sont pas seulement les expressions de l’auteur ancien, ce sont encore les lambeaux de ses ïambes qu’on retrouve ici. Plus loin je montrerai que la collection de l’anonyme de Nilant a, en général, suivi de plus près le modèle primitif ; mais il n’en est pas moins vrai que, dans cet exemple, la similitude est encore quelquefois presque littérale.
Pour mieux faire apprécier ce point, je vais, en terminant ces {p. 311}observations, ajouter à l’exemple que j’ai choisi quelques autres termes de comparaison toujours empruntés au manuscrit Burnéien. Les voici, pris un peu au hasard :
phèdre i, 21 et romulus i, 16.
Ph.
R.
Ph.
R.
Ph.
R.
phèdre iii, 15 et romulus ii, 6.
Ph.
Inter capellas Agno balanti Canis. R.
Inter capellos agno uaganti canis. Ph.
. . . . . . . . . non est hic mater tua. R.
Non est hic mater tua. Ph.
R.
Ph.
R.
phèdre iv a, 24 et romulus ii, 17.
Ph.
Formica et Musca contendebant acriter. R.
Nam formica et musca contendebant acriter. Ph.
. . . . . . . . . Musca sic cœpit prior. R.
Musca sic cepit prior. Ph.
Ubi immolatur, exta prægusto deûm. R.
Vbi immolatur, exta primum ego gusto. Ph.
In capite regis sedeo. R.
in capite regis sedeo.
phèdre i, 8 et romulus i, 8.
Ph.
{p. 312}R.
phèdre i, 5 et romulus i, 6.
Ph.
R.
Ph.
Sic totam prædam sola improbitate sustulit. R.
Sic totam prædam illam solus improbitate sustulit.
phèdre i, 23 et romulus ii, 3.
Ph.
Nocturnus quum fur panem misisset Cani. R.
Nocturnus quidam fur cum panem mitteret cani.
Je pourrais ainsi continuer longtemps les rapprochements. Je m’en abstiens : ceux que je viens de faire permettent d’apprécier la mesure dans laquelle les expressions de Phèdre et même les fragments de ses ïambes se retrouvent dans la collection de Romulus.
Mais ma tâche ne doit pas s’arrêter là ; il me faut encore signaler
et réfuter la thèse de M. É. du Méril qui consiste à supposer que les fables de
Romulus ont eu la même origine que ce qu’on appelle les fables de Phèdre, et
qu’elles ont été, comme celles-ci, la traduction latine des œuvres, sinon de ce
fabuliste, au moins de divers auteurs grecs. Il est vrai que, dans la dédicace à
Tiberinus, on lit cette phrase qui semble lui donner raison : « Ego Romulus
transtuli de græco sermone in latinum. »
Mais M. du Méril aurait pu s’apercevoir qu’elle était
aussi fantaisiste que le reste de la dédicace, et, s’il voulait la prendre au
sérieux, il aurait dû comprendre qu’il était facile de donner autrement à ces mots
une explication plausible : Phèdre avait puisé dans le texte grec d’Ésope les
sujets de ses fables ; elles pouvaient donc, dans une certaine mesure, être
regardées par celui qui les paraphrasait comme une traduction latine du vieux
fabuliste grec, et, sous le nom de Romulus, faisant en définitive parler
l’affranchi d’Auguste, le paraphraste pouvait lui faire dire qu’il avait mis
l’œuvre grecque en latin. M. du Méril ne se fait pas à lui-même cette réflexion ;
il passe outre, et, malgré les fragments d’ïambe qu’on découvre dans les divers
Romulus, il {p. 313}n’admet pas même qu’elles soient plus
récentes, ni qu’aucun des auteurs des versions en prose se soit aidé de la
traduction en vers ïambiques.
« C’est même, dans quelques passages, dit-il, le poète qui semble s’être servi, et très malheureusement, du prosateur : ainsi, pour n’en point citer dont les constructions trop elliptiques aient rendu la pensée obscure, on lit dans une des fables du troisième livre :
Hoc illis narro qui me non intelligunt ;ce qui me paraît au moins fort singulier, et il y a dans le Romulus encore inédit de la bibliothèque de Wissembourg : Hæc tibi Æsopus narrat qui me non intelligis. Les fables nouvelles, dont il y a cent ans personne ne soupçonnait l’existence, ont prouvé de plus en plus que les versions latines qui nous sont parvenues n’avaient qu’une liaison indirecte entre elles, et remontaient, au moins pour la plupart, à une source plus ancienne319. »
Tout cela est inexact : M. du Méril est parti de cette idée fausse que Phèdre était un poète grec, et, traduisant ensuite à sa guise le passage de Quintilien, il a supposé que cet auteur recommandait de faire traduire en latin des fables grecques par les écoliers romains ; ce qui est encore une interprétation erronée. Il faut donc, en définitive, reconnaître que les fables des divers Romulus ont été des paraphrases en prose, ou plutôt les copies un peu modifiées d’une première paraphrase en prose faite, au moyen âge, sur les fables latines de Phèdre.
Maintenant à qui cette paraphrase est-elle due ? Faut-il y voir le résultat de l’application des conseils de Quintilien, qui engageait à faire traduire en prose les fables ésopiques originairement écrites, non en prose grecque, mais en vers latins ? J’ai peine à croire qu’on se soit au moyen âge si bien souvenu des recommandations faites par le célèbre auteur latin, et, si les fables de Phèdre ont été employées, dans les écoles, à l’instruction des élèves, qui, pour s’exercer, les auraient paraphrasées en prose, je ne puis supposer que la collection de l’Æsopus ad Rufum ait dû son existence à ces versions corrigées et conservées par les professeurs.
{p. 314}On aperçoit dans cet Æsopus, lorsqu’à laide du Romulus ordinaire on cherche à se rendre compte de ce qu’il a été, un plan général et une uniformité d’exécution qui ne permettent pas de le considérer comme une œuvre collective, due aux élèves d’une même école, et qui obligent à y voir une compilation purement individuelle.
Section III.
Examen comparatif des fables du manuscrit de
Wissembourg et de celles du Romulus primitif. §
Il existe un lien évident entre les fables du manuscrit de Wissembourg et celles du Romulus primitif.
D’abord, dans les unes comme dans les autres, figure la dédicace à Rufus. Ce premier point a son importance.
Mais ce qui rend, dans les deux collections, la parenté frappante, c’est la similitude des leçons substituées à celles de Phèdre. Pour mieux la faire ressortir, je puise dans la fable du Loup et de l’Agneau des exemples qui ne pourront manquer de paraître concluants. À défaut du texte perdu du Romulus primitif, c’est encore, comme s’en rapprochant le plus, celui du Romulus Burnéien que je mets en présence de celui de Wissembourg :
texte du ms. de Wissembourg : texte du Romulus Burnéien :
L’identité attestée par ces exemples montre clairement que l’œuvre qui porte le nom de Romulus n’a pas été une œuvre originale et qu’il existait, au siècle auquel appartiennent le manuscrit de Wissembourg et le manuscrit Burnéien, une œuvre plus {p. 315}ancienne due à un précédent compilateur relativement habile qui s’était étudié à approprier les fables de Phèdre, en les mettant en prose, aux idées religieuses du moyen âge, pour les faire servir, dans cet état de transformation, à l’enseignement de la langue latine.
Puis est survenu un pédagogue maladroit, qui, s’emparant de la compilation récente, a modifié sensiblement l’ordre des fables, a fait disparaître le Prologue qui les précédait, en a reporté la première partie en tête de l’Épilogue, en a fait entrer la seconde dans une dédicace fictive et s’est efforcé de donner à l’œuvre par ce déguisement une apparence antique. Mais il a procédé comme un mauvais potier, qui de nos jours voudrait reproduire des faïences anciennes, et toute son habileté a consisté à introduire les noms les plus connus de l’histoire et de la géographie romaines dans sa dédicace qu’il n’avait pas même eu le mérite de puiser dans son propre fonds.
Je dois maintenant, pour faire apparaître les choses sous leur vrai jour, avouer que l’identité entre les deux textes n’est pas toujours aussi complète que dans les exemples que je viens d’exhiber. Cela tient à une double cause. D’abord, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer, nous ne possédons pas dans toute sa pureté la collection dont le manuscrit de Wissembourg est l’exemplaire unique. Cet exemplaire altéré profondément par l’ignorance du copiste, qui, en les écrivant, défigurait les mots, a donné lieu, au xie siècle, à des corrections fort nombreuses, faites tantôt à l’aide d’un texte dérivé du Romulus primitif, tantôt sans le secours d’aucun texte, de sorte que le manuscrit de Wissembourg doit nécessairement différer de celui de ce Romulus. Ensuite, la collection du Romulus primitif ayant disparu, on est obligé d’en remplacer le texte par celui d’un dérivé qui, quoique s’en éloignant fort peu, ne lui est pas non plus de tout point conforme. Mais si, à raison de ces deux causes d’écart, il n’y a pas partout identité entre les deux collections, elles ont conservé un air de famille saisissant qui trahit une origine commune.
La question qui reste à résoudre est celle de savoir si l’une des deux collections a été la fille de l’autre, ou si toutes les deux sont nées des fables de l’Æsopus ad Rufum, dont on pourrait, dans ce cas, très exactement déterminer le nombre et les sujets.
{p. 316}Il est évident que la collection de Wissembourg n’a pu donner naissance à celle de Romulus, puisque la seconde renferme plus de fables que la première. Mais ne se pourrait-il pas, au contraire, que de celle de Romulus fût issue celle de Wissembourg ? Cela ne paraît pas impossible, quand on songe que toutes les fables du manuscrit de Wissembourg se retrouvent dans Romulus. Il s’ensuit qu’on pourrait admettre qu’il en a été la source. Je m’empresse de dire que pourtant je ne le crois pas. Je pourrais invoquer bien des raisons solides pour justifier mon sentiment. Je n’en donnerai qu’une, ou plutôt j’en donnerai quatre qui n’en font qu’une : Si la collection de Wissembourg avait été copiée sur celle de Romulus, étant donnée l’ignorance du copiste, il est probable qu’il eût suivi les divisions adoptées par son modèle, c’est-à-dire le partage en trois livres, qu’il aurait transcrit les fables dans le même ordre, qu’il les aurait fait précéder de la même dédicace ou ne les aurait fait précéder d’aucune, enfin qu’il ne leur aurait pas donné pour préambule cette épître à Rufus qui n’a pu être empruntée qu’à l’Æsopus ad Rufum.
La conclusion, c’est que les deux collections du manuscrit de Wissembourg et de Romulus sont deux sœurs nées de cet Æsopus, dont elles diffèrent un peu l’une et l’autre, mais trop peu pour n’être pas encore une timide transformation du texte phédrien.
J’emploie à dessein le mot phédrien, parce que c’est encore une fausse hypothèse que celle qui, comme nous le verrons plus loin, consiste à dire que l’Æsopus ad Rufum a été un Corpus fabularum, formé de toutes les collections de fables alors connues. Non seulement l’Æsopus ad Rufum n’a été créé qu’à l’aide de l’œuvre de Phèdre transformée avec une habileté relative, mais encore l’imitateur primitif ne l’a pas employée tout entière. Il n’a constitué qu’un recueil de fables choisies, empruntées à un seul auteur et accommodées au goût du temps. Ces fables, partiellement extraites de Phèdre, sont au contraire entrées toutes dans la collection de Romulus, dans laquelle, quoiqu’il eût été rationnel de la supprimer, la dédicace à Rufus a été seulement altérée320.
{p. 317}Le doute à cet égard devient impossible, quand, rapprochant l’une de l’autre les deux collections de Wissembourg et de Romulus, on voit la première ne comprendre que des fables existant dans la seconde. Dérivée directement de l’Æsopus ad Rufum, la collection de Wissembourg n’a pu évidemment se composer de fables existant toutes également dans celle de Romulus, qu’à la condition que cette dernière elle-même comprît toutes celles de l’Æsopus ad Rufum.
On peut m’objecter que, si l’Æsopus ad Rufum n’a, d’après ce qui précède, constitué qu’un recueil très restreint, ce n’est pas une raison pour qu’il n’ait été tiré que de l’œuvre de Phèdre. Cette objection, je le reconnais, trouve un point d’appui dans cette circonstance qu’une bonne partie des fables de Romulus n’existe pas dans ce qui nous est resté de l’œuvre du fabuliste romain. Elle n’est pourtant que spécieuse, et la découverte des manuscrits de Perotti fait voir combien est faible la base sur laquelle elle repose. En effet quelques fables de Phèdre ont été découvertes, et aussitôt le nombre de celles de Romulus en apparence étrangères au fabuliste romain a proportionnellement diminué ; dans les fables nouvellement découvertes on trouve l’origine de huit fables de Romulus. N’est-il pas dès lors évident que, si toute l’œuvre antique parvenait à être connue, on finirait par voir celle de Romulus s’y rapporter tout entière ?
Maintenant, la comparaison que j’ai faite du manuscrit de Wissembourg et du texte du Romulus primitif m’ayant déjà permis de déterminer le nombre et les sujets des fables de l’Æsopus ad Rufum, puis-je, en la prolongeant, obtenir un nouveau résultat et parvenir à la reconstitution certaine du texte même de ces fables ? Je ne le crois pas. À mon avis, toute tentative de ce genre, sans avorter complètement, n’aboutirait qu’à des résultats approximatifs.
D’abord la collection de Wissembourg, ainsi que je l’ai précédemment expliqué, a été altérée par un correcteur du xie siècle, et celle du Romulus primitif, perdue comme l’Æsopus ad Rufum lui-même, ne se retrouve plus que dans des manuscrits qui ne nous en ont conservé que des copies plus ou moins infidèles ou même des imitations plus ou moins indépendantes.
Ensuite, lors même que nous posséderions le texte du manuscrit de Wissembourg, tel qu’il est sorti de la plume du premier {p. 318}copiste et le texte du Romulus primitif, tel qu’il a été écrit par le compilateur à qui il est dû, le problème serait encore fort difficile à résoudre. En effet, il est malheureusement certain que, tout en suivant de près l’Æsopus ad Rufum, le texte du manuscrit de Wissembourg et celui du Romulus primitif, en ont, en beaucoup d’endroits, été l’imitation plutôt que la simple copie, et l’on conçoit que cette seule circonstance suffirait pour opposer à une restitution littérale un insurmontable obstacle.
Pour justifier cette affirmation, le mieux est de rapprocher simultanément de Phèdre le texte du manuscrit de Wissembourg et celui du manuscrit Burnéien, qui, je le rappelle encore une fois, étant le plus ancien de ceux connus, est vraisemblablement celui qui contient la reproduction la moins imparfaite du Romulus primitif. Il va m’être ainsi aisé de démontrer qu’il existe dans le manuscrit de Wissembourg des expressions de Phèdre qui ne se rencontrent pas dans le texte de Romulus et que ce dernier en possède aussi que le manuscrit de Wissembourg n’a pas conservées. Or aucune des deux collections n’a été tirée directement de Phèdre, et l’une et l’autre n’ont pu puiser que dans l’Æsopus ad Rufum les expressions du fabuliste antique. D’où il suit que ce n’est qu’en altérant cet Æsopus que l’auteur du texte de Wissembourg a pu ne pas employer certaines des expressions de Phèdre qu’on trouve dans le Romulus primitif, et que réciproquement c’est par suite d’une altération analogue que ce dernier ne possède pas toutes les expressions de Phèdre contenues dans le texte de Wissembourg. Cette allégation formulée, j’ai, pour la justifier, recours à la fable du Chien et du Loup qui est dans Phèdre la septième du livre III, dans le manuscrit de Wissembourg la septième du livre IV et dans le Romulus primitif la dix-septième du livre III.
Phèdre. A furibus tuearis et noctu domum. Rom. Nemo passim ingreditur noctu. Wiss. Nemo passim ingreditur.
Phèdre. Dat ossa dominus. Rom. Dat ossa dominus. Wiss. Donat ossa dominus.
Phèdre. ..... a catena collum detritum cani. Rom. cani collum catena attritum. Wiss. collum catena perstrictum.
{p. 319} Phèdre. ........... alligant me interdiu. Rom. Interdiu ligor. Wiss. In die ligor.
En sens inverse on trouve dans les manuscrits du Romulus ordinaire des expressions qui s’écartent du texte de Phèdre, tandis que le manuscrit de Wissembourg les a conservées :
Phèdre.
Wiss. Canis pinguis occurrit lupo. Rom. Canis et lupus dum convenissent.
Phèdre. ........ salutantes dein invicem. Wiss. Cum se gratiose salutarent. Rom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phèdre.
Wiss. Donat ossa dominus a mensa. Rom. Dat ossa dominus.
Phèdre. Et, quod fastidit quisque. Wiss. Et, quod fastidit quisque. Rom. Quod fastidit unusquisque.
Phèdre. Sic sine labore venter impletur meus. Wiss. Sic sine labore vitam gero. Rom. Sic otiosus vitam gero.
Phèdre.
Wiss.
Quanto facilius mihi est otioso satiari cibo bono et sub tecto beatius vivere. Rom. Ut otiosus saturer cibo et sub tecto melius viverem.
Ce qui résulte du double rapprochement qui précède, c’est que, tout en s’écartant peu de leur modèle, les textes du manuscrit de Wissembourg et du Romulus primitif ont été des imitations de l’Æsopus ad Rufum, assez serviles pour donner une idée à peu près exacte de ce qu’il a été, mais non des copies assez littérales pour permettre une restitution que dès lors je ne tenterai pas. Ce qu’on peut seulement tenir pour à peu près certain, c’est que toutes les fois que les manuscrits de Wissembourg et du Romulus Burnéien sont d’accord, on est en présence de l’Æsopus ad Rufum.
Chapitre III.
Examen comparatif des Fabulæ
antiquæ et de l’Æsopus ad Rufum. §
À l’aide des fables du manuscrit de Wissembourg et de celles du Romulus primitif, j’ai pu faire connaître ce qu’était l’Æsopus ad Rufum. Mais entre lui et les Fabulæ antiquæ existe-t-il une corrélation aussi étroite ? Voilà la question sur laquelle j’ai maintenant à m’expliquer.
Il y a d’abord un fait dont la matérialité concluante fournit un sûr élément d’appréciation, c’est que, quoique les Fabulæ antiquæ ne se composent que de fables dont la forme et le fond sont empruntés à Phèdre et quoiqu’elles soient moins nombreuses que celles de l’Æsopus ad Rufum, elles sont loin de ne porter que sur des sujets traités dans cet Æsopus. D’une part, sur les soixante-sept fables de l’anonyme de Nilant, il y en a cinquante-deux seulement qui soient communes aux deux collections et par conséquent quinze étrangères à l’Æsopus, et d’autre part sur les quatre-vingt-quatre de l’Æsopus il y en a trente-deux qui ne se retrouvent pas dans l’Anonyme. En un mot les deux collections présentent au total quatre-vingt-dix-neuf sujets de fables dont quarante-sept, c’est-à-dire presque la moitié, n’appartiennent pas à la fois à l’une et à l’autre. C’est ce qui ressort du tableau suivant :
fables communes à l’anonyme de nilant et à l’æsopus ad rufum.
| Phèdre. | |||
| 1. Le Coq et la Perle. | iii, | 12. | |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | i, | 1. | |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | |||
| 4. Le Chien et la Brebis. | i, | 17. | |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | i, | 4. | |
| {p. 321}6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | i, | 5. | |
| 7. Le Soleil qui se marie. | i, | 6. | |
| 8. Le Serpent mourant de froid. | iva, | 19. | |
| 9. L’Âne et le Sanglier. | i, | 29. | |
| 10. Le Rat de ville et le Rat des champs. | |||
| 11. L’Aigle et le Renard. | i, | 28. | |
| 12. Le Corbeau et le Renard. | i, | 13. | |
| 13. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | i, | 21. | |
| 14. L’Âne qui caresse son maître. | |||
| 15. Le Lion et le Rat. | |||
| 16. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | |||
| 17. Les Grenouilles qui demandent un roi. | i, | 2. | |
| 18. Les Colombes et le Milan. | i, | 31. | |
| 19. Le Chien et le Voleur. | i, | 23. | |
| 20. Le Geai vaniteux. | i, | 3. | |
| 21. La Mouche et la Fourmi. | iva, | 24. | |
| 22. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | i, | 10. | |
| 23. L’Homme et la Belette. | i, | 22. | |
| 24. La Grenouille qui s’enfle. | i, | 24. | |
| 25. Le Lion et le Berger. | |||
| 26. Le Cheval et l’Âne. | |||
| 27. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | |||
| 28. Le Rossignol et l’Épervier. | |||
| 29. Le Renard et le Loup. | |||
| 30. Le Cerf et la Fontaine. | i, | 12. | |
| 31. La Vipère et la Lime. | iva, | 8. | |
| 32. Les Loups et les Brebis. | |||
| 33. La Hache et les Arbres. | |||
| 34. Le Loup et le Chien. | iii, | 7. | |
| 35. Le Singe et le Renard. | App. | 1. | |
| 36. Le Marchand et l’Âne. | iva, | 1. | |
| 37. Le Cerf et les Bœufs. | ii, | 8. | |
| 38. Le Lion roi et le Singe. | iva, | 13. | |
| 39. Le Loup et le Berger. | App. | 28. | |
| 40. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | |||
| 41. L’Homme et le Lion. | |||
| 42. La Chienne qui met bas. | i, | 19. | |
| 43. La Corneille et la Brebis. | App. | 26. | |
| 44. La Fourmi et le Grillon. | |||
| 45. Le Lion malade et le Renard. | |||
| 46. La Puce et le Chameau. | |||
| 47. Le Loup et le Chevreau. | |||
| 48. Le Chien vieilli et son maître. | v, | 5. | |
| 49. Le Renard et la Cigogne. | i, | 26. | |
| {p. 322}50. Le Loup et la Grue. | i, | 8. | |
| 51. Le Serpent et le Pauvre. | |||
| 52. Le Chauve et la Mouche. | ivb, | 4. | |
fables spéciales à l’anonyme de nilant.
| 1. Les Chiens affamés. | i, | 20. | |
| 2. Les deux Coqs et l’Épervier. | |||
| 3. Le Limaçon et le Singe. | |||
| 4. La Grue, la Corneille et le Maître. | |||
| 5. Le Chauve et le Jardinier. | |||
| 6. Le Hibou, le Chat et la Souris. | |||
| 7. La Perdrix et le Renard. | |||
| 8. Le Chien et le Crocodile. | i, | 25. | |
| 9. Le Chien et le Vautour. | i, | 27. | |
| 10. L’Âne, le Bœuf et les Oiseaux. | |||
| 11. Le Taureau et le Moucheron. | |||
| 12. La Cigogne, l’Oie et l’Épervier. | |||
| 13. Le Lièvre, le Moineau et l’Aigle. | i, | 9. | |
| 14. Le Cheval, l’Âne et l’Orge. | |||
| 15. L’Aigle et le Milan. | |||
fables spéciales à l’æsopus ad rufum.
| 1. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | ii, | 6. | |
| 2. L’Épervier malade. | |||
| 3. Le Loup accoucheur. | App. | 19. | |
| 4. La Montagne en mal d’enfant. | iva, | 23. | |
| 5. Le Chien et l’Agneau. | iii, | 15. | |
| 6. Les Lièvres et les Grenouilles. | |||
| 7. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | i, | 16. | |
| 8. La Tête sans cervelle. | i, | 7. | |
| 9. La Mouche et la Mule. | iii, | 6. | |
| 10. Le Lion médecin. | |||
| 11. Junon et Vénus. | App. | 11. | |
| 12. L’Inconstance de la Femme. | App. | 15. | |
| 13. La Courtisane et le Jeune Homme. | App. | 29. | |
| 14. Le Renard changé en homme. | |||
| 15. Le Taureau et le Veau. | v, | 4. | |
| 16. Le Père et le mauvais Fils. | App. | 12. | |
| 17. L’Estomac et les Membres. | |||
| 18. Les Raisins trop verts. | iva, | 3. | |
| 19. La Belette et les Rats. | iva, | 2. | |
| 20. Le Paon et Junon. | iii, | 18. | |
| 21. La Panthère et les Paysans. | iii, | 2. | |
| {p. 323}22. Les Moutons et les Béliers. | |||
| 23. L’Oiseleur et les Oiseaux. | |||
| 24. Le Cheval et le Cerf. | iva, | 4. | |
| 25. L’Âne et le Lion. | i, | 11. | |
| 26. Le Corbeau et les Oiseaux. | |||
| 27. La Corneille altérée. | |||
| 28. L’Enfant et le Scorpion. | |||
| 29. L’Âne et le Loup. | |||
| 30. Les trois Boucs et le Lion. | |||
| 31. Le Glaive perdu. | |||
| 32. La Statue d’Esope. | ii, | Epil | |
Il est un second fait qui ressort péremptoirement de la comparaison des textes, c’est que, si, comme je l’ai démontré, il y a, sinon identité absolue, au moins conformité presque complète entre le texte de Wissembourg et celui du Romulus primitif, la dissemblance est au contraire très apparente entre ce dernier et celui des Fabulæ antiquæ. Ainsi, pour produire un exemple à l’appui de mon affirmation, dans la fable Lupus et Agnus des Fabulæ antiquæ on retrouve les expressions et presque les vers du poète ancien ; dans la même fable des deux autres collections, ils sont très altérés. Pour n’en citer qu’une phrase, dans Phèdre on lit :
Tunc fauce improbaLatro incitatus, iurgii causam intulit.Cur, inquit, turbulentam mihi fecisti aquam ?
Les Fabulæ antiquæ reproduisent presque mot à mot le
texte original ; on y lit en effet : Tunc fauce improba latro
incitatus iurgis dixit : Cur turbulentam fecisti mihi aquam ?
Quand au contraire on cherche la même phrase dans les deux autres
collections, on trouve dans celles de Romulus et de Wissembourg : Lupus ut Agnum vidit, sic ait : Turbasti mihi aquam.
En somme, deux points sont bien acquis, à savoir que l’Æsopus ad Rufum et les Fabulæ antiquæ, ni par leur nombre respectif, ni par les leçons de leurs textes, ne laissent apparaître entre elles une réelle concordance.
Il devient dès lors très facile d’apprécier la valeur des opinions qui ont été exprimées sur l’origine des trois collections, d’en apercevoir la fausseté et de découvrir la vraie solution.
{p. 324}Éditeur des Fabulæ
antiquæ, Nilant devait tout naturellement entrer le premier dans le champ des
hypothèses. Remarquant que le texte qu’il éditait se rapprochait de Phèdre beaucoup
plus que celui de Romulus, il en a conclu que ce dernier avait dû avoir son anonyme
pour origine. Voici en quels termes, dans sa préface, il exprime cette opinion :
« Je ne puis passer sous silence, pendant que je discute et que je rencontre
tant de collections de fables dont l’ordre et la disposition sont presque toujours
les mêmes, que j’ai presque acquis la conviction que nos Fabulæ
antiquæ, comme étant plus anciennes et plus pures que les autres, avaient été
tirées de Phèdre par quelque amateur de fables très ancien, mais pourtant chrétien,
pour en former un petit volume, et qu’elles avaient ensuite servi à un certain
Romulus (si toutefois ce nom n’est pas purement imaginaire), qui, cherchant à en
employer les préceptes à l’instruction de son fils ou à se donner de la réputation à
l’aide du travail d’autrui, comme Paul avec Festus Pompée, les modifia sans
discernement. »
Quand on se réfère au tableau que j’ai dressé, on voit qu’il existe dans la collection de Romulus 32 fables étrangères aux Fabulæ antiquæ. Dans l’hypothèse de Nilant, il faudrait au moins concéder que la collection de Leyde n’a pas été l’unique source de celle de Romulus. Mais la comparaison que j’ai faite des textes ne permet pas d’admettre que l’une ait pu être la base, même partielle, de l’autre.
Si, sans être déraisonnable, on peut, faute d’avoir fait cette
comparaison, soutenir que les Fabulæ antiquæ ont partiellement servi
à la composition du recueil de Romulus, il faut avouer que la thèse inverse, qui
consiste à prétendre qu’elles en sont issues, est absolument insensée. Aussi n’est-ce
pas sans une certaine surprise que j’ai vu M. H. Oesterley la soutenir dans sa
préface. « Bien plus éloignés du plus ancien manuscrit, dit-il, sont les deux
textes donnés par Nilant qu’on ne peut considérer que comme des fragments ou des
excerpta du véritable Romulus321. »
{p. 325}Ce qui paraît avoir porté M. H. Oesterley à cette erreur, c’est que le codex Vossianus latinus in-8º, 15, contenait la dédicace à Tiberinus, et que Nilant l’avait publiée lui-même dans la note B de la page 65 de son édition322. La place même que Nilant avait choisie aurait dû l’éclairer, et il aurait dû comprendre que, si cet éminent critique l’avait reléguée dans une note, c’est qu’il ne l’avait pas considérée comme se rapportant au texte des Fabulæ antiquæ, et son appréciation était parfaitement juste. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à l’analyse que j’ai donnée du fameux manuscrit. On y verra que la dédicace occupe le verso du fol. 4, tandis que les fables, s’étendant du fol. 195 recto au fol. 203 verso, en sont séparées par 190 feuillets, ne paraissent pas copiées par la même main, et très vraisemblablement ne se sont trouvées réunies dans le même Codex que bien longtemps après avoir été écrites.
Dans son opuscule intitulé De Phædri et Aviani fabulis
libellus, M. Müller a formulé une troisième hypothèse. « Il a existé,
dit-il, au commencement du moyen âge un corps de fables ésopiques, tiré d’un certain
nombre d’auteurs latins, désigné sous la dénomination d’Aesopus et
dédié à un certain Rufus. C’est de cet ouvrage, qui depuis a
disparu, que, nul exemplaire de Phèdre n’ayant encore été découvert, l’anonyme de
Nilant, celui de Wissembourg et Romulus ont extrait leurs collections. Ces
collections découlent de cette source unique ; cela est démontré non seulement par
la plus grande partie des sujets traités et par leur texte, mais encore par leur
ordre même qui en beaucoup d’endroits est en parfaite concordance, comme cela
ressort nettement de la table que Roth a établie à la page 545 de son ouvrage323. »
Et plus loin M. Müller ajoute : « Quant à l’âge de celui qui
composa l’Aesopus latin, sa suprême puérilité me semble indiquer
qu’il vécut au temps des Mérovingiens. À l’égard de Romulus, qui, comme je l’ai
rappelé plus haut, ajouta à l’auteur anonyme une certaine parure de langage, je
crois qu’il appartient à l’époque carlovingienne. L’âge de l’anonyme de Wissembourg
ne peut être {p. 326}déterminé. Il est certain que celui de
Nilant est postérieur à Romulus324. »
Il continue en disant que Nilant a publié ce dernier anonyme d’après un manuscrit du xiiie siècle, dernière erreur trop évidente pour que j’aie besoin de la faire ressortir.
En somme, M. L. Müller pense qu’à l’époque mérovingienne un écrivain peu lettré a, en les altérant, fait de toutes les fables latines alors connues un recueil, qui, comprenant non seulement les fables de Phèdre, mais encore beaucoup d’autres, est ensuite devenu la source des trois collections de l’anonyme de Nilant, de celui de Wissembourg et de Romulus. Il place à l’époque carlovingienne l’apparition des fables de Romulus, ne sait quel âge attribuer à celles du manuscrit de Wissembourg, et croit que celles de l’anonyme de Nilant ne remontent qu’au xiiie siècle.
Que les fables du manuscrit de Wissembourg et celles du Romulus primitif soient, les unes et les autres, dérivées de l’Æsopus ad Rufum, je crois pour ma part l’avoir bien établi. Mais qu’il en soit de même de la collection des Fabulæ antiquæ, voilà ce qu’on ne saurait admettre. Malgré mon sincère respect pour la haute érudition de M. L. Müller, je ne puis m’empêcher de trouver qu’il a, dans cette circonstance, été bien irréfléchi. Que n’ayant pas vu le manuscrit de Leyde, il se soit trompé de deux siècles sur son âge, cela se conçoit ou du moins peut s’expliquer : il avait pu ne pas deviner que le feuillet en parchemin dans lequel il s’agit d’une sédition réprimée, en 1221, dans le Limousin, avait été introduit dans le manuscrit par le plus ancien relieur et collé par lui sur la face interne du premier des plats. Mais ce qui à bon droit m’étonne, c’est que, pouvant aisément avoir sous les yeux, par l’édition de Nilant, le texte des Fabulæ antiquæ, et, par celle de M. Oesterley, celui, sinon du Romulus primitif, au moins du Romulus ordinaire qui s’en éloigne peu, il n’ait pas aperçu les différences profondes qui devaient empêcher de leur attribuer une origine commune. En effet, cette impossibilité de les rattacher à une seule et même source est palpable, et par la comparaison des textes je l’ai fait assez ressortir pour qu’il soit superflu d’y ajouter de nouveaux arguments, et je m’en abstiens.
{p. 327}Restent les appréciations de M. L. Müller relativement aux époques auxquelles il faut faire remonter les diverses collections.
Disons d’abord que rien n’autorise M. L. Müller à reporter aux temps mérovingiens la première apparition de l’Æsopus ad Rufum. En effet, si l’on se réfère aux manuscrits, on voit que celui du Romulus Burnéien, qui est pourtant le plus ancien, n’est pas antérieur au xe siècle. Il est vrai que la collection contenue dans ce manuscrit n’est pas une pure copie du Romulus primitif, qui dès lors peut être considéré comme appartenant à une époque plus reculée. Mais, l’eût-il même de beaucoup précédée, on pourrait encore supposer que l’Æsopus ad Rufum, source du Romulus primitif, a été composé au commencement du ixe siècle, ou au plus tôt vers la fin du viiie, et en tous cas à l’époque Carlovingienne. Les temps mérovingiens furent des temps d’ignorance profonde où Phèdre dut être complètement négligé. Au contraire, le siècle de Charlemagne fut, par rapport à la période qui l’avait précédé, un siècle de renaissance littéraire, pendant lequel on s’explique que les gens relativement lettrés aient pu avoir l’idée de transformer le poète ancien.
Quant à la collection de Wissembourg, comme le manuscrit qui la renferme n’est guère que l’altération de l’Æsopus ad Rufum due à une main inexpérimentée, il ne faut peut-être pas lui chercher une date d’apparition antérieure à celle du manuscrit lui-même, et, comme il est du xe siècle, il est très vraisemblable que c’est celui où elle a elle-même pris naissance.
Enfin, en ce qui touche la collection de Leyde, il n’est pas présumable que le moine Adémar l’ait copiée sur un manuscrit antérieur, et il est au contraire supposable qu’il la composa avec l’aide d’un manuscrit de Phèdre, et dès lors on est obligé de lui assigner les premières années du xie siècle.
Livre III.
Étude sur les fables dérivées du Romulus primitif
et sur les manuscrits qui les renferment. §
Prolégomènes. §
En terminant mon étude sur la personnalité du compilateur qui a en la fantaisie de se dissimuler sous le pseudonyme de Romulus, je disais qu’il avait fait oublier Phèdre. Ce troisième et dernier livre va fournir la preuve palpable de cette assertion ; car il n’y va plus être question que des dérivés directs ou indirects du Romulus primitif. Dans ces dérivés on rencontre bien des fables étrangères non seulement aux textes de Phèdre, de Leyde et de Wissembourg, mais même à celui de ce Romulus. Je négligerai les collections dans lesquelles elles sont l’élément dominant, et je ne donnerai asile dans cet ouvrage qu’aux textes dont le Romulus primitif aura été la base capitale.
Comme ce livre, à raison de l’extraordinaire abondance des matières, devait prendre des proportions beaucoup plus considérables que les deux premiers, je l’ai divisé en cinq parties affectées chacune à un dérivé spécial et à ses sous-dérivés, et, pour qu’on sache immédiatement quelle sera la part faite à chacune d’elles, je crois devoir dès à présent avertir qu’elles seront consacrées :
La première, au Romulus ordinaire et à ses sous-dérivés,
La deuxième, au Romulus de Vienne et à ses sous-dérivés,
La troisième, au Romulus de Florence,
La quatrième, au Romulus de Nilant et à ses sous-dérivés,
La cinquième, au Romulus de Berne.
Première partie.
Romulus ordinaire et ses
sous-dérivés. §
Chapitre premier.
Romulus ordinaire. §
Section I. Observations sur le Romulus ordinaire. §
Jusqu’à ce jour la collection que j’appelle Romulus ordinaire a été considérée comme la plus ancienne de toutes celles auxquelles le nom de Romulus peut être donné, en un mot, comme celle qui a été le point de départ de toutes les autres.
Cette manière de voir qu’avant d’y avoir regardé de plus près, j’avais moi-même partagée, devait presque inévitablement être tout d’abord adoptée. En effet, d’une part, le Romulus primitif, directement tiré de l’Æsopus ad Rufum, ne nous a été conservé par aucun manuscrit, et, d’autre part, celui qu’on trouve aussi bien dans les plus anciens manuscrits que dans les plus anciennes éditions, c’est le Romulus ordinaire qu’on devait être dès lors induit à juger le plus ancien de tous.
Plusieurs indices m’ont fait comprendre qu’il ne devait par son ancienneté être placé qu’au second rang.
Je me suis d’abord aperçu qu’il lui manquait deux fables heureusement conservées par le Romulus de Vienne. Je reconnais que ce premier indice à lui seul n’aurait pas été suffisamment concluant ; car deux fables pouvaient avoir été omises, et les manuscrits dans lesquels elles manquaient pouvaient, malgré cette lacune, contenir {p. 331}le vrai texte du Romulus primitif. Aussi, dans ma première édition, tout en constatant l’absence des deux fables, n’avais-je pas été amené à la déduction à laquelle aujourd’hui j’aboutis.
Mais, en comparant les textes, j’ai remarqué que certains Romulus qui n’étaient évidemment que des dérivés du type originaire se rapprochaient, par exception, dans certains endroits, plus que le Romulus ordinaire, de Phèdre et conséquemment de l’Æsopus ad Rufum qui en était directement issu et qui avait été à son tour la source immédiate du Romulus primitif.
Dès lors la conclusion s’imposait : la collection que, comme tous mes devanciers, j’avais prise pour ce Romulus, devait passer au second plan. Mais elle devait y figurer la première ; car, si elle n’était plus qu’un sous-dérivé, elle était de tous celui qui s’était le moins écarté de son modèle et qui en donnait l’idée la plus exacte.
J’ajoute que c’est celui auquel, pendant tout le cours du moyen âge, les copistes, plagiaires, compilateurs, prosateurs et poètes, se sont surtout cramponnés ; car il n’en est pas un dont il soit resté autant de copies littérales ou altérées et qui ait été le point de départ de tant de transformations successives.
Aussi est-ce lui et sont-ce ses sous-dérivés qui, dans cet ouvrage, occuperont la plus large place.
À la rigueur, pour faire connaître son contenu, il me suffirait, dans ce premier chapitre, de renvoyer à la nomenclature que j’ai déjà donnée des fables du Romulus primitif et d’avertir que celle du Romulus ordinaire n’en doit différer que par l’absence des deux fables du Renard changé en homme et du Taureau et du Veau. Mais, à raison de l’importance de ce premier dérivé, je vais ici dresser explicitement la liste de celles dont il se compose :
| Romulus. | Phèdre. | |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | iii, 12. | |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | ii, 1. | |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | ||
| I, 4. Le Chien et la Brebis. | i, 17. | |
| I, 5. Le Chien et l’Ombre. | i, 4. | |
| I, 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | i, 5. | |
| I, 7. Le Soleil qui se marie. | i, 6. | |
| I, 8. Le Loup et la Grue. | i, 8. | |
| I, 9. La Chienne qui met bas. | i, 19. | |
| I, 10. Le Serpent mourant de froid. | iva, 19. | |
| {p. 332}I, 11. L’Âne et le Sanglier. | i, 29. | |
| I, 12. Le Rat de Ville et le Rat des Champs. | ||
| I, 13. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | ii, 6. | |
| I, 14. Le Corbeau et le Renard. | i, 13. | |
| I, 15. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | i, 21. | |
| I, 16. L’Âne qui caresse son maître. | ||
| I, 17. Le Lion et le Rat. | ||
| I, 18. L’Épervier malade. | ||
| I, 19. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | ||
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un roi. | i, 2. | |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | i, 31. | |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | i, 23. | |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | App. 19. | |
| II, 5. La Montagne en mal d’enfant. | iva, 23. | |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | iii, 15. | |
| II, 7. Le Chien vieilli et son Maître. | v, 5. | |
| II, 8. L’Aigle et le Renard. | i, 28. | |
| II, 9. Les Lièvres et les Grenouilles. | ||
| II, 10. Le Loup et le Chevreau. | ||
| II, 11. Le Serpent et le Pauvre. | ||
| II, 12. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | i, 16. | |
| II, 13. Le Chauve et la Mouche. | ivb, 4. | |
| II, 14. Le Renard et la Cigogne. | i, 26. | |
| II, 15. La Tête sans cervelle. | i, 7. | |
| II, 16. Le Geai vaniteux. | i, 3. | |
| II, 17. La Mouche et la Mule. | iii, 6. | |
| II, 18. La Mouche et la Fourmi. | iva, 24. | |
| II, 19. Le Loup et le Renard, jugés par le Singe. | i, 10. | |
| II, 20. L’Homme et la Belette. | i, 22. | |
| II, 21. La Grenouille qui s’enfle. | i, 24. | |
| III, 1. Le Lion et le Berger. | ||
| III, 2. Le Lion médecin. | ||
| III, 3. Le Cheval et l’Âne. | ||
| III, 4. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | ||
| III, 5. Le Rossignol et l’Épervier. | ||
| III, 6. Le Renard et le Loup. | ||
| III, 7. Le Cerf à la Fontaine. | i, 12 | |
| III, 8. Junon et Vénus. | App. 11. | |
| III, 9. L’Inconstance de la Femme. | App. 15. | |
| III, 10. La Courtisane et le Jeune homme. | App. 29. | |
| III, 11. Le Père et le mauvais Fils. | App. 12. | |
| III, 12. La Vipère et la Lime. | iva, 8. | |
| III, 13. Les Loups et les Brebis. | ||
| III, 14. La Hache et les Arbres. | ||
| {p. 333}III, 15. Le Loup et le Chien. | iii, 7. | |
| III, 16. L’Estomac et les Membres. | ||
| III, 17. Le Singe et le Renard. | App. 1. | |
| III, 18. Le Marchand et l’Âne. | iva, 1. | |
| III, 19. Le Cerf et les Bœufs. | ii, 8. | |
| III, 20. Le Lion roi et le Singe. | iva, 13. | |
| IV, 1. Les Raisins trop verts. | iva, 3. | |
| IV, 2. La Belette et les Rats. | iva, 2. | |
| IV, 3. Le Loup et le Berger. | App. 28. | |
| IV, 4. Le Paon et Junon. | iii, 18. | |
| IV, 5. La Panthère et les Paysans. | iii, 2. | |
| IV, 6. Les Moutons et les Béliers. | ||
| IV, 7. L’Oiseleur et les Oiseaux. | ||
| IV, 8. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | ||
| IV, 9. Le Cheval et le Cerf. | iva, 4. | |
| IV, 10. L’Âne et le Lion. | i, 11. | |
| IV, 11. Le Corbeau et les Oiseaux. | ||
| IV, 12. Le Lion malade et le Renard. | ||
| IV, 13. La Corneille altérée. | ||
| IV, 14. L’Enfant et le Scorpion. | ||
| IV, 15. L’Âne et le Loup. | ||
| IV, 16. Les trois Boucs et le Lion. | ||
| IV, 17. L’Homme et le Lion. | ||
| IV, 18. La Puce et le Chameau. | ||
| IV, 19. La Fourmi et le Grillon. | ||
| IV, 20. Le Glaive perdu. | ||
| IV, 21. La Corneille et la Brebis. | App. 26. | |
| IV, 22. La Statue d’Ésope. | ii, Epil. | |
| Épil. Rufus. | ||
Il serait maintenant naturel que je fisse apprécier, par les mêmes procédés que précédemment, dans quelle mesure le Romulus ordinaire a conservé les phrases et les expressions de Phèdre. Mais, lorsque j’ai voulu qu’on pût se rendre compte du degré de ressemblance qui existe entre l’œuvre du fabuliste romain et celle du Romulus primitif, c’est, à défaut du texte disparu de ce dernier, à celui du Romulus ordinaire que j’ai eu recours. Établir un nouveau parallèle entre les mêmes éléments serait refaire une besogne déjà exécutée, et, comme il est bien inutile de la recommencer, je m’en abstiens.
Section II. Manuscrits du Romulus ordinaire. §
Les manuscrits que j’ai considérés comme contenant le texte du Romulus ordinaire sont les six suivants :
1º Le manuscrit du British Museum ;
2º La copie manuscrite du manuscrit de Dijon ;
3º Le manuscrit de Pierre Crinitus ;
4º Le manuscrit du Mans ;
5° Le manuscrit du Corpus Christi d’Oxford ;
6º Le manuscrit de Phillips.
Ces manuscrits peuvent se partager en deux groupes égaux.
Le premier doit comprendre les trois premiers manuscrits, le second les trois derniers.
Les trois textes du premier groupe sont presque identiques : ils sont divisés en quatre livres semblables tant par le nombre que par l’ordre des fables.
Les trois manuscrits, formant le second groupe, sont en notable désaccord avec ceux du premier. Sauf celui d’Oxford, ils offrent bien la même division en quatre livres, mais tous les trois ils différent des trois premiers par le classement des fables ; ainsi dans les manuscrits du second groupe la fable de l’Aigle et du Renard, au lieu d’être la huitième du livre II, est la treizième du livre Ier.
En outre, leurs textes eux-mêmes s’écartent de celui des manuscrits du premier groupe par de telles variantes que, si l’on ne craignait pas de pousser trop loin les divisions, on pourrait les regarder comme des dérivés du Romulus primitif distincts du Romulus ordinaire. Mais, comme, en l’absence du Romulus primitif, on ne peut avec certitude trancher la question, j’ai trouvé plus simple et plus prudent de considérer les trois manuscrits du second groupe comme contenant, malgré leurs variantes, la même collection que les trois du premier.
La solution opposée aurait eu des conséquences que je tenais à éviter : les collections du second groupe non seulement diffèrent de celles du premier, mais encore entre elles ne sont pas en {p. 335}parfaite harmonie. Si j’avais vu en elles des dérivés du Romulus primitif, j’aurais dû, en même temps, en faire trois dérivés distincts les uns des autres, et, comme telles, les éditer toutes les trois à la suite du texte du Romulus ordinaire. En somme, j’aurais été dans la regrettable nécessité de publier côte à côte quatre textes assez peu dissemblables pour pouvoir être considérés comme appartenant à une seule et même collection.
Ne faisant paraître qu’un seul texte, comme c’est le premier groupe qui renferme le plus exactement le texte du Romulus ordinaire, c’est à l’un des trois manuscrits de ce groupe que je l’emprunterai, et, comme des trois manuscrits qu’il comprend deux sont des apographes modernes et qu’un seul, celui du British Museum, à raison de sa grande ancienneté, est le plus digne de confiance, c’est son texte que je reproduirai.
Comme dans ma première édition j’avais opté pour la copie de Pierre Crinitus, mon choix actuel permettra à ceux qui le désireront de comparer ensemble le plus ancien texte et le plus récent.
Cela expliqué, je vais donner sur chacun des six manuscrits quelques indications particulières.
Avant d’entrer dans le Musée Britannique, le manuscrit Burnéien avait appartenu à un savant qui avait su se constituer une des plus remarquables bibliothèques qu’un particulier ait jamais possédées, au professeur Charles Burney, de qui je vais d’abord en quelques mots retracer la vie.
Né, le 4 décembre 1757, à Lynn dans le comté de Norfolk, il est, encore enfant, conduit à Londres. En 1768, il est placé à la Chartreuse (Charter House). Puis, à Cambridge, il entre au collège de Caïus, et de là passe à celui du Roi dans Vieux Aberdeen. En 1781, il est reçu maître ès arts, et l’année suivante il devient professeur de l’Académie de Highgate. Au cours de l’année 1783, il épouse la fille du docteur Rose, et collabore à Chiswick avec ce dernier dans la Monthley Review. Ayant, en 1792, obtenu, à l’Université d’Aberdeen, le grade de docteur en droit, il fonde une première institution à Hammersmith, puis une seconde à Greenwich, laisse cette dernière à son fils et meurt en 1817.
{p. 336}Ces diverses phases de sa.vie ne l’avaient pas mis assez en lumière pour sauver son nom de l’oubli. Mais, en se formant sa magnifique bibliothèque, il avait accompli une œuvre qui devra l’immortaliser. En vertu d’un vote de la Chambre des Communes, l’État, moyennant la somme de 337 000 francs, se rendit acquéreur de sa collection. Elle fût placée au British Museum, et aujourd’hui elle y forme un des fonds les plus précieux du département des manuscrits.
Le manuscrit de Romulus, qui en fait partie, porte le nº 59, et,
comme sous ce numéro l’ancien catalogue imprimé en donne une analyse exacte, il
est permis de trouver un peu prétentieuse cette phrase de M. H. Oesterley :
« D’abord j’ai été assez heureux pour trouver un manuscrit de Romulus,
appartenant, non au xiie siècle, mais
au xe. »
Sans doute, en publiant le
Codex Burnéien, il a eu une bonne inspiration ; mais, quand il se glorifie de sa
découverte, il se vante un peu d’avoir trouvé ce qui n’était pas perdu ; et,
quant à l’âge du manuscrit, il est vrai que le catalogue imprimé l’avait à tort
attribué au xie siècle ; mais, pour rectifier
cette erreur, l’administration du British Museum n’avait pas attendu la visite
du docteur allemand : il reconnaît lui-même qu’au mois d’août 1869 l’origine du
manuscrit, par suite d’une révision générale, avait été reportée au xe siècle.
Le manuscrit est du grand format in-folio ; l’écriture, admirablement nette, est sur vélin, et se divise sur chaque page en deux colonnes. Il n’y a que dix feuillets.
Les fables de Romulus commencent en tête du verso du premier feuillet et se terminent au verso du sixième, au bas de la première colonne.
Au haut de la seconde commence un ouvrage qui a dû être composé à
l’usage des écoliers ; car il porte ce titre : Incipiunt
propositiones ad acuendos juvenes
, et paraît ne contenir que
des problèmes d’arithmétique.
Quant au texte des fables, après ce que j’en ai déjà fait connaître, il me paraît superflu d’en parler de nouveau.
La description que je viens de faire sommairement du manuscrit Burnéien suffit pour en faire comprendre l’importance. En effet, si des doutes pouvaient encore subsister au sujet de l’ancienneté des fables de Phèdre, il suffirait pour les lever. Mais {p. 337}M. H. Oesterley lui trouve encore un autre intérêt : pour lui, il démontre que le texte de Romulus qu’il contient nous est parvenu tel qu’il a été composé à l’origine ; il en conclut que c’est bien un dérivé direct ; autrement, dit-il, on ne le retrouverait pas, à plusieurs siècles d’intervalle, toujours conforme à lui-même, tout en servant de source à d’autres collections qui n’en étaient que l’altération. La filiation des textes, telle que je l’ai jusqu’ici établie, permet de savoir ce que vaut son appréciation. Aussi, après l’avoir exposée, m’abstiendrai-je de la réfuter.
Le manuscrit de Dijon appartenait au couvent bénédictin de Saint-Bénigne. C’est là que Gude l’a trouvé et l’a copié. Malheureusement il n’existe plus ; il a dû périr avec l’abbaye elle-même pendant la tourmente révolutionnaire.
J’ai voulu savoir si, à l’époque où furent supprimés les ordres monastiques, il n’était pas passé dans la bibliothèque publique de Dijon, et pour cela je me suis par lettre adressé au conservateur. Voici sa réponse qui ne s’est pas fait attendre, mais qui ne m’a pas permis de garder à ce sujet la moindre illusion :
« Dijon, le 10 février 1870.
« Monsieur,
« J’ai l’honneur de vous faire connaître que la bibliothèque publique ne possède pas le plus ancien manuscrit des fables de Romulus, et j’ai de graves raisons de croire qu’il ne lui a jamais appartenu.
« Ce manuscrit du xiie siècle, de grand format, renfermant les quatre livres de fables de Romulus et XXXII livres de l’histoire naturelle de Pline, se trouvait, au temps du docte Gude qui le copia (1660-1663), dans l’ancienne bibliothèque de l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Mais tout me fait penser que ce manuscrit précieux n’entra jamais dans la bibliothèque publique de la ville. J’ai fait, pour m’en assurer, des recherches sérieuses à l’occasion d’une demande toute semblable à la vôtre, qui m’a été adressée au mois d’août dernier par M. le docteur E. Grosse de {p. 338}Kœnigsberg, occupé de la publication d’une nouvelle édition des fables ésopiques chez le libraire Teubner à Leipzig.
« Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
« Le bibliothécaire de la ville de Dijon,
Signé : « Guignard. »
Le manuscrit de Dijon est donc bien perdu, et il n’y a pas à espérer qu’il se retrouve jamais.
Heureusement la copie de Gude n’a pas subi le même sort. Gude, on le sait, fut un des plus savants antiquaires de l’Allemagne. En 1659, chargé de l’instruction d’un jeune et riche Hollandais, nommé Samuel Schatz, il partit de la Haye avec lui, resta une année à Paris, parcourut le midi de la France, passa par Toulouse au mois d’octobre 1661, gagna l’Italie et visita Florence, Rome et Naples. À son retour en Hollande, ses amis lui firent offrir une chaire à Duisbourg ; mais il la refusa pour continuer ses voyages avec son élève qu’il conduisit en Angleterre. Rentré en Hollande une seconde fois, il n’y séjourna pas plus que la première, et, toujours suivi du même compagnon de route, il se rendit dans le Holstein, dont le souverain, en 1671, lui confia les fonctions de bibliothécaire. Il s’occupa alors de mettre en ordre les précieux matériaux qu’il avait recueillis dans ses nombreuses pérégrinations ; mais le temps lui manqua pour les publier, et il mourut le 26 novembre 1689, sans avoir pu faire connaître toutes les richesses archéologiques qu’il avait amassées.
Il avait, en voyageant, rencontré dans le couvent de Saint-Bénigne le fameux manuscrit de Dijon. Ce manuscrit se composait, suivant lui, d’un cahier de parchemin in-folio, dont l’écriture devait remonter à cinq cents ans. D’après un usage bien fréquent, les fables de Romulus n’étaient pas seules. Ainsi que le porte la lettre de M. Guignard, à la suite venaient 32 livres de l’histoire naturelle de Pline. Mais il paraît qu’ils avaient peu d’intérêt pour Gude, qui les a bien signalés, mais qui ne prit copie que des fables. La compétence du savant à qui cette copie est due lui donne une valeur presque égale à celle du manuscrit perdu. Aussi Schwabe et les autres érudits qui s’en sont servis y ont-ils accordé la même foi qu’au manuscrit lui-même.
{p. 339}À propos du manuscrit de Wissembourg, j’ai déjà eu l’occasion d’expliquer qu’au nom du duc de Brunswick, Leibnitz, après la mort de Gude, avait acheté ses livres. Il en est résulté que sa copie est passée dans la bibliothèque de Wolfenbüttel, où elle est encore.
L’existence du manuscrit de Pierre Crinitus me fut révélée par
une sorte de post-scriptum ajouté par M. Oesterley à la préface de son édition
du Codex Burnéien. Voici ce que j’y ai lu : « Grâce à l’obligeance de
M. le docteur E Grosse de Königsberg, qui s’occupe depuis longtemps de réunir
des matériaux importants pour un ouvrage semblable, j’ai eu connaissance d’une
copie de Romulus, que je ne soupçonnais pas auparavant et qui a été écrite, en
1495, à Florence, par le célèbre Pierre Crinitus. Elle est contenue dans le
manuscrit latin 756 de Munich et concorde si parfaitement, sauf quelques
titres intervertis, avec les manuscrits Dijonais et Burnéien, qu’il n’y a à
relever qu’un très petit nombre de variantes qui peuvent être mises au compte
du savant copiste. Si cette copie n’a pas d’importance pour la détermination
du texte, elle prouve du moins une fois de plus que la composition originaire
de notre ouvrage s’est conservée pendant des siècles entiers sans aucun
changement, à côté des transformations multiples et profondes que le fond même
de l’œuvre avait subies325. »
{p. 340}Ces réflexions de M. H. Oesterley contribuèrent à m’inspirer le désir de publier le manuscrit de Munich. Il avait donné du plus vieux manuscrit une édition diplomatique qui avait établi l’ancienneté de l’œuvre. Schwabe avait déjà fait paraître une édition, qui était le résultat de la combinaison de l’apographe de Gude avec l’édition originale de Stainhövel et avec les extraits insérés dans les œuvres de Vincent de Beauvais, et qui par suite avait été élaborée à l’aide des documents de l’âge intermédiaire. Je pensai que, pour montrer comment, tout en donnant lieu à des imitations variées, la collection la plus proche du Romulus primitif s’était conservée intacte jusqu’à l’époque de la Renaissance, il était intéressant d’en éditer enfin le manuscrit le plus récent.
Au cours de l’été de 1873, j’avais, ainsi que je l’exposerai plus loin, formé le projet de me rendre à Vienne, pour vérifier une assertion de M. Endlicher, qui, en s’appuyant sur un manuscrit de la grande bibliothèque autrichienne, avait attribué à l’archevêque Hildebert les Tables de l’anonyme de Névelet. Devant inévitablement passer par Munich, je ne voulus pas laisser échapper une occasion si naturelle de me procurer la copie du manuscrit de Crinitus. Mais je ne devais m’arrêter à Munich que quatre ou cinq jours, et je savais que, chaque jour, la bibliothèque n’était ouverte que de huit heures du matin à une heure de relevée ; ce qui, si surtout l’écriture de Crinitus n’était pas bien nette, pouvait m’ôter le loisir de le copier sur place. Dans cette crainte, j’écrivis à M. Lefebvre de Behaine, chargé d’affaires de France, pour le prier d’en demander communication, de manière à me permettre de faire ma copie soit à la Légation, soit à mon hôtel.
Il s’empressa de me répondre la lettre suivante :
« Munich, le 20 juin 1873.
« Monsieur,
« J’aurais été très heureux de vous rendre service et de vous procurer des facilités pour copier pendant votre prochain séjour à Munich le manuscrit qui vous intéresse. Mais il m’est impossible de solliciter la communication de ce document sans y être autorisé par M. le ministre des affaires étrangères. Veuillez donc réclamer à cet effet les bons offices du duc de Broglie. Dès que {p. 341}j’aurai reçu l’avis officiel d’agir auprès du gouvernement bavarois, je ferai les démarches nécessaires pour qu’on vous accorde la disposition dudit manuscrit en dehors des heures réglementaires. Je ne saurais toutefois vous garantir que vous serez autorisé à procéder à votre travail en dehors de la bibliothèque.
« Veuillez recevoir, monsieur, l’assurance de ma haute considération.
« Signé : E. Lefebvre de Behaine,
« Chargé d’affaires de France à Munich. »
Je désirais trop vivement parvenir à mes fins pour ne pas suivre la voie qui m’était tracée et je me hâtai d’adresser ma requête au ministre des affaires étrangères, qui ne tarda pas à m’envoyer la réponse suivante :
« Versailles, 1er juillet 1873.
« Monsieur,
« J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 25 juin dernier pour m’exprimer le désir d’être autorisé, pendant le séjour que vous vous proposez de faire à Munich, à copier certains passages d’un manuscrit latin portant le nº 756 et appartenant à la bibliothèque de cette ville. J’ai transmis votre demande à M. le chargé d’affaires de France à Munich, en le priant de vouloir bien faire auprès du gouvernement bavarois les démarches nécessaires pour vous procurer les facilités qui pourraient vous aider dans votre travail.
« Recevez, monsieur, les assurances de ma parfaite considération.
« Signé : Broglie. »
Toute difficulté me paraissant aplanie, je quittai Paris, et le jeudi matin, 10 juillet, arrivé à Munich, je me présentai à la Staat bibliotek, et demandai à être introduit auprès du conservateur des manuscrits. Avec la conviction qu’il s’attendait à me voir, je lui exposai l’objet de ma visite. Mais quelle ne fut pas ma surprise, quand je vis qu’aucun avis ne lui avait été donné ! Il m’exposa que, pour m’autoriser à emporter chez moi le manuscrit, il lui fallait une garantie ; et comme, d’après mes explications, il supposait bien que le chargé d’affaires de France devait être disposé à me {p. 342}prêter son concours, il m’engagea à l’aller trouver et à lui faire signer en blanc un des bulletins de la bibliothèque, me disant que, si je lui rapportais sa signature, il me confierait le manuscrit. Je suivis son conseil et me hâtai de me rendre chez le chargé d’affaires, qui, à son tour, me manifesta le plus grand étonnement. Autorisé par le duc de Broglie, il avait aussitôt adressé en ma faveur une demande au ministre des affaires étrangères bavarois ; mais, grâce sans doute aux lenteurs de la bureaucratie, le conservateur de la bibliothèque n’avait reçu aucune instruction. Bref, M. Lefebvre de Behaine eut la complaisance de mettre sa signature au bas du bulletin. Seulement il fut entendu que je rapporterais le manuscrit au Consulat situé vis-à-vis de la Légation, et que, pour me permettre d’y travailler à l’aise, une salle serait mise à ma disposition.
Le lendemain matin, retourné à la bibliothèque, je reçus du conservateur le manuscrit tant désiré. Je m’empressai de le porter au Consulat et de m’installer dans la salle que le consul avait eu l’obligeance de me réserver, et, au bout de trois jours, le dimanche 13 juillet, ma copie était terminée.
Le manuscrit forme un volume in-fol. de petit format, composé de
186 feuillets en papier et écrit tout entier de la main du savant Florentin. Les
fables de Romulus occupent les feuillets 151 à 164. Après les avoir transcrites,
Crinitus y avait ajouté une mention, qu’il avait signée et dont voici la
traduction : « J’ai terminé la copie de ces fables d’Ésope le
30 juin 1495, lorsque j’interprétais à part Fabius326 et que je me consacrais aux auteurs
grecs plus spécialement qu’aux latins. Signé : Pierre Crinitus de Florence. »
Je crois inutile de m’étendre davantage sur le contenu du manuscrit de Munich, et la raison, c’est que je l’ai publié dans ma première édition.
La bibliothèque publique de la ville du Mans possède un manuscrit, qui, malgré les nombreuses variantes qu’il présente, doit être considéré, non comme un dérivé, mais comme un exemplaire plus ou moins pur du texte du Romulus ordinaire.
{p. 343}C’est un volume du petit format in-fol., composé de 167 feuillets : ceux portant les nos 1, 2, 129, 130, 165 à 167, sont en papier, et appartiennent au xve siècle ; les autres sont en vélin et appartiennent au xiiie siècle.
L’écriture est à longues lignes, sauf sur les feuillets 115 a à 128 b, où elle est à deux colonnes. Voici l’analyse du contenu.
Fol. 1 à 2, 129 à 130 et 165 à 167. — « Ex
Proprietario super prefacionem in Bestiarium. Argumentum. Ad hoc dicit idem
in libro primo : Animalia quedam sunt urbana, quedam
agrestia… »
Fol. 3 a à 76 b. « Incipit bestiarius loquens de naturis bestiarum, avium, serpentum,
piscium, arborum et de naturis corporeis exterioribus et interioribus et de
gradibus etatis. — Capitula de bestiis (49 chap.). »
— Fol. 4 a. « De Leone. Leo fortissimus
bestiarum ad nullius pavebit occursum… »
— Fol. 33.
« Prologus super aves (36 chap.). »
— Fol. 52 b. « Prologus super serpentes
(19 chap.). »
— Fol. 60 b. « Prologus vermium (8 chap.). »
— Fol. 62. « Prologus piscium (23 chap.). »
— Fol. 71. « Prologus arborum (29 chap. terminés par ces mots : scriptura scribe in buxo). »
Fol. 76 b à 94 a. (Isidori
Etymolog. xi, 1 et 2.) Sans titre : « Natura
dicta eo quod nasci… — … humum est inicere. »
Fol. 94 a à 110 a.
« Hic incipit lapidarius.
Evax rex Arabum legitur scripsisse Neroni,Qui post Augustum regnavit in urbe secundus…De gemmis.
Preter quod lapidum titulo liber iste notatur. »
Fol. 110 a et b. (De
Castitate.) Sans titre : « Sunt lapides igniferi in quodam
monte Orientis… — … nunc debachatur. »
Fol. 110 b à 114 b.
« De vestimentis sacerdotalibus et missa.
Illud sulpicium quod presbiter induit ante…Fert nimis indigne cecas habitasse cavernas. »
Fol. 115 a à 128 a.
« Incipiunt capitula libri Ysopi primi libri… Liber
primus fabularum Ysopi gentilis incipit. Romulus Tyberino filio de civitate
attica. Isopus homo… Explicit liber Ysophiarum. »
Fol. 128 b. Fable sans titre : « Qui pravorum consilio credit viam… in laqueum mortis.
Explicit. »
{p. 344}Fol. 131 a à 152 b. (Petri Alfonsi clericalis disciplina.) « Dixit Petrus Ambfonsus servus Christi Jhesu compositor hujus libri. Gratias
ago domino qui primus est… — … in aula celesti, prestante domino nostro
Jhesu Christo cui est honor et gloria cum patre et spiritu sancto per
infinita seculorum secula. Amen. »
Fol. 153 a à 164 b. (Sancti
Methodii revelationes.) « Rogasti, Karissime pater, ut
librum Carissimi Methodii… — … et postea Tyri episcopus. Explicit prologus.
— Adam et Eva de paradiso virgines… — … in monumento temporis.
Explicit. »
Fol. 163 b à 164 b.
— « Et post hec descendet rex Romanorum… — … in
infernum, ex quo eripiamur per gratiam et humanitatem domini dei et
salvatoris nostri Jhesu Christi, cum quo est patri una cum spiritu sancto
omnis honor et gloria et potestas et imperium nunc et semper in secula
seculorum. Amen. Explicit liber sancti Methodii episcopi de greco in latinum
translatus a Petro monacho. »
De l’analyse qui précède il ressort d’abord que le manuscrit contient les fables du Romulus ordinaire ; elles s’y trouvent bien au complet et elles seraient dans le même ordre que dans les manuscrits de Burney, de Gude et de Pierre Crinitus, si la fable du Renard et de l’Aigle, au lieu d’être la treizième du livre Ier, était la huitième du livre II. Nous avons vu que, sur ce point, le manuscrit du Mans n’est pas le seul qui soit en désaccord avec les trois précédents. Je dois ajouter que son texte présente des variantes assez nombreuses, qui sont en général le résultat soit de changements dans l’ordre des mots, soit d’erreurs involontaires dues à l’ignorance des copistes, et quelquefois aussi la conséquence de modifications intentionnelles. Je rappelle que, dans ma première édition, je les ai notées au bas du texte du Romulus ordinaire édité d’après la copie de Pierre Crinitus. Je ne crois pas utile de prendre une seconde fois la même peine.
Dans le manuscrit du Mans, à la suite des fables du Romulus ordinaire, vient au verso du feuillet 128 une fable dont le sujet a été traité dans Avianus ; c’est celle du Lion et du Renard qui a volé le cœur du Cerf. Comme elle a pour origine une de celles de ce fabuliste, je ne lui maintiendrai pas dans cette seconde édition la place qu’elle occupait dans la première.
{p. 345}Après avoir, dans la Préface de sa publication du manuscrit Burnéien, exprimé son opinion sur les deux collections de Nilant et avoir bien imprudemment allégué que les Fabulæ antiquæ et le Romulus de ce philologue ne seraient que des dérivés semblables de la collection du Romulus ordinaire, M. Oesterley donne la nomenclature de ceux des manuscrits relatifs à ces matières, parvenus à sa connaissance.
Les deux premiers appartiennent au collège du Corpus Christi d’Oxford ;
Le troisième, au collège Merton de la même ville ;
Le quatrième, au fonds Harley du British Museum.
Voici l’indication sommaire qu’il donne du premier :
« Cod. Oxon., collège Corpus Christi 42, feuillets 150 bis à 161, xive siècle, ne contient que
trois livres. Il commence ainsi : Incipit prologus super librum fabularum
Æsopi gentilis. Le prologue commence par ces mots : Memoriam tibi
tradam. Ce manuscrit me paraît plus voisin de la paraphrase de
Wissembourg que de celle de Romulus. »
J’ai voulu voir ce manuscrit. Je me suis rendu à Oxford, et, quoique la Bibliothèque du Corpus Christi ne fût pas publique, j’ai pu, grâce à l’intervention obligeante d’un membre de l’Université, bibliothécaire à la Bodléienne, pénétrer dans la Bibliothèque de ce collège, et, pendant une heure environ, examiner le petit in-folio qui portait la cote 42.
Je n’ai pas tardé à me convaincre que M. Oesterley ne l’avait jamais eu entre les mains, et qu’il n’avait fait dans sa courte analyse que copier, en l’altérant, celle qu’il en avait trouvée dans le Catalogue des manuscrits des collèges d’Oxford publié par le savant et vénérable Coxe327.
Si M. Oesterley avait pris la peine de jeter un simple coup d’œil sur le manuscrit, il aurait vu qu’il contenait le Romulus ordinaire, qu’il portait en tête, sans modification notable, la dédicace {p. 346}à Tibérinus, que les mots Memoriam tibi tradam formaient, comme dans les autres manuscrits, le commencement non pas du prologue, mais de l’épilogue, et qu’enfin le manuscrit renfermait non pas seulement les trois premiers livres, mais la totalité des fables divisées en trois livres.
Le premier livre se compose de 20 fables ; le second, de 27 sous 28 numéros, et le troisième, de 36, l’épilogue à Rufus compris ; ce qui donne un total de 83 fables, qui non seulement sont égales en nombre à celles des manuscrits du premier groupe, mais encore se suivraient absolument dans le même ordre, si la fable du Renard et de l’Aigle, au lieu d’appartenir au livre Ier, où elle est la treizième, était la huitième du livre II.
La fin du livre I et le commencement du livre II sont indiqués en
ces termes : Explicit liber primus. Incipit liber
secundus.
La fin du livre II et le commencement du livre III sont signalés
par ces deux formules semblables aux deux précédentes : Explicit liber secundus. Incipit liber tertius.
La souscription finale consiste dans le simple mot Explicit
, écrit à l’encre rouge comme les
souscriptions et les titres que je viens de reproduire.
Voilà ce que tout de suite un premier examen superficiel m’a permis d’apercevoir.
Dans un second voyage, j’ai, par l’entremise obligeante du savant Neu-Bauer, bibliothécaire à la Bodléienne, obtenu que le manuscrit fût extrait de la bibliothèque du collège du Corpus Christi et mis à ma disposition dans la Radcliffe library ; là j’ai, au mois de juillet 1875, passé plusieurs soirées à en faire la copie entière, et je me suis ainsi assuré que la pureté du texte était assez irréprochable pour qu’on pût y voir un exemplaire du Romulus ordinaire. En effet il ne diffère guère de celui du manuscrit Burnéien que par des variantes consistant le plus souvent, non dans des mots différents, mais dans la place différente donnée aux mêmes mots. Elles se réduisent en général à de légères transpositions opérées sans doute par un copiste un peu trop indépendant qui comprenait et croyait pouvoir améliorer ce qu’il écrivait. En outre ce copiste, trouvant probablement trop longs les titres qui existent dans les plus anciens manuscrits et devaient exister dans son modèle, s’est permis, non de les remplacer par d’autres, mais de {p. 347}les supprimer. Il n’a respecté que ceux des fables i, ii et xx du livre I et xxii du livre II, c’est-à-dire des fables du Coq et de la Perle, du Loup et de l’Agneau, des Oiseaux et de l’Hirondelle et du Lion et du Berger.
Enfin, dans la première fable du livre I, il a même omis la moralité.
Tel est le contenu du manuscrit du Corpus Christi.
Quant au volume lui-même, c’est un in-4º, dont les feuillets sont en parchemin et dont l’écriture, un peu grosse et parfaitement nette, est du xive siècle.
Depuis la publication de ma première édition, j’ai découvert un sixième manuscrit du Romulus ordinaire. Il est en Angleterre, à Cheltenham, et dépend de la Phillips’s library installée dans un palais particulier de style grec connu sous le nom de Thirlestaine house. C’est un volume in-4º, qui, formé d’éléments divers, comprend 146 feuillets en parchemin et dont l’écriture m’a paru être en partie du xvie siècle et en partie du xve.
Les quatre premiers feuillets seraient totalement blancs, si le recto du premier ne portait cette courte table des matières :
Johēs de Muris, de Musica,
Æsopi fabulæ,
Gaffrey Wynsafe, de Poetrica,
Expositio ejusdem,
De Preteritis et Supinis.
Le titre Æsopi fabulæ se rapporte à la fois aux fables de l’Anonyme de Névelet que j’appellerai Walther et à celles du Romulus ordinaire.
Les fables de Walther, qui commencent au haut du feuillet 13 vº et finissent au milieu du feuillet 33 rº, ont d’abord figuré seules sur les feuillets qu’elles occupent. Puis, tant en marge qu’au bas des pages, elles ont été encadrées dans celles du Romulus ordinaire, sinon par le même copiste, du moins par un autre aussi ancien.
Il a été donné aux deux collections un seul et même titre général ; {p. 348}un seul titre sert également aux deux prologues ; enfin chaque fable en vers et sa correspondante en prose s’abritent aussi sous le même.
Tous paraissent empruntés au Romulus ordinaire. On peut trouver
plus de ressemblance avec celui du Romulus de Vienne dans le titre général ainsi
conçu : Incipit liber primus fabularum isopi
gentilis.
Mais il ne faudrait pas en conclure qu’il en est de
même des fables. Par la première que je vais ici transcrire on va pouvoir se
convaincre que leur texte est bien celui du Romulus ordinaire : Esopus de se primam dixit fabulam. In sterquilinio quidam
gallinatus, dum quereret escam, invenit margaritam in indigno loco jacentem.
Quam ut vidit, sic ait : O bona res, in stercore jaces. Te si cupidus homo
invenisset, quo gaudio te rapuisset, ut redires ad splendorem pristinum
decoris tui ! Ego te inveni in hoc loco jacentem. Potius mihi escam quero, nec
ego tibi prosum, nec tu mihi. Hec illis Esopus narrat qui non
intelligunt.
Les deux premiers livres se composent de chacun vingt fables par suite du transfert du deuxième au premier de la fable de l’Aigle et du Renard.
La fin du livre I et le commencement du livre II sont indiqués
par ces deux phrases à l’encre rouge : Explicit liber
primus fabularum. Incipit Esopi liber secundus.
La fin du livre II et le commencement du livre III sont annoncés
en ces termes : Explicit liber secundus : incipit liber
tercius Ysopi gentilis.
Dans le livre III, comme Walther n’a pas traduit en vers
élégiaques la fable en prose De Junone et Venere, elle a été
mise avec celle De la Veuve et du Jeune soldat en marge de la version poétique
de cette dernière. Dans le même livre la fable du Lion régnant du Romulus
ordinaire a été transcrite au-dessous de celle du Juif et de l’Échanson de
Walther. Immédiatement après, au bas du feuillet 34 b, on lit
la souscription suivante : Explicit liber tertius prosa
Esopi.
Au haut du feuillet 35 a, commence, sans titre, la fable lx de Walther ordinairement intitulée De Cive et Milite, suivie des deux fables qui y sont le plus souvent ajoutées. En marge et au-dessous tant de la soixantième que des deux complémentaires, le second copiste a transcrit les vingt-deux fables du livre IV du Romulus {p. 349}ordinaire, et, comme l’espace n’était pas suffisant, il a, pour l’achever, continué sa copie en marge de deux petits poèmes en vers hexamètres, qui font suite aux fables de Walther.
L’Épilogue à Rufus a été omis. Il n’y a, après la
fable xxii
De statua Æsopi, que cette souscription finale : Explicit prosa libri quarti Esopi gentilis qui scilicet ultimus
esse dicitur.
Section III.
Éditions du Romulus ordinaire. §
De tous les dérivés directs du Romulus primitif le Romulus ordinaire est, avec celui de Nilant, le seul qui ait été imprimé ; mais en revanche la publicité qu’il a reçue a été considérable. Il a fait, dès les premières années de l’imprimerie, l’objet de publications relativement nombreuses, qui ont été longtemps reproduites.
L’édition la plus célèbre et vraisemblablement la plus ancienne du Romulus ordinaire fut celle d’Ulm, que Schwabe considéra comme ayant la valeur d’un véritable manuscrit, et qui, ayant été la base de toutes les réimpressions successives, doit être décrite avant toutes les autres.
Elle fut publiée par le Dr Henri Steinhöwel, médecin né à Wyrms, qui exerçait à Ulm sa profession, et imprimée dans le petit format in-folio par l’imprimeur Jean Zeiner sans indication de date, et sans pagination, signatures ni réclames. Elle se compose de 288 feuillets, répartis entre vingt-neuf cahiers qui eux-mêmes sont formés, les vingt-six premiers de dix feuillets chacun, le vingt-septième de douze, le vingt-huitième de six, et le vingt-neuvième de dix. Ils ont été imprimés en caractères gothiques de grosse dimension, de sorte que le nombre des lignes de chaque page descend jusqu’à trente et un, est le plus souvent de trente-trois ou trente-quatre, mais ne s’élève point au-dessus de ce dernier chiffre.
L’édition est ornée de nombreuses gravures sur bois toujours {p. 350}grossières et quelquefois licencieuses, dont la première occupe tout le verso du premier feuillet et a la prétention d’être le portrait en pied du père de la fable.
Le feuillet 2 a commence par ce titre :
Vita Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina ꝑ │
Rimicium facta ad reuerendissimʒ patrem dnˉm │ Anthonium tituli sancti
Chrysogoni presbiterum │ Cardinalem.
Puis vient une préface allemande qui établit que le Dr Steinhöwel est l’auteur de la traduction allemande, et de laquelle j’extrais littéralement ce qui suit (feuillet 2 a) :
Das Leben des hochberümten fabeldichters Esopi, vss krichischer zungen. in latin, durch Rimiciū gemachet, an den hochwirdigen vatter, herren anthonium des titels sancti Chrysogoni priestern cardinaln, vnd fürbas das selb leben Esopi mit synen fabeln. die etwan romulus von athenis synem sun Thiberino vss kriechischer zungen in latin gebracht. hatt gesendet, und mer ettlich der fabel Auiani ach dogliami, Aldefonsy vnd schimpfreden poggy vnd andrer, ietliche mitt ierē titel ob verzaichnet. vss latin von doctore hainrico stainhöwel schlecht un̄ verstentlich getütschet nit wort vss wort sunder sin vss sin, vmb merez lütrung wegen dess textes oft mit wenig zügelegtn̄ oder abgebrochenen worten, gezogen Ze lob vnd ere dem durchlüchtigisten fürsten vn̄ herren h’ren Sigmunden herczogen zū öesterrich.
Ce qui littéralement peut se traduire ainsi : « La vie du
célèbre fabuliste Ésope traduite du grec en latin par Rimicius, pour le
révérend père et cardinal prêtre, monseigneur Antoine du titre de
Saint-Chrysogone, — puis la vie elle-même d’Ésope avec ses fables que Romulus
a envoyées d’Athènes à son fils Tiberinus, mises du grec en latin, — en outre
quelques fables d’Avianus, de Deligame, d’Alphonse, les facéties du Pogge et
d’autres, chacune avec son titre y indiqué, en latin, — le tout mis en
allemand clair et intelligible par le docteur Henri Steinhöwel, non pas mot
pour mot, mais sens pour sens, et souvent, pour la meilleure intelligence du
texte, avec addition ou suppression de quelques mots, et imprimé à la louange
et en l’honneur du très illustre prince et seigneur Sigismond, duc
d’Autriche. »
Les feuillets 3 b in fine à 26 b sont occupés par la vie d’Ésope en latin, qui est elle-même suivie de la traduction allemande due au Dr Steinhöwel. Cette traduction, qui s’étend du feuillet 26 b au {p. 351}feuillet 60 b, est ornée de gravures sur bois toujours naïves, quand elles ne sont pas triviales.
Viennent ensuite les quatre livres des fables de Romulus précédés chacun d’une table latine.
La table du livre I est annoncée par ce titre : registrum fabularum in primum Esopi librum
(fol. 61 a).
Voici la nomenclature qu’elle contient :
| De gallo et margarita. | i. | |
| De lupo et agno. | ii. | |
| De mure rana et miluo. | iii. | |
| De Cane et oue. | iv. | |
| De Cane et frusto carnis. | v. | |
| De Leone, vacca, capra et oue. | vi. | |
| De Fure malo et sole. | vii. | |
| De Lupo et grue. | viii. | |
| De duobus canibus. | ix. | |
| De Homine et serpente. | x. | |
| De Asino et apro. | xi. | |
| De duobus muribus. | xii. | |
| De Aquila et vulpe. | xiii. | |
| De Aquila, testudine et coruo. | xiv. | |
| De Coruo et vulpe. | xv. | |
| De leone, apro, thauro et asino. | xvi. | |
| De Asino et catella. | xvii. | |
| De Leone et mure. | xviii. | |
| De Miluo infirmo et matre. | xix. | |
| De Hyrundine et ceteris auibus. | xx. | |
À la suite de cette table se trouve la dédicace de Romulus ainsi conçue (fol. 61 b) :
Incipit prefatio. — Romulus tyberino filio de civitate athica. S. Esopus quidam homo grecus et ingeniosus, fabulis suis docet homines quid obseruari debeant. Verum vt vitam hominum et mores ostenderet, inducit aues, arbores, bestias, et pecora loquentes prouana cuiuslibet fabula, vt nouerint homines, fabularum cur sit inuentum genus, aperte et breuiter narrauit. Apposuitque vera malis. Composuit integra bonis. Scripsit calumnias malorum, argumenta improborum. Docet infirmos esse humiles, Verba blanda potius cauere : et cetera multa variis hiis exemplis scripta. Ego romulus transtuli de greco sermone in latinum. Si autem legis, Thiberine fili, et pleno animo aduertis, {p. 352}inuenies apposita loca que tibi moueant risum et acuant satis ingenium.
Cette dédicace est suivie d’abord d’une traduction allemande, puis du prologue des fables en vers élégiaques, dont l’auteur a été longtemps appelé l’Anonyme de Névelet.
C’est après ce prologue que se placent les vingt fables du livre I (fol. 62 a lig. 24 à 82 b), disposées dans l’ordre suivant :
1º Texte latin en prose,
2º Gravure sur bois,
3º Traduction allemande de Steinhöwel,
4º Texte latin en vers élégiaques.
Le même ordre est observé dans la disposition des matières des trois autres livres.
En tête du second qui, comme le premier, se compose de vingt
fables, est placée une table des matières qui est intitulée : Incipiunt capitula de libro secundo fabularum Esopi viri
clarissimi atque ingeniosi
, et qui comprend les titres suivants
(fol. 83 a) :
| De Ranis. | i. | |
| De Columbis. | ii. | |
| De Cane et fure. | iii. | |
| De Scrofa et lupo. | iv. | |
| De Monte parturiente. | v. | |
| De Agno et cane. | vi. | |
| De domino et eius cane. | vii. | |
| De leporibus et ranis. | viii. | |
| De Lupo et edo. | ix. | |
| De homine paupere et serpente. | x. | |
| De Ceruo et oue. | xi. | |
| De Caluo et musca. | xii. | |
| De Vulpe et ciconia. | xiii. | |
| De Lupo et tragede. | xiv. | |
| De Graculo et pauonibus. | xv. | |
| De Musca et mula. | xvi. | |
| De Formica et musca. | xvii. | |
| De Vulpe, lupo et asino. | xviii. | |
| De Mustela et homine. | xix. | |
| De Rana et boue. | xx. | |
Puis viennent les fables elles-mêmes (fol. 83 a à 104 b).
La table des matières, qui précède le livre III, est annoncée {p. 353}par cette phrase : Incipit
registrum capitulorum Tercii libri Esopi.
Voici les vingt
titres qu’elle comprend (fol. 105 a) :
| De Leone et pastore. | i. | |
| De Equo et leone. | ii. | |
| De equo, asino, temporibus et fortunis. | iii. | |
| De Quadrupedibus et auibus. | iv. | |
| De Liscinia (sic) et occipitre (sic). | v. | |
| De Lupo et vulpe. | vi. | |
| De Ceruo et fenatore (sic). | vii. | |
| De Junone, venere et aliis. | viii. | |
| De Muliere et milite. | ix. | |
| De Meretrice et iuuene. | x. | |
| De Patre et filio seuo. | xi. | |
| De Malo et peiore. | xii. | |
| De Lupis et ouibus. | xiii. | |
| De Homine et lignis. | xiv. | |
| De Lupo et cane. | xv. | |
| De manibus et pedibus hominis et de ventre. | xvi. | |
| De Simio et vulpe. | xvii. | |
| De Negociatore et asino. | xviii. | |
| De Ceruo et boue. | xix. | |
| De Leonis fallaci conuersatione. | xx. | |
À la suite se trouvent les fables elles-mêmes (fol. 105 a à 130 b).
Enfin vient le livre IV, composé comme les trois premiers de
vingt fables et précédé de la table suivante (fol. 131 a) :
Incipiunt Capitula de libro Quarto fabularum Esopi viri
clarissimi atque ingeniosi.
| De Vulpe et Vua. | i. | ||
| De Mustela sene et mure cauto. | ii. | ||
| De Lupo et bubulco. | iii. | ||
| De Pauone et Junone. | iv. | ||
| De Pantbera et agrestibus. | v. | ||
| De Veruecibus et lanione. | vi. | ||
| De Auibus et aucupe. | vii. | ||
| De Homine verace et fallace et de simiis. | viii. | ||
| De Equo, Ceruo et fenatore (sic). | ix. | ||
| De Asino, leone. | x. | ||
| De Vulture et aliis auibus. | xi. | ||
| De Leone et vulpibus. | xii. | ||
| De Puero et scorpione. | xiii. | ||
| {p. 354}De Asino et lupo. | xiv. | ||
| De Hirco maiore et tribus minoribus. | xv. | ||
| De Homine et de Leone. | xvi. | ||
| De Camelo et pulice. | xvii. | ||
| De gladio et viatore. | xviii. | ||
| De Cornice et oue. | xix. | ||
| De Abiete et arundine. | xx. | ||
Comme l’auteur des fables élégiaques n’a point traduit le livre IV de Romulus, il s’ensuit qu’ici chacune des fables du prosateur latin n’est accompagnée que de la traduction allemande (fol. 131 a à 147 a). Sauf cette lacune, la disposition du texte et des gravures est la même que dans les trois premiers livres.
On voit par l’exposé qui précède que, dans l’édition d’Ulm, l’œuvre de Romulus comprend quatre-vingts fables divisées en quatre livres égaux. Cette division ne correspond pas exactement à celle des principaux manuscrits. En effet, dans ces manuscrits, le livre I ne renferme pas la fable De Aquila et Vulpe et par suite ne se compose que de dix-neuf fables ; cette fable fait partie du livre II, dans lequel elle est la huitième et qui, la possédant, comprend vingt et une fables ; le livre III, au contraire, ne présente aucune différence ; enfin, dans les manuscrits, le livre IV, d’une part, offre trois fables qui ne se trouvent pas dans les éditions imprimées, savoir : la xiiie, De cornice sitienti ; la xixe, De cicada et formica ; la xxiie, De statua Esopi, et l’épilogue, Magistro Rufo Esopus ; et, d’autre part, il ne possède pas la fable De abiete et arundine, qui est la xxe dans les éditions primitives. En somme, les manuscrits, non comprise la dédicace de Romulus, se composent au total de quatre-vingt-deux fables et d’un épilogue, c’est-à-dire de trois pièces de plus que les imprimés.
La division adoptée dans l’édition d’Ulm est une fantaisie d’éditeur, à laquelle Steinhöwel a peut-être été involontairement entraîné par sa publication simultanée des fables en prose de Romulus et de leur paraphrase en vers élégiaques. Il est probable qu’après avoir, dans les trois premiers livres, fait suivre chaque fable en prose de sa traduction en vers, et avoir été conduit ainsi à leur donner à chacun vingt fables, il en aura pour la symétrie attribué un pareil nombre au quatrième.
Ce dernier livre est terminé par une sorte d’avis ainsi formulé :
{p. 355}Finit quartus Esopi nec plures eius libri
inueniuntur, licet plures eius fabule adhuc reperte sint, quarum alique sunt
consequenter posite.
Mais le volume est loin de s’achever par cet avis. Aux fables de
Romulus succèdent dix-sept fables dites Fabulæ extravagantes,
et attribuées à Ésope (fol. 147 b à 187 a).
En effet, elles sont annoncées par cette phrase dans l’édition d’Ulm :
Extrauagantes Esopi antique sequuntur.
En
voici les titres (fol. 147 b) :
| De Mulo, vulpe et lupo. | i. | |
| De verre, agnis et lupo. | ii. | |
| De Vulpe et gallo. | iii. | |
| De dracano (sic) et villano. | iv. | |
| De Vulpe et catto. | v. | |
| De Lupo et hirco. | vi. | |
| De Lupo et asino. | vii. | |
| De serpente et agricola. | viii. | |
| De Vulpe et lupo piscatore et leone. | ix. | |
| De Lupo pedente. | x. | |
| De Cane inuido. | xi. | |
| De Lupo et cane famelico. | xii. | |
| De Patre et tribus filiis. | xiii. | |
| De Vulpe et lupo. | xiv. | |
| De Cane, lupo et ariete. | xv. | |
| De homuntione, leone et eius filio. | xvi. | |
| De Milite, vulpe et armigero. | xvii. | |
Ces fables se terminent par cette observation : Finite sunt extrauagantes antique, ascripte esopo, nescio si vere
vel ficte.
Ces fables, que Lessing trouve trop ineptes pour qu’Ésope en soit l’auteur primitif, sont, comme celles de Romulus, ornées de gravures sur bois et suivies une à une de leur traduction en langue allemande (fol. 147 b à 187 a). Puis vient leur table (fol. 187 b).
Un autre groupe de dix-sept fables leur succède sous cette
désignation : Sequuntur alique esopi fabule nove
translationis Remicii
(fol. 187 b à 202 a). C’est un choix plus ou moins heureux fait dans une
collection plus considérable de fables d’Ésope traduites par Ranutio
d’Arezzo328. Peut-être même Steinhöwel n’a-t-il
entendu faire aucun choix et n’en a-t-il publié que dix-sept faute d’avoir connu
les autres. Elles sont ornées de gravures, accompagnées d’une traduction
allemande et terminées par la mention suivante : {p. 356}Finis fabularum Esopi a rimitio noue translationis
fabularum Esopi grecarum auctore extracte. Que a romulo in suis quatuor
libris non continentur.
Puis vient la table ainsi conçue
(fol. 202 a) :
| Registrum earundem. | ||
| De Aquila et coruo. | i. | |
| De Aquila et scabrone. | ii. | |
| De Vulpe et hirco. | iii. | |
| De Catto et gallo. | iv. | |
| De Vulpe et rubo. | v. | |
| De Homine et ligneo deo. | vi. | |
| De Piscatore quodam. | vii. | |
| De Muribus et catto. | viii. | |
| De Agricola et pelargo. | ix. | |
| De Puero oues pascente. | x. | |
| De Formica et columba. | xi. | |
| De Ape et ioue. | xii. | |
| De Lignatore quodam. | xiii. | |
| De Puero fure et eius matre. | xiv. | |
| De Pulice. | xv. | |
| De Viro et duabus uxoribus. | xvi. | |
| De agricultore et eius filiis. | xvii. | |
On lit immédiatement après : Auiani fabule
sequntur
(fol. 202 b à 226 b). En effet, ici se placent vingt-sept fables d’Avianus, qui sont,
comme les précédentes, ornées de gravures sur bois et traduites en langue
allemande, et qui sont énumérées dans la table suivante (fol. 226 b à 227 a) :
| Fabularum Auiani finis. Sequitur registrum earundem. | ||
| De rustica et lupo. | i. | |
| De testudine et auibus. | ii. | |
| De duobus cancris. | iii. | |
| De asino et pelle leonis. | iv. | |
| De rana medica et vulpe. | v. | |
| De duobus canibus. | vi. | |
| De camelo et ioue. | vii. | |
| De duobus sociis. | viii. | |
| De duobus ollis. | ix. | |
| De leone, thauro et hirco. | x. | |
| De simea et nalo eius. | xi. | |
| De grue, pauone. | xii. | |
| De tigride et venatore. | xiii. | |
| De quatuor bobus. | xiv. | |
| {p. 357}De dumo et abiete. | xv. | |
| De piscatore et pisciculo. | xvi. | |
| De phebo, auaro et inuido. | xvii. | |
| De puero fiente et fure. | xviii. | |
| De leone et capra. | xix. | |
| De cornice siciente. | xx. | |
| De rustico eiuuenco. | xxi. | |
| De viatore alumno. | xxii. | |
| De boue et mure. | xxiii. | |
| De ansere et domino suo. | xiv. | |
| De simea et gemino fetu. | xv. | |
| De nimbo et olla. | xvi. | |
| De lupo et edo. | xvii. | |
Après les apologues d’Avianus, l’édition d’Ulm offre un dernier groupe de fables appelées dans les titres courants collecte, et tirées des œuvres de Pierre Alphonse et des facéties du Pogge (fol. 227 a à 272 b). En voici les titres :
Ex Adelfonso prima hortatio ad sapientiam et veram amicitiam.
II. De fideicommissa peccunia.
III. Subtilis inuentio sententie In causa obscura olei depositi.
IV. Sententia de pecunia inuenta.
V. De fide trium sociorum aut potius fraude panis.
VI. De auicula et rustico.
VII. De dictatore quodam et gipposo.
VIII. De ouibus.
IX. De lupo rustico uulpe et caseo.
X. De iuuencula, eius marito, soccu et porco.
XI. De anu seducente mulierem castam cum canicula.
XII. De ceco et eius [uxore] ac riuali.
XIII. De astutia mulieris erga maritum vineatorem.
XIIII. De Vxore mercatoris et eius soccu vetula.
XV. De sartore regis et eius sutoribus.
XVI. De muliere et marito in columbario clauso.
XVII. De muliere puerum pariente gratia diuina marito absente poggii.
XVIII. De ypocrita et muliere vidua pogii.
XIX. De iuuencula impotentiam mariti accusante poggii.
XX. Aucupii et venationis studium summa est amentia.
[XXI]. De monstris aliquibus.
[XXII]. De sacerdote et eius cane et episcopo.
[XXIII]. Fabula XVIII. De vulpe et gallo et canibus. Et pertinet ad finem quarti libri Esopi.
Cette fable De Vulpe et Gallo est la dernière du dernier groupe. {p. 358}Il est important de remarquer que l’imprimeur a commis, en la numérotant, une faute d’impression qui a consisté à mettre un v pour un x, de sorte qu’au lieu du nº xxiii elle porte le nº xviii.
Cette erreur typographique permet d’affirmer que l’édition d’Ulm, sans date, est la plus ancienne de toutes et que celles qui ont été imprimées dans la seconde moitié du xve siècle n’en ont été que la copie. En effet, lorsqu’on jette les yeux sur les autres, on aperçoit que la faute d’impression non seulement a été reproduite, mais encore a été aggravée par une correction maladroite. Les imprimeurs, qui dans les autres éditions suivaient le texte de l’édition d’Ulm, ont remarqué que la fable De Vulpe et Gallo, venant après la fable xxii, ne pouvait porter le nº xviii, et ont, à gauche de ce numéro, ajouté un x sans songer à supprimer le v, de sorte qu’au lieu de rétablir le nº xxiii, ils ont donné le nº xxviii à la dernière fable.
Les divers groupes de fables que je viens d’analyser sont, pour
la commodité du lecteur, suivis d’une table alphabétique générale en allemand
(fol. 273 a à 278 b), terminée par ces
mots : Geendet säliglich von Johanne Zeiner zū
vlm
, qui en français signifient : « Imprimé heureusement
par Jean Zeiner à Ulm. »
Tel est l’avis qui marque la fin de la première partie de
l’édition ; car on peut considérer comme formant une seconde partie indépendante
de la première un opuscule intitulé : Hystoria
Sigismunde
, imprimé avec les mêmes caractères et orné de
figures du même genre gravées sur bois et intercalées dans le texte. Je ne le
signale que pour ne rien omettre de ce qui intéresse les amis des vieux
livres.
Je n’ai plus, pour en finir avec la fameuse édition d’Ulm, qu’à signaler les exemplaires qui en restent.
D’abord il en existe un auquel les travaux de Schwabe ont valu une notoriété spéciale ; c’est celui qui aujourd’hui porte la cote 10.2. Ethic. dans la bibliothèque ducale de Volfenbüttel, et qui, avec la copie manuscrite de Gude, lui a servi à composer en 1806 son édition des fables de Romulus. Il a cru que cet exemplaire était un spécimen unique, lui a attribué l’importance d’un véritable manuscrit et l’a appelé le Phénix des livres. Mais, dans cette circonstance comme dans beaucoup d’autres, il s’est complètement trompé ; car, en parcourant les bibliothèques de l’Allemagne, de l’Angleterre {p. 359}et de l’Italie, j’en ai rencontré quatre autres, qui vraisemblablement ne sont pas les seuls.
Le premier, qui appartient à la bibliothèque royale de Munich, porte au catalogue la cote A. Gr. B. 12. Il est dans un parfait état de conservation.
Le deuxième, qui dépend de la bibliothèque impériale de Vienne, est catalogué sous la cote 3. D. 8. Gomme le précédent, il est irréprochable, et les gravures sur bois en ont été coloriées par une main assez adroite.
Le troisième, qui est revêtu à la bibliothèque Bodléienne de la cote Douce G. P. 252, est au contraire très défectueux. Il y manque un feuillet, des traces d’humidité le déparent, enfin l’Hystoria Sigismunde en a été enlevée. En tête, à l’intérieur d’un des plats il porte cette notice, dans l’écriture de laquelle j’ai facilement reconnu la main de Douce lui-même :
This copy (wanting one leaf) belonged to Lord Spencer who retained it till he fortunately obtained an other copy. Perhaps a third is not to be found in England.
I think the cuts, the best of any in the early Æsopi, were done by John Schwitzer of Arnheim, the person who engraved the maps in the Ptolemy of 1482.
See M. Dibdin’s account of this Æsop Bibl. Spencer., I., 239. See Fabricius.
Ce qui peut se traduire ainsi :
« Cet exemplaire (auquel manque un feuillet) a appartenu à Lord Spencer, qui l’a conservé jusqu’au jour où il a eu la bonne fortune de s’en procurer un autre. Peut-être un troisième ne pourrait-il pas être trouvé en Angleterre.
« Je suppose que les illustrations, les meilleures de toutes celles des premières éditions d’Ésope, ont été exécutées par Jean Schwitzer d’Arnheim, celui qui a gravé les cartes du Ptolémée publié en 1482.
« Voyez la description de cet Ésope par Dibdin, dans la Bibliotheca Spenceriana, i, 239. Voyez Fabricius. »
Je ne m’arrête pas à l’hypothèse que le rédacteur de la notice a cru pouvoir risquer sur l’auteur des gravures sur bois. Je remarque seulement la révélation relative à l’existence d’un exemplaire complet, qui était, en 1814, la propriété de Georges John Earl Spencer, {p. 360}et qui vraisemblablement est encore à Althorp entre les mains de sa famille. Cet exemplaire faisant partie d’une bibliothèque privée, il ne m’a pas été loisible de le voir. Mais le bibliophile Dibdin, bibliothécaire du comte Spencer, en a, dans sa Bibliotheca Spenceriana, donné, avec des spécimens de l’écriture et de l’illustration, une description à laquelle je renvoie les amateurs d’incunables329.
Enfin le quatrième exemplaire est à Florence dans la Bibliothèque Laurentienne où il dépend du fonds d’Elci et où il porte la cote E. 2. 326. Il ne comprend pas l’Hystoria Sigismunde. Il devrait se composer de 278 feuillets, et il n’en a que 270. Cela tient à ce que, malgré sa belle apparence, l’exemplaire est incomplet. Dans les Fabulæ collectæ huit feuillets font défaut ; il en résulte deux lacunes. La première comprend la fin de la version allemande de la fable xi, le texte latin et la version allemande de la fable xii et le commencement du texte latin de la fable xiii. La seconde embrasse la fin de la version allemande de la fable xvii, le texte latin et la version allemande des fables xviii et xix et le commencement du texte latin de la fable xx.
1º Éditions d’Augsbourg. §
Dans les dernières années du xve siècle l’édition de Steinhöwel a été souvent réimprimée. Les deux réimpressions les plus connues et les plus conformes à l’édition originale sont celles dues à Antoine Sorg, imprimeur, qui florissait à Augsbourg en même temps que Zeiner à Ulm. Elles ont été décrites par Hain, l’une sous le nº 325, l’autre sous le nº 326330.
A. Édition de Sorg (Hain 325). §
Je ne suis pas bien sûr d’avoir rencontré en Allemagne aucun exemplaire de l’édition de Sorg, que Hain signale sous le nº 325. C’est donc d’après lui que je dois la décrire331.
C’est une réimpression pure et simple, dans le même format,
{p. 361}du texte latin de l’édition de Steinhöwel.
Comme dans cette dernière, le verso du premier feuillet est occupé par le
portrait d’Ésope. En tête du recto du deuxième on lit : Vita Aesopi fabulatoris clarissimi e greco latina per Rimicium facta ad
reverendissimum patrem dominum Anthonium Tituli sancti Chrisogoni
presbiterum Cardinalem.
La vie d’Ésope se termine au recto
du feuillet 25. Puis viennent les fables de Romulus accompagnées de celles
de l’Anonyme de Nevelet, les dix-sept fables d’Ésope traduites en prose
latine et dites extravagantes, la traduction en prose
latine de dix-sept autres par Ranutio d’Arezzo, les fables d’Avianus et
enfin les vingt-trois fables diverses, à la suite desquelles on lit :
Finis diuersarum fabularum.
Cette
édition ne porte ni le lieu, ni le nom de l’imprimeur, ni réclames, ni
pagination. Hain, qui, sur ce point d’ailleurs, est en désaccord avec
Panzer332, prétend
même qu’elle est dépourvue de signatures. Enfin elle se compose de
129 feuillets, qui sont, comme ceux de l’édition de Steinhöwel, imprimés en
caractères gothiques et ornés de gravures sur bois.
B. Édition de Sorg (Hain 326). §
La réimpression que Hain a décrite sous le nº 326, paraît avoir été faite après la précédente et, quoiqu’il ne risque aucune hypothèse sur le nom de l’imprimeur, il ne me semble pas douteux que, comme la précédente, elle doive être attribuée à Sorg. D’ailleurs, par le format, les caractères gothiques et le nombre des feuillets, elle est entièrement semblable à la première, et sans un barbarisme qui se trouve dans son titre, il serait presque impossible de l’en distinguer.
Elle comprend 129 feuillets non chiffrés et formés de la réunion de seize cahiers dont les quinze premiers ont chacun huit feuillets, et le seizième, neuf.
Ces cahiers sont pourvus des 16 lettres d’ordre ou signatures suivantes : a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, p, q, et les quatre premiers feuillets de chaque cahier, au bas du recto, portent, indépendamment de la lettre d’ordre, un numérotage qui va de 1 à 4. De même que la lettre d’ordre sert au classement des {p. 362}cahiers, les numéros servent au classement des feuillets de chaque cahier. Le dernier cahier étant composé de neuf feuillets, les cinq premiers sont exceptionnellement numérotés de 1 à 5 ; mais, comme dans les quinze premiers cahiers, les quatre derniers feuillets ne sont munis d’aucun numéro. Il est probable que, dans cette édition comme dans la précédente, il y avait un dernier feuillet non imprimé, dont la reliure des exemplaires encore existants ne permet pas de constater la disparition.
La deuxième impression de Sorg ne contient pas plus que la première la traduction allemande de Steinhöwel. Comme la première, elle n’est que la copie servile du texte latin de l’édition originale.
Pour la plus facile intelligence de la classification des matières, les voici accompagnées des numéros que devraient porter les feuillets et des signatures dont ils sont réellement pourvus.
Fol. 1b (a.ib). Comme dans l’édition d’Ulm, le premier feuillet présente au verso le portrait d’Ésope en pied, qui est la copie exacte de celui publié par Zeiner ; toutefois, quelques différences très légères montrent qu’il n’a pas été, dans les deux éditions, imprimé avec le même bois.
Fol. 2ª à 25b (a. iiª à d.ib). Traduction latine de la vie d’Ésope due à Ranutio d’Arezzo.
Cette traduction est intitulée : Vita Esopi fabulatoris
clarissimi e greco | latina per Rimicium facta ad reuerēdissimū | patrem
dominū Anthonū Tituli sancti Chri-|sogoni prespiterum (sic) Cardinalem.
Fol. 25b à 26ª (d.ib
à d.iiª). Table du livre I des fables de Romulus, intitulée : Registrū fabularu Esopi in librū primū.
Fol. 26ª (d.iiª). Fin de la table et commencement du
Prologus metricus in Esopum.
Fol. 26ª à 26b (d.iiª à d.iib). Prologue des fables en vers élégiaques, suivi d’une
gravure commune à ce prologue et à la dédicace à Tiberinus qui vient ensuite
et qui commence par ces mots : [R]omulus tyberino filio.
de ciuitate athica. S. Esopus quidam
, etc.
Fol. 27ª (d.iiiª). Incipit fabularum
liber primus.
Ici l’ordre n’est pas le même que dans
l’édition de Zeiner. Chaque fable de Romulus est précédée et non suivie de
la fable correspondante en vers, et en est séparée par l’illustration
xylographique. Chacun des quatre livres se composant de vingt fables, il
s’ensuit que les gravures {p. 363}sont au nombre de 80,
non comprise celle qui orne la dédicace de Romulus à son fils.
Fol. 38b (e.vib). Fin du livre I.
Fol. 39ª (e.viiª). Capitula libri
secundi fabularum Esopi.
Au-dessous de ce titre vient la
table du livre II, à la suite de laquelle on lit : Prohemium libri secundi fabularum Esopi.
Fol. 39ª à 51ª (e.viiª à g.iiiª). Fin du livre II, suivi de
la table du livre III, annoncée ainsi : Incipit
registrū capitulorū tercij libri esopi.
Au-dessous la page
finit par ce titre de la première fable : Fabula prima
de Leone ei pastore.
Fol. 51ª à 65ª (g.iiiª à i.iª). Livre III.
Fol. 65ª (i.iª). Fin du livre III, suivi de la table du
livre IV annoncée en ces termes : Incipit registrum
capitulorum quarti libri Esopi.
Au-dessous de cette table
on lit : Fabula prima de Vulpe et vua.
Fol. 65ª à 73ª (i.iª à k.iª). Livre IV, terminé par cette
souscription : Finit, quartus Esopi nec | plures eius
libri inueniuntur licet plures eius fabule adhuc | reperte sint. quarū
alique consequenter posite.
Fol. 73b (k.ib).
Fabule Esopi antique extrauagantes dicte
sequuntur.
Fol. 73b à 89b (K.ib à m.ib). Fables dont le titre précède.
Fol. 89b (m.ib).
Table des fables précédentes, intitulée : Registrū
fabularū p̄dictarum extrauagantiū.
Fol. 90ª (m.iiª). Fin de la table, à la suite de laquelle on
lit : Sequūtur fabule noue esopi ex translatiōe
remicij.
Fol. 90ª à 98ª (m.iiª à n.iiª). Fables de Rimicius.
Fol. 98ª à 98b (n.iiª à n.iib). Table des fables de Rimicius intitulée : Registrū fabularū predictarū q̄s remicius
trāstulit.
Fol. 98b (n.iib). Fin
de la table et commencement des fables d’Avianus annoncées en ces termes :
Sequuntur fabule auiani quarum reegistrum (sic) post sub-|iungitur.
Fol. 98b à 111b (n.iib à o.viib). Fables d’Avianus.
Fol. 111b (o.viib).
Fin des fables et table annoncée ainsi : Fabularū
Auiani antedictarum Registrum sequitur.
Fol. 112ª (o.viiiª). Commencement des Fabule collecte
par ce titre de la première fable :
Hortatio prima. ad sapientiam et ueram amiciciam |
ex Adelfonso.
{p. 364}Fol. 129b
(q.ixb). Souscription ainsi conçue : Finis diuersarū fabularū.
Par suite d’une aggravation plus haut expliquée de l’erreur que Zeiner avait déjà commise, la fable vingt-troisième et dernière des Fabulæ collectæ porte le nº xxviii, qui montre bien que l’imprimeur d’Augsbourg s’est borné à copier l’édition d’Ulm.
Ce n’est pas seulement le fond que l’édition d’Augsbourg a copié ; c’est aussi la forme.
Ainsi, en ce qui touche les caractères, je ne sais si l’imprimeur d’Augsbourg s’est servi de ceux que Zeiner avait déjà employés ; mais, si dans les deux éditions ils ne sont pas les mêmes, ils se ressemblent.
Il en est de même des gravures. Quand elles ne sont pas identiques, elles diffèrent peu. Celles qui illustrent la vie d’Ésope sont dans l’édition d’Augsbourg en même nombre que dans l’édition originale. Quant au dessin, voici les remarques que j’ai faites : la première d’Augsbourg est la même que la première d’Ulm, mais elles se présentent en sens inverse ; la deuxième dans les deux éditions est identique ; tandis que, dans l’édition d’Ulm, la dixième et la onzième sont la répétition l’une de l’autre, il en est autrement dans l’édition d’Augsbourg, où la onzième, différant de la dixième, représente Ésope servant des langues à son maître ; la douzième est celle d’Ulm renversée ; la quatorzième d’Ulm n’existe pas dans Augsbourg où elle est remplacée par la répétition de la troisième ; enfin la seizième, dans les deux éditions, se présente en sens inverse. Dans les fables d’Avianus, il y a aussi entre les gravures des deux éditions des différences à signaler : ainsi la gravure qui devrait orner la fable xxv fait défaut dans l’édition d’Augsbourg, et en tête de la fable xxvii l’imprimeur a trouvé commode de reproduire la gravure de la fable précédente. Je ne crois pas utile de pousser plus loin la comparaison : j’en ai dit assez pour montrer que, jusque dans les différences xylographiques, l’édition d’Augsbourg n’a guère été qu’une simple réimpression de l’autre.
Remarquons, en terminant, que les fables n’y sont pas suivies de l’Histoire de Sigismonde, qui d’ailleurs n’est pas non plus le complément nécessaire de l’édition d’Ulm.
C’est au British Museum que se trouve l’exemplaire sur lequel {p. 365}j’ai fait en partie les remarques qui précèdent. Il n’est pas inscrit sur le catalogue général, ce qui le rend assez difficile à trouver pour ceux qui ne connaissent pas l’organisation de la grande bibliothèque Londonienne. Il appartient à un fonds spécial qu’on appelle Grenville library et qui possède son catalogue séparé. Ce catalogue, dans lequel il porte le nº 7805, a été publié en trois volumes in-8º, sous le titre de Bibliotheca Grenvilliana, par John Thomas Payne et Henry Foss, et imprimé par W. Nicol, à Londres, de 1842 à 1848.
L’exemplaire 7805 est magnifique ; il est, pour ainsi dire, aussi neuf qu’au moment où il est sorti des presses de Sorg ; ses marges sont entières, et la beauté en est rehaussée par une splendide reliure en maroquin vert.
Le second exemplaire dont j’ai fait usage est celui que, sous la cote F. 2. 879, possède la bibliothèque Laurentienne, où il dépend du fonds d’Elci. Comme le précédent, il est dans un parfait état de conservation.
Quoique les exemplaires de cette édition soient fort rares,
j’en ai aperçu plusieurs dans les grandes bibliothèques de l’Allemagne, qui
est la vraie terre classique des éditions incunables de Romulus imprimées en
caractères gothiques. C’est surtout à Munich et à Vienne qu’il faut aller
les étudier. Mais il en existe aussi dans les bibliothèques moins
importantes. Pour ne parler que de la seconde édition de Sorg, je signale
entre autres l’exemplaire que j’en ai trouvé à la bibliothèque publique de
Stuttgard. Il porte cette mention manuscrite : Édition
tout à fait inconnue jusqu’à présent ; peut-être d’Ulm ou de Hol ou de
Dynkmut.
Mais le bibliophile qui a risqué cette hypothèse a
commis une erreur qu’explique, en l’absence des noms des imprimeurs, la
similitude trompeuse des premières éditions. Sous la cote V. F. 36, la
Bibliothèque impériale de Vienne possède aussi parmi ses incunables, dans le
petit format in-fº, une réimpression latine de l’édition d’Ulm, que le
Catalogue attribue à l’imprimerie de Sorg. La bibliothèque de Munich m’a
également paru avoir, sous la cote A. Gr. B. 15, un exemplaire de l’édition
de Sorg, que j’ai cru reconnaître à la répétition de la même gravure dans
les deux dernières fables d’Avianus. Enfin la bibliothèque publique de Linz,
s’il faut en croire son catalogue, en possède un aussi sous la
cote D. iv. 9.
2º Première édition de 114 feuillets. §
Après les deux éditions de Sorg, l’édition gothique qui paraît la plus ancienne est celle que Hain a mentionnée sous le nº 327 de son Repertorium bibliographicum. Comme il existe deux éditions gothiques de 114 feuillets imprimés qui se rapportent à sa mention, je ne suis pas sans peine parvenu à savoir quelle était celle des deux qu’il avait voulu signaler. Mais j’y suis arrivé. Il existe et j’ai rencontré plusieurs exemplaires de l’édition visée par Hain. Grâce à eux, je vais en faire connaître les particularités.
Comme les précédentes, elle ne porte ni lieu, ni date, ni nom d’imprimeur ; elle est ornée de nombreuses figures sur bois.
Elle se compose de 16 cahiers signés, dont les signatures vont de a à q. Les cahiers portant les lettres a, c, e, g, i, l, n, p et q, se composent de 8 feuillets, et ceux portant les lettres b, d, f, h, k, m et o n’en comprennent que 6. Il s’ensuit que le volume embrasse en tout 114 feuillets imprimés. Les signatures du dernier cahier qui vont de q à qv, me portent à croire qu’il était formé de dix feuillets dont les deux derniers étaient blancs. Mais ces deux feuillets blancs, s’ils ont existé, ne se voient plus dans les exemplaires reliés que j’ai seuls rencontrés.
Voici maintenant le contenu du volume :
Fol. 1 b (a. 1 b). — Portrait d’Ésope surmonté du mot Esopus.
Fol. 2 a à 21 a (a.
ii
a à c. vii
a). — Vie d’Ésope annoncée par le titre suivant : Vita Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina per Rimicium
fa|cta ad reverendissimū Patrem dominū Anthoniū tituli sancti Chry|sogoni
presbiterum Cardinalem.
Ce titre occupe trois lignes et le
point précis où, d’après mes notes, chacune d’elles finit, est celui qui comme
tel est également indiqué par des hachures dans le Répertoire de Hain. C’est
le premier des deux indices qui m’ont permis de voir quelle était, des deux
éditions de 114 feuillets, celle véritablement décrite par lui sous le nº 327.
La vie d’Ésope est ornée de 28 gravures, ce qui fait une de moins que dans les
éditions de Sorg.
Il y a dans la vie d’Ésope 42 lignes à la page.
Fol. 21 a (c. vii
a). — Registrum fabularum Esopi. in
librum primū.
C’est la table du premier livre des fables de
Romulus.
Fol. 21 b (c. vii
b). — Prologus metricus in
Esopum.
Ce Prologus est celui des fables de
l’Anonyme de Névelet. Au-dessous est {p. 367}une gravure
sur bois qui elle-même surmonte la dédicace de Romulus à son fils. Cette
dédicace commence ainsi : Romulus Tyberino filio de
civitate athica. S. Esopus
, etc., et aussi bien par l’ordre
des mots que par la ponctuation justifie la thèse que j’ai précédemment
soutenue.
Fol. 22 a (c. viii
a). — Commencement du premier livre des fables de Romulus.
Il est annoncé par ce titre : Incipit fabularum liber
primus.
L’ordre adopté n’est plus le même que dans le
préambule : la fable en vers est la première ; elle est immédiatement suivie
de la fable en prose, au-dessous de laquelle est placée la gravure. Par
exception, dans les fables x et xiii du livre I la
gravure précède, au lieu de les suivre, les deux fables auxquelles elle se
rapporte.
Fol. 34 a (e. v
a). — Fin du livre I et table du livre II, ainsi intitulée :
Capitula libri Secungi (sic)
Fabularum Esopi.
Fol. 34 b (e. v
b). — Prohemium libri secundi fabularum
Esopi.
Ce préambule n’est accompagné d’aucune gravure. Dans
ce second livre, la gravure vient toujours après les deux fables qu’elle
concerne, et des deux fables c’est toujours celle en vers qui précède celle en
prose.
Fol. 43 a (g. i a). — Dans le titre courant par suite d’une erreur typographique on lit tertius au lieu de secundus.
Fol. 46 a (g. iv
a). — Finis (sic) secundus liber.
Fol. 46 b (g. iv
b). — Incipit registrum capitulorum
tercii libri Esopi.
La table du livre III n’occupe que la
moitié de la page. Puis commencent les fables, dont la première, au-dessus de
sa désignation spéciale, porte ce premier titre : Fabula
prima Tertii libri Esopi.
Contrairement à la règle adoptée
dans l’édition, la fable correspondante de Romulus qui suit immédiatement,
porte ce titre : Eiusdem fabule prosa.
Le
livre III présente cette particularité que les fables viii
et xx de Romulus intitulées, l’une : De
iunone et venere
, l’autre : De leonis
fallaci conversatione
, ne sont pas accompagnées des deux
fables en vers correspondantes. Quant à l’ordre des gravures, il est toujours
le même, sauf dans la fable x, où l’imprimeur s’est trouvé dans la
nécessité de placer la gravure au milieu du texte en prose.
Fol. 60 a (i. iv a). — Fin du livre III, sans souscription, et table du livre IV, sans titre.
{p. 368}Fol. 60 b (i. iiii b). — Commencement du livre IV. La disposition du texte et des gravures cesse d’être méthodique. Les fables de Romulus sont tantôt précédées et tantôt suivies de leurs gravures. Le désordre est complet : ainsi la gravure de la fable iv est au milieu du texte de la fable v.
Fol. 67 a (k. iii
a). — Fin du livre IV, terminé par cette souscription :
Finit quartus Esopi nec plures eius libri inueniuntur
licet plures eius │ fabule adhuc reperte sint, quarum alique sunt
consequenter posite.
Puis viennent les fabulæ
extravagantes précédées de ce titre : Fabule
esopie antique extrauagantes dicte sequuntur.
Ces fables sont
au nombre de 17, ornées de 17 gravures intercalées dans le texte ou mises à la
suite de chaque fable. Aux pages occupées par les fabulæ
extravagantes les titres courants offrent de nombreuses erreurs
typographiques. Ainsi le fol. 71 a (l. i a) porte tercius au lieu de vagantes, le fol. 78 a (l. viii a), vagante au lieu de vagantes, le fol. 78 b (l. viii b), liber au lieu de extra, le fol. 79 b (m. i b), fa. noue au lieu de extra, le
fol. 80 a (m. ii a), Remicii au lieu de vagantes.
Fol. 80 a (m. ii a). Fin des fabulæ extravagantes.
Fol. 80 b (m. ii
b). — Registrum fabularum
predictarum.
À la suite de la table des Fabulæ
extravagantes on lit : Sequūtur fabule noue Esopi
ex transiatione (sic) remicii.
La faute typographique commise dans le mot transiatione et signalée par Hain a été pour moi un nouvel
indice et m’a de nouveau démontré que l’édition de 114 feuillets par lui
mentionnée sous le nº 327 est bien celle que j’analyse ici. Les titres
courants des pages occupées par les 17 fabule noue
présentent, comme ceux des pages précédentes, quelques erreurs typographiques.
Le fol. 81 b (m. iii b) et le
fol. 82 b (m. iv
b) portent extrauā au lieu de fabule novæ, les fol. 83 b et 84 b
(m. v b, et m. vi b), fabula noue
au lieu de fabule noue. Les 17 fabule noue
sont ornées de 17 gravures sur bois, placées soit à la suite, soit au milieu
du texte de chacune d’elles.
Fol. 86 b (n. ii
b). — Fin des fabulæ novæ. Elles sont
suivies d’une table qui commence sur la même page et qui est intitulée :
Registrum fabularum predictarum quas Remicius post
transtulit.
Fol. 87 a (n. iii
a). — Fin de la table des fabulæ novæ et
commencement des fables d’Avianus que précède ce titre : Sequuntur fabule Auiani quarum registrum subiungitur.
Les
fables d’Avianus, {p. 369}qui au nombre de vingt-sept
occupent les feuillets suivants et se terminent au fol. 100, sont accompagnées
de 27 gravures placées tantôt au milieu, tantôt à la fin du texte
correspondant. Les titres courants présentent de nombreuses fautes. Les
fol. 87 b, 88 b et 89 b (n. iii b, n. iv b et n. v b) portent noue fabule au lieu de fabule, les fol. 90 b et 91 a (n. vi b et n. vii a) et les fol. 91 b et 92 a (n. vii b et n. viii a), noue
fabule-Remicii au lieu de fabule Auiani, les
fol. 92 b et 93 b
(n. viii b, et o. i b), noue fabule au lieu de fabule.
Fol. 100 a (p. ii
a). — Fin des 27 fables d’Avianus, et table annoncée en ces
termes : Fabularum Auiani antedictarum Registrum
sequitur.
Fol. 100 b (p. ii
b). — Commencement des Fabulæ collectæ.
Ici encore des erreurs s’aperçoivent dans les titres courants. Les
fol. 100 b et 101 a
(p. ii b et p. iii a) portent fabule-uiani (sic) au
lieu de collecte-collecte, et les fol. 105 a et 106 a (p. vii a et
p. viii a), Auiani au lieu de
collecte. Comme précédemment les Fabulæ
collectæ sont accompagnées de gravures insérées dans le texte ou mises
à la suite. Par exception, la dernière est en tête de la dernière fable qui
est elle-même suivie de cette souscription finale : Finis
diuersarum fabularum.
À la dernière page
(q. viii b), comme dans les éditions plus
anciennes de Sorg, la fable De Vulpe et Gallo porte par
erreur le nº xxviii au lieu du nº xxiii.
Les exemplaires de cette réédition gothique des éditions de Sorg sont relativement nombreux. Parmi ceux que j’ai rencontrés, je signale les suivants : British Museum, 167. F. 12 ; Grenville library, 7831 ; Bâle, B. C. iii. 7 ; Maëstricht, 484.
Ici je dois donner un avis utile à ceux qui au British Museum compareront l’exemplaire qui s’y trouve avec celui de la Grenville library. Un examen trop rapide pourrait leur faire croire à tort que ce ne sont pas des exemplaires de la même édition ; ils diffèrent en effet l’un de l’autre : mais la différence est due à une interversion de page qui s’est produite au tirage de l’exemplaire 167. F. 12. La composition de la dernière page de la vie d’Ésope a été imprimée sur le verso du fol. c. ii, et vice versa la composition destinée au verso du fol. c. ii a été imprimée sur la dernière page de la vie d’Ésope. Il s’ensuit que l’exemplaire de la Grenville library, d’ailleurs mieux conservé, plus grand de marges et superbement relié, a plus de valeur que l’autre.
{p. 370}L’exemplaire que j’ai vu à la bibliothèque publique de Maëstricht est relié avec deux autres ouvrages, qu’à raison de leur contenu je crois devoir analyser ici.
Le premier est le Speculum Stultorum dont
l’auteur est désigné ainsi : Vigellus monachus
Cantuariensis.
Brunet, dans sa troisième édition (1821),
tome III, p. 538, et dans sa cinquième édition (1864), tome V, p. 1215, a cité
cet ouvrage, mais n’a pas signalé la précieuse édition du xve siècle, dont la bibliothèque de Maëstricht possède
un exemplaire. L’édition imprimée en caractères quasi-gothiques ne porte ni
signatures, ni réclames, ni lieu d’impression, ni nom d’imprimeur, ni date.
Elle forme un petit in-folio de 72 feuillets. Le premier est blanc et les
trois suivants contiennent, sous forme de lettre, un premier prologue en prose
dont le titre est ainsi conçu : Incipit epistola veteris
vigelli ad guilhelmū amicū suū secretū con|tinens ītegumentū speculi
stultorum ad eundem directi et inferius scripti.
À la fin du
prologue on lit cette souscription : Hec de prologo
autoris.
Le recto du fol. v est occupé par un second prologue
en vers élégiaques, qui se lie plus intimement à l’ouvrage composé tout entier
dans le même rythme, qui est annoncé par ces mots : Incipit prologus in speculum stultorum
, et qui sur la même
page est suivi de cette souscription : Explicit
prologus.
Cette souscription est accompagnée de ces mots qui
annoncent le commencement de l’ouvrage lui-même : Incipit
pars executiua.
Au bas du recto du dernier feuillet on lit :
Explicit speculum stultorum.
Le second ouvrage, réuni sous la même couverture, est, au point de vue de l’histoire de la fable ésopique, beaucoup plus intéressant que le premier. C’est un petit in-folio du même format que le précédent, composé de 82 feuillets répartis entre 13 cahiers qui sont signés de a à n et qui comprennent, les douze premiers, six feuillets chacun, et le treizième, dix. Il renferme la traduction du Calila et Dimna de Bidpaï faite au xiiie siècle par Jean de Capoue.
Le premier feuillet porte au recto le titre suivant :
Directorium humane vite alias parabole antiquorū
sapientū.
Le verso est tout entier rempli par une gravure sur
bois.
Du recto du fol. 2 au ihilieu du verso du fol. 4 s’étend un
prologue avec le titre : Prologus
et la
souscription : Explicit prologus
que suivent
les mots : Incipit liber.
{p. 371}Le fol. 5 est occupé par la table des matières, que, pour indiquer le contenu de l’ouvrage, je crois devoir transcrire ici :
Capitulum primum est de berozia : et est equitatis et timoris dei.
Capitulum secundum est de leone et boue. et est capitulum de dolo et seductione.
Capitulum tercium est de inquisitione cause dymne. et est capitulum de fine illius qui delectabatur in malo alterius.
Capitulum quartum est de columba. et est de fidelibus sociis.
Capitulum quintum est de coruo et sturno. Et est de eo qui confidit de inimico suo et quid vltimo accidit ei.
Capitulum sextum de symea et testudine. Et est de eo qui affectat habere amicum. et postquam acquirit ipsum : nescit eum conseruare donec amittat ipsum.
Capitulum septimum est de heremita. et de eo qui celer est in suis negociis. et non respicit ultima.
Capitulum octauum de murilego et mure. Et est de inimico qui requirit pacem inimici sui in tempore necessitatum.
Capitulum nonum est de rege et aue. Et est de sociis qui imitantur ad inuicem. Et quomodo debeant se cauere ad inuicem.
Capitulum decimum est de Esdra rege. et de eo qui prorogat iram suam. et superat sua vicia.
Capitulum undecimum est de venatore et leena. Et est de eo qui desinit a maleficiendo alteri propter malum quod sibi accidit.
Capitulum duodecimum est de heremita et peregrino. et est de eo qui relinquit opera propria. et facit que non debet.
Capitulum tredecimum est de leone et volpe. Et est de amore regum qui restituitur post inimicitias.
Capitulum quartum decimum est de aurifice et serpente. Et est de facienda misericordia.
Capitulum quintum decimum est de filio regis et sociis eius. Et est de diuina sententia quam nullus potest effugere.
Capitulum sextum decimum est de auibus. Et est de sociis et de proximis qui decipiunt se inuicem.
Capitulum septimum decimum est de columba et volpe. Et est de eo qui perhibet consilium alteri. et sibi ipsi nescit consulere.
L’ouvrage qui suit cette table a été, comme la table elle-même, imprimé à longues lignes avec des caractères gothiques plus petits que ceux qui ont servi à l’impression des deux précédents. Il renferme un grand nombre de gravures sur bois appropriées aux fables.
Il se termine au bas du feuillet 82 a par la
souscription {p. 372}suivante : Explicit liber parabolarum antiquorum sapientum333.
Puisque j’ai été amené à analyser ici l’édition, peut-être la plus vieille, de la traduction latine, faite par Jean de Capoue, des fables de Bidpaï, on me permettra, avant de revenir au Romulus ordinaire, de signaler deux autres éditions d’une traduction espagnole qui a dû être faite sur le texte latin du Directorium humanæ vitæ.
La première, dans le petit format in-fº, est mentionnée en ces
termes par Panzer334 et par Hain335 :
Exemplario contra Engaños : y Peligros del
mundo, traduzido en Romance por Iuan de Capua. In
fine : Acabose el excellente libro intitulado Exemplario contra
los Engannos : y peliglos del mundo Emprentado en la muy noble e leal
ciudad de Burgos por Maestre Fadrique aleman de Basilea a. xvi. dias del
mes de febrero. Anno de nuestra saluacion.
Mil.CCCC.XCVIII.
Je n’ai rencontré aucun exemplaire de cette édition.
Quant à la deuxième édition, la Bibliothèque nationale en possédant un exemplaire que j’ai pu voir à loisir, j’en vais donner une analyse un peu moins succincte.
C’est un petit in-fº chiffré, signé de a à h et composé de huit cahiers dont les six premiers comprennent huit feuillets et les deux derniers seulement six, soit au total soixante.
Fol. 1 a (a. i a). — En
tête du frontispice se trouve le mot Exemplario
; au-dessous dans un encadrement xylographique on
lit : Libro llamado Exem-|plario : enel quel se | cōtiene
muy bue-|na doctrina y | graues sen-|tencias de baxode | graciosas
fa-|bulas.
Fol. 1 b (a i b). — Table donnant les titres des dix-sept chapitres de l’ouvrage.
Fol. 2 a (a ii a) à 60 a (h vi a). — Prologue et fables. À la suite
du Prologue se trouve cet avis : El prologo que se sigue
es d’l interprete q̄ traduxo este libro de la lengua Persica en hebrayco :
enel qual persuade y da auiso alos lectores dela manera que deuen tener en
leer este libro par a que se aprouechen de su doctrina : corroborando su
intento con muchas y buenas sentencias recolegidas d’los fabios de
Arabia : y declaradas por aplasibles exemptos.
{p. 373}Les fables qui viennent après, se
terminent au bas du recto du dernier feuillet par cette souscription :
Fue impreso el presente libro inti-|tulado Exemplario
contra los engasios y peligros | del mundo en la muy noble y muy leal
ciudad de | Seuilla en las Casas de Jacome | Cromberger. Año de | mil y
quiniētos | y xlvj.
J’ai rencontré, à la Bibliothèque de l’Escurial, un exemplaire de cette édition sous la cote j v. N 3.
3º Deuxième édition de 114 feuillets. §
Je passe à la seconde édition in-folio de 114 feuillets, imprimée, comme les précédentes, à longues lignes, en caractères gothiques, sans lieu ni date et sans nom d’imprimeur, et ornée également de nombreuses gravures sur bois.
Le volume est formé de 16 cahiers pourvus de signatures et classés dans l’ordre des lettres suivantes : a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, p, q. Ils sont composés, les uns de huit feuillets et les autres de six feuillets, alternant régulièrement ensemble. Ceux qui sont signés des lettres a, c, e, g, i, l, n, p, q, comprennent chacun huit feuillets ; ceux qui sont signés des lettres b, d, f, h, k, m, o comprennent chacun six feuillets.
Les quatre premiers feuillets de chacun des cahiers de huit feuillets sont numérotés de 1 à 4, et ces numéros sont précédés de la lettre spéciale au cahier ; les quatre derniers feuillets ne portent aucune signature. Contrairement à la régie d’alternance qui a été jusque-là observée, le cahier q est numéroté de 1 à 4 et se compose de huit feuillets ; ce dernier cahier ne comprend aucun feuillet blanc. La disposition est la même pour les cahiers de six feuillets ; les trois premiers feuillets sont numérotés de 1 à 3, et ces numéros sont précédés de la lettre spéciale à chaque cahier ; les trois derniers feuillets ne portent aucune signature.
Cette seconde édition de 114 feuillets peut être facilement confondue avec la première ; c’est que, si la première n’a été que la réimpression de celle de Sorg, la deuxième a été de la première une copie encore plus servile. Non seulement elles ont le même nombre de feuillets ; mais encore elles sont identiques par le nombre des cahiers, la division de ces cahiers en deux séries et l’alternance de leur distribution. Quant aux diverses collections de fables, non seulement leur texte est identique, mais encore dans chaque édition la même commence et finit aux mêmes pages. {p. 374}Enfin les deux éditions présentent les mêmes particularités typographiques : non seulement dans la première phrase de la dédicace de Romulus à son fils Tiberinus la ponctuation si discutée est identique, non seulement la xxiiie et dernière des Fabule collecte figure dans les deux sous le nº xxviii, mais encore, dans chacune d’elles, la dix-septième de ces fables, par une erreur qui leur est spéciale, porte le nº xvi.
Malgré cette similitude, rendue encore plus complète par l’ignorance ou l’incurie des imprimeurs, on ne peut confondre les deux éditions. Dans chacune d’elles les caractères des fables en vers sont, il est vrai, plus gros que ceux des fables en prose ; mais la forme gothique de ceux de la première est plus pure et plus nette. L’une et l’autre appartiennent au petit format in-folio ; mais la dimension de la première est un peu plus grande, et par suite, tandis que la seconde n’a que 41 ou 42 lignes par page, on en compte jusqu’à 44 dans la première. Les gravures de la seconde sont bien la reproduction de celles de la première ; mais elles les reproduisent en sens inverse. Dans la seconde les lettres initiales, gravées sur bois, constituent encore un élément de dissemblance. Enfin, quand on regarde de près les signatures, elles révèlent aussi des différences sensibles ; ainsi, dans la première édition, le premier feuillet du cahier a n’est pas signé ; mais le deuxième porte la signature a ; le deuxième feuillet du cahier d et le deuxième du cahier h ne sont pourvus d’aucune signature ; aucune erreur de numéro n’existe dans le cahier i et le cinquième feuillet du dernier cahier est signé q. iiiij. Au contraire, dans la seconde édition, les signatures manquent aux deux premiers feuillets du cahier a, les cahiers d et h portent les signatures d.ij et h.ij, par erreur le quatrième feuillet du cahier i porte la signature i. iiiij, et le cinquième feuillet du cahier q n’est pas signé. Il existe encore d’autres différences que, chemin faisant, j’aurai soin de signaler.
Je poursuis mon analyse.
Fol. i b. — Portrait d’Ésope qui occupe toute la page. Il est entouré, sous forme d’arabesque, d’un encadrement gravé qui n’existe pas dans la première édition de 114 feuillets ni dans aucune des éditions antérieures.
Fol. 2 a à 21 a. — Vie
d’Ésope. Elle est précédée d’un titre ainsi conçu : Vita
Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina {p. 375}per
Rimicium | facta ad reuerendissimum patrem dominū Anthoniū tituli sancti |
Chrysogoni presbiterum Cardinalem.
Les hachures, qui dans ce
titre marquent la fin des lignes, fournissent un nouveau moyen de distinguer
cette édition de la précédente. La vie d’Ésope elle-même offre aussi un point
important de dissemblance : elle ne renferme que 26 gravures sur bois au lieu
de 28. À mesure qu’on s’éloigne de l’édition originale, on voit dans chaque
édition nouvelle diminuer le nombre de ces gravures.
Fol. 21 a. — Table du livre I des fables de Romulus.
Fol. 21 b. — Prologus
metricus in Esopum.
Fol. 22 a. — Incipit
fabularum liber primus.
Fol. 22 a à 34 a. — Premier livre.
Fol. 34 a. — Capitula
libri secundi fabularum Esopi.
Fol. 34 b. — Prohemium
libri secundi fabularum Esopi.
Fol. 34 b à 46 a. — Fables du livre II.
Fol. 46 a. — Finit
secundus.
Fol. 46 b. — Incipit
registrum capitulorum tercii libri Esopi.
Fol. 46 b à 60 a. — Fables du livre III.
Fol. 60 a. — Table du livre IV, sans titre qui la précède.
Fol. 60 b à 67 a. — Fables
du livre IV. Elles se terminent au haut du recto du fol. 67 a (k. iii a) par cette souscription :
Finit quartus Esopi nec plures eius libri inueniuntur
licet plures eius | fabule adhuc reperte sint, quarum alique sunt
consequenter posite.
On rencontre de nombreuses erreurs dans
les titres courants des pages qu’occupent les fables de Romulus. Ainsi au
verso des feuillets c. viii et e. v les titres courants
ont été oubliés, et les feuillets g. i a
et g. viii b portent, le premier, liber au lieu de secundus, et le second, tercius au lieu de liber.
Fol. 67 a. — Fabule
Esopi antique extrauagantes dicte sequuntur.
Fol. 67 a à 80 a.
— Fabule extrauagantes.
Ces 17 fables
sont suivies chacune de sa gravure. Les titres courants sont très fautifs : le
feuillet l. i porte au recto tercius au lieu de
vagantes, et au verso liber au lieu de
extra ; au recto et au verso du
feuillet l. viii les mêmes fautes existent ; sur le verso du
feuillet m. i on lit fa. noue au lieu de extra, et sur le recto du feuillet m. ii, Remicii au lieu de uagantes.
Fol. 80 b. — Registrum
fabularum predictarum extrauagantium.
{p. 376}Sur la même page commencent les dix-sept fables
traduites par Ranutio d’Arezzo ; elles sont précédées de ce titre : Sequuntur fabule noue Esopi ex translatione
Remicii.
Les titres courants des pages qu’elles occupent
offrent de nombreuses fautes : ainsi les feuillets m. iii
et m. iv portent au verso extraua, au lieu de
fa. noue.
Fol. 86 b. — Fin des 17 fabule
noue et commencement de la table intitulée : Registrum fabularum predictarum quas Remicius
transtulit.
Fol. 87 a à 99 b. — Fables
d’Avianus commençant par ce titre : Sequuntur fa. Auiani
quarum registrum post subiungitur.
Les titres courants des
feuillets qu’elles occupent sont très fautifs. Ainsi les
feuillets n. iii, n. iv, n. v,
n. vi, n. vii et n. viii portent au verso
noue fa. au lieu de fabule, et les
feuillets n. vii et n. viii au recto Remicii au lieu de Auiani.
Fol. 100 a. — Table ainsi intitulée :
Fabularum Auiani antedictarum registrum
sequitur.
Fol. 100 b à 114 b.
— Fabule collecte.
Ces fables sont au
nombre de 23. Dans les titres courants des feuillets qu’elles occupent, je
relève de nouvelles fautes : ainsi les feuillets p. vii et
p. viii au recto portent Auiani au lieu de collecte.
Comme dans les éditions antérieures la souscription finale est
ainsi conçue : Finis diuersarum
fabularum.
Sans l’affirmer, je suis porté à croire que cette seconde édition a été exécutée en Angleterre. Tandis que sur le continent je n’en ai rencontré que trois exemplaires, l’un dans la bibliothèque d’Heidelberg sous la cote Sch. 69 nº 449, un autre à Bâle sous la cote A. M. V. 6 et un dernier à Berne sous la cote Inc. 42, en Angleterre j’en ai trouvé quatre exemplaires : ainsi la Bibliothèque du British Museum en possède un sous la cote C. 19. D. 5 et la Bibliothèque Bodléienne, trois, le premier sous la cote Auct. 2. 4. 30, le deuxième sous la cote Auct. N. 4. 16 et le troisième sous la cote Douce 226. Mais ce qui semble surtout indiquer qu’ils n’y ont pas été importés, ce sont les nombreuses annotations en langue anglaise, qui, sur les marges de ces deux derniers exemplaires, ont été écrites par des mains du xvie siècle.
L’exemplaire du British Museum a été relié, sans doute à cause de l’identité du format et de la similitude du contenu, avec un {p. 377}autre petit in-folio. C’est un exemplaire du Dialogus creaturarum, que Gérard Leeu avait imprimé sans réclames ni signatures et terminé à Gouda le 31 août 1482. J’avais été accidentellement entraîné, dans la première édition de cet ouvrage, à donner l’analyse détaillée de ce livre, dont, quoiqu’il contînt un recueil de fables, je n’aurais peut-être pas dû m’occuper. Depuis lors les deux volumes ont été séparés, et n’ayant plus de raison de maintenir ma précédente analyse, je la supprime.
J’en ai fini avec les éditions sans date. J’aborde maintenant la série des éditions datées.
4º Édition de Gérard Leeu de 1486. §
Si l’on ouvre, à la page 444, le premier volume de l’ouvrage de
Panzer, on y trouve sous le nº 27 l’indication ainsi formulée d’une édition
datée de Romulus : Esopi Vita et fabulæ latine per
Rimicium et Avienum cum fabulis dictis extravagantibus et collectis tam
carmine quam prosa. Per Gerardum Leeu in opido Goudensi
1482. 4.
Il importe d’ajouter que cette désignation est
précédée d’un astérisque, par lequel le bibliographe a voulu affirmer qu’il
avait rencontré un exemplaire de l’édition. Aussi Hain, s’en rapportant à
Panzer, l’a-t-il, à son tour, sous le nº 338, mentionnée en ces termes :
… per Gerardum Leeu in opido Goudensi
1482. 4.
Si mes regards s’étaient portés sur l’astérisque qui
probablement lui avait inspiré confiance, il est probable qu’il m’aurait
également rassuré. Mais, ne l’ayant pas remarqué, je conçus des doutes, et
voici sur quoi ils étaient établis : en 1480, Gérard Leeu s’était occupé
d’imprimer la collection de fables en prose de Nicole de Pergame et il en
avait fait une première édition in-folio, dont la souscription finale était
ainsi conçue : Presens liber Dyalogus creaturarum
appellatus iocundis fabulis plenus Per Gerardum Leeu in opido goudensi
inceptus munere dei finitus est anno domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo mensis iunii die tercia. G LEEV.
La publication
ayant vraisemblablement réussi, Gérard Leeu en avait imprimé une seconde
édition in-fol. qui avait été achevée le 6 juin 1481, et, la vogue de
l’ouvrage ne diminuant pas, il en avait, en 1482, fait paraître non seulement
une troisième édition, mais encore deux traductions, l’une en langue
française, l’autre en langue flamande. Des exemplaires de toutes ces éditions
existent à la Bibliothèque nationale ; malheureusement, à l’exception de celui
de l’édition de {p. 378}1481, coté Y 6592, ils ne figurent
pas au catalogue imprimé, et par suite il est difficile d’en avoir
communication. Mais au British Museum, ainsi que je l’ai déjà expliqué336, il existe un exemplaire de
l’édition de 1482 qui a été longtemps réuni au Romulus à arabesques C. 19 D. 5. Donc il me semblait au premier
abord que Gérard Leeu, à moins d’avoir voulu se faire concurrence à lui-même,
n’avait pas dû publier la collection de Romulus, qui, faisant double emploi
avec celle du Dyalogus, n’aurait pas manqué de nuire à son débit.
D’autre part, les termes, dans lesquels Panzer avait mentionné l’édition de Romulus, ne permettaient pas de supposer que le Dyalogus eût été par lui confondu avec elle.
Enfin j’ai pu sortir de ma perplexité. J’avais remarqué,
au-dessous de la mention de Panzer, une référence ainsi conçue : Cat. bibl. Bodl. I. p. 16.
Je me reportai à la
référence indiquée par Panzer qui, dans ma pensée, avait dû faire allusion au
catalogue de la Bibliothèque Bodléienne imprimé en 1674337. Mais sur ce catalogue je ne retrouvai rien
qui se rapportât à la prétendue édition de Romulus de 1482. C’est qu’en effet
c’était dans le catalogue de 1738338, que l’édition était signalée et que Panzer avait puisé sa
propre citation. Mais je ne connaissais pas alors le catalogue de 1738, et le
silence de celui de 1674 ne fit qu’accroître ma méfiance. Dans cette
situation, il me parut que ce n’était qu’à la Bodléienne elle-même que je
pourrais trouver le mot de l’énigme. Pendant un de mes séjours à Oxford, je
fis part de mes incertitudes à l’un des bibliothécaires, qui, après bien des
recherches, fut obligé de me dire que le volume était introuvable, et que la
bibliothèque ne l’avait jamais possédé.
En réalité, elle ne l’avait jamais possédé parce qu’il n’existait pas : la première édition publiée par Gérard Leeu est celle de 1486, {p. 379}et j’en ai rencontré des exemplaires qui me permettent de l’analyser. C’est, comme les vieilles éditions publiées en Allemagne à la même époque, une simple réimpression du texte latin de l’édition d’Ulm. Le format en est à peu près pareil, c’est-à-dire qu’elle a les dimensions d’un petit in-folio, et, comme sa devancière, elle est enjolivée de nombreuses gravures sur bois.
Le volume se compose de 104 feuillets, dont voici maintenant le contenu :
Fol. 1 a. — Fabule et
vita Esopi cum fabulis Auiani : Alfonsii : Pogii Florentini et aliorum ;
cum optimo cōmento : bene diligenterque correcte et
emendate.
Malgré ce titre, le texte n’est accompagné d’aucun commentaire. C’est une simple copie des éditions précédentes, faite avec si peu d’attention, que l’erreur de numéro n’a même pas été rectifiée à la dernière fable.
Au-dessous du titre est le portrait en pied du vieil Ésope.
Fol. 2 a. — Vita Esopi
fabulatoris clarissimi e greco latina : per Rimicium facta : ad
reuerendissimum patrem dominum Anthonium tituli Chrysogoni presbiterū
cardinalem.
Fol. 18 a. — Explicit
vita esopi. — Sequitur registrum fabularum in primum
Esopi librum.
Fol. 18 b. — Gravure, puis prologue en vers
élégiaques, enfin dédicace de Romulus, dont le commencement a subi le
travestissement suivant : Romulus tyberino filio, de
civitate attica seu anthiochia. P. S. dicit. Esopus quidem homo
grecus
, etc.
Fol. 19 a. — Incipit
fabularum liber primus.
Pour chaque fable, la gravure, le
texte en vers et le texte en prose se suivent dans le même ordre que pour le
prologue.
Fol. 30 a. — Explicit
liber primus. — Sequitur registrum libri secundi
fabularum Esopi.
Au-dessous de la table annoncée par ce
dernier titre on lit celui-ci : Prohemium libri secundi
fabularum Esopi.
Fol. 41 b. — Fin du deuxième livre. Table du
troisième livre intitulée : Incipit registrum fabularum
tercii libri Esopi.
Commencement du troisième livre.
Fol. 53 b. — Fin du troisième livre ; la
vingtième et dernière fable de ce livre intitulée De Leonis
fallaci conversatione n’existe qu’en prose. Ensuite vient ce titre de
la table du quatrième livre : Sequitur tabula libri
quarti.
{p. 380}Fol. 54 a. — Commencement du quatrième livre, qui ne se compose plus que des fables de Romulus surmontées chacune d’une gravure.
Fol. 60 6. — Finitur liber Esopi quartus
nec plures huius libri inueniuntur licet plures eius fabule adhuc reperte
sint : quarum alique sunt consequenter posite.
— Fabule esopi antique extrauagantes dicte
sequuntur.
Fol. 71 a. — Fin des fabulæ
extravagantes. — Registrum fabularum
extrauagantium.
— Sequuntur fabule nove
Esopi ex translatione Rimicii.
Fol. 77 a. — Fin de la traduction latine de Ranutio d’Arezzo.
Fol. 77 b. — Registrum
fabularum predictarum Esopi quas Remicius transtulit.
— Sequuntur fabule Auiani quarum registrum post
subiungitur.
Fol. 78 a. — Commencement des fables d’Avianus, comprenant chacune d’abord une gravure, puis le texte en vers, enfin une morale en prose.
Fol. 92 b. — Fin des fables d’Avianus.
Fol. 93 a. — Fabularum
Auiani ante dictarum registrum sequitur.
À la suite de la
table des fables d’Avianus commencent les fabulæ collectæ
précédées chacune d’une gravure.
Fol. 104 a. — Expliciunt
fabule et vita Esopi : cum fabulis Auiani. Alfonsii. Pogii florentini : et
aliorum cum optimo commento : bene diligenterque correcte et emendate.
Impresse Antwerpie per me Gerardum leeu anno domini millesimo
quadringentesimo octuagesimo sexto Mense septembri. die vero vicesima
sexta.
Un exemplaire de cette édition est conservé dans la bibliothèque impériale de Vienne, où le catalogue lui donne la cote IV. H. 3. Au British Museum il en existe un qui porte au catalogue de la Grenville library le nº 7808. En outre, M. Bradshaw, conservateur de la bibliothèque de l’Université de Cambridge, m’en a communiqué, en 1875, un autre, qu’il avait récemment acheté à Londres moyennant 31 liv. et 10 schellings, et qui, n’ayant pas encore été catalogué, ne portait aucune cote. Enfin à la bibliothèque royale de Bruxelles j’en ai aperçu un dernier portant le nº 2486.
5º Édition de Sébastien Brant de 1501. §
Toutes les éditions du xve siècle sont, ainsi qu’on a pu l’apercevoir, des copies tantôt directes, tantôt indirectes, mais toujours littérales de l’édition {p. 381}d’Ulm. Il n’en est pas ainsi de celle qui fut publiée à Bâle en 1501. Gomme un cadre neuf destiné à faire ressortir la valeur d’une vieille toile, une œuvre nouvelle avait été ajoutée à l’ancienne.
L’auteur de cette addition était un littérateur de la Renaissance, le célèbre Sébastien Brant.
L’imprimeur de l’édition de 1501, Jacob Phortzheim n’avait pas imité son exemple : il s’était dans son travail typographique attaché au contraire à suivre ses devanciers : il avait adopté le même format et copié les gravures des premières éditions.
L’ouvrage qui forme un petit in-folio de 203 feuillets, se divise en deux parties bien distinctes : la première, qui occupe les 124 premiers feuillets, est consacrée aux divers groupes de fables latines que comprend l’édition de Steinhöwel, et la seconde, qui remplit les 79 derniers feuillets, est exclusivement réservée aux compositions de l’éditeur.
La première partie n’est pas paginée, mais porte des signatures de a à s, et se compose de cahiers alternants de six et de huit feuillets.
Fol. 1 a (a. i
a). — Titre de l’ouvrage ainsi conçu : Esopi appologi siue mythologi cum | quibusdam carminum et fabularum |
additionibus Sebastiani Brant.
Fol. 1 b (a. i b). — Portrait d’Ésope copié sur celui des éditions précédentes.
Fol. 2 a (a. ii
a). — Dédicace de Sébastien Brant à
Adelberg de Rapperg, doyen de l’église de Bâle. Elle commence par ces mots :
Adebero de Rapperg, insignis ecclesie Basiliensis
decano me-|ritissimo : magneque virtutis et nobilitatis viro
prestātissimo : dño suo | et patrono obseruātissimo Sebastianus Brant
Argētinensis : cum | felicitate gaudium optat et salutem.
Fol. 2 b (a. ii b). — Préface de Laurent Valla.
Fol. 3 a à 22 b (a. iii a à c. vi b). — Traduction latine de la vie d’Ésope par Ranutio d’Arezzo. Elle est ornée de 29 gravures, qui, ayant été copiées sur celles des éditions antérieures, montrent qu’elle a été elle-même faite soit sur l’édition primitive, soit sur celles de Sorg, qui seules renferment un nombre de gravures aussi grand.
Fol. 23 a (d. i a). — Il est occupé par la dédicace de Romulus, {p. 382}précédée elle-même du prologue de l’anonyme de Névelet que surmonte une gravure pareille à celle des éditions antérieures.
Le même ordre a été suivi pour les fables elles-mêmes : d’abord la gravure, puis la fable en vers élégiaques, enfin celle en prose.
Fol. 23 b (d. i
b). — Incipit Esopi fabularum liber
primus.
Fol. 34 b (e. iv
b). — Prohemium libri secundi fabularum
Esopi.
Fol. 46 a (g. ii
a). — Fabule tertii libri
Esopi.
Sous cette rubrique sont placées, comme dans le
manuscrit 42 du Corpus Christi d’Oxford, les fables
appartenant aux livres III et IV. En outre, à la suite des vingt fables, qui
dans les éditions antérieures forment le livre III, Sébastien Brant a placé
les deux dernières fables de l’Anonyme de Névelet, De Judeo et
Pincerna latrone et De Cive et Milite seruientibus uno
domino, à chacune desquelles il a ajouté, sans doute pour la symétrie,
une traduction latine en prose. Il s’ensuit que le livre III comprend
42 fables. Comme les fables du livre IV n’ont pas été traduites en vers par
l’anonyme de Névelet, Brant, pour combler la lacune et rétablir la symétrie, a
fait précéder chaque fable en prose d’un quatrain et quelquefois d’un sixain
en vers élégiaques. Il a procédé de même pour les dix-sept fabulæ
extravagantes qui suivent les fables de Romulus.
Fol. 71 b (k. vii
b). — Fabule Esopi antique
extrauagantes dicte sequuntur.
Fol. 85 b (m. vii
b). — Sequuntur fabule Esopi ex
translatione Remicii.
Comme précédemment, Brant a, en tête de
chacune des dix-sept fables traduites en latin par Ranutio d’Arezzo, placé une
traduction en vers élégiaques.
Fol. 94 a (o. ii
a). — Sequuntur fabule
Auiani.
Pour les fables d’Avianus, sacrifiant toujours à la
même symétrie, Brant a fait l’inverse : il a ajouté à chacune une fable en
prose.
Fol. 109 b (q. iii b). — À ce feuillet commencent sans titre les fabulæ collectas des éditions précédentes, réduites au nombre de dix-neuf par l’élimination des quatre facéties suivantes : De sartore regis et eius sutoribus, De muliere et marito clauso in columbario, De ypocrita et muliere vidua, De iuvencula impotentiam mariti accusante.
À peine est-il besoin d’ajouter que, fidèle à son système, Brant a fait précéder chacune des fabulæ collectæ de distiques élégiaques généralement au nombre de deux et quelquefois plus nombreux.
{p. 383}La deuxième partie, séparée de la première par un feuillet blanc, commence au feuillet 125 et ne renferme plus que l’œuvre de Brant. Elle n’est pas chiffrée, mais porte une seconde série de signatures de a à m, mises sur des cahiers qui sont composés de 6 et de 8 feuillets, à l’exception des deux derniers formés l’un de 4 feuillets et l’autre de 5.
Elle débute par un prologue en vers élégiaques, qui occupe le recto du feuillet 125, tandis que le verso du même feuillet représente l’auteur à genoux.
Ensuite, inspirée sans doute par celle de Romulus, vient une
dédicace qu’il adresse à son fils Onophrius et qui est intitulée : Sebastianus Brant : Onophrio Thedigene filio suo
salutem.
Elle est suivie d’une dissertation sur l’utilité des fables qui
porte pour titre : Utilitas et commoditas fabularum
poëtarumque : et fabulonum defensio ex joanne bocacio, Li xiiii de
genealogia deorum.
Puis commence l’œuvre véritable de Brant : elle se compose de 140 fables, anecdotes, moralités ou récits, composés toujours d’une première partie en vers élégiaques et d’une seconde en prose. En voici la nomenclature :
1. Ex hesiodo contra blacterones et linguaces.
2. Quando liceat aliorum errores reprehendere.
3. (Ici le titre manque) Cum tua peruideas mala lippus inunctis, etc.
4. Quod corruptus iudex male pronunciat.
5. Quam venalis sit iusticia.
6. Quod corruptum humanum iudicium neque altissimis rebus parcere nouit.
7. Quomodo corui conati sunt aquilam expugnare.
8. De aquila ex cuius vnguibus gallina cecidit in gremium Livie Auguste.
9. Toleranda est seruitus sponte suscepta.
10. Quomodo romanus princeps adiutus corui beneficio in bello contra gallum victor euasit.
11. Discordiam causam esse euersionis omnium regnorum.
12. Assentatores multos ledunt.
13. Male loqui.
14. De medico indocto.
15. Quilibet rex in domo sua.
16. De amicorum fiducia.
17. Stulticiam non posse occultari.
18. De libris Sibyllinis.
19. De fatuis cathenatis.
{p. 384}20. Quod dormientes multa non considerant.
21. Differre rem difficilem salubre sepe est.
22. Difficile est naturam mutari.
23. De breui contra pestem ad collum suspendendo.
24. De lupo comedente porcum pro pisce.
25. De inequali societate.
26. De tyrannorum crudelitate.
27. Deum nihil latere.
28. Uxoris fidem esse sequendam.
29. De pertinacia mulierum.
30. De calliditate consilii muliebris.
31. De fletu vxorum in morte viri.
32. De muliere que vt tegeret caput posteriora detexit.
33. De sacerdote qui decimam indebitam exegit.
34. De reliquiis bracharum cuiusdam monachi.
35. Amatores mutos esse conspecta venere.
36. De muliere excoriante asinum.
37. De pigritante iuuene.
38. De eo qui querebat asinum quem equitabat.
39. De duobus gladiatoribus.
40. De iuuene mingente supra mensam.
41. De fatuo qui dixit episcopum quadrupedem.
42. De tutore qui rationem tutele reddere iussus erat.
43. De sacerdote qui loco capparum episcopo capones portat.
44. Dantis florentini faceta responsio.
45. De equite caluo cui crines deciderunt.
46. Contra mercatorem alios accusantem.
47. De eo qui comedit carnes cuiusdam iudei.
48. De Anthonii fratre et laico ac lupo.
49. Predicator multum clamans quomodo confundebat.
50. De seruo et ouo.
51. De eo qui per crepitum ventris cardinali ventulum fecit.
52. De monacho peierante.
53. De votum faciente qui dedit putamina deo.
54. De aucupe quem lesit serpens.
55. De augure qui furtum rei sue preuidere non potuit.
56. Quare lupi sectantur oues, et sacerdotes insidias faciant mulieribus.
57. De eo qui in somni[i]s aurum reperiebat.
58. Donati equi non esse respiciendos dentes.
59. De iudeo qui cacando inuenit pecuniam.
60. De eo qui liberauit hospitale a sordidis mendicantibus.
61. De equo qui noluit auxilio esse asino in onere deferendo.
62. De patre qui somniauit filium suum a leone occidi.
63. De mortuo vomente eucharistiam.
{p. 385}64. De gallina saginata : etauca ponente singulis diebus ouum aureum.
65. De mercatore naufrago, postea facto pastore.
66. De vulpe et leone.
67. (Le titre manque) Qui parere cupit cunctis, plerumque periclum, etc.
68. Fenorator ficte penitens in peius recidiuat.
69. De monacho qui mori voluit vt iudeus.
70. De Tubicine captiuo in bello.
71. De eo qui harundinibus predicauit.
72. De armato nobili qui multa presumebat sed parum faciebat.
73. De notario falso.
74. De lanione et corde abrepto.
75. De eo qui socium suum fecit prophetam.
76. De eodem Gonella et eius mirabili morte.
77. De vulpe nolente visitare leonem. Ex horatio. 1. epistola.
78. De importuno sollicitatore.
79. De culice et pastore. Ex Virgilio.
80. De coruo quare certo tempore non bibit aquas. Ex Ouidio.
81. De faciente confessionem per scedam.
82. Facetissimum consilium minacii ad rusticum.
83. Facetum cuiusdam medici, forte medelas dantis, dictum.
84. De vulpe et pardo, ac agricola qui proprios boues interemit.
85. De heremita qui multas mulieres stuprauerat.
86. De vulpe in palea abscondita que fugabatur a canibus.
87. Quod res sacre ad vsum prophanum deputari non debent.
88. De sacerdote, diabolo et peregrino.
89. De paruo pisce qui a maiori agitabatur.
90. De prouerbio inter os et offam.
91. De vulpe et marmorea imagine.
92. Mutari homines ex maribus in puellas ex Ouidio et Virgilio.
93. Hominem mutari in lupum.
94. De psyllis pugnantibus contra austrum.
95. De Marsis domantibus serpentes. Ex Lucano et Virgilio.
96. De anthropophagis. Ex Juuenali.
97. De cynocephalis, aeleala, leucotrota, et sciopedibus.
98. De simearum natura.
99. De sphinge et eius enigmate. Ex Statio.
100. De Nabo, Ceffi, Rhinoceronte, catoblepa : parandro.
101. De chameleonte.
102. De regulo et mustela.
103. De serpente boa.
104. De capro quare ponatur super pocula. Ex Ouidio.
105. De Arione methymneo et delphine. Ex Ouidio.
106. De pauone pythagoreo. Ex Ouidio.
107. De amore delphini et pueri.
{p. 386}108. De fidelitate canum.
109. De hippopodibus et phanesiis.
110. De visontibus : vris et alce.
111. De hyena ex Ouidio.
112. Leonis nature comparatio ad veram amiciciam. Ex Homero.
113. De Milonis vita et morte.
114. Quomodo dentes crocodyli purgentur.
115. De thauris indicis.
116. De pantheris.
117. De tygribus.
118. De vrsarum ingenio.
119. De pugna elephantorum et draconum.
120. De Coralio. Ex Ouidio.
121. De Trytamno neruoso.
122. De perdicibus boetiis.
123. De gallorum natura et perdice.
124. De arimaspis et arympheis.
125. De Ibi et serpentibus.
126. De bello pygmeorum et gruum. Ex Juuenali.
127. De aucupe et volucribus.
128. De Castoreo ingenio.
129. De blemiis aliisque monstruosis gentibus.
130. De muliere que plures pueros simul enixa est.
131. De puero comedente alios pueros in antro.
132. De puero quadrupede in agro florentino ex equa nato.
133. De quodam hermaphrodito : et eius vaticinio.
134. Aenigma in thermis orciniis a nympha speciosissima Joanni Reuchlin phorcensi oblatum. Anno. M.CCCC.XCVII.
135. Enigma Hieronymi Empfer.
136. Aliud enigma.
137. De mortuo : viuo ad sepulchrum deducto : loquente, et risum mouente.
138. De Gelonis et agathyrsis.
139. De hyrpis, et gymnosophystis. Ex Virgilio.
140. De Essedonibus qui mortuos suos cantu sepeliunt : Et de hyperboreis.
Tels sont les titres des opuscules de Sébastien Brant qui forment la seconde partie de l’édition de Bâle.
La fin en est, au feuillet 203, annoncée en ces termes :
Mythologi Esopi clarissimi fabulatoris : una cum |
Auiani et Remicii quibusdam fabulis : per Sebastia-|num Brant nuper
reuisi : additisque per eum ex variis | autoribus centum circiter et
quadraginta elegantissi-|mis fabellis, facetis dictis, et versibus : ac
mundi mon-|struosis {p. 387}compluribus creaturis :
Impressi Basilee ope-|ra et impenso magistri Jacobi de Phortzheim : An-|no
dominice incarnationis primo post quindecim cen-|tesimum : feliciter
finiunt.
Il est probable que l’édition de Brant avait été tirée à un nombre d’exemplaires relativement considérable. Si j’avais pris note de tous ceux que j’ai vus, j’en pourrais signaler beaucoup. Je puis néanmoins citer les suivants :
1º À la Bibliothèque nationale un exemplaire qui porte la cote Y 6536, mais qui malheureusement est incomplet et ne contient que la seconde partie du volume ;
2º À la bibliothèque de l’Arsenal, sous la cote 12708, un magnifique exemplaire complet, à pleines marges, dont la reliure porte sur les plats les initiales réunies des noms de Henri II et de Diane de Poitiers ;
3º À la bibliothèque du British Museum, un exemplaire sous la cote 86. K. I. ;
4º À la Grenville library, un exemplaire sous la cote 7809 ;
5º À la bibliothèque Bodléienne, un exemplaire sous la cote A 573 ;
6º À la bibliothèque de l’Université de Cambridge, un exemplaire sous la cote O. 3. 4. 2 ;
7º À la bibliothèque publique d’Innsbruck, un exemplaire sons la cote 293 ;
8º À la bibliothèque publique de La Haye, un exemplaire mutilé qui, dans la deuxième partie du catalogue imprimé des incunables, porte le nº 17 ;
9º À la bibliothèque de l’Université de Leyde, un exemplaire sous la cote Prenktab ;
10º À la bibliothèque publique de Grætz, un dernier exemplaire.
6º Édition de Sébastien Brant de 1521. §
L’édition de Bâle, qui avait essayé de rajeunir les fables latines du Romulus ordinaire, avait été pour elles le chant du cygne. Il en parut bien encore quelques réimpressions. Ainsi, en 1521, à Leipzig, l’édition de Bâle fut encore une fois reproduite par Valentin Schumann dans le format in-4º339. Mais leur vogue était passée. De même qu’au {p. 388}moyen âge elles avaient tué Phèdre, de même les traductions qui en avaient été publiées à l’époque de la Renaissance leur avaient porté un coup fatal.
7º Édition de Schwabe de 1806. §
Pendant deux siècles entiers, le texte latin du Romulus ordinaire fut presque oublié. Gude l’avait bien retrouvé dans l’ancien manuscrit de Dijon et s’était donné la peine d’en prendre copie ; Nilant, dans la préface de ses Fabulæ antiquæ, avait bien appelé sur lui l’attention du monde savant ; Christ enfin et Funck, dans leurs jeux d’esprit, l’avaient bien l’un et l’autre invoqué en faveur de leurs thèses contraires. Mais personne n’avait songé à le vulgariser par une nouvelle publication.
C’est seulement en 1806 que Schwabe, dans sa deuxième édition des fables de Phèdre, tira le Romulus ordinaire de l’oubli presque complet dans lequel la découverte de Gude ne l’avait point empêché de rester. Cette édition, publiée à Brunswick par l’éditeur Vieweg, est trop connue pour que j’en donne ici l’analyse.
8º Édition de Lemaire de 1826. §
M. Gail, chargé par le savant Lemaire de faire figurer les fables de Phèdre dans sa célèbre collection des classiques latins, prit pour base de son travail la deuxième édition de Schwabe, qu’il augmenta des trois dissertations latines du Père Desbillons, des deux opuscules du Père Adry, intitulés l’un : Dissertations sur les quatre manuscrits de Phèdre, l’autre : Examen des nouvelles fables, et du texte de ces fables restauré par Jannelli. Cette deuxième édition de Schwabe possédant les fables de Romulus, Gail les publia telles qu’elle les renfermait. Il n’avait voulu en faire et n’en fit qu’une simple réimpression.
9º Édition de M. Hermann Oesterley de 1870. §
Ainsi qu’on a déjà pu s’en convaincre, M. H. Oesterley a, mieux que Schwabe, compris son rôle d’éditeur des fables de Romulus. Ayant rencontré au British Museum le manuscrit Burnéien, il a senti que c’était une nouvelle source dont il ne pouvait, sous peine de lui ôter son importance, être fait qu’une publication purement littérale. Aussi son édition, publiée à Berlin par le libraire Weidmann en 1870, se borne-t-elle à donner le texte exact du manuscrit.
Comme de toutes celles qui ont paru en Europe dans les dernières années du xve siècle, la traduction allemande a été publiée la première, c’est des éditions qui en ont été imprimées que je vais d’abord m’occuper.
1º Édition de Günther Zainer. §
De toutes les éditions purement allemandes la plus ancienne paraît être celle qui, selon Hain340, fut publiée par Günther Zainer, imprimeur à Augsbourg et sans doute proche parent de son confrère d’Ulm. Ce dernier lui avait vraisemblablement communiqué un exemplaire de sa fameuse édition du Romulus ordinaire ; il n’est donc pas étonnant qu’il ait été le premier à réimprimer la traduction allemande qu’elle contenait.
La réimpression de Günther Zainer forme un volume in-fol. de 167 feuillets de 36 lignes à la page, sans lieu, date, ni nom d’imprimeur, et avec les mêmes gravures sur bois que l’édition originale.
Les 167 feuillets se composent de 34 feuillets non numérotés, consacrés à la vie d’Ésope, de 119 feuillets numérotés, occupés par les diverses collections de fables, et de 14 feuillets non numérotés, remplis par la table générale des matières et l’histoire de Sigismonde341.
Voici au surplus l’analyse de leur contenu :
Fol. 1 a. — Page blanche.
Fol. 1 b. — Gravure sur bois représentant Ésope en pied.
Fol. 2 a. — Hie hept
sich an das buch vnd leben des hoch berü-|meren fabeltichters esopi auss
krieschicher zügen in | latein gemacht. Auch etlich ander fabel als Auiani
| auch Doligami Adelfonsi. Vnd etlicher Schimpfre-|den Pogij. Auch die
histori Sigismunde der tochter | des fürsten Tancredi vō Salernia. vn̄ des
iunglings | gwistardi (sic)
, etc. Zum ersten die vorrede. | (D)as leben des hochberümten
fabelti-|chters Esopi. ausӡ kriechischer zun-|gen in latin. durch Rimiciū
gema-|chet. an dē hochwürdigē vatter her-|ren anthoniū des titels sancti
Criso-|goni priestern
{p. 390}Cardinaln. vn̄ fübz | dӡ selb leben
esopi mit seynen fabeln | die etwa Romulus von athenis seinem sun
Tiberi-|no ausӡ kriechischer zungē in latein gebracht. hat ge-|sendet.
vn̄mer etlich der fabel Auiani. auch doligami | Adelfonsy. vnd
schimpfreden pogij vn̄ anderer. yeg-|liche mit irē titel ob vertzeichnet.
ausӡ latin. von do-|ctore Heinrico Steinhöwel
Zum ersten die vorrede. | (D)as leben des hochberümten
fabelti-|chters Esopi. ausӡ kriechischer zun-|gen in latin. durch Rimiciū
gema-|chet. an dē hochwürdigē vatter her-|ren anthoniū des titels sancti
Criso-|goni priestern
{p. 390}Cardinaln. vn̄ fübz | dӡ selb leben
esopi mit seynen fabeln | die etwa Romulus von athenis seinem sun
Tiberi-|no ausӡ kriechischer zungē in latein gebracht. hat ge-|sendet.
vn̄mer etlich der fabel Auiani. auch doligami | Adelfonsy. vnd
schimpfreden pogij vn̄ anderer. yeg-|liche mit irē titel ob vertzeichnet.
ausӡ latin. von do-|ctore Heinrico Steinhöwel
Ce texte peut se traduire ainsi :
« Ici commence le livre et la vie du très célèbre fabuliste Ésope, traduits du grec en latin. De plus, quelques autres fables d’Avianus et de Doligame Alphonse, et quelques facéties du Pogge. En outre, l’histoire de Sigismonde, fille du prince Tancrède de Salerne, et du jeune Gwiscard.
« Tout d’abord la préface.
« La vie du très renommé fabuliste Ésope, traduite du grec en latin, par Rimicius pour le très révérend père, monseigneur Anthoine du titre de Saint-Chrysogone, prêtre cardinal ; en outre la vie même d’Ésope avec ses fables que Romulus a envoyées d’Athènes à son fils Tiberinus, traduites du grec en latin ; de plus quelques fables d’Avianus, de Doligame Alphonse, et joyeusetés du Pogge et d’autres, chacune avec son titre, traduites du latin par le docteur Henri Steinhöwel, etc. »
Fol. 34 a, ligne 13. — La vie d’Ésope se
termine par ces mots : tod auch vergan.
Puis on lit cette phrase finale : Finis
desӡ leben Esopi
, c’est-à-dire : « Fin de la vie
d’Ésope. »
Fol. 35 a, portant le nº i.
— Das Register desӡ ersten buchs desӡ hochberümptē |
fabeltichters vnnd meysters Esopi. Zum ersten die | vorred
,
etc. En français : « La table du premier livre du très célèbre
fabuliste et maître Ésope. Tout d’abord la préface, etc. »
Fol. 35 b. — Die vorred
Romuli philosophi in dӡ buch Esopi, |
etc. Ce qui veut dire :
« La préface de Romulus sur le livre d’Ésope, etc. »
Fol. 80 a, portant le nº xlvi. — Hie endet sich das vierd buch des hochberümten | fabeltichters
vnd meisters esopi. Vnd hebent sich | an die mitlauffenden alten fabeln
die man zu sch-|reibet Esopo.
Phrase, dont voici le sens :
« Ici finit le IVe livre du très illustre
fabuliste et maître Ésope et commencent les anciennes fables courantes que
l’on attribue à Ésope. »
Fol. 101 b, portant le nº lxvij. — Hie haben ein ende die mitlauffendē {p. 391}alten | fabeln die man czuschreybet Esopo.
Lisez :
« Ici finissent les vieilles fables que l’on attribue à
Ésope. »
Fol. 102 a, portant le nº lxviij.
— Hie vahend an die neuwen geteutschten fabeln | von
Rimicio die auch czugeschriben werdent Esopo | mit irem
Register.
Autrement dit : « Ici commencent les nouvelles
fables mises en allemand d’après Rimicius, qui sont attribuées aussi à
Ésope, avec leur table. »
Fol. 111 a, portant le nº lxxvij.
— Eyn ende habent die fabeln Esopi. die von dē
hoch-|gelerten maister Rimicio neulich ausӡ kriechischer | zungen ī latein
gebracht welche fabeln von romu-|lo in seinen vier bücher nit werden
begriffen |
etc. Ce qui peut s’interpréter ainsi :  Hie vahent an die fabeln Auiani mit irē Register.
|
Hie vahent an die fabeln Auiani mit irē Register.
|« Ici
finissent les fables d’Ésope mises récemment du grec en latin par le savant
maître Rimicius, lesquelles ne sont pas comprises dans les quatre livres de
Romulus. Ici commencent les fables d’Avianus avec leur table. »
Fol. 126 b, portant le nº lxxxxij.
— Hie habend eyn ende die fabeln Auiani.
C’est-à dire : « Ici finissent les fables d’Avianus. »
Fol. 127
a, portant le nº lxxxxiij. — Hie
endent sich die fabeln Auiani vnnd vahet | an das Register seyner
fabeln (rectius : der gesammelten Fabeln).
Littéralement : « Ici finissent les fables d’Avianus et commence la
table de ses fables (et plus exactement : des fables réunies). »
Fol. 153 b, portant le nº cxix. Là se terminent les diverses collections de fables.
Fol. 154 a à 158 b.
— Dӡ (Das) Register über die gemeinen puncten materi
disӡ büchlins
, ou : « Table synoptique des points
communs que présentent les matières de ce livre. »
Fol. 159 a. — Hystoria
sigismunde : der tochter des fürsten tan-|credi von salernia vnd des
iünglings gwisgardi.
En d’autres termes : « Histoire
de Sigismonde, fille du prince de Tancrède de Salerne, et du jeune
Guiscard. »
Tel est le contenu du volume, dont les matières se terminent, sans souscription, à la ligne 23 du feuillet 167 a.
Pour ceux qui voudront faire plus ample connaissance avec cette édition, j’ajoute que j’en ai trouvé, sous la cote X. E. 28, un exemplaire conservé dans la bibliothèque impériale de Vienne.
2º Éditions de Sorg. §
Antoine Sorg, qui, presque aussitôt {p. 392}après l’apparition de l’édition d’Ulm, en avait réimprimé le texte latin, procéda de même à l’égard de la traduction allemande. En négociant judicieux, il dédoubla l’édition originale, dont les deux textes ne pouvaient convenir au même public, et il paraît qu’en ce qui concerne le texte allemand son idée eut un plein succès ; car il le réimprima plusieurs fois.
Ces réimpressions ne portent ni date, ni nom d’imprimeur, et, quoique très vraisemblablement elles émanent de lui, elles ne peuvent cependant lui être incontestablement attribuées ; une seule, étant accompagnée de son nom, ne peut, quant à son origine, être l’objet d’aucun doute.
A. Édition sans date (Hain 332). §
L’édition, décrite par Hain sous le nº 332, forme un volume in-folio de 158 feuillets, dont 34 non numérotés, 119 numérotés à la suite, et enfin 5 non numérotés.
En voici le contenu :
Fol. 1 b. — Portrait d’Ésope occupant toute la page.
Fol. 2 a. — Vita Esopi
fabulatoris clarissimi e greco latina per | Rimicium facta ad
reuerēdissimum patrem dominū | Anthonium Tituli sancti Chrisogoni
prespiterum (sic) Cardinalem.
| À la
suite de ce titre on lit : Das leben des hochberümten
fabelti-|chters Esopi. ausӡ kriechischer zun-|gen in latein. durch
Rimicium ge-|machet. an den hochwürdigen va-|ter herren Anthonium des
titels |
etc. Ce qu’on peut traduire ainsi : « La
vie du très illustre fabuliste Ésope mise du grec en latin par Rimicius
pour le très révérend père monseigneur Antoine du titre de
Saint-Chrysogone, etc. »
Fol. 34 b, ligne 9. — Was mit söllichem tod auch vergan |
— C’est-à-dire :  finis desӡ leben Esopi.
finis desӡ leben Esopi.« … qui a fini par une mort
heureuse. — Fin de la vie d’Ésope. »
Fol. 35 a à 158. — Collections de fables imprimées avec les mêmes caractères que ceux de la précédente édition. Elles ne sont pas suivies de l’histoire de Sigismonde.
B. Édition sans date (Hain 333). §
L’édition, décrite par Hain sous le nº 333, forme un volume in-folio de 170 feuillets numérotés en partie et ornés de gravures sur bois.
En voici l’analyse :
Fol. 1 b. — Portrait d’Ésope remplissant la page entière.
Fol. 2 a à 37 b. — Vie
d’Ésope, dont la fin est marquée par cette {p. 393}phrase : Hie hat ein ende das leben
Esopi
, phrase qui veut dire : « Ici finit la vie
d’Ésope. »
Fol. 38 (1) a à 87 (50) b. — Traduction allemande des quatre livres de Romulus.
Fol. 87 (50) a. — die
mitlauffenden alten fabeln
, ou « vieilles fables
courantes »
, qui se terminent au folio 109 (72) b.
Fol. 110 (73) a. — Hye
vahent and die newen geteutschten falblen (sic) von
Rimicio
, etc. En français : « Ici commencent les
nouvelles fables mises en allemand d’après Rimicius. »
Fol. 120 (83). — vahent an die fabeln
Auiani
, etc., ce qui signifie : « Ici commencent les
fables d’Avianus. »
Fol. 137 (100). — Gesamlet
fabeln
, ou « Fables complètes »
.
Fol. 165 (128) a. — Hyenach volget daӡ Register über die gemeinē puncten der materi disӡ
büchlins.
En d’autres termes : « Ici commence la
table synoptique des points communs dans la matière du
livre. »
Cette table se termine au folio 170 a.
C. Édition sans date (Hain 334). §
L’édition sans date, décrite par Hain sous le nº 334, forme un volume in-fol. de 115 feuillets, qui a de 43 à 44 lignes à la page, qui est imprimé en caractères gothiques et qui est agrémenté de gravures sur bois.
Voici le détail de son contenu :
Fol. 1 a. — Page blanche.
Fol. 1 b. — Portrait d’Ésope aussi grand que la page.
Fol. 2 a. — Hye hept
sich an das buch vnd leben des fabeltichters. Esopi auss | kriechischer
zungen in latin gemacht. Auch etlich (sic) ander fabel als Auia|ni. Doligani. Adelfonsi. vnd etlicher
schimpfreden. Pogii.
Autrement dit : « Ici
commencent le livre et la vie du fabuliste Ésope mise du grec en latin,
puis quelques autres fables telles que d’Avianus, de Doligane, d’Alphonse,
et quelques facéties du Pogge. »
Fol. 24 a. — Finis des
leben. Esopi
, c’est-à-dire : « Fin de la vie
d’Ésope. »
Fol. 24 b. — Das.
Register des ersten buchs des hochberümpten fabel-|tichters vnnd
meysters. Esopj zum ersten.
Ce qui peut se lire ainsi :
« Table du premier livre du célèbre fabuliste et maître Ésope ;
tout d’abord… »
Fol. 25 a. — Dye
vorred. Romuli philosophi in das buch. Esopi.
{p. 394}Soit : « La Préface du philosophe Romulus
pour le livre d’Ésope. »
À la suite de cette préface viennent les
4 livres de Romulus.
Fol. 60 a. — Hie endet sich das vird buch
dӡ hochberümtē fabeltichters vn̄ meysters | esopi vn̄ hebēt sich an
diemit lauffendē altē fabeln die mā zu schribet esopo.
Lisez : « Ici finit le quatrième livre du célèbre fabuliste et maître
Ésope, et commencent les vieilles fables courantes qu’on lui
attribue. »
Fol. 74 a, portant la signature i. iiii.
— Hie endet sich die alten mit lauffendē fabeln die
mā zuschreibet. esopo | Vn̄ vahend an die neuw geteutschten fabln
(sic) von. Rimitio die auch | zugeschriben werdent. Esopo.
Mit irem register.
Traduction : « Ici finissent les
vieilles fables courantes que l’on attribue à Ésope, et commencent les
nouvelles fables mises en allemand d’après Rimitius, que l’on attribue
aussi à Ésope, avec leur table. »
Fol. 81 a. — Eyn ende
habent die fabeln. Esopi. die von deӡ hochgelerten meister | rimicio
neulich ausӡ kriescher zūgen in latein gebrach welche fabeln von |
romulo in seineӡ vier bücher nit werden begriffen Vn̄ vahēt an die
fa|belen. Aniani mit irem register.
Observation
correspondant à celle-ci : « Fin des fables d’Esope mises récemment
du grec en latin par le savant maître Rimicius, lesquelles ne sont pas
comprises par Romulus dans ses quatre livres, et commencement des fables
d’Avianus avec leur table. »
Fol. 93 a. — Hie endet
sich die fabeln Auiani. vnnd vahet an das register in | die gesamelt
fabeln.
Ce qui équivaut à ces mots : « Fin des
fables d’Avianus, et commencement de la table pour les fables
réunies. »
Fol. 111 b. — Hyenach
vahet an dos Register über dye gemeynen puncten | der materien disӡ
büchlinsӡ.
Ce qui signifie : « Ici commence la table
des points communs dans la matière du livre. »
Fol. 112 a à 115 a. — La table qui remplit ces feuillets n’est terminée par aucune mention finale.
D. Édition de 1483. §
L’édition de 1483 forme un volume in-folio composé de 169 feuillets, imprimé en caractères gothiques et orné de gravures sur bois. Comme elle est plus connue que les précédentes, je m’abstiens de l’analyser. D’ailleurs elle renferme les mêmes collections de fables, qui occupent les 154 premiers feuillets, et ne se distingue des autres éditions de Sorg que par l’histoire de Sigismonde qui s’étend du feuillet 155 au feuillet 169 et dernier.
{p. 395}À la fin on lit ces mots.
— Esopus der hochbetümpt fabeltichter mit etlichen
zugelegten fabeln. Rimicii vnd Aviani, vnd der histori Sigismunde der
tochter des fūrsten tancredi
, etc. Ce qui veut dire :
« Esope le célèbre fabuliste avec addition de quelques fables de
Rimicius et d’Avianus et l’histoire de Sigismonde, fille du prince
Tancrède, etc. »
Plus bas se trouve cette dernière indication qui détermine le
lieu, la date et le nom de l’imprimeur : Gedruckt vnd
vollendet in der hochwirdigen vnnd kayserlichen stat Augspurg von
Anthonio Sorg am montag nach Agathe do man zalt nach Cristi geburt MCCCC
vnd in dem Lxxxiii Jar.
Ce qui signifie : « Imprimé
et terminé dans la très glorieuse et impériale ville d’Augsbourg par
Antoine Sorg, le lundi après Sainte-Agathe, M.CCCC.LXXXIII de la naissance
du Christ. »
Hain signale l’édition de 1483342, mais n’en donne guère l’analyse, et je suis obligé de renvoyer ceux qui voudront en prendre connaissance aux deux exemplaires que j’en ai rencontrés, l’un dans la bibliothèque privée du roi de Wurtemberg, à Stuttgart, l’autre dans la bibliothèque publique de Linz, sous la cote D. iv. 9, relié avec un exemplaire de l’édition latine du Romulus de Sorg décrite par Hain sous le nº 326.
3º Éditions de Schobsser. §
Aux éditions d’Antoine Sorg ont succédé celles d’un autre imprimeur d’Augsbourg, Jean Schobsser, qui fut peut-être son successeur.
A. Édition de 1485. §
Jean Schobsser réimprima, en 1485, la traduction de Steinhöwel. Comme les précédentes, sa réimpression fut faite dans le format in-folio et illustrée de gravures sur bois.
Elle se termine par ces mots : Esopus der
hochberümbt fabeldichter mit ettlichen czugelegten fabeln Rimicii vnnd
Auiani endet sich hie. Gedruckt vnd vollendet in der kaiserlichen stat
Augspurg von Johanne Schobsser am mitwoch vor Jacobi nach cristi
gepurd M.CCCC. vnd im Lxxxv. iare343.
Ce qui peut se traduire ainsi : « Ésope
le très illustre fabuliste, avec addition de quelques fables de Rimicius
et d’Avianus, se termine ici. Imprimé et achevé dans la ville impériale
d’Augsbourg par Jean Schobsser, le mercredi avant la {p. 396}fête de Saint-Jacques, en l’an M.CCCC.LXXXV après la
naissance du Christ. »
B. Édition de 1487. §
Comme la réimpression précédente, celle de 1487 forme un
volume in-folio, illustré de gravures sur bois. Il porte cette souscription
finale : Gedruckt vnd volenndet in der kaiserlichen stat
Augspurg von Johanne Schobsser an mitwochen vor Vrbani des heiligen
babst Nach Cristi gepurd M.CCCC.Lxxxvij344.
En français : « Imprimé et terminé dans
la ville impériale d’Augsbourg par Jean Schobsser, le mercredi avant la
fête du saint pape Urbain, en l’an M.CCCC.LXXXVII après la naissance du
Christ. »
4º Éditions de Schönsperger. §
Après les réimpressions d’Antoine Sorg et de Jean Schobsser vinrent celles de Hannsen Schönsperger, qui paraît avoir rivalisé d’ardeur avec eux, ou, tout au moins, avoir suivi leurs traditions. Trois fois, en 1491, en 1496 et en 1498, il réimprima la traduction de Steinhöwel dans le format in-folio.
A. Édition de 1491345. §
La réimpression de 1494 forme un volume composé de 151 feuillets, imprimé en caractères gothiques, disposé en pages de 34 à 36 lignes et illustré de gravures sur bois. Des 151 feuillets les 31 premiers sont dépourvus de numéros, les 113 suivants sont numérotés, et les 7 derniers ne le sont pas.
Voici l’analyse du volume :
Fol. 1 a. — Il est consacré au titre de
l’ouvrage ainsi conçu : Das buch des hochbe-|remten
(sic) fabeltichters E-|sopi mit seinen figuren.
Mots qui
signifient : « Le livre du célèbre fabuliste Ésope avec ses
figures. »
Fol. 1 b. — Grand portrait d’Ésope.
Fol. 2 a, portant la signature a. ij :
Hye vahet an die vorrede in das buch | des
hochberemten fabeltichters Esopi.
Traduction : « Ici
commence la préface du livre du très célèbre fabuliste
Ésope. »
Fol. 32 a, portant la signature e.iiij et
le nº 1. Aux lignes 11 et 12 on lit : Hie hat ein ende
das lesen (sic) esopi. |
Mots dont voici le sens :  Die vorrede Romuli philosophi in das buch Esopi.
Die vorrede Romuli philosophi in das buch Esopi.« Ici finit la vie d’Ésope. — La préface de
Romulus le philosophe pour le livre d’Ésope »
{p. 397}Fol. 144 a,
portant la signature v.iiij et le nº cxiij : Hienach
volget das Register.
C’est-à-dire : « Ici commence
la table. »
Fol. 144 a à 151 b.
— Table, à la fin de laquelle on lit : Hye endet sich
Esopus der hochberümbt fabeltichter : mit | ettlichen zu gelegtē
fabeln : Rimicii vnd Aniani : Gedru-|cket un̄ volendet in der
keyserlichen reychstat Augspurg | von Hannsen Schönsperger am montag
nach sant Fe-|liczen tag : Nach Cristi
geburd. M.CCCC. lxxxxi.
Traduisez : « Ici finit Ésope
le célèbre fabuliste avec quelques fables ajoutées de Rimicius et
d’Avianus. Imprimé et terminé dans ta ville impériale d’Augsbourg par
Hannsen Schönsperger le lundi après Sainte-Félicité, en l’an du
Christ M.CCCC.Lxxxxi. »
B. Édition de 1496346. §
L’édition de 1496, qui forme, comme la précédente, un volume
in-fol. imprimé en caractères gothiques et illustré de gravures sur bois,
est une réimpression que je crois pouvoir attribuer à Hannsen Schönsperger,
et qui au moins a été exécutée à Augsbourg, ainsi qu’il résulte de ces
mots : Gedruckt zu Augspurg.
C. Édition de 1498347. §
En 1498, Hannsen Schönsperger exécuta une troisième et dernière réimpression, formant encore un vol. in-fol. illustré de gravures sur bois.
Le lieu, la date et le nom de l’imprimeur y sont nettement
indiqués par cette mention finale : Esopus der
hochberühmbt fabel Tichter mit ettlichen zugelegten fabeln Rimicii und
Aviani endet sich hie. Gedruckt vnd volendet in der keyserlichen stat
Augspurg von Hannssen Schönsperger an Dornstag nach sant Bartholome.
Nach Cristi gepurt M.CCCC. vnd Lxxxxviij.
Lisez :
« Ésope le très célèbre fabuliste avec quelques fables ajoutées de
Rimicius et d’Avianus finit ici. Imprimé et achevé dans la ville impériale
d’Augsbourg par Hannsen Schönsperger, le jeudi après Saint-Barthélemy, en
l’an du Christ M.CCCC.XCVIII. »
5º Édition de Jean Prüss de 1508. §
La traduction allemande de l’œuvre de S. Brant, publiée par Jean Prüss, forme un vol. in-fol. Elle est précédée de la traduction allemande due à Steinhöwel.
Le volume présente deux séries de signatures, la première de a à s, la seconde de a à l. Il se divise en deux parties.
{p. 398}La première partie se compose de 114 feuillets, dont les six premiers ne portent pas de numéros. Les 108 numérotés qui suivent, contiennent l’œuvre de Steinhöwel.
Les feuillets non numérotés contiennent ce qui suit :
Fol. 1 a. — Titre ainsi conçu : In disem Buch ist des ersten teils : das leben und fabel Eso-|pi
Auiani : Doligani : Adelfonsi : mit schympfredē Pogij. Des andern | teils
uszüge schöner fabeln un̄ ex-|empelen Doctoris S. Brant : alles mit synen
figuren un̄ | Registern.
Au-dessous de ce titre est une gravure sur bois représentant trois personnages.
Fol. 1 b. — Le verso du feuillet 1 est rempli par une gravure qui occupe toute la page et qui représente la Vierge et l’Enfant-Jésus avec les mots Sancta Maria.
Fol. 2 a. — Commencement de la première table des matières, établie d’après leur nature.
Fol. 5 a. — Commencement de la seconde table, divisée comme l’ouvrage en deux parties.
Voici le contenu des feuillets numérotés :
Fol. 1 a à 23 b. — Vie d’Ésope.
Fol. 24 a à 58 a. — Fables de Romulus.
Fol. 58 a à 71 b. — Fables appelées fabulæ extravagantes.
Fol. 71 b à 78 a. — Fables appelées novæ.
Fol. 78 b à 89 b. — Fables d’Avianus.
Fol. 90 a à 108 b. — Fables appelées collectæ. Elles sont au nombre de vingt-quatre.
À la fin on lit : Hie nach folget der ander
teil : Schöner | vnd lieplicher fabeln ; hyspilen : | vnd historien : von
doctore Sebastiano brand : zu | underwyszung gut-|ter sitten : Zelamē |
geordnet.
La deuxième partie du volume se compose de 68 feuillets portant les numéros 111 à 178. Il semble au premier abord en résulter qu’il a dû exister, à l’origine, deux feuillets portant les numéros 109 et 110. Mais, autant que j’ai pu en juger par le seul exemplaire que j’aie eu sous les yeux, ils n’ont jamais existé ; ce qui me le fait croire, c’est que je n’ai aperçu aucune lacune dans les signatures.
Les feuillets 111 a à 178 a
contiennent la traduction de l’œuvre de Brant suivie de cette souscription :
Ein ende beyder teyl disӡ büchsӡ : Getruckt zum
Thiergarten | durch Joannem Prüsӡ burgern zū {p. 399}Strasӡburg : In | dem Augstmonat des. M.CCCCC. vnd | achtsten jares |
.
Il existe à la bibliothèque royale de La Haye un exemplaire
de cette édition.
6º Édition de Jean Fahre. §
Si, au xvie siècle, le texte latin du Romulus ordinaire cessa d’être réimprimé, il n’en fut pas de même de la traduction allemande. Elle fut l’objet de quelques réimpressions et la bibliothèque publique d’Ulm abrite de l’une d’elles un exemplaire acquis à la vente des livres d’un descendant des Besserer.
Le volume, qui est un in-4º de petit format, se divise en deux parties, l’une renfermant le texte allemand des fables contenues dans l’édition d’Ulm, l’autre, la traduction allemande de l’addition de Sébastien Brant.
La fin de l’une et le commencement de l’autre s’annoncent par
un double avis, dont voici la traduction littérale : « Ici finissent
les fables réunies. — Ici suit une deuxième partie de fables belles et
agréables, d’exemples et d’histoires du Dr Sébastien
Brant, pour l’enseignement des bonnes mœurs, coordonnés
ensemble. »
Une préface indique ensuite que Brant a écrit son ouvrage pour l’instruction de son fils Onophrius.
Les fables de Brant suivent cette préface, et sur un feuillet
final on lit, toujours en allemand, ce dernier avis : « Imprimé à
Fribourg en Brisgau par Jean Fabre de Jülich, en l’année 1531, au mois de
février. »
7º Éditions de Graff. §
Graff, qui fut peut-être, à Fribourg en Brisgau, le successeur de Jean Fabre, y réimprima deux fois, dans le format in-4º, la traduction allemande de Steinhöwel, suivie de la traduction allemande des fables latines publiées par Sébastien Brant.
A. Édition de 1545. §
Il existe, au British Museum sous la cote 12 305. e. 15 et à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote A. III. art., des exemplaires de la première édition de Graff, imprimée dans le format in-4º en 1545. Le volume, numéroté non par page, mais par feuillet, comprend clxxiiii feuillets chiffrés, précédés de douze autres non chiffrés contenant le frontispice, un préambule et le Register.
Voici le frontispice : Esopus Leben |
vnd fabeln, mit sampt den fabeln Aniani, | Adelfonsi, | vnd etlichen
schimpffreden Poggii. Darsu ausszüge schöner | fabeln vnd exempeln
Doctors Sebastian {p. 400}Brant,
alles klärlich mit | schönen figuren vnd registern
aussgestrichen.
Au-dessous de ce titre est le portrait en pied d’Ésope qui occupe les deux tiers de la page.
Au verso du feuillet clxxiiii on lit : Zu Friburg | im Brissgaw, | Durch Stephanum Melechum Graff, |
jm Jar M.D.XLV.
B. Édition de 1555. §
Je passe à la seconde des deux éditions sorties des presses de Graff.
J’en ai trouvé à Londres, dans la Bibliothèque du British Museum sous la cote 637. F. 40 et dans celle du South Kensington Museum, deux exemplaires qui me permettent d’en donner le signalement.
Les douze premières pages comprennent d’abord le titre, ensuite les deux préfaces allemandes attribuant la traduction à Steinhöwel, enfin la table des matières.
Viennent ensuite 175 feuillets paginés, qui contiennent la vie d’Ésope et les diverses collections de fables.
Sur la première page du volume se trouve le titre ainsi
conçu : Esopus Leben und Fabeln : mit sampt den Fabeln
Aniani : Adelfonsi und etlichen schimpffreden Pogii. Darzu usszüge
schöner Fabeln un̄ Exempeln Doctors S. Brant… mit schönen figuren
, etc. Ce titre, placé au
bas de la page, est surmonté d’une gravure sur bois, qui représente Ésope en
pied et dans un angle de laquelle on lit : 1531.
Mais il n’en est pas moins vrai que le volume a bien
été imprimé en 1555, ainsi qu’il résulte de cet avis final : Gedruckt zu Friburg im Brisgaw | Durch Stephann Graff | Im Jar
M. D LV.
Le texte est illustré de petites gravures sur bois
beaucoup moins grossières que celles du siècle précédent.
8º Édition de Francfort. §
Sous la même date de 1555, une autre édition de la traduction allemande a été publiée à Francfort. Le British Museum en possède un exemplaire sous la cote 12305. aaa. 23.
9º Éditions de Nicolas Bassée. §
Nicolas Bassée, à Francfort-sur-le-Mein, en 1572, en 1586 et en 1589, a imprimé trois fois la traduction allemande des fables contenues dans l’édition de Steinhöwel et de celles ajoutées par Sébastien Brant.
A. Édition de 1572. §
La première édition de Bassée consiste dans un volume in-8º de 313 feuillets imprimés. En voici l’analyse :
Fol. 1. — Frontispice.
{p. 401}Fol. 2 a à 6 a. — Préface de Steinhöwel : Vorrede
anden Christlichen Leser.
Fol. 6 b à 55 a.
— Das leben Æsopi.
— Ende desӡ Lebens
Esopi.
Fol. 55 b. — Die
Vorrede Romuli phy-|losophi, in das Buch | Esopi.
Fol. 56 a à 71 b.
— Das Erste Buch | Esopi.
— Ende desӡ Ersten Buchs
Esopi.
Fol. 71 b à 85 b.
— Das ander Buch desӡ hoch-|berümpten
Fabeltich-|ters Esopi. — Ende desӡ andern Buchs Esopi.
— Das dritte Buch desӡ
hoch-|berühmpten Fabeltich-|ters Esopi.
Fol. 100 b. — Ende desӡ
dritten Buchs | Æsopi.
— Hie hebt sich an das Vierdt | Buch
desӡ hockberühmpten | Fabeltichters Esopi.
Fol. 112 a. — Ende desӡ
Vierdten Buch Æsopi.
— Folgen etliche alte zugethane
Fabeln die | man zuschreibet Esopo.
Fol. 112 b. — Die Erste
Fabel von dem Maul.
Fol. 143 b. — Hie enden
sich die Alten Fabeln die | man zuschreibet Esopo, und fahend an | die
newe gedichtet Fabeln, von | Rimitio, Esopo auch zu |
geschriben.
Fol. 144 a. — Die Erste
Fabel von dem Adler.
Fol. 153 a. — End der
Fabeln Esopi von Rimi-|tio ausӡ dem griechischen ins latein gebracht |
und werden von Romulo inn seinen | vier Būcheren nicht |
begriffen.
Fol. 153 b. — Die Erste
Fabel Aniani (sic).
Fol. 171 a. — Ende der
Fabeln Aniani.
— Die Erste Fabel
Adelfonsi.
Puis viennent 24 fables terminées au
fol. 203 b par cette souscription : Ende der Gesamleten Fabeln.
Fol. 203 b. — Folget
der Ander Theyl, Schöner | und lieblicher Fabeln, Beyspilen, und
histo-|rien von doctore Sebastiano Brand | zu underweisung guttersitten
| zusammen geordnet.
Fol. 305 b. — Amen.
Fol. 306 a. — Ein
Räters in dem Wildbad von einer schönen | Jungfrawen, Doctor Johan
Reuchlin | von Pfortzheim auffgeben | imjar 1497.
Fol. 307 a. — Register
dieses Büchlein, an wel-|chem Blat ein jede zu finden
sey.
Fol. 313 b. — Ende.
— Getruckt zu Frankfurt am Meyn | in dem Roseneck bey Niclas Bassee. |
1572.
La bibliothèque publique de Versailles possède, sous la cote E 717 d, un exemplaire de cette édition.
B. Édition de 1586. §
J’ai trouvé à la bibliothèque publique de Nancy, sous la cote NN 1, un exemplaire de l’édition de 1586. C’est un volume in-12 de 400 pages, imprimé en caractères gothiques.
Le titre qui se trouve en tête du frontispice est ainsi
conçu : Esopus Teutsch, | Das ist : Das gantze Le-|ben
und fabeln Esopi mit | sampt den fabeln Aviani, Adelfonsi, | vund
etlichen Schimpffreden Pogii, darzu | Aufzuge schöner fabeln und
Trempeln Doctors Seba-|stian Brand
, etc. Le centre de la
page est occupé par une gravure sur bois qui représente Ésope assis et
tenant de la main droite un oiseau et de la main gauche une jambe de
mammifère. Au-dessous on lit : Gedruckt zu Frankfurt am
Mayn | M. D. LXXXVI.
Voici le contenu du volume :
Pages 1 à 64. — Vie d’Ésope.
Pages 65 à 151. — Fables de Romulus.
Pages 152 à 194. — Dix-sept fables, dites Alte fabeln.
Pages 194 à 205. — Dix-sept fables, dites Neuwe fabeln.
Pages 206 à 320. — Fables de Sébastien Brant.
Pages 321 à 347. — Fables d’Avianus.
Pages 348 à 390. — Vingt-trois fables, dites Gesamlete fabeln.
Pages 391 et suivantes. — Table des matières.
Au bas du recto du dernier feuillet on lit : Gedruckt zu Franckfurt am Mayn | durch Nicolaum Bassæum | im
fahr | M. D. LXXXVI.
C. Édition de 1589. §
L’édition de 1589, dont je ne connais aucun exemplaire, m’a été révélée par la Bibliotheca librorum germanicorum, publiée en 1611 par Georges Brand in Freyhüt.
10º Édition de 1648. §
En 1648, les traductions allemandes des fables publiées par Steinhöwel et S. Brant furent éditées à Erfurt dans le format in-12. Comme dans l’édition de Bassée de 1586, les fables de Brant sont placées dans celle d’Erfurt entre les dix-sept issues de la traduction latine de Ranutio d’Arezzo et les vingt-sept d’Avianus. Il existe à la bibliothèque publique de Linz un exemplaire de cette édition sous la cote L. II. 155.
11º Édition sans lieu ni date. §
Je dois citer ici une édition de la traduction allemande de
Steinhöwel, sans lieu ni date, qui, d’après le catalogue général de la
bibliothèque du British Museum, aurait été imprimée à Nuremberg, en 1650, dans
le format in-8º, avec gravures sur bois. Voici dans quels termes elle est
signalée par ce catalogue : Erneuester Esopus : Das ist : Das gantze Leben
{p. 403}und Fabeln Esopi, so ihme pflegen
zugeeignet Werden aus Latein von… H. Steinhöwel… geteutschet. Neue Fabeln,
gedicht durch Rimitium, welche Esopo auch zugeschrieben
Werden.
12º Édition de 1676. §
Les éditions allemandes d’Erfurt et de Nuremberg ne furent pas
les seules imprimées au xviie siècle. Il en fut
publié, à Bâle, en 1676, une autre formant un volume in-8º de 452 pages
chiffrées, précédées de quatre feuillets et suivies de six autres non paginés.
Ces six derniers sont affectés à la table. Le frontispice est ainsi conçu :
Der gantze Lehr un̄ Sin̄reiche Fabeldichter
Esopus : Das ist, Das gantze Leben unnd Fabeln Esopi :
Sam̄t einem Anhang der Fabeln Aniani, Adelfonsi, un̄ etlicher
Schimpff-Reden Pogii : Auch Ausszügen, schöner Fabeln und Exempeln
D. Sebastian Brands. Alles mit schönen Figuren zu besserer Einbildemg : in
Druck gegeben.
Au-dessous est une gravure qui représente
Ésope revenant du marché, et au bas de la page le lieu et la date sont
indiqués en ces termes : Zu Basel,
Anno 1676.
Il existe un exemplaire de cette édition au British Museum sous la cote 12304. b. 14.
13º Éditions plus récentes. §
Aux éditions qui précèdent il faut ajouter les suivantes qui figurent au catalogue de la Bibliothèque du British Museum, savoir : celle de 1679 (Ulm), sous la cote 12305. a. 3 ; celle de 1700 (Magdebourg), sous la cote 12305. b. 9 ; celle de 1717 (Coburg), sous la cote 11517. aa. 7 (4) ; celle de 1730 (Hambourg), sous la cote 12305. b. 25 et celle de 1800 (Hambourg) sous la cote 12305. b 36.
14º Édition de 1838. §
La dernière édition allemande qui me reste à signaler est celle que j’ai aperçue dans la Bibliothèque publique de Grætz. Elle a été imprimée à Stuttgart en 1838.
À peine avait paru la traduction allemande des fables du Romulus ordinaire qu’une traduction française en était également publiée. Cette dernière était l’œuvre du frère Julien Macho des Augustins de Lyon, qui s’y donnait le titre de docteur en théologie. Elle est trop célèbre pour que j’omette d’en faire connaître ici les éditions successives.
1º Édition originale. §
Je mentionne en premier lieu une édition {p. 404}sans date, consistant dans un volume in-fol. de petit format, qui ne porte ni lieu, ni date, ni nom d’imprimeur.
En ce qui touche le lieu, le traducteur étant moine dans un couvent de Lyon, il est à peu près certain que c’est dans cette ville que l’édition a paru. Quant à la date, si cette édition a été la première, elle doit être antérieure à 1480 ; car je vais tout à l’heure en analyser une qui porte ce millésime. Enfin, il me paraît très probable qu’elle est due à Nicolas Phillipi de Bensheym et à Reinhardi de Strasbourg qui furent les imprimeurs de celle de 1480.
Il en existe, à la Grenville library sous la cote 7806, un exemplaire auquel j’ai emprunté l’analyse qui va suivre.
Le volume se compose de 72 feuillets non paginés, mais signés de a à f ; les cahiers portant les signatures a, k et f comprennent huit feuillets chacun ; les autres n’en ont que six. Voici leur contenu :
Fol. 1 a. — Titre ainsi conçu : Les subtiles fables de esope avec celles de Avian de Alfonce et
de Pogge florentin.
Au-dessous est le portrait d’Ésope en
pied.
Fol. 1 b. — Répétition du même portrait.
Fol. 2 a. — Le commencement de la page est
occupé par un nouveau titre général ainsi formulé : Cy
cōmence le liure des subtilitez, histoires et fables de esope translatez |
de latin en frācois, et aussi de auian et de alfonce, et aucunes ioyeuses
de po-|ge florentin, lequel a été translate de latin en frācois par
reuerend docteur | en theologie frere iulien des augustins de
Lyon.
Fol. 2 a à 18 b. — Vie
d’Ésope divisée en vingt-huit épisodes dont le dernier par suite d’une erreur
typographique est indiqué comme contenant La dixhuytiesme
hystoire. Elle est ornée de 23 gravures sur bois et terminée par cette
souscription : Cy finist la vie de esope.
Fol. 18 b à 19 a. — Table
du livre I des fables de Romulus surmontée de ce titre : Cy commence le registre des fables de esope du premier
liure.
Fol. 19 a. — Commencement du livre I, annoncé
en ces termes : Cy commence la preface du premier liure de
esope.
Puis vient la dédicace de Romulus qui débute ainsi :
Romulle filӡ de Thybere de la cite de atique
salut.
La dédicace est ornée d’une gravure.
Fol. 19 a à 23 b. — Premier livre orné seulement de 8 gravures.
Fol. 23 b. — Cy finist le
premier liure de esope et cōmēce le registre des fables du
second.
Suit la table au-dessous de laquelle on {p. 405}lit ce titre : Cy cōmēce le prohesme du
second liure des subtilles fables de esope.
Fol. 23 b à 28 a.
— Deuxième livre orné de 9 gravures seulement et suivi de ces deux phrases :
Cy finist le second liure de Esope. Et commence le
registre des fables du tiers.
Fol. 28 a à 28 b. — Table du livre III.
Fol. 28 b. — Cy commence
le tiers liure des subtilles fables de esepe (sic).
Fol. 28 b à 34 b.
— Livre III, à la fin duquel on lit : Cy finist le tiers
liure des subtilles fables de esope. Et cōmēce le quart.
Le
livre III est pourvu de douze gravures.
Fol. 34 b à 40 a.
— Livre IV, que par exception ne précède aucune table, qui comme le précédent
contient douze gravures et qui se termine par cette souscription : Cy finist le quart liure des subtilles fables de esope. Et cōbiē
quon nen ait plus trouue dēregistreeӡ, toutesfoys on a trouueeӡ pluseurs
autres par lui composeeӡ cy apres sensuyuent.
Fol. 40 a à 51 a. — Dix-sept fables dites Fabulæ extravagantes dépourvues de table et accompagnées de 15 gravures.
Fol. 51 a. — Cy apres
sensuyuent aucunes fables de esope selon la nouuelle trāslacion lesquelles
ne sont pas trouueeӡ ne escriptes es liures de romule.
Suit
la table des matières.
Fol. 51 a dernière ligne à 55 b. — Dix-sept fables accompagnées de 8 gravures et suivies de ce
double avis : Cy finissent les fables de esope. Et sensuit
la table des fables de auian.
Fol. 55 b. — Table des fables d’Avianus.
Fol. 55 b à 61 a. — Fables
d’Avianus accompagnées de dix gravures seulement et suivies de ce double
avis : Cy finissent les fables de auian. Et cōmēcent
celles de alfonce.
Fol. 61 a à 68 b. — Treize
fables attribuées à Alphonse, accompagnées chacune d’une gravure et terminées
par ce double avis : Cy finissent les fable (sic) de alfonce. Et cōmencent aucunes autres fables de poge
florentin.
Fol. 68 b à 72 a. — Sept
fables du Pogge avec cinq gravures. Elles sont suivies de cette souscription :
Cy finissent les fables de esope. de auian. et de
alfonce et aucunes ioyeuses de poge florentin.
Le rédacteur du catalogue imprimé de la Grenville library n’a
pas hésité à considérer cette édition comme la plus ancienne. {p. 406}Aussi à la cote qu’il donnait à l’exemplaire 7806 a-t-il
ajouté l’observation suivante : « Of this very early and probably first
edition of the French Æsop, no trace is to be found in any of the
bibliographical books, nor was it known to M. Van Praet. It may probably be
considered as prior to any known edition. »
2º Édition de 1480. §
Cette édition consiste dans un volume in-folio de petit format de 146 feuillets signés de a à s par cahiers, qui, sauf le dernier comprenant dix feuillets, en possèdent chacun huit. Elle a été imprimée en caractères gothiques et est ornée de nombreuses gravures xylographiques qui ressemblent trop à celles des premières éditions allemandes pour n’avoir pas été copiées plus ou moins exactement sur elles.
D’après le rédacteur du Catalogue de la Bibliothèque de Tours, où existe un exemplaire de cette édition sous le nº 3266, elle serait l’originale. Le rédacteur du Catalogue de la Grenville library affirmant au contraire que c’est celle sans date qui a paru la première, il y a là une question à trancher. Mais comme, pour la trancher, il faudrait avoir simultanément entre les mains les exemplaires des deux éditions, je ne l’essaierai pas. Ce qui en somme est à peu près certain, c’est qu’elles sont les deux plus anciennes, et ce qui est probable, c’est qu’elles sont sorties des mêmes presses.
Quoi qu’il en soit, voici l’analyse de l’édition de 1480 :
Fol. a. i. — Titre et portrait d’Ésope en pied.
Fol. a. ii a à e. i b. — Vie d’Ésope.
Fol. e. i b. — Table du livre I de Romulus.
Fol. e. ii a. — Cy commance la préface du premier liure de
esope.
Fol. f. v a. — Cy finist le premier liure de esope et commēce le registre des
fables du second liure de Esope.
Fol. f. v b. — Cy cōmance le proheme du second liure des fables de esope homme
saige et tres ingenieux.
Fol. g. viii b.
— Cy finist le second liure de esope et commence le
registre du tiers liure des fables de Esope.
Fol. h. i a. — Cy commēce le tiers liure des fables subtilles de
Esope.
Fol. j. v b. — Cy finist le tiers liure des subtiles fables de esope et commence
la table du quart liure dicelles.
Fol. k. viii b.
— Cy finist le quart liure des subtiles fables de
esope et cōbien que nulles ne soyent trouueeӡ registréeӡ toutesfois lē a
trouueeӡ plusieurs aultres cōposeeӡ de luy lesq̄lles cy apres
sensuyēnt.
{p. 407}Fol. n. v b. — Cy apres sensuyuent aulcunes fables
de esope selonc la nouuelle translation lesquelles ne sont pas trouuees es
liures de rommule.
À la suite de cette phrase vient la table
et au-dessous de la table commencent les fables.
Fol. o. vi b. — Fin des fables.
Fol. o. vii a. — Cy finissent les fables de esope et sensuyt la table des fables
de auian.
Fol. o. vii b. — La premiere fable de la vielle et du loup.
Fol. q. iv b. — Cy finissent les fables dauian. Et cōmacen les fables de
alfousse (sic).
Fol. s. ii b. — Cy finissent les fables de Alfonse. Et commence aulcunes aultres
fables du Poge florentin.
Les fables d’Alphonse sont
seulement au nombre de treize.
Fol. s. iii a. — La première est de la subtillité de la femme pour decepuoir son
mary.
Les fables du Pogge sont au nombre de sept. La dernière
est intitulée : Du cocq et du regnard et des
chiens.
Fol. s. x b. — Au milieu de
la page on lit cette souscription : Cy finissent les
subtilles fables de esope | translateeӡ | de latin en francois par
reuerend docteur en theologie | frere iulien des augustins de lyon
auecques les fables | Dauiā et d’Alfonse. et aussi aulcūes ioyeuses fables
| de Poge florentin impremees a lyon par Nicolas philli-|pi de bensheym
et Marc reinhardi de Strasbourc lan mil | quatre cens et octante le. xxvi.
iour daust.
3º Édition de 1484. §
La seconde édition datée de la traduction du frère Julien, qui sans doute n’était que la réimpression des précédentes, fut publiée dans le format in-folio par Mathis Huss et Jean Schabeller, à Lyon, en 1484.
Je n’ai rencontré aucun exemplaire de cette édition, et je n’en
parle que d’après Brunet348,
qui la signale comme une « édition rare et fort précieuse imprimée en
caractères d’une forme grossière, à longues lignes, au nombre de 41 dans les
pages qui sont entières, avec des figures en bois nombreuses, mais d’un
dessin informe. Le volume, ajoute-t-il, a des signatures de a—o iiij, par
cahiers de 8 et 6 ff. »
Le volume se termine par la souscription suivante, qui se
trouve au verso du sixième feuillet du cahier o, et qui occupe {p. 408}sept lignes : Cy finissent les subtilles
fables de Esope translatees de | latin en francoys. Par reuerend docteur
en théologie fre|re Julien des augustins de Lyon auecques les fables de
A|uian et de Alfonse et aussi aulcunes ioyeuses fables de | Poge florentin
imprimees a Lyon sur le rosne par mai|stre Mathis hucӡ (sic) et maistre Jean Schabeller. Lan de | grâce mil CCCC. lxxxiiii,
le quinzième iour de may.
4º Édition de 1486. §
L’édition de 1486 fut imprimée dans le format in-4º, à Lyon, par Mathis Huss seul. Cette édition, qui, comme les précédentes, est ornée de gravures sur bois, commence par le titre ou sommaire suivant :
Ci commence le livre des subtilles hystoires et fables de Esope. Que toutes personnes que ce liure vouldront lire, pourront apprendre et entendre par ces fables à eulx bien gouverner. Car chescune fable donne son enseignement. Et aussi d’autres fables de Avian et aussi de Alfonce. Et aulcunes joyeuses fables de poge florentin. Et este a translate de latin en françoys par reverend docteur en theologie frere Julien des Augustins de Lyon.
On le voit, l’ordre des matières est toujours le même. C’est la
vie d’Ésope qui est en tête. Elle est suivie des fables de Romulus précédées
elles-mêmes de la dédicace ainsi traduite : Romuleo filӡ
de Thibère de la cité daticque salut. Esope homme de Grèce, subtil et
ingénieux, enseigne en ses fables que les hommes doyvent garder affin
qu’il démontrât la vie et les coustumes des hommes, il induit les oyseaux,
les arbres et les bestes parlans affinque les hommes congnoissent pourquoi
les fables ont este trouvées esquelles il a escript la malice des maulvais
et largement de improbes. il enseigne aux mallades humilité pour user de
perolles doulces et autres divers exemples icy après déclares. Lesquelles
ie Romule ay translate de grece en latin, lesquelles se tu les litӡ te
aiguiseront ton entendement et te donnront cause de ioye.
La traduction de Macho comprend, à la suite des fables de Romulus, les divers groupes des éditions antérieures. Il y manque cependant trois des fabulæ collectæ : ainsi elle ne reproduit à la suite des 13 fables d’Alphonse que sept facéties du Pogge ; ce qui réduit à vingt fables ce groupe qui, dans l’édition d’Ulm, en renferme vingt-trois.
Le volume se termine par cette souscription :
Cy finissent les subtilles fables de Esope translatées de latin en {p. 409}francoys. Par reverend docteur en theologie frere Julien des Augustins de Lyon avec les fables de Avian et de Alphonse. Et aussi aulcunes ioyeuses fables de Poge florentin. Imprimées à Lyon sur le rosne par maistre Mathis husӡ. L’an de grâce Mil CCCC.L.XXXVI, le neufvième iour de avril.
J’ai trouvé, à la Bibliothèque impériale de Vienne, un exemplaire de cette édition sous la cote 10. G. 1.
5º Édition sans date de P. Mareschal et B. Chaussard. §
Cette édition forme un volume in-4º imprimé en caractères gothiques à longues lignes et composé de 77 feuillets non chiffrés, mais signés de a à k par cahiers de 8 feuillets à l’exception du dernier qui n’en comprend que 5.
Voici le frontispice : Les subtiles fables
| de Esope, avec cel-|les de auiē. de alfonce. et de | poge
florentin.
Au-dessous de ce titre est une vignette dans
laquelle une banderole porte les noms des imprimeurs. Le verso du premier
feuillet est occupé par le portrait d’Ésope en pied. Enfin au verso du dernier
feuillet on lit : Cy finissent les fables de Esope de
Auian de | Alfonce. Et aulcunes ioyeuses de Poge
florentin.
Il existe un exemplaire de cette édition à la Bibliothèque du British Museum sous la cote 638. K. 2.
6º Édition de 1499. §
L’édition in-4º de 1499, qui paraît n’être que la réimpression de la précédente, forme, d’après Brunet349, un volume de 77 ff. non chiffrés, imprimé à longues lignes au nombre de 39 sur les pages pleines, avec des signatures de Aiij à Kiij. Le titre est tiré en rouge et porte au verso le portrait d’Ésope. La vie de ce fabuliste commence sur le recto du deuxième feuillet et finit au bas du recto du dix-neuvième.
L’édition porte le titre suivant : Les
subtilles fables de Esope auec celle de auiē, de Alfonce, et de poge
florentin, auec plusieurs beaulx dits mouraulx.
Elle se
termine par cette souscription : Ci finissent les fables
de Esope, de Auian, de Alfonce. Et aucunes ioyeuses de Poge florentin…
imprimee à Lyon, par Pierre mareschal et Barnabbe Chaussard, lan
Mil CCCC. xcix. le viij iour de nouembre.
7º Édition de 1502. §
L’édition de 1502, qui n’est que la réimpression de celle de
1499, m’a été révélée par le catalogue imprimé {p. 410}de
la bibliothèque de Lyon, publié par M. Delandine350. Elle forme un volume in-4º, orné de
gravures sur bois, dont un exemplaire existe dans cette bibliothèque sous le
nº 4693. Comme les précédentes, elle contient la traduction de Macho
intitulée : Les subtiles fables d’Ésope, avec celles
d’Avien, d’Alphonse et de Poge Florentin
, et la souscription
indique qu’elle a été imprimée à Lyon par Pierre Mareschal et Barnabé
Chaussard et que l’impression en a été achevée le 22 février 1502.
M. Delandine351 en donne la description suivante :
« Cette édition est à longues lignes, sans titres, mais avec des
signatures dont la dernière est H. Les figures en bois sont gravées au
simple trait ; elles sont nombreuses, et paroissent sur presque toutes les
pages. Les dessins en sont curieux, et pour la plupart de trois pouces de
hauteur. »
8º Édition de 1520. §
L’édition de 1520, comme les précédentes, est une réimpression de la traduction de J. Macho. Elle ne contient aucune date. Le verso du dernier feuillet, qui représente la figure d’Ésope, porte bien le nombre xv, dans lequel Panzer a cru voir la date de 1515352 ; mais Brunet plus judicieux affirme qu’il indique seulement le nombre des cahiers, et il assigne à l’édition la date approximative de 1520, qui me paraît pouvoir être adoptée353.
L’édition forme un volume in-4º, qui débute par ce titre :
Esopet en Françoys Auec les Fables de Auian.
Delfonce (sic). Et de Poge florentin
, et
qui se termine par cette souscription : Imprimees a Paris
par la vefue Jehan trepperel et Jehan Jehannot libraire iure en
luniuersite de Paris demourant en rue neufue nostre dame a lenseigne de
lescu de France.
9º Édition de 1526. §
Je me borne à citer, d’après Brunet354, l’édition de 1526, qui a été publiée à Lyon par Claude Nourry et Pierre de Vingle, et qui forme un volume in-4º, imprimé en caractères gothiques et orné de gravures sur bois.
10º Édition de 1531. §
{p. 411}Je n’accorde également qu’une mention sommaire à l’édition de 1531, qui ne doit avoir été que la réimpression des deux éditions de 1499 et de 1502. Elle forme un volume in-fol., qui se compose de 60 feuillets, imprimés en lettres gothiques, non chiffrés, signés de a à h et illustrés de gravures sur bois.
Il commence par ce titre : Les subtilles
fables de Esope auec celles d’Auien et Alfonce. Ensemble auscunes
ioyeusetez de Poge florentin. On les vend à Lyon en la
maison de la veufue de feu Barnabe Chaussard : près nostre-dame de
Confort.
Il se termine par cette souscription : Cy finissent les subtiles fables de Esope et imprimeeӡ à Lyon par
la Veufue de feu Barnabe Chaussard près nostre-dame de Confort. MDXXXI, le
vij iour de Mars.
Il existe un exemplaire de cette édition à la bibliothèque ducale de Wolfenbüttel.
11º Édition sans date d’Alain Lotrian. §
Alain Lotrian s’est contenté de donner une simple réimpression
des éditions antérieures. Graesse prétend qu’il a exercé de 1518 à 1539 ; mais
Brunet affirme que c’est là une erreur, qu’il a été imprimeur de 1530 à 1544,
et que c’est entre ces deux années « qu’il faut chercher la date de son
Esopet355 »
.
Quoi qu’il en soit, sa réimpression forme un volume in-4º de 70 feuillets réimprimés en lettres gothiques, à deux colonnes de 40 lignes, illustrés de gravures sur bois et signés de A à Q.
Le volume commence par ce titre : Esopet
en Françoys auecque les Fables de Auian, de Alphonce et de Poge
florentin
, et se termine par ces mots : Imprime à Paris par Alain Lotrian.
12º Édition de 1532. §
La traduction en prose de J. Macho ne fut pas publiée seulement en France ; témoin l’édition peu connue de 1532, qui est signalée par Brunet356 et dont j’ai trouvé à la Grenville library un exemplaire sous la cote 7703.
Elle forme un volume in-8º, imprimé en caractères gothiques et composé de 128 feuillets numérotés.
Le fol. 1 a porte ce titre : Les subtiles fa|bles de Esope, auec celles de Auien, et
Al|fonse. Et plusieurs aulcunes ioyeusetez | de Poge florentin,
augmentez.
Au-dessous de ce titre se voit le {p. 412}portrait d’Ésope en pied, et au-dessous du portrait on lit ce
qui suit : On les vend à Anuers en lescu de | Basle, par
Gregoire Bonte, en la | rue de Chambre. 1532.
Au fol. 128 a, l’ouvrage se termine par une
souscription ainsi conçue : Cy finissent les subtiles
fables de Eso|pe, de Auien, et de Alfonse. Et aulcunes | ioyeusetez de
Poge Florentin. Impri|mees a Anuers par Jehan le Graphier | pour Gregoire
Bont. Lan mil | ccccc. xxij. Le xxij. iour | Doctobre.
13º Édition de 1561. §
Plus rare encore peut-être est l’édition de 1561, dont
l’existence m’a été révélée par un exemplaire conservé sous la cote 7707 dans
la Grenville library. En tête de cet exemplaire, qui forme un petit volume
in-12 imprimé en caractères de civilité, existe une page blanche sur laquelle
a été écrite au crayon la mention suivante : « Très rare. Voyez
l’Alexandréidos de Gualthier en caractères semblables. »
Le volume n’est pas paginé ; il est signé de a à m. En tête de la première page se trouve un
titre ainsi conçu : Les | fables et la vie | d’Esope
Phrygien, Tra|duites de nouueau en fran|coys selon la véritable
| .
Le milieu de la page est occupé par une vignette, et au
bas on lit : En Anuers | de l’imprimerie d’Amé |
Tauernier, anno M.D. et lxi.
Ainsi que l’annonce le titre, le volume contient une traduction distincte de celle de J. Macho et par suite offre un intérêt tout particulier. Beaucoup de fables n’y ont pas trouvé place. Il n’en renferme que 120, dont les 62 premières se rapportent seules à celles de Romulus.
L’ouvrage se termine par cette souscription finale : Fin des fables d’És|ope. | De l’imprimerie d’A|mable
Tauernier.
14º Édition de 1572. §
Pour terminer la nomenclature des éditions françaises, je n’ai
plus à citer qu’une édition imprimée à Orléans par Eloy Gibier en 1572. Elle
forme un volume in-16, dont le titre encadré est ainsi conçu : Les Fables et la vie d’Esope avec les fables de Avian de
Alphonse et de Poge, traduites en francoys.
L’existence de cette édition m’a été révélée sous le nº 2019 par le catalogue de la librairie Techener, imprimé à Paris en 1869.
1º Édition originale. §
{p. 413}À peine la version française de Julien Macho avait-elle paru en France qu’elle se répandait en Angleterre et y était traduite en langue anglaise par le fameux imprimeur William Caxton. Sa traduction fut imprimée de 1483 à 1484 et publiée en un volume in-folio de petit format, orné de gravures sur bois analogues à celles des éditions antérieures. C’est un des premiers livres qui aient été imprimés en Angleterre en langue anglaise. Il est signé de a à s, et comme les cahiers, sauf le dernier qui ne comprend que six feuillets, sont chacun formés de huit, le nombre total des feuillets est de 142. Ils sont chiffrés.
L’ouvrage commence par ce titre placé en tête du recto du
premier feuillet : Here begynneth the book of the subtyl
hystoryes | and fables of Esope Whiche were translated out | of frensshe
in to englysshe by Wylliam Caxton | at westminstre. In the yere of oure
Lorde M. | CCCC.LXXXIII.
Voici maintenant comment les
matières sont distribuées dans le volume :
Fol. 2 a à 30 a. — Partie préliminaire comprenant la vie d’Ésope.
Fol. 30 b. — Table du livre I des fables de Romulus.
Fol. 31 a à 41 a. — Dédicace de Romulus et livre I.
Fol. 41 b. — Table du livre II des fables de Romulus.
Fol. 42 a à 53 a. — Livre II.
Fol. 53 b. — Table du livre III des fables de Romulus.
Fol. 53 b à 66 a. — Livre III.
Fol. 66 b. — Table du livre IV des fables de Romulus.
Fol. 67 a à 77 a. — Livre IV.
Fol. 77 b à 96 b. — Livre V comprenant les dix-sept fables dites Fabulæ extravagantes, sans table qui les précède.
Fol. 96 b in fine et fol. 97 a initio. — Table des dix-sept fables tirées de la traduction de Ranutio d’Arezzo.
Fol. 97 a à 105 b. — Fables énumérées dans la table précédente.
Fol. 106 a. — Table des vingt-sept fables d’Avianus.
Fol. 106 b à 120 a. — Fables d’Avianus.
Fol. 120 b à 133 b. — Fables d’Alphonse au nombre de treize.
Fol. 134 a et suivants. — Facéties du Pogge.
En tête de chaque fable il y a une gravure sur bois semblable à {p. 414}celle des autres éditions contemporaines et peut-être encore plus grossière.
L’ouvrage est terminé par un épilogue dont Caxton est l’auteur.
À la suite on lit cette souscription : And
here with I fynysshe this book translated by me William Caxton at
Westmynstre in thabbey | And fynysshed the xxvj daye of Marche the yere of
oure lord MCCCC lxxxiiij | And the fyrst yere of the regne of kyng Rychard
the thyrdde.
Je me contente de cette courte analyse, et je renvoie ceux qui
seront curieux de connaître plus complètement l’édition originale de Caxton
aux deux exemplaires que j’en ai trouvés, l’un au British Museum sous la
cote C. 11. c. 17, et l’autre à la bibliothèque Bodléienne sous la
cote Auct. Q. Q. supra 1. 21. L’exemplaire de la Bodléienne, privé
malheureusement des derniers feuillets, est relié avec trois autres volumes du
même format, contenant : 1º les distiques de Caton accompagnés d’une glose en
anglais, 2º la Consolation de Boëce pourvue également d’une glose anglaise,
3º un roman anglais intitulé : The knyght of the
toure.
Quant à ceux qui s’intéresseront à la personne et aux travaux
typographiques du célèbre imprimeur anglais, je leur signale l’ouvrage qui a
été publié en 1863, à Londres, en deux beaux volumes in-4º, par William
Blades, sous ce titre : The life and typography of William
Caxton England’s first printer
, et dont un exemplaire existe
à la bibliothèque de l’Université de Cambridge sous la cote Oo. 3. 49.
2º Réimpressions de l’édition originale. §
La traduction de Caxton paraît avoir été longtemps réimprimée. Je vais faire connaître quelques-unes des réimpressions qui en ont été faites.
A. Réimpression de R. Pynson de 1500. §
Un imprimeur nommé R. Pynson a réimprimé l’édition de Caxton
à Londres vers 1500 dans le format in-fol. Le British Museum en possède un
exemplaire porté au catalogue avec la mention suivante : The fables of Æ., R. F. Auienus, P. Alfunsi, and P. Bracciolini.
Translated into English by W. Caxton.
B. Réimpression de 1550. §
Vers 1550, d’après le Catalogue de la Bibliothèque Bodléienne
qui en possède un exemplaire sous la cote Douce A 40, parut de la traduction
anglaise de Caxton une réimpression partielle comprenant seulement les
fables qui précèdent celles d’Avianus. En voici le frontispice : The Fa-|bles of {p. 415}Esope in
Englys-|she with all his lyfe and fortune, | howe he
was subtil, wyse, and borne | in Grece, nat farre from Troye the |
greate, in a towne named Amoneo, he | was of all othermen most
disfourmed | and euyll shapen. For he had a greate | heed, large visage,
longe iawes, | sharpe eyen, a shorte necke, croke backed, | greate
belly, great legges, large feete. | And yet that Whiche was worse, | he
was dombe and coulde nat | speke : But nat witstandyng | this he hadde a
singuler | Wytte, and was | greatly in-|genious and subtill in
cauillations, and pleasant in wordes, after he | came to his
speche.
Le volume se compose de 151 feuillets numérotés,
non compris le frontispice.
C. Réimpression de H. Wykes de 1570. §
Vers 1570 parut encore à Londres une réimpression en caractères gothiques de la traduction de Caxton formant un volume in-8º non daté, signé de a à r et chiffré par feuillet. Les feuillets chiffrés sont au nombre de 134, et sont suivis de cinq autres non chiffrés, mais signés de r vii à s iii et remplis par la table.
Cette édition, dont un exemplaire existe à la Bibliothèque du
British Museum sous la cote 12 304. aaa.32, est mentionnée au Catalogue dans
les termes suivants : The Fables of Esope in English
with all his life and Fortune… whereunto are added the Fables of Avyan. And also the Fables
of Alfonce, with the Fables of Poge the Florentyne
,
etc.
Au verso du dernier des feuillets consacrés à la table on
lit : Imprinted at London | by Henri Wykes for
John. V. Valey.
D. Réimpression de 1634. §
En 1634, nouvelle réimpression de la traduction de Caxton,
éditée à Londres, dans le format in-12. Elle forme un volume de 214 pages
numérotées, précédées d’un feuillet pour le frontispice et de quatre pour la
table, non numérotés. Au frontispice on lit, formulées dans les mêmes termes
dont l’orthographe est seulement plus moderne, les mêmes observations que
dans l’édition de 1550, auxquelles a été ajouté ce qui suit : whereunto is added the Fables of Auian and also | the Fables
of Alfonce, with the Fables of Poge | the Florentine, very pleasant to
be | reade
; au centre est une gravure ; au bas on lit :
Imprinted at London for Andrew Hebb dwel-|ling at
the Bell in Paules Churchyeard. | 1634.
J’ai rencontré trois exemplaires de cette édition, l’un à la bibliothèque {p. 416}du British Museum sous la cote 636. b. 38, un autre à la Grenville library sous la cote 7760, et un troisième à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote Douce A. 647.
E. Réimpression de 1647. §
En 1647, dans le format in-8º, paraît une nouvelle
réimpression éditée à Londres et exécutée par le même imprimeur que la
précédente. Elle se compose de 182 pages chiffrées, non compris un premier
feuillet pour le frontispice et quatre derniers pour la table. Le British
Museum en possède un exemplaire inscrit au catalogue sous la cote 12305. bb. 14 avec la mention suivante : The
Fables of Esop in English. With all his life and fortune… Whereunto are added the Fables of Auian and also the Fable[s]
of Alphonce, with the Fables of Poge the Florentine
,
etc.
F. Réimpression de 1658. §
En 1658, dans le format in-12, fut exécutée à Londres par le
même imprimeur que les deux précédentes, une nouvelle réimpression,
composée, comme celle de 1647, de 182 pages chiffrées, non compris le
premier feuillet consacré au frontispice et les quatre derniers affectés à
la table. Au catalogue du British Museum, qui, sous la cote E. 1889, en
possède un exemplaire, elle est mentionnée en ces termes : The Fables of E. in English with all his life and fortune… Whereunto is added the Fables of Alphonse with the fables of
Poge the Florentine.
3º Édition de 1692. §
Il me reste à faire mention d’une traduction anglaise, qui,
éditée par sir Roger L’Estrange, n’a pas été une simple réimpression. Elle
forme un volume in-fol. dont voici le frontispice : Fables of | Æsop | and other Eminent mythologists : |
with | Morals and Reflexions | By sir Roger L’Estrange Kt. | London, | Printed for R. Sare, T. Sawbridge, B. Took,
M. Gillyflower, | A. et J. Churchil, and J. Hindmarsh,
1692.
Le volume se compose de 480 pages numérotées, précédées de 7 feuillets, dont le premier porte le portrait en buste de sir Roger l’Estrange, et le septième, celui en pied d’Ésope.
Il existe un exemplaire de l’édition à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote A. 5. 13. Art.
Elle a été plusieurs fois réimprimée.
A. Réimpression de 1694. §
La première réimpression de l’édition L’Estrange a été faite,
comme la première, dans le format in-fol. ; elle se compose de 476 pages
chiffrées, que précèdent six feuillets contenant le frontispice, la préface
et le portrait d’Ésope {p. 417}en pied. Voici ce que
porte le frontispice : Fables | of | Æsop | and other
Eminent | mythologists : | with | Morals and Reflexions. | By sir Roger l’Estrange Kt. | The second
Edition Corrected and Amended. | London. Printed for R. Sare, B. Took,
M. Gillyflower, A. et J. Churchil, J. Hindmarsh, and G. Sawbridge,
1694.
Il existe au British Museum un exemplaire de cette réimpression sous la cote 85. l. 1.
B. Réimpression de 1708. §
L’édition de sir Roger L’Estrange a fait, en 1708, l’objet
d’une quatrième réimpression, qui forme un volume in-8º de 550 pages
numérotées, précédées de six feuillets et suivies d’un dernier non
numérotés. En voici le frontispice : Fables of Æsop and
other Eminent mythologists : with Morals et Reflexions, By sir Roger l’Estrange Kt. The fifth
Edition Corrected. London : Printed for R. Sare, A. and J. Churchil,
D. Brown, T. Goodwin, M. Wotton, J. Nicholson, G. Sawbridge, T. Tooke,
and G. Strahan, 1708.
Il existe à la Bodléienne, sous la cote 291. f. 39, un exemplaire de cette réimpression.
C. Réimpression de 1714. §
En 1714 parut une cinquième réimpression de l’édition
Lestrange sous la forme d’un volume in-8º de 550 pages chiffrées, précédées
de huit premiers feuillets et suivies d’un dernier non chiffrés. Voici ce
qu’on lit au-dessous du titre : The Sixth Edition
corrected. London : Printed for R. Sare, A. and J. Churchill, D. Brown,
T. Goodwin, M. Wotton, J. Nicholson, G. Sawbridge, B. Tooke, and
G. Strahan, 1714.
Il existe au British Museum un exemplaire de cette réimpression sous la cote 12304. cc. 31.
D. Réimpression de 1738. §
En 1738, a été publiée une septième réimpression de l’édition
de sir Roger L’Estrange, dont le frontispice, semblable dans sa partie
supérieure à ceux des éditions précédentes se complète ainsi : The eighth Edition corrected. | London : | Printed for
A. Bettesworth, C. Hitch, | G. Strahan, R. Gosling, B. Ware, |
J. Osborn, | S. Birt, | B. Motte, | C. Ba-|thurst, D. Browne. and
J. Hodge. | M.DCC.XXXVIII.
Il existe à la Bodléienne un exemplaire de cette réimpression sous la cote Douce A. 500.
Je ne connais pas d’exemplaires des deuxième, troisième et sixième réimpressions.
1º Éditions de Gérard Leeu. §
A. Édition in-4º de 1485. §
Traduites en France et en Angleterre, les fables du Romulus
ordinaire le furent bientôt dans les Pays-Bas, et l’honneur en revient au
célèbre Gérard Leeu, qui, dès 1485, c’est-à-dire un an avant sa première
édition latine, en publia à Gouda une édition néerlandaise en caractères
gothiques dans le format in-4º. Il ne faut pas la confondre avec celle qui a
été ensuite, la même année, publiée à Anvers dans le format in-fol., dont
Panzer357 et Hain358 font mention, et
dont je m’occuperai moi-même tout à l’heure. J’ai trouvé à la bibliothèque
du South Kensington Museum un exemplaire de l’édition de Gouda, qui, quoique
incomplet, me permet du moins d’indiquer le titre de l’ouvrage. Le voici :
Esopus leuen ende fabulen, ende die fabulen van
Auienus ende Alfonsius Poeten, die welke seer
ghenoechlijck, end vol profijtelijcke leeringhen sijn, en̄ vermeerdert
lot XXXI. fabulen toē dienoyt gheprint en waren met haren
figueren.
B. Édition in-fol. de 1485. §
Au mois d’octobre 1485, après avoir transporté ses presses de Gouda à Anvers, Gérard Leeu publia une seconde édition en langue flamande des fables de Romulus. Elle forme un volume in-fol. de 112 feuillets, imprimé en caractères gothiques à longues lignes de 40 à la page, non chiffré, mais pourvu de signatures et orné de gravures sur bois.
Il en existe à la bibliothèque royale de La Haye un exemplaire, qui figure sous le nº 593 dans la première partie du catalogue imprimé. J’emprunte à ce catalogue l’analyse qui suit :
Fol. 1 a. — Titulus : Dye hystorien ende fabulen van Esopus | die leerlijck wonderlijck
en̄ zeer ghenoeh (sic) | lijck zijn. |
(Seq. icon xylogr.)
Fol. 1 b. — Vacat.
Fol. 2 a (c. sign. a
ij) : Hier beghint een proper profitelijck boec van die
subtijlheyt der fabulen en̄ | ghenoechlike hystorie ghemaeckt by eenen
mensche die zeer subtijl van gheest | en̄ van sinnen was gheheyten
Esopus
, etc.
{p. 419}Fol. 38 a lin.
16 : Hier eyndet dat eerste boeck van esopus. En̄
be|ghint dat registere der fabulen van dat anderde | boeck.
|
Fol. 38 b. (icon xylogr.).
Fol. 39 a (c. sign. A i) : Die eerste fabule is vā die vorsschen eñ van iupiter Die ander
fabule is vā die |
etc.
Fol. 112 a in calce : Hier eyndē die ghenoechlijcke fabulē vā Esopus en̄ vā meer and’. inde
welc-|ke vele goed’ leeringē in beslotē sijn : elc pynse hē tonthoudē
het sal hē profiterē. | Gheprent in die v̄maerde coopstadt tantwerpē bij
mij Gheraert leeu Anno M | CCCC. en̄ lxxxv. den twalefstē dach in
octobri.
Fol. 112 b. — Vacat.
2º Édition de Henrich Eckert de Homberch de 1498. §
L’édition en langue néerlandaise de Henrich Eckert de Homberch forme un volume in-fol. de 100 feuillets, imprimé en caractères gothiques sur deux colonnes, orné de gravures sur bois inspirées par celles des éditions primitives, mais un peu moins grossièrement exécutées, non paginé et pourvu seulement de signatures de a à r. Les signatures portent sur 17 cahiers composés chacun de six feuillets, sauf l’avant-dernier qui n’en comprend que quatre. Voici l’analyse du contenu.
Fol. 1 a. — Titre : Die
historien ende fabulen van | Esopus die leerlic wonderlick en̄ | seer
ghenoechlick syn.
Au-dessous gravure sur bois représentant
Ésope en pied.
Fol. 1 b. — Page blanche.
Fol. 2 a, col. 1. — Répétition du titre
général, puis titre spécial à la vie d’Ésope ainsi conçu : Hier begint dat leuē en̄ die historie vā | dē voernoemdē Esopus dӡ seere
leerlijc | ghenoechlic en̄ wonderlijck is.
Fol. 2 a à 25 b. — Vie
d’Ésope divisée en 28 épisodes, ornée de 28 gravures et terminée, vers le bas
du fol. 25 b, col. 1, par ces mots : Hier eyndet dat leuen van esopus.
Fol, 25 b, col. 1. — Table du premier livre
des fables de Romulus, précédée de ce titre : Ende beghint
dat register der fabulen | van dierste boeck van esopus
, et
suivie de cet autre : Hier beghint dat prologus oft
prefa-|cye van dyerste boec van esopus.
Fol. 26 a. — Dédicace de Romulus surmontée d’une gravure et commencement du premier livre. Les fables sont toutes précédées d’une gravure qui s’y rapporte.
Fol. 34 a, col. 1. — Hier
eyndet dat yerste boeck vā | esopus. En̄ {p. 420}beghint dat registere der | fabulen van dat andere boeck.
Suit la table des fables du livre II.
Fol. 34 a, col. 2. — Hier
beghint die prefacye van tand’ | boec der fabulē vandē en̄ nota-|bilen
Esopus.
Fol. 34 a à 42 b. — Fables du livre II.
Fol. 42 b, col. 1. — Hier
eyndet dat ander boeck vā Eso-|pus fabulen. En̄ beghint dӡ register vā |
den derden boeck.
Suit la table du livre III qui se termine à
la col. 2.
Fol. 42 b, col 2. — Hier
beghint dat derde boec vā die | subtijle fabulen
vā esopus.
Fol. 42 b, col. 2 à 52 a,
col. 1. — Fables du livre III, terminées par cette souscription : Hier eyndet dӡ derde boeck vā esopus.
Puis vient la
table du livre IV, précédée de ce titre : En̄ begint die
tafel vā dat vierde boec.
Fol. 52 a à 59 b. — Fables
du livre IV, accompagnées seulement de 19 gravures. À la fin on lit :
Hier eyndet dat vierde boec vā die sub-|tijle fabulen
vā Esopus Ende hoe wel | datter niet meersijn gheuondē ghere-|gistreert
Riecce min men heester vele | meer gheuondē van hem gemaect syn | de die
welcke hier na volghen.
Fol. 59 a à 73 b. — Ces feuillets sont occupés par les 17 fables dites fabulæ extravagantes, qui ne sont ornées que de 15 gravures et ne sont ni précédées ni suivies d’aucune table.
Fol. 73 b, col. 2. — Hier
naeuolghē sommige fabulē vā | Esopus ghetranslaleert ende ouerghe | set na
die forme der nieuwer ouersettin-|ghe : die Welcke intboeck van Romule |
niet gheuonden en sijn.
Fol. 73 b, col. 2 à 74 a, col. 1. — Table des 17 fables traduites sur la version latine de Ranutio d’Arezzo.
Fol. 74 a à 80 b. — Texte néerlandais de ces 17 fables.
Fol. 80 b, col 1. — Souscription terminant
ces 17 fables et titre de celles d’Avianus : Hier eynden
die subtijle historien en̄| fabulen vā Esopus. Ende hier begint | na die
tafele der fabulē van Auiaen een | poete also ghehieten.
Fol. 80 b, col. 2 à 81 a, col. 1. — Table des 27 fables d’Avianus.
Fol. 81 a à 89 b. — Fables
d’Avianus, ornées de 27 gravures et terminées par la souscription et le titre
qui suivent : Hier eynden die fabulen en̄ historien | vā
auiaen. En beginnē die subtijle fa-|bulen vā alfonsie.
Fol. 89 b à 99 a. — Fables
dites fabulæ collectæ, réduites au nombre {p. 421}de 14, ornées de 14 gravures et terminées par cette
intéressante souscription finale : Hier eyndē die subtijle
en̄ genoechli-|ke fabulen van Esopus en̄ vā meer an-|der. in die Welke
vele goed’ lerīge beslo-|ten sijn : elc pijnse hē tonthoudē hetsal-|hem
profiteren. Ghepient te delf. Bij | mi Henrich eckert van Homberch. An-|no
dn̄i. MCCCC. en̄ xcviij. den xxvij. | dach inden april.
Fol. 99 b à 100 b. — Pages blanches.
J’ai trouvé deux exemplaires de cette rare édition, l’un au British Museum sons la cote B. 20 e, l’autre à la Bibliothèque publique de Gand sous la cote Rés. 351.
Après leur première apparition en Allemagne, les fables de Romulus ne tardèrent pas à pénétrer en Espagne où elles furent immédiatement traduites en langue espagnole. Leur traduction fut, au xve siècle, l’objet de deux éditions que Panzer à tort a confondues en une seule359.
1º Édition de 1489. §
Des éditions du xve siècle celle de 1489 est la plus ancienne. Elle forme un volume in-folio, dont les feuillets sont signés et paginés.
Les signatures sont les suivantes : a, b, c, d, e, f, g, hh, h, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K.
La pagination, si on ne la vérifiait pas, ferait croire à l’existence de 133 feuillets ; mais il n’y en a en réalité que 120, dont le dernier est blanc. En effet, les cahiers a, A, et K comprennent chacun huit feuillets, tandis que les autres n’en ont que six.
Fol. 1 a. — Esta es la
vida del Ysopet con | sus fabulas hystoriadas.
Fol. 1 b. — Portrait d’Ésope, surmonté du mot Esopus, et orné, au-dessous, d’une gravure qui représente deux anges portant un écu vide d’ornements.
Fol. 2 a. — Comiença la
vidadel Ysopet.
Fol. 2 a à 25 b (a 2 rº à d 5 vº). — La vie d’Ésope est
illustrée de vingt-huit gravures sur bois pareilles à celles des premières
éditions allemandes. Elle se termine par cette souscription : Aqui se acaba la vida de ysopo.
{p. 422}Fol. 25 b (d 5 vº). — Au-dessous de la souscription qui vient d’être indiquée est une gravure représentant Ésope assis qui écrit et deux autres personnages.
Plus bas se trouve la dédicace de Romulus à son fils précédée
de ce titre : Aqui comiença el prefacio et prologo | del
primero libro del ysopo.
Fol. 26 a (d 6 rº).
— Aqui se acaba el prologo prosaico : et comiença la
de|claracion de otro prologo metrico.
À la suite de la traduction de ce prologue métrique qui est
celui de Walther, on lit : Comiēça el primero libro de las
fabulas del Ysopo | La p’mera fabula d’l gallo et d’la margarita o
iaspid’.
Puis vient la gravure de la première fable.
Fol. 26 a (d 6 rº) à 34 b (f 2 vº). — Texte espagnol du livre I des fables de Romulus.
Fol. 34 b (f 2 vº).
— Souscription du livre I : Aqui se acaba el primero
libro.
Elle est immédiatement suivie de ce titre du
livre II : Aqui comiença el segundo libro de las fabulas |
de ysopo clarissimo et ingenioso fabulador. | El
prohemio.
Fol. 34 b (f 2 vº) à 43 a (g 5 rº). — Texte espagnol du livre II des
fables de Romulus, qui est terminé par cette souscription : Aqui se acaba el segundo libro.
Fol. 43 a (g 5 rº).
— Commencement du livre II annoncé par ce titre : Comiença
el libro tercero d’ysopo varon muy fabio y de clarissimo
ingenio.
Fol. 43 a (g. 5 rº) à 52
b (h 2vº). — Texte espagnol du livre III
terminé par cette souscription : Aqui se acaba el tercero
libro del ysopo.
Fol. 52 b (h 2 vº).
— Commencement du livre IV des fables de Romulus indiqué en ces termes :
Aqui comiença el quarto libro del
ysopo.
Fol. 52 b (h 2 vº) à 61 b (A 5 vº). — Texte espagnol du livre IV terminé par cette
souscription : Aqui se acaba el. iiij. libro del Isopo muy
ingenioso et claro fabulador et non se fallan mas libros suyos empero
muchas fabulas suyas son falladas. grand numero delas quales se sigue
enesta forma seguiēte.
Fol. 61 b (A 5 vº). — Titre des Fabulæ extravagantes : Las fabulas extrauagantes del ysopo
comiēçā enesta orden.
Fol. 61 b (A 5 vº) à 77 a
(D 1 rº). — Texte espagnol des Fabulæ extravagantes, à la
fin desquelles on lit : A qui se acaban las fabulas {p. 423}extrauagātes antiguas | del ysopo. no se si son atribuydas a el
verdaderamente o en fingida-|mente.
Fol. 77 a (D 1 rº). — Titre des fables
provenant de la traduction latine de Ranutio d’Arezzo : Siguen se algunas fabulas del ysopo dela | trōslacion nueua de
remicio.
Fol. 77 a (D 1 rº) à 84 b
(E 2 vº). — Texte espagnol des fables à la fin desquelles, vers le milieu de
la dernière page, on lit cet avis : A qui se acaban las
fabulas del esopo sacadas de re|micio componedor dellas dela nueua
translacion delas fabulas grie-|gas las quales non se contienen en los
quatro libros ditados de ro|mulo.
Fol. 84 b (E 2 vº). — Titre des fables
d’Avianus mis à la suite de l’avis précédent : Aqui
comiençan las fabulas de auiano.
Fol. 84 b (E 2 vº) à 98 a
(G 4 rº). — Texte espagnol des fables d’Avianus closes par cette
souscription : Aqui se acaban las fabulas de
Auiano.
Fol. 98 a (G 4 rº). — Titre des Fabulæ
collectæ : Aqui comiençan las fabulas collectas d’alfonso
et | de pogio et de otros en la forma et orden seguiente.
Fol. 98 a (G 4 rº) à 116 b
(K 4 vº). — Texte espagnol des Fabulæ collectæ, qui, seulement au nombre
de 22, sont arrêtées au bas de la dernière page par cette mention : Aqui se acaba el libro del ysopete ystoriado aplica-|das las
fabulas en fin junto con el principio a moralidad prouecho | sa ala
correcion et auisamiēto de la vida humana. Conlas fabulas de | remisio. de
Auiano. doligamo. de alfonso et pogio. cō otras extrava|gantes, el qual
fue sacado de latin en romance. et emplentado enla | muy noble et leal
cibdad de zaragoza. por Iohan hurus alaman de | costancia, enel āno del
sen̄or de mill. cccc lxxxix.
Fol. 117 a (K 5 rº). — Titre du registre et
de la table : Acqui comiença el registro et tabla delas
fabulas et | exemplos del libro del esopo muy excla rescido
fabulador.
Fol. 117 a (K 5 rº) à 119 a
(K 7 rº). — Registre et table terminés par ces mots : Aqui
se acaba la tabula
, au-dessous desquels on lit : Deo gracias.
Fol. 119 b. (K 7 vº). — Gravure représentant
un guerrier désigné par les mots Alexander
magnus.
Fol. 120 (K 8). — Feuillet blanc.
Gomme dans les éditions allemandes du même temps, toutes les fables sont ornées de gravures sur bois.
{p. 424}Cette édition est citée par Hain, dans son Repertorium bibliographicum, t. I, p. 41, col. 1, nº 358.
J’en ai donné l’analyse qui précède d’après un exemplaire, qui, sous la cote I. Z. 13, existe à la Bibliothèque de l’Escurial.
2º Édition de 1496. §
La seconde édition espagnole a été achevée d’imprimer à Burgos, le 22 août 1496. Je vais en donner, d’après Hain360, une courte analyse :
Fol. 1 a. — Titre encadré d’ornements
xylographiques et conçu en ces termes : Libro del ysopo
famoso fabulador historiado in romace.
Fol. 1 b. — Portrait d’Ésope.
Fol. 99 a. — Souscription ainsi formulée :
Aqui se acaba el libro del ysopete ystoriado aplicadas
las fabulas en fin junto cō el principio a moralidad prouechosa a la
correciō et auisamiēto de la vida humana : cō las fabulas de remicio : de
auiano : doligamo de alfonso pagio : cō otras extrauagantes et an̄adidas.
El qual fue emprētada la presente obra por Fadrique aleman de Basilea : en
la muy noble et leal cibdad de Bourgos. An̄o del nascimiēto de nuestro
sen̄or jesu xp̄o mill CCCC, xcvj. a. xxij. de agosto.
Ensuite viennent cinq pages consacrées à la table des matières et un dernier feuillet portant les emblèmes du typographe. Le tout forme un volume in-fol. gothique, dont les feuillets sont chiffrés.
3º Édition de 1526. §
Cette édition forme un volume in-fol. de petite dimension, comprenant 80 feuillets signés de a à k et néanmoins numérotés.
Le frontispice dans sa moitié supérieure est orné de quatre
gravures sur bois, au-dessous desquelles on lit dans un encadrement :
Libro del sabio et clarissi-|mo fabulador ysopo
hy-|storiado et annotado. | 1526.
Au bas du recto du feuillet 80 et dernier est cette
souscription : Acabāse las fabulas de Ysopo cor-|regidas y
emendadas, et nuevamente annotadas por los margines. | Impressas en la muy
noble ciudad de Seuilla por Jacobo crom-|berger aleman. An̄o. de mil. d.
et. xxvj. a. x. dias de Abril.
Il existe un exemplaire de cette édition à la Bibliothèque du British Museum sous la cote 637. K. 2.
4º Édition de 1546. §
J’ai de cette édition publiée à Anvers rencontré deux exemplaires, l’un à la Bibliothèque publique de Carpentras sous la cote 524 et l’autre à la Bodléienne sous la cote 90. C. 31. Cette édition, qui est du format in-12 allongé, consiste dans un petit volume signé, qui se compose de 211 feuillets chiffrés, suivis de 5 autres sans numérotage consacrés à la table des matières.
Fol. 1 a. — Las fabulas
| del clarissimo | y | sabio fabulador Ysopo y
nueua-|mente emendadas. | A las quales agora se an̄adieron al-|gunas
nueuas muy graciosas, hasta | aqui nunca vistas ni imprimidas. | Con su
Vida, maneras, costūbres | y muerte : y mas vna Tabla de | lo que en este
libro va | declarado. | M. D. XLVI.
Au-dessous de ce titre
est une vignette de forme circulaire, dans l’encadrement de laquelle figure la
maxime suivante : Res parva crescunt concordia. Au bas de
la page on lit : Vendense en Enueres por Juan | Steelsio,
enel escudo de | Borgon̄a.
Fol. 2 a. — Prologo.
Fol. 5 b. — La vida de
Ysopo.
Fol. 50 a. — Aqui se
acaba la vida de Ysopo.
Fol. 50 b. — Aqui
comiença el prefacioy prologo del primero libro de Ysopo.
Fol. 51 b. — Comiença el
primero librode las fabulas de Ysopo.
Fol. 63 b. — Aqui se
acaba el primero libro.Aqvi comiença el segvndo librode las fabulas de Ysopo clarissimo et ingenioso
fabulador.
Fol. 74 b. — Aqui se
acaba el segundo libro de Ysopo.
Fol. 75 a. — Comiença el
libro tercerodel Ysopo, varon muy sabio y de clarissimo
ingenio.
Fol. 89 a. — Aqui se
acaba el tercero libro de Ysopo.Aqvi comiença el qvarto libro de Ysopo.
Fol. 99 b. — Las fabvlas
extravagantes del Ysopo comiençan enesta orden.
Fol. 129 b. — Aqui se
acabā las fabulas extrauagantes antiguas del Ysopo.
Fol. 130 a. — Las nve.
de Rem. sigvese algvnas fabvlas del Ysopo de la traducion nueua de Rimicio.
Fol. 140 b. — Aqui se
acabā las fabulas de Ysopo, facadas de Remigio…Aqvi comiençan las fabvlas de auiano.
Fol. 161 b. — Aqui se
acaban las fabulas de Auiano.
{p. 426}Fol. 162 a.
— Aqui comiençan las fabulas collectas de Alfonso, de
Pogio et de otros en la forma siguiente.
Fol. 211 a. — Acabanse las fabulas de Ysopo corregidas y anotadas.Siguese la Tabla de las fabulas que se contienen en este
libro.
La table qui commence au fol. 211 b occupe en outre les cinq feuillets suivants.
5º Édition de 1547. §
Cette édition forme un volume in-fol. de 71 feuillets chiffrés et d’un dernier non chiffré.
Fol. 1 a. — Six gravures xylographiques sur
deux colonnes se rapportant à la vie d’Ésope avec ce titre placé au-dessous :
Libro del Sabio y clarissimo fabula-|dor Ysopo :
hystoriado y annotado. | Impresso
an̄o. MD. xlvij.
Fol. 1 b à 16 b.
— La vida de Ysopo.
Fol. 17 a à 36 a. — Fables de Romulus.
Fol. 36 a à 46 a.
— Las Fabulas extrauagantes del
Ysopo.
Fol. 46 a à 50 a.
— Las nueuas de Rimicio.
Fol. 50 a à 58 a.
— Las fabulas de Auiano.
Fol. 58 a à 71 b.
— Las fabulas collectas.
À la fin on lit : Acabanse las fabulas de
Ysopo corregidas y emen-|dadas por las margines. fueron impressas en la
imperial | ciudad de Toledo en la Casa de Juan de Ayala. Acabaron se | a
treynta dias del mes de Marco, An̄o de mil | et quinietos y quarenta y
siete an̄os.
6º Édition de 1553. §
L’édition de 1547 ne tarda pas à être réimprimée dans le même format et avec le même nombre de feuillets pourvus de signatures, qui vont de a à i. Les cahiers étant au nombre de 9 et se composant chacun de 8 feuillets, il s’ensuit que le nombre des feuillets est de 72. Cette réimpression est ornée de gravures qui n’occupent que les petits espaces ordinairement réservés aux lettres initiales. Celles qui illustrent la vie d’Ésope sont au nombre de 29.
Fol. 1 a (a 1 rº).
— Frontispice dans l’encadrement duquel sont six gravures sur deux colonnes.
Au-dessous on lit : Libro de sabio y clarissimo
fabula-|dor ysopo : hystoriado y annotado. | Impresso
an̄o. M. D. liii.
Fol. 1 b (a 1 vº).
— Prologo. Comiença la vida de Ysopo
,
etc.
Fol. 1 b (a 1 vº) à 16 b (b 8 vº). — Vie d’Ésope, terminée par cette souscription :
Aqui se acaba la vida de Ysopo.
Fol. 17 a (c 1 rº) à 22 a (c 6 rº). — Premier livre de Romulus.
{p. 427}Fol. 22 a (c 6 rº) à 26 b (d 2 vº). — Deuxième livre de Romulus.
Fol. 26 b (d 2 vº) à 32 a (d 8 rº). — Troisième livre de Romulus.
Fol. 32 a (d 8 rº) à 36 a (e 4 rº). — Quatrième livre de Romulus.
Fol. 36 a (e 4 rº) à 46 a (f 6 rº). — Las
fabulas extravagantes.
Fol. 46 a (f 6 rº) à 50 a (g 2 rº). — Las nuevas
de Remicio.
Fol. 50 a (g 2 rº) à 58 a (h 2 rº). — Las
fabulas de Aviano.
Fol. 58 a (h 2 rº) à 71 b (i 7 vº). — Las
fabulas collectas.
Tandis que la première édition espagnole
ne renferme que 22 de ces fables dont la dernière est intitulée : Del patre y del hijo que yvā a vēder el asno
, il en
existe 26 dans l’édition de 1533 ; aux 22 premières en effet ont été ajoutées
les quatre suivantes : Fa. xxiij. fabula de la dueña viuda
y del ypocrita
; Fa. xxiiij : dela muger
que acusaua a su marido
; Fa. xxv.
d’algunos mōstruos qū fueron eneste tiēpo
;
Fa. xxvj. Fabula de la diosa venus y de su
gallina.
Ces fables sont, au verso du feuillet 71, suivies des mots :
Deo gracias
, au-dessous desquels on lit
cette souscription : Acabāse las fabulas de ysopo
corregidas y emen-|dadas y annotadas por las margines. fueron impressae en
la imperial | ciudad de Toledo en casa de Juan de Ayala. Acabaronse | enel
mes de Diziembre. An̄o de mil et quinientos | y cinquenta y tres
an̄os.
Fol. 72 (i 8). — Feuillet blanc.
Il existe, à la Bibliothèque de l’Escurial, un exemplaire de cette édition sous la cote jv. N. 3.
7º Édition de 1562. §
L’édition publiée en 1562 n’a été, pour ainsi dire, qu’une
réimpression des deux précédentes : même format, même nombre de feuillets
chiffrés, mêmes gravures au recto du premier. Au-dessous de ces gravures le
titre se formule ainsi : Libro del Sabio y clarissimo
fa-|bulador Ysopo : hystoriado y ano-|tado. Impresso an̄o M. D. lxij.
Au bas du dernier
feuillet on lit : Impresso en Seuilla en casa de
Seba-|stian Trugillo impressor de libros. Iūto alas casas de Pedro del
Pineda. | Acabose a veyntey ocho dias del mes de Marco. An̄o de | mil y
quinientos y sessentay dos.
Un exemplaire de cette édition se trouve sous la cote 637. K. 5, au catalogue de la bibliothèque du British Museum.
8º Édition de 1607. §
Le principal mérite de l’édition de 1607 est d’avoir été imprimée par le fameux Plantin. Elle forme un volume in-12 de 384 pages.
Page 1. Frontispice. La vida | y | fabvlas
| del | Esopo : | A las {p. 428}quales se an̄adieron
algunas muy | graciosas de Auieno, y de otros sa-|bios
fabuladores.
Au-dessous de ce titre et au centre de la page est
une vignette représentant entre autres choses une banderole sur laquelle se
lit cette devise de Plantin : Labore et
Constantia.
Plus bas : En la oficina
Plantiniana | 1607.
Page 3. Prologo | Al
Lector.
Page 8. Lo que en este Libro se contienē,
es los seguiente : La vida del Esopo. Las Fabulas del Esopo y de otros.
Las Fabulas extrauagantes. Las Fabulas del Esopo de la traducion de
Remicio. Las Fabulas de Auieno. Las Fabulas collectas de muchos
Autores.
Page 9. La vida | de |
Esopo.
Page 86. A qui se acaba la vida de
Esopo.
Page 87. Las Fabulas de Esopo.
Ces fables, quoiqu’elles ne soient que la traduction de celles de Romulus, ne
sont pas précédées de sa dédicace ni divisées en quatre livres. Elles sont au
nombre de 80.
Page 187. A qui se acaban las Fabulas de
Esopo.
Page 188. Las | Fabulas | extrauagantes
comiençan en esta orden.
Page 242. A qui acaban las Fabulas
extrauagantes.
Page 243. Algunas | Fabulas | del Esopo, |
de la traducion de Remicio.
Page 268. Las | Fabulas | de |
Auieno.
Page 308. Las | Fabulas | collectas | de
muchos autores.
Le nombre des fables est absolument identique
à celui de l’édition d’Ulm.
Page 384. Fin.
Des exemplaires de l’édition de Plantin existent à la bibliothèque publique de Grenoble sous la cote 2504 F, à celle d’Avignon sous la cote 2061. 1488, à la Stads bibliothek d’Anvers sous la cote 9907, et à la Bodléienne sous la cote Douce A. 52.
9º Édition de 1657. §
L’édition de 1657 forme un volume in-16. de 176 feuillets, non compris ceux, au nombre de 8, consacrés à la table. En voici le frontispice littéralement transcrit :
Libro de la Vida, y fabulas del Sabio, y clarissimo fabulador Isopo. Con las Fabulas y Sentencias de diversos, y graves autores. Agora de nuevo corregido, y enmendado, con las anotaciones en las margenes. Impresso con licencia de los Señores del Consejo Real de su Magestad. Año 1657. En Madrid : En la Imprenza Real. A costa de Antonio Rodriguez de Ribero, Mercadee de Libros. Vendese en Palacio, y en su casa en la calle de Toledo.
{p. 429}L’édition ne contient pas le texte latin des fables et n’en offre que la traduction espagnole. J’ajoute que la dernière série de fables, intitulée : Fabulas collectas, n’en comprend que 21.
J’ai trouvé sous la cote 15915 un exemplaire de cette édition dans la bibliothèque publique de Bordeaux.
10º Édition de 1683. §
L’édition de 1683 forme un volume in-8, qui contient la
traduction espagnole sans le texte latin. Voici le frontispice : Favles de Isop filosof moral Preclarissim, y de altres famosos
Autors. Corrigides de non, y historiades ab major claredat que fins vuy
se sian vistas. Preceheix la vida de Ysop dividida en capitols, y
representada en Estampas. La declaraciò, y sententia de las faules se
troba a la fi de cada una dellas. — Barcelona, Joan Jolis,
1683.
11º Édition sans date. §
C’est ici le lieu de citer une édition sans date, qui a été, comme celle de Plantin, imprimée à Anvers, et dont un exemplaire existe à la bibliothèque publique de Versailles sous la cote E 713 d. Elle forme un petit volume in-8º de 274 feuillets dont voici le contenu :
Fol. 1 a, consacré au frontispice :
La vida y fabu-|las del clarissimo y sabio |
fabulador Ysopo, nueuamente | emendadas. | Exemplario, enel qual se
contienen muy | buenas doctrinas, debaxo de | graciosas fabulas. | En Anuers | En casa de Juan Steelsio.
Fol. 1 b. — Consacré à la table des matières.
Fol. 2 a. — Prologo.
Carta del Impressor al Lector.
Fol. 4 a. — La vida de
Ysopo.
Fol. 32 b. — Aqui se
acaba la vida de Ysopo.
Fol. 33 a. — Aqui
comiençan | las fabulas de Ysopo.
Il y a 80 fables sans
dédicace et avec une seule série de numéros.
Fol. 67 b. — Las fabulas
extra-|uagantes del Ysopo comiençan | enesta orden.
Fol. 89 b. — Las nueuas |
siguese algunas fabu-|las del Ysopo de la traducion nue-|ua de
Remicio.
Fol. 97 a. — Aqui
comiençan las | fabulas de Auiano.
Fol. 112 a. — Aqui
comiençan las fa-|bulas collectas de muchos autores | en la forma
siguiente.
Fol. 140 b. — Acabanse
las fabulas de Ysopo, y de otros | autores, corregidas y
anotadas.
Fol. 141 a. — Libro
llamado Exem-|plario, enel qual se contie-|nen {p. 430}muy buenas doctrinas | y graues sentencias, deba-|xo de graciosas
fabulas, | contra los engaños y | peligros deste | mundo.
Fol. 270 b. — Finis.
Fol. 271 a. — La tabla de
las | fabulas del Ysopo.
Fol. 274 b. — Fin. | Fue
impresso en Anuers por | Juan Lacio.
12º Édition de 1728. §
Au haut du frontispice de l’édition de 1728, on lit :
Libro de la vida, y fabulas de el Sabio, y clarissimo
fabulador. Isopo. Con las Fabulas, sentencias de diversos, y graves
autores. Agora de nuevo corregido, y emendado, con las anotaciones en
les margenes…
Au bas du frontispice : Año 1728, Con Licencia. En Madrid : A iosta de D. Pedro Joseph Alonso de
Padilla, se hallara en su Imprenta, y Libreria, vive en la Calle de Santo
Thomas, junto al Contraste.
À la fin du volume : Laus deo.
Cette édition, dont un exemplaire se
trouve à la bibliothèque du British Museum, n’est qu’une réimpression des
précédentes.
13º Éditions, sans date, du commencement du XIXe siècle. §
A. — Fabulas | de la vida del sabio y
clarissimo | fabulador | isopo, | con las fabulas, y sentencias | de
diversos, y graves autores : Ahora de nue-|vo corregido
y enmendato, con las Anotaciones. — Madrid : | En la imprenta de Don
Antonio Espinosa. | A costa de la Real compania de Impresores, | y
Libre-|ros del Reyno.
À la fin du volume on lit : Laus
deo.
Cette édition est dans le format in-8, et, en outre des feuillets paginés de 1 à 352, en comprend douze autres qui, les précédant, sont consacrés au frontispice, à la table et au prologue.
La traduction que cette édition renferme a le mérite d’être complète. Rien de ce qui existe dans l’édition de Zeiner n’a été oublié, et l’on y trouve notamment la dédicace à Tiberinus qui dans l’édition de Plantin avait été omise.
Il en existe un exemplaire sous la cote 12304 a 27 à la bibliothèque du British Museum, où le catalogue lui attribue la date de 1802.
B. — Fabulas | De Isopo. | filsofo moral |
preclarissimo, | y de otros | famosos autores, | corregidas de nuevo, Y | referidas con el mejor estilo, que hasta | hoy
se hayan visto. | Precede la vida de isopo, dividida | en Capitulos : y en
Laminas re-|presentada. | La declaracion, y sentencia de las fabulas, se |
hallara a la fin de cada una de ellas. | Con licencia, Barcelona : Por
Matheo Barceló {p. 431}Im-|presor, en la Puerta del
Angel.
Cette édition consiste dans un vol. in-8, de 373 pages
numérotées, précédées de 5 feuillets et suivies de 9 pages de table non
numérotées.
Il en existe un exemplaire à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote GP. 75.
C. — Faules | de Isop | filosof moral |
pleclarissim | y de altres famosos autors | corregides
de nou, e | historiades ab major claredat, que | fins vuy se sien vistes.
| Preceheix la Vida de Isop, | dividida en Capitols, y en Estampas |
representada. | La declaracio, y sentencia de les Faules, se | troba à la
fi de cada una dellas. | Barcelona : En casa Matheu Barceló
Estamper.
Cette édition consiste dans un volume in-8 de
343 pages numérotées, précédées de 4 feuillets et suivies de 9 pages de table,
non numérotés.
Il en existe un exemplaire à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote GP. 394.
14º Éditions de 1815. §
A. — Fabulas | de Esopo | filosofo moral ;
| y de otros famosos autores : | corregidas de nuevo. |
Barcelona. | en la imprenta de sierra y marti, | plaza de S. Jayme. |
año 1815. | Con licencias necesarias.
Cette édition consiste
dans un volume in-8 de 364 pages numérotées, suivies de 4 pages de table non
numérotées.
Il en existe un exemplaire à la Bibliothèque Bodléienne sous la cote 291. g. 55.
B. — Fabulas de la vida del sabio y
clarissimo fabulador Ysopo, con las fabulas de diversos y graves
autores ; ahora de nuevo corregido y enmendado, con las
anotationes. Madrid, imp. de Lopez y herm. lib. de la Publicidad,
1815.
Cette édition forme un volume in-8º illustré de gravures sur
bois361.
15º Édition de 1818. §
Fabulas de la vida del sabio y clarissimo
fabulador Ysopo ; con las fabulas y sentencias de diversos y graves
autores ; ahora de nuevo corregido y enmendado con las
anotaciones. Madrid, imp. de la V. de Barco Lopez.
Cette
édition forme un volume in-8º, composé de xxiv-352 pages et orné de
gravures362.
Chapitre II.
Dérivés en prose du Romulus
ordinaire. §
Première collection.
Romulus de Vincent de
Beauvais. §
Si je commence mon étude par les deux Romulus de Vincent de Beauvais, c’est d’abord parce que, compris dans les plus grands ouvrages de cet illustre encyclopédiste, ils en ont partagé la fortune et ont obtenu une notoriété plus grande que les autres dérivés du Romulus ordinaire, et c’est ensuite parce que, tout en différant assez de leur modèle pour n’en être pas une simple copie et pour constituer un véritable dérivé, elles l’ont suivi d’aussi près que les autres collections dont j’aurai ensuite à m’occuper.
Notice sur Vincent de Beauvais et sur ses œuvres. §
Qu’on me permette de dire brièvement quelques mots de Vincent de Beauvais et de ses œuvres.
Bourguignon de naissance, il est quelquefois appelé Vincent de Bourgogne. Sous le règne de Philippe-Auguste, il quitta son pays natal, pour venir étudier les lettres à Paris, où il entra dans l’ordre {p. 433}des dominicains. Son surnom de Bellovacensis lui vint non pas de ce que, comme beaucoup l’ont supposé, il aurait été évêque de Beauvais, mais de ce qu’il passa sa vie dans le couvent dominicain de cette ville. Il arriva vers 1244 à l’apogée de sa réputation, et mourut, suivant les uns, en 1256, suivant les autres, en 1264, et, suivant quelques-uns, en 1270. Lessing conduit même son existence jusqu’à l’année 1289.
Son œuvre immense, qui pourrait s’appeler l’Encyclopédie du xiiie siècle, comprend quatre parties intitulées, la première : Speculum historiale, la deuxième : Speculum naturale, la troisième : Speculum morale, la quatrième : Speculum doctrinale.
Le Speculum historiale se divise en trente-deux livres, qui embrassent l’histoire universelle depuis l’origine du monde jusqu’à l’année 1244.
Le Speculum naturale est divisé par les uns en trente-trois livres et par les autres en trente-deux seulement. Comme son titre l’indique, il traite des sciences naturelles, telles que la zoologie et la botanique. L’auteur paraît l’avoir écrit vers 1250 ; cependant Vossius lui assigne la même date qu’au précédent.
Le Speculum morale ne se compose que de trois livres qui contiennent des dissertations sur les mouvements de l’âme, sur les vices et sur les vertus. Mais Bellarmin363, dans le catalogue où il énumère les écrits de saint Thomas d’Aquin, exprime des doutes sur la question de savoir si le Speculum morale n’est pas l’œuvre d’un écrivain plus récent, et Echard, dans sa dissertation sur les écrits de Vincent de Beauvais, lui en refuse nettement la paternité.
Le Speculum doctrinale comprend dix-huit livres. C’est par erreur que quelques bibliographes ne lui en attribuent que dix-sept. C’est un vaste répertoire qui traite très explicitement de questions littéraires et artistiques de tout genre, en commençant par la Grammaire et en finissant par la Théologie.
Ce quadruple miroir avait été demandé à Vincent de Beauvais par un roi de France, qui lui avait fourni les fonds nécessaires. Certains auteurs disent que ce fut Philippe de Valois ; mais l’époque {p. 434}où il fut écrit, démontre que c’est là une erreur et que ce roi fut saint Louis, qui d’ailleurs avait fait de Vincent de Beauvais le précepteur de ses enfants. C’est pour leur instruction que Vincent de Beauvais composa son œuvre qu’il adressa à leur mère, la reine Marguerite.
Mais je m’en tiens à ces généralités, et je renvoie ceux qui voudraient avoir de plus longs détails sur Vincent de Beauvais et sur son œuvre à l’appréciation qu’en ont faite Phil. Labbé, Jac. Echard, Morhof et Brucker et surtout Daunou.
Je ne m’arrête qu’à ce qui touche les fables de Romulus. Elles figurent au nombre de 29 dans le livre IV du Miroir historial, où on les rencontre du chap. 2 au chap. 8. Ce sont les fables 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17 du livre I, les fables 3, 5, 9, 16, 18, 21 du livre II, les fables 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18 du livre III, et les fables 1, 8, 10, 12, 19 du livre IV. De ces 29 fables de Romulus dix-sept ont leur origine dans la traduction en prose des fables connues de Phèdre, savoir : dans les fables 1, 4, 5, 8, 13, 21, 23, 3, 24, 12, 11 du livre I, 7 du livre III, 23, 24, 1, 3 du livre IV a et 1 de l’appendice.
Dans le Speculum doctrinale, Vincent de Beauvais, non pas, comme on l’a prétendu, plus correctement à l’aide d’un autre manuscrit, mais avec les mêmes variantes imaginées par lui, reproduisit ensuite les 29 fables de Romulus qu’il avait déjà insérées dans son premier Speculum ; on les trouve dans le livre IV, où elles vont du chap. 114 au chap. 123.
Dans son édition de 1806364, Schwabe semble dire que les fables de Romulus n’ont été transcrites par Vincent de Beauvais que dans son Miroir doctrinal. Mais les notes dont il a, dans la même édition, pourvu le texte de Romulus, montrent qu’il a eu connaissance des deux transcriptions. Toutefois il s’est trompé, en ajoutant que, dans le Miroir doctrinal, les fables de Romulus occupent les chap. 114 à 124 du livre IV ; car elles ne comprennent pas le chapitre 124.
Pour qu’on voie plus aisément quelles sont les fables extraites du Romulus ordinaire par Vincent de Beauvais et dans quel ordre nous les montre chacun des deux Miroirs historial et doctrinal, je {p. 435}vais établir ici un tableau synoptique qui vaudra mieux que des explications même clairement données :
| Romulus ordinaire. | Miroir historial. | Miroir doctrinal. | ||
| I, | 2. | Le Loup et l’Agneau. | 1. | 1. |
| I, | 3. | Le Rat et la Grenouille. | 2. | 2. |
| I, | 5. | Le Chien et l’Ombre. | 3. | 4. |
| I, | 6. | La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | 4. | 7. |
| I, | 8. | Le Loup et la Grue. | 5. | 8. |
| I, | 14. | Le Corbeau et le Renard. | 6. | 11. |
| I, | 15. | Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | 7. | 12. |
| I, | 16. | L’Âne qui caresse son maître. | 8. | 13. |
| I, | 17. | Le Lion et le Rat. | 9. | 20. |
| II, | 3. | Le Chien et le Voleur. | 10. | 6. |
| II, | 5. | La Montagne en mal d’enfant. | 11. | 14. |
| II, | 9. | Les Lièvres et les Grenouilles. | 12. | 15. |
| II, | 16. | Le Geai vaniteux. | 13. | 17. |
| II, | 18. | La Mouche et la Fourmi. | 15. | 18. |
| II, | 21. | La Grenouille qui s’enfle. | 16. | 19. |
| III, | 3. | Le Cheval et l’Âne. | 17. | 21. |
| III, | 4. | Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | 18. | 22. |
| III, | 5. | Le Rossignol et l’Épervier. | 19. | 3. |
| III, | 7. | Le Cerf à la Fontaine. | 14. | 9. |
| III, | 14. | La Hache et les Arbres. | 20. | 10. |
| III, | 15. | Le Loup et le Chien. | 21. | 29. |
| III, | 16. | L’Estomac et les Membres. | 22. | 24. |
| III, | 17. | Le Singe et le Renard. | 23. | 5. |
| III, | 18. | Le Marchand et l’Âne. | 24. | 16. |
| IV, | 1. | Les Raisins trop verts. | 25. | 26. |
| IV, | 8. | Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | 26. | 23. |
| IV, | 12. | Le Lion malade et le Renard. | 28. | 28. |
| IV, | 19. | La Fourmi et le Grillon. | 29. | 25. |
Il ressort du tableau qui précède que, dans son Miroir historial, Vincent de Beauvais a, sauf pour la fable du Cerf à la Fontaine, suivi l’ordre des fables du Romulus ordinaire, et qu’au contraire, dans son Miroir doctrinal, il l’a entièrement bouleversé.
Manuscrits du Romulus de Vincent de Beauvais. §
L’œuvre encyclopédique de Vincent de Beauvais dut avoir une grande vogue au moyen âge à en juger par le nombre considérable de manuscrits qui en est resté dans les bibliothèques publiques.
Je n’essaierai pas de les mentionner tous, et, pour ne pas donner à l’examen de ceux que je signalerai des proportions qu’un dérivé partiel ne comporterait pas, je n’entreprendrai pas de présenter de chacun d’eux une analyse détaillée. Excepté pour ceux de la Bibliothèque nationale et pour quelques autres, je me contenterai de transcrire la description nécessairement sommaire qui m’aura été fournie par les catalogues imprimés des bibliothèques publiques.
§ 1er. — France. §
1º Bibliothèque nationale. §
1. Romulus du Miroir historial. §
Les fables du Miroir historial se trouvent à la Bibliothèque nationale, non seulement dans les manuscrits de ce Miroir, mais encore dans des manuscrits spéciaux, où elles figurent séparément.
Manuscrits du Miroir historial. §
Les manuscrits du Miroir historial comprennent des volumes in-folio catalogués sous les cotes 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 11728 et 14354-14355. Mais ces manuscrits ne contenant pas tous intégralement l’ouvrage historique de Vincent de Beauvais, il s’ensuit qu’ils ne renferment pas tous les fables de Romulus. Elles n’existent que dans le manuscrit 4897, qui comprend les 16 premiers livres du Miroir et dans le manuscrit 14354-14355 divisé en deux volumes qui embrassent l’œuvre entière.
L’inventaire imprimé de 1744 donne du manuscrit 4897 la désignation suivante :
« Codex membranaceus, olim D D. de Bethune. Ibi continentur speculi historialis libri sexdecim priores : authore Vincentio Bellovacensi ; præmittuntur prologus et capitum index generalis. Is codex decimo quarto sæculo exaratus videtur. »
{p. 437}L’inventaire imprimé de 1869
donne du manuscrit 14354-14355 cette désignation un peu laconique :
« Miroir historial de Vincent de Beauvais, avec la table de
Jean Hautfuney. XIV s. »
Il provient de l’abbaye de
Saint-Victor.
Manuscrits spéciaux. §
Les fables de Romulus, tirées du Miroir historial, existent isolément dans trois manuscrits spéciaux portant les cotes 2622, 11412 et 18600.
A. Manuscrit 2622. §
Ce manuscrit, dont l’écriture du xve siècle est sur vélin et qui a appartenu à Bigot, n’est pas exclusivement consacré aux œuvres de Vincent de Beauvais ; les fables de Romulus extraites du Miroir historial y figurent parmi neuf autres opuscules de divers auteurs.
Elles s’étendent du recto du feuillet 118 au verso du
feuillet 122. Elles sont intitulées : De hesopo et
fabulis eius moraliter fictis contra calumpniosos cupidos et
incautos et vane gloriantes Eusebius
, etc., et la fin
en est indiquée par ces mots : Explicit libellus
de fabulis hesopi
, etc.
Malheureusement, au milieu d’un des cahiers du volume, un feuillet a été arraché, et il en résulte une lacune, qui s’étend du premier tiers de la fable Luscinia et Accipiter à l’avant-dernière phrase de celle intitulée Asinus et Leo et qui fait entièrement disparaître les huit autres comprises entre elles.
B. Manuscrit 11412. §
Le manuscrit 11412 est un volume in-quarto de très petit format. Il se compose de 160 feuillets en vélin, dont le dernier ne porte aucune écriture. Il appartient au xiiie siècle.
Il renferme les fables du Miroir historial, qui occupent les feuillets 106 et 107 et commencent sans titre préalable au haut du recto du feuillet 106. Comme l’écriture est d’une finesse extraordinaire, elle a été disposée sur deux colonnes. La dernière fable se termine au milieu de la deuxième colonne du feuillet 107 verso.
Les fables sont seulement au nombre de 27. Le copiste a
omis les deux fables qui commencent par les mots Nocturnus quidam fur et Securis cum facta
esset. À la fin de sa copie il a ajouté les trois titres qui
suivent : De Cane latrante contra
furem
, De Securi
,
De Vulpe et Ciconia qui se invicem
invitaverunt
; mais il ne les a pas fait suivre des
fables qui y correspondent.
Le manuscrit, avant d’être fondu dans la classification actuelle, appartenait au Supplément latin, dans lequel il portait le nº 1219.
C. Manuscrit 18600. §
{p. 438}Le manuscrit 18600 est un
petit in-4º, relié en veau et composé de 45 feuillets en vélin. Il est
dû à des mains diverses et contient plusieurs opuscules, que le
catalogue imprimé de 1871 énumère dans les termes suivants :
« Historiettes pieuses, parmi lesquelles la légende des
danseurs saxons qui avaient profané la nuit de Noël (1), et la
légende de Hellekin (13). — Fables Ésopiques (38). — Sententie
diuersorum philosophorum collecte seu ludicra philosophorum (41).
— XIII s. »
Les fables du Miroir historial commencent en tête du recto du folio 38 et se terminent au bas du recto du folio 41. Elles sont au nombre de 29.
Elles sont précédées seulement de la partie ainsi
conçue de leur préambule : De ciuitate Attica hesopus quidam
homo grecus et ingeniosus famulos suos docet quid obseruare debeant.
Et ut uitam ostendat et mores, inducit aues. arbores, bestiasque
loquentes.
2. Romulus du Miroir doctrinal. §
Ainsi que je l’ai expliqué, les fables du Miroir doctrinal
offrent avec les mêmes variantes le même texte que celles du Miroir
historial. J’ai dit aussi qu’elles ne différaient guère que par l’ordre
dans lequel elles étaient disposées. Il y a cependant entre elles un autre
point de différence, ce sont leurs deux préambules. Me proposant de
joindre aux textes, qui seront publiés à la fin de cet ouvrage, le Romulus
du Miroir historial, je n’ai pas cru devoir plus haut en reproduire le
préambule. Au contraire, ne devant pas le publier ailleurs, je dois ici
transcrire celui du Miroir doctrinal. En voici les termes : Tales
sunt et morales Æsopi fabulæ, de quibus exempli causa non nullas hoc in
loco placuit breviter inserere. Nam etsi legenti vel audienti misceant
risum, acuunt tamen ingenium.
Les fables des Miroirs historial et doctrinal sont en outre terminées par une sorte d’épilogue. Celui du second Miroir a été copié sur celui du premier qu’il ne reproduit même qu’en partie et que je dois publier avec le Romulus lui-même. Pour éviter tout double emploi, je m’abstiens donc d’en donner ici le texte.
J’ai maintenant à signaler les manuscrits que possède la Bibliothèque nationale.
Je dois dire d’abord qu’il n’existe pas de manuscrit spécial du Romulus du Miroir doctrinal. Il est probable que ce Miroir a eu moins de vogue que l’autre, et que les copistes, le connaissant {p. 439}moins, ont moins songé à en faire des extraits. Mais la Bibliothèque nationale possède 2 manuscrits complets du Miroir doctrinal, dans lesquels se trouve le Romulus de Vincent de Beauvais. Ils portent les cotes 6428 et 16100.
A. Manuscrit 6428. §
Dans l’Inventaire imprimé de 1744, le manuscrit 6428, qui
forme un gros volume du grand format in-8º, est décrit dans les termes
suivants : « Codex membranaceus, olim Colbertinus. Ibi continetur
Vincentii Bellovacencis doctrinale, sive de
scientiis libri octodecim. Is codex decimo quarto sæculo exaratus
videtur. »
B. Manuscrit 16100. §
Le manuscrit 16100 forme un volume in-folio, d’un format moins grand que le précédent.
Dans l’inventaire des manuscrits latins de la Sorbonne
publié en 1870, il est l’objet de cette simple mention : « Miroir
doctrinal de Vincent de Beauvais. XIII s. »
2º Bibliothèque de l’Arsenal. §
A. Manuscrit 1010 (112. H. L.). §
Le catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Arsenal, T. II, p. 231, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
Vincent de Beauvais : « Speculum
hystoriale fratris Vincencii. »
— Fol. 1. Prologue de la
table : « Secundum Augustinum… »
— Fol. 1-3. Table. — Fol. 3. Commencement de l’ouvrage : « Quoniam multitudo librorum et temporis
brevitas… »
Ce volume contient les livres I-VIII.
Parchemin. 259 feuillets. 383 sur 261 millim. Écriture du xive siècle sur 2 col. Initiale à miniature, avec bordure épineuse et animaux, au fol. 3. — 7 initiales ornées et peintes en or et couleur, avec bordure épineuse et animaux aux fol. 39 vº, 78 vº, 111 vº, 136 vº, 153 vº, 182, 246 vº. Initiales rouges et bleues. Titres rouges.
Reliure en parchemin blanc.
B. Manuscrit 1015 (114 H. L.). §
Le même catalogue, Arsenal, T. II, p. 232, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
Vincent de Beauvais : Speculum
doctrinale.
— Livres I-IX. — Ce volume contient aussi le
commencement du livre X. — Commencement : « Quoniam
multitudo librorum et temporis brevitas… »
Parchemin. 181 feuillets. 359 sur 252 millim. Écriture du {p. 440}xive siècle, sur 2 col. Initiale à miniature, avec encadrement épineux, au fol. I. Initiales rouges et bleues. Titres rouges.
De la bibliothèque des Grands-Augustins de Paris. — Quétif et Echard citent ce manuscrit sous le nº 225 ou 275 des Grands-Augustins, Script. ord. Praedic., I, 234 b.
Reliure en veau brun.
3º Bibliothèque d’Auxerre. §
Manuscrit 92 (86). §
Le catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Départements, T. VI, p. 40, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
« Speculum hystorie fratris Vincencii.
Apologia tocius operis. De causa suscepti operis et ejus materia.
I. Quoniam multitudo librorum… »
Table
alphabétique des chapitres, fol. 1-4 ; table des chapitres des livres I
à XXXII, fol. 12-15, sur 4 colonnes. Début de l’ouvrage : « Deus est substancia incorporea… »
Ce premier
volume renferme les livres I-VIII.
xive siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 346 sur 246 millim. Initiales de couleur ; titre courant. — (« Liber beate Marie Pontigniaci. S. Edmundus. » Ancien 162.)
4º Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. §
Manuscrit 5 (4). §
Le même catalogue, T. VI, p. 361, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
Vincent de Beauvais : Speculum
historiale.
(Livres I-VII.)
Le texte finit aux mots : « … nisi te
scire hoc sciat alterius… »
— La fin du chapitre CXXXVII
et le chapitre CXXXVIII manquent.
xive siècle. Parchemin. 418 feuillets à 2 col. 438 sur 203 millim. Rel. veau. — (La Ferté-sur-Grosne.)
5º Bibliothèque de Dijon. §
Manuscrit 568 (329). §
Le même catalogue, T. V, p. 140, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
Vincent de Beauvais : Speculum
historiale
, livres 1 à 7. Table des chapitres en
tête.
xiiie siècle. Parchemin. 265 feuillets à 2 col. 328 sur 240 millim. Belle écriture, lettres ornées, titre courant. Fol. 9, miniature représentant saint Louis ; fol. 15, autre représentant la Crucifixion. En garde, fragment d’un acte judiciaire de 1348, au nom de Miles de Voisins, garde pour le Roi de la prévôté de Sens. Rel. peau blanche, aux armes de Cîteaux. — (Citeaux.)
6º Bibliothèque de Rouen. §
Manuscrit 1133 (U. 23). §
{p. 441}Le catalogue précité, T. I,
p. 282, donne de ce manuscrit l’analyse suivante : Vincentii Bellovacensis Speculi historialis libri XVI
priores.
Au fol. 7, grande initiale ornée avec miniature
(55 × 50 millim.).
xive siècle. Parchemin. 379 feuillets. 390 sur 270 millim. Rel. mod. (Jumièges, G. 5. — Ancien nº U. 43.)
7º Bibliothèque de Troyes. §
A. Manuscrit 170. §
Le catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques des Départements, publié dans le format in-4º, donne, T. II, p. 83, du manuscrit 170 l’analyse suivante :
Deux volumes in-folio sur beau vélin. — Speculum historicum
(in XXXII libros
distinctum, auctore Vincentio Belvacensi). — Incipit : « Deus est substantia incorporea… »
— xiiie-xive siècles.
Clairvaux, Q. 52 et 53. Le premier volume contient 424 feuillets, et le second 431. Beau manuscrit à deux colonnes, avec initiales en or et en couleur.
B. Manuscrit 464. §
Le même catalogue, T. II, p. 208, donne de ce manuscrit l’analyse suivante :
Deux volumes in-folio sur vélin. — Vincentii (Bellovacensis) Speculi historialis libri I-IX,
XXV-XXXII.
— Fin du xiiie siècle.
Provenance inconnue. Manuscrit en gothique mixte, à deux colonnes, avec initiales coloriées et titres à l’encre rouge. Le 1er volume est de 313 feuillets et le 2e de 323. Les quarante-six premiers chapitres du livre XXV manquent.
§ 2. — Allemagne du Sud. §
Bibliothèque royale de Munich. §
C’est seulement par des extraits textuellement tirés du catalogue imprimé de la Bibliothèque royale de Munich que je vais faire connaître les manuscrits des Miroirs historial et doctrinal de Vincent de Beauvais dans lesquels se trouve son Romulus.
2661-2664. (Ald. 131-134.) Membr. in-2º max. s. XIV in. 238, 276, 234 et 220 fol.
Vincentii Bellovacensis Speculum maius (naturale, doctrinale, morale, historiale).
{p. 442}4524-4525. (Bened. 24 et 25). membr. 2º. s. XV. 228 et 362 fol.
Vlncentii Beluacensis Speculi historialis libri I-XV.
17129-17132. (Scheftl. 129-132). Membr. 2º. s. XIV. 228, 321, 312, 302 f.
Vincentii Bellouacensis Speculum historiale.
Quatuor uolumina Chunradus Sachsenhauserus a fratre Hainrico Talhaymaero a. 1333 emit 180 fiorenis.
17416-418. (Schir. 16. 17. 18). Membr. in 2º. s. XV. 251, 233 et 256 f. cum initialibus ornatis.
F. 2. Vincentii de Burgundia (Bellovacensis) speculi historialis vol. I, III, IV, sive libri 1-8 et 17-32. Scripserunt nº. 16 Joh. Reym de Augusta, nº. 17 fr. Maurus Eystetensis, nº. 18 Hainr. Molitor. — Tomus II, quem A. Fel. Ofele in bibliotheca Schirensi viderat, in nostram non pervenit.
18060-18063. (Teg. 60-63). Membr. 2º mai. s. XV. 298, 355, 338, 354 f.
Vincentii Bellouacensis Speculi historialis libri XXXII.
Indépendamment des manuscrits des Miroirs historial et doctrinal contenant les fables extraites par Vincent de Beauvais du Romulus ordinaire, la Bibliothèque royale de Munich possède un manuscrit qui les renferme isolément.
Ce manuscrit qui porte la cote 6804 et qui provient du couvent des Cordeliers de Freising, forme un volume in-fol., dont l’écriture à deux colonnes est du xve siècle. Il porte la date de 1473.
Les fables du Miroir historial qu’il renferme, commencent au haut de la première col. du feuillet 284 rº et se terminent au milieu de la première col. du feuillet 286 rº.
Malheureusement elles sont incomplètes : entre les
feuillets 285 et 286, il y en avait un qui a été coupé ou arraché. Comme il
contenait les dernières fables du Miroir historial, il s’ensuit que le
manuscrit ne possède plus actuellement que les dix-neuf premières. Encore le
texte de la dix-neuvième est-il incomplet ; il s’arrête après les mots
suivants : E diuerso autem auceps venit et.
Les premiers mots que porte le feuillet 286 rº sont ces
derniers de la fable de la Fourmi et du Grillon : « cantasti, hyeme
salta »
, que suit l’épimythion.
Immédiatement après vient l’épilogue de Vincent de Beauvais.
§ 3. — Angleterre. §
1º Bibliothèque du British Museum. §
Manuscrit Harl. 2346. §
{p. 443}Ce manuscrit forme un petit volume in-8º, auquel M. Oesterley n’attribue que 53 feuillets, mais qui en réalité en possède 64 en parchemin et dont l’écriture est de diverses mains du xve siècle.
Les feuillets 53 à 64 sont remplis par le Romulus de Vincent de Beauvais tiré de son Miroir historial.
Par suite d’une erreur, qui, si elle émanait d’un autre, serait vraiment surprenante, M. Oesterley affirme que le manuscrit Harléien n’est qu’un recueil inutilisable, où les fables dégénèrent en légendes de saints365. Si l’opuscule du critique allemand était moins connu, je ne prendrais pas la peine de relever cette allégation ; mais, comme il est dans beaucoup de mains, il me paraît utile de la signaler.
2º Bibliothèque du Collège d’Exon à Oxford. §
Manuscrit XV. §
Le manuscrit qui, dans la Bibliothèque du Collège d’Exon, porte le nº 15 et qui, contenant les trente-deux livres du Miroir historial, renferme nécessairement les fables du Romulus de Vincent de Beauvais, a, dans le Catalogue imprimé des manuscrits des collèges d’Oxford366, été décrit en ces termes :
Codex membranaceus, in-folio, ff. 463, sec. xiii. exeuntis, binis columnis exaratus ; olim conventus S. Albani, ex dono Johannis Whethamstede, Prioris.
Vincentii Burgundi, Bellovacencis, Speculum Naturale, sive Historiale, libris xxxii. comprehensum ; præviis cujusque libri capitulis.
Tit. « Prima pars Speculi… cujus primus liber continet tantum annotaciones capitulorum librorum sequencium et ideo annotaciones inferius posite incipiunt a libro secundo. »
In calce tabulæ, « Hunc librum ad usum conventus monasterii Sancti Albani assignavit venerabilis pater dominus Johannes Whethamstede, abbas monasterii antedicti, vinculoque anathematis {p. 444}innodavit illos omnes, qui aut titulum illius dolere curaverint aut ad usus applicare presumpserint alienos. »
Evulsum est folium primum lib. II. In margine fol. 2 inscribitur, « Hic est liber Sancti Albani de libraria conventus. »
Defic. lib. XXXII in verbis, « fervore conversatur. Apud Raven. »
3º Bibliothèque de l’Université de Cambridge. §
Manuscrit Ff. III. 22. §
Le Catalogue des manuscrits de cette Bibliothèque mentionne, T. II, page 420, sous la cote Ff. III. 22 substituée au nº 1230, un manuscrit in-folio du xve siècle, dont les 116 feuillets en vélin portent, à raison de cinquante-deux lignes sur chaque face, une écriture à deux colonnes.
Ce manuscrit contient seulement les quatorze premiers livres du Miroir historial et par suite le Romulus de Vincent de Beauvais.
4º Bibliothèque du Corpus Christi college de Cambridge. §
Manuscrit VIII. §
Le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque du Corpus Christi college de Cambridge, édité par Jacob Nasmith et imprimé dans cette ville en 1777367, signale, sous la cote VIII, dans les termes suivants un manuscrit du Miroir historial contenant le Romulus de Vincent de Beauvais :
Codex membranaceus in-folio, seculo xv exaratus, quo continentur.
Vincentii [Bellovacensis] speculi historialis libri XIV priores, in quibus historia deducitur a mundo condito ad mortem Valentis imperatoris, A. D. 380.
§ 4. — Belgique. §
1º Bibliothèque royale de Bruxelles. §
Voici comment, dans le Catalogue imprimé des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bruxelles, sont analysés les manuscrits du Miroir historial qui contiennent le Romulus de Vincent de Beauvais.
9146-9148. — Vincentii Bellovacensis. Speculum historiale. — Tome I : « Quoniam multitudo librorum… » 1450. — Tome II : « Comestor. Caio igitur… » 1453. — Tome III : « Ab anno primo Gratiani… » 1453.
{p. 445}9330. — Vincentii Bellovacensis. Speculum historiale : « Quoniam multitudo librorum… » — 1453.
2º Bibliothèque de l’Université de Liège. §
Manuscrit 715. §
La Bibliothèque de l’Université de Liège possède, sous la cote 715, un manuscrit du Miroir historial, dont le Catalogue imprimé donne une analyse trop prolixe pour que je la transcrive ici.
Je me contente de dire que ce manuscrit que le copiste a terminé, d’après sa propre déclaration, en 1350 et qui vient de l’abbaye de Saint-Trond, forme deux volumes in-fol., qui se composent, le premier, de 286 feuillets, le second de 345, dont l’écriture à deux colonnes sur vélin est irréprochable et qui contiennent tous les livres du Miroir historial et par conséquent le Romulus de Vincent de Beauvais.
§ 5. — Italie. §
Bibliothèque Riccardienne. §
Manuscrit 688. §
Ce manuscrit est un volume in-4º, dont les feuillets en papier sont, suivant un numérotage à l’encre rouge en chiffres romains, au nombre de 152, et dont l’écriture est celle d’une main française du xve siècle.
Il renferme, entre autres ouvrages, le Romulus de Vincent de Beauvais tiré du Miroir historial.
Les fables qui commencent au fol. xcvij rº, sont au
complet. Elles sont précédées de ce titre à l’encre rouge : Incipit
tractatus siue libellus || de fabulis hesopi moraliter fictis et de ipso
hesopo. Eusebius in cronicis. || Capitulum I. extractus de speculo
historiali.
Elles sont suivies, au recto du fol. cvij, de l’épilogue, à
la fin duquel on lit ces mots : Deo gratias. Amen.
Éditions latines des ouvrages de Vincent de Beauvais. §
Quoiqu’il existe encore des manuscrits nombreux que je pourrais analyser, je crois la liste de ceux que j’ai signalés suffisamment longue, et le moment me paraît venu de m’occuper des éditions imprimées.
§ 1er. — Éditions de Strasbourg. §
{p. 446}C’est à Strasbourg que fut publié pour la première fois le quadruple miroir de Vincent de Beauvais. L’imprimeur en fut Jean Mentellin. Voici le signalement des éditions qui sortirent de ses presses.
1º Speculum naturale. §
Un volume du grand format in-folio, à 2 colonnes de 66 lignes chacune sans gardes, signatures ni pages numérotées. Il est imprimé en lettres rondes tirant sur le gothique.
La première partie se compose des 18 premiers livres et occupe 318 feuillets. Les 21 premiers feuillets renferment : le prologue et la table des chapitres.
La deuxième partie se compose des livres XIX à XXXIII et
occupe 327 feuillets. Les huit premiers feuillets sont consacrés à la table
et le neuvième commence par cette première ligne du livre XIX : ij. De opere sexte diei. Et primo de anima.
La première colonne du verso du dernier feuillet ne renferme
que 27 lignes, dont la dernière, terminant l’ouvrage, est ainsi conçue :
rialis. p̱patescunt. Amen368.
2º Speculum doctrinale. §
Un volume du grand format in-folio à deux colonnes de
67 lignes par page sans gardes, signatures ni pagination. L’ouvrage qui
embrasse 400 feuillets se termine à la deuxième colonne du recto du dernier
feuillet, qui n’a que 60 lignes, par celle-ci : in quo
et agnus ābulet et elephas natet.
Les caractères sont les
mêmes que ceux de l’édition du Speculum naturale.
Mentellin ne s’est pas tenu à cette édition. Avec les mêmes
caractères il en a imprimé une autre, qui a, comme la précédente,
400 feuillets et 67 lignes à la page, mais qui s’en distingue par plusieurs
différences dans les abréviations. Pour n’en citer qu’un exemple, je ferai
observer que la dernière ligne est ainsi conçue : & altus in quo et agnus ambulet & elephas natet369.
3º Speculum morale. §
Première édition. §
Un volume in-folio de 474 feuillets à 2 colonnes de 62 lignes chaque. Il est imprimé en lettres rondes. Il comprend trois livres.
Les 3 premiers feuillets contiennent la table des matières.
Le {p. 447}quatrième commence ainsi : Incipit
primvs liber specvli moralis || [I] N omnibus
operi.
L’ouvrage se termine au verso de l’avant-dernier
feuillet, qui n’a que 14 lignes, par celle-ci : secula
benedictus deus.
Le dernier feuillet est occupé par un
chapitre intitulé De virginitate
370.
Deuxième édition. §
Mentellin a publié une seconde édition du Speculum Morale,
ou plutôt il a fait de sa première édition un second tirage, facile à
distinguer du premier par cette circonstance que la dernière colonne de
l’avant-dernier feuillet est terminée par une souscription en 13 lignes,
dont voici la fin : Impressumqӡ ī inclyta vrbe
Argentinensium ac nitide terse emendateque refectum. per honorandū
Dn̄m Johannem Mentellin artis imp̄ssorie magistrū famosissimū. Anno a
partu virginis salutifero millesimo quadringentesimo septuagesimo
sexto. die mensis nouembris nona371.
4º Speculum historiale. §
Première édition372. §
Cette édition, inconnue à Daunou, comprend 4 vol. in-fº à 2 col. de 67 lignes, imprimés avec les mêmes caractères que les deux premiers Speculum.
Le tome I renferme les livres I à VIII. Il se compose de
155 feuillets, dont les deux premiers sont consacrés à la table des
matières, et dont le troisième commence par cette ligne : Speculum historiale Vincentii Beluacensis
fra.
Le contenu se termine à la deuxième colonne du recto du
dernier feuillet par ces mots : Primū volumen speculi
|| historialis finit.
Le tome II renferme les livres IX à XVI. Il se compose de
176 feuillets, dont les 3 premiers sont occupés par la table, et dont le
quatrième commence à la deuxième colonne du recto par ce titre :
I. De promotōne claudij ad imperium ||
Comestor.
Au dernier feuillet du tome II, la deuxième
colonne du recto qui ne se compose que de 13 lignes, se termine par
celle-ci : Explicit scd’a pars speculi historialis
vincētij.
Le tome III renferme les livres XVII à XXIV. Il se compose
de 175 feuillets. En tête il porte la table des chapitres et la table
particulière du livre XVII, qui commence par ce titre à la première
colonne du recto du folio 3 : I. De cōtemporalitate.
ix. regnorū.
Le {p. 448}dernier
feuillet est terminé à la deuxième colonne du verso par cette ligne :
ordinis predicatorum explicit.
Le tome IV renferme les livres XXV à XXXII. Il se compose
de 191 feuillets, et commence par la table des matières. Puis on lit au
verso du deuxième feuillet sur la deuxième colonne : I. De imperio Karoli magni et forma.
Enfin, au verso du
dernier feuillet, la première colonne se termine par cette souscription :
Speculum Vincentij historiale
explicit.
Deuxième édition. §
Mentellin a publié une autre édition du Speculum historiale en quatre volumes grand in-folio à deux colonnes de 62 lignes chacune, imprimés en lettres rondes comme celles du Speculum morale, sans réclames, signatures, ni pagination.
Le premier volume se compose de 168 feuillets ; le deuxième, de 204 ; le troisième, de 201, et le quatrième, de 213. Le texte est précédé, dans le premier, d’une table unique et, dans les trois autres, de deux, l’une alphabétique et l’autre dressée par ordre de matières. Voici l’analyse des quatre volumes :
Premier volume. Fol. 1 a. À la suite d’un
court préambule on lit : Incipit. Tabvla. Primi.
Volvminis. Spe-||cvli. Historialis.
Cette table occupe
les deux premiers feuillets. — Fol. 3 a. Incipit. Specvlvm. Historiale. Fra-||tris.
Vincentii.
Le premier volume se termine par cette
souscription en lettres capitales : Explicit. Primvm.
Volvmen. Specvli. Hi-||storialis. Impressvm. Per Johannem. ||
Mentellin.
Deuxième volume. À la fin se trouve cette phrase :
Explicit Secunda. Pars. Specvli. Hi-||storialis.
Vincencii. Impressa. Per. Jo-||hannem. Mentellin.
Troisième volume. Il porte cette mention finale :
Explicit. Tercivm. Volvmen. Specvli. ||
Historialis. Vincencii. Impressvm. Per. | Johannem.
Mentellin.
Quatrième volume. Au verso du dernier feuillet, la deuxième
colonne se termine par une souscription imprimée en lettres capitales et
conçue dans les termes suivants : Explicit. specvlvm.
historiale. fra||tris. vincencii. ordinis. predicatorvm. || impressvm.
per iohannem. mentellin. || anno. domini. millesimo
qvadringente-||simo septvagesimo tercio. qvarta. die. ||
decembris373.
Telles sont les éditions imprimées par Mentellin.
{p. 449}Faut-il lui en attribuer une
dernière de cinq volumes in-folio en caractères gothiques, sans indication
de lieu, ni d’année, ni de nom d’imprimeur, qui comprend les 4 miroirs de
Vincent de Beauvais ? Ce qui porterait à le croire, c’est que Panzer374 qui la signale d’après Maittaire, suppose
qu’elle pourrait bien avoir été imprimée à Strasbourg. Mais rien ne prouve
qu’elle soit due à l’un des imprimeurs de cette ville, et cela fût-il
établi, qu’il n’en résulterait pas nécessairement qu’elle fût l’œuvre de
Mentellin. Voici d’ailleurs en quels termes il la mentionne : Vincentii Bellovacensis ordinis Praedicatorum speculum
doctrinale, historiale, morale, naturale, quinque
voluminibus. Char. goth. fol.
§ 2. — Édition d’Augsbourg. §
Des œuvres de Vincent de Beauvais, une seule fut réimprimée en 1474 ; ce fut le Miroir historial. À Augsbourg, dans le monastère de Sainte-Afre, il en fut publié une édition formée de trois volumes, grand in-folio, à deux colonnes de 52 lignes chacune, sans chiffres, réclames ni signatures. Cette édition a été exécutée soit avec des caractères gothiques pareils à ceux d’Antoine Sorg, soit même par ce dernier avec les siens pour le compte du monastère. Le premier volume de 326 feuillets renferme les livres I à X ; le deuxième de 321 feuillets, les livres XI à XXI ; le troisième de 371 feuillets, les livres XXII à XXXII. Au verso du dernier feuillet du troisième volume, la première colonne se termine par cette souscription en 10 vers suivis de la date de l’édition :
Codicis insignis quin periodus quoque finisFauste nunc annotatur agente deo.In partes hunc sectum tres augustaque lectorImpressa littera dedit ecce tibi.Hystoriae seriem cuius vis complicat in seHystoricum speculum cui bene nomen eritIllustris sententia tempore quelibet aptoOmnis et inferitur florida queque viri.Auctoris nomen Vincentius. ordine ferturPredique cator. burgundia sed patria.M.cccc.lxxiiij375.
§ 3. — Édition de Paris. §
{p. 450}L’édition d’Augsbourg ne paraît pas avoir été la seule édition du Miroir historial publiée en 1474. Maittaire376, d’après le P. Le Long, et Panzer377, d’après Maittaire, affirment que le Speculum historiale fut également imprimé la même année à Paris dans le format in-folio.
§ 4. — Édition de Bâle. §
En 1481, une publication partielle de l’œuvre de Vincent de Beauvais fut entreprise à Bâle par Jean de Amerbach. Il publia, en un volume in-folio gothique, les cinq traités suivants : 1. Libri gratix, 2. Tractatus de laudibus Mariæ Virginis Deiparæ, 3. Tractatus de S. Johanne Evangelista, 4. De eruditione seu modo instruendorum filiorum regalium, 5. Consolatio super morte amici.
Le lieu de l’impression et le nom de l’imprimeur sont exprimés
dans trois distiques qui terminent le volume. En outre, la date est indiquée
par cette souscription : Idibus Decembribus anno a Christo
natali octuagesimo primo supra millesimum quaterque
centesimum.
L’édition de 1481 ne paraît pas avoir été le seul hommage rendu par Jean de Amerbach à l’illustre Vincent de Beauvais. Panzer croit pouvoir lui attribuer une édition in-folio qu’il signale du Speculum naturale, sans date, ni lieu d’impression, ni nom d’imprimeur. Elle a 69 lignes à la page, et ne porte ni signatures, ni réclames, ni pagination378.
§ 5. — Édition de Cologne. §
Panzer attribue à Ulrich Zell de Cologne une édition in-folio
du Speculum morale, à deux colonnes de 56 lignes, qui ne
porte ni signatures, ni réclames, ni pagination, et qui se termine par les
mots Speculum morale finit
. M’abstenant de
toute hypothèse, je me borne à la mentionner d’après lui379.
§ 6. — Éditions de Nuremberg. §
{p. 451}De 1483 à 1486, le Speculum quadruplex fut imprimé à Nuremberg par Antoine Koburger.
Speculum naturale. §
En 1483, Koburger fit paraître une première édition in-folio du Speculum naturale380 et, s’il faut en croire Panzer381, il la réimprima même, vers 1486, dans le même format.
Speculum historiale. §
L’année même où il publiait la première de ces deux éditions,
Koburger faisait paraître, dans le format in-folio, le Speculum
historiale. L’ouvrage est précédé d’une table alphabétique, et
terminé par cette souscription : Speculum historiale
perlustrati fratris Vincencij ordinis predicatorum professoris per
Antonium Koburger nurmberge incolam impressum : finit feliciter.
consummatum sub nostri saluatoris anno incarnato M.CCCC.LXXXIII. in
vigilia sancti Jacobi : de quo fine laus et gloria altissimo sit per
euum. Amen382.
Speculum morale. §
Selon Brunet, le Speculum morale aurait été imprimé deux fois par Koburger, une fois sans date et une fois en 1485. Je ne connais et je ne puis décrire que la seconde de ces éditions, qui forme un volume de 270 feuillets, du plus grand format in-folio, imprimé en caractères gothiques à deux colonnes, sans signatures, réclames, ni pages numérotées.
Les deux premiers feuillets sont occupés par la table. Sur le
recto du troisième feuillet on lit : Incipit primus
liber Speculi moralis Vincentii.
L’ouvrage se termine par
cette souscription : Anno incarnate deitatis Millesimo
quadringentesimo octogesimo quinto. VIII. ydus februarii. Opus insigne
ab egregio doctore Vincentio alme Beluacencis ecclesie presule… editum.
quod Morale speculum intitulatur. Et in imperiali Nurembergk summa cum
diligentia impensis Antonii Kobergers prefate ciuitatis ciuem
(sic) hoc fine terminatum. De quo cunctipotenti deo honor :
eiusque genito cum sua benedicta matre semperque virgine gloria,
spirituique quoque paraclito decus sit per euum. Amen.
Comme dans les éditions antérieures, cette souscription est
suivie d’un court traité intitulé : De
Virginitate383.
Speculum doctrinale. §
{p. 452}C’est par le Speculum doctrinale que Koburger termina la publication du Speculum quadruplex. L’édition qu’il en donna, forme un volume de la plus grande dimension in-folio, imprimé en caractères gothiques, sans signatures, réclames, ni pages numérotées.
Le premier feuillet, sur le recto, porte ces mots :
Primus liber Speculi doctrinalis. Speculum
doctrinale Vincentii beluacensis Incipit
, etc.
L’ouvrage est terminé par la souscription suivante qui révèle
le lieu d’impression, la date et le nom du typographe : Speculum doctrinale Vincentii beluacen. fris diui ordinis p̄dicatorum
in regia imperialique ciuitate Nurembergk : expensis itaque et solertiis
spectabilis uiri Anthonii kobergers inibi ciuis et incole his ereis
figuris effigiatum : castigatum : emendatum ac faustissime perornatum
finit Anno a natali xpiano. M.CCCC.LXXXVI. kls XVII. Aprilis. Summe et
indiuidue trinitati Jesu Christi crucifixe humanitati eiusque
gloriosissime matri Marie sit laus : honor et gloria per infinita secula
seculorum Amen384.
J’en ai maintenant fini avec Koburger, et je passe aux éditions Vénitiennes.
§ 7. — Édition de Venise de 1484. §
En 1484, le quadruple Miroir de Vincent de Beauvais fit, à Venise, l’objet d’une première édition en quatre volumes. Ne la connaissant que par la courte mention qu’en fait Panzer, je m’abstiens de la décrire385.
§ 8. — Éditions de Venise de 1493 et 1494. §
Hermann Liechtenstein, né à Cologne, mais établi à Venise, imprima de 1493 à 1494 l’œuvre entière de Vincent de Beauvais.
Speculum morale. §
Commençant par le Speculum morale, il en
fit, en 1493, un volume in-folio, terminé par ces mots : Opus preclarum quod speculum morale intitulatur : ab egregio doctore ||
Vincentio alme Beluacensis ecclesie presule : ac sancti dominici
ordi-||nis professore {p. 453}editum : feliciter
finit. Impensisque et cura non me-||diocri Hermanni liechtenstein
coloniensis : emendatione diligentis-||sima impressum Anno salutis.
M.CCCC.LXXXXIII. pridie kalend. Octo-||bris Venetiis. Laus
Christo386.
Speculum doctrinale. §
Après le Speculum morale parut le Speculum doctrinale en un volume in-folio, imprimé en
caractères gothiques, composé de 255 feuillets signés et numérotés, et
terminé par cette souscription : Operis preclari Speculi
communis Speculum doctrinale ab eximio doctore Vincentio almeque
Belluacensis ecclesie presule : Ac sancti dominici ordinis professore
editum feliciter finit. Impensisque non mediocribus ac cura
solertissima. Hermanni liechtenstein Coloniensis agrippine colonie : Nec
non emendatione diligentissima est Impressum Anno. Salutis.
M.CCCC.LXXXXIIII. Idibus Januarii. Venetiis. Sedente Diuo Alexandro. VI.
Maximo pontifice Regnanteque Maximiliano primo Romanorum rege
inuictissimo Faustissimoque Semper Augusto387.
Speculum naturale. §
Au Speculum doctrinale succéda le Speculum naturale que Hermann Liechtenstein publia, au mois
de mai 1494, en un volume in-folio, encore imprimé en caractères gothiques,
composé de 423 feuillets signés et numérotés, et terminé par cette
souscription : Opus preclarum Speculi communis Speculum
naturale ab eximio doctore Vincentio alme Beluacensis ecclesie presule :
.., editum : feliciter finit. Impensisque non mediocribus et cura
solertissima Hermanni liechtenstein Coloniensis agrippine colonie : Nec
non emendatione diligentissima est Impressum Anno. Salutis. M.CCCC.
LXXXXIIII. Idibus may. Venetiis Sedente Diuo Alexandro VI. pontifice
Maximo. Regnanteque Maximiliano primo Romanorum rege inuictissimo
Faustissimoque Semper Augusto388.
Speculum historiale. §
Au mois de septembre de la même année 1494, le Speculum historiale sortit enfin des presses du même typographe, qui
en donna une édition imprimée, comme la précédente, dans le format in-folio
en caractères gothiques avec signatures et feuillets numérotés, et terminée
par cette souscription presque identique : Operis
preclari Speculi communis Speculum historiale ab eximio || doctore
Vincentio almeque beluacensis ecclesie presule ac sancti {p. 454}dominici ordi-||nis professore editum feliciter finit.
Impensisque non mediocribus ac cura || solertissima Hermanni
liechtenstein Coloniensis agrippine colonie. || Nec non emendatione
diligentissima est impressione completum anno || Salutis. M.CCCC.XCIIII.
nonis Septembris in inclita vrbe Venetiarum. || Cuius Hermanni bone
memorie heredibus (e vita enim paulo ante ab-||solutionem operis
discesserat) Illu. Dn̄iuӡ Venet. ex gratia speciali con-||cessit ut nemo
alius per decennium id quoad eius partes quattuor videlicet || Naturale
doctrinale morale et historiale imprimere aut imprimi facere || audeat
sub pena pro vnoquoque libro ita impresso inuento decem ducato-||rum ad
mulctandum in terris ipsi Dominio subiacentibus sicut in eorum gratia ||
clarius continetur anno et die uti. s̄. data Sedente diuo Alexandro VI.
|| pontifici Maximo Regnanteque Maximiliano primo Romanorum || rege
etc. Inuictissimo felicissimoque semper Augusto || Finis389.
Comme on le voit par cette souscription, Hermann Liechtenstein n’avait point eu la satisfaction de voir sa grande entreprise achevée. Peu de temps avant qu’elle n’eût été terminée, la mort l’avait frappé.
§ 9. — Édition de Venise de 1591. §
À partir de la fin du xve siècle Vincent de Beauvais fut presque oublié, et son œuvre ne fut plus imprimée en latin qu’à de longs intervalles.
Dominique Nicolin en fit bien paraître une édition in-folio à Venise en 1591 ; mais elle n’offre qu’un texte altéré.
§ 10. — Édition de Douai. §
À Douai, une édition en 4 vol. in-folio, fut publiée avec ce
frontispice : Bibliotheca mundi Vincentii burgundi…
episcopi bellovacensis speculum quadruplex, opera et studio theologorum
benedictorum collegii Vedastini. Duaci, Balth. Bellerus,
1624.
Daunou juge cette édition pire que la précédente. Il prétend que, pour prendre une connaissance exacte de l’œuvre de Vincent de Beauvais, il faut encore aujourd’hui recourir aux premières éditions, surtout à celle de Mentellin de 1473390.
Éditions françaises. §
§ 1. — Édition de Buyer. §
Des œuvres de Vincent de Beauvais la plus intéressante était le
Miroir historial. Aussi est-ce lui qui fut traduit le premier en langue
française. La traduction due à Jean de Vignay en fut pour la première fois
publiée à Lyon en 1479 par Bartholomieu Buyer, et l’édition in-4º qui la
renferme se termine par cette souscription : Imprime a
Lyon sur le Rosne en la maison de maistre Bartholomieu Buyer citoyen de
Lyon et fini le dernier de Juillet, mil quatre cen LXXIX391.
§ 2. — Édition de Verard. §
L’édition française du Miroir historial, imprimée par Buyer, n’est pas la seule qui ait paru au xve siècle. Le Miroir historial fut encore publié à Paris par Verard, de 1495 à 1496. Cette édition extrêmement rare forme cinq volumes du grand format in-folio, imprimés en caractères gothiques à deux colonnes et ornés de gravures sur bois. Il paraît que ces cinq volumes ont été imprimés en huit mois, c’est-à-dire avec une rapidité qui aujourd’hui ne pourrait guère être dépassée. Il n’en existe que très peu d’exemplaires. Celui sur lequel j’ai rédigé l’analyse qui va suivre, se trouve à la Bibliothèque nationale et figure sous la cote G 203 à G 207 au tome V de l’Inventaire alphabétique de l’histoire générale.
Tome I, comprenant les huit premiers livres.
Il se compose d’abord de dix feuillets préliminaires signés,
mais non paginés, dont voici le contenu : Fol. 1 a. Titre
ainsi conçu : Le premier vo||lume de Vincent || miroir
historial || nouuellement Im-||prime a
Paris.
— Fol. 1 b. Belle gravure sur bois.
— Fol. 1 b à 10 b. Prologue, table et
répertoire des cahiers.
Viennent ensuite les feuillets signés et numérotés. Ces feuillets, dont les signatures vont de a 1 à z 4 et de aa 1 à rr 5, ne seraient, {p. 456}d’après leur numérotage, qu’au nombre de 311 ; mais c’est une erreur ; car, si l’on se réfère à la table des cahiers, on voit qu’il y en a 39 de 8 feuillets et un dernier de 10.
Au recto du dernier feuillet les huit premiers livres du Miroir
historial se terminent par cette souscription placée sur la deuxième colonne :
Cy finist le premier volume de || Vincent hystorial.
Imprime nou||vellement a Paris l’an CCCC || quatre vingt et quinze : le
XXIXe iour. || de septembre. Pour Antoine Verard ||
libraire demourant sur le pont nostre || dame a lymage Saint Jehan
leuan||geliste : ou au palays au premier pili||er deuant la chapelle ou on
chante || la messe de messeigneurs les presidens.
Tome II, comprenant les livres IX à XV.
Il se compose d’abord de 12 feuillets préliminaires signés,
mais non paginés, dont le premier porte au recto le titre suivant : Le second volume || de Vincent mi||roir historial || nouvellement imprime a Paris.
Le reste des feuillets
préliminaires est occupé par la table et le répertoire des cahiers.
Viennent ensuite les feuillets signés et numérotés. Les signatures de ces feuillets vont de aa 1 à nn 2, de aaa 1 à xxx 4 et de aaaa I à llll 3. Les cahiers sont toujours de huit feuillets, sauf le cahier nn qui n’en comprend que 4 et le cahier llll qui n’en comprend que 6. D’après leur numérotage, les feuillets seraient au nombre de 353 ; mais ce numérotage doit être inexact ; car, si l’on considère que, d’après la table des cahiers, il y a 43 cahiers de 8 feuillets chacun, un de 4, et un dernier de 6, on arrive forcément au chiffre de 354.
Le contenu du deuxième volume se termine au verso du dernier
feuillet par cette souscription placée au bas de la première colonne :
Cy finist le xve liure du miroir
|| historial. Et commence le xvie.
Tome III, comprenant les livres XVI à XXII.
Il se compose d’abord de 12 feuillets préliminaires signés,
mais non paginés, dont le premier porte au recto le titre suivant : Le tiers volume de || Vincent miroir || historial || Nouuellement imprime a Paris.
Le surplus, sauf le
dernier feuillet qui est blanc, est occupé par la table et le répertoire des
cahiers.
Viennent ensuite les feuillets signés et numérotés. Les signatures de ces feuilletsvont de a 1 à g 3, de A 1 à X 4 et de AA 1 à OO 4. Les cahiers sont de 8 feuillets, à l’exception des cahiers d, e, f, qui {p. 457}ne contiennent chacun que 6 feuillets. Il y a 39 cahiers de 8 feuillets et 3 de 6 ; ce qui, conformément au numérotage, donne un total de 330 feuillets.
Le contenu du troisième volume se termine au verso du dernier
feuillet par cette souscription placée au bas de la première colonne :
Cy finist le vingt et deuziesme || liure du miroer
hystorial.
Tome IV, comprenant les livres XXIII à XXVII.
Il se compose d’abord de 10 feuillets préliminaires signés,
mais non paginés, dont le premier porte au recto le titre suivant : Le quart volu||me de Vincent || miroir historial || Nouuellement imprime a Paris.
Le surplus est occupé
par la table et le répertoire des cahiers.
Viennent ensuite les feuillets signés et numérotés. Les
signatures des cahiers vont d’abord de aaaa 1 à zzzz 4 ; puis il y en a 2 signés 
Le contenu du volume se termine au recto du dernier feuillet
par cette souscription qui se trouve sur la première colonne : Cy fine le xxviie liure || Du miroir
hystorial.
Tome V, comprenant les livres XXVIII à XXXII.
Il se compose d’abord de 8 feuillets préliminaires dont le
premier porte au recto le titre suivant : Le quint volume
|| de Vincent mi||roir hystorial || nouuellement
imprime a Paris.
Le surplus est occupé par la table ; le
répertoire des cahiers fait défaut.
Viennent ensuite les feuillets signés et numérotés. Les
signatures de ces feuillets vont d’abord de aaaaa 1 à zzzzz 4 ; puis il y a deux cahiers signés 
Le contenu du cinquième volume se termine au recto du dernier
feuillet par cette souscription placée au bas de la deuxième colonne :
A l’honneur et louenge De nostre || seigneur iesuscrit
et de sa glorieuse || et sacree mere, et de la cour celeste || de paradis
fine le xxxii. et derre||nier liure de Vincent miroir histo||rial. Imprime
a Paris le vii. iour || du moys de May mil quatre cens || quatre vingz et
seize, par Anthoine || Verard libraire demourant sur le || pont nostredame
a lymage saint || Jehan leuangeliste, ou au palaiz de||uant la chapelle ou
on chante la || messe De messeigneurs les presidens.
{p. 458}Chacun des 32 livres est précédé d’une grande et belle gravure sur bois, qui occupe presque toute la page.
§ 3. — Édition de Nicolas Couteau. §
La traduction française de Jean de Vignay fut réimprimée au xvie siècle par Nicolas Couteau. L’édition de cet imprimeur, comme celle de Verard, forme cinq volumes in-folio, dont les feuillets, imprimés en caractères gothiques sur deux colonnes, sont signés et numérotés. L’imprimeur en avait fait trois tirages différents pour les trois libraires François Regnault, Galliot du Pré et Jean Petit. Voici la description de l’édition :
Tome I, comprenant les huit premiers livres du Miroir historial.
Il se compose d’abord de 8 feuillets signés, mais non chiffrés.
Fol. 1 a. — En tête titre ainsi conçu :
Le premier volu||me de Vincent Miroir || hystorial nouuellement imprime a Paris.
Au bas du
frontispice, dans les exemplaires destinés à J. Petit, on lit : Ils se vendent en la rue Sainct-Jacques a Paris || a lenseigne de
Lelephant deuant les mathurins || Mil. V. C. xxxi
, et dans
ceux destinés à Galliot du Pré on lit : Ils se vendent en
la grant salle du palais au premier || pilier en la boutique de Galliot du
pre. || Mil. V. C. xxxi.
Ce frontispice est orné d’un encadrement xylographique, dans lequel est plusieurs fois répété le nom du libraire J. Petit, lorsque l’exemplaire lui est destiné. Dans ceux destinés à Galliot du Pré, le frontispice ne porte qu’une fois son nom et est orné d’un encadrement différent.
Fol. 1 b. — Magnifique gravure sur bois représentant Vincent de Beauvais à genoux devant saint Louis qui est lui-même assis sur son trône et entouré de sa Corte.
Fol. 2 à 8. — Table des matières.
Viennent ensuite 236 feuillets signés et numérotés. Les livres
du Miroir historial qu’ils contiennent sont terminés par cette souscription :
Cy finist le premier volume de Vin||cent mirouer
hystorial.
Tome II, comprenant les livres IX à XV.
Il se compose d’abord de 8 feuillets, dont le premier au recto
porte ce titre : Le second volume || de Vincent Miroir ||
hystorial
, dans un encadrement approprié au destinataire. Le
surplus des 8 feuillets est occupé par la table.
{p. 459}Puis viennent 260 feuillets signés
et numérotés qui contiennent les livres du Miroir historial terminés eux-mêmes
par cette souscription : Cy finist le. xve. liure de Vincent || miroir hystorial.
Tome III, comprenant les livres XVI à XXII.
Il se compose d’abord de 6 feuillets signés, mais non
numérotés, dont le premier au recto porte ce titre : Le
tiers volume de || Vincent miroir || hystorial.
Comme
précédemment ce titre est encadré. Le verso du premier feuillet et les cinq
feuillets qui suivent sont occupés par la table.
Puis viennent 243 feuillets signés et numérotés qui contiennent
les livres du Miroir historial terminés par cette souscription : Cy finist le. xxiie. liure de Vincent ||
miroir hystorial.
Tome IV, comprenant les livres XXIII à XXVII.
II se compose d’abord de 6 feuillets signés, mais non
numérotés, dont le premier au recto porte encadré ce titre : Le quart volume || de Vincent miroir || hystorial.
La table commence au verso du premier feuillet et occupe les cinq autres.
Puis viennent 202 feuillets signés et numérotés qui contiennent
les livres du Miroir historial terminés par cette souscription : Cy fine le xxviie liure du miroir ||
hystorial.
Tome V, comprenant les livres XXVIII à XXXII.
Il se compose d’abord de 6 feuillets signés, mais non
numérotés, dont le premier porte au recto ce titre : Le
cinquiesme || volume de Vincent || Miroir hystorial.
Le verso
du premier feuillet et les autres sont occupés par la table.
Puis viennent 218 feuillets signés et numérotés qui contiennent
les 5 derniers livres clos ainsi au recto du dernier feuillet : Cy fine le. xxxiie. et dernier liure de ||
Vincent miroir hystorial Nouuelle||ment imprime a Paris par Nicolas ||
couteau. Et fut acheue dimprimer || le. xvie. tour du
moys de mars Lan || mil cinq cēs. xxxi.
À ces mots, dans les
exemplaires destinés à F. Regnault, l’imprimeur a ajouté ceux-ci : pour François || regnault libraire iure de
luniuersite.
Le verso du même feuillet est occupé par une
gravure représentant un éléphant et sur son dos une tour ornée d’un écusson
sur lequel figurent les initiales de l’éditeur. Au-dessous de l’éléphant se
voit une banderole portant les mots François Regnault.
La Bibliothèque nationale, sous les cotes G. 209 et G. 210, et celle d’Épinal possèdent chacune un exemplaire de l’édition.
Éditions anglaises de Caxton. §
Toujours attentif aux grands ouvrages publiés en langue française et toujours ardent à les faire traduire et à les imprimer lui-même, Caxton fit paraître vers 1480 deux éditions anglaises du Miroir historial.
L’une se compose de cent feuillets sans lettres initiales. L’autre, qui n’a que 84 feuillets, est au contraire avec initiales et porte le sceau de l’imprimeur. Toutes les deux sont ornées de gravures.
Quant à leur date, elles ne la font qu’approximativement
connaître par cet avis qui se réfère, non au travail du typographe, mais à celui
du traducteur : The Myrroyr or th’ ymage of the World
translated out of Latin into Frenche and now translated out of Frenche into
English : began the second of January M.CCCC.LXXX. and finished the VIII. of
March the same year. Caxton me fieri fecit392.
Je ne connais pas d’autres éditions anglaises.
Éditions néerlandaises. §
Le Miroir historial, qui avait seul été publié en français et en anglais, fut seul aussi traduit en langue néerlandaise. Cette version, qui n’est qu’une traduction libre, est due à Jacob Van Maerlant, qui lui donna le titre de Spiegel historiael of Rymkronyk. Elle a été imprimée en quatre volumes in-8º à Leyde et à Amsterdam, les deux premiers, par Jacques Arnout Clignett et Jean Steenwinkel de 1784 à 1785, le troisième par V. Bilderdyk, en 1812, et le quatrième par Van Lennep, en 1849.
Telles sont dans leur ensemble les éditions des traductions du Miroir historial.
Deuxième collection.
Romulus du Collège du Corpus
Christi, à Oxford. §
Pendant les deux ou trois heures qu’il m’a été permis de passer au collège du Corpus Christi, je ne me suis pas borné à étudier le manuscrit 42 qui a été analysé plus haut ; j’ai aussi jeté un coup d’œil sur le manuscrit 86, que déjà, comme au docteur Oesterley, m’avait signalé le catalogue des manuscrits des collèges d’Oxford, publié dans cette ville, en 1852, par M. Henri O. Coxe.
C’est un petit in-folio du xive siècle, qui se compose de 241 feuillets en parchemin et dont l’écriture très lisible est sur deux colonnes.
Les fables qu’il renferme, commencent au fol. 113 verso et finissent au fol. 117 recto. Elles sont au nombre de 45.
Dans le prologue d’ailleurs très amoindri, l’imitateur, en homme clairvoyant, a intentionnellement laissé de côté Romulus et son fils Tiberinus qu’il a sans doute considérés avec raison comme des personnages imaginaires, et dans les fables il a constamment écourté le récit. Mais il n’en a pas moins conservé souvent les expressions de son modèle.
Reste à savoir quel a été son modèle.
Si, comme cela est supposable, les fables ne sont pas plus anciennes que le manuscrit qui les renferme, elles ne peuvent être un dérivé direct du Romulus primitif, qui à l’époque de leur naissance n’existait déjà plus.
On ne peut pour la détermination de leur source hésiter qu’entre le Romulus ordinaire et le Romulus de Vienne, qui, ainsi que je l’établirai plus loin, est, comme le Romulus ordinaire, un dérivé direct du Romulus primitif. Pour sortir d’embarras, ce qu’il y a, je crois, de mieux à faire, c’est, comme précédemment, de comparer les textes entre eux. Je vais donc montrer, par de courts extraits tirés des fables du Loup et de l’Agneau et de la Grenouille et du Rat, duquel des deux Romulus celui d’Oxford est le plus voisin :
Rom. ordinaire : ad rivum e diverso venerunt. Sursum bibebat Lupus.
Rom. de Vienne : ad quemdam e diverso venerunt rivum. Superius bibebat Lupus.
{p. 462}Rom. d’Oxford : ad rivum e diverso venerunt. Sursum bibebat Lupus.
Rom. ordin. : et innocenti vitam eripuit.
Rom. de Vienne : ac innocenti vitam abstulit.
Rom. d’Oxford : Sicque innocenti vitam eripuit.
Rom. ordin. : Mus cum transire vellet flumen a Rana petiit auxilium. Illa grossum petiit linum. Murem sibi ad pedem ligavit et natare cœpit.
Rom. de Vienne : Mus cum vellet flumen transire, a Rana petiit auxilium. Annuens illa petitioni, linum grossum poposcit. Quo sibi alligato Mure, natare cœpit.
Rom. d’Oxford : Mus cum transire vellet flumen, a Rana petiit auxilium. Rana grossum petens filum, Murem ad pedem sibi alligavit.
Après ces rapprochements le doute n’est plus possible. En effet dans la première fable le Romulus de Vienne contient le mot quemdam que ne possèdent ni le Romulus ordinaire ni celui d’Oxford ; ces deux derniers portent le mot Sursum, au lieu de Superius qui est dans celui de Vienne ; au mot eripuit que présentent le Romulus ordinaire et celui d’Oxford celui de Vienne substitue abstulit. Si nous passons aux extraits de la fable suivante, nous voyons qu’en général l’ordre des mots qui est le même dans les Romulus ordinaire et d’Oxford, ne s’accorde pas avec celui qui a été adopté dans le Romulus de Vienne, et, détail spécial et topique, ce dernier ne dit pas, comme les deux autres, que c’est à sa patte que la Grenouille attache le fil par lequel elle tient le Rat. C’est donc du Romulus ordinaire que celui d’Oxford est l’abrégé.
J’ai dit que cet abrégé se composait de quarante-cinq fables.
En voici la nomenclature avec l’indication de celles qui y correspondent dans le Romulus ordinaire.
| Ms. 86. | Romulus ordinaire. |
| Prologue. | Dédicace. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1 |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5 |
| 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| 7. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 8. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| 9. Le Serpent mourant de froid. | I, 10. |
| {p. 463}10. Le Rat de Ville et le Rat des Champs. | I, 12. |
| 11. L’Aigle et le Renard. | II, 8. |
| 12. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| 13. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. |
| 14. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 15. |
| 15. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. |
| 16. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| 17. L’Épervier malade. | I, 18. |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 19. |
| 19. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. |
| 20. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 21. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| 22. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| 23. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 24. Le Loup et le Chevreau. | II, 10. |
| 25. Le Serpent et le Pauvre. | II, 11. |
| 26. Le Renard et la Cigogne. | II, 14. |
| 27. Le Geai vaniteux. | II, 16. |
| 28. La Mouche et la Mule. | II, 17. |
| 29. La Mouche et la Fourmi. | II, 18. |
| 30. L’Homme et la Belette. | II, 20. |
| 31. La Grenouille qui s’enfle. | II, 21. |
| 32. Le Lion médecin. | III, 2. |
| 33. Le Cheval et l’Âne. | III, 3. |
| 34. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| 35. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| 36. Le Renard et le Loup. | III, 6. |
| 37. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. |
| 38. L’Inconstance de la Femme. | III, 9. |
| 39. La Vipère et la Lime. | III, 12. |
| 40. Les Loups et les Brebis. | III, 13. |
| 41. La Hache et les Arbres. | III, 14. |
| 42. Le Loup et le Chien. | III, 15. |
| 43. L’Estomac et les Membres. | III, 16. |
| 44. Le Singe et le Renard. | III, 17. |
| 45. Le Marchand et l’Âne. | III, 18. |
Devant publier le texte de ces fables dans le second volume de cet ouvrage, je m’abstiens ici de toute autre explication.
Troisième collection.
Romulus de Munich. §
Examen des fables. §
Quand on examine la collection du manuscrit 5337 de la Bibliothèque royale de Munich, on voit que, sous 39 chapitres, comprenant 40 fables, elle en présente d’abord vingt-cinq premières, qui non seulement par le fond descendent du Romulus ordinaire, mais qui en sont encore par la forme une imitation servile, puis quinze dernières, qui, presque toutes par les sujets et toutes sans exception par les développements littéraires, s’en écartent complètement. Dans cette situation j’aurais pu considérer les vingt-cinq premières fables et les quinze dernières comme formant deux collections indépendantes et voir dans la première, ainsi séparée de la seconde, un dérivé uniquement tiré du Romulus ordinaire, et dans la seconde elle-même un dérivé mixte, issu d’éléments variés. Mais, en m’astreignant à suivre mon plan avec cette inflexibilité, je me serais, faute de l’avoir, en une fois, examiné tout entier, mis dans la nécessité de revenir plus tard au même manuscrit. Cela n’était pas impossible ; mais, comme il n’était pas non plus nécessaire d’opérer cette division, j’ai pris le parti de considérer les quarante fables comme formant dans leur ensemble un seul dérivé mixte et comme ne comportant qu’une seule analyse. Je vais donc, pour en faire connaître le contenu, donner la liste entière des fables dont il se compose, accompagnées de leur corrélation avec les collections plus anciennes qui en ont été les principales sources.
| Romulus de Munich. | Romulus ordinaire. | Fabulæ extravagantes. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. | |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. | |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. | |
| {p. 465}4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. | |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. | |
| 6. La Vache, la Chèvre, la Brebis et le Lion. | I, 6. | |
| 7. Le Soleil qui se marie. | I, 7. | |
| 8. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. | |
| 9. L’Epervier malade. | I, 18. | |
| 10. Le Chien et le Voleur. | II, 3. | |
| 11. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. | |
| 12. Le Loup accoucheur. | II, 4. | |
| 13. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 15. | |
| 14. Le Lion et le Rat. | I, 17. | |
| 15. Le Renard et la Cigogne. | II, 14. | |
| 16. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. | |
| 17. Le Chauve et la Mouche. | II, 13. | |
| 18. Le Geai vaniteux. | II, 16. | |
| 19. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | II, 19. | |
| 20. Le Loup et le Berger. | IV, 3. | |
| 21. La Courtisane et le Jeune Homme. | III, 10. | |
| 22. La Vipère et la Lime. | III, 12. | |
| 23. L’Âne et le Lion. | IV, 10. | |
| 24. La Puce et le Chameau. | IV, 18. | |
| 25. La Fourmi et le Grillon. | IV, 19. | |
| 26. Le Mulet, le Renard et le Loup. | 1. | |
| 27. Le Verrat, les Agneaux et le Loup. | 2. | |
| 28. Le Renard, Le Coq et les Garçons de ferme. | 3. | |
| 29. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 9. | |
| 30. Le Dragon, le Paysan et le Renard. | 4. | |
| 31. Le Chat et le Renard. | 5. | |
| 32. Le Loup et le Bouc. | 6. | |
| 33. Le Loup et l’Âne liés ensemble. | 7. | |
| 34. Le Paysan, son Fils et le Serpent. | 8. | |
| 35. Le Loup à qui le Renard conseille de pêcher. | 9. | |
| 35 a. Le Lion malade, le Loup écorché et le Renard. | 9 bis. | |
| 36. Le Loup ambitieux. | 10. | |
| 37. Le Chasseur, le Lièvre et le Laboureur. | ||
| 38. Le Rat invité par la Grenouille à dîner. | ||
| 39. Le Maître avare, le Chien et le Loup. | 12. |
On voit par ce tableau que les vingt-cinq premières fables ont bien toutes un Romulus pour origine. Mais quand on examine leur {p. 466}texte, on ne peut avoir d’incertitude sur celui qui a été leur source : c’est bien du Romulus ordinaire qu’elles sont dérivées ; car, si de temps en temps elles s’en éloignent sensiblement, souvent aussi elles en sont la copie littérale ou n’en diffèrent que par quelques variantes.
Quant aux quinze dernières, elles sont très différentes : il n’y en a qu’une, la xxixe, qui soit issue du Romulus ordinaire, où elle est la ixe du Livre II. Les xxvie, xxviie et xxxiiie correspondent aux fables viii, xx et xxii du Romulus mixte de Berne. La fable xxviii correspond à la sixième du Dérivé partiel du Romulus anglo-latin et à la cinquantième du Dérivé complet de ce Romulus, et la fable xxxi a sa correspondante dans la cent vingt-neuvième de ce dernier Dérivé. Les deux réunies sous le nº xxxv ont leurs similaires, la première et la seconde, dans celles du Romulus mixte de Berne placées sous le nº xxiii, et la seconde seule, dans les fables xxi du Dérivé partiel du Romulus anglo-latin et lix du Dérivé complet de ce Romulus. Enfin les fables xxxviii et xxxix se retrouvent dans les vingt-quatrième et vingt-cinquième du Romulus mixte de Berne.
Il est probable que les fables dont les sujets se retrouvent dans les Dérivés partiel et complet du Romulus anglo-latin, ont été empruntées à l’un ou à l’autre de ces Dérivés ou directement au Romulus anglo-latin lui-même. Mais ce n’est pas à dire, parce qu’il y a aussi corrélation entre quelques fables du Romulus de Munich et du Romulus mixte de Berne, qu’on doive voir dans celles du premier la paraphrase de celles du second. Il est plus vraisemblable que celles du second sont au contraire les moins anciennes et qu’il faut les considérer comme un abrégé des autres.
Quant aux fables xxx, xxxii, xxxiv, xxxvi et xxxvii, je ne peux en indiquer l’origine ni même en signaler de semblables dans d’autres collections. Peut-être quelques-unes d’entre elles sont-elles originales.
Les quinze fables qui forment la seconde partie de la collection du Romulus de Munich, ont été presque toutes publiées dans l’édition d’Ulm. Le Dr Steinhöwel en a introduit douze dans le groupe de dix-huit qu’il a intitulé Fabulæ extravagantes.
Quant aux six autres qui complètent ce groupe, je les publierai en les empruntant à son édition.
Les Fabulæ extravagantes n’avaient pas échappé à l’attention de {p. 467}Jacob Grimm qui ne les avait pas trouvées indignes d’être publiées. Les huit qui dans l’édition d’Ulm portent les nos 1, 3, 5, 7, 9 (première partie), 9 (deuxième partie), 10 et 14, ont été insérées par lui, avec une autre qui leur est étrangère, à la fin du Reinhart Fuchs, qu’il a édité en 1834393.
Il est toutefois permis de se demander pourquoi il s’en est tenu à ces huit fables. Il semble qu’il aurait dû ne pas faire de choix et faire figurer toutes les extravagantes à la fin de son livre. Quant à moi, considérant qu’elles n’ont guère plus de valeur les unes que les autres, je ne ferai aucune sélection entre ces diverses fables, et je reproduirai dans mon second volume non seulement toutes celles du manuscrit de Munich, mais encore les six qui, dans l’édition de Steinhöwel, en sont le complément et même celle que, quoiqu’elle n’en fît pas partie, M. Grimm avait cru bon de ne pas négliger.
Description du manuscrit. §
Le manuscrit 5337, qui renferme la collection du Romulus de Munich, provient de l’ancienne bibliothèque épiscopale de Chiemsee (Bavière supérieure), dans laquelle il portait la cote 37, et appartient aujourd’hui à la bibliothèque royale de Munich. Il forme un volume in-fol. composé de 334 feuillets, dont l’écriture à longues lignes est du xve siècle, et contient divers ouvrages dont le catalogue imprimé394 donne la nomenclature suivante :
Fol. 1. Petri Blesensis epistolae.
Fol. 203. Ordinatio principum imperii s. Caroli IV bulla aurea.
Fol. 218. Priuilegium (fictum) ecclesiae Romanae sanctae ab Imp. Constantino Magno datum.
Fol. 226. De priuilegiis et confirmationibus.
Fol. 250. Libellus fabularum Esopi cati.
Fol. 266. Liber dictaminis decori qui dicitur flos Monachi. Praecedit index 121 capitulorum. Inc. : « Illi soli uirtutem uerae caritatis agnoscunt etc. »
{p. 468}Fol. 324. Poggii Florentini orationes quaedam. Extrema folia exsecta sunt.
Les fables signalées par cette nomenclature occupent les feuillets 250 a à 266 b.
Elles portent à l’encre rouge cette suscription : Incipit libellus fabularum esopi cati
, sont pourvues
de titres également à l’encre rouge, et se terminent par cette souscription :
Esopus explicit etc. Finis libelli fabularum Esopi
etc.
Quatrième collection.
Romulus mixte de Berne. §
Les fables que j’ai maintenant à analyser, sont contenues dans un manuscrit de la bibliothèque cantonale de Berne où il porte le nº 676. C’est un petit in-4º dont l’écriture à deux colonnes sur vélin est du xiiie siècle.
Les fables qui occupent les feuillets 80 a
à 96 b, sont annoncées par cette suscription : Hic incipiunt fabule Ysopi
, mais ne portent pas de
titres particuliers. Elles sont au nombre de 95 et peuvent se diviser en deux
groupes comprenant, le premier, sous 47 chapitres, les 48 premières, et le second,
sous 42 chapitres, les 47 dernières395.
Je laisse de côté le second groupe uniquement composé de fables
d’Eude de Cherrington. Dans la première édition de cet ouvrage j’ai analysé et
publié l’œuvre de ce moine ; j’y avais été entraîné par des raisons que j’ai alors
exposées et qu’aujourd’hui encore je crois plausibles396. Mais M. Gaston Paris n’a pas été de mon avis. Voici comment,
dans son analyse critique de mon travail, il s’exprime sur ce point : « Sur
les 116 morceaux (rangés sous 79 numéros) qui composent le Liber
parabolarum d’Odon de Cerington, il n’y en a guère qu’une quinzaine qui
remontent à cette source, et l’on peut se demander si la place d’Odon était bien
marquée parmi les imitateurs, même indirects, de Phèdre397. »
{p. 469}Tenant compte de cette observation, je laisserai Eude
de Cherrington en dehors des dérivés de Phèdre, et plus tard, si j’en ai la force
et le loisir, je lui consacrerai un volume spécial. Quant à présent, je me
restreins à la première partie de la collection.
Comme le Romulus d’Oxford que j’ai décrit plus haut398, c’est un dérivé latin en prose qui est en même temps un abrégé ; seulement le Romulus ordinaire, au lieu d’en être la source unique, en est seulement la principale ; car cet abrégé présente en même temps d’évidentes affinités avec le dérivé complet du Romulus anglo-latin, avec le Romulus de Munich et même avec les fables d’Eude, qui, quoique la seconde partie de la collection leur ait été spécialement affectée, n’en font pas moins sentir leur influence dans la première.
Pour qu’on puisse s’en convaincre, je vais donner la liste des quarante-huit fables qui forment la première partie de la collection et indiquer en même temps leur corrélation avec leurs principales sources :
|
Romulus ordinaire.
|
Dérivé complet du Romulus anglo-latin. |
Eude399.
|
Romulus de Munich.
|
|
| 1. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. | 2. | 32. | 2. |
| 2. L’Aigle et sa fille. | I, 7. | 8. | ||
| 3. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. | 14. | 82. | 8. |
| 4. Le Lion vieilli, le Sanglier et l’Âne. |
I, 15. |
15. |
13. |
|
| 5. Le Lion et le Rat. | I, 17. | 17. | 14. | |
| 6. Le Loup et le Berger. | IV, 3. | 78. | 20. | |
| 7. Le Lion et l’Âne. | IV, 10. | 83. | 23. | |
| 8. Le Mulet, le Loup et le Renard. | 26. | |||
| 9. Le Lion malade, le Loup et le Renard. | ||||
| 10. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. | 3. | 25 b. | 3. |
| 11. Le Chien et la Brebis. | I, 4. | 4. | 4. | |
| 12. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. | 5. | 73. | 5. |
| 13. La Vache, la Chèvre et le Lion. | I, 6. | 7. | 6. | |
| 14. L’Épervier malade. | I, 18. | 71. | 9. | |
| 15. Le Chien et le Voleur. | II, 3. | 21. | 10. | |
| 16. Le Renard et la Cigogne. | II, 14. | 93. | 15. | |
| 17. Le Cerf à la fontaine. | III, 7. | 28. | 16. | |
| 18. Le Geai vaniteux. | II, 16. | 58. | 18. | |
| {p. 470}19. La Cigale et la Fourmi. | IV, 19. | 87. | 25. | |
| 20. Le Verrat, les Agneaux et le Loup | 27. | |||
| 21. Le Renard, le Coq et les Garçons de ferme. | 50. | 28. | ||
| 22. Le Loup et l’Âne liés ensemble. | 33. | |||
| 23. Le Loup à qui le Renard conseille de pêcher. | 86. | 35. | ||
| 23 a. Le Lion malade, le Loup écorché et le Renard. | 59. | 35 a. | ||
| 24. Le Rat invité par la Grenouille à dîner. | 38. | |||
| 25. Le Maître avare, le Chien et le Loup. | 39. | |||
| 26. Le Jeune Homme qui veut entrer en religion. | ||||
| 27. Le Singe, son petit et l’Ours. | ||||
| 28. Le Chien qui garde son maître tué. | ||||
| 29. L’Enfant qui se noie et le Chien qui le sauve. | ||||
| 30. Le Lion et le Berger. | III, 1. | 25. | ||
| 31. Le Bélier et son maître. | ||||
| 32. Le Renard et le petit Oiseau. | ||||
| 33. Le Loup et le Renard affamé. | ||||
| 34. La Cigogne infidèle. | ||||
| 35. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. | 19. | 1 b. | |
| 36. Le Bélier, les Brebis et le Loup. | ||||
| 37. Le Renard et le Singe infirme. | ||||
| 38. Le Chien et le Porc. | ||||
| 39. Le Lion confesseur. | ||||
| 40. Le Rat, son Fils, le Coq et le Chat. |
||||
| 41. Le Coq et son Maître. | ||||
| 42. Le Mulot qui cherche femme. | 75. | |||
| 43. La Grenouille qui s’enfle. | II, 21. | 96. | 74. | |
| 44. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 9. | 24. | ||
| 45. Le cadeau du Renard au Loup. | ||||
| 46. L’Âne qui caresse son Maître. | I, 16. | 16. | 81. | |
| 47. Le Chien qui demande un os à son Maître. |
{p. 471}Les quarante-huit fables dont se compose cette liste offrent un intérêt spécial. D’abord, par la forme s’éloignant beaucoup des fables plus anciennes dont elles sont issues, elles deviennent, pour ainsi dire, autant de créations nouvelles. Ensuite, dérivées en partie du Romulus de Munich, elles permettent, vu l’âge du manuscrit qui les possède, d’affirmer que ce Romulus, quoique conservé par un manuscrit du xve siècle, remonte au moins au xiiie. Enfin, si elles proviennent pour la plupart des quatre sources principales auxquelles je les ai rattachées tout à l’heure, il n’en est pas moins vrai que quelques-unes d’entre elles paraissent être entièrement originales.
Malheureusement quelque chose diminue leur valeur philologique : c’est la défectuosité de leur texte. La copie contenue dans le manuscrit 679 est probablement due à un scribe, qui avait sous les yeux un modèle difficile à lire et qui, ignorant la langue latine, ne pouvait substituer aux mots illisibles pour lui que des mots barbares n’ayant du latin que l’apparence. On ne peut s’expliquer autrement les fautes grossières dont le manuscrit pullule.
Chapitre III.
Collections en vers. §
Première collection.
Fables de Walther
l’Anglais. §
Source des fables de Walther l’Anglais. §
Les fables du Romulus ordinaire n’ont pas seulement servi de base à des compilations en prose ; elles ont encore inspiré des collections de fables en vers ; elles paraissent notamment avoir donné naissance à celle de l’auteur qu’on appelle encore aujourd’hui l’Anonyme de Névelet. C’est celle qui va la première arrêter mon attention,
Tous les critiques qui ont cherché à découvrir l’origine de ces fables, sont partis de cette idée qu’il avait existé un auteur nommé Romulus et que son œuvre consistait dans la collection que j’ai baptisée du nom de Romulus ordinaire. Ne supposant pas qu’il y eût d’autres collections susceptibles d’être revêtues du nom de Romulus, ils ne pouvaient se poser la question de savoir à laquelle il fallait rattacher les fables de l’Anonyme ; ils ne pouvaient que se demander si celle qui seule existait pour eux, en avait été la source.
C’est réduit à ces termes simples que le problème se présenta à {p. 473}Lessing400, qui, dans sa dissertation sur Romulus et Rimicius, entreprit le premier de le résoudre : il démontra que c’était, non du second, mais du premier que les fables de l’Anonyme étaient issues.
À son tour M. Robert crut que ce qu’il y avait à décider, c’était
si ces fables venaient directement de Phèdre, ou d’un compilateur prosaïque
nommé Romulus. Dans la préface de son édition des fables de La Fontaine,
envisageant ainsi la question, il constate qu’en dehors des sujets les fables de
Phèdre et celles de l’Anonyme n’ont rien de commun, que cependant il existe
entre elles un trait d’union, qu’en effet, comme dans les fables de Romulus on
reconnaît « les sujets et les vers de Phèdre »
, de même celles de
l’Anonyme, comparées à celles de Romulus, offrent les mêmes sujets et des idées
et des expressions souvent identiques.
« Je pourrais, dit-il401, en présenter plus d’un exemple ; mais je craindrais d’entrer dans de trop longs détails. Je me bornerai à celui-ci, que m’offre la moralité d’une fable dont j’ai déjà parlé, et que notre La Fontaine a imitée : l’Œil du Maître.
Phèdre, f. 39. —
Romulus, f. 59. —
Hæc fabula docet quemlibet exulem non esse suum. sed cum alienis incautè vivere, et dominum debere attentum esse in rebus suis disponendis. Galf., f. 59. —
« Il me semble, ajoute-t-il, que l’on peut déjà voir, si l’on veut lire avec attention cette fable dans les trois auteurs, que Romulus sert d’intermédiaire entre le premier et le troisième. »
Se plaçant au même point de vue, M. Fleutelot déclare qu’il est
impossible, quand on a les trois auteurs sous les yeux, « de ne pas
suivre, de ne pas toucher au doigt la filiation des textes au moyen de
certains traits communs à Phèdre et à Romulus, combinés dans ce dernier avec
d’autres qui ne sont plus communs qu’à Romulus et {p. 474}à
l’Anonyme. »
Et à l’exemple déjà fourni par M. Robert il ajoute le
suivant, tiré de la fable Musca et Mula :
Phèdre :
Romulus :
Verba tua non pavesco, sed hujus, qui prima sella sedet, qui frenis ora temperat.
Anonyme :
En somme Lessing et MM. Robert et Fleutelot n’ont rien démontré. Il était bien certain que l’Anonyme de Névelet ne s’était servi ni de Phèdre, ni de Ranutio d’Arezzo. Ce qu’il s’agissait uniquement de faire, c’était de découvrir, parmi les collections de fables en prose latine dérivées de celle qui avait été la première affublée du pseudonyme de Romulus, celle dont s’était servi l’Anonyme de Névelet. Voilà quel était le vrai problème.
La solution n’en était pas très aisée, et la raison en est facile à comprendre. En effet l’Anonyme de Névelet, en composant sa traduction en vers élégiaques, a si bien substitué sa forme à celle de son modèle qu’il est presque impossible de trouver dans son œuvre une expression, qui, alors surtout que certains Romulus ont entre eux tant de ressemblance, autorise à la rapporter avec certitude à l’un plutôt qu’à l’autre.
Si du moins dans les manuscrits, quand un Romulus accompagne les fables de l’Anonyme, c’était toujours le même, cet indice significatif permettrait de sortir d’embarras. Mais il n’en est pas ainsi : tandis que, dans le manuscrit 3121 de la Phillip’s library, c’est au Romulus ordinaire qu’elles sont jointes, dans le manuscrit de Berlin Lat. 8º 87, c’est au Romulus de Vienne qu’elles sont ajoutées.
Il est vrai que, lorsque des manuscrits on passe aux vieilles éditions, on ne trouve plus l’Anonyme uni qu’au Romulus ordinaire. Mais cela ne prouve qu’une chose, c’est qu’à l’époque à laquelle l’imprimerie a été découverte, les éditeurs ne connaissaient que les manuscrits de ce Romulus ; ce qui d’ailleurs s’explique aisément par ce motif que c’étaient les plus nombreux.
Le doute quant à la vraie origine ne pouvant, à mes yeux, subsister {p. 475}qu’entre le Romulus ordinaire et celui de Vienne, j’ai essayé de comparer simultanément ces deux textes avec celui de l’Anonyme. Si cette comparaison n’a pas été bien probante, elle n’est pas non plus restée sans résultat. Voici, par exemple, ce que dans la fable de la Grenouille et du Rat les trois collections m’ont offert :
Rom. ordinaire.
Ila grossum petiit linum ; Murem sibi ad pedem ligavit.
Rom. de
Vienne.Annuens illa petitioni, linum grossum poposcit. Quo sibi alligato Mure, natare cœpit.
Anonyme :
Dans l’Anonyme, comme dans le Romulus ordinaire, c’est bien à sa patte que la Grenouille attache le fil qui retient le Rat. Dans le Romulus de Vienne on ne trouve pas ce détail.
Sans être absolument sûr de ne pas se tromper, on peut, en se fondant sur cet exemple, trancher la question de filiation en faveur du Romulus ordinaire. Obligé de prendre un parti, c’est pour cette solution que j’ai opté. Dès lors c’était dans ce chapitre que les fables de l’Anonyme devaient figurer. Je vais les y introduire, et, comme elles ont eu, à la fin du moyen âge et au commencement de la renaissance, une vogue vraiment incroyable et qu’elles ont éveillé l’attention de presque tous les commentateurs du fabuliste romain, c’est une très large place que je vais ici leur ménager.
Dissertation sur le véritable auteur des fables en vers élégiaques. §
Longtemps on s’est livré sur l’Anonyme de Névelet à des conjectures erronées. Je crois avoir trouvé son vrai nom dans un manuscrit dont il sera bientôt question, et cependant je dois avouer qu’en général les manuscrits fournissent des indications plus propres à entraver qu’à faciliter la solution du problème. Toutes sont des variations plus ou moins extravagantes sur la fictive dédicace {p. 476}à Tiberinus placée en tête du Romulus ordinaire. Je vais en passer en revue quelques-unes.
Dans le manuscrit 636 de la Bibliothèque de Parme les fables élégiaques sont attribuées à un certain Romulus qui les a traduites du grec à l’usage de son fils Tiburtinus. Ce Romulus ne serait pas le premier roi de Rome ; mais il en aurait été presque le contemporain ; car il serait mort sous le règne de Tarquin le Superbe.
Le manuscrit 4409 de la Bibliothèque royale de Munich présente un préambule qui n’est guère que la copie altérée de l’épître dédicatoire du Romulus ordinaire. Romulus y est bien présenté comme le traducteur latin des fables d’Ésope ; mais ce n’est pas à son fils, c’est à son père nommé Tibernius qu’il les adresse.
Dans le manuscrit 609 de la même Bibliothèque, on voit apparaître l’empereur Tibère, nom auquel celui de Tiberinus a dû conduire. Pour sa satisfaction personnelle, Romulus, appelé par erreur Romalus et qualifié de Latinus magister, est chargé par lui de faire un choix de fables amusantes. Romulus, pour lui complaire, commence par traduire en prose latine les fables grecques d’Ésope, puis il les met en vers.
Dans le manuscrit 237 de la même Bibliothèque, Romulus disparaît. L’empereur Tibère, toujours pour se distraire, demande directement à Ésope de compiler pour lui quelques fables joviales, et ce dernier, pour ne pas contrarier un si haut personnage, traduit en prose latine ses fables grecques.
La Bibliothèque Ambrosienne, sous la cote I. 85 supra nº 3, possède un manuscrit des fables élégiaques, dans lequel le commentateur, sans rien affirmer, relate les hypothèses qui ont cours en ce qui touche la personnalité de leur auteur. D’abord il expose qu’au dire de certaines personnes un Grec d’Athènes, nommé Ésope, a composé un livre de fables et que, suivant les uns, l’empereur Tibère à maître Romulus ou, suivant les autres, l’empereur Théodose à un certain Anglais a demandé de composer pour lui un livre à la fois utile et agréable. Ce serait ainsi qu’aurait été exécutée la traduction latine des fables d’Ésope dont le nom aurait été conservé à l’œuvre nouvelle.
La même incertitude relativement au nom de l’empereur se
manifeste dans un vieux manuscrit des fables en vers élégiaques cité par Barth
dans ses Adversaria Commentaria publiés à Francfort {p. 477}en 1624402. Il déclare avoir lu dans
le commentaire joint aux fables le passage suivant : « Æsopus magister
Atheniensium fuit. Quidam vero Imperator Romanorum rogavit
magistrum Romalium ut sibi aliquas jocosas fabellas
conscriberet, ad removendum publicas curas. Magister Romalius, non audens
precibus tanti viri contradicere, auctorem græcum in latinum
transtulit. »
Si dans ce passage le nom de l’empereur n’est pas
indiqué, en revanche aucun doute n’apparaît sur le savant à qui il a recouru :
c’est maître Romulus. Il est vrai que, dans le manuscrit, il était appelé
Romalius ; mais il est évident que ce nom n’était que l’altération de celui de
Romulus, commise par un copiste illettré.
Dans le manuscrit 216. NB. 1 de la Bibliothèque de l’Université de Ferrare, on ne voit surgir aucun doute sur le nom de l’empereur ; c’est Théodose qui prie Romulus, orateur et philosophe de premier ordre, de composer pour lui un livre unissant le charme à l’utilité. Romulus, ayant mis la main sur l’œuvre grecque de l’Athénien Ésope, la traduit en latin et envoie sa traduction à l’empereur sans vouloir la revêtir de son propre nom.
J’aurais pu, chemin faisant, produire des extraits des textes. Comme on les trouvera dans l’analyse que plus loin je ferai des manuscrits de l’Anonyme de Névelet, j’ai cru pouvoir, dans cet exposé, me dispenser de citations qu’on aurait à bon droit trouvées sans doute fastidieuses.
Je passe donc aux vieilles éditions de la seconde moitié du xve siècle.
Établies sur les manuscrits par des éditeurs peu clairvoyants elles durent nécessairement se ressentir de leur origine. Mais, grâce à ce que vraisemblablement peu de manuscrits furent utilisés pour leur préparation, les divagations des commentaires dont elles furent pourvues, si elles sont aussi insensées, offrent moins de variété. Il semble qu’à l’origine deux manuscrits seulement, pourvus de commentaires dissemblables, ont dû être employés, l’un par un éditeur, l’autre par un autre, et qu’ensuite les deux éditions originales furent suivies de réimpressions qui prolongèrent leur divergence.
Dans des éditions scolaires relativement nombreuses, le
commencement {p. 478}du commentaire consiste dans la reproduction littérale
d’une Préface dont j’ai parlé dans ma Dissertation sur Romulus, c’est-à-dire de
la Préface du Dérivé complet du Romulus anglo-latin. De ce début il résulterait
que, comme les fables en prose dont elles sont issues, les fables en vers
élégiaques auraient été une traduction latine de celles d’Ésope faite par
l’empereur Romulus pour l’instruction de son fils Tyberius (sic). Mais le commentaire ne s’arrête pas là. Un peu plus loin on peut y
lire une seconde explication, qui, sensiblement différente de la première, est
ainsi formulée : « Causa efficiens dicitur fuisse Æsopus qui erat
græcus ; unde, ut fertur, præsens liber conscriptus erat in græco ; sed postea
jussu Romuli imperatoris Romanorum fuit translatus in latinum ; et hoc propter
filios ejus quos voluit instrui per doctrinas hujus libri. »
On le
voit, l’indication primitive subit dans cet extrait une certaine déviation :
l’empereur Romulus n’est plus le traducteur ; il a seulement donné l’ordre de
traduire, et ce n’est plus seulement pour l’instruction de Tiberius, c’est pour
celle de tous ses fils qu’il a fait faire cette traduction.
Les fables de l’Anonyme de Névelet ne parurent pas seulement avec ce commentaire. Elles furent également publiées avec un autre tant dans des petits livres de classe qui leur étaient uniquement affectés que dans des livres plus volumineux renfermant les œuvres poétiques de huit auteurs latins. Il y avait parmi ces livres une édition originale, dont les autres n’étaient guère que la réimpression. On trouvera plus loin la nomenclature analytique de ces éditions, dont les premières, imprimées en 1884, sortirent des presses lyonnaises. Elles montrent d’abord l’empereur Théodose, pour son amusement personnel, chargeant Ésope de composer des fables grecques, puis, bien longtemps après, l’empereur Tibère priant dans le même but un savant nommé Romulus d’écrire pour lui des fables latines, enfin ce savant traduisant en latin les fables grecques d’Ésope.
Voici en quels termes tout cela est expliqué : « In
principio hujus libri quinque sunt inquirenda, scilicet : causa efficiens,
forma materialis et finalis utilitas, et cui parti philosophiæ supponitur, et
quis titulus. Causa efficiens est duplex, sc. : movens et non mota fuit
Theodosius ipse imperator vel miles qui petiit Æsopum ut sibi aliquas res
jocosas componeret ad removendum curas publicas : qui {p. 479}recusare non valens hoc opus composuit in græco : qui ipse
fuit græcus et ille fuit latinus… Istud autem opus fuit in græco sermone
compositum : diu a latinis jacuit intemptatum, donec Tiberius quidam imperator
romanorum rogavit magistrum Romulum, ut sibi aliquas fabulas jocosas, ad
removendum publicas curas, compleret et legeret ; iste autem magister Romulus,
non audens precibus tanti viri contradicere, librum suum utpote authenticum de
græco sermone in latinum transtulit. »
Il est impossible de lire de pareils contes sans en apercevoir l’insanité. Il est probable que, quoique contemporain de leur publication, Henri Bebel n’en avait pas eu connaissance ; car il n’hésita pas à attribuer les fables élégiaques à un certain Romulus, dont il ne faisait d’ailleurs aucun cas.
Après bien des recherches, j’ai trouvé, en Styrie, dans la
Bibliothèque de Grätz, sous la cote 43 a / 10 un exemplaire de
son opuscule intitulé : Qui auctores legendi sunt ad
eloquentiam comparandam
, imprimé à Pfortzeim chez Thomas
Anthelme et achevé au mois de mars 1504. Dans cet exemplaire j’ai lu ce qui
suit : « Esopus etiam Phrigius ille fabulator philosophusque
celeberrimus, uti etiam Quintiliano visum est, jucundus esset pueris. Verum a
Romulo quodam, ut dicitur, translatus est in carmen nulla
venere et lepore. »
En même temps que lui, Gyraldi tombait dans la même erreur. En
effet, dans son Histoire des poètes, cet illustre critique
s’exprimait en ces termes : « On pourrait aussi, au nombre de ces poètes,
compter le fameux Romulus, qui adressa à son fils Tybertinus un livre, dont
les fables imitées des apologues du Phrygien Ésope, furent appelées par lui
fables d’Ésope, quoique, comme certains le pensent, il
n’en eût pas été que le traducteur403. »
Gyraldi avait ainsi adopté la même thèse que Bebel. On se
l’explique d’autant moins que, déjà, de son temps elle était vivement combattue.
Il le déclarait lui-même en ces termes : « Vous ne pouvez vous figurer à
quel point certaines gens de Parme se tourmentent pour refuser à Romulus la
paternité de ce livre, pour l’attribuer à l’un de leurs concitoyens nommé
Salon, poète, qui, lorsqu’il {p. 480}étudiait à Athènes,
aurait, en les appropriant, disent-ils, à nos goûts, tiré du grec et versifié
ces fables404. »
Mais, tout en exposant cette revendication,
Gyraldi n’y ajoutait nullement foi.
Elle méritait peut-être un peu plus d’attention. Au moyen âge, en
effet, elle n’avait pas été dédaignée. J’en ai trouvé la preuve, au British
Museum, dans le manuscrit XXXVII de la bibliothèque Grenville qui est du
xive siècle : la glose du prologue des
fables, dans ce manuscrit, fait non seulement de Salon l’auteur des fables
élégiaques, mais encore expose les circonstances qui l’avaient déterminé à
traduire en vers latins la prose grecque d’Ésope : « Salo quidam sapiens
homo fuit qui iuit athenas, ibique inuenit librum Esopi greci poete prosaïce
scriptum et metrice de diversis fabulis, et iacebat quasi exule opus, cumque
ibi cepisset legere et uidisset ad figuram posse conuerti, ad figuram nostri
carminis adduxit ; fecit inde quemdam librum latinis uersibus. »
D’après ce texte, Salon, savant chercheur, aurait été à Athènes, y aurait trouvé
un exemplaire des fables grecques d’Ésope et les aurait traduites en vers
latins. Tout cela est très nettement affirmé. Cette affirmation, qui n’était que
l’expression d’une des opinions admises en Italie au moyen âge, était encore, au
temps même de Gyraldi, reproduite dans certaines éditions italiennes des fables
élégiaques.
La première de ces éditions avait été imprimée à Parme en 1507.
J’en ai trouvé dans la Bibliothèque palatine de cette ville un exemplaire, le
seul peut-être qui en soit resté. Le frontispice en est ainsi conçu : Continentur in hoc Volumine, Æsopi fabulæ. LXIIII. interprete
Salone Parme. Æsopi item fabulæ, interprete Auiano.
Je dois
ajouter que cette première édition avait été imprimée par François Ulgoleto qui
l’avait faite à frais et risques communs avec un associé nommé Octavien Saladi.
C’était par héritage qu’il était devenu propriétaire de son imprimerie,
exploitée, avant d’être à lui, par Angelo Ugoleto, frère du savant Thadée
Ugoleto qui, dans une lettre latine adressée à un prêtre parmesan nommé Pérégrin
Posthume Loticus, avait chaudement revendiqué la paternité des fables pour
Salon, ancien magistrat de Parme. Il est vraisemblable que c’est {p. 481}Thadée, encore vivant en 1507, qui avait inspiré à son parent
François l’idée de publier les fables élégiaques ou tout au moins d’en faire
honneur à Salon de Parme. Ce qui semble prouver l’intervention de Thadée dans
l’affaire, c’est l’extrait de sa lettre latine placé dans l’édition en tête des
fables elles-mêmes. On me saura peut-être gré d’en donner ici la
traduction :
« Puisque vous me demandez si Romulus a composé les fables latines d’Ésope en prose ou en vers élégiaques, comme on le pense généralement, je vous répondrai en peu de mots, afin de n’être pas, sur un point si insignifiant et si peu intéressant, accusé de me livrer à des observations presque puériles et de vouloir d’une mouche faire un éléphant. Ce Romulus, homme aussi instruit que son temps le comportait, a, cela est hors de doute, mis en prose les fables d’Ésope, comme nous le voyons dans beaucoup de bibliothèques tant publiques que particulières ; mais je ne veux pas en dire les noms, pour que ceux qui sont d’un autre avis se complaisent plus tranquillement dans leur opinion, et continuent, s’il plaît au ciel, à croire que les fables ésopiques en vers élégiaques sont l’œuvre de Romulus, quand il est pourtant constant que Salon, notre magistrat municipal, en est bien l’auteur. C’est là ce qu’attestent non seulement des inscriptions anciennes, mais encore un vieux manuscrit de la vie d’Ésope, qui se trouve entre les mains de Thomas Mactecoda, professeur de littérature fort distingué. J’ai transcrit les phrases de ce manuscrit, pour n’être pas soupçonné de l’avoir peut-être inventé. — Salon, poète de Parme, pendant qu’il étudiait à Athènes, a composé en vers ces mêmes fables, qu’il a traduites du grec en latin et appropriées à nos mœurs405. »
De toutes les citations qui précèdent il ressort que l’opinion de
ceux qui reportaient à Salon de Parme l’honneur d’avoir composé les fables
élégiaques n’était pas au moins en apparence dépourvue {p. 482}de points d’appui, et Gyraldi aurait pu au moins la discuter. Mais, s’il avait
eu tort de ne pas prendre cette peine, il n’en avait pas moins instinctivement
compris le néant de l’hypothèse favorable à Salon. Dans la glose du manuscrit de
la bibliothèque Grenville, il ne faut pas lire bien des lignes pour comprendre
que le glossateur, qui probablement vivait dans le nord de l’Italie, s’était
fait l’interprète passif de l’idée qui s’y était répandue ; ce qui m’autorise à
tenir ce langage, c’est qu’il ne connaissait même pas l’origine de Salon dont il
faisait un citoyen, non de Parme, mais de Pavie, ainsi que l’atteste ce passage
de la même glose : « Libri titulus talis est : Incipit liber Esopi greci
poete, vel incipit liber Salonis papiensis
poete. »
En somme, les témoignages fournis par les manuscrits et par les livres imprimés étaient trompeurs. Mais encore fallait-il en faire la démonstration.
Comprenant que néanmoins on ne pouvait pas non plus raisonnablement donner le nom de Romulus à l’auteur des fables élégiaques, Jules César Scaliger l’avait appelé Accius406 ; mais, en le nommant ainsi, il avait fait lui-même une confusion nouvelle : un Italien, sur l’œuvre duquel je reviendrai, Accio Zuccho, avait traduit les fables élégiaques en sonnets écrits dans le dialecte véronais, et le titre de Libellus Zuccharinus avait été vulgairement donné à sa traduction, publiée pour la première fois en 1479. Scaliger avait pris le traducteur pour l’auteur lui-même.
En 1610, en les publiant à Francfort, Névelet n’osa en gratifier personne. Il les présenta au public comme l’œuvre d’un anonyme ; de là vint le nom d’Anonyme de Névelet par lequel on désigna depuis l’auteur inconnu.
Mais la recherche de son nom n’en fut pas moins poursuivie, Barth
s’en occupa ; le vrai nom lui parut être celui de Bernard. {p. 483}Il appuyait cette hypothèse sur une fable du Castor, qu’un
certain Bernard de Chartres avait composée, dont Girald Barry407 avait reproduit deux vers, et
qui lui semblait avoir par le style beaucoup de ressemblance avec celles de
l’Anonyme. « Si quelqu’un, écrivait-il, me demande le nom de l’auteur, je
dirai que c’est ce Bernard dont Silvester Giraldus a publié des vers analogues
tirés de la fable du Castor408. »
Pour me rendre compte
de la valeur de cette hypothèse, je me suis reporté à l’ouvrage de Girald Barry
intitulé Itinerarium Cambriae409.
L’auteur y consacre un chapitre aux mœurs du Castor, et, après avoir insisté sur
l’instinct qui, lorsqu’il est poursuivi par un chasseur, le porte, pour lui
échapper, à faire lui-même le sacrifice de la partie la plus estimée de son
corps, il cite, à l’appui de cette tradition antique, cette phrase empruntée à
Cicéron : Redimunt se ex illa parte corporis propter quam
maxime expetuntur
, cette autre tirée de Juvénal :
Qui seEunuchum ipse facit cupiens evadere damnoTesticuli,
et enfin ce distique d’un certain Bernard sur lequel il ne fournit aucun renseignement :
Prodit item Castor proprio de corpore veloxReddere, quas sequitur hostis avarus, opes.
Ce Bernard ayant emprunté à Phèdre la fable du Castor et l’ayant mise en vers élégiaques, il n’était pas déraisonnable de lui attribuer également les fables de l’Anonyme composées dans le même rythme.
{p. 484}Mais cette opinion trouva peu de prosélytes, et le champ des hypothèses demeura ouvert. S’il faut en croire le célèbre Christ410, les uns, oubliant que cette hypothèse était inconciliable avec l’âge de quelques-uns des manuscrits qui la renfermaient, attribuèrent l’œuvre de l’Anonyme à Walther de Winterborn, cardinal romain, mort à Gênes en 1305411, les autres allèrent jusqu’à inventer un Romulus junior, qui aurait été le contemporain de Pierre Mosellanus et le précepteur de J. Pflugius en Italie412.
Adoptant l’opinion que, sans y croire, Gyraldi avait signalée, Marcheselli pensa que l’auteur anonyme pourrait bien être Salon de Parme413.
Sans admettre cette supposition, Morelli414 la fortifia, en déclarant qu’il avait vu, dans un passage imprimé d’une lettre de Thadée Ugolet, le nom de Salon de Parme donné à l’auteur des fables élégiaques415. On sait par ce qui précède à quelle lettre il faisait allusion.
Il n’avait pas oublié non plus que Kropff l’avait nommé Walther, et il était assez porté à supposer qu’il s’agissait de Walther de Châtillon, auteur du xiie siècle, qui avait composé le célèbre poème d’Alexandre le Grand.
{p. 485}Mais, en s’appuyant sur une édition
des fables, qui avait été publiée à Modène en 1481 et dont il avait vu un
exemplaire dans la riche bibliothèque d’Apostolo Zeno, il crut pouvoir les
attribuer à Nicolas Jenson, homme lettré, qui avait vécu au xiiie siècle et qui avait écrit la vie de Pomponius
Atticus. L’idée ainsi exprimée par Morelli était basée sur la mention suivante
qui terminait l’édition de 1481 : « Finit Esopus Mutine impressus impensa
et ope Domini Rhochociola : per Thomam Septemcastrensem Ioannem Franciscum
socios : compositus per me Nicolaum Jenson. Anno millesimo
quadringentesimo octuagesimo primo : die decima nona Maii. »
Malheureusement cette mention, en donnant le nom de Jenson, se rapportait
clairement, non pas à l’homme lettré du xiiie siècle, mais à l’imprimeur, qui, suivant Morelli lui-même, posséda
au xve siècle une grande réputation.
En 1825, dans sa publication des fables inédites du moyen âge,
M. Robert nomma Galfred l’auteur des fables élégiaques. Après avoir rappelé que
Névelet lui avait donné le nom d’Anonyme ancien, il ajoutait : « Je lui
ai substitué celui de Galfred, d’après un manuscrit du xive siècle, et je l’ai fait avec d’autant plus de confiance que
les fables et les fabliaux me semblent, dans ces temps anciens, plus propres
aux goûts des peuples du Nord, chez lesquels ce nom étoit fort connu416. »
Pour justifier ce nom, voici ce qu’il expliquait ensuite dans une des notes de son ouvrage :
« J’aurois dû écrire Gauffredus ; car, dans le manuscrit que M. Van Praet a bien voulu me communiquer, on trouve ce titre à la tête des fables en vers élégiaques :
Incipit liber Eusopi edito a magistro Gauffredo.Ce maître Geoffroy ne peut pas être le copiste : car ce volume qui renferme les écrits de huit auteurs moraux, me paroît écrit de la même main, et je ne vois pas pourquoi il auroit mis son nom aux fables : j’ai cru quelque temps que ce Galfred ou Gauffred était celui que l’on nomme de Montmouth, parce que, dans quelques manuscrits, on trouve au bas des pages de sa Chronique anglaise des distiques dont le style se rapproche assez de celui de l’ouvrage dont nous {p. 486}parlons ; mais il y avoit, au commencement du xiie siècle, tant d’Anglais portant ce nom, qu’il me semble difficile de choisir d’une manière certaine : je crois, soit dit en passant, que Fabricius attribue à Geoffroi de Montmouth ce qui appartient à Geoffroi Arthur417. »
J’ai désiré voir à la Bibliothèque nationale le manuscrit dans
lequel M. Robert prétendait avoir trouvé le nom de Galfred. Mais je n’ai pas
tardé à m’apercevoir que le nom de Gauffredus ne figurait dans aucun des huit
par lui signalés418.
M. Hermann Oesterley, dans la préface dont il a fait précéder son édition du
manuscrit du British Museum, dit bien que M. Robert a lu le nom de Galfred dans
le manuscrit nº 8259. Mais c’est là une erreur : ce manuscrit porte pour titre
ces mots : Hic incipit liber magistri greci
, et
non pas magistri Gauffredi.
Quant aux autres manuscrits, lorsqu’ils portent un nom, c’est
toujours celui d’Ésope. Ainsi le manuscrit 8509 commence par ces mots :
Incipit liber Esopi
; le manuscrit 8509 A finit par ceux-ci : Explicit Esopus
; le manuscrit 14381 n’a ni phrase initiale ni phrase
finale ; le manuscrit 15135 commence par cette invocation : Sancti
Spiritus assit nobis gratia. Amen
, suivie de ce titre : Incipit
Esopus
, et se termine par les mots :
Explicit Esopus
, qui ont été écrits à l’encre
rouge à la suite de la table des matières, et qui sont presque entièrement
effacés.
Enfin, après des recherches longtemps infructueuses, j’ai trouvé
le manuscrit sur lequel M. Robert avait échafaudé son hypothèse. Contrairement à
l’indication de M. H. Oesterley, il est catalogué sous le nº 11344 du fonds
latin. Dans ce manuscrit les fables élégiaques ne sont accompagnées d’aucune
glose ; mais elles sont précédées d’un titre à l’encre rouge ainsi conçu :
Incipit liber eusopi edito a magistro Gauffredo.
D’abord je dois faire remarquer que le manuscrit est du commencement du xve siècle, c’est-à-dire d’un temps où le nom du véritable auteur, oublié depuis deux siècles, était nécessairement ignoré du copiste.
Ensuite, quand on considère le titre en lui-même, il me semble difficile d’y trouver la preuve qu’un certain maître Galfred en ait été {p. 487}l’auteur. L’ouvrage est au contraire attribué à Ésope, et les mots edito (lisez editus) a magistro Gauffredo se rapportent évidemment au copiste, à qui, avant la découverte de l’imprimerie, pouvait convenir la qualification d’éditeur, et qui par une petite faiblesse d’esprit avait été porté à introduire son nom dans le titre.
Du reste, il est aisé de juger qu’après avoir laborieusement cherché à justifier sa thèse, M. Robert, d’abord très convaincu, a senti sa conviction ébranlée par la découverte, qu’il a tardivement faite à la même bibliothèque, du manuscrit 8023. On devine que, s’il avait le courage de recommencer son travail, il serait très disposé à jeter aux orties le nom de Galfred et à attribuer les fables à un certain Garritus. Mais son siège est fait, et il n’a pas l’énergie de le refaire. En cela il a manqué de la qualité principale du vrai philologue, qui doit, sans lassitude, savoir marcher d’erreur en erreur jusqu’à la vérité finale.
Dans le manuscrit 8023, le prologue des fables est précédé d’une glose dont voici le commencement :
« In principio huius libri quatuor causae sunt inquirende, scilicet : causa efficiens, materialis, formalis et finalis. et quis titulus et cui parti philosophie supponitur. quare ad omnia ista rude est, et primo sic dico quod causa efficiens fuit magister Garritus, qui composuit istum librum, et non Ysopus, ut dicunt quidam ; sed quia Ysopus erat honeste vite, idcirco istum librum sub nomine e us intitulauit, quare vir erat antetiquus (sic) et sciens. Alii dicunt quod Ysopus fecit istum librum qui cognomine vocabatur Garritus, ut paret per istum versum :
Incipit librum Ysopus stamine tectus. ».........
Et à la fin de la même glose, on lit encore :
« Quid titulus ? Incipit Ysopus magistri Garritus, vel aliter :
Incipit Ysopus garriti stamine tectus. »
En affirmant que l’auteur véritable s’appelait Garritus, le glossateur avait combattu d’avance l’hypothèse de M. Robert.
Mais s’ensuit-il qu’on doive au nom de Galfred substituer celui de Garritus ? Voilà ce que je ne crois pas. Il ne faut pas oublier quelles erreurs grossières commettaient de bonne foi les moines du moyen âge. La forme et le sens du mot Garritus me portent à penser, avec ceux dont l’opinion est rappelée par le glossateur lui-même, {p. 488}que ce mot était non pas un nom propre, mais un participe qui qualifiait Ésope de causeur facile.
Le même sens doit, suivant moi, être attaché au nom de Garicius, qui, ainsi que je m’en suis assuré, se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque royale de Madrid.
Il fallait donc chercher ailleurs l’introuvable nom de l’Anonyme.
En 1838, dans son édition des fables de Phèdre, M. Dressler, qui
paraît n’avoir connu ni l’ouvrage de M. Robert ni la glose du manuscrit 8023,
prétendit à son tour avoir trouvé le nom du véritable auteur qu’il nomma Ugobard de Sulmona. En marge d’un manuscrit des fables
élégiaques, qui lui avait été communiqué par son compatriote Haenel, il avait
trouvé la note suivante écrite de la main même du copiste : « In
principio huius operis attenduntur quatuor : causa materialis, formalis,
efficiens et finalis. Causa efficiens est duplex, sc. inveniens et compilans.
Inveniens fuerunt Sulmonenses pingentes istas historias, causa compilans Ugobardus Sulmonensis, qui ipse compilavit
metra. »
Dressler avait conclu de cette note que l’auteur véritable était Ugobard de Sulmona. Conçue dans des termes analogues à ceux des gloses des manuscrits de la Bibliothèque nationale, elle n’en différait guère que par le nom de l’auteur qui aurait été le compatriote d’Ovide. C’était une hypothèse, substituée à d’autres hypothèses, et il était assez logique de penser qu’Ugobard était un personnage aussi chimérique que Galfred et même que Garritus. Aussi la prétendue découverte de Dressler ne mit-elle pas fin aux recherches.
Enfin l’incertitude cessa. En 1836, M. Endlicher, deux ans avant l’édition de Dressler, avait publié, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire, un catalogue des manuscrits philologiques de la bibliothèque impériale de Vienne, au nombre desquels un manuscrit des fables élégiaques était signalé sous la cote 303. Ces fables, portant dans le catalogue un titre qui semblait emprunté au manuscrit, y étaient appelées Hildeberti Turonensis Fabulae.
Ce nom a eu au moyen âge une grande notoriété, et je vais sans doute prendre une précaution superflue en rappelant à quel personnage il se rapporte. Aussi n’en dirai-je que deux mots. Né en 1057, à Lavardin dans le Vendômois, Hildebert devint, en 1097, évêque du Mans, et, en 1125, fut élevé, presque malgré lui, à l’archevêché de Tours. Homme lettré, il a laissé non seulement des homélies et des {p. 489}traités de théologie, mais encore des poèmes dont le principal est celui De Ornatu mundi. Ses œuvres, réunies par Beaugendre, ont été publiées en 1708 ; elles forment un volume in-folio.
Tandis que tous les autres noms avaient laissé subsister des doutes, celui-ci fut facilement accepté. Il est vrai que les ouvrages connus du célèbre Hildebert permettaient de le croire l’auteur des fables élégiaques.
Lorsqu’on examine ses œuvres poétiques, on trouve en elles ce qui caractérise les fables de l’Anonyme. Ainsi, en dehors des sujets religieux qu’Hildebert devait surtout traiter, ceux qu’il adopte ont avec les fables une certaine analogie : dans son poème intitulé Phisiologus, il peint les caractères du Renard, du Cerf, de la Fourmi et des divers animaux que les fabulistes ont l’habitude de mettre en scène ; le style est le même ; il aime l’antithèse et il en abuse ; si dans ses poèmes il a souvent recours au vers hexamètre, il emploie plus souvent encore le distique élégiaque ; il évite le vers léonin que le mauvais goût de son temps avait mis à la mode ; enfin, détail plus caractéristique, dans ses nombreuses œuvres poétiques, on chercherait peut-être en vain un vers présentant une élision.
Qu’on me permette, pour donner un échantillon de son style et de sa versification, de reproduire ici l’épigramme sur l’Hermaphrodite, à lui attribuée par l’éditeur de ses œuvres419 et rendue célèbre par la traduction qui en a été faite :
Dum mea me mater gravida (sic) gestaret in alvo,Quid pareret fertur consuluisse deos.Phœbus ait : Puer est, Mars : fœmina, Junoque : neutrum.Jam qui sum natus, Hermaphroditus eram.Quaerenti lœtum (sic) Dea sic ait : Occidet armis,Mars cruce, Phœbus aqua : Sors rata quæque fuit.Arbor obumbrat aquas, ascendo, labitur ensisQuem tuleram casu ; labor et ipse super.Pes haesit ramis, caput incidit amne ; tuliqueVir, mulier, neutrum, flumina, tela, crucem420.
Si de ce simple spécimen on rapproche les fables élégiaques, on {p. 490}trouve le même style, le même goût pour l’antithèse soit dans la pensée, soit dans la forme, et surtout le même soin soutenu d’éviter les élisions.
Aussi M. Fleutelot, rassuré d’ailleurs par le catalogue de M. Endlicher, n’hésita-t-il pas, dans sa préface publiée en tête du Phèdre de la collection Nisard, à considérer Hildebert comme le véritable auteur des fables élégiaques.
J’avoue que, lorsqu’à mon tour j’eus à me faire une idée, je ne
partageai pas sa confiance ; ni l’opinion générale qui s’était formée, ni les
raisons que je viens moi-même d’analyser, ne purent mettre fin à mes doutes. Il
est vrai que la versification de l’épigramme sur l’Hermaphrodite présente les
mêmes particularités que celle des fables élégiaques ; mais, malgré la
publication de Beaugendre, je n’étais pas non plus bien sûr que l’archevêque de
Tours en fût l’auteur, et un manuscrit du xve siècle que j’ai en ma possession, en attribuant cette épigramme à
Antonius Panormita, ne faisait que fortifier mes doutes. Peut-être
n’auraient-ils pas persisté, si, à l’époque à laquelle ils prirent naissance en
moi, j’avais eu connaissance d’un manuscrit du xiie siècle, qui, sous la cote 11, est conservé dans la Bibliothèque
de Beauvais. Ce manuscrit, qui provient du chapitre de la Cathédrale, montre
que, dans le siècle même dans lequel avait vécu le poétique archevêque de Tours,
l’épigramme de l’Hermaphrodite était considérée comme son œuvre. Le manuscrit de
Beauvais, au fº 77 vº, contient un petit poème de vingt-quatre hexamètres rimés,
portant pour titre : Versus Hi[l] deberti Cœnomanensium
episcopi
, et débutant ainsi : Jam tot in
ecclesias insurrexere procellæ.
Ce petit poème est suivi de
l’épigramme, qui, dans la pensée du scribe étant du même auteur, commence, sans
intervalle et sans titre, au bas de la même page et finit au recto du feuillet
suivant. Mais j’ignorais ce fait intéressant.
Après de longues réflexions, je finis par acquérir la conviction qu’en définitive M. Endlicher avait dû se tromper et que le manuscrit analysé par lui ne devait pas porter le nom d’Hildebert, et, persécuté par le désir d’en avoir le cœur net, je me décidai, au mois de juillet 1873, à entreprendre le voyage de Vienne.
En route, ainsi que je l’ai dit, je m’arrêtai à Munich, et, après avoir transcrit la copie des fables de Romulus, faite par Pierre Crinitus, j’examinai avec soin les gloses contenues dans les manuscrits {p. 491}des fables élégiaques que possédait la bibliothèque royale. L’un d’eux les attribuait à Romalus, nom qui, comme celui de Romalius, n’était qu’une altération de celui de Romulus ; mais aucun ne me fournit un renseignement utile.
Enfin j’arrive à Vienne ; en toute hâte je me rends à la
bibliothèque impériale, je demande le manuscrit latin 303, et, quand il est dans
mes mains, je m’aperçois que le nom d’Hildebert n’y figure pas. En revanche, en
marge du prologue, je lis cette glose qui rend inexplicable l’erreur de
M. Endlicher : « Titulus ei talis est : Incipit Esopus,
quod non fuit nomen compositoris, sed Waltherus. Vt autem
eius liber honestius reciperetur, intitulauit eum hoc nomine, quod nomen
forsan cuiusdam nobilis vel sumptum ab isopo ; quod nomen appellatiuum est
cuiusdam herbe ad similitudinem, quod isopus bonus est et varios reddit
odores ; sic iste liber varias reddit utilitates. »
Ce qui peut se
traduire ainsi : « Le titre de ce livre est Incipit
Esopus ; ce nom n’est pas celui de l’auteur, qui au contraire est
Walther. Mais, pour assurer à son œuvre un accueil plus honorable, il le
revêtit de ce nom qui peut-être est celui de quelque noble personnage ou qui
est emprunté à l’hysope, dénomination d’une certaine herbe analogue, en ce
sens que l’hysope est suave et exhale des parfums variés. Or il en est de même
de ce livre qui présente des avantages divers. »
Je ne m’arrête pas à l’explication puérile que le glossateur donne du nom d’Ésope qui serait celui de quelque personnage noble ou d’une plante odoriférante. Ce qui est intéressant, c’est le nom de Walther par lequel il désigne le véritable auteur. Je fus, je le crois du moins, mis par ce texte sur la vraie piste. Convaincu que cette fois j’étais en présence d’un manuscrit qui me révélait la vérité, je n’eus plus d’autre préoccupation que de savoir de quel Walther il s’agissait. Était-il question de Walther de Winterborn ? Évidemment non. Ceux qui avaient songé à lui, avaient commis un anachronisme évident ; car si Lessing et Eschenburg, et, sur la foi de leur déclaration, Schwabe, Dressler et enfin M. Oesterley ont fait à tort remonter au xiie siècle le plus ancien des manuscrits des fables élégiaques, conservé à la bibliothèque de Wolfenbüttel, il n’en est pas moins vrai que ce manuscrit, qui appartient au xiiie siècle, est trop ancien pour que son contenu soit l’œuvre du cardinal romain mort en 1305. L’hypothèse qui en faisait honneur à Gauthier de Châtillon, {p. 492}n’était pas démentie par l’âge des manuscrits ; mais était-elle plus exacte ? Comment sortir d’embarras ? Au moyen âge le nom de Walther ou Gauthier a appartenu à de nombreux auteurs, et, à défaut de renseignement complémentaire, il m’aurait été impossible d’opter avec certitude pour l’un d’eux. Ce renseignement complémentaire, je le découvris avec une facilité inespérée. Je n’étais pas encore de retour en France que je l’avais déjà obtenu.
En passant par Wurtzbourg, je m’arrêtai à la bibliothèque de
l’Université, et j’y trouvai, sous la cote L. R. 9. 44, une édition in-4º des
fables élégiaques achevée d’imprimer à Lyon par Jean Fabre le 23 janvier 1490.
En lisant la glose du prologue, je fus frappé par ce membre de phrase :
« Galterus Anglicus fecit hunc librum sub nomine
Esopi. »
Ainsi le Walther, dont le manuscrit de Vienne m’avait révélé
le nom, c’était bien celui qui a été surnommé l’Anglais, et j’étais forcément
ramené à l’hypothèse, que Christ, confondant ensemble deux homonymes, avait
rejetée avec autant de légèreté que de dédain. Désormais le véritable auteur
était nettement déterminé. Je fus vraiment heureux de cette découverte, et, je
dois l’avouer, ce qui doubla ma satisfaction, ce fut de la devoir à une édition
française. Depuis j’ai trouvé beaucoup d’autres éditions du même temps, qui,
imprimées en France, contenaient la même phrase, et, comme celle de Lyon,
contrastaient avec l’ineptie des gloses reproduites, d’après les manuscrits, par
la plupart des éditions étrangères. Je peux citer notamment :
1º Une édition scolaire in-4º, sans date, ni lieu, ni nom d’imprimeur, qui se compose de 42 feuillets signés de a à c, et, sauf la vignette du premier, dépourvus de toute gravure (deux exemplaires de cette édition se trouvent, l’un dans la bibliothèque publique de la ville de Rouen sous la cote O. 638, l’autre dans la Grenville library sous le nº 7724) ;
2º Une édition scolaire in-4º également sans date, ni lieu, ni
nom d’imprimeur, comprenant 38 feuillets, dont le premier, au-dessous de ce
titre : Fabule Esopi cū cōmento
, représente
deux singes au pied d’un arbre portant un écusson avec le mot Felix
, et dont le dernier offre cette souscription :
Fabularum liber cum glosa finit feliciter
(un exemplaire de cette édition existe à la bibliothèque de Dijon sous le
nº 10974, et à la bibliothèque royale de Bruxelles autrefois sous le nº 1358 et
actuellement sous le nº 74) ;
{p. 493}3º Une édition de 35 feuillets in-4º,
sans lieu, ni année, ni nom d’imprimeur, mais néanmoins facile à distinguer des
autres, 1º par son frontispice, qui, au-dessus du titre Fabule Esopi cū cōmento
, présente un écu parsemé de fleurs de
lis, surmonté d’une couronne royale, et encadré par ces mots formant quatrain :
« Honneur au roy et à la cour, Salut à l’université Dont notre bien
procède et sourt, Dieu gart de Paris la cyté ; »
2º par la
souscription suivante : Fabularum liber cū glosa finit
feliciter
;
4º Une édition in-4º de 56 feuillets, non chiffrés, mais signés de a à g, sans lieu, ni date, ni nom d’imprimeur, dont un exemplaire existe à la Bibliothèque cantonale de Berne sous la cote Inc. 153 ;
5º Une édition d’écolier imprimée dans le petit format in-4º à Paris, par Pierre Levet, en 1499 ;
6º Une petite édition scolaire in-4º, qui avait été imprimée en
caractères gothiques à Rouen vers 1505, dont le frontispice portait en tête les
mots : Fabule Esopi cum commento
, puis les
armes des rois de France, ensuite celles de la ville et enfin tout au bas ce nom
d’éditeur : J. le forestier
, et qui se
terminait par cette souscription : Fabularum liber cum glosa
finit feliciter. Impressus Rothomagi in domo Laurentii hostingue et Jameti
louys pro Jacobo le forestier. In intersignio regule auree iuxta conventum
augustinorum commorante
(un exemplaire de cette édition se
trouve à la bibliothèque publique de la ville de Rouen sous la cote O. 2261 (a)) ;
7º Une petite édition in-4º, imprimée à Rouen par Jean Mauditier en 1508, et faite, comme celle de 1505, pour Jacob Le Forestier.
8º Une édition in-4º de 42 feuillets, imprimée en 1503, à Londres, par Wynkyn de Worde ;
9º Une réimpression dans le même format faite en 1516, par le même imprimeur, de son édition de 1503 ;
10º Enfin la plupart des éditions que j’ai nommées éditions des Huit auteurs et qu’on trouvera plus loin dans la nomenclature analytique des imprimés contenant le texte de Walther.
Ces éditions, en attribuant les Fables élégiaques à celui des auteurs du nom de Walther, qui a été le plus communément surnommé l’Anglais, n’avaient pas adopté une hypothèse dénuée de base.
En effet, si l’on veut lire ci-après la Section V de mon Étude sur les fables élégiaques, on y trouvera l’analyse de plusieurs manuscrits {p. 494}qui lui en imputent la paternité. Tels sont les manuscrits C. b. 37 de la Bibliothèque de Marseille, LXVIII de la Bibliothèque communale de Trèves et I. 85. supr. H. 3 de l’Ambrosienne.
À mon retour en France, il ne me restait plus qu’à lire dans un dictionnaire bibliographique la vie de Walther l’Anglais. Je possédais l’ouvrage de Jean Bale, imprimé à Bâle de 1557 à 1559421 ; je l’ouvris, et j’y trouvai les biographies de plusieurs Walther, parmi lesquelles figurait celle de Walther l’Anglais. D’après Bale, ce Walther, appelé aussi le Panormitain, avait été le chapelain de Henri II, roi d’Angleterre. Il était très estimé tant à cause de sa droiture qu’à raison de ses talents littéraires. Henri II, avant de donner en mariage sa fille Jeanne à Guillaume le Jeune, roi des Deux-Siciles, l’avait chargé de se rendre auprès de son futur gendre et de lui enseigner les belles-lettres. Le jeune prince profita si bien de ses leçons qu’il apprit non seulement la langue latine, mais encore la prosodie de cette langue. En récompense, Walther fut nommé archevêque de Palerme et primat du royaume, et son élève le considéra, tant qu’il vécut, non seulement comme un précepteur, mais encore comme un père. Walther avait composé pour lui un livre intitulé : Pro latinæ linguæ exercitiis. Il est probable que les fables élégiaques furent le produit de cet enseignement et qu’elles furent rythmées par le jeune prince sur celles de Romulus et corrigées ensuite par Walther. On s’explique ainsi qu’elles n’embrassent que les trois premiers livres du Romulus ordinaire. Il est supposable que, si elles ne comprennent pas le quatrième, c’est que l’exercice littéraire n’aura pas été poussé plus loin.
La question de la paternité des fables élégiaques est, je crois, maintenant résolue, et je n’y reviendrai plus.
De la solution de ce point découle tout naturellement celle de la date à laquelle elles ont été écrites. Cette date est d’un an ou deux antérieure au mariage de la fille de Henri II avec Guillaume le Jeune, qui eut lieu en l’an 1177.
L’auteur et la date étant ainsi déterminés, il ne reste plus, devant la réalité, de place pour les hypothèses trompeuses que l’incertitude sur ces deux points avait singulièrement favorisées. Dorénavant, {p. 495}je l’espère du moins, il ne sera plus possible de reculer ou de rapprocher la date suivant les besoins de telle ou telle thèse plus ou moins fantaisiste ; il ne sera plus possible, par exemple, d’accepter l’opinion de Christ, qui voulait voir dans les fables élégiaques une œuvre du ive siècle, sinon antérieure à celle d’Avianus, au moins aussi ancienne.
Nomenclature des fables de Walther. §
Un point sur lequel on n’a guère été plus d’accord que sur le nom de l’auteur des fables, c’est celui qui concerne leur nombre.
Ce qui est bien admis, et ce qui ne pouvait être controversé, c’est que la collection complète en comprend au moins soixante. En voici, suivant l’ordre le plus généralement suivi dans les manuscrits et dans les éditions du xve siècle et adopté en dernier lieu par M. Dressler, la nomenclature accompagnée de leurs références avec celles du Romulus ordinaire :
| Walther. | Romulus ordinaire. |
| Prologue. | Prologue. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| 7. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| 8. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 9. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| 10. Le Serpent mourant de froid. | I, 10. |
| 11. L’Âne et le Sanglier. | I, 11. |
| 12. Le Rat de ville et le Rat des champs. | I, 12. |
| 13. L’Aigle et le Renard. | II, 8. |
| 14. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| 15. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. |
| 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 15. |
| 17. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. |
| 18. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| 19. L’Épervier malade. | I, 18. |
| 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 19. |
| {p. 496}21. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. |
| 22. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 23. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| 24. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| 25. La Montagne en mal d’enfant. | II, 5. |
| 26. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 27. Le Chien vieilli et son Maître. | II, 7. |
| 28. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 9. |
| 29. Le Loup et le Chevreau. | II, 10. |
| 30. Le Serpent et le Pauvre. | II, 11. |
| 31. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | II, 12. |
| 32. Le Chauve et la Mouche. | II, 13. |
| 33. Le Renard et la Cigogne. | II, 14. |
| 34. La Tête sans cervelle. | II, 15. |
| 35. Le Geai vaniteux. | II, 16. |
| 36. La Mouche et la Mule. | II, 17. |
| 37. La Mouche et la Fourmi. | II, 18. |
| 38. Le Loup et le Renard, jugés par le Singe. | II, 19. |
| 39, L’Homme et la Belette. | II, 20. |
| 40. La Grenouille qui s’enfle. | II, 21. |
| 41. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| 42. Le Lion médecin. | III, 2. |
| 43. Le Cheval et l’Âne. | III, 3. |
| 44. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| 45. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| 46. Le Renard et le Loup. | III, 6. |
| 47. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. |
| 48. L’Inconstance de la Femme. | III, 9. |
| 49. La Courtisane et le Jeune Homme. | III, 10. |
| 50. Le Père et le Mauvais Fils. | III, 11. |
| 51. La Vipère et la Lime. | III, 12. |
| 52. Les Loups et les Brebis. | III, 13. |
| 53. La Hache et les Arbres. | III, 14. |
| 54. Le Loup et le Chien. | III, 15. |
| 55. L’Estomac et les Membres. | III, 16. |
| 56. Le Singe et le Renard. | III, 17. |
| 57. Le Marchand et l’Âne. | III, 18. |
| 58. Le Cerf et les Bœufs. | III, 19. |
| 59. Le Juif et l’Échanson du Roi. | |
| 60. Le Citoyen et le Soldat. |
Pour ces 60 fables il n’y a pas de doute. Elles sont toutes du même auteur, et, si sur lui mon hypothèse est exacte, elles sont toutes de Walther l’Anglais.
{p. 497}Mais, dans certaines éditions du xve siècle, on en trouve d’autres que, dans le second volume de cet ouvrage, je placerai à la suite des soixante premières. Faut-il les attribuer au même auteur ? Comme, soit par la pensée, soit par l’expression, elles n’ont pas toutes avec son œuvre un égal degré de ressemblance, il faut les examiner une à une et porter sur chacune un jugement spécial.
D’abord il en est deux qu’on rencontre dans les manuscrits plus souvent que les autres, et qui, après avoir été publiées au xve siècle, ont été de nos jours rééditées par Dressler ; ce sont les deux fables intitulées, l’une : le Chapon et l’Épervier, l’autre : le Berger et le Loup. Pour savoir si elles appartiennent à Walther, il faut se référer à leur texte. Quand on l’examine et quand on le compare à celui des autres fables, on y aperçoit le même style et la même versification, le même esprit et la même forme, les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts.
Cependant certains philologues ont voulu attribuer ces deux fables à un auteur différent, et, comme toujours, ils ont trouvé des arguments à l’appui de leur opinion.
Ainsi ils ont remarqué que l’épimythion de la seconde, quoique bien placé à la fin, se composait de quatre vers contrairement à l’usage de Walther qui n’en consacrait que deux à l’affabulation. Si cette observation était exacte, elle ne serait pas très probante ; mais elle n’est pas absolument vraie : en effet, dans les fables xxi, xxviii, et xxxviii, l’épimythion se compose de quatre vers.
Ils ont encore cherché à appuyer leur thèse sur ce distique final :
Fine sui, versu gemino, quod continet omnisFabula declarat, datque quod intus habet.
Je reconnais avec eux qu’il ne peut être convenablement placé qu’à la fin de la dernière fable de la collection, et que, même dans les manuscrits et dans les anciennes éditions qui contiennent les deux fables complémentaires, c’est presque constamment à la fin de la soixantième qu’on le rencontre. Mais il n’en est pas non plus toujours ainsi ; quelquefois le distique final se trouve rejeté à la fin de la fable lxii, et détruit ou semble détruire l’argument tiré de la place qu’il occupe.
Enfin on a objecté que les fables de Walther n’étaient que la paraphrase poétique de la prose de Romulus, et que les deux premières {p. 498}fables complémentaires, n’ayant pas la même origine, ne devaient pas non plus être sorties de la plume du même écrivain. Ici encore l’argument pèche par la base ; car les fables 59 et 60 ne sont pas non plus dérivées de Romulus, et cependant, personne ne le conteste, elles appartiennent bien à la même collection que les 58 premières.
En somme d’une part, les raisons négatives ne sont pas concluantes ; d’autre part, rien non plus n’autorise à faire de Walther l’auteur des deux premières fables complémentaires. Ce qui est certain, c’est que, si elles ne sont pas son œuvre, elles sont celle d’un auteur qui s’est inspiré de sa manière et qui a dû être presque son contemporain.
Je passe à la fable intitulée : le Marchand et sa femme, qui figure dans plusieurs manuscrits du moyen âge et dans plusieurs éditions du xve siècle.
Je ne me dissimule pas que la donnée de cette fable est un peu risquée, et que l’idée qu’on y trouve a quelque chose de sauvage et par suite d’assez incompatible avec le caractère et la mission de Walther l’Anglais. Mais il ne faut pas oublier que les lettrés les plus purs du moyen âge, quand ils écrivaient en vers latins, se permettaient quelquefois de singuliers écarts. Il faut se rappeler aussi que, si l’archevêque de Palerme avait été chargé de l’éducation d’un prince, ce prince était déjà un jeune homme à la veille de prendre femme, et qu’il avait pu sortir de la réserve à laquelle l’éducation d’un enfant l’aurait forcément assujetti.
J’ajoute que la fable dont je m’occupe a, comparée aux autres, un
air de parenté véritablement frappant. La facture du vers est la même ; ainsi,
on ne peut lire l’hémistiche En vir, ecce puer
,
sans se rappeler cet autre : Est Lupus, est
Agnus
; quant à l’affabulation, elle est rejetée à la fin, et
c’est le dernier distique qui la formule.
Enfin je dois faire observer que cette fable se trouve justement dans le plus ancien des manuscrits de Walther, dans celui qui est conservé à Wolfenbüttel, et qu’on a longtemps considéré comme remontant au xiie siècle. Malgré ces circonstances assez graves, je n’affirme pas qu’elle soit l’œuvre de Walther ; mais ce qui me paraît encore mieux démontré que pour les deux précédentes, c’est que tout au moins elle est due à un écrivain de son temps.
{p. 499}Mais j’avoue tout de suite que, lorsqu’il s’agit de la quatrième fable, intitulée Le Paysan et Pluton, je n’ai plus d’incertitude. La fable précédente pouvait être réputée licencieuse ; celle-ci est franchement ordurière, et je n’ai pas le courage de l’infliger au vertueux chapelain de Henri II.
La vraisemblance, à défaut de justifications, légitimerait mon sentiment ; mais il est appuyé sur une preuve qui me semble concluante ; en effet, on ne trouve cette fable dans aucun manuscrit ancien ; on ne la rencontre que dans ceux du xve siècle qui renferment en même temps la traduction en sonnets italiens du fameux Accio Zuccho. Je ne me permettrai pas d’en induire que c’est ce dernier qui en est l’auteur ; mais ce que je peux raisonnablement supposer, c’est que, l’ayant trouvée je ne sais où, il l’a traduite et insérée avec la traduction à la suite des soixante-trois premières fables, avec lesquelles elle n’avait rien de commun.
On ne peut davantage reconnaître le style de l’archevêque de Palerme dans les trois fables placées à la suite des siennes dans une édition publiée à Brescia en 1522. Je les joindrai néanmoins à celles de l’appendice, dans lequel elles porteront les titres : De Cornice et Hirundine, De Coco et Cane cor rapiente, De Avibus et Pavone.
Les diverses fables que je viens d’examiner figurent dans quelques-unes des éditions des fables de Walther publiées au xve siècle. Elles ne sont pas les seules que je publierai. Les manuscrits nombreux qui contiennent son œuvre m’en ont révélé quelques autres, qui certainement ne peuvent lui être attribuées, mais auxquelles, pour qu’on en puisse juger, je donnerai place dans le même appendice.
Jugements des critiques sur les fables de Walther. §
On ne saurait croire combien ont été différents les uns des autres les jugements dont les fables de Walther ont été l’objet. Il est remarquable qu’en matière de littérature, et surtout de littérature latine, les hommes les plus expérimentés ont en général la plus grande peine à s’accorder ; tant, suivant l’esprit dans lequel on les examine, {p. 500}les choses littéraires prennent des aspects opposés. Aussi, lorsque j’ai discuté l’authenticité des fables de Phèdre, ne me suis-je pas trop appuyé sur cet argument banal et rebattu, qui consiste à dire qu’on y retrouve cette belle latinité particulière au siècle d’Auguste.
Pour en revenir à celles de Walther, à l’époque où elles ont été
écrites elles ont été universellement admirées. « Si Romulus avait
supplanté Phèdre, dit M. Fleutelot, Hildebert fut pour le poète latin un rival
bien plus dangereux encore. Les fables en distiques eurent un tel succès
qu’elles empêchèrent pour longtemps de penser à Phèdre et firent même oublier
quelque peu Romulus. »
Éberhard de Béthune, qui, dans un poème écrit en 1215, les
attribue à Ésope, dit que son vers ne sommeille point : Aesopus metrum non sopit.
Au siècle suivant, vers 1333, les fables de Walther sont traduites en vers français en l’honneur de Madame Jehanne de Bourgogne, épouse du roi Philippe VI, à qui le traducteur les dédie en ces termes :
Ce livret que cy vous récitePlaist à oïr et si proufite.
En développant le sentiment des vraies beautés littéraires, le
mouvement de la Renaissance amène contre ce concert d’éloges quelques
protestations imposantes. Henri Bebel n’hésite pas à déclarer « que ces
fables en vers sont dénuées de beauté et de charme, qu’elles sont tout ce
qu’il y a de plus opposé aux Muses et aux Grâces, que la pureté des
expressions y fait défaut, et qu’en somme il faut éviter de les lire422. »
L’engouement n’en continue pas moins pendant le xvie siècle. J.-C. Scaliger lui-même s’y laisse aller. Il admire la facture du vers {p. 501}de Walther exempt d’élisions et l’élégance sans égale de son style : ses fables lui semblent pour les jeunes poètes un modèle utile qui se distingue à la fois par la solidité de la pensée et la grâce de la forme423.
Après tant de siècles de vogue imméritée, la réaction était
inévitable. Elle s’accusa nettement dès le commencement du xviie siècle. À son tour elle fut exagérée. C’est ainsi
qu’on voit tour à tour Névelet, tout en publiant les fables élégiaques,
qualifier de singe de Phèdre leur auteur encore inconnu424, et Barth, sans
plus de ménagement, le traiter de poète inepte et barbare, valde ineptus atque barbarus
425.
Moins sévères, Gellert426 et Lessing427 adoptent un avis
mixte ; Muratori reconnaît au fabuliste une remarquable facilité de
versification, mais refuse de voir en lui un véritable latiniste428 ;
Morelli n’hésite pas à partager le même sentiment429 ; enfin Schwabe, qui en général se conforme
à l’opinion définitivement admise, pense, comme eux, que ce qu’il y a de plus
sûr, c’est de se tenir à égale distance des opinions extrêmes. « Avouons,
dit-il, que l’anonyme marche sur les traces de Phèdre et que ses fables ne
sont pas dépourvues de toute élégance ; concédons qu’elles sont agréables et
utiles, mais que par une latinité çà et là barbare, par les jeux de mots
ineptes, par l’absence affectée des élisions et aussi par la fréquence des
assimilations, elles ne sont pas exemptes de tout reproche430. »
{p. 502}Cette appréciation moyenne, qui résume
l’état de l’opinion au commencement de ce siècle, est ensuite adoptée par
M. Robert, qui, dans sa publication des fables inédites du moyen âge, s’exprime
à son tour en ces termes : « De fréquentes antithèses, de continuels
rapprochements ou de nombreuses oppositions de sens ou de sons, voilà ce qui
distingue particulièrement les fables en vers élégiaques, et ce qu’elles
présentent toutes d’une manière constamment uniforme. Ces ornements, plus
déplacés encore dans le genre de l’apologue que dans les autres, leur valurent
cependant une grande renommée, et Évrard de Béthune n’hésite pas à les mettre
fort au-dessus de celles d’Aviénus. Les choses ont bien changé depuis, et on
les traite à présent avec un mépris que Ion peut accuser quelquefois
d’injustice ; car on ne doit pas rendre le poète élégiaque responsable des
fautes des copistes, et surtout des éditeurs, qui, en faisant imprimer ses
fables, n’ont pas consulté avec soin les manuscrits qui existent, et à l’aide
desquels on auroit pu corriger des vers qui semblent manquer de sens ou qui
n’offrent que des tournures ridicules431. »
Si maintenant à toutes ces appréciations je puis ajouter la mienne, je prendrai la liberté de trouver les fables de Walther aussi défectueuses par la forme que par le fond. Non seulement la versification est barbare, mais encore l’idée primitive a été presque partout puérilement travestie. Je n’en fais pas un reproche à l’auteur, qui était pour son temps un homme lettré, qui d’ailleurs n’a pas eu d’autres prétentions que de composer de simples exercices de prosodie latine, et qui peut-être même s’est borné à corriger tant bien que mal le travail fautif de son royal élève. Mais je ne puis m’empêcher de constater que, dénuée de valeur littéraire, son œuvre n’offre qu’un intérêt purement historique.
Quant à Phèdre, comme elle n’en a pas conservé les expressions, elle est sans utilité pour la critique de son texte, et il a fallu l’inexplicable célébrité dont elle a joui, pour me déterminer à lui faire dans cette étude la grande place que je lui ai consacrée.
Manuscrits des fables de Walther. §
§ 1. — France. §
1º Manuscrits latins de la Bibliothèque nationale. §
Schwabe, sur la foi du savant Labbé, a cru qu’il n’existait à la Bibliothèque nationale qu’un manuscrit des fables de Walther, et Dressler, sur la foi de Schwabe, est tombé dans la même erreur. Il faut reconnaître que le second était moins excusable que le premier ; car, depuis 1825, la publication de M. Robert ne laisse plus de place à une pareille idée. Il signale en effet huit manuscrits, auxquels il donne les cotes suivantes : 8023, 8259, 8460, 8509, 8509 A, 7616, 266 Saint-Victor 175, et 793 Saint-Victor 548. Cette nomenclature est encore très incomplète : à ma connaissance, la Bibliothèque nationale en possède treize. Les douze premiers appartiennent au fonds latin, dans lequel ils portent les nos 8023, 8259, 8460, 8509, 8509 A, 11344, 11392, 11393, 11418, 14176, 14381 en remplacement de la cote 266 Saint-Victor 175, et 15135 en remplacement de la cote 793 Saint-Victor 548 ; le dernier dépend du fonds français, dans lequel il est inventorié sous le nº 1594 en remplacement du nº 7616.
Je vais donner la description de ces treize manuscrits, et j’y ajouterai, à raison de l’analogie qu’ils ont avec le manuscrit 1594, une analyse sommaire de ceux du fonds français portant les cotes 1595, 19123, 24310 et 983.
A. Manuscrit 8023. §
Le catalogue imprimé de 1744 donne du manuscrit 8023 l’analyse suivante :
Codex partim chartaceus, partim membranaceus, olim Colbertinus. Ibi continentur :
1º Catonis disticha, cum commentario.
2º Eadem disticha ; passim inter lineas glossæ et ad marginem scholia.
3º Theoduli ecloga : initium desideratur.
4º Anonymi carmen de rebus ad mores spectantibus.
5º Anonymi aliud id genus carmen.
6º Geraldi Odonis, Ministri generalis Fratrum Minorum, vaticinia de fine mundi, è Daniele potissimum et Abbate Joachimo petita.
{p. 504}7º Luciferi epistola ad mundanos, anno 1351 scripta.
8º Garriti fabularum liber, Æsopo parum rectè tributus.
9º Tobiæ prophetia, à Matthæo Vindocinensi versibus expressa : passim ad marginem scholia.
Hujusce codicis pars decimo quarto, pars decimo quinto sæculo videtur exarata.
Le manuscrit est du format in-4º. Il se compose de 134 feuillets, dont la première partie est en papier et la deuxième en parchemin.
Les fables, dont l’écriture paraît être du xive siècle, commencent au feuillet 63 et finissent au feuillet 101. Ce sont seulement les soixante fables primitivement connues. Chacune d’elles est précédée d’une glose dont l’écriture est plus fine que celle du texte. C’est dans la glose du prologue qu’elles sont attribuées à un poète qui se serait nommé Garritus. Elles se terminent par ce vers que les moines du moyen âge aimaient à placer à la fin de leurs copies :
Finito libro sit laus et gloria Christo. — Amen.
B. Manuscrit 8259. §
Le catalogue imprimé de 1744 donne du manuscrit 8259 l’analyse suivante :
Codex chartaceus, olim Colbertinus. Ibi continentur :
1º Anonymi commentarius in Catonis disticha.
2º Sancti Augustini tractatus de dignitate Sacerdotum.
3º Anonymi versus parænetici ad Sacerdotes.
4º Magistri Theodoli ecloga : accedit commentarius.
5º Æsopi fabulæ, versibus latinis : accedit commentarius.
6º Alani parabolæ, cum commentario : præmittitur authoris vita.
7º Liber floretus, sive carmen de virtutibus et vitiis : accedit commentarius.
8º Anonymi sermo de poenitentia.
9º Pœnitentiarius Magistri Johannis de Garlandia, cum commentario.
Is codex sæculo decimo quinto exaratus videtur.
De l’analyse du catalogue il ressort que l’écriture du manuscrit paraît être du xve siècle. Il appartient au format in-4º et se compose de 234 feuillets en papier. Les fables commencent en tête du recto du feuillet 73 et finissent au bas du verso du feuillet 96 ; chacune d’elles est accompagnée d’un commentaire. Seules les 60 premières y figurent ; encore la soixantième n’est-elle pas complète. Elle s’arrête à ce vers :
Surgo, surge, miser : pudor est mactare sedentem.
{p. 505}Ce vers contient des leçons qui sont en désaccord soit avec celles des autres manuscrits, soit avec celles des éditions imprimées. Et qu’on ne croie pas que ce soit là une particularité exceptionnelle ; car tous les manuscrits, comparés entre eux, offrent d’innombrables variantes, qui ne permettent pas de parvenir avec certitude à la restitution des véritables leçons.
C. Manuscrit 8460. §
Le catalogue imprimé de 1744 donne du manuscrit 8460 l’analyse suivante :
Codex membranaceus, olim Puteanus. Ibi continentur :
1º P. Ovidii Nasonis liber de remedio amoris.
2º Catonis disticha de moribus.
3º Theoduli ecloga.
4º Anonymi carmen morale de contemptu mundi.
5º Æsopi fabulæ, versibus heroïcis.
6º Matthæi Vindocinensis ad Bartholomæum, Turonensem Archiepiscopum, Tobias, sive metaphrasis libri Tobiæ, versibus elegiacis.
7º Ovidii liber de remedio amoris : finis desideratur.
Is codex decimo quarto sæculo exaratus videtur.
Le manuscrit a la dimension d’un petit volume in-8º. Les feuillets sont en parchemin. L’écriture paraît être du xive siècle. Il se compose de 125 feuillets.
Les fables ésopiques commencent au recto du feuillet 48 et finissent au verso du feuillet 68. Les 60 premières seules y figurent. Elles sont terminées par ce mauvais distique, qui, comme tous ceux de la même nature, est évidemment une addition du copiste :
Christus laudetur, Æsopi quia finis habetur.Finito libro sit laus et gloria Christo.
D. Manuscrit 8509. §
Le catalogue imprimé de 1744 donne du manuscrit 8509 l’analyse suivante :
Codex membranaceus, quo continentur Aesopi fabulæ, versibus elegiacis : interprete anonymo. Is codex decimo quarto sæculo videtur exaratus.
C’est celui que Schwabe avait signalé, en lui attribuant le nº 893 et le titre de Liber Hisopi. C’était une double erreur qu’il avait empruntée à Labbé et que Dressler s’est empressé de répéter.
Le manuscrit a porté successivement le nº DCCCXXII dans l’inventaire de Rigault, le nº 893 dans celui de Dupuy imprimé en {p. 506}1645, le nº 5642 dans celui de Clément imprimé en 1682, enfin le nº 8509 dans le Catalogue des manuscrits latins imprimé en 1744. Il y avait donc, lorsque Schwabe lui attribuait le nº 893, plus de deux siècles que ce numéro avait été remplacé par un autre, auquel, depuis plus d’un demi-siècle la cote actuelle avait été substituée.
Quant au titre, il se formule ainsi : Incipit liber Esopi
, et non pas : Hisopi.
Dans ma première édition j’ai exprimé l’idée que le manuscrit avait appartenu à Paul Petau.
Nicolas Rigault avait pris chez lui communication d’un
manuscrit des fables de Walther, et, en même temps que d’un autre
manuscrit que j’aurai bientôt à faire connaître, il s’en était servi en
1599 pour livrer à la publicité six fables élégiaques imprimées dans les
notes de sa première édition de Phèdre. Voici, en effet, ce qu’on lit dans
son commentaire sur la fable 29 du livre I : « Asinus
irridens aprum. Hanc fabulam refert Camerarius, verum Phaedri
nequitiam dissimulat, pag. 174. Fabularum scriptor ante centum annos
Venetiis excusus, et in Bibliotheca P. Petauij v. c. et S. Victoris
Paris. manuscriptus. »
Mais si la déclaration de Rigault ne permet pas de douter
que Paul Petau ait possédé un manuscrit de Walther, il est constant, ainsi
que M. Omont, sous-bibliothécaire au département des manuscrits de la
Bibliothèque nationale, a eu la complaisance de me le démontrer, que,
contrairement à ma première supposition, ce manuscrit n’a rien de commun
avec celui dont il est ici question. Ce dernier en effet est un de ceux de
Naples qui ont été apportés en France par les rois Charles VIII et
Louis XII et placés au château de Blois. En y regardant de près, on peut
encore, au haut du recto du premier feuillet en parchemin, déchiffrer la
cote Cxlj qu’il avait reçue à Naples et qui signifie soit 141, soit C. 41,
et, au bas du feuillet 16 vº, la signature Duca di
Amerfe
, qui montre à qui il avait appartenu avant
d’entrer dans la Bibliothèque des rois des Deux-Siciles. En outre, au
recto du premier des deux feuillets de garde en papier placés par le
relieur en tête du volume, on peut aisément lire l’annotation suivante
dont il a dû être revêtu à Blois avant 1545 : Tabula
poetica ad terram || est alius.
Quant à sa provenance, elle se reconnaît tant au nom italien de son premier propriétaire qu’à la reliure, dont, comme tous {p. 507}ceux des manuscrits de Naples, les plats en bois sont recouverts de veau estampé et avaient été garnis de fermoirs, et qu’à l’écriture, qui est l’italienne de la fin du xive siècle.
Le manuscrit est un in-4º formé de deux cahiers en parchemin comprenant ensemble seize feuillets et ne contenant que les fables de Walther.
Chaque fable est précédée d’un titre à l’encre rouge et accompagnée de notes interlinéaires d’une écriture microscopique et beaucoup plus récente que celle du texte. Il y a soixante-deux fables. À la fin de la soixantième, on lit ce distique un peu différent de celui qui se trouve dans les éditions imprimées :
Fine fruor : versu gemino quod cogitet omnisFabula declarat datque quod inter habet.
Les deux autres fables qui complètent le recueil sont les
fables De Capone et Accipitre et De Pastore
et Lupo. Elles sont suivies de ces mots : Deo
gratias Amen
, qui terminent le recto du seizième
feuillet. Le verso de ce feuillet est rempli par des écritures sans suite,
plus modernes, mais presque indéchiffrables.
E. Manuscrit 8509 A. §
Le catalogue imprimé des manuscrits latins donne du manuscrit 8509 A l’analyse suivante :
Codex membranaceus, olim Mazarinæus. Ibi continentur :
1º Æsopi fabulæ, versibus elegiacis ; anonymo interprete.
2º Magistri Johannis Faceti liber ; aliàs, inscribitur liber facetiæ, sine quo nemo potest esse bene moriginatus.
3º Fragmentum elegiæ amatoriæ, cui titulus Pamphilus.
4º Geta, sive Amphytrion ; comœdia de amoribus Jovis et Alcmenæ.
Is codex decimo quarto sæculo videtur exaratus.
Ce manuscrit paraît provenir de la bibliothèque du cardinal
Mazarin, et n’être entré qu’après sa mort dans celle du Roi. Il s’ensuit
qu’il ne se trouve pas dans l’inventaire imprimé de 1645, et qu’il figure
au contraire, sous le nº 5643, dans l’inventaire imprimé de 1682. Dans le
catalogue imprimé des manuscrits latins on lui a, en 1744, donné la
cote 8509 A. C’est un volume in-4º de forme un peu
allongée, relié en maroquin rouge avec l’écusson du Roi sur les plats. Au
dos se trouve le titre suivant, dont les mots sont abrégés à cause de
l’épaisseur trop faible du volume : Esopiæ fabulæ cum
scholiis.
Il se compose de 27 feuillets en parchemin.
L’écriture est {p. 508}la gothique française, qui,
malgré l’indication contraire du catalogue, m’a paru être de la fin du
xiiie siècle.
Les fables ne portent pas de titre ; au nombre de soixante, elles occupent la première partie du manuscrit et s’arrêtent au quart du verso du quinzième feuillet. Chaque fable est accompagnée d’une glose interlinéaire, en écriture microscopique, qui le plus souvent se prolonge jusqu’à la marge de la suivante. Cette écriture paraît presque aussi ancienne que celle du texte. Au lieu du distique suivant qui se lit après la soixantième fable dans les éditions de la société Bipontine et de Dressler :
Fine sui, versu gemino, quod continet omnisFabula declarat datque quod intus habet,
on trouve cet unique hexamètre :
Laus et honor Christo ; versu liber explicit isto.
Puis viennent ces deux mots : Explicit
Esopus.
Le nom du véritable auteur manque, comme dans tous les autres manuscrits que j’ai déjà examinés.
Les fables sont suivies de trois ouvrages poétiques, dont
le premier paraît complet, à en juger par ces mots qui le terminent :
Explicit doctrina magistri Johannis Faceti,
etc.
Quant à l’ouvrage lui-même, on le rencontre souvent
dans les anciens manuscrits. Je ne puis mieux indiquer ce qu’il est qu’en
renvoyant à la notice du catalogue.
Les dernières pages sont remplies par un fragment d’élégie amoureuse intitulée Pamphilus et par un poème relatif aux amours de Jupiter et d’Alcmène.
Sauf M. Robert et M. du Méril, aucun auteur ne paraît même avoir soupçonné l’existence du manuscrit de Mazarin.
F. Manuscrit 11344. §
C’est M. Van Praet qui signala à M. Robert l’existence du
manuscrit 11344, et il faut avouer que, sans le vouloir, il lui rendit un
mauvais service. En effet, M. Robert ayant vu en tête des fables le titre
suivant : Incipit liber eusopi edito a magistro
Gauffredo
, en tira, au grand détriment de sa bonne
réputation de critique, la déduction fort irréfléchie que j’ai rappelée.
Mais, s’il avait aperçu cette phrase qu’il eût pour lui mieux valu ne pas
découvrir, il ne s’était pas préoccupé de la cote du manuscrit, et, n’en
rencontrant {p. 509}pas le signalement dans son
ouvrage, j’ai eu beaucoup de peine à le retrouver. Y étant néanmoins
parvenu, je puis maintenant en donner ici la description sommaire.
Le manuscrit 11344 forme un volume in-4º de très petit format. Il se compose de 81 feuillets en parchemin, dont l’écriture fort nette est du commencement du xve siècle. Les ouvrages qu’il renferme sont les suivants : 1º le livre de Caton, 2º une épître en vers, 3º le livre De contemptu mundi, 4º l’églogue déjà plusieurs fois rencontrée de Théodule, 5º les fables de Walther, 6º le livre de Tobie.
Les fables, dont j’ai seulement à m’occuper, commencent au recto du fol. 28 vers le bas de la page. Elles sont au nombre de 61, réparties sous 62 numéros. La dernière est intitulée De Lupo et Pastore. C’est une des deux fables qui sont le plus souvent ajoutées aux soixante premières. Elle se termine vers le bas du fol. 45 recto, et, comme dans les manuscrits 8023 et 8460, est suivie de ce dernier vers, ou plutôt de cette espèce de soupir de soulagement qu’au moyen âge les copistes avaient l’habitude de pousser à la fin de leur tâche :
Finito libro sit laus et gloria Christo.
Une main moins ancienne avait écrit au-dessous deux lignes, dans lesquelles se trouvait le nom d’un des propriétaires successifs du volume ; mais, suivant une habitude autrefois trop constante, un propriétaire postérieur a effacé ce nom, de sorte qu’il ne reste plus que ce qui suit :
Quis scripsit scribat, semper cum domino vivat.Iste liber est . . . . . . . . . Nutriti Ucecie.
Toutefois au bas du fol. 54 a on lit :
Tanguidus Nutriti de Ucecia.
G. Manuscrit 11392. §
Le manuscrit 11392, qui, dans le supplément à l’ancien fonds, portait le nº 597, est un volume in-8º, qui se compose seulement de dix-neuf feuillets en parchemin, écrits par une main du xive siècle.
Les premier et dix-neuvième feuillets ne contiennent que
des fragments de prières latines ; très étrangères à l’œuvre de Walther,
elles ont été la première couverture du volume aujourd’hui relié en veau.
Les fables en vers élégiaques sont le seul ouvrage qu’il renferme ; mais
elles sont plus qu’au complet, c’est-à-dire qu’elles sont au nombre de 62.
Elles commencent au haut du recto du deuxième {p. 510}feuillet, ne sont précédées d’aucun titre, ne sont accompagnées d’aucun
commentaire marginal ni interlinéaire, et se terminent par cette phrase
usuelle : Explicit liber Esopi, deo gratias.
Amen.
H. Manuscrit 11393. §
Le manuscrit 11393, qui, avant la fusion de tous les fonds
latins, avait la cote Supp. l. 391, forme un volume
in-8º, composé de 21 feuillets en parchemin, dont l’écriture est du
xve siècle. Il porte sur le recto du
premier feuillet cette mention écrite par un de ses anciens
propriétaires : Jo. Bap. Ponzonus Clericus, possessor
huius libri.
Il est entièrement consacré aux fables de Walther, qui
commencent au recto du feuillet 2, et qui ne sont accompagnées d’aucun
commentaire. En marge chaque fable est ornée d’une miniature peinte dans
un petit cercle doré. Indépendamment des soixante fables ordinaires, il
renferme les deux complémentaires, qui y sont le plus souvent ajoutées, et
qui, dans les manuscrits, sont intitulées De Capone et
Accipitre et De Lupo et Pastore. Les fables se
terminent au verso du feuillet 20, sur lequel on lit : Explicit liber Esopi
, et au-dessous : Deo gratias. Amen
, et plus bas : Finito libro refferamus gratias Christo.
Enfin il existe un vingt et unième feuillet, sur le recto
duquel le même propriétaire du manuscrit a réitéré sa première déclaration
par cette mention : Questo libro e di Gio. Batista
Ponzono 1578. A di 30 di Giunio.
I. Manuscrit 11418. §
Le manuscrit 11418 figurait autrefois dans le supplément du fonds latin sous la cote 1749. Il appartient au format in-4º et se compose de 177 feuillets en papier. Il est formé de la réunion de plusieurs cahiers, sur chacun desquels figurent des opuscules transcrits par des mains diverses.
Le premier de ces cahiers comprend quatorze feuillets
numérotés de 1 à 14, et renferme une copie des fables de Walther faite par
Pierre Pithou sur un ancien manuscrit. C’est là ce qui ressort de cette
mention qui les précède : Ex vetusto codice
sumptum.
Quel était cet ancien manuscrit, d’où provenait-il, et à
qui appartenait-il ? Voilà ce que, selon son habitude, il n’a pas pris la
peine d’indiquer. Supposant que c’était un des deux manuscrits de l’abbaye
de Saint-Victor, j’ai voulu les comparer à sa copie. Mais je n’avais pas
poussé mon examen comparatif jusqu’à la fin du prologue des fables, que
j’avais déjà acquis la certitude qu’il ne s’en était {p. 511}pas servi. En effet, au cinquième vers du prologue, les
deux manuscrits portent Fructum lege
,
tandis que dans la copie de P. Pithou on lit : Fructum
cape.
Cette copie ne comprend que les soixante fables ordinaires ; elles portent 61 numéros à cause de la division en deux parties de la fable des Grenouilles qui demandent un roi.
Les fables ne sont précédées d’aucun titre général ; mais
chacune porte un titre spécial. En marge des trois premiers vers de celle
qui concerne la Matrone d’Éphèse, P. Pithou a écrit cette note :
Hæc Fabula sumpta est Petronio Arbitro et relata à
Joanne Sarisberiensi in Policratico suo.
Le distique Fine sui
,
etc., qui d’ordinaire termine la soixantième fable, est suivi de cet
autre :
Perdere quisque suam sortem de iure meretur,Quam sua si placeant plus aliena sibi.
Au-dessous se trouve cette souscription finale : Hactenus de vetusto codice.
La copie se termine
au milieu du recto du fol. 14.
J. Manuscrit 14176. §
Le manuscrit 14176 est un volume in-8º, qui est formé de
122 feuillets en papier et dont l’écriture est du xve siècle. Il a appartenu à l’abbaye de Saint-Germain des
Prés, ainsi qu’il résulte de cette mention mise au bas du recto du premier
feuillet : Sancti Germani in pratis
, et
n’est passé à la Bibliothèque nationale qu’à l’époque de la
Révolution.
Les fables de Walther, qu’entre autres ouvrages il renferme, commencent sans titre général au milieu du verso du feuillet 40 et se terminent au verso du feuillet 66. Elles sont au nombre de 60, réparties par la raison connue sous 61 numéros.
Chaque fable porte un titre spécial écrit à l’encre rouge.
La dernière est suivie de ces mots écrits avec la même encre : Deo gratias. Amen.
K. Manuscrit 14381. §
Le manuscrit 14381, comme le précédent, n’est entré qu’à l’époque de la Révolution dans le grand fonds de la rue de Richelieu.
Auparavant il appartenait à cette fameuse abbaye de Saint-Victor, qui a dû à ses richesses bibliographiques une célébrité trop grande pour n’être pas ici l’objet d’une courte notice.
Cette abbaye, qui appartenait à l’ordre de Saint-Augustin, avait {p. 512}été fondée en 1113 sous Louis VI. À la porte du dortoir, cette origine était rappelée par l’inscription suivante en hexamètres rythmiques, gravée sur une plaque de cuivre :
Illustris genitor Ludovici rex Ludovicus,Vir clemens, Christi servorum semper amicus,Institui fecit pastorem canonicorumIn cella veteri trans flumen Parisiorum.Hanc vir magnanimis almi Victoris amore,Auro, reliquiis ornavit, rebus, honore.Sancte Dionysi, qui servas corpus humatum,Martyr et antistes, Ludovici solve reatum.Christi centeno, cum mille, decem et tribus, annoTemplum hoc Victoris struxit regalis honoris.
La règle de cette abbaye avait été créée, non par Hugues,
qui fut surnommé de Saint-Victor, mais par Guillaume de Champeaux, qui, en
1108, avait quitté l’archidiaconat de Paris, pour y établir une discipline
sévère. C’est ce qu’Abélard affirme en ces termes : « Elapsis autem
paucis annis, cum ex infirmitate jam dudum convaluissem, præceptor meus
Parisiensis archidiaconus, habitu pristino commutato, ad regularium
canonicorum ordinem se convertit… Nec tamen hic suæ conversationis
habitus aut ab urbe Parisiaca, aut a consueto philosophiæ studio eum
revocavit, sed in ipso quoque monasterio ad quod se causa religionis
contulerat, statim more solito publicas exercuit scholas,
etc. »
L’abbaye avait été établie hors la ville. Par suite de son importance toujours croissante, elle subit des agrandissements successifs ; on y créa notamment une chapelle souterraine, qu’on appela Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et dont le nom a survécu à l’édifice.
Mais ce qui faisait surtout l’importance de l’abbaye, c’était sa bibliothèque. Voici comment il en a été parlé dans une Dissertation sur les bibliothèques publiée à Paris par MM. Chaubert et Hérissant en 1758 :
« La bibliothèque des chanoines réguliers de Saint-Victor, rue des Fossés Saint-Victor, est aussi ancienne que leur maison, qui fut fondée en 1113. Elle était fort estimée du temps même de François Ier, à cause des manuscrits et des belles éditions que l’on y voyait ; elle fut dans la suite considérablement augmentée par la libéralité de plusieurs personnes, particulièrement de M. Dubouchet de Bournonville, qui en fut un des premiers bienfaiteurs, et par M. de Tralage, {p. 513}neveu de M. de la Reynie, lieutenant-général de la police de la ville de Paris, deux sçavans des plus célèbres de leur siècle. Cette bibliothèque est très considérable par rapport aux Livres Théologiques et Ecclésiastiques ; on y trouve un assez grand nombre d’anciennes éditions. Elle contient aussi plusieurs manuscrits très estimables, surtout par rapport à l’histoire ecclésiastique, de sorte qu’à ce dernier égard elle paraît préférable à plusieurs autres bibliothèques. »
Des manuscrits que possédait l’abbaye, celui qui nous occupe n’était pas le moins précieux.
Le catalogue manuscrit du fonds Saint-Victor, sur lequel il porte les nos 266 et 175, l’un ancien, l’autre plus récent, en donne l’analyse suivante :
Boëtius, de consolatione philosophiæ (in fine mutilus).
Prosperi epigrammatum pars ultima.
Catonis carmina.
Æsopi fabulæ versibus redditæ.
Lucanus de bello civili.
Versus Nasonis de Virgilio.
Virgilii Æneis.
Ejusdem epitaphium.
Le manuscrit forme un volume in-fº, dont l’écriture sur
parchemin paraît être de la fin du xiiie siècle. Il comprend 177 feuillets. Au bas du recto du
premier feuillet on lit : Iste liber est Sancti
Victoris Parisiensis. Quicumque eum furatus fuit vel celavit vel
titulum istum deleverit, anathema sit. Amen.
Cette note
établit bien que le manuscrit a appartenu à l’abbaye de Saint-Victor.
Au bas du feuillet 176 s’en trouve une autre, qui, en
montrant quel prieur l’avait acheté, précise l’époque à laquelle il y
était entré. Elle est ainsi conçue : Hunc librum
adquisivit monasterio Sancti Victoris prope Parisius frater Johannes
Lamasse dum esset prior eiusdem ecclesiæ.
Or Jean Lamasse
de Paris, à qui l’abbaye dut surtout l’extension de sa bibliothèque,
devint, le 26 octobre 1448, prieur sous le nom de Jean V et mourut le
30 mai 1458.
Entré dans la bibliothèque de Saint-Victor entre ces deux dates, le manuscrit y resta jusqu’à l’époque de la grande Révolution, où, avec les autres volumes échappés à la destruction, il alla enrichir l’immense collection du palais Mazarin.
{p. 514}Les fables ésopiques qu’il renferme commencent au recto du feuillet 27 et finissent au recto du feuillet 35. Elles sont au nombre de 62, et comprennent, outre les soixante fables ordinaires, les deux complémentaires De Capone et Accipitre et De Pastore et Lupo.
L. Manuscrit 15135. §
Le manuscrit 15135, comme celui qui porte le nº 14381, provient de l’abbaye de Saint-Victor et n’a dû entrer dans la Bibliothèque nationale qu’à l’époque de la Révolution.
Le catalogue manuscrit du fonds Saint-Victor, sur lequel il porte les nos 793 et 548, l’un ancien, l’autre plus récent, en donne l’analyse suivante :
Quædam de grammatica.
Officium translationis S. Nicolaï.
Compendium artis musicæ.
Passio S. Cirici.
Gosvini de Marbais tractatus.
Quædam carmina.
Litteræ concernentes statum monasterii S. Victoris.
Æsopi fabulæ metricè.
Carmina ordine alphabetico, excerpta è diversis authoribus.
Galfredi de vino salvo Poëtria nova.
Liber grammaticalis, metrificatus et glossatus.
Le volume est un in-8º écourté. L’écriture est italienne et paraît appartenir aux xiiie et xive siècles. Elle est très fine.
Il y avait originairement 261 feuillets en parchemin ; mais
le traité de musique, qui commençait au feuillet 96 et finissait au
feuillet 112, a disparu. Cette disparition a été constatée par M. Nisard,
qui, au commencement du livre, sur la face interne de la couverture a
inscrit une note ainsi conçue : « Ce qui a rapport à la musique a
été déchiré et volé. »
Le manuscrit ne contient que les soixante fables de
Walther. Elles sont précédées de cette invocation écrite à l’encre rouge :
Sancti Spiritus assit nobis gratia.
Amen.
Puis au-dessous on lit : Incipit
Esopus.
Les fables commencent au recto du feuillet 113 et finissent au recto du feuillet 126. Du verso de ce feuillet au recto du feuillet 128 s’étend une sorte de table des matières, où le titre de chaque fable à l’encre rouge est accompagné du distique qui en contient la morale.
Je dois enfin signaler une particularité qui a son
importance. Entre la fable xx
De Hirundine et Avibus et la fable xxi
De terra
{p. 515}Attica non habente regem se
trouvent ces mots à l’encre rouge : Explicit liber
primus ; incipit secundus.
Ils montrent que Walther avait
adopté la division en livres qui se trouve dans les manuscrits du Romulus
ordinaire et que chacun de ses livres se composait des mêmes fables, et
fournissent un argument de plus en faveur de la solution que j’ai adoptée
et qui a consisté à considérer son œuvre comme dérivée de ce Romulus et
non de celui de Vienne.
Maintenant que j’ai décrit les deux manuscrits du fonds Saint-Victor, je suis naturellement amené à me poser une question qui, je le reconnais, n’a pas un grand intérêt, mais dont la solution servira peut-être à satisfaire la curiosité de quelques personnes.
On se rappelle qu’à la fin du xvie siècle, Rigault, en préparant ses premières notes sur les fables de Phèdre, remarqua, dans la librairie du vieux monastère, un manuscrit qui contenait les fables d’un auteur alors inconnu ; il en transcrivit non pas seulement cinq, comme le dit Schwabe, et comme Dressler le répète de confiance, mais six qu’il inséra dans sa première édition de Phèdre. Était-ce dans l’un des deux manuscrits qui existent encore à la Bibliothèque nationale, ou bien dans un troisième aujourd’hui disparu, qu’il avait pris ces six fables ? Et si ce n’était pas dans un troisième, auquel des deux avait-il fait ses emprunts ? Telles étaient les deux questions qui devaient se poser d’elles-mêmes à ma pensée.
Pour que l’on pût apprécier si ces fables avaient été puisées dans le manuscrit 14381, ou dans le manuscrit 15135, ou enfin dans un troisième aujourd’hui disparu, j’ai, dans ma première édition, extrait les variantes présentées par les deux qui subsistent, et je les ai comparées avec les leçons adoptées par Rigault.
Je ne crois pas bien utile de reproduire ce travail comparatif. Qu’il me suffise de dire qu’il en est ressorti que les deux manuscrits offrent chacun des variantes, qui non seulement les font différer entre eux, mais encore les font tour à tour différer du texte de Rigault. Il n’en faut pas conclure qu’il a existé un troisième manuscrit de Saint-Victor. Non seulement l’abbaye de Saint-Victor n’en a pas possédé un troisième ; mais encore Rigault n’en a connu qu’un seul : le manuscrit, auquel il fait allusion, doit être le manuscrit 14381, qui, acheté par le prieur Lamasse, était probablement seul dans l’abbaye au temps de Rigault, et qui me semble moins que l’autre s’écarter des leçons qu’il a préférées.
{p. 516}Si entre ce manuscrit et la copie de Rigault il n’y a pas conformité complète, cela tient sans doute à ce que Rigault aura cru devoir corriger les passages qui lui paraissaient fautifs. Et puis il ne faut pas oublier qu’il eut également recours au manuscrit de Petau et qu’il y dut prendre quelques variantes, selon lui, plus conformes au véritable texte.
2º Manuscrits français de la Bibliothèque nationale. §
A. Manuscrit 1594. §
Parmi les manuscrits français je n’en ai trouvé qu’un seul contenant les fables de Walther. Après avoir porté successivement le nº 842 et le nº 7616, il figure aujourd’hui au catalogue sous le nº 1594. À raison de son importance, M. Robert, dans sa publication des fables inédites du moyen âge, en a fait l’objet d’une étude spéciale.
Il n’offre pas seulement, comme les précédents, un intérêt purement littéraire ; aux points de vue artistique et calligraphique il mérite encore une attention toute particulière ; les miniatures dont chaque fable s’y trouve ornée et le talent du copiste à la plume duquel il est dû, en avaient fait ce qu’on appellerait aujourd’hui un vrai livre de luxe. On me permettra donc de m’y arrêter un peu plus qu’aux autres.
Il forme un vol. in-4º, dont les feuillets sont en
parchemin. Il se compose de 115 feuillets numérotés, dont l’écriture
gothique appartient au xive siècle. Ces
feuillets sont eux-mêmes précédés de deux autres non numérotés. Le premier
porte au haut du verso cette mention qui remonte à une époque très
ancienne : Histoires et liures en frācois pulto 1o contre la muraille deriere
la court.
Le second porte au milieu du verso cette autre
mention moins ancienne : A mon entrée à la librairie
du Roy, j’ai trouvé le présent volume fort gasté comme il est, a
raison qu’il estoit a l’endroit d’une fenestre mal
joincte.
Les 89 premiers feuillets numérotés contiennent les fables de Walther, suivies chacune d’une traduction en vers français de 8 syllabes, dont l’auteur inconnu a reçu de M. Robert le nom d’Ysopet I.
En tête de la première page le miniaturiste qui a illustré le manuscrit, a représenté l’auteur, sous la forme d’un moine à genoux, offrant son livre à la Vierge qui est assise et qui dans ses bras tient l’enfant Jésus.
Au-dessous le titre général du livre est ainsi conçu :
Compilatio Ysopi alati cum auinioneto cum
quibusdam addicionibus et moralitatibus.
{p. 517}L’auteur se qualifie de compilateur ; on voit qu’il a voulu se mettre en garde contre l’accusation de plagiat. Voilà ce qui ressort d’abord du titre. Mais ce n’est pas tout ; les noms d’Ysopet et d’Avionnet montrent que le manuscrit comprend deux séries de fables ; le volume se divise en effet en deux parties : la première contenant les fables de Walther ; la deuxième, dix-huit de celles d’Avianus. Le titre enfin indique qu’il a été fait à l’œuvre primitive quelques additions. Quand on cherche ce qu’elles sont, on voit qu’elles ont porté sur les épimythions dont le texte latin a été augmenté de quelques vers ; ce qui a obligé à allonger d’autant la traduction française.
Ailleurs, quand je donnerai l’analyse du manuscrit français 1595, il me sera facile d’établir que l’amplification latine et la traduction française qui en a été faite constituent bien une œuvre postérieure à la traduction du véritable texte de Walther.
Après le titre vient le prologue de Walther, auquel le copiste a fait l’addition suivante :
Ut loquar uberius adsit michi virgo Maria.Suppleat eclisim filius ipse suus.Cum nessimus (sic) enim perpleri quod faciamus,Auxilium mittunt celitus ista duo.
Le prologue ainsi accru est suivi d’une traduction, en tête
de laquelle le copiste, fort préoccupé de la symétrie, a placé un titre
général ainsi conçu : Ci commence la compilation de
Ysopet-Avionnet.
Voici la traduction :
Ce liuret que cy vous recitePlaist à oïr et si proufite ;Et pour ce que plus delitablesSoit, y a maintes belle fables.A ce qu’oiseuse ne peresseMon sen n’endorme ne ne blesse,Me vueil trauilier et penerD’un petit iardin a hener,Ou chascun pourra, se me samble,Et fleur et fruit cuillir ensamble :Fleur que a oir est delitables,Fruis qu’en est fais et profitables :Qui la fleur plaira la fleur preigne,Et qui le fruit, le fruit retiengne ;Qui voudra le fruit et la fleur,Prengne les deux, c’est le mellieur.{p. 518}Et pour ce que saiche est ma terre,Au iardin vueil faire requerreDieu qui tout puet et scet et voit,Que de sa rousee m’enuoitQui le iardinet par sa graceFleurir et fructefier face :Pour ce qu’il soit plus essauciez,Je ioins mes mains deuos au ciez,Que suppliant tout mon deffautLa mere et le fis qui ne faut ;Quar com ne sauons que faisonEt conuient que par tout trason,De cieulx enuoie le subside :La mere et [le] fis nous aïde,E main biau dit qui semble fableHa main biau mot et anotable.J’ay oy dire mainte foiz :Sus saiche cruse est bonne noiz.
Puis se succèdent, suivies chacune de sa traduction, les fables latines de Walther, qui, ainsi que le prologue, sont allongées à l’aide de quelques vers ajoutés, au nombre de quatre en général, à l’affabulation primitive.
En tête de chacune des fables latines est une miniature, qui, quoique péchant par la raideur et le défaut de perspective, présente presque toujours une délicatesse de détails et une finesse d’exécution, supérieures aux dessins des manuscrits de la même époque.
Il y a 64 fables ; mais les fables 21 De ranis volentibus regem, et 59 De Atheniensibus volentibus regem, n’en formant qu’une seule dans les éditions imprimées, il faut n’en compter que 63. L’édition Dressler contenant 62 fables, on en devrait conclure que le manuscrit 1594 en renferme seulement une qui lui soit étrangère. Mais il n’en est pas ainsi : ce manuscrit ne possède pas les fables qui, dans cette édition, portent les nos 48, 49, 50 et 60. En revanche, les fables 47, 61, 62, 63 et 64 du manuscrit ne se rencontrent pas dans les éditions imprimées. Je ne sais de qui elles sont l’œuvre ; ce qui est certain, c’est que le style en est tellement barbare et la versification tellement fautive que Walther ne peut en avoir été l’auteur. On les trouvera dans l’appendice, qui, dans le second volume de cet ouvrage, fera suite aux soixante premières fables.
Après cette première observation sur le texte latin des 5 fables {p. 519}étrangères à Walther, je vais faire connaître la liste complète de celles que le manuscrit contient dans sa première partie, et à cet effet transcrire ici dans leur ordre les titres français que leur traduction porte :
1. Du Coc et de l’Esmeraude.
2. Du Loup qui mist sus a l’Aigniel qui troubloit le ruissel.
3. De la Grenoille qui conchie la Souris.
4. Le Plet du Chien et de Brebis.
5. Du Chien qui passoit l’ieaue et tenoit une piece de froumage.
6. Comment la Brebis et la Chieure et la Genice et le Lion sentre acompaignierent.
7. D’une Femme qui se maria a un Larron.
8. Comment la Grue garist le Loup.
9. De deux Chienez.
10. Du Villain qui herberia le Serpent.
11. L’Asne qui salue le Sanglier.
12. De la Souris de bonne ville et de celle de vilaige.
13. De l’Aigle et de Renart.
14. De l’Aigle et de la Limace.
15. Du Renart et du Corbel.
16. Du Lion qui cheï en viellesce.
17. De l’Asne et du Chien.
18. D’un Lion et de la Souris.
19. Des Rainnes qui voudrent auoir roy.
20. Du Loup et de la Truie.
21. Des Colons et de l’Escoufle.
22. Du Chien et du Larron.
23. De la Terre qui enfanta une Souris.
24. Du Filz a l’Ecoufle qui estoit malades.
25. De l’Arondelle et de autres Oisiaux.
26. Du Loup et de l’Aigniau.
27. Du Chien qui cheï en viellesce.
28. Des Lieures qui s’enfuioient.
29. De la Chieure et du Loup.
30. [Du V]ilain qui norrit le Serpent.
31. Du Serf, de la Brebis et du Loup.
32. De la Mouche et du Preudoume.
33. De Renart et de la Segogne.
34. Du Corbiau qui se para de plumes du Paon.
35. D’un Muletier et d’une Mule.
36. De la Mouche et du Fremi.
37. Du Singe et du Renart et du Lieure.
38. Du Preudoume et de la Belète.
39. De la Rainne et du Buef.
{p. 520}40. Du Pastour qui osta l’espine du pié au Lion.
41. Du Cheual qui mata le Lion.
42. D’un biau Cheual et de l’Asne pel.
43. De Renart et du Loup.
44. Du Serf morant de soif.
45. De la Bataille des Bestes et des Oisiaux.
46. Du Rossinol et de l’Ostoir.
47. Du Loup et du Mouton.
48. D’un Serpent qui rungoit au dens une lime.
49. De la Bataille des Loups contre les Brebis.
50. Du Bois et de la Coignie.
51 [Du L]oup qui se veult accompaigner au Chien.
52. Du Contens du Ventre et des Membres.
53. Du Singe et du Renart qui li pria qu’i li donast de queue.
54. D’un Marchant et de son Asne.
55. Du Serf qui issi du bois, qui se cuida sauuer chieuz un vilain.
56. De l’Ostoir et du Chapon.
57. Du Loup, du Pastour et du Chien.
58. Du Boutellier et du Juif.
59. Des gens de la Cité d’Athenes.
60. Du Loup qui trouua une teste painte.
61. De l’Espreuier et du Coulon.
62. Des Souris qui firent concilie contre le Chat.
63. Du Coc et de la Souris.
64. De la Femme qui nourrissoit sa Vache et el la commendoit chascun iour a un saint.
La première partie du manuscrit consacrée aux fables de Walther se termine par l’épilogue suivant :
c’est la substance de cest livre.
Or vous ai conté mainte fableOu maint bon mot et profitablePuet chascun oïr et entendre,Qui a la fin se voudra prendre ;Mais aus bourdes ne gardés mie.Toute la moüelle et la mie,Tout le sen, toute la substance,Vous enseigneront sans doubtanceLes derreniers vers de la fable :Car il sont trestout veritable.Et du fransçois et du latinPrenés vous sans plus à la fin.Il n’i a nulle faus[se]té,Et pour ce l’é-ie translaté :{p. 521}Pour les dames tant seulementL’ai du latin trait en romant,Esquelles excellant clergieNe tres eminant n’afiert mie ;Mais est proprement leur ouurageDe Dieu seruir de bon courage,Et de leur belle portéureAvoir et diligence et cure,Et que facent chose plaisantA leurs maris en eulx aisant ;Et li mari doiuent entendreAus armes et lettres aprendre ;Mes de armes doiuent sauoir,Plus les amer sus toute auoir.Et pour ce dit IustiniensQui fist les livres anciens :Je veuil mes cheualiers adrois,Plus sachent armes que les drois :Mais l’un et l’autre et bon ensemble.Si doit l’en mettre, ce [me] semble,Noble homme quant il a vii ans,Que aus letres soit entendansJusques a xiiii ou a xv ;Puis lui soit la leson aprinseDes armes et la cognoissance,Quant cheuauche et hors d’enfancePour viter peresce et repos.Revenons a nostre propos :Ce liure fit chier a tenir.Ci conuient Ysopet fenir.Ie vous aferme et creantDe ce ne mentur neantQue estudier en YsopetN’est pas euure de mignopet :Car en y treuue veritéCombien que fable recitéFait ce n’est pas a meruilier :Car qui en logiq’ veut veillier,Il trouuera que des presmissesFusiés ensemble bien assisesEt ansinc vraye conclusion.Yceste est vraye opinion.Mais aucunement veritéNe puet engondier fausseté :Car ce qui est ne puet non estre,{p. 522}Et qui n’est pas puet bien estre ;Et l’espine porte la rose ;De ianuier ist bien douce chose ;La rose près est de l’ortie ;La terre qui bien est gargniePorte bon blef et pour ce vuarge[Bo]n et mauués ensemble charge ;[L’en] ne se doit si abergier,[Ta]ntost l’un pour l’autre arragierJusques l’en viengne à la murté,Plus puet l’en par grant seurtéMiex a part mettre le bon blé,[Les] chardons soient asemblé,Les vuarges pour un feu mettre.Ainsi les nous dit en la lettreLi souuerres de tout le monde ;Pour ce que la ou il abondeMultitude et humain lignageSembleroit que ce fust doumageQui vaudroit debonnairetéPour cause de pularité ;Car qui voudroit tout effacierLes bons y faudroit enlacier.Ne puet estre qu’em mainte gentNe soient aucun bel et gent.
Je passe à la seconde partie du manuscrit. Elle s’étend du feuillet 89 a au feuillet 113 b. Elle commence par ce prologue :
Or vous ai des fables aprisesQui en Ysopet furent prises.Auionnet, un autre liureD’autres bonnes fables nous liureProfitables a escouter :Pour ce d’aucunes auiterMe vueil encores entremettreEt du latin ens roumans mettreAu preu de ceulz qui les liront ;Car aucun bien aprendre y pourront.Dou latin, des vers y auraPourquoy le sens plustost sauraPar le latin sera trouués,Dont le françois après ourrésNe [com]pren pas toute l’istoire ;Car seroit troup longue memoire,Et ce le fais pour breueté{p. 523}Qui est amie verité ;Et pource que par auentureNe plaist une longue escripture,Plus est en bénignitéBreueté que n’est prolixité,Et y mettre aucune choseQue trais en cieute ou en glose :Car on doit tout mettre en escriptOu en cuer le bien qu’est escript.De ce me vuieille secourirLe Dieu qui pour nous voult mourirEt la Dame qui le porta.En la nommer grand déport a.
La collection des fables d’Avianus, qui suit ce prologue, comprend, comme la précédente, le texte latin et la traduction en vers français. Mais elle est loin d’être complète. Elle ne contient que 19 fables. Comme dans la première partie du manuscrit, chaque fable latine est précédée d’une miniature appropriée au sujet et suivie d’une traduction française en vers de huit syllabes.
Voici les titres des dix-neuf fables françaises :
1. De la Norrice qui deceut le Loup de sa parole.
2. De l’Écreuisce qui aprenoit son filz a aler.
3. De la comparison et contens du Soleil et du Vent de bise.
4. De. ij. Compaignons que l’Ourse fist dessambler.
5. D’un Cheualier chauue.
6. Du Vilain qui trouua le tresor en sa terre.
7. Du Singe qui disoit que ses Singios estoient li plus biaus.
8. Du Paon et de la Grue.
9. Du biau Chene qui ne se vouloit fléchir contre l[e Vent].
10. Des. iiij. Toriaux que le Lion deceut pour ce qui les fist desembler.
11. Du Lapin et du Bisson.
12. Du Pechieur Poisson prenant.
13. De. ij. Menestriers l’un conuoiteus et l[’autre enuieus].
14. De l’Anfant qui conchia le Larron.
15. De la Cornille qui but l’eaue par son engin.
16. Du Singe et de ses. ij. Singes.
17. Dun viel Buef et du iuesne Touriau.
18. De Renart et de la Ourse.
19. D’un Menestrier enuoié de l’espouse pour auoir une robe d’un chanoine de troies.
La fable xix n’est pas, comme chacune des dix-huit autres, la traduction d’une des fables latines d’Avianus ; mais, comme elle y {p. 524}fait suite, c’est dans l’édition que je donnerai de ces fables que j’en publierai le texte.
Le manuscrit 1594 se termine par un épilogue, qui commence au milieu du recto du feuillet 112 et finit au milieu du verso du feuillet 113. Je le reproduis ici, parce qu’il fournit des renseignements utiles sur le copiste et sur le temps où il vivait :
comment l’acteur a compilé ces livres
avecques adicions aucunes
en l’onneur de madame la
royne.
Or est temps que ie doie entendreA Dieu louer et grâces rendre,Pouquoi ie me sui entremisDe ce liuret ci, ou ie misCe que me semble que bon estDe Ysopet et d’Auionnet.Aucune chose ay trespassé,Et aucune autre enmassé :Aiousté y ay aucun compte,La moralité toute seurmonte.De venter ne vieil faire faisteQue i’aie fait tout de ma teste ;Mes en ai trouué plus grant partieDe compilé, se Diex m’aye,Et du francois et du latin,Qu’ont esté pour leuer matinTranslaté et par grant estude,Par tieux qui n’ierent ne fol ne rude,Je qui suis des autres le pis,Apres le grain cuilliez espis,Si comme fist Ruth la courtoise,[Qui fut dame sans nulle boise.]Qui n’a le grain [aura la] paille.Ainsi comme il est, le vous baille.Toute sience vient du PereDe lumiere, de ce me pere :En celi met mon parementLe doulz Ihesu-Crist qui ne ment :Tout bien de quoi homme est imbuéEstre le doit attribué,Dire li deuons comme estable :Tes sers somme non proufitable,Tout le bien qui puet estre ditDescent de vous sans contredit :{p. 525}Toute chose aues fait pour homme ;Ci deuous dire toute soume,Vous Dieu, tres debonnaire fins,Nostre vie estes, nostre fins.En l’onneur de madame chiereLa royne a tres belle chierre,Madame Iehanne de BourgoingneOu n’a ne mente ne vergoingne,Fille du roy de celle terre,Ceste matiere ay voulu querre,Pour [y] trouer ebatement,Aus iuesnes gens ensaignement,Et mesmement quant est yuersEt le temps est fors et diuers,Si que on ne puet cheuauchier,Ains se conuient au feu cachier,Ne puet l’en mouuoir de la chambre,Lors est bon que l’en se remembreD’aucun liure ou narrationOu naist de ma occasion.Si comme dit Chaston le sage,C’est deliure le vaselage,De regarder les iugemensQu’ont esté fais es parlemens,De ce me passe ci breffment,Sans faire long sermonnement :Car n’a mestier de ma doctrineLa sage dame bonne et fine.Le sage deuient par oïrPlus sage et sans conioïr,Si comme Salemons l’escript,Ainsi le trouuons en escript.Auoir la voeille en sa gardeLe roy puissant qui tretout garde,Le roy Philippe son seigneur,De lignage sur tous greineur,Leurs enfans, toute la lignieDe France qui tant est prisie :Qu’apres les ennuis de ce mondeSoient ou tout soulas abonde,Mon seignieur ne vueil trespasser,Le duc mes vueil amasser,L’aisné filz du bon roi de France,Qui est de justice balance,Madame Bonne sa compaigne,{p. 526}Qui de bonté porte l’ansaigne.Ne semble pas estre riméQui n’est clerement exprimé :De sa belle succession,De ces enfans pour qui prionQue ihūcrist, le roy de gloire,Auoir les vueille en sa memoire.
En se fondant sur cet épilogue, M. Robert fait sur le
traducteur et sur son œuvre les conjectures suivantes : « C’étoit,
dit-il, pour la reine de France, Jeanne de Bourgogne, épouse de
Philippe VI, qu’il avoit traduit les fables latines, que les dames et
les jeunes gens n’auroient pu lire sans cela. Il appelle
particulièrement son seigneur Jean, duc de Normandie,
depuis roi de France, ce qui peut faire croire qu’il étoit normand ; il
parle aussi de Bonne de Luxembourg, mariée en 1332 à ce prince.
L’épilogue est donc postérieur à cette année, et comme il ne fait aucune
mention des enfants de cette princesse, il faut qu’il ait été achevé
après ce mariage, c’est-à-dire vers 1333432. »
Enfin, suivant M. Robert, c’est
celui-là même qui fut présenté par l’auteur à la reine de France ; ce
n’est pas un simple manuscrit ; c’est un autographe.
Il est vrai qu’en tête du manuscrit, à côté des divers numéros qu’il a portés et qui sont en chiffres arabes, il y en a un en chiffres romains, qui paraît être d’une main ancienne et qui, s’il était une date, serait celle de l’année 1333. Mais ce détail ne justifie pas la dernière hypothèse de M. Robert ; car ce nombre n’est pas une date ; c’est une ancienne cote. En regardant de plus près le manuscrit, il aurait vu que, si le copiste était un calligraphe distingué, il était en même temps d’une ignorance qui ne permet pas de supposer un instant qu’il ait été l’auteur de la traduction française. En effet, le texte latin est criblé de barbarismes qui montrent qu’il ne le comprenait pas ; ainsi il a écrit Solo pour Sole, Thomas pour comas, soxosis pour saxosis, etc. De plus, dans le texte français il y a des omissions que vraisemblablement l’auteur n’aurait pas commises. Enfin, si c’est à cause de la beauté du manuscrit que M. Robert a été conduit à penser que c’était l’exemplaire offert à la reine de France, il s’est basé sur un argument bien faible ; car je montrerai {p. 527}plus loin qu’il existe à Londres et à Bruxelles deux autres manuscrits identiques, qui, quoique d’un format un peu plus petit, sont également remarquables par l’écriture et les dessins, et dont l’un surtout, celui de Bruxelles, présente un texte latin beaucoup moins fautif.
Le manuscrit 1594 n’en est pas moins précieux.
Malheureusement ce curieux spécimen de l’art au xive siècle est en assez mauvais état. Sur le verso du second
des deux feuillets blancs qui précède les feuillets numérotés, la cause en
est indiquée dans cette note que j’ai déjà citée : « A mon entrée
en la librairie du roy, j’ai trouvé le présent volume fort gasté comme
il est, à raison qu’il estoit à l’endroit d’une fenestre mal
joincte. »
Ces mots paraissent à M. Robert avoir été écrits
pendant la minorité de Louis XIV433.
Craignant que le mal dont il a été atteint ne fit des
progrès de nature à en amener la destruction complète, M. Robert voulut en
conserver les miniatures et les reproduire dans sa publication des fables
inédites des xiie, xiiie et xive siècles. Voici
comment il s’exprime sur les motifs qui l’ont déterminé : « L’état
de dépérissement dans lequel il est déjà depuis près de deux siècles
demandoit qu’il fût arraché à une entière destruction dont le temps le
menace chaque jour ; nous avons cru rendre un véritable service en
reproduisant, avec toute l’exactitude possible, les quatre-vingt-cinq miniatures qu’il renferme. On pourroit presque
dire que ces gravures sont autant de fac-simile ; mais
le mérite même de ces dessins, au moment où ils furent faits, étoit une
nouvelle recommandation que nous n’avons pas cru devoir négliger. Ce ne
sera pas, nous l’espérons, une chose inutile à l’histoire des
beaux-arts ; elle pourra nous mettre en garde contre la prévention qui
nous fait quelquefois assigner une date à ces esquisses, d’après
l’impression que leur aspect produit sur nous. Ces figures cependant, si
on les juge seules, paroîtront au-dessous de l’éloge que nous en faisons
et n’intéresseront que par le ridicule de l’exécution ; mais si on les
compare aux miniatures des manuscrits du même temps, on ne pourra se
refuser à reconnoître leur supériorité ; et c’est pour que l’on puisse
faire facilement cette comparaison, que nous avons ajouté quelques
gravures, en petit nombre, dont les sujets ont été fournis par des
livres exécutés à la même époque434. »
{p. 528}On ne peut que louer M. Robert de la peine qu’il a prise. Par malheur, son entreprise n’a pas été couronnée d’un succès aussi complet qu’il semble le croire. Les miniatures de son livre ne sont que la caricature de celles du manuscrit : elles ne donnent une idée exacte ni de la finesse du dessin ni de la dégradation du coloris généralement monochrome. Espérons donc, sans souhaiter de mal aux copies, que les originaux leur survivront.
B. Manuscrit 1595. §
L’étude, que je viens de faire, du manuscrit 1594 me conduit à jeter maintenant un coup d’œil sur les autres manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui, veufs du texte latin de Walther, en renferment seulement la traduction française.
De ces manuscrits, le premier dans l’ordre numérique est celui qui, après avoir reçu la cote Regius 7616.3 et plus anciennement la cote De Cangé 106, porte aujourd’hui le nº 1595 ; c’est par lui que je vais commencer mon examen.
C’est un volume in-4º, dont l’écriture est du xve siècle. Il se compose de 38 feuillets anciens en parchemin, précédés d’un premier feuillet neuf qui porte un titre écrit par une main moderne, et suivis d’un dernier feuillet qui est resté entièrement blanc.
Le manuscrit est presque totalement rempli par la traduction en vers français des fables de Walther. Elles sont précédées d’une jolie miniature, qui orne, au recto, le haut du premier feuillet ancien, et représente un moine instruisant trois personnes agenouillées devant lui. Cette miniature est la seule. Le prologue et les fables qui la suivent ne présentent d’autre ornement que celui de leur lettre initiale, au centre de laquelle est un dessin à la plume approprié au texte. Aucun titre général ne domine les fables ; aucune ne porte un titre particulier.
Quoiqu’elles soient les mêmes que celles du manuscrit 1594, on ne peut les considérer comme en étant la copie littérale ; car entre les unes et les autres il existe de grandes différences.
D’abord les fables du manuscrit 1595 offrent un très grand nombre de variantes. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple tiré du premier vers de la fable i, dans le manuscrit 1594 il est ainsi conçu :
Un cot en un fumier estoit,
tandis que dans l’autre on lit :
Un coq sur un fumier estoit.
{p. 529}Le classement et le nombre des fables ne sont pas non plus identiques. L’ordre dans lequel le manuscrit 1595 les possède est différent de celui dans lequel les donne le manuscrit 1594, et le premier de ces deux manuscrits n’en renferme que 56 et n’a pas les 12 suivantes :
1. Le Serpent et le Pauvre.
2. La Tête sans cervelle.
3. Le Lion et le Berger.
4. Le Cheval et l’Âne.
5. Le Chapon et l’Épervier.
6. Le Loup et le Berger.
7. Le Loup et le Mouton.
8. Les Gens de la cité d’Athènes.
9. L’Épervier et la Colombe.
10. Le Chat et les Souris.
11. Le Coq et la Souris.
12. La Femme et sa Vache.
En revanche, le manuscrit 1594 est dépourvu des quatre tables suivantes qui existent dans le manuscrit 1595 :
1. L’Inconstance de la Femme.
2. La Courtisane et le Jeune Homme.
3. Le Père et le mauvais Fils.
4. Le Citoyen et le Soldat.
Enfin une différence notable est relative au nombre des vers. Le prologue du manuscrit 1595 n’a pas les huit vers, qui, dans celui du manuscrit 1594, précédent les 4 derniers. Le nombre des vers de chaque épimythion n’est pas non plus le même dans les deux manuscrits. On a vu dans le manuscrit 1594 que le texte latin de Walther avait été allongé, et que l’allongement était, comme le reste, traduit dans la fable française. Il n’en est pas de même dans le second manuscrit, où chaque affabulation se borne à la traduction du seul texte de Walther. Cette différence me porte à croire que l’auteur des additions latines et françaises n’est pas le même que le traducteur du vrai texte de Walther.
Maintenant quel est l’auteur des additions ? Il n’est pas plus connu que celui de la première traduction. Ce qui est dans tous les cas certain, c’est que ce n’est pas le copiste du manuscrit 1594 qui a augmenté {p. 530}les morales des fables latines, et qui a ensuite traduit les additions en français. Je m’empresse d’ajouter qu’il ne faut pas davantage lui attribuer le développement considérable donné à l’épilogue.
Les fables du manuscrit 1595, comme celles du manuscrit 1594, sont suivies d’un épilogue en vers français, qui commence au fol. 35 b et se termine au fol. 36 a.
Cet épilogue se compose seulement de 18 vers, comprenant les 16 premiers du même épilogue dans le manuscrit 1594 et les quarante-troisième et quarante-quatrième ainsi conçus :
Ly livres fait chier a tenirSy convient Esopet fenir.
L’épilogue se termine par le mot Amen
, au-dessous duquel se lit cette souscription
affectant la forme d’un hexamètre : Explicit Esopus,
putat435 qui dicit
Ysopus.
Le manuscrit 1595 ne renferme pas la traduction des fables d’Avianus, ni les prologue et épilogue dont elles sont précédées et suivies dans le manuscrit 1594. La raison me paraît en être toujours la même, à savoir que toutes les additions faites à la traduction du texte de Walther sont l’œuvre d’un second traducteur inconnu comme le premier.
Les feuillets 36 b à 37 a sont occupés par une pastourelle, qui commence par ces deux vers :
(A)u temp pascour que toutes riens s’esgayeEt que la terre de mainte couleur gaye.....
Elle est composée de quatrains, dont chaque vers rime avec les trois autres. Malheureusement elle est inachevée.
C. Manuscrit 19123. §
Le manuscrit 19123 provient de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, dans laquelle il portait le nº 1622. Il avait auparavant fait partie de la bibliothèque des ducs de Coislin, léguée à cette abbaye en 1732. C’est un volume in-folio composé de 152 feuillets en parchemin, dont l’écriture, disposée en deux colonnes, est du xve siècle.
Il renferme la même traduction en vers français que les manuscrits 1594 {p. 531}et 1595. Cette traduction se compose de 39 fables précédées d’un prologue et suivies d’un épilogue.
Le prologue, comme celui du manuscrit 1595, ne se compose que de 26 vers commençant par celui-ci :
Ce liuret que cy vous recite.
L’épilogue, comme celui du manuscrit 1595, ne se compose que de dix-huit vers dont les deux derniers sont ainsi conçus :
Le liure fait a chier tenirEt conuient Ysopet fenir.
Le prologue commence à la première colonne du feuillet 109, et l’épilogue, à la deuxième du feuillet 126.
Les fables, qui occupent tout l’intervalle, ne portent aucun titre. Le commencement de chacune d’elles se révèle aux yeux par la dimension et les ornements de la première lettre, qui est enjolivée, rouge, de traits bleus à la plume, et bleue, de traits rouges.
Comme dans le manuscrit 1594, elles sont suivies de la traduction de dix-huit fables d’Avianus. Toutefois le copiste, confondant en une seule la douzième et la treizième, a enlevé de cette dernière ces deux premiers vers :
Jupiter en terre enuoyaSon fils et si lui octroya…
Les fables d’Avianus sont précédées d’un prologue, qui ne se compose que des quatorze premiers vers de celui du manuscrit 1594, et ne comprend pas les seize derniers, peut-être dus à l’amplification sur laquelle je me suis précédemment expliqué.
Quant à l’épilogue, il ne comprend que les six premiers vers de celui du manuscrit 1594 ; les vers écrits en l’honneur de Jeanne de Bourgogne n’y ont pas été ajoutés.
La collection des fables d’Avianus se termine au
feuillet 131 b par ces mots : Explicit les fables Dysopet e Dauionnet.
D. Manuscrit 24310. §
Le fonds français des manuscrits de la Bibliothèque nationale possède un dernier exemplaire de la traduction en vers français des fables de Walther.
C’est un in-folio dont l’écriture sur parchemin est du xve siècle. {p. 532}Il a appartenu au collège de Navarre, où il portait le nº 85 ; il a aujourd’hui la cote 24310.
Il forme un volume de 92 feuillets, savoir : quatre-vingt-dix anciens et deux feuillets de garde entièrement blancs, l’un en tête, l’autre à la fin.
Ce volume, dont l’écriture est d’ailleurs très soignée, était évidemment destiné à être un livre de luxe. Le copiste, au-dessus de chaque fable, avait ménagé un grand espace blanc, qui devait être occupé par une miniature, mais qui n’a pas été rempli.
La lettre initiale de chaque fable et celle de chaque épimythion en sont restées le seul ornement. La première est plus grande que la seconde. Elles sont ou écrites à l’encre bleue et ornées de petits traits à l’encre rouge, ou écrites à l’encre rouge et ornées des mêmes traits à l’encre bleue. Toutes les fables portent des titres à l’encre rouge.
Elles sont au nombre de 126 et se réfèrent à trois séries de fables latines bien différentes.
Les 59 premières sont la traduction de celles de Walther : les 18 suivantes se rapportent à celles d’Avianus, et les 49 dernières appartiennent à Marie de France.
Les 59 fables qui sont la traduction de l’œuvre de Walther, sont précédées d’un prologue, qui, comme celui des mss. 1595 et 19123, ne se compose que de 26 vers. Elles sont en outre suivies d’un épilogue, qui n’a également que 18 vers. Comme enfin le nombre des fables est le même que dans le ms. 19123, et qu’elles sont classées dans le même ordre, on est, au premier abord, porté à en induire que le moins ancien des deux, c’est-à-dire celui qui porte le nº 24310, doit être la copie exacte de l’autre. Pourtant il n’en est pas ainsi. Dans le moins ancien le texte a été rajeuni, et beaucoup de mots déjà vieillis ont été remplacés par des expressions plus nouvelles. J’extrais des deux manuscrits, à titre d’exemple, les cinq premiers vers de la fable Du Loup et de l’Aignel.
{p. 533}manuscrit 19123.
Un loup et un aignel amaineSoif pour boire à une fontaine,Le loup amoult, l’aignel aval.Cilz qui ne pense fors a mal,Rudement a dist a l’aignel…
manuscrit 24310.
Un leu et un aygnel amaineSoif pour boire à la fontaine,Le leu en hault, l’aignel aval.Le leu qui ne pense fors a mal,Rudement a dit a l’aigneau…
Les 18 fables, à qui celles d’Avianus servent de base, sont précédées d’un prologue qui ne se compose que de dix vers, et d’un épilogue, qui, comme dans le manuscrit 19123, n’en a que six. Ces fables, comme les 59 qui les précèdent, présentent des variantes qui ont le même caractère.
Les 49 fables, qui forment la troisième série, ne sont, comme on le sait déjà, qu’une partie de l’œuvre de Marie de France. Le copiste, pour donner en apparence plus d’unité à la collection totale, en a supprimé le prologue, qui en aurait révélé l’origine différente, et l’épilogue qui en aurait fait connaître l’auteur, et, afin d’éviter les doubles emplois, il a eu soin de ne copier que les fables dont le sujet n’avait pas été traité dans celles des deux premières séries.
Le manuscrit 24310 est uniquement rempli par les trois
séries de fables que je viens d’analyser. Elles se terminent au
fol. 90 b par le mot Explicit
.
Enfin, au bas de la même page, se lit cette observation qui
ne tire son importance que de la main qui l’a écrite et signée :
« Le présent manuscrit, composé de 92 feuillets, y compris les
blancs. Paris, le 1er Mai 1822. B. Gail. »
E. Tableau comparatif du contenu des quatre manuscrits français. §
Pour compléter mon analyse des quatre manuscrits français, je vais maintenant, en négligeant celles d’Avianus et de Marie de France, dresser le tableau comparatif des fables qu’ils contiennent.
| Ms. 1594. | Ms. 1595. | Mb. 19123. | Ms. 24310. | |
| Prologue. | Prologue. | Prologue. | Prologue. | Prologue. |
| 1. Le Coq et la Perle. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | 5. | 9. | 10. | 10. |
| 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | 6. | 5. | 5. | 5. |
| {p. 534}7. Le Soleil qui se marie. | 7. | 6. | 6. | 6. |
| 8. Le Loup et la Grue. | 8. | 7. | 7. | 7. |
| 9. La Chienne qui met bas. | 9. | 8. | 8. | 8. |
| 10. Le Serpent mourant de froid. | 10. | 9. | 9. | |
| 11. L’Âne et le Sanglier. | 11. | 10. | 11. | 11. |
| 12. Le Rat de Ville et le Rat des champs. | 12. | 11. | 12. | 12. |
| 13. L’Aigle et le Renard. | 13. | 12. | 13. | 13. |
| 14. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | 14. | 13. | 14. | 14. |
| 15. Le Corbeau et le Renard. | 15. | 14. | 15. | 15. |
| 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | 16. | 15. | 16. | 16. |
| 17. L’Âne qui caresse son Maître. | 17. | 16. | 17. | 17. |
| 18. Le Lion et le Rat. | 18. | 17. | 18. | 18. |
| 19. L’Épervier malade. | 24. | 23. | 24. | 24. |
| 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | 25. | 24. | 25. | 25. |
| 21. Les Grenouilles qui demandent un Roi. | 19. | 18. | 19. | 19. |
| 22. Les Colombes et le Milan. | 21. | 20. | 21. | 21. |
| 23. Le Chien et le Voleur. | 22. | 21. | 22. | 22. |
| 24. Le Loup accoucheur. | 20. | 19. | 20. | 20. |
| 25. La Montagne en mal d’enfant. | 23. | 22. | 23. | 23. |
| 26. Le Chien et l’Agneau. | 26. | 25. | 26. | 26. |
| 27. Le Chien vieilli et son Maître. | 27. | 26. | 27. | 27. |
| 28. Les Lièvres et les Grenouilles. | 28. | 27. | 28. | 28. |
| 29. Le Loup et le Chevreau. | 29. | 28. | 29. | 29. |
| 30. Le Serpent et le Pauvre. | 30. | 29. | 30. | 30. |
| 31. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | 31. | 30. | 31. | 31. |
| 32. Le Chauve et la Mouche. | 32. | 31. | 32. | 32. |
| 33. Le Renard et la Cigogne. | 33. | 32. | 33. | 33. |
| 34. La Tête sans cervelle. | 60. | |||
| 35. Le Geai vaniteux. | 34. | 33. | 34. | 34. |
| 36. La Mouche et la Mule. | 35. | 34. | 35. | 35. |
| 37. La Mouche et la Fourmi. | 36. | 35. | 36. | 36. |
| 38. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | 37. | 36. | 37. | 37. |
| 39. L’Homme et la Belette. | 38. | 37. | 38. | 38. |
| 40. La Grenouille qui s’enfle. | 39. | 38. | 39. | 39. |
| {p. 535}41. Le Lion et le Berger. | 40. | 40. | 40. | |
| 42. Le Lion médecin. | 41. | 39. | 41. | 41. |
| 43. Le Cheval et l’Âne. | 42. | 42. | 42. | |
| 44. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | 45. | 40. | 43. | 43. |
| 45. Le Rossignol et l’Épervier. | 46. | 41. | 44. | 44. |
| 46. Le Renard et le Loup. | 43. | 42. | 45. | 45. |
| 47. Le Cerf à la Fontaine. | 44. | 43. | 46. | 46. |
| 48. L’Inconstance de la Femme. | 44. | 47. | 47. | |
| 49. La Courtisane et le Jeune Homme. | 45. | 48. | 48. | |
| 50. Le Père et le Mauvais Fils. | 46. | 49. | 49. | |
| 51. La Vipère et la Lime. | 48. | 47. | 50. | 50. |
| 52. Les Loups et les Brebis. | 49. | 48. | 51. | 51. |
| 53. La Hache et les Arbres. | 50. | 49. | 52. | 52. |
| 54. Le Loup et le Chien. | 51. | 50. | 53. | 53. |
| 55. L’Estomac et les Membres. | 52. | 51. | 54. | 54. |
| 56. Le Singe et le Renard. | 53. | 52. | 55. | 55. |
| 57. Le Marchand et l’Âne. | 54. | 53. | 56. | 56. |
| 58. Le Cerf et les Bœufs. | 55. | 54. | 57. | 57. |
| 59. Le Juif et l’Échanson du Roi. | 58. | 55. | 58. | 58. |
| 60. Le Citoyen et le Soldat. | 56. | 59. | 59. | |
| 61. Le Chapon et l’Épervier. | 56. | |||
| 62. Le Loup et le Berger. | 57. | |||
| 63. Le Loup et le Mouton. | 47. | |||
| 64. Les Gens de la Cité d’Athènes. | 59. | |||
| 65. L’Épervier et la Colombe. | 61. | |||
| 66. Le Chat et les Souris. | 62. | |||
| 67. Le Coq et la Souris. | 63. | |||
| 68. La Femme et sa Vache. | 64. | |||
| Épilogue. | Épilogue. | Épilogue. | Épilogue. | Épilogue. |
F. Manuscrit 983. §
Les fables en vers, dont j’ai analysé les manuscrits, n’ont pas été la seule paraphrase du texte de Walther, et l’on pourrait aisément retrouver tous les anneaux de la chaîne par laquelle La Fontaine s’y rattache.
Sans vouloir entreprendre cette tâche, je terminerai mon étude sur les manuscrits parisiens du fabuliste élégiaque, en signalant une des paraphrases intermédiaires qui m’a été révélée par un manuscrit de la Bibliothèque nationale.
Ce manuscrit, qui appartient au fonds français, a reçu successivement les cotes MMCXCII, 816.1, et 7304. Il porte aujourd’hui le {p. 536}nº 983. C’est un petit in-folio du xvie siècle, dont les feuillets en papier doré sur tranche sont dans une belle reliure du temps.
Il comprend 103 feuillets écrits, 3 blancs qui les précèdent et 3 autres blancs qui les suivent.
Il renferme 43 fables écrites en prose française, dont la moralité est suivie d’une autre affabulation contenue dans un distique en vers de huit syllabes. Ce distique n’a d’ailleurs rien de commun avec la vieille paraphrase du premier traducteur français de Walther, ni avec celle de Marie de France.
Ces fables, ainsi composées, commencent au fol. 75 a par ce titre général : Cy cōmence
lexposicion des fables ysopet.
En voici les titres particuliers :
1. Du chien qui passoit leaue Et portoit une piece de chair.
2. De la chieuure, la brebis, la genice et du lyon qui sentre encompagnerent.
3. De la fēme qui se maria a ung larron.
4. De la grue qui garit le loup.
5. De deux chiennes.
6. Du villain qui heberga le serpent.
7. De lasne qui salue le sanglier.
8. De la souriz de la bōne ville Et de celle des champs.
9. Du Regnart et de laigle.
10. De laigle et de la limace.
11. Du Regnart et du corbeau.
12. Du lyon qui cheut en viellesse Et nauoit fait nuls amys.
13. De lasne et du chien qui veullent complaire a leur maistre.
14. Du lyon et de la souriz.
15. Des Raynes qui voulloient auoir ung Roy.
16. Du chien et du larron.
17. De la terre qui enfanta une souris.
18. Du filz de lescouffle qui fut malade.
19. De larondelle et des autres oyseaulx.
20. Du loup et de laignel.
21. Du chien qui cheoit en viellesse.
22. Des lieuures qui sen fuyrent.
23. De la chieuure et du loup.
24. Du villain qui nourrit le serpent.
25. Du cerf et de la brebis et du loup.
26. De la mousche et de lōme chanu.
27. Du Regnart et de la cigoigne.
28. Du corbeau qui se para des plumes du paon.
29. Dun muletier et dune mule.
{p. 537}30. De la mousche et du fromy.
31. De Regnart, du lieuure et du singe.
32. Du preudōme et de la mustelle.
33. De la rayne et du beuf.
34. Du lyon et du pastour.
35. Du lyon et du cheual.
36. Du beau cheual et de lasne pelle.
37. Du Regnart et du loup.
38. Du cerf qui buuoit a la fontaine.
39. De la bataille des bestes Et des oyseaulx.
40. Du Rousignol et de lautour.
41. Du loup et du mouton.
42. Du serpent et de la lyme.
43. De la bataille des loups contre les brebis.
Ces 43 fables se terminent au feuillet 101 b par le mot Explicit
.
3º Manuscrit de Douai. §
Dans les catalogues d’Haenel publiés à Leipzig en 1830, le
manuscrit de Douai est désigné par ces mots : Phædri
fabulæ, varia carmina, membr. 8436.
Orelli en avait conclu que la bibliothèque publique de cette ville possédait
un manuscrit de Phèdre. C’était une erreur imputable aux bibliothécaires,
qui, dans les inventaires de la bibliothèque, avaient signalé le manuscrit.
Dans ceux qui furent dressés en 1805 et en 1822, il avait reçu, sous le
nº 714, la désignation que Haenel a aveuglément reproduite. Peut-être en
avait-il aperçu l’inexactitude, et n’avait-il, dans sa publication, maintenu
l’erreur commise que pour rester fidèle à son modeste programme et publier,
tels qu’ils étaient, les catalogues des bibliothèques publiques. Mais,
quoique cette hypothèse ne soit pas dénuée de vraisemblance, je suis
davantage porté à croire qu’en exécutant machinalement son travail de
copiste, Haenel avait, à son insu, transcrit la fausse mention du
catalogue.
Lorsqu’il était conservateur de la bibliothèque de Douai, M. Duthillœul sépara les fables des Varia carmina, laissa à ces derniers leur ancienne reliure qu’il fit restaurer, et en tête du volume, auquel il donna la cote 713, en indiqua le contenu dans les termes suivants :
1º Boecius de disciplina scholarum ;
2º Sententiæ versificatæ ;
3º De pœnitentia poëma cum commentario ;
4º De officiis presbyterum poëma ;
{p. 538}5º Reflexiones de divitiis ;
6º Poëma thecnicum (sic) ;
7º Dictionarium de eadem materia ;
8º Poëma de vita Christi.
Quant aux fables, M. Duthillœul les fit relier à part et leur
conserva le nº 714. Il devait tout naturellement supprimer de la désignation
placée sous ce numéro les mots varia carmina, qui ne
s’appliquaient qu’aux ouvrages formant le manuscrit 713. Il ne s’en tint pas
là. Ayant appris par Dressler que les fables devaient être l’œuvre d’Ugobard
de Sulmona, il substitua à l’inscription copiée par Haenel celle-ci qui est
aussi inexacte : Ugobardi Sulmonensis fabulæ
Phædrianæ.
Il est facile de s’expliquer comment M. Duthillœul a si facilement admis l’erreur de Dressler : Dressler n’ayant eu recours qu’à deux manuscrits, il avait cru qu’il n’en existait pas d’autre, et que, s’il y en avait un troisième, c’était tout, et, ignorant l’existence des autres, il n’avait pu songer à y recourir pour s’éclairer.
Voici, en effet, comment, à cet égard, il s’exprimait dans
son édition du catalogue des manuscrits de Douai : « Jusqu’à présent
on ne connaît donc que deux manuscrits des fables d’Ugobard, et celui de
la ville de Douai serait à la fois le plus ancien et le plus complet.
Cependant il doit en exister un troisième ; celui d’après lequel ont été
imprimées les deux fables que nous avons de plus que dans le manuscrit de
Pie VI, puisque Eschenburg dit les avoir trouvées dans un manuscrit de
Wolfenbüttel. »
Réduit aux fables de Walther, le manuscrit 714 se compose de vingt feuillets en parchemin in-8º ou plutôt in-4º de petit format. Dans son catalogue, M. Duthillœul en fait à tort remonter l’écriture au xiie siècle ; elle n’est que du xiiie.
Les fables commencent au recto du premier feuillet. Elles ne
portent pas de titre général ; mais, en tête, une main ancienne a écrit
cette sorte d’invocation : Alanii assit principio
maria.
Le prologue n’est surmonté non plus d’aucun titre.
Il en est autrement des fables, dont chacune a le sien écrit à l’encre
rouge.
Elles se terminent au bas du recto du vingtième feuillet. À la suite de la dernière on lit cette double souscription :
Explicit iste liber, scriptor sit crimine liber.
Explicit liber esopus. deo gracias. Amen.
{p. 539}S’il faut en croire M. Duthillœul, le manuscrit, avant d’entrer à la bibliothèque de Douai, avait dû appartenir à l’abbaye d’Anchin, située sur le territoire de la commune de Pecquencourt. C’était une abbaye de Bénédictins, dont les manuscrits ont été transférés à la bibliothèque communale de Douai.
Lorsque Dressler travaillait à l’édition qu’il a publiée en 1838, il s’est servi d’une copie de ce manuscrit, qui avait été très soigneusement prise et qui lui avait été envoyée par M. Duthillœul. Il déclare y avoir trouvé beaucoup de leçons qui lui ont permis de faire d’heureuses corrections au texte des éditions précédemment publiées.
Voici sur ce point les renseignements que, dans son
catalogue, M. Duthillœul fournit lui-même : « En 1837, M. Dressler,
professeur érudit de l’Université de Bautzen, voulant publier une édition
aussi complète que possible des fables de Phèdre, et ayant lu dans les Catalogi librorum manuscriptorum de Haenel qu’un recueil
de fables de Phèdre manuscrit existait à la bibliothèque communale de
Douai, m’écrivit et me demanda des renseignements sur le Phèdre, dont
parlait le docteur Haenel. Je dus lui dire que ce manuscrit ne renfermait
point les fables de Phèdre, mais bien l’Anonymi veteres
fabulæ, et je lui fis passer quelques fac simile,
qui le mirent à même de reconnaître sa parfaite conformité, à diverses
versions près, avec le manuscrit de Haenel. Bientôt après je reçus de
M. Dressler la prière de lui envoyer une collation du texte que nous
possédions, avec celui de l’édition des Deux-Ponts. M. Gratet-Duplessis
voulut bien se charger de faire cette collation, et il la fit avec la plus
scrupuleuse exactitude. Ce travail, ayant été adressé au professeur de
Bautzen, fut mis par lui à profit dans une nouvelle édition des fables de
Phèdre, la plus complète que l’on ait publiée jusqu’ici et dans laquelle
il fit entrer les fables d’Ugobard de Sulmona, avec des variantes
empruntées du manuscrit de Haenel et de celui de la bibliothèque de
Douai. »
J’ajoute que dans ce dernier il trouva les deux fables De Capone et Ancipitre (sic) et De Lupo et Pastore, qui ne figurent pas dans les éditions des Deux-Ponts, et qu’il en profita pour les publier dans la sienne.
4º Manuscrits de Laon. §
La bibliothèque publique de Laon possède deux manuscrits des fables de Walther sous les cotes 461 et 462.
A. Manuscrit 461. §
Le manuscrit 461 a appartenu à la bibliothèque {p. 540}du chapitre de l’église cathédrale de Notre-Dame, où il portait le nº 229. C’est un volume in-fol., dont l’écriture sur parchemin est du xive siècle, et qui contient, soit en totalité, soit par extraits, 31 ouvrages différents. Les fables de Walther en sont le dix-septième. Je renvoie ceux qui désireront en avoir la nomenclature au Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, publié dans le format in-4º sous les auspices du ministère de l’instruction publique. Aux pages 242 et suivantes du tome I ils pourront satisfaire leur curiosité.
Quoique je désire ne pas m’arrêter aux hors-d’œuvre, je crois devoir, à cause de son originalité misanthropique, signaler en passant le distique suivant, qu’en ouvrant le manuscrit j’ai trouvé au recto du deuxième feuillet :
Falli qui possit nemo est, quin femina fallat.Falli si posset, falleret ipsa deum.
Le troisième feuillet est occupé par la table des
matières ; les fables élégiaques, sous ce titre : Ysopus integer
, y sont indiquées comme commençant au
feuillet 90. Mais c’est une erreur due à un système spécial de pagination,
qui consiste à donner un seul et même numéro au verso d’un feuillet et au
recto du suivant. Il en résulte qu’elles commencent réellement au recto du
feuillet 91, où elles sont annoncées par ces mots : Incipit Esopus.
Elles comprennent les soixante fables ordinaires, qui même, à cause du dédoublement de la fable des Grenouilles qui demandent un roi, en forment en apparence soixante et une. C’est par erreur que, dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, l’auteur du catalogue de celle de Laon déclare que le manuscrit 461 ne renferme que 59 fables437. Cette erreur tient à ce que la dernière fable, ne portant pas de titre, a échappé à son examen trop rapide.
Les 13 dernières fables ne sont pas rangées dans l’ordre
ordinaire. Elles se terminent, d’après la pagination, au recto du
feuillet 97 et, en réalité, au verso, par cette souscription : Explicit de Ysopo.
B. Manuscrit 462. §
Le manuscrit 462, qui provient de l’abbaye de Cuissy, est un volume in-8º, dont l’écriture sur parchemin est du xive siècle.
{p. 541}On n’y trouve que des fragments des fables de Walther, réunis sur deux feuillets. Ces fragments comprennent :
1º Ce distique par lequel se termine le préambule :
Verborum leuitas morum fert pondus honestum,Ut nucleum celat arida testa bonum.
2º L’épimythion suivant de la fable i :
Tu gallo stolidum, tu, iaspide dona sophiæPulchra notes. Stolido nil sapit ista seges.
3º L’épimythion de la fable ii ainsi conçu :
Et nocet innocuo nocuus causamque nocendiInuenit : hii regnant qualibet urbe lupi.
4º Dix-neuf vers empruntés presque tous aux épimythions des fables suivantes, commençant par ce troisième de la fable iii :
Omne genus pestis superat mens dissona verbis,
et finissant par ce dernier de la fable xi :
Non stolidus doctum debet adire iocis.
5º Enfin ces deux distiques qui appartiennent à la fable xii :
In mensa tenui satis est inuisa voluntas,Nobilitat viles frons generosa dapes…Pauperies (si leta venit) tulissima res est :Tristior immensas pauperat usus opes.
On le voit, le copiste ne s’est attaché qu’à extraire des fables de Walther les maximes qu’il y a rencontrées. Il en résulte que le manuscrit n’offre qu’un très médiocre intérêt.
Quant au surplus de son contenu, comme il est étranger à mon étude, je m’abstiens d’en parler, et, comme précédemment, je ne puis qu’engager ceux qui seront désireux de le mieux connaître, à lire l’analyse qui en est donnée dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements438.
5º Manuscrit de Besançon. §
La bibliothèque de Besançon possède un manuscrit qui renferme les fables de Walther. Il n’était pas {p. 542}encore catalogué, lorsque j’ai eu l’occasion de le voir. Mais je peux le décrire avec assez de précision pour donner à qui le désirera la possibilité d’y recourir.
Il forme un volume in-4º, dont les plats sont en bois et dont l’écriture remontant au xiiie siècle est sur parchemin.
Sur la face interne du premier plat, il porte cette mention
inscrite au siècle dernier : Ex bibliotheca
Joan. Baptistæ Boisot abbatis sancti Vincentii
Vesontini.
Le volume se compose de 168 feuillets, dont le dernier est collé sur la face interne du deuxième plat, et, comme la plupart des manuscrits, il comprend plusieurs ouvrages. Les fables de Walther commencent au feuillet 105 b et se terminent au feuillet 123 b.
Elles ne sont qu’au nombre de soixante.
Elles sont accompagnées de deux séries de gloses d’une écriture très fine, l’une marginale, l’autre interlinéaire.
Elles ne sont précédées d’aucun titre général, mais sont en revanche terminées par cette souscription hexamétrique :
Finito libro Christus sit jure magistro (sic).
Les fables de Walther sont dans le manuscrit suivies de celles d’Avianus, qui occupent les feuillets 124 recto à 136 verso.
6º Manuscrit de Lyon. §
Je continue la revue des manuscrits de la France par celui qui est, à mon sens, le plus précieux de tous. Il est signalé sous la cote 673 dans le Catalogue des Manuscrits de la bibliothèque de Lyon, publié par M. Delandine en 1812439, et dans l’inventaire de cette bibliothèque copié et publié par Haenel440.
Aujourd’hui il est conservé à Lyon dans la bibliothèque du Palais des Arts (deuxième division des bibliothèques municipales de cette ville), et il dépend du fonds de l’Académie des sciences, lettres et arts, dans lequel il porte le nº 57.
Il a appartenu à M. Adamoli, illustre bibliophile du
xviiie siècle, dont je ne puis mieux
parler qu’en extrayant ce qui suit de sa biographie écrite par
M. Delandine : « Pierre Adamoli, plein d’amour {p. 543}pour les lettres et les fruits heureux qu’elles font
naître, passa sa vie à former une bibliothèque distinguée par le choix des
éditions, précieuse par ses manuscrits, ses estampes et les ouvrages rares
qu’elle renferme. Il la commença en 1734, et il ne cessa pendant trente
ans de l’augmenter. L’état de ses acquisitions, en janvier 1764, se
montait, suivant une note de sa main, à la somme de 50,787 livres. À sa
mort, il en donna la propriété à la ville, et la jouissance à
l’Académie441. »
Voici maintenant comment le Catalogue de la bibliothèque du Palais des Arts s’exprime sur le manuscrit lui-même :
« Les caractères mixtes de ce volume, l’un des plus anciens de la bibliothèque, datent du xiiie siècle. Les feuilles de vélin sont ornées de lettres capitales coloriées et d’un grand nombre de miniatures oblongues très curieuses par leurs défauts de proportion. Le texte latin de cinquante-sept des fables attribuées au célèbre conteur d’apologues, est accompagné d’une traduction en langue romane versifiée, traduction libre, d’une naïveté fort prononcée, dont on jugera par ce fragment de la fable Dou chien et de lasne :
Li chien qu’est amoureuse besteA son seigneur façoit grant fête,La coe muet, dou pié li tapeEt d’un petit esbai lo jape…« Le volume, assez précieux par cette version peu connue, commence par un prologue et se termine par une fable intitulée (en roman) Dou chevalier et dou borjois qui est de la maignie à roi. Cette pièce n’a pas été achevée. M. Adamoli estimait à 7 livres ce rare manuscrit. »
Cette courte notice serait insuffisante pour le faire bien connaître. À raison de son importance je crois devoir en donner une analyse plus étendue.
Par son format il se rapproche du petit in-4º. Il est formé de 93 feuillets en parchemin. Il devrait en posséder 97 ; malheureusement au centre d’un des quaternes manquent deux feuillets, qui, s’ils existaient, seraient les xxviiie et xxixe du volume, et, au centre d’un autre cahier, deux autres feuillets, qui, si le manuscrit était complet, seraient les lxxe et lxxie. Cette lacune est d’autant {p. 544}plus regrettable que le manuscrit est unique et qu’il est, par suite, impossible de reconstituer le texte disparu.
L’écriture, lisible et nette, paraît dater du commencement du xiiie siècle ; les pages les plus remplies n’ont que 27 lignes et ne sont écrites que sur une seule colonne.
Le manuscrit a renfermé les fables de Walther, suivies chacune de sa traduction en vers français de huit syllabes. Mais avec les feuillets qui manquent ont disparu : 1º les trois derniers vers latins de la fable de l’Épervier malade, 2º la traduction de cette fable, 3º le texte latin de la fable de l’Hirondelle et des Oiseaux, 4º le commencement de la traduction de cette fable, dont il ne reste que les 28 derniers vers, 5º la traduction de la fable De la dame et dou cheualier depuis le neuvième vers jusqu’à la fin, 6º le texte latin de la fable De Thaïde et iuuene, 7º le commencement de la traduction de cette fable, dont il ne reste que les 24 derniers vers.
Il ne faut pas, avec celle qui a été publiée par
M. Robert442,
confondre cette traduction, qui a été écrite dans le dialecte franc-comtois,
et qui, d’un siècle plus ancienne, présente davantage des expressions
rappelant celles de la langue latine. « Les expressions, dit
M. Delandine443, sont remarquables par leur
dérivation du latin et leur naïveté. Le renard y est toujours nommé un vulpi, l’hirondelle hyrundille, le
serpent colubre, etc. »
Le texte est orné de cinquante-huit miniatures coloriées, qui représentent les sujets des fables, et dont la conception et l’exécution respirent la naïveté et l’inexpérience. La fable des Grenouilles qui demandent un roi ayant été divisée en deux parties, il devrait en exister soixante et une ; mais trois ont disparu avec les feuillets sur lesquels elles se trouvaient. Chaque miniature est placée entre la fable latine et la traduction auxquelles elle se rapporte.
Pour faire mieux connaître cette disposition et la traduction elle-même, voici la description des sept premiers feuillets :
Fol. 1 a. — En tête du feuillet 1 a on lit : Incipit Esopus.
Prologus.
À la suite de ces mots écrits à l’encre rouge
viennent les {p. 545}douze vers du prologue, dont une
mouillure a enlevé quelques lettres.
La traduction est précédée de ce titre à l’encre rouge :
Cy comãce Ysopet ẽ romãt que....... fait tñslater de
latin a romãt.
Un grattage a fait disparaître le nom du
traducteur. Suivent, sous ce titre : Li
prolougues
, vingt-huit vers français ainsi conçus :
Cilz liures quest ci en présenceContient de grand profit sentence :Raisons quest de solez paréeEst plus uoluntiers escoutée ;Car cilz fait commun soutilz lazQui melle sent auuec soulez.Tulles aussi lensoigne a faire,Por les cuers des genz plus atraire.Vn petit iardin ai hantey ;Flours et fruit porte a grant plantey.Li fruiz est bons, la flours nouele,Delitauble, plaisanz et bele.Li flours est example de fauble,Li fruiz doctrine profitauble.Bone est la flour por delitier,Lou fruit cuil se uuez profitier.Se luns te plait, tu lo puez prandre,Ou les dous, se plus uuez aprendre.Mon sent qui uolontiers somoille,Muet a ourer, mes cuers qui uoille ;Dex, la rousée de ta graceMe done si quele me faceLa langue soiche bien sonerEt de vil champ bien moissoner ;Ceste oure en parole legierePorte fais doneste menière ;Aussi con la cruise quest soiche,Lo bon noiellon danz soi quoiche.
Après ce prologue viennent les fables, dont les titres latins et romans sont écrits à l’encre rouge.
Fol. 16. — De gallo et
iaspide.
Les douze vers latins, dont cette première fable se
compose, se terminent au commencement du fol. 2 a.
Fol. 2 a. — Miniature et au-dessous
traduction surmontée de ce titre : Dou poul et de la
iaspe.
La traduction se compose ensuite de {p. 546}trente-quatre vers, qu’à titre de spécimen je crois
intéressant de transcrire ici :
A son fort bec li pous trauailleEn un femier por sa uitaille.Vne iaspe per auentureAi trouée, don nauoit cure.Habaiz fu, quant la trouée,Et dit con cil cui point nagrée :He ! fait-il, preciouse chose,Que ci es si uilmant enclouse,Certes ci ai mult grant domaige ;Tu ne uauz riens por mon usaige ;Mais se aucuns te puet trouer,Ta bontey sehust esprouer,Ta valours quest si escondue,Prisie fust et chier tenue ;Jai fusses richemant essiseEn un ioel per grant maistrise.Las ! ta bontey ne ta ualourNe me fait ne froit ne chalour :Estrange est a moi ta nature ;En toi ne truis point de pasture ;Muez ainz grains de fromant ou dorge,Quar miez me font ourir la gorge.— Or entent la moraliteyEt la prend por autoritey :La riche iaspe, cest sauoirQue li fox pous ne puet auoir.Bone est donc la comparaisonDou foul a poul quest sanz raison :Sapience quest espandueEntre fous, cest chose perdue.Ensic quier un prouerbe finEs autres fables en la fin,Et pense bien dou retenir ;Quar grant profit tan puet uenir.
Fol. 2 b. — De Lupo et
Agno.
Les 16 vers de cette fable latine se terminent au
commencement du feuillet 3 a.
Fol. 3 a, 3 b, 4 a et 4 b. — Miniature et traduction
précédée de ce titre : Dou lou et de
laignelat.
Les soixante-dix vers dont la traduction se
compose commencent par ce premier :
Entre lo lou et laignelat,
{p. 547}et, au verso du quatrième feuillet, se terminent par ce dernier :
Auuec genz que de deu non cure.
Fol. 4 b, 5 a, 5 b et 6 a. — De Mure et
Rana.
Viennent après ce titre les seize vers de la fable
latine, puis la miniature, enfin la traduction, qui porte ce titre :
De la rate et de la renoille
, et qui
comprend cinquante-quatre vers, commençant par ce premier :
La rate san uai per la terre,
et finissant par ce dernier :
Portoit la poinne qui lo fait.
Fol. 6 a, 6 b et 7 a. — De Cane et Ove.
Suivent les dix vers de la fable latine, la miniature et la traduction
intitulée : Dou chien et de la burbiz
et
composée de quarante vers.
Fol. 7 a, 7 b et 8 a. — De Cane portante carnem in
ore.
Ce titre est suivi de six vers de la fable latine, de
la miniature et de la traduction intitulée : Du chien
qui porte la pece de char en son boiche
et composée de
cinquante-quatre vers.
La même disposition se répète ainsi jusqu’à la dernière fable
de Walther De Cive et Equite
, qui commence
au fol. 85 b. Les quatre-vingt-douze vers latins dont elle
se compose sont, comme toujours, suivis d’une miniature appropriée à la
fable et d’une traduction portant pour titre ces mots : Dou chevalier et dou boriois qui est de la maignie a roi
,
et comprenant deux cent soixante-quatre vers, dont le premier est ainsi
conçu :
Uns rois puissant et de grant gloire,
et dont les deux derniers sont les suivants :
Grace et amour confont rancure,Droiz et loiautey touz iour dure.
À la fin du volume, c’est-à-dire au haut du verso du dernier
feuillet, on lit … cit transfeter (sic) de latino in romanum.
La première syllabe du mot fecit a été grattée. Plus bas une main moins ancienne a
écrit : Fecit transferi (sic) de
latino in romanum.
Ayant dû, pour éviter de trop longs développements, m’abstenir d’analyser toutes les fables, j’en vais du moins indiquer maintenant {p. 548}les titres. J’omets ceux des fables latines et je me borne à transcrire ici ceux de leur traduction :
1. Dou poul et de la iaspe.
2. Dou lou et de laignelat.
3. De la rate et de la renoille.
4. Dou chien et de la burbiz.
5. Du chien qui porte la pece de char en son boiche.
6. Da berbiz, da uaiche, da chieure, dou lyon.
7. De la famme qui prist a mari lo larron.
8. Dou lou et de la grue.
9. De la chine que ere pregnant.
10. Dou serpent qui occist son oste.
11. Dou cengler et de lasne.
12. De la rate priuée et de la sauaige.
13. Dou uulpil et de laigle.
14. Dou corbel et de laigle.
15. Dou corbel et dou uulpil.
16. Dou lion ancien.
17. Dou chien et de lasne.
18. Dou mercheant et de lasne.
19. Dou lion et de la rate.
20 et 21. (Les titres des deux fables 20 et 21 ont disparu avec le double feuillet qui les portait.)
22. Dou roi que li antique eslirent.
23. Des renoilles que demandarent roi.
24. De columbes qui ont fait de loitour leur roi.
25. Dou larron et dou chien.
26. Dou lou et de la true.
27. De la terre qui anfante la rate.
28. Dou lou et de laigneal.
29. Dou chien ancien.
30. Des lieures et des renoilles.
31. De la chieure qui ensoigne son cheuriat.
32. De celui qui norrit lo serpent.
33. Dou lou, de la berbiz et dou corbeal.
34. Dou chalue et de la moche.
35. Dou uulpil et de la cioigne.
36. Dou lou qui trouai la teste pointe.
37. Dou raicle qui uestit les pannes dou paon.
38. De la mule et de la moiche.
39. De la moiche et de la fremie.
40. Dou lou et de la uulpille.
41. De celui qui prist la mostoile.
42. De la renoille qui se uuet comparer a buef.
{p. 549}43. Dou lion qui lespine naura ou pie.
44. Dou cheual et dou lion.
45. Dou cheual et de lasne.
46. Des cheuas et des oiseax.
47. Dou rossignuel et de loitour.
48. Dou lou et de la uulpille.
49. Dou cer qui besmoit ses iambes.
50. De la dame et dou cheualier.
51. (Le titre manque, deux feuillets ayant disparu.)
52. Dou pere qui chestoie son anfant.
53. De la uiure et de la lime.
54. De la bataille des lous et des berbiz.
55. Dou bois qui esmange la coignie au uilain.
56. Dou chien, dou lou et dou bien de franchise.
57. [D]ou pie, de la main qui se plaignent dou uantre.
58. Dou singe et dou uulpil.
59. Dou cer qui se quaichai auuec les bues.
60. Dou iuyf cui ocist li botoillier lo roy.
61. Dou cheualier et dou boriois qui est de la maignie a roi.
Tel est le manuscrit de Lyon. Je n’ai pas besoin d’insister sur l’importance philologique qu’il offre à quiconque s’intéresse aux origines de notre langue nationale.
Dans le premier volume de ma première édition, à la page 508, je disais avoir appris par l’un des bibliothécaires du Palais des Arts qu’un jeune professeur de l’Université de Vienne, venu à Lyon au mois de septembre 1871, avait pris copie du manuscrit avec l’intention bien arrêtée de le publier. Ce jeune professeur était M. Wendelin Foerster, aujourd’hui professeur à l’Université de Bonn. Après avoir longtemps différé l’exécution de son projet, il y a donné suite : en 1882, sous le titre Der Lyoner Ysopet, il a fait paraître à Heilbronn, chez le libraire Herminger, une remarquable édition, non seulement de la traduction française, mais encore du texte latin, précédée d’une introduction et suivie d’un glossaire. Sa publication me dispense de donner du manuscrit une analyse plus complète.
7º Manuscrit de Carpentras. §
Le manuscrit des fables de Walther qui, dans la Bibliothèque municipale de Carpentras, est conservé sous la cote 368, est analysé dans le premier des trois volumes du catalogue de cette Bibliothèque dressé par M. C. G. A. Lambert et imprimé en 1862444. Malheureusement, l’analyse contenue dans {p. 550}ce catalogue n’est guère exacte et je ne peux me borner à la transcrire.
Le manuscrit est un petit volume in-8º, dont les feuillets en papier sont non, comme l’indique le catalogue, au nombre de 54, mais bien au nombre de 57, et dont l’écriture est de la fin du xve siècle et du commencement du xvie.
Les 35 premiers feuillets contiennent, non pas, suivant la mention erronée du catalogue, seulement les 45 premières fables de Walther, mais les 60 authentiques auxquelles, au haut du recto du feuillet 36, s’ajoutent les quatre premiers vers de la soixante et unième, ordinairement intitulée De Capone et Accipitre. Le reste du feuillet est blanc ; ce qui montre que le scribe avait l’intention d’achever sa copie.
Il n’a pourvu les fables ni d’un titre général, ni de titres
particuliers. La lettre initiale de chaque fable, écrite à l’encre rouge,
n’existe même que dans les premières. En ce qui touche le titre général, une
main moins ancienne, pour combler la lacune, a écrit, en tête du recto du
premier feuillet, ces mots qui trahissent, sinon une grande ignorance, au
moins une grande légèreté : Fabulæ in versibus
exametris.
Il y a dans le manuscrit des fautes dues au copiste, qui ne devait avoir aucune notion de la langue latine. C’est ainsi qu’au lieu du mot Cervus, par lequel commence la fable xxxi, il a écrit Servus. Le manuscrit offre en outre de mauvaises leçons qui ne sauraient être imputées au copiste. C’est ainsi que, dans le premier vers de la fable xxxix, au lieu de prædo murum, on lit prædoque murum, ce qui rend le vers faux. D’autre part, la fable xlviii, relative à la matrone d’Ephèse, ne se composant que de trente vers, ne comprend pas les mauvaises additions qui y ont été faites.
Les vingt et un derniers feuillets, qui sont en partie
blancs, contiennent diverses pièces que le Catalogue analyse en ces termes :
« Les prières qui terminent le volume occupent six feuillets. La
première, contre la fièvre, est en latin ; les autres, en vers romans
catalans, sont le Pater et l’Ave Maria
paraphrasés. Viennent ensuite {p. 551}diverses notes
d’une écriture plus moderne. La première est datée de 1515. »
8º Manuscrit de Marseille. §
Il ne me reste plus, pour en finir avec les manuscrits des bibliothèques françaises, qu’à faire connaître celui que possède la Bibliothèque de la ville de Marseille sous la cote C. b. 37.
Voici la description qu’on en trouve dans le Catalogue :
« Æsopus in glosa mistici sensus. Manuscrit de 1411 sur papier. Les
fables sont en vers latins, le titre à la marge. Il y a quelques
abréviations. La glose est en latin, en lignes fort serrées de la même
écriture ; le tout est un peu difficile à lire. »
Il ne faut tenir aucun compte de cette description à la fois inexacte et insuffisante.
Le manuscrit est un petit volume in-4ºde 131 feuillets. Les deux premiers sont blancs ; il en est de même de ceux qui portent les nos 127 à 131.
Les fables de Walther, accompagnées d’un commentaire, occupent les feuillets 3 à 76. Elles sont limitées aux soixante authentiques.
En tête du feuillet 3 a, se trouve, écrit
plus récemment que l’œuvre elle-même, un titre ainsi formulé : Æsopus cum (et non pas in)
glosa mistici sensus.
Puis vient, précédant le prologue de
Walther, un préambule qui, relativement au point de savoir si l’œuvre doit
lui être attribuée, me paraît avoir une importance capitale. Voici en effet
ce que j’y ai lu : « Causa autem efficiens dicitur fuisse Ysopus qui
ortus erat de Grecia ; sed, secundum alios, Galterus
anglicus composuit sub nomine ysopi, ut diligencius liber suus
reciperetur, quia nobilis erat, vel quia de eisdem fabulis tractavit ; vel
ab ysopo quadam herba suum librum intitulauit, quia, sicut ysopus bonos
dat odores, sic notitia huius libri dat intellectui
delectationem. »
À la suite du prologue se succèdent les fables, dont les titres sont écrits en marge à l’encre noire et soulignés à l’encre rouge. Quoique ne dépassant pas le nombre de soixante, elles sont pourvues de soixante-deux numéros placés au-dessous des titres.
Cette fausse manière de compter, qui se retrouvera souvent, tient à ce que le prologue de l’œuvre et le préambule spécial à la fable des Grenouilles qui demandent un roi, sans être des fables, sont comptés comme tels.
Les fables et leur commentaire se terminent, au milieu du recto {p. 552}du feuillet 76, non par la date 1411 faussement relevée dans l’analyse du catalogue, mais par celle de 1407 écrite en chiffres arabes.
L’opuscule suivant, qui forme une collection d’exorcismes,
commence immédiatement au-dessous de cette date par ce titre : Exorcismus salis et aque contra maleficia
, et se
termine au haut du feuillet 78 a par cette souscription :
Amen. Pax dei sit semper vobiscum.
Amen.
Le feuillet 79 est blanc.
Les feuillets 80 à 126 sont remplis par un ouvrage religieux
intitulé : Lumen animæ.
Cet ouvrage est
précédé d’une table qui occupe les feuillets 80 a à 81 a et qui est intitulée : Excerptorius
luminis anime.
Puis viennent deux prologues qui s’étendent
du commencement du feuillet 81 b au milieu du
feuillet 82 b. Ils sont suivis de l’ouvrage lui-même,
dont le premier chapitre est annoncé en ces termes : Sequitur primum capitulum
, et dont la fin, au milieu du
feuillet 126 b, est couronnée d’abord par cette
souscription : Et sic est finis excerptorum luminis
anime
, puis par la formule religieuse : Laudetur deus in sublimis !
§ 2. — Allemagne du Nord. §
1º Bibliothèque royale de Berlin. §
Manuscrit latin Berol. 87. §
La bibliothèque royale de Berlin ne possède, à ma connaissance, qu’un manuscrit des fables de Walther. C’est le manuscrit latin in-8º du xive siècle, qui porte le nº 87. Il renferme 59 fables élégiaques, mêlées à celles d’un Romulus dérivé de celui de Vienne. On en trouvera plus loin l’analyse.
2º Bibliothèque communale de Trèves. §
Formée des fonds d’anciens couvents supprimés, la bibliothèque de Trèves possède de nombreux manuscrits fort intéressants. En les examinant, j’en ai trouvé quatre se rapportant aux fables de Walther.
A. Manuscrit 1109. §
Le manuscrit 1109, qui portait auparavant la cote LXVIII, forme 1 volume in-4º, dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture est du xve siècle.
En tête de la première page l’origine du manuscrit est
révélée par un ex-libris ainsi conçu : Codex monasterii Sancti Mathie apostoli.
Au-dessous une table des matières donne dans les termes {p. 553}suivants la nomenclature des ouvrages contenus dans le
manuscrit :
Speculum confessionis.
Modus confitendi et penitendi.
Floretus cum glossa marginali.
Phisiologus de naturis xii animalium Theobaldi episcopi.
Esopus cum commento.
De Spiritu Guidonis.
Les fables de Walther indiquées par les mots Esopus cum commento
occupent les
feuillets 88 a à 435 b. Elles sont
accompagnées d’un commentaire, qui prouve une fois de plus que Walther en
est le véritable auteur, et dans lequel, presque dès les premiers mots, on
lit ce qui suit : « Causa autem efficiens fuisse dicitur Esopus qui
ortus erat de Grecia, vel secundum alios Galterus
Anglicus composuit sub nomine Ysopi, ut diligentius liber suus
raperetur. »
L’œuvre de Walther n’est pas complète. Le copiste n’a transcrit que les 55 premières fables ; la dernière qui figure dans le manuscrit est celle des Membres et de l’Estomac. À la suite viennent quatre feuillets blancs qui avaient été ménagés pour les 5 dernières.
Le Phisiologus, qui, dans le manuscrit,
précède les fables, paraît avoir été écrit par le même copiste, qui a,
dans la souscription suivante, exactement donné la date de sa copie :
« Est finitum et completum per me p. de || Rijs sub anno domini
1476 feria || septima ante festum assumptionis beatæ
Mariæ. »
Indirectement cette souscription fixe en même temps l’année dans laquelle il a copié les fables.
B. Manuscrit 1106. Num. loc. : 45. §
Ce manuscrit, qui portait auparavant la cote XCIII, forme
un petit volume in-12, dont les feuillets sont en parchemin et dont
l’écriture paraît remonter aux xiiie et
xive siècles. Il provient de l’abbaye
de Saint-Mathieu hors Trèves, ainsi qu’il résulte de l’ex-libris suivant inscrit sur la face intérieure du premier des
deux plats : Codex monasterii Sancti Mathie apostoli
extra Treviros.
Il contient trois ouvrages, dont l’énumération figure au-dessus de l’ex-libris dans les termes suivants :
Vocabularius parvus usque p.
Esopus metrice.
Summa magistri Guidonis de compilatione dictaminum.
{p. 554}Les fables de Walther, désignées
par les mots Esopus metrice, sont au nombre de 60. Elles
sont suivies d’une soixante et unième fable, dans laquelle il s’agit du
lion malade et du renard, et dont par exception à la règle ordinaire
l’auteur paraît avoir puisé ses inspirations à deux sources différentes.
En effet, on y trouve certains vers évidemment inspirés par ces mots de la
fable xii du livre IV du Romulus ordinaire : Interrogata autem à leone : Quare non intrasti ?
Respondit
, et par les hexamètres suivants qu’offre dans
Horace la première épître du livre I :
Olim qued Vulpes ægroto caute LeoniRespondit, referam : Quia me vestigia terrentOmnia te adversum spectantia, nulla retrorsum.Bellua multorum es capitum : nam quid sequar, aut quem ?
Quant à la fable elle-même, je ne la transcris pas ici : elle trouvera sa place toute naturelle dans l’appendice que j’ajouterai aux soixante fables de Walther.
Le tout est terminé par cet hexamètre léonin : Explicit Esopus ; peccat qui dicit Ysopus.
C. Manuscrit 132. Num. loc. : 1197. §
Ce manuscrit, qui portait auparavant la cote CLX, est un
volume in-8º de grand format, dont l’écriture sur papier appartient au
xve siècle ; il n’a pas grande
importance. Si je le signale, c’est parce qu’il renferme non le texte des
fables de Walther, mais un commentaire qui a été fait sur elles, et qui,
précédé de ce titre : Hic incipiunt dicta
Ysopi
, est suivi de cette souscription : Expliciunt dicta Ysopi
, et de ces mots :
Ysopus est herba, Ysopus fert bona
verba.
D. Manuscrit 756. Num. loc. : 304. §
Ce manuscrit, qui portait auparavant la cote 591, forme un volume in-4º, dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture est du xve siècle. Il comprend plusieurs ouvrages, dont la nomenclature a été, dans les termes suivants, établie sur la première page :
Liber consolationum sacre theologie.
Epistola siue tractatus cuiusdam carthusiensis ad quemdam canonicum.
Tractatus cuiusdam de anima.
Tractatus de duodecim patriarchis.
Esopus.
Liber Senece de forma et honestate vite.
{p. 555}L’ouvrage désigné par le mot Esopus n’est en réalité pourvu d’aucun titre. Il est
seulement précédé de cette maxime : Prudencia non
sapit fatuis.
C’est un commentaire, qu’on peut considérer
comme un fragment manuscrit des fables de Walther. En effet, chaque
commentaire partiel est précédé des deux premiers vers de la fable à
laquelle il s’applique.
Le préambule a été omis ; le texte commence par ce premier vers de la première fable :
Dum rigido fodit ore fimum, dum queritat escam.
Puis vient le commentaire de la première fable. À la suite
on trouve celui de la deuxième fable précédé des deux premiers vers
dénaturés de cette façon : Est lupus, est agnus ;
sitit hic, sitit ille. Tramite non equo querit uterque lacum
fluentem.
Il en est ainsi jusqu’à la fin de l’ouvrage, qui se termine
par cette souscription : Explicit liber iste feria
sexta || ante festum Margarete || post meridiem circa horam primam ||
anno domini etc. xlixo.
3º Bibliothèque de Wolfenbüttel. §
A. Manuscrit 37.34 Aug. §
Ce manuscrit, composé de deux cents feuillets en papier, forme un volume in-fº, dont l’écriture à longues lignes est due à un copiste du xve siècle nommé Théodoric Block.
Il renferme quinze opuscules que je m’abstiens d’énumérer. Le dixième, dont j’aurai à donner ailleurs une plus longue analyse, consiste dans les fables d’Avianus, qui commencent au feuillet 88 a et finissent au feuillet 97 a, et le onzième dans celles de Walther, qui, partant du feuillet 99 a, se terminent au milieu du feuillet 110 b.
Devant analyser ailleurs les premières, je m’arrête seulement aux secondes.
En tête de la page où elles commencent on lit ces deux mots
qui leur tiennent lieu de titre général : Esopi
prologus.
Elles ne sont accompagnées d’aucune glose et
les dix-neuf premières seules sont pourvues de titres.
Réduites aux soixante authentiques, elles ne se présentent pas tout à fait dans l’ordre ordinaire : il y a interversion entre la vingt-deuxième et la vingt-troisième.
La fable xlviii se compose de 36 vers. Indépendamment des deux distiques qui font voir la veuve brisant les dents de son défunt {p. 556}époux, on y trouve, avant le distique final qui contient la vraie affabulation, le suivant que j’ai déjà signalé dans un autre manuscrit :
Quos coluit vives (sic), nescit vixisse sepultosFama (sic) ; nil fidei mens mulieris habet.
On voit, par cette seule citation, à quel point l’ignorance du copiste a rendu le texte défectueux.
B. Manuscrit 87.5. Aug. §
Schwabe, sur la foi de Lessing, Dressler, sur la foi de Schwabe, et M. Oesterley, sur la foi des trois, ont tour à tour répété que la Bibliothèque de Wolfenbüttel possédait deux manuscrits des fables de l’anonyme de Névelet, et que l’un des deux remontait au xiie siècle. C’est ce dernier qui porte la cote 87.5. Aug. ; mais, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il est, non du xiie siècle, mais du xiiie. C’est un volume in-4º à deux colonnes, à tort qualifié in-fº, et formé de trente-neuf feuillets en parchemin précédés d’un autre beaucoup moins ancien. Sur ce feuillet le contenu du manuscrit est indiqué en ces termes :
In hoc libro continentur hi poetæ manuscripti :
Catonis Disticha.
Theodoli Poetæ Christiani carmina.
Auiani Fabulæ Elegiaco carmine.
Zozimas monachus eiusque carmina rithmica.
Matthias Vindocinencis Episcopus Turonensis Tobiam Elegiaco carmine transtulit.
De cette table il ressort que le manuscrit renferme les
fables d’Avianus, que j’analyserai ailleurs ; mais il possède aussi,
quoiqu’elle ne les mentionne pas, les soixante de Walther, qui, commençant
au haut de la deuxième col. du feuillet 11 a, y sont
surmontées de ce titre à l’encre rouge : Incipit
Esopus.
Chacune a son titre spécial à l’encre rouge. Celle qui dans
les manuscrits est généralement la vingt-sixième vient après les deux que
d’ordinaire elle précède. La fable xlviii ne se compose que des
trente vers authentiques. La fable lx n’a pas le distique final
qui habituellement la suit ; il a été rejeté à la fin d’une soixante et
unième intitulée : De fero rustico et seua
coniuge
, qu’on trouvera parmi celles de l’appendice dans
le second volume de cet ouvrage.
Le distique final ainsi transposé est lui-même, vers le milieu de {p. 557}la première colonne du feuillet 19 b, suivi de ces trois vers léonins :
Explicit esopus ; peccat qui dicit ysopus.Scriptor sum talis, demonstrat littera qualis.Est liber hic scriptus ; qui scripsit [sit] benedictus !
Au-dessous on lit cette souscription usuelle : Explicit esopus. deo gracias. Amen.
Le reste de
la page est blanc.
C. Manuscrit 185 Helmst. §
Ce manuscrit, du format in-fº, est composé de 244 feuillets en papier dont l’écriture à deux colonnes est due à une main du xve siècle. Il porte le millésime de 1471.
Il contient les fables d’Avianus, qui occupent les feuillets 95 a à 110 b ; mais en ce qui les touche je me borne, quant à présent, à cette indication, et je passe à celles de Walther qui les suivent.
Limitées aux soixante authentiques, elles commencent au haut de la deuxième colonne du feuillet 110 b.
Elles ne portent pas de titres particuliers, mais sont
accompagnées de gloses interlinéaires et suivies chacune d’un commentaire.
Celui qui s’applique au prologue commence ainsi : Incipiunt fabule Esopi ad detestacionem viciorum et virtutum
instructionem finaliter ordinate.
La fable xlviii se compose de trente-cinq vers. Elle possède les deux distiques qui montrent la veuve brisant les dents de son défunt mari et se termine par ces trois vers :
Quos coluit uiuos nescit uixisse sepultosFemina ; nil fidei mens mulieris habet.Sola premit uiuos que metu penaque sepultos.
Le dernier pentamètre de la fable manque dans le manuscrit, dans lequel, il sera, en ce qui touche les fables de Walther, aisé de reconnaître une simple copie de celui de Göttingen, analysé à la page 559.
Au haut du recto du feuillet 133 où elles finissent, on lit
cette souscription : Hic finitur Esopus cum suis
fabulis et moralitatibus eiusdem Sub Anno domini millesimo
quadringe[nte]simo septuagesimo primo In die marcelli martiris et
pape.
D. Manuscrit 622 Helmst. §
Ce manuscrit, du format in-4º, se compose de 343 feuillets en papier dont l’écriture est du milieu du xve siècle. Il est l’œuvre du copiste And. Soteflesch qui l’a signé.
{p. 558}Les fables de Walther, limitées aux soixante ordinaires, commencent sans titre général au recto du feuillet 297. Chacune d’elles porte son titre particulier en marge, en face du premier vers.
La fable xlviii se compose de trente-deux vers, dont les deux derniers, s’ajoutant aux trente authentiques, sont ainsi conçus :
Quos coluit vivos nescit vixisse sepultosFemina ; nil fidei mens mulieris habet.
Le tout est clos au verso du feuillet 318 par cet hexamètre léonin :
Explicit esopus ; benedictus sit pater almus.
E. Manuscrit 162 Gud. §
Ce manuscrit est un in-4º formé de trente-sept feuillets en parchemin, dont l’écriture à longues lignes est de la fin du xive siècle ou du commencement du xve.
Voici comment, sur la face intérieure du premier des plats, un calligraphe moderne a indiqué le contenu du volume :
LXII Æsopei Apologi versibus conscripti auctore anonymo. F. 1 à 22 a.
Ecloga sacra CCCLI versuum hexametrorum, quæ S. Johannis inscribitur, in qua Pseustis et Alethia alterno carmine certant, paganam altera theologiam ornans, altera Christianam. Est autem hæc Ecloga Theoduli presbyteri, natione Itali, et a monachis nonnullis nugacibus S. Johanni Chrysostomo adscribebatur. F. 22 a à 30 a.
Valerii dissuasiones ad Rvfinvm ne ducat vxorem. F. 30 b à 37.
Les Æsopei apologi sont les fables de Walther qui remplissent les vingt et un premiers feuillets et les quatre premières lignes du recto du vingt-deuxième feuillet.
Elles sont précédées de ce titre général : Incipit liber apologorum Esopi.
Elles comprennent les soixante fables authentiques et les deux complémentaires.
Les quatorze premières ont seules reçu leurs titres, écrits à l’encre rouge. L’espace ménagé au-dessus de chacune des autres pour les recevoir n’a pas été rempli.
La fable xlviii contient les deux distiques, souvent introduits après le vingt-sixième vers dans le texte primitif.
Enfin la soixante-deuxième fable est suivie de cette
souscription : Explicit liber Exopi. deo grās.
Amen.
4º Bibliothèque de l’Université de Göttingen. §
Manuscrit philol. 106. §
{p. 559}Ce manuscrit, dont l’écriture est du xve siècle, forme un volume in-8º de 62 feuillets, dont le premier est en parchemin et les autres en papier.
Les fables de Walther, au nombre de soixante seulement, y remplissent les feuillets 2 a à 36 b.
Elles ne portent pas de titre général, mais sont précédées
d’un préambule commençant par cette phrase : Incipiunt
fabule Esopi ad detestationem vitiorum et virtutum instructionem
finaliter ordinate.
Elles sont accompagnées de gloses interlinéaires, et suivies chacune d’un commentaire d’une écriture plus fine que le texte.
La fable xlviii, comme dans plusieurs manuscrits précédemment analysés, possède les deux distiques suivants, qui montrent la matrone d’Éphèse brisant les dents de son mari mort :
Inquid tunc miles : Nil feci ; dentibus illeQuem male seruaui, deficiebat enim.Ne timeas, inquit mulier, lapidemque reuoluens,Dentes huic misero fregit in ore viro.
Plus bas, la même fable, tout en conservant le distique originairement consacré à l’affabulation, a été augmentée de cet autre déjà signalé dans trois manuscrits de la Bibliothèque de Wolfenbüttel :
Quos coluit viros nescit vixisse sepultosFemina ; nil fidei mens mulieris habet.
Ainsi accrue, la fable se compose de trente-six vers.
5º Manuscrit de Haenel. §
L’Allemand Haenel, dans ses voyages en Italie, eut la bonne fortune de rencontrer un manuscrit des fables élégiaques et de pouvoir s’en rendre acquéreur.
Comme celui de Douai, avec lequel ses leçons s’accordent, il a aidé Dressler à remédier aux fautes des éditions antérieures. La description que cet auteur en a faite me permet d’en dire quelques mots. C’était un cahier in-4º composé de treize feuillets en parchemin. L’écriture était de la fin du xiiie siècle ou du commencement du xive. Le titre et la première partie de chaque fable étaient écrits à l’encre rouge ; en marge, de place en place, étaient peints des animaux qui se rapportaient aux fables elles-mêmes. Le deuxième feuillet avait été détaché, et à partir de la fable vingt-huitième, {p. 560}le copiste, dans la crainte de manquer de parchemin, avait serré ses lignes davantage, et, tout en conservant à son écriture la même netteté, avait diminué les caractères au point de pouvoir sur le dernier feuillet placer une double colonne de vers. Ce feuillet ne contenait qu’une partie de la fable lviii, et cependant rien n’indiquait que la fin de cette fable eût, avec les deux dernières, existé auparavant sur un feuillet disparu.
Les fables étaient précédées d’un ouvrage de grammaire composé en vers par le professeur Alexandre de la Ville-Dieu.
Le manuscrit avait appartenu au pape Pie VI, et avait figuré après sa mort à la vente de ses livres. Il est probable qu’il existe encore ; mais je ne saurais dire dans quelles mains il est passé.
§ 3. — Allemagne du Sud. §
Bibliothèque royale de Munich. §
A. Manuscrit 237. §
Les fables de Walther sont contenues dans ce manuscrit du format in-folio, composé de 373 feuillets en papier, dont l’écriture est de l’année 1460 et des années suivantes.
Elles s’étendent du verso du feuillet 153 au verso du feuillet 169.
En tête se trouve un préambule inepte, qui les attribue à
Ésope et dans lequel se lisent les phrases suivantes : « Causa
efficiens est magister Esopus de civitate Atheniensi. Et est liber
presens compositus in greco. Tiberius vero imperator Romanorum Esopum
peciit ut sibi aliquas iocosas fabulas ad removendum curas publicas
compilaret ; qui precibus ipsius nolens contradicere presentem librum de
greco transtulit in latinum, in quo per verba et que risum multiplicant,
(et) reproborum corrigantur vitia. »
Le nombre des fables est de soixante ; elles sont
accompagnées de courtes gloses tant en marge qu’en interligne et suivies
de cette mention qui paraît être de la même main que les gloses :
Per Hartmannum Schedel in Studio Lipsiensi anno
domini iiiilxijo (lisez : seculo quarto
decimo anno sexagesimo secundo) in novo
foro.
B. Manuscrit 416. §
Les 60 fables primitives figurent également dans le manuscrit 416. Ce manuscrit, qui, comme le précédent, est du xve siècle, forme un volume in-4º de 245 feuillets en papier et comprend onze ouvrages.
{p. 561}Les fables, qui en sont le
cinquième, occupent les feuillets 205 à 219, ne sont accompagnées d’aucun
commentaire et se terminent par les mots Finis
Esopi
.
C. Manuscrit 609. §
Le manuscrit 609, qui est plus intéressant que le précédent, forme un volume du petit format in-4º, composé de 108 feuillets en papier dont l’écriture est du xve siècle. Les soixante-quatre premiers sont occupés par 62 fables accompagnées de gloses marginales et interlinéaires et précédées du préambule suivant :
« Magister Esopus, excellens boeta (sic) grecus de civitate atheniensi, (volens) auctor libri, volens homines communiter informare quid agere vel quid vitare debeant, hoc opus in grecia composuit, et fingit bruta animalia et irationabilia loqui, nobis volens per hoc cavere cavenda et sectari sectanda. Nam quod fingit gallum loqui et lupus (sic), ut patet in littera, hoc totum est figurative, significanter ut sic quod minus videtur inesse inest et quod magis. Istud autem opus in greco diu iacuit a latinis incaptatum, donec Tiberius quidem imperator Romanorum rogavit Romalum quemdam latinum magistrum ut sibi aliquas iocosas fabulas ad removendum publica vitia compilaret et legeret, et Romalus, non audens precibus tanti principis contradicere, librum istum, ut puto autenticum, de greco sermone in latinum primo prosaice transtulit, dicens : O Tiberi, [pro] te scribens scribam tibi calumpnias maiorum et reproborum verbo blando, ut ista risum multiplicent et ingenium acuent (sic) per exempla ; deinde eumdem librum metrice composuit. »
Les fables se terminent, au verso du feuillet 64, par ce distique qui se trouve ordinairement à la fin de la fable 60 :
Fine fruor ; versu gemino quod cogitat omnisFabula declarat, datque quod intus habet.
À la fin des fables de Walther viennent celles d’Avianus qui commencent au fol. 65.
C’est tout ce que renferme le manuscrit.
D. Manuscrit 4146. §
Ce manuscrit, qui a été écrit en 1436 et dans les années
suivantes et dont l’origine est indiquée au catalogue imprimé de la
Bibliothèque par cette mention : Aug. S. Cruc. 46
, forme un
volume in-folio de 116 feuillets.
{p. 562}Il renferme dix-huit ouvrages, dont les fables de Walther sont le quatorzième. Elles occupent les feuillets 76 et suivants.
L’écriture est de la main d’un copiste nommé Burkhardus Zingg.
E. Manuscrit 4409. §
Une partie seulement des fables de Walther se rencontre dans un manuscrit du xve siècle provenant d’un couvent d’Augustins, dans lequel il portait le nº 109.
Ce manuscrit, dont le catalogue indique l’origine par cette
mention : Aug. S. Ur. 109
et à qui la
cote 4409 a été donnée dans la bibliothèque de Munich, forme un volume
in-4º, partie en parchemin et partie en papier, qui se compose de
229 feuillets écrits et de quatre blancs à la suite.
Les fables élégiaques, qui sont le huitième des vingt et un ouvrages qu’il renferme, commencent au recto du feuillet 83 par le prologue ordinaire, au-dessous duquel ou lit cette glose inspirée par la dédicace de Romulus à son fils.
« Romula (sic) filius Tibernio (sic). De civitate a(n)t(e)tica salutem. Esopus quidam homo grecus ingeniosus natus fuit in Phrigia et claruit ibi, [ita ut] honeste viveret per omnia. Ego vero Romulus transtuli hunc librum de greco in latinum. Titulus huius : Incipit Esopus, liber fabularum ab Esopo compositus atheniosi (sic) magistro. Nota causa finalis omnium poetarum consistit in utilitate vocabulorum et in delectatione materie, quia poete diversa narrant. Unde Horatius :
Aut prodesse volunt aut delectare poete. »
Les fables élégiaques qui suivent, sont très incomplètes ; mais le manuscrit n’en est pas moins précieux ; en effet, non seulement chaque fable est ornée d’une aquarelle à fond vert d’eau et accompagnée d’un commentaire, choses qui peuvent être intéressantes à titre de renseignement sur l’état artistique et scientifique du temps, mais encore elle est suivie d’une traduction en vers allemands, qui est l’œuvre du vieux Boner, c’est-à-dire du prince des minnesingers.
Le copiste, laissant son travail inachevé, s’est arrêté à la fin de la vingt-deuxième fable élégiaque De Columbis, Miluo et Accipitre, et n’a même conduit son commentaire que jusqu’à la dix-huitième, De Leone et Mure ; mais il a poussé un peu plus loin la copie des fables de Boner, en laissant au-dessus de chacune l’espace nécessaire à la fable latine. Malheureusement il n’a pas non plus terminé la {p. 563}copie de l’œuvre allemande, de sorte qu’à la suite quatre feuillets sont restés entièrement blancs. En somme, malgré ses lacunes, le manuscrit 4409 méritait une mention toute spéciale.
Il est l’œuvre de plusieurs copistes, comme l’atteste cette
mention finale : Codicem complures scripserunt.
F. Manuscrit 5311. §
Lorsqu’en 1873 j’ai été visiter la bibliothèque royale de Munich, le catalogue des manuscrits n’était pas encore entièrement imprimé, et les premiers volumes qui en avaient paru n’avaient pas atteint le nº 5311. Il en est résulté que, rien ne me révélant leur existence, je n’ai pu me faire communiquer ni le manuscrit 5311 ni ceux auxquels ont été attribuées des cotes plus élevées. Je ne pourrai donc en donner d’autre description que celle qui m’est aujourd’hui fournie par le catalogue complété.
Le manuscrit 5311 forme un volume in-4, dont l’origine est
indiquée au catalogue par cette mention : Chiem.
ep. 11.
Il porte la date de 1449 et se compose de
272 feuillets. Du feuillet 257 b au feuillet 260 a, sous le titre Excerpta ex Esopo
probablement imaginé par les auteurs du catalogue, il renferme les
épimythions des 60 fables de Walther. Il comprend quinze ouvrages dont ces
épimythions sont le treizième.
G. Manuscrit 5942. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle, forme un volume in-4º, dont l’origine est indiquée
au catalogue par cette mention : Ebersb. 141.
Il se compose de 263 feuillets, dont les
47 premiers contiennent les fables de Walther. C’est ce qui résulte de la
désignation suivante que j’emprunte au catalogue : Apologi vel fabulae Esopi (quidam asserunt magistrum Galterum
composuisse).
Le manuscrit renferme au total vingt-cinq
ouvrages divers.
H. Manuscrit 7680. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle, forme un volume in-4º dont l’origine est indiquée au
catalogue par cette mention : Ind. 280.
Il se compose de 217 feuillets, et renferme, accompagnées d’un
commentaire, les fables de Walther, qui, suivant le catalogue, sont
intitulées Liber Esopi et sont le dernier des trois
ouvrages qui s’y trouvent.
I. Manuscrit 14134. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle, forme un volume in-fol., dont l’origine est indiquée
au catalogue par cette mention : Em.
B 42.
Il se compose de 333 feuillets, dont les vingt-cinq
premiers sont occupés par les fables de Walther, signalées {p. 564}en ces termes : Æsopi fabulae
versibus elegiacis expressae
, et suivies de quatorze
autres ouvrages.
J. Manuscrit 14301. §
Ce manuscrit, dont le catalogue indique l’origine par cette
mention : Em. D 26
, contient plusieurs
opuscules, qui, d’après les dates qu’il porte, ont été écrits de 1425 à
1433. Il forme un volume in-fol. de 288 feuillets, dans lequel les
feuillets 183 a à 202 b sont occupés
par les fables de Walther annoncées par les mots Fabulae Æsopiae
.
K. Manuscrit 14586. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle et dont l’origine est indiquée par cette mention :
Em. F 89
, forme un volume in-4º de
429 feuillets. Parmi les ouvrages variés qu’il contient et qui sont au
nombre de douze se trouvent les fables de Walther qui commencent au
feuillet 393. Elles sont accompagnées d’un commentaire et interprétées par
des gloses ; c’est ce que le catalogue révèle en ces termes : Æsopi fabulae cum commento et glossis.
L. Manuscrit 14703. §
Ce manuscrit qui remonte au xve siècle et dont l’origine est indiquée au catalogue par
cette mention : Em. G. 87
, forme un
volume in-4º de 161 feuillets et renferme six ouvrages, dont le premier
est le Novus Avianus de Vienne, le deuxième, les vraies
fables d’Avianus, et le cinquième, celles de Walther qui commencent au
feuillet 68 a et se terminent au feuillet 123 b.
Ces dernières sont accompagnées d’un commentaire ; c’est ce
que le catalogue fait connaître en ces termes : Æsopi
fabulæ cum commento.
M. Manuscrit 16213. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle, forme un volume in-fol., dont l’origine est indiquée
au catalogue par cette mention : S. Nic. 213.
Il se compose de 336 feuillets et renferme
sept ouvrages, parmi lesquels figurent, accompagnées d’un commentaire, les
fables de Walther commençant au feuillet 292 a. Elles
sont signalées en ces termes : Æsopi fabulae metrice
cum commento.
N. Manuscrit 22404. §
Ce manuscrit est un in-4 du xve siècle composé de 236 feuillets.
Il renferme de nombreux ouvrages énumérés dans le catalogue de la Bibliothèque.
Le premier consiste dans les fables de Walther qui occupent les premiers feuillets, et qui du feuillet 61 au feuillet 102 sont suivies {p. 565}de celles d’Avianus. Les unes et les autres sont accompagnées d’un commentaire.
Le reste du manuscrit ne se rapportant pas aux fabulistes latins, je m’abstiens d’en donner l’analyse.
§ 4. — Angleterre. §
1º Bibliothèque du British Museum. §
De toutes les bibliothèques que j’ai visitées, la plus riche en manuscrits est celle du British Museum. En ce qui touche ceux de Walther, j’en ai feuilleté treize, dont je vais maintenant donner une courte analyse.
A. Manuscrit B. Eg. 832. §
Le manuscrit B. Eg. 832 est un volume in-18, composé de 321 feuillets dont l’écriture est du xve siècle.
Les fables de Walther, qui occupent les feuillets 171 b à 185 a, offrent une division en trois livres, qui trahit leur origine et qui montre que, suivant l’opinion adoptée, elles sont bien dérivées du Romulus ordinaire. Elles ne comprennent que 60 fables, et sont précédées de ces deux distiques écrits au bas du feuillet 171 a.
Jucundos flores fructus editque salubresOrtulus esopi : carpe quid ipse voles.Iure legendus erit qui miscuit utile dulci.Si bene perpendis, noster hic actor agit.
La fin de la collection est annoncée par ces mots :
Explicit apologiarum (sic) esopi
liber tertius.
B. Manuscrit 15. A. XXVIII. §
Le manuscrit ainsi coté se compose de 16 feuillets en parchemin, dont l’écriture, due à une main du xve siècle, est merveilleusement belle. En tête, à la place qui aurait dû être affectée au titre général, il est orné d’une superbe miniature ; ce qui n’empêche pas les marges d’en offrir d’autres destinées à illustrer les fables.
Il ne comprend que les 60 fables authentiques et se termine
par le mot Finis
.
C. Manuscrit Harl. 2745. §
Le manuscrit Harl. 2745 forme un volume du petit format in-fol., dont les feuillets au nombre de 160 sont en parchemin, et dont l’écriture est du xive siècle.
Il comprend plusieurs ouvrages désignés par ces titres :
Flores Senecæ, Virgilii, Ovidii,
Galterii
; Esopi fabulæ
carmine.
{p. 566}Les 60 fables élégiaques
annoncées par ce dernier titre s’étendent du feuillet 136 au feuillet 152.
Elles portent en tête ces mots : Incipit liber
Esopi
, et à la fin ceux-ci : Explicit
liber Esopi.
D. Manuscrit Add. 10088. §
Ce manuscrit est un grand in-4º, composé de dix-huit feuillets en parchemin. L’écriture, qui est du xve siècle, offre une magnifique ampleur de forme. La reliure en bois, qui est presque aussi ancienne que le contenu, en est digne par son élégance ; sur l’un des plats le mot Esopus a été gravé en grands caractères gothiques.
Les fables élégiaques, seul ouvrage contenu dans le manuscrit, sont au nombre de 63 ; elles comprennent les 60 fables primitives, auxquelles s’ajoutent les trois suivantes : De Capone et Accipitre, De Pastore et Lupo, De Sponsa et Marito.
Le titre, qui, sans doute, devait être orné de miniatures
par un artiste spécial, avait été à cet effet laissé en blanc par le
copiste. Mais à la fin des fables qui se terminent au bas du recto du
feuillet 18, il a écrit : Explicit Esopus. Deo
gracias. Amen.
E. Manuscrit Add. 10089. §
Le manuscrit 10089 est un volume in-fol. composé de 69 feuillets en parchemin et écrit par une main du xve siècle.
Il contient quatre ouvrages désignés par les titres suivants : Theodolus, Esopus, Liber parvi doctrinalis, Liber synonymorum.
Les 62 fables élégiaques auxquelles s’applique le mot Esopus s’étendent du feuillet 14 au feuillet 33. Chacune d’elles porte un titre à l’encre rouge, et est en outre accompagnée de gloses marginales.
En tête il n’existe pas de titre général ; mais à la fin on
lit : Explicit liber Esopi.
F. Manuscrit Add. 10093. §
Le manuscrit 10093 forme un petit volume in-4º, composé de 65 feuillets en parchemin et écrit par une main du xive siècle.
Il contient quatre ouvrages annoncés par ces titres : Catonis disticha, Grammatica latina, S. Prosperi Aquitanici liber, Esopi fabulæ quædam.
Ce dernier titre, qui se rapporte aux fables de Walther, indique qu’elles sont incomplètes. En effet, le manuscrit ne renferme que le prologue et les 30 premières fables. Elles occupent les feuillets 57 à 65 qui sont actuellement les derniers du manuscrit. Il est probable que la collection à l’origine était entière, et qu’elle n’est {p. 567}devenue incomplète que par la disparition des feuillets qui en contenaient la fin.
G. Manuscrit Add. 10389. §
J’arrive à l’un des plus curieux manuscrits de Walther.
Voici l’analyse qu’en donne le catalogue imprimé de la
bibliothèque : « Liber Exopi, editus à Lucone de Suma Campanea :
i. e. Fabulae aesopicae, carmine latino, cum duplice versione Italica,
materiali, ab Accio Zuccho Veronensi. Codex chartaceus, manu Johannis
Benedicti, aurificis, exaratus, anno 1462. »
De cette analyse il ressort que le manuscrit est du xve siècle et qu’il a été écrit en 1462 par un copiste nommé Jean Benoît.
Il s’ensuit que, lorsqu’en 1479 les sonnets italiens d’Accio Zuccho furent pour la première fois publiés à Vérone, ils existaient depuis dix-sept années au moins.
Le manuscrit forme un volume in-fol. de 57 feuillets, et, bien qu’écrit sur papier, peut être considéré comme un livre de luxe.
Il ne renferme que les fables de Walther accompagnées de l’œuvre de son traducteur italien, et illustrées en marge de dessins à la plume que relève un brillant coloris.
Au recto du premier feuillet se trouve d’abord le titre
suivant : Incipit liber Esopi Zucarini editi a Zucone
de Suma Campanea.
Au-dessous viennent deux sonnets préliminaires intitulés,
le premier : Sonelus
, et le second :
Commentum.
Le prologue latin, qui commence au verso du premier feuillet, est également suivi de deux sonnets qui s’y rapportent.
Il en est de même des fables : après chacune d’elles viennent deux sonnets.
Comme dans les éditions imprimées de la traduction d’Accio Zuccho, il y a soixante-quatre fables, terminées par une Canzona.
Le verso du feuillet 56 est rempli par une pièce de vers latins dont l’auteur a pris pour thème la vanité des grandeurs humaines et a clos sa dissertation par ces deux vers :
Quid mihi divitie, quid lata palacia prosunt,Cum mihi sufficiat parvo quod marmore claudor ?
Enfin au recto du feuillet 57 on lit : De forio || Jhoanes benedictus aurifex scripsit die 15 Augustii ||
1462, in contrata sancti Salvarii. ||Pax || aeterna.
H. Manuscrit Add. 11675. §
{p. 568}Je ne dois mentionner que sommairement ce manuscrit 11675, petit volume in-8º de huit feuillets en parchemin, qui ne contient que le prologue et les trente-deux premières fables de Walther. La trente-deuxième fable, intitulée De Cervo, Lupo et Ove, s’arrête à ce vers :
Namque die fixo debita spondet Ovis.
Les 8 feuillets, par la faute du relieur, sont en désordre. Le dernier a été placé le second.
Comme pour rendre ce désordre plus inextricable, les fables ne portent pas de titres ; elles sont seulement accompagnées de gloses marginales, d’une écriture excessivement fine, qui, comme celle du texte, paraît être du xiiie siècle.
I. Manuscrit Add. 11896. §
Au point de vue artistique, de tous ceux qui renferment les fables de Walther, le manuscrit 11896 est certainement le plus précieux. Je n’ai jamais vu écriture plus belle que celle qui en remplit les 100 feuillets en parchemin, ni surtout miniatures mieux dessinées ni mieux coloriées que celles qui les décorent.
Un pareil manuscrit n’avait pu être exécuté que pour un prince ; c’est ce que révèle tout de suite la mention suivante mise sur le recto du premier feuillet :

Les mots : Dux Johannes Galeaz
Mediolani
, qu’il faut lire dans ces abréviations,
indiquent que le manuscrit a appartenu à Jean Galéaz, duc de Milan, pour
qui il avait été sans doute écrit et illustré.
Le duc Galéaz avait dû en apprécier, à sa juste valeur, le mérite artistique ; car au-dessous de la mention que je viens d’indiquer, il avait pris la peine d’écrire et de signer de sa propre main ce qui suit :
dvx
Iste liber est mei Jarandi de nobilibus Chairi

{p. 569}Les fables commencent au recto
du deuxième feuillet et portent pour titre général ces mots : Incipit liber fabularum Esopi.
Elles sont
précédées du prologue, dont le texte est relevé par les dorures de la
première lettre. Mais, si belle que soit cette lettre, elle est loin de
valoir la miniature qui sur la même page sert d’ornement à la première
fable, c’est-à-dire à la fable du Coq et de la Perle. Dans cette miniature
dont la finesse est incomparable, on ne sait vraiment ce qu’on doit le
plus admirer du dessin ou de la couleur. Le bas de la même page est occupé
par les armes du duc, autre chef-d’œuvre de miniature qui ne le cède en
rien au précédent.
Les fables sont au nombre de 61, composées de
60 ordinaires, et d’une soixante et unième en vers hexamètres, intitulée :
De Pueris ludentibus et Lepore
, et
très certainement étrangère à Walther. Elles se terminent au
feuillet 25 b et sont suivies de cette mention finale,
qui fixe l’âge exact du manuscrit : Deo laus et eius
genitrici. Mli. lzl’aprilibus 1477.
Le reste du volume est consacré à l’œuvre de Rimicius.
Au recto du feuillet 26 commence par les mots : Novas nimirum merces
la dédicace au cardinal
Anthoine du titre de Saint-Chrysogone. Puis viennent l’argument de la vie
d’Ésope et sa vie elle-même dont la première lettre est ornée
d’illustrations splendides. La vie d’Ésope s’étend jusqu’au
feuillet 67 b, où la fin en est indiquée par les mots
Finis Esopi vitae
. Alors, au
feuillet 68 apparaissent les fables d’Ésope traduites par Rimicius. Comme
sa vie, elles sont précédées d’un argument intitulé : Argumentum fabularum Esopi è greco in latinum
, et
suivies d’une sorte d’épilogue terminé par ce dernier vers du Livre II des
Géorgiques :
Et iam tempus equum fumantia soluere colla.
Immédiatement après a été écrite cette intéressante mention
qui termine le manuscrit : « Vita Esopi et fabule per Rimicium
thettalum traducte. Mediolani absolute quarto nonas junias pro
illustrissimo et eximio D. domino Io. Ga. duce Mli. ĪC.
1477. »
J. Manuscrit Add. 11897. §
Le manuscrit 11897 est bien loin d’avoir l’importance du précédent. C’est un volume in-fol. dont l’écriture sur papier, due à une main du xve siècle, occupe seulement 27 feuillets. Aussi ne renferme-t-il pas d’autre ouvrage que les fables de Walther. On n’y trouve que les 60 premières, accompagnées, il est {p. 570}vrai, de ces gloses naïves qui ont été imprimées dans les éditions du xve siècle. Dans l’espoir d’y découvrir quelque renseignement relatif au véritable auteur des fables, j’ai jeté les yeux sur l’introduction, qui, mise en tête du manuscrit, précède même le prologue en vers ; mais elle ne m’a rien révélé.
K. Manuscrit Add. 11966. §
Le manuscrit 11966 est un volume in-4º, dont les
51 feuillets en parchemin sont remplis par une belle écriture du
xve siècle. Les fables élégiaques qu’il
renferme occupent les feuillets 13 a à 35 b et sont précédées de ce titre : Esopi fabule
feliciter incipiunt.
Elles ne sont accompagnées d’aucune
glose. Il y en a soixante-deux ; comme toujours lorsqu’elles atteignent ce
nombre, les deux dernières sont celles intitulées De Capone
et Accipitre et De Pastore et Lupo.
L. Manuscrit Add. 18107. §
C’est encore un manuscrit à feuillets en parchemin que celui qui porte le nº 18107.
Il ne se compose que de 18 feuillets, uniquement consacrés
aux 62 fables ordinaires par un véritable calligraphe du xve siècle. Elles commencent au feuillet 2 a sans titre, ne sont pourvues d’aucun commentaire et se
terminent au recto du fol. 18 par ces mots usuels : Explicit liber Esopi. Deo gratias. Amen.
M. Manuscrit Add. 27625. §
Le manuscrit 27625 est un vol. in-4º, formé de
84 feuillets, les uns en parchemin, les autres en papier. Les fables, que
ne précède aucun titre général et que n’accompagne aucune glose, n’en
occupent que les 25 premiers. Indépendamment des 62 fables ordinaires,
elles en comprennent une soixante-troisième, qui est la même que la
soixante-troisième du manuscrit 10088, et qui est intitulée : De Uxore et Viro et Puero.
Au-dessous de cette
dernière fable on lit cette double souscription : Deo
gratias ; Amen. — Finis ; Amen.
2º Bibliothèque Grenville. §
La Bibliothèque Grenville (Grenville library), quoique installée dans le même palais que la Bibliothèque du British Museum, en est presque entièrement indépendante. Cataloguée séparément, elle occupe des salles qui lui sont réservées et auxquelles un personnel spécial est attaché.
Elle est riche en livres précieux et notamment en incunables. Elle possède, il est vrai, peu de manuscrits ; mais ils sont d’une grande valeur. On en va pouvoir juger par ceux que je vais maintenant décrire.
A. Manuscrit XIII. §
{p. 571}J’ai eu la satisfaction d’exhumer des rayons de la Grenville library un manuscrit identique à celui qui, à la Bibliothèque nationale, porte dans le fonds français la cote 1594. Non seulement, comme ce dernier manuscrit, il contient le texte latin de Walther et celui d’Avianus, amplifiés et accompagnés d’une traduction française en vers de huit syllabes, mais encore il lui ressemble tellement par l’écriture gothique et par les miniatures, qu’on le croirait écrit par le même copiste et illustré par le même artiste.
Malgré l’existence d’un double, il présente un grand intérêt ; car, n’ayant pas été altéré par l’humidité, son texte est complet et permet de combler les lacunes de l’autre.
Formant un volume in-4º de dimension moindre que le manuscrit de la Bibliothèque nationale, il a nécessairement un plus grand nombre de feuillets. Ces feuillets en parchemin ont dû, à l’origine, être au nombre de 134 ; mais, le premier ayant disparu, il n’en reste que 133 anciens, augmentés de deux neufs laissés blancs.
La première partie du manuscrit comprend 63 fables sous
64 numéros à cause de la division en deux parties de la fable des
Grenouilles qui demandent un roi. Originairement, comme dans le manuscrit
de la Bibliothèque nationale, elles étaient précédées d’un préambule qui a
disparu. Il occupait le premier feuillet et le second jusqu’au milieu du
recto. Mais, le premier feuillet ayant été arraché, les derniers vers qui
occupaient sur le second le commencement du recto ont été grattés et
remplacés par ce titre dû à une main du siècle dernier :
« Sensuivent les Fables Dysopet et Davionet moralisées en latin
et en roman l’an 1316. »
Je dois tout de suite dire où le méticuleux et peu intelligent bibliophile, qui avait écrit ce titre, avait cru pouvoir prendre cette date supposée. Il s’était autorisé de ces trois vers de l’épilogue, dont j’ai déjà donné copie :
En le honneur de ma dame chiereLa royne a tres belle chiereMadame iehanne de borgomgne.
En marge de ce dernier vers il a écrit cette note :
« femme de Philipes le Long qui régnoit en
1316. »
Mais il avait là commis une erreur, que M. Robert a su
éviter et que, d’après lui sans doute, le {p. 572}catalogue de la Grenville library a relevée dans une notice dont voici
la traduction : « La mention de Madame Jeanne de Bourgogne dans
l’épilogue du traducteur français a trompé quelque ancien possesseur de
ce manuscrit, et l’a induit à attribuer à la composition de la
traduction une fausse date. Il a supposé que Jeanne de Bourgogne, la
femme de Philippe le Long, était ainsi désignée ; mais ce n’est pas
elle ; c’est Jeanne, fille de Robert II, duc de Bourgogne, mariée en
1313 avec le Dauphin Philippe II de Valois, qui régna de 1328 à 1350.
Jeanne mourut en 1348. Ce qui précède ressort manifestement de la
mention suivante, qui dans l’épilogue est faite, de Lainsne
fil dou bon roy de France et de Madame Bonne sa
compaigne. Le Dauphin Jean (plus tard Jean le
Bon, prisonnier à la bataille de Poitiers) est le fils aîné, qui, en 1332, épousa Bonne, fille de Jean de
Luxembourg, l’aveugle et héroïque roi de Bohême, tué à la bataille de
Crécy. Elle mourut en 1349, un an avant l’avènement de son mari au
trône, après avoir eu plusieurs enfants de lui, et c’est pourquoi cette
traduction doit avoir été faite entre 1332 et 1348, et probablement vers
cette dernière année à raison de la mention des enfants de Madame
Bonne445. »
M. Robert ayant adopté la date de 1333, le bibliophile anglais, sur ce seul point, est un peu en désaccord avec lui ; mais je ne veux pas me livrer sur ce petit détail à une discussion qui serait oiseuse, et je reviens aux fables de Walther.
Elles sont toutes précédées de miniatures à peu près pareilles à celles du manuscrit de la Bibliothèque nationale, peut-être même {p. 573}un peu plus fines, et respectivement suivies de leur traduction en vers français. L’épimythion des fables de Walther, qui ne se compose presque toujours que d’un simple distique élégiaque, est partout, comme dans le manuscrit 1594, augmenté de deux autres au moins. Voici ceux qui ont été ajoutés au texte primitif de la fable De Gallo et Jaspide :
Stultorum numerus infinitus solet esse ;Stultus stulticiam monstrat ubique suam :Longe satis melior solet esse status sapientumQuam fatui stolidis non solet esse status.
Comme dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale, les cinq fables qui portent les numéros xlvii, lxi, lxii, lxiii et lxiv ont été substituées au texte de Walther, et, comme l’écriture en est intacte, je pourrai, en les publiant dans le second volume de cet ouvrage, reconstituer les vers que M. Robert n’avait pas pu entièrement déchiffrer.
Les fables de Walther sont terminées par cette
souscription : C’est la substance de ce
romans.
Puis vient un épilogue, qui, composé de 84 vers
français, commence par les quatre suivants :
Or vous ai conté mainte fable,Ou maint bon mot et profitable •Puet chacun oïr et entendre,Qui a la fin se voudra prendre.
Après les fables de Walther arrivent celles d’Avianus. Elles sont précédées d’un prologue de trente vers qui est intitulé Addition, et qui commence ainsi :
Or vous ai des fables aprinsesQui en Ysopet furent prinses.Auionnet un autre liureDautres bonnes fables vous liure.
L’écriture de cet épilogue est en aussi bon état que le reste et permet de reconstituer les vers 66, 67, 68 et 72, que, vu l’état du manuscrit 1594, M. Robert n’avait pas pu lire complètement.
Ce prologue est suivi de dix-neuf fables latines,
accompagnées de leur traduction en vers français. Ce sont les mêmes que
celles qui forment la seconde partie du manuscrit 1594 de la Bibliothèque
{p. 574}nationale. Ainsi que l’annoncent les premiers vers du
prologue, ces fables, sauf la dernière, sont toutes tirées d’Avianus.
Aussi portent-elles ce titre général : Ci commence le
liure Auionnet.
Elles sont suivies de l’épilogue en 86 vers que j’ai déjà transcrits dans mon analyse du manuscrit 1594. Il est complet et contient le vers, que, dans ce dernier manuscrit, le copiste a oublié ; ainsi, après le vers :
Si comme ruth la courtoise,
on lit le suivant :
Qui fut dame sans nulle boise.
Il s’ensuit que, si les deux manuscrits ont été écrits par le même copiste, celui de la Grenville library n’est pas la copie de l’autre. L’hypothèse inverse n’aurait rien d’invraisemblable.
B. Manuscrit XXXVII. §
Le manuscrit XXXVII, qui renferme les soixante fables de Walther, forme un volume in-folio, admirablement conservé dans une superbe reliure en maroquin vert. Il se compose de 32 feuillets en parchemin portant une belle écriture du xive siècle et de deux feuillets blancs et neufs, également en parchemin, que le relieur a placés, l’un au commencement, l’autre à la fin.
Les 60 fables de Walther, contenues dans ce manuscrit, ne portent aucun titre ; mais chacune d’elles est suivie d’une glose très différente de celle des autres manuscrits.
Celle du prologue, ainsi qu’on l’a déjà vu, est particulièrement intéressante : elle fournit une base à la thèse de ceux qui veulent faire de Salon l’auteur des fables élégiaques. J’en ai donné plus haut des extraits qu’on trouvera aux pages 480 et 482 de ce volume.
Les 60 fables se terminent par cette souscription à l’encre
rouge : Explicit Esopus cum expositione.
Enfin au-dessous une main plus récente a tracé ces deux mots : Deo gracias.
3º Bibliothèque du Lambeth palace. §
Manuscrit 431. §
Ce manuscrit consiste dans un volume in-4º de 241 feuillets en parchemin résultant de la réunion sous la même reliure de plusieurs cahiers contenant vingt-six œuvres distinctes.
Les écritures de ces cahiers dues à des mains diverses sont à longues lignes. Toutes appartiennent au xive siècle.
L’un des cahiers renferme, fort lisiblement écrites, les fables de {p. 575}Walther qui commencent au feuillet 116 b du volume et se terminent au feuillet 136 b.
Elles sont au nombre de soixante-deux, composées des
soixante authentiques et des deux intitulées : De
Capone et Accipitre
et : De Pastore
et Lupo.
Comme cela se rencontre fréquemment, elles ne portent pas de titre initial ; mais chacune d’elles est pourvue de son titre spécial écrit à l’encre rouge.
Elles ne sont accompagnées d’aucun commentaire.
À la suite de la dernière on lit :
Ysopus est herba, sed ysopus dat bona verba.Sit tibi, Christe, laus, quoniam liber explicit iste.Finito libro frangamus ossa magistro.Nomen meum non pono, quia me laudare nolo.Qui scripsit scribat ; semper cum domino vivat.Vivat in celis semper cum domino felix.
Au-dessous de ce galimatias dont elle n’est séparée que par une ligne blanche, vient cette souscription :
Explicit liber Exopi deo gracias. Amen.
Le cahier dans lequel sont les fables de Walther, est complété par le poème d’Eva columba, qui commence au haut du feuillet 137 a et finit au milieu du feuillet 141 b. Il a dû appartenir à un noble personnage ; car le bas de la page est rempli par un écu colorié portant un Lion rouge barré par une sorte de branche diagonalement placée. Au-dessous de l’écu, on lit, sous la forme d’un vers pentamètre, la devise suivante :
Singula cum ualeant sunt meliora simul.
4º Bibliothèque Bodléienne. §
A. Manuscrit Canonicus latinus 80. §
Ce manuscrit, qui dans les Canonici latini porte le nº 80, est un petit in-fol. de 65 feuillets en parchemin, qui renferme les trois ouvrages suivants : 1º Fabulæ anonymi, 2º Præcepta rethorica, 3º Boëtius de consolatione philosophiæ.
Ce sont les fables de Walther qui sont désignées par les
mots Fabulæ anonymi
. Ecrites en gros caractères par une
main habile du xive siècle, elles occupent
les feuillets 2 à 19. Aucun titre général {p. 576}ne
les précède, et l’espace blanc laissé pour le titre entre chacune d’elles
n’a pas été rempli. Seule la première lettre du préambule est ornée d’une
belle miniature que le temps a malheureusement effacée. Les fables, au
nombre de 62, se terminent par ces mots : Explicit
liber exopi : Deo gratias.
B. Manuscrit Canonicus latinus 127. §
Le manuscrit qui dans les Canonici latini
porte le nº 127, est un volume in-4º, dont les soixante-quatre feuillets
sont occupés par deux ouvrages intitulés, le premier : Exopi fabulæ
, le second : Glosa in
poëtica Horatii
, et écrits en gothique italienne du
xive siècle, le premier sur parchemin,
le second sur papier.
L’ouvrage appelé Exopi fabulæ consiste
dans 62 fables, comprenant les soixante fables de Walther et les deux
fables qui y sont ordinairement ajoutées et qui sont intitulées, l’une :
De Capone et Accipitre
, l’autre :
De Lupo et Pastore.
Remplissant les feuillets 2 à 23, elles sont précédées de
ce titre : Incipit liber Exopi
, et
suivies de ce vers final qu’on employait souvent au moyen âge, mais qu’une
interversion de mots a rendu faux :
Finito libro laus sit et gloria Christo !
C. Manuscrit Canonicus latinus 128. §
Le manuscrit qui dans les Canonici latini porte le nº 128, est un volume in-4º qui ne se compose que de 20 feuillets, partie en parchemin et partie en papier.
Il ne renferme pas d’autre ouvrage que les fables de Walther qui remplissent les feuillets 1 à 19. Ces fables, dont l’écriture est du xve siècle, sont au nombre de 61, et comprennent les 60 fables ordinaires et la fable De Capone et Accipitre, qui, étant incomplète et s’arrêtant à ce vers :
Non amat insontes, sed sontes aula tiranni,
donne lieu de penser qu’un feuillet manque au manuscrit.
En guise de titre général, les fables sont précédées de cette invocation pentamétrique, placée en tête de la première page :
Adsit principio virgo beata bono !
Au bas de la première page se lit cette espèce d’hexamètre encore plus barbare :
Exopus est herba. Exopus dat bona verba.
D. Manuscrit Digbey 26. §
{p. 577}Le manuscrit qui dans le fonds
Digbey porte le nº 26, est un vol. du petit format in-4º, dont les
feuillets sont en parchemin et dont l’écriture paraît être du xive siècle. Il renferme les 60 fables de Walther,
qui commencent au feuillet 98 a et finissent au
feuillet 118 b. Le titre qui a été écrit au bas du
feuillet 97 b, est ainsi conçu : Incipit liber qui vocatur Esopus.
La fin des fables est
annoncée par ce vers faux qui était usuel au temps du copiste :
Laus tibi sit, Christe, quando liber explicit iste,
et par cette phrase écrite un peu plus bas : Explicit liber fabularum qui dicitur Esopus.
E. Manuscrit 496. §
Le manuscrit 496, qui autrefois dans le fonds Bodley portait le nº 2159, est un volume in-4º, qui se compose de 349 feuillets en papier et dont l’écriture est du xve siècle.
Les fables de Walther qu’il contient occupent les feuillets 192 b à 203 b, et sont au nombre de 62, comprenant les 60 fables primitives et les deux qui en sont le complément ordinaire.
Aucun titre général ne les surmonte ; mais la fin en est
annoncée d’abord par cette phrase écrite à l’encre rouge : Expliciunt fabule Ysopi
, et ensuite au-dessous
par ce vers léonin écrit à l’encre noire :
Explicit explicite quidquid liber implicat iste.
5º Bibliothèque du nouveau collège à Oxford. §
Manuscrit CCLXIX. §
Le nouveau collège à Oxford possède un manuscrit de Walther sous le nº CCLXIX. C’est un volume in-4º, qui se compose de 44 feuillets en parchemin et dont l’écriture est du xve siècle. La première partie du manuscrit est consacrée à une œuvre bucolique de Pétrarque, comprenant douze églogues.
Puis viennent les fables de Walther, qui commencent au
feuillet 32 et se terminent par les mots : Explicit
liber Isopi.
6º Bibliothèque Phillips. §
Cette bibliothèque renferme cinq manuscrits des fables de Walther sous les numéros 215, 1694, 2869, 3121 et 10624.
A. Manuscrit 215. §
Ce manuscrit a la forme d’un petit in-8º allongé dont les feuillets sont en parchemin et dont l’écriture est du xiiie siècle. Il comprend trois ouvrages, savoir : les distiques de Denys Caton, les fables d’Avianus, celles de Walther.
{p. 578}Les distiques de Denys Caton,
précédés de la dédicace à son fils, commencent au
feuillet i a et sont terminés au bas du
feuillet xi b par cet hexamètre usuel :
Finito libro sit laus et gloria
Christo.
Au haut du feuillet xii a commencent les fables d’Avianus, qui se terminent vers le haut du feuillet xxiii a.
Immédiatement après viennent, également sans titres général
ni spéciaux, les soixante fables authentiques de Walther, qui, commençant
au feuillet xxiii a, sont, au
feuillet xxxviii et dernier, closes par ces deux mots :
Explicit Esopus.
B. Manuscrit 1694. §
Ce manuscrit consiste dans un volume in-4º de grand format composé de 190 feuillets en parchemin, chiffrés par pages, dont l’écriture est à deux colonnes.
Il contient de nombreux ouvrages en prose et en vers et
notamment les fables de Walther, qui, au bas de la 2e colonne de la page 200, sont annoncées en ces termes : Incipit liber hisopi.
Les fables sont dépourvues
de titres particuliers et ne sont accompagnées d’aucune glose. Elles ne
sont pas au complet : après celle de l’Épervier et du Rossignol qui est la
quarante-cinquième, le copiste n’a pas poursuivi son travail.
Le manuscrit renferme la fable De Lupo et Opilione qui commence au haut de la première colonne de la page 370. Quoiqu’elle ait déjà été publiée, notamment par MM. Jacob Grimm446 et E. Voigt447, en ayant reconnu ici les leçons généralement bonnes, j’en ai pris copie dans l’intention d’en donner une édition nouvelle.
En sus des 190 feuillets du manuscrit, il y a, à la suite,
un feuillet en parchemin plié en deux à cause de sa grande dimension et
couvert sur les deux faces d’une écriture aussi ancienne que celle qui
précède. Cette pièce est intitulée : Ad Paulinum
Augustinus
, et commence par ces mots : Apostolus Paulus ad Timotheum scribens
, etc.
C. Manuscrit 2869. §
Ce manuscrit, qui, à tort classé dans les in-folio, est du format in-4º, ne se compose que de vingt-quatre feuillets en parchemin, dont l’écriture italienne à longues lignes est du xive siècle.
Le premier feuillet et le dernier sont blancs.
{p. 579}Le volume ne contient que les fables de Walther qui occupent les feuillets 2 a à 23 b.
Sans titre général, elles sont précédées du prologue qui lui-même ne porte pas de titre particulier. Chaque fable en revanche est ornée d’un titre spécial et d’une initiale à l’encre rouge.
Le texte n’est accompagné d’aucune glose.
Les fables se composent des soixante authentiques, et des deux complémentaires suivies elles-mêmes de la fable en vers hexamètres De Pueris ludentibus qui, ainsi qu’on l’a vu, se rencontre quelquefois à la fin des manuscrits de Walther.
Le tout est terminé par cette souscription : Explicit Esopus. Deo gratias. Amen.
D. Manuscrit 3121. §
Ayant dû, lorsque j’ai passé en revue les manuscrits du Romulus ordinaire, décrire ce manuscrit qui en contient une copie, je ne puis maintenant que me référer à l’analyse que j’en ai faite. Je me contente de rappeler qu’il renferme les soixante fables authentiques suivies des deux complémentaires.
E. Manuscrit 10624. §
Ce manuscrit qui porte aussi la cote 13835, est un grand in-fol., dont les feuillets, au nombre de 62, sont en parchemin et dont l’écriture à trois colonnes est du xiiie siècle.
D’après la table manuscrite placée en tête, il renferme onze ouvrages, dont les fables de Walther, comprenant les soixante-deux ordinaires, forment le douzième.
Elles commencent à la première colonne du feuillet 58 b, ne portent pas de titre général, ni de titres
particuliers, ne sont accompagnées d’aucun commentaire et se terminent
vers le haut de la troisième colonne du feuillet 61 b
par les mots Explicit Esopus
.
§ 5. — Autriche. §
Bibliothèque impériale de Vienne. §
Je n’ai trouvé en Autriche que quatre manuscrits des fables de Walther ; encore deux seulement sont-ils complets. Ils appartiennent à la bibliothèque impériale de Vienne.
A. Manuscrit 303. §
Je donnerai plus loin, d’après M. Endlicher, la nomenclature des ouvrages contenus dans le manuscrit 303. Quant à présent, je me contente de dire qu’elle comprend les fables de Walther qui s’étendent du feuillet 12 b au feuillet 22 b.
{p. 580}Elles sont au nombre de 60. En
marge du prologue en vers se trouve une sorte de préface ou commentaire en
prose, qui donne le vrai nom de l’auteur. En voici le texte :
« Incipit Esopus. Materia huius libri duo continet in se :
scilicet iocum qui ostenditur per fabulas et vtilitatem que ostenditur
per (x)ii versus proverbiales qui quamlibet fabulam
determinant in fine. Quod autem ille submiscet iocum sapiencie ostendit
per primos duos versus sui libri, ubi dicit : Ut iuuet et
pro. Dulcius arrident. Intencio eius est nos invitare et hortare
ad librum suum legendum. Vtilitas est vt perlecto libro conprehendamus
per intelligenciam quod auctor edidit per doctrinam. Ethice subponitur :
tractat enim de moribus. Titulus ei talis est : Incipit
Esopus, quod non fuit nomen compositoris, sed Waltherus. Vt autem
eius liber honestius reciperetur, intitulauit eum hoc nomine, quod nomen
forsan cuiusdam nobilis vel sumptum ab isopo ; quod nomen appellatiuum
est cuiusdam herbe ad similitudinem, quod isopus bonus est et varios
reddit odores ; sic iste liber varias reddit vtilitates ; quod ipse
ostendit dicens : Ortulus iste parit. Et his
prelibatis accedatur ad librum : primo proponit : Vt
iuuet, et inuocat : Verbula sicca, deus, et
narrat : Cum rigido. »
Ce n’est pas seulement le prologue qui est ainsi accompagné d’un commentaire ; les fables 1 à 6 et 8 à 17 sont également pourvues d’une paraphrase placée en tête de chacune d’elles.
B. Manuscrit 639. §
Le manuscrit 639 a été écrit sur parchemin par une main du xive siècle.
Quoiqu’il se compose de 201 feuillets, il ne présente que quelques courts fragments des fables de Walther contenus seulement dans le dernier feuillet, savoir : 1º la fin de la fable De Cive et Milite, à partir du vers :
Prædicitque minas frontis utrumque jubar.
2º la fable De Patre et filio, tout entière.
Au-dessous on lit : Explicit Esopus :
deo gratias : amen.
C. Manuscrit 4268. §
Le manuscrit 4268 est un volume in-4º, dont les feuillets en papier portent une écriture du xve siècle. Il comprend 226 feuillets écrits et 6 laissés blancs.
Les 60 fables de Walther qu’il renferme, commencent au
feuillet 164 a, où elles ont pour titre le seul mot
Esopus
. Elles ne sont chargées
d’aucune glose ni marginale, ni interlinéaire, et se terminent {p. 581}au recto du feuillet 190. La fin en est indiquée d’abord
par cette sorte d’hexamètre :
Explicit Esopus ; qui scripsit sit benedictus,
au-dessous duquel cet autre se lit encore :
Finito libro sit laus et gloria Christo.
Enfin plus bas la date à laquelle la copie a été
exécutée, est énoncée en ces termes : Anno domini mo iiiio xxxii.
D. Manuscrit 12881. §
Le manuscrit 12881 ne se compose que de deux feuillets en parchemin du format in-8º.
C’est un fragment d’un manuscrit du xive siècle, qui contenait la collection complète des fables de Walther et dont il n’est resté qu’un double feuillet comprenant les suivantes :
1º De Leone et Mure, moins les trois premiers vers,
2º De Miluo ægrotanle,
3º De Lino et Hyrundine,
4º De Populo atthico regem eligente,
5º De Ranis regem habere volentibus, fable dont il ne reste que le premier vers,
6º De Rustico et Angue,
7º De Ceruo et Oue,
8º De Musca et Caluo,
9º De Vulpe et Ciconia,
10º De Capite et Lupo,
11º De Graculo et Pauone, fable dont il ne reste que les sept premiers vers.
Les nombreuses variantes que ces fables présentent font regretter que la collection ne soit pas complète.
§ 6. — Belgique. §
Bibliothèque royale de Bruxelles. §
La bibliothèque royale de Bruxelles possède les fables de Walther dans deux manuscrits portant les cotes 2519 et 11193.
A. Manuscrit 2519. §
Le manuscrit 2519 forme un volume in-4º de 138 feuillets en
papier, dont l’écriture est du xve siècle.
Ces {p. 582}feuillets sont précédés d’un autre en parchemin, sur le
recto duquel le contenu du volume est indiqué dans les termes suivants :
« In hoc libro continentur : Albertanus de consolatione et
consilio, Item de amore et dilectione Dei et proximi, Item de doctrina
dicendi et faciendi, Et Esopus. »
Le nom d’Esopus, qui figure dans cette nomenclature, est donné aux fables
de Walther qui occupent les feuillets 89 a à 138 a. Ces fables, au nombre de soixante, sont accompagnées
d’un commentaire, qui, comme presque tous les autres, attribue leur texte
latin à l’empereur romain du nom de Romulus. Au bas du feuillet 138 a on lit ces deux vers rythmiques :
Explicit liber iste.Infande lumen, Criste.
À la fin du volume on a, comme au commencement, ajouté un
feuillet en parchemin, qui porte cette mention : Est
liber hic sancti Martini louaniensis.
B. Manuscrit 11193. §
Le manuscrit 11193 forme un petit volume in-4º. Par le
texte latin, par la traduction en vers français du xive siècle qui l’accompagne, par son titre qui est ainsi
conçu : « Compilatio Ysopi alani cum auionetto cum quibusdam
addicionibus et moralitatibus »
, par les additions faites au
prologue et aux épimythions, par les cinq fables substituées aux fables
ordinaires, par l’addition de dix-neuf autres tirées d’Avianus, enfin par
les dessins ombrés qui illustrent chaque fable, il est absolument
identique aux manuscrits 1594 du fonds français de la Bibliothèque
nationale et XIII de la Grenville library. Cela me dispense d’en donner la
description.
Sans les variantes qu’offre le texte latin, je croirais que les trois manuscrits émanent du même copiste. Mais, si ces variantes sont trop nombreuses pour que j’insiste sur cette hypothèse, je suis au contraire persuadé que les deux manuscrits de Bruxelles et de Londres sont sortis de la même main. Ils ont d’ailleurs entre eux une ressemblance plus grande due à leur format identique et plus petit que celui du manuscrit de Paris.
Quant aux dessins, ils me paraissent, dans les trois manuscrits, devoir être attribués au même dessinateur.
Le manuscrit de Bruxelles se compose de 134 feuillets. Dans ce nombre sont compris deux feuillets blancs, qui le terminent et dont le second a été ajouté par le relieur.
{p. 583}Au verso du feuillet 132, une
main moins ancienne que celle du copiste primitif a écrit ce qui suit :
« C’est le liure des fables de Ysope mora||lise en latin et en
franchois ou il y a || quatre-vingt et trois histoires Lequel || est à
mons. Charles de Croy comte de Chimay. Signé : Charles. »
§ 7. — Espagne. §
1º Bibliothèque nationale. §
Cette bibliothèque possède deux manuscrits des fables de Walther.
A. Manuscrit A. 163. §
Ce manuscrit, qui seul a été signalé par Haenel, forme un vol. in-4º de 41 feuillets en parchemin dont l’écriture est la gothique du xive siècle. Ils sont précédés d’un feuillet également en parchemin, ajouté après coup et non paginé. Le relieur a en outre placé trois feuillets blancs en papier au commencement du volume et trois à la fin.
Le manuscrit ne comprend que deux ouvrages.
Le premier est la collection des épigrammes de Prosper. Il
est précédé d’une table, que surmonte ce titre : Hec est tabula
totius libri
, et qui occupe le feuillet non paginé.
Les feuillets 1 et 2 a sont remplis par
la préface des épigrammes, qui ne commencent au feuillet 2 b qu’après cet avertissement : « Iste Prosper fuit
equitanicus (sic), eruditissimus omniumque artium dogmate peritus, qui
primiter canonicam normam, sacre religionis instanciam, omnibus
ecclesiis edidit (normam). Unde merito equitanicus dicitur gente et
prosper vocabulo, quia ceteris equitatis viam parare studuit, quam in
vocabulo prosperitatis sortitus fuit. Ob hanc causam merito et nomine
fulget, eo quod equitatis et prosperitatis judicium omnium ecclesiarum
videtur habere. »
Puis viennent les épigrammes débutant par ce
vers :
Hæc Augustini ex sacris epigrammata dictis.
Elles se terminent au recto du feuillet 25 par ce pentamètre :
Una sit, atque duo spiritus unus alit.
Au-dessous on lit cette souscription : Explicit liber Prosperi deo gracias, amen
, et plus bas
cette autre : Manus scriptoris salvetur omnibus oris.
Amm̄m.
{p. 584}C’est au verso du feuillet 25 que commencent les fables de Walther, dont l’écriture est la même que celle des épigrammes.
En tête une main un peu moins ancienne a écrit ce titre :
Garicii prologus
, dont il a été
question à la page 488 de ce volume.
Les fables, accompagnées de quelques gloses, sont au nombre de soixante-deux comprenant les 60 ordinaires et les deux fables De Capone et Accipitre et De Pastore et Lupo.
Quelques-unes au commencement ont été pourvues de titres à l’encre rouge.
Elles se terminent au verso du feuillet 41 par cette
souscription : Explicit liber Esopi. Deo gracias.
Amen.
Le texte manque de pureté et les fautes qu’on y aperçoit démontrent que le copiste ne devait avoir aucune connaissance de la langue latine.
B. Manuscrit 110. §
Ce manuscrit forme un volume in-4º dont les feuillets en papier sont au nombre de 120 et portent une écriture du xve siècle.
Il contient deux ouvrages.
Le premier est un poème religieux qui occupe les 80 premiers feuillets.
Le second n’est qu’un fragment de l’œuvre de Walther, comprenant le prologue, les 57 premières fables et la 58e jusqu’au vers suivant :
Hic silet ; argus init stabulum bobusque ministrat.
Au-dessous de ce vers on lit cet autre bien connu :
Finito libro sit laus et gloria Christi (sic),
que suit le mot Amen
.
Cette souscription, due à une main ancienne, démontre que les feuillets
qui portaient la fin de la fable inachevée et les dernières, ont dû
disparaître de bonne heure.
Le relieur a placé deux feuillets blancs en tête du volume et trois à la fin.
2º Bibliothèque de la « Academia della Historia ». §
Manuscrit 45. §
Ce manuscrit forme un volume in-4º, dont les feuillets en papier contiennent seulement les 60 fables de Walther et les deux complémentaires.
Elles commencent au recto du premier feuillet par ce
titre : {p. 585}Incipit liber esopi.
Elles portent des titres à l’encre rouge, mais ne sont accompagnées
d’aucune glose.
L’écriture qui est la ronde italienne du xve siècle est fort belle.
Au bas du recto du premier feuillet on lit : Collegii Soc. Jesu d. Ignatii, Pollentini.
Au feuillet 23 b l’œuvre de Walther se
termine par cette souscription : Bononie G. Monet.
Scripsit 1476
, et plus bas on lit : Finis.
Au-dessous du mot Finis une autre main a
écrit le titre et les deux premiers vers de la fable hexamétrique :
De pueris ludentibus.
Enfin viennent quatre derniers feuillets, les deux premiers blancs et les deux autres portant au verso des écritures dénuées d’intérêt.
§ 8. — Hollande. §
Bibliothèque de l’Université de Leyde. §
Manuscrit xviii. 191. C. §
Le manuscrit xviii. 191. C, dont l’écriture est du xve siècle, se compose de 178 feuillets en papier et forme un volume du grand format in-8º. Il a appartenu au couvent de Saint-Jacques de Liège. Sur le catalogue de ce couvent, qui se trouve actuellement à la bibliothèque royale de Bruxelles, il porte le nº 534.
Il contient un grand nombre d’œuvres distinctes, dues à divers copistes. Les fables de Walther, qui ne s’y trouvent que partiellement, occupent les feuillets 159 a à 172 b. Il est vrai que ces feuillets portent les nos 189 à 202. Mais cela tient à ce que le manuscrit, avant d’être mis dans sa reliure actuelle, avait trente feuillets de plus, savoir : les 28 premiers du volume qui portaient les nos 1 à 28, et deux autres qui précédaient ceux occupés par le fragment conservé des fables élégiaques et qui devaient eux-mêmes porter les nos 187 et 188 et contenir une partie des quarante et une premières fables. Car l’ouvrage précédent est complet, et les deux feuillets perdus ne pouvaient s’y rapporter.
Le manuscrit avait renfermé à l’origine soixante fables. Les fables conservées sont d’abord les fables 42 à 60. La quarante-deuxième commence au deuxième vers ainsi conçu :
Hæc mouet, ut fiat esca Leonis Equus.
Celles qui la suivent sont complètes.
{p. 586}Ces 19 fables occupent 12 feuillets. La dernière se termine au milieu du recto du douzième feuillet. Le reste de la page est rempli par une fable en vers élégiaques composée seulement de quatorze vers. Je regrette de ne pouvoir la reproduire.
Le verso du douzième feuillet porte cette souscription :
Explicit Ysopus
, qu’une main plus
récente a corrigée en mettant un E au-dessus de l’Y. Puis on lit :
Finito libro reddatur gracio (sic) Christo.Heu, male finiui, quia non bene scribere sciui.Ast ego scripsissem melius, bene si potuissem.
Enfin au-dessous une main qui n’est pas non plus celle du
copiste du manuscrit a ajouté ces mots : Manus
domini.
Non seulement les cahiers qui contenaient les quarante et une premières fables de Walther, ont été presque entièrement détruits, mais encore le relieur a mis du désordre dans la partie sauvée. Il s’ensuit que les 13e et 14e feuillets renferment quatre fables, qui se trouvent après les 19 autres et qui devraient les précéder ; ce sont les fables xviii De Leone et Mure, xix De Miluo aegrotante, xx De Hirundine et Auibus, et xxi De Ranis depuis le commencement jusqu’au vers :
Ira Iouem mouit, regem dedit, intulit Ydrum.
§ 9. — Italie. §
1º Bibliothèque Vaticane. §
Manuscrit palatin. §
Parmi les manuscrits des bibliothèques italiennes, le premier auquel une mention soit due, est le manuscrit palatin. C’est un de ceux dont Névelet s’est servi pour composer sa Mythologia Æsopica448.
Ayant formé le projet de réunir dans une sorte de
répertoire général toutes les collections grecques et latines des fables
ésopiques, il s’en ouvrit à Jean Gruter, qui l’engagea à recourir aux
manuscrits de la bibliothèque palatine et aux éditions les plus anciennes.
C’est lui-même qui nous l’apprend dans sa dédicace à {p. 587}Pierre Névelet-Dosche son père449.
Il dit ensuite dans sa préface qu’il a puisé dans cinq manuscrits
différents cent trente-six fables d’Ésope encore inédites. Il ne faudrait
pas en conclure que c’est de ces cinq manuscrits qu’il a également extrait
les fables de Walther. La bibliothèque palatine n’en possédait qu’un
seul ; c’est du moins ce qu’atteste ce sous-titre placé sur le frontispice
de la Mythologia Æsopica : Accedunt…
anonymi veteris fabulæ, latino carmine redditæ LX ex exsoletis
editionibus et codice ms. luci redditæ.
Du reste, dans
ses notes sur les fables en vers élégiaques, Névelet ne signale toujours
qu’un seul manuscrit qu’il appelle Palatinus codex.
L’histoire de ce manuscrit est une véritable odyssée. D’où venait-il, lorsque Névelet l’a étudié à Heidelberg ? Je l’ignore. Ce qui est certain, c’est qu’il n’avait pas bien des années à rester dans cette ville. En 1622, les troupes bavaroises, l’ayant occupée, s’emparèrent de la bibliothèque dans laquelle se trouvait le manuscrit, et, quoiqu’elle appartînt non pas au gouvernement de l’électeur palatin, mais à l’Université d’Heidelberg, c’est-à-dire à une corporation indépendante dont le Saint-Siège lui-même avait autorisé la fondation, le duc de Bavière Maximilien en fit présent au pape Grégoire XV. Le savant Léo Allatius se rendit à Heidelberg en qualité de commissaire pontifical, y prit possession de la bibliothèque, et l’envoya à Rome, où elle forma, sous la dénomination de Bibliothèque Palatine, un des fonds de celle du Vatican.
Le manuscrit qui contenait les fables de Walther fut-il, à la fin du siècle dernier, au nombre de ceux qui, à la suite du traité de Tolentino, furent apportés à Paris ? Non ; car le catalogue de ces manuscrits a été publié450 ; il montre que les seuls manuscrits latins du fonds Palatin reçus à Paris étaient ceux portant les cotes 729, 854, 894, 912, 921, 1080, 1546, 1568, 1616, 1661, 1914 et 1969, et donnant le contenu de chacun d’eux, il n’en signale aucun comme renfermant des fables ésopiques. Au surplus, si celui qui nous occupe {p. 588}avait été apporté en France, il aurait, comme les autres, été rendu au pape.
En 1815, c’est-à-dire à l’époque où les souverains de l’Europe réclamaient toutes les richesses artistiques et bibliographiques que la guerre leur avait fait perdre, l’Université d’Heidelberg, quoique dépossédée depuis deux siècles, se mêla à ce concert de revendications. Elle sollicita l’appui du roi de Prusse pour obtenir du Saint-Père la restitution de sa bibliothèque, et, sur les ordres du roi, le chancelier d’État, le 31 octobre 1815, adressa à cet effet une note très pressante au cardinal Gonsalvi, secrétaire d’État pontifical, avec prière d’en porter le contenu à la connaissance de son souverain. Un arrangement ne tarda pas à intervenir. Il fut convenu que les manuscrits purement littéraires resteraient à Rome et que ceux qui offriraient un intérêt spécial à l’Allemagne, seraient au contraire restitués. Parmi ces derniers n’a pas figuré le manuscrit des fables de Walther, qui fut ainsi définitivement laissé au Vatican et qui s’y trouve encore aujourd’hui.
Dans ma première édition, je me bornais à affirmer l’existence de ce manuscrit au Vatican, et j’exprimais le regret de ne pouvoir le décrire. Aujourd’hui, grâce à la complaisance d’un érudit domicilié à Rome, le Père Ehrle, je peux en donner une analyse succincte.
C’est un volume in-4º qui figure sous le nº 1710 dans le fonds Palatin. Il se compose de 63 feuillets en parchemin qui renferment divers fragments d’ouvrages latins et dont les écritures sont les unes du ixe siècle, les autres moins anciennes. En voici le contenu :
1º Fol. 1ª à 24b. — Persius Flaccus.
— Satyræ.
2º Fol. 25ª à 47ª. — Prosper
Aquitanus.
— Epigrammata.
3º Fol. 47ª à 63b. — Ces feuillets sont
occupés par les fables de Walther, dont l’écriture est de la fin du
xiiie siècle ou du commencement
du xive et qu’une main du xviiie ou du xixe siècle a fait précéder du titre : Æsopi
fabulæ carmine.
Les soixante fables authentiques sont suivies des deux qui en sont le complément le plus fréquent.
La dernière, qui est la fable De Pastore et
Lupo, est suivie de cette phrase finale : Explicit liber Esopi. Deo gratias. Amen. D. M.
Au-dessous une main du xvie siècle a écrit ces mots : Reverendissimo
in Kpo patri domino Nicolino Cipriano.
2º Bibliothèque nationale du palais Brera. §
Manuscrit AD. 10. 43. nº 2. §
{p. 589}Le manuscrit AD. 10. 43. nº 2 n’a qu’une faible valeur philologique. C’est un petit volume in-4º, dont les feuillets sont en papier et qui renferme plusieurs ouvrages écrits à des époques très diverses. L’écriture des fables de Walther est du xiiie siècle. Le cahier qui les contient se compose de vingt feuillets. Le premier, qui est le douzième du manuscrit, est occupé au recto par des écritures insignifiantes et au verso par une glose due à une seconde main et relative à la fable De Gallo et Jaspide. Les fables commencent au recto du second feuillet ; elles ne sont précédées d’aucun titre général ; mais chacune d’elles est accompagnée d’un titre spécial écrit à l’encre rouge et de nombreuses gloses marginales ajoutées par une main moins ancienne. Elles sont au nombre de soixante-deux, comprenant les soixante ordinaires et les deux complémentaires De Capone et Accipitre et De Lupo et Pastore, qui par exception ont été placées immédiatement avant la soixantième.
Le catalogue de la bibliothèque du palais Brera renvoie pour plus amples renseignements à l’ouvrage suivant de Muratori : Antiq. Itat. medii ævi, t. III, Dissert. XLIV, col. 914.
3º Bibliothèque Ambrosienne. §
A. Manuscrit H. 28 supr. §
Le manuscrit H. 28 supr. forme un petit volume in-4º de 52 feuillets en parchemin, dont l’écriture est du xive siècle. Il contient quatre ouvrages, qui sont sur un premier feuillet en papier indiqués dans les termes suivants :
1º Poetica quædam incerta et antiqua (fol. 1 a).
2º Opusculum inscriptum De contemptu mundi (fol. 5 b).
3º Fabulæ Æsopi metricæ (fol. 20 b).
4º Vita Tobiæ carmine reddita (fol. 34 a).
Les mots Fabulæ Æsopi metricæ désignent
les fables de Walther. La collection qui commence au milieu du verso du
feuillet xx porte un titre général écrit à l’encre rouge et
ainsi conçu : Incipit liber Esopi.
Les
fables sont également pourvues de titres à l’encre rouge, et la
soixantième et dernière est terminée au milieu du recto du
feuillet xxxiv, non seulement par le distique connu, mais
encore par ce vers déjà bien des fois rencontré dans les manuscrits
précédemment analysés :
Finito libro sit laus et gloria Christo.
B. Manuscrit I. 85 supr. nº 3. §
Le manuscrit I. 85 supr. nº 3 {p. 590}forme un volume in-4º de grand format pourvu d’une reliure ancienne dont les plats sont en bois. Il se compose de 90 feuillets en papier dont l’écriture est du xve siècle et comprend, d’après la nomenclature qu’on lit sur un feuillet ajouté en tête, plusieurs ouvrages énumérés dans les termes suivants :
1º Catonis commentum (fol. 1 a à 5 b).
2º Prosperi Aquitanici carmina commentariis illustrata (fol. 6 a à 20 a).
3º Æsopi apologi et fabule commentariis explicate, anno 1415 scripte per Johannem Brixianum (fol. 24 a à 57 a).
4º Carmina Catoni adscripta, commentariis declarata (fol. 70 a à 82 b).
5º Guarini regule grammatice (fol. 83 a à 89 a).
Les fables qui forment le troisième ouvrage sont celles de Walther. Elles comprennent non seulement les soixante dont il est incontestablement l’auteur, mais encore les deux fables qui les suivent le plus souvent.
Elles sont accompagnées d’une glose très prolixe, dont le
début ressemble beaucoup à toutes les autres, mais, en ce qui touche le
véritable auteur des fables élégiaques, s’en distingue par une nouvelle
conjecture. Après avoir rappelé les hypothèses fournies par les autres
manuscrits, elle en reproduit une autre qui consiste à attribuer les
fables élégiaques à un moine de Faenza. J’extrais de la glose tout ce qui
concerne ce point : « Quidam dicunt quod Esopus fuit Atheniensis
grecus, et composuit librum quemdam in quo erant ex istis apologis ;
modo liber iste non erat notus aput (sic) latinos ;
Tiberius imperator rogavit magistrum Romulum, et quidam dicunt quod fuit
imperator Theorosius (sic), qui rogavit quemdam
Anglicum, ut componeret quemdam librum de quo haberentur delectatio et
utilitas. Iste vidit istum librum grecum et ipsum transtulit in latinum
et voluit appellari nomine autoris Esopi. Quidam autem dicunt quod
quidam fuit monacus Faventinus, qui volens fugere inannem (sic) gloriam istius mundi, hunc librum Esopi nomine
nuncupavit. »
J’aurais pu, dans ma dissertation sur le véritable auteur des fables élégiaques, signaler l’hypothèse nouvelle contenue dans l’extrait qui précède. Mais je n’avais pas, à mon sens, à en discuter d’autres que celles qui avaient été émises par mes devanciers. Mon seul but étant d’en démontrer la fausseté et de justifier celle que {p. 591}je leur ai substituée, je n’avais pas à en examiner une, dont aucun critique n’avait eu connaissance et qui me semblait n’avoir aucune vraisemblance. Je ferai d’ailleurs remarquer que la glose ne donne pas le nom du moine de Faenza qu’elle signale, et qu’elle paraît ne le signaler en termes d’ailleurs très vagues que pour reproduire, sans l’approuver, une supposition assez peu accréditée.
Les fables occupent les feuillets 24 a
à 57 a. Elles se terminent par cette première
souscription : Amen
, suivie de cette
seconde : Explicit liber Exopi. Deo gracias.
Amen.
Les feuillets 58 et 59 sont blancs.
Si prolixe que soit la glose qui accompagne les fables,
elle n’est pas la seule : il en existe une seconde qui est écrite sur deux
colonnes, et qui s’étend du feuillet 60 a au
feuillet 68 b. Due à la même main que la première,
elle n’est pas, sans doute pour éviter un double emploi, accompagnée du
texte auquel elle se rapporte. Elle se termine au milieu de la seconde
colonne du feuillet 68 b par cette première
souscription : Explicit Æsopus fabularum.
Au-dessous s’en trouve une seconde, dans laquelle le copiste se donne le
nom de Jean fils et déclare avoir achevé sa copie le 29 juillet 1415.
4º Bibliothèque Laurentienne. §
Manuscrit Strozzi LXXX. §
Dans la bibliothèque Laurentienne a été englobée la bibliothèque Léopoldine, qui comprenait elle-même divers fonds et notamment le fonds Strozzi.
Le catalogue de la bibliothèque Léopoldine, imprimé à Florence en 1792, signale à la page 413 un manuscrit des fables de Walther, qui, dans le fonds Strozzi, porte le nº LXXX. C’est un volume in-4º, dont les feuillets en parchemin, au nombre de 91, sont remplis par une belle écriture italienne du xiiie siècle.
Voici, telle qu’elle figure au catalogue, la nomenclature des ouvrages contenus dans le manuscrit :
1º Fol. 1 a. Donati prima Grammaticæ rudimenta, seu de Octo partibus orationis.
2º Fol. 29 b. Catonis liber.
3º Fol. 33 b. Prosperi Aquitanici liber.
4º Fol. 60 b. Magistri Tebaldi regulæ in duos Tractatus distributæ.
5º Fol. 73 a. Æsopi fabulæ latine redditæ, versibus elegis, etc.
Les fables de Walther, qui forment le dernier des ouvrages {p. 592}contenus dans le manuscrit, en occupent les feuillets 73 a à 91 a.
Elles se composent des soixante authentiques et des deux
complémentaires qui, dans le manuscrit, sont intitulées : De Ancipitre et Capone
et : De Pastore et Lupo.
Elles ne sont pas annoncées par un
titre général, sont seulement pourvues de titres particuliers à l’encre
rouge, ne sont accompagnées d’aucune glose et sont suivies de cette
souscription : Explicit liber exopi. deo
gratias.
5º Bibliothèque Magliabecchienne ou nationale. §
Manuscrit 1. 8. 45. §
Ce manuscrit consiste dans un volume in-4º, recouvert de parchemin, dont les feuillets aussi en parchemin sont au nombre de 99 et dont l’écriture italienne à longues lignes est du xive siècle.
Il renferme plusieurs ouvrages tant en prose qu’en vers, parmi lesquels les fables de Walther occupent les feuillets 69 a à 91 a.
Au haut du recto du feuillet 69 on lit d’abord cette invocation, qui, sous la forme d’un pentamètre léonin, était souvent, au moyen âge, placée par les scribes en tête de leurs copies :
Adsit principio virgo Maria meo !
Immédiatement au-dessous les fables sont annoncées par ce
titre : Incipit liber exopi.
Elles se
composent des soixante ordinaires et des deux complémentaires. Toutes sont
surmontées de titres à l’encre rouge. La quarante-huitième ne possède que
les trente vers authentiques. Les deux dernières sont intitulées :
De Ancipitre consulente Caponi
et :
De Pastore et Lupo.
L’ensemble est clos par cette souscription complexe :
« Explicit liber esopi Et ultimi voluminis liber, deo gratias. ||
Nomen non pono, quia laudare non volo. || Finis adest opere :
Scriptorem, christe, tuere. || Qui scrixit (sic)
scribat ; semper cum domino vivat. || Vivat in celis semper cum domino
felix. || Manus scriptoris salvetur omnibus oris. »
6º Bibliothèque Riccardienne. §
A. Manuscrit 350. §
Le manuscrit 350 est un volume in-4º, composé de 52 feuillets en parchemin dont l’écriture est d’une main italienne du xive siècle. Il y a bien à la fin un cinquante-troisième feuillet ; mais il a dû faire partie de la couverture, et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Le manuscrit renferme deux ouvrages.
{p. 593}Le premier, qui s’étend du
feuillet 1 a au milieu du feuillet 30 b, est visé dans les termes suivants sur un premier feuillet en
papier : Prosper Episcopus Reginensis. De vita
atciva (sic) et contemplativa.
Le second ouvrage consiste dans les fables de Walther, qui, partant du milieu du feuillet 30 b, s’achèvent au bas du feuillet 52 b.
Elles sont annoncées par ces mots à l’encre rouge :
Incipit liber Esopii (sic).
Grâce aux deux complémentaires, elles sont au nombre de 62. Les 49 premières sont pourvues de titres particuliers à l’encre rouge. L’espace blanc qui, en tête des suivantes, avait été ménagé pour les recevoir, n’a pas été rempli.
La fable xlviii, intitulée : De Viro defuncto et Uxore
, ne se compose que des trente
vers authentiques.
B. Manuscrit 607. §
Le manuscrit 607, volume in-4º composé de deux cahiers en parchemin de huit feuillets chacun dans une ancienne reliure à plats en bois, ne possède que les fables de Walther dues à un copiste italien du xive siècle.
Le recto du premier feuillet, en tête duquel elles
commencent précédées de ce titre général : Incipit
liber Esopi
, est orné sur la marge droite de trois
miniatures fort grossières.
Elles sont pourvues de titres particuliers à l’encre rouge,
et se terminent vers le bas du feuillet 16 b par ces
mots usuels : Explicit liber Exopi. deo gracias,
amen.
La fable xlviii ne comprend que les trente vers authentiques.
C. Manuscrit 630. §
Le manuscrit 630 est un in-4º, dont les feuillets, au nombre de 112, sont en parchemin et dont l’écriture, due à une main italienne, est du xive siècle.
Les ouvrages qu’il contient sont énumérés dans les termes suivants sur le premier des deux feuillets en parchemin placés par le relieur en tête du volume :
Fol. 1 a à 6 b. Carmen Catonis cum præfatione.
Fol. 7 a à 12 b. Carmen de contemptu mundi cum præfatione.
Fol. 13 a à 16 b. Prudentius. Liber Evæ Columbæ.
Fol. 17 a à 22 b. Carmen naturarum animalium.
Fol. 23 a à 28 b. Liber Æthiopi.
Fol. 29 a à 44 b. Liber vitæ scholasticæ.
Fol. 45 a à 64 b. Prosper S. Epigrammata.
{p. 594}Fol. 65 a à 80 b. Æsopus. Fabulæ.
Fol. 81 a à 112 b. Philippus de Florentia. Regulæ grammatices.
Les fables de Walther, auxquelles se rapportent les mots
Æsopus, Fabulæ, se composent des soixante authentiques
et des deux qui y sont le plus habituellement ajoutées, ne portent pas de
titre général, sont précédées chacune d’un titre particulier à l’encre
rouge et se terminent par cette souscription : Explicit liber Esopi.
La fable xlviii ne possède que les quinze distiques ordinaires.
D. Manuscrit 640. §
Œuvre d’un copiste italien du xive siècle, le manuscrit 640 se compose de vingt-quatre feuillets en parchemin du format in-4º et ne renferme que deux ouvrages.
Le premier, en vers hexamètres, commence, sans titre, au
haut du feuillet 1 a, mais se termine, au bas du
feuillet 6 a, par cette souscription qui révèle ce
qu’il est : Explicit liber Senece. Deo gratias.
Amen.
Le second ouvrage, qui commence au haut du feuillet 7 a, consiste dans les 60 fables de Walther suivies des deux
complémentaires, qui, dans le manuscrit, sont intitulées : De Accipitre et Capone
et : De Pastore dante Canes pro obs[ed]ibus Lupo.
Ces 62 fables ne sont précédées d’aucun titre général, mais
sont pourvues chacune d’un titre particulier à l’encre rouge. La
quarante-huitième, intitulée : De Viro mortuo et Uxore
sua
, ne comprend que les trente vers primitifs.
E. Manuscrit 725. §
Le manuscrit 725, composé de 64 feuillets en parchemin du format in-4º, offre une écriture italienne du xiiie siècle plus fine que celle des manuscrits précédents.
Voici, telle qu’elle figure en tête du volume, la nomenclature des ouvrages qu’il renferme :
1. Æsopi fabulæ.
2. De natura quorumdam animalium cum allegoria ad Cristum.
3. Liber Theodori : Eclogam continet inter Pseustim et Alethiam, hoc est, inter Errorem et Veritatem, etc.
4. Henricus Septimellensis.
Tous ces ouvrages sont en vers. Les fables de Walther, qui forment le premier, s’étendent du feuillet 1 a au feuillet 25 a, et, accrues des deux complémentaires, s’élèvent au nombre de 62. Elles ne portent aucun titre général, mais sont précédées chacune {p. 595}d’un titre particulier écrit à l’encre rouge. Toutefois l’espace blanc destiné à le recevoir n’a pas été rempli pour les onze dernières.
Comme dans les autres manuscrits de la même bibliothèque précédemment analysés, la fable xlviii ne comprend que trente vers.
La soixante-deuxième fable se termine au haut du
feuillet 25 a, où figurent seulement ses trois
derniers vers, au-dessous desquels se lit cette souscription : Explicit liber esopi deo gratias. amen
, suivie
elle-même de cette autre : Manus scriptoris salvetur
ab omnibus oris.
7º Bibliothèque Marcienne. §
A. Manuscrit LXXXVIII, Class. XII. §
Ce manuscrit est un très gros in-4º de très petit format,
dont les feuillets sont en parchemin et dont l’écriture est du xive siècle. De son ancienne cote N. CXVI qui est
rappelée au Catalogue il ressort qu’il a appartenu à la Bibliothèque de
Nani, et que c’est celui que Morelli a analysé dans son Catalogue
intitulé : Codices manuscripti latini bibliothecæ
Nanianæ
, et publié à Venise en 1776.
Voici, d’après le Catalogue de Saint-Marc, l’indication du contenu du manuscrit :
S. Prosperi epigrammata super S. Augustini sententiis.
Catonis liber distichorum.
Prudentii liber Evæ, sive columbæ.
Liber de contemptu mundi.
Æsopi fabulæ.
Theobaldi episcopi Physiologus.
Dialogus de virtute.
De differentia vocum carmen.
Les mots Æsopi fabulæ se rapportent aux fables de Walther qui occupent les feuillets 59 à 76.
Elles sont précédées d’observations préliminaires qui occupent le recto du feuillet 59 et les cinq premières lignes du verso et qui, différant sensiblement de celles offertes par les autres manuscrits, me paraissent, malgré leur longueur, devoir être ici transcrites :
Circa istum libellum quedam, id est, quinque sunt extrinsecus prelibanda. Videlicet que materia, que utilitas lectionis, cui parti phylosophye supponatur et quis sit libri titulus. Ad primum et per ordinem videamus : Materia istius libri est appologia siue fabule. Et dicitur apologia ab ypo, quod est retro vel supra, et logos, quod est sermo ; inde apologus, id est rectus vel supra sermo. Intentio auctoris est scribere ipsos appoll[og]os metricè ad informationem {p. 596}nostram et delectationem. Vtilitas lectoris est delectatio fabularum et instructio bonorum morum, et per hoc patet quod supponitur ethice, vel morali scientie, quia de moribus tractat. Et hoc est cui parti vel philosophie supponatur.
Libri titulus est talis : Incipit Esopus. Ysopus non dicitur primus, quia non sequitur secundus. Verumtamen diuiditur in duas partes, scilicet in prohemium et executionem. Incipit executio : dum fodit. Iste auctor, more aliorum poetarum, tria facit : Primo inuocat, secundo narrat, tertio proponit. Ubi dicit : Ut juuet et prosit, inuocat ; ubi dicit : Verbula sicca, narrat ; ubi dicit : Dum fodit, proponit.
Lictera (sic) gesta refert quod credas aligoria,Moralis quod agas, quod speres anagogia.Quattuor sunt expositiones sacre sancte scripture, una storialis, alie tres spirituales : prima allegorica, secunda moralis siue tropologi[c]a, tertia anagogica. Sicut sunt quatuor doctores, ita sunt quatuor expositiones. Primo exposuit beatus Jeronimus, secundo beatus Ambrosius, tertio beatus Gregorius, quarto beatissimus Augustinus. Storia dicitur ab storin quod est lictera, scilicet licteralis sensus. Allegorica dicitur ab aleon, quod est alienum, et gogos, quod est ductio, id est aliena ductio. Moralis dicitur, siue tripologiscus (sic) sensus dicitur a tropos, quod est conuersio [et logos quod est sermo. Anagogica dicitur ab ana quod est super], et gogos, quod est ductio, id est superna ductio, id est quando inferiora ad superiora, diuina gratia, reducuntur. Et dicitur quatuor. Istis moralibus tractat esopus in libro suo et ponit duos tantum : ponit licteralem et allegoricum sensum. Licteralem ponit in versibus qui continent fabulas ; allegoricum ponit in notabilibus versibus et illis quod credere non debemus.
À la suite de ces observations préliminaires commencent les
fables annoncées par ces mots à l’encre rouge : Incipit liber Esopi.
Elles se composent des soixante authentiques et des deux
complémentaires qui, dans le manuscrit, sont intitulées : De Caupone (sic)
, Domino et
Accipitre
et : De Pastore et
Lupo.
Elles sont revêtues de titres à l’encre rouge et se
terminent au bas du verso du feuillet 76 par cette souscription :
Explicit liber Esopi deo gratias.
Amen.
À la fin du manuscrit se trouve un double feuillet qui en
est indépendant et qui, ayant appartenu à une ancienne couverture, {p. 597}lui a survécu. On y lit : Iste grammaticalis siue notabilis est magistri Justi Guiduccii
olim..... Joannis de Gotthis de Vulterra..... emptus st. 3. aur. .....
May Mccccxxxj.
B. Manuscrit CXVII, class. XII. §
Ce manuscrit consiste dans un cahier in-4º de seize feuillets en parchemin, qui ne portent que les fables de Walther dues à un copiste italien du xive siècle.
Elles commencent au haut du recto du premier feuillet sans
titre général, mais sont munies chacune de son titre écrit à l’encre
rouge. Elles sont au nombre de soixante-trois et comprennent les soixante
authentiques, les deux complémentaires qui, dans le manuscrit, sont
intitulées : De Capone et Accipitre
et :
De Pastore et Lupo
, et que suit le
distique final ordinairement placé après la soixantième, enfin la fable
De Viro et Uxore adultera, qui possède après le
quatorzième vers le distique suivant, rarement conservé dans les autres
manuscrits et dans les éditions incunables :
Hec lacrimosa manet ; laniat sine fine capillos.Cui suadere volens vir suus inquit ei.
Cette dernière fable, qui se termine au verso du
feuillet xvie, est close par le mot
Amen
, au-dessous duquel est cet ex-libris : Iste liber est domini
Sebastiani de domo baduaria nobilis Venetarum.
De l’ancienne cote A.Z. nº 434 que le Catalogue rappelle, il ressort que le manuscrit a appartenu à Apostolo Zeno.
8º Bibliothèque de l’Université de Bologne. §
A. Fonds général. — Manuscrit 1213. §
Ce manuscrit qui ne renferme que les soixante fables de
Walther, est, avec celui du duc de Milan, le plus artistique qu’il m’ait
été donné de rencontrer. C’est un in-fol. composé seulement de dix-sept
feuillets en parchemin, mais rendu extrêmement précieux par une suite
ininterrompue de magnifiques miniatures qui en occupent les marges
largement ménagées pour elles. Ces miniatures sont au nombre de 146. Les
fables sont en outre précédées d’une miniature initiale qui représente
Ésope assis et devant lui trois auditeurs vus tous de profil. Au haut du
recto du dix-septième feuillet qui ne porte que le distique final :
Fine fruor
, etc., elles se terminent
par cette souscription : Deo gratias.
Amen.
B. Fonds S. Salvatore. — Manuscrit 2795. §
Ce manuscrit est un volume in-4º composé de vingt feuillets en parchemin remplis par une grosse et belle écriture italienne du xive siècle.
{p. 598}Il ne possède que les fables de
Walther annoncées par ce titre général à l’encre rouge : Incipit liber Esopi
, pourvues de titres
particuliers également à l’encre rouge et terminées par cette
souscription : Explicit liber Esopi. Deo gratias.
Amen.
Les fables, au nombre de soixante-trois, comprennent les soixante ordinaires auxquelles s’ajoutent les trois suivantes : De Domino, Accipitre et Capone, De Pastore et Lupo et De Pueris ludentibus.
9º Bibliothèque de l’Université de Ferrare. §
Manuscrit 216. NB. 1. §
Le manuscrit inscrit sous cette cote est un gros volume in-8º de très petit format. À en juger par le numérotage des feuillets, il a dû en comprendre 367 ; mais les 60 premiers ont disparu, de sorte qu’en réalité il n’en possède plus que 307. Ils sont en parchemin, et l’écriture qui les remplit est du xive siècle.
Voici, d’après le Catalogue de la Bibliothèque, les ouvrages qui s’y trouvent :
1º Æsopi Phrygii fabulæ ;
2º Item Catonis carmina moralia ;
3º D. Bonaventuræ pharetra ;
4º S. Augustini Episcopi Sermo de Solitudine ;
5º S. Thomæ de Aquino Tractatus de Prædestinatione.
Les fables dont il est question dans cette nomenclature sont celles de Walther qui occupent les 19 premiers feuillets (61 à 79, d’après le numérotage du ms.).
En tête du prologue on lit, en guise de titre général, ce pentamètre écrit à l’encre rouge :
Adsit principio virgo Maria meo !
Les fables munies de titres spéciaux à chacune d’elles,
également écrits à l’encre rouge, sont au nombre de soixante-deux. Les
deux dernières sont intitulées : De Capone et
Domino
et : De Pastore et
Lupo.
Elles se terminent a la huitième ligne du verso du
dix-neuvième feuillet par ces mots : Explicit liber
exopi. Deo gracias. Amen.
Elles sont immédiatement suivies d’un Commentaire latin
qui, commençant au feuillet 19 b, s’achève au bas du
feuillet 35 a (ff. 79 vº à 95 rº, d’après le
numérotage du manuscrit), où sa fin est indiquée par le mot Explicit
. Voici le début de ce Commentaire :
{p. 599}Theodosius imperator, vt fertur a nonnullis, rogauit quemdam magistrum Romulum, oratorem et philosophum precipuum, ut sibi componeret vnum librum de quo habeatur delectatio et utilitas. Qui reperiens hunc librum in grecum exaratum ab exopo greco de Athenis, translatum in latinum misit predicto imperatori, et noluit quod appellaretur nomine autoris ipsius. — Supponitur autem liber iste philosophie morali, vel ethice, que est eius pars, per quam gubernamus nos et amicos nostros, ut infra apparebit, vel politice, per quam gubernamus patriam nostram, et patebit in textu, vel vconomice, per quam gubernamus familiam nostram ; omnes doctrine istarum rerum patent in libro.
10º Bibliothèque royale d’Este à Modène. §
Manuscrit XII. F. 9. §
Ce manuscrit est un mince in-4º du xve siècle, formé de trois cahiers de papier, comprenant, le premier et le deuxième, dix feuillets chacun, et le troisième, seulement quatre.
Il ne renferme que les fables de Walther composées des soixante authentiques, des deux qui en sont le complément habituel et de la fable De pueris ludentibus. Elles occupent les deux premiers cahiers et les deux premiers feuillets du troisième.
Tout au haut du recto du premier feuillet, écrits en
lettres très fines, se lisent les mots yesus
maria
.
Le titre général est conçu en ces termes usuels :
Incipit liber esopi.
Les fables ne
sont encombrées d’aucune glose ; mais chacune a son titre spécial.
La fable xlviii De viro et uxore porte les quatre vers qu’on trouve quelquefois intercalés entre le vingt-sixième et le vingt-septième et qui montrent la veuve, pour rendre le cadavre de son mari plus conforme à celui du voleur, lui brisant les dents avec une lourde pierre.
Le manuscrit n’a guère de valeur ; il est l’œuvre d’un copiste qui ne connaissait ni la langue, ni la prosodie latines, de sorte que le texte est fort défectueux.
Au-dessous de la dernière fable, en lettres moins fines et
avec une encre plus noire ont été écrits les mots : Finis. laus deo. || τελως.
11º Bibliothèque de Parme. §
Manuscrit 686. §
Ce manuscrit du xive siècle est un in-4º, qui, après en avoir eu davantage, est réduit à trente feuillets en parchemin.
Il ne renferme que les fables de Walther, précédées, au
haut du {p. 600}recto du premier feuillet, d’une sorte de préface
dont voici le commencement : « Esopus atticus poeta qui fabulas
composuit ad vitam et mores hominum corrigendos. In quibus inducit
bestias et aues et cetera loquentes. volensque librum romulus quidam ad
suum filium tiburtinum de greco in latinum transtulit. Mortuus est
tempore quo Taquinus (sic) superbus regnabat apud
romanos. »
Les fables, ornées en partie de titres en lettres dorées, sont en outre accompagnées de quelques gloses interlinéaires.
Par suite de la disparition des derniers feuillets, elles ne vont que jusqu’à ce vingtième vers de la fable liv, c’est-à-dire de la fable du Chien et du Loup.
Quia (sic) nisi conditur, nil sapit esca mihi.
Aux trente feuillets du manuscrit il en a été ajouté, à la suite, deux de dimension moindre qui ont appartenu à un autre manuscrit de Walther. Le texte commence à ce cinquième vers de la fable xli dans laquelle est relatée l’histoire d’Androclès :
Vix egrum sinit ire dolor saniemque fatetur.
Il s’arrête à ce vers qui est le cinquième de la fable xlvi, De Vulpe et Lupo :
Ille refert : Pro me vigilat tua cura, precari…
12º Bibliothèque de Brescia. §
Manuscrit A. VI. 16. §
Ce manuscrit, du format in-4º, se compose de vingt-six feuillets en parchemin, dont l’écriture est du xiiie siècle.
Les vingt premiers contiennent les fables de Walther,
précédées de leur prologue, dépourvues de titre général, mais pourvues de
titres particuliers à l’encre rouge. Elles se composent des soixante
authentiques et des deux additionnelles qui, dans le manuscrit, sont
intitulées : De Capponibus et Ancipitre
et : De Lupo et Pastore.
À la fin de la
dernière on lit : Explicit liber Esopi deo gratias.
Amen.
Les cinq feuillets suivants sont occupés par le poème d’Eva columba, en vers hexamètres, annoncé en ces termes :
Incipit liber eue columbe.
Il est
formé, après un préambule de quatre vers, de quatrains précédés chacun
d’un titre à l’encre rouge.
Le recto du feuillet xxvi et dernier contient un opuscule écrit par une autre main.
§ 10. — Suisse. §
1º Bibliothèque cantonale de Berne. §
Manuscrit 688. §
Le manuscrit 688 est un volume in-4º de petit format, dont
l’écriture sur deux colonnes appartient au xiiie siècle. Il renferme plusieurs ouvrages dont le cinquième
consiste, non pas dans les fables de Walther, mais seulement dans leurs
affabulations. Elles sont précédées d’un titre à l’encre rouge ainsi
conçu : Incipiunt versus excerpti ab
Esopo
, et occupent les feuillets 61 b,
col. 1 à 62 b, col. 2.
2º Bibliothèque cantonale de Bâle. §
A. Manuscrit A. N. II. 12. §
Le manuscrit A. N. II. 12 appartenait déjà à la bibliothèque à l’époque où Haenel publiait ses catalogues ; cet éditeur l’avait mentionné sous la cote A. VI. 3, qu’il portait alors451. C’est un fort volume du grand format in-4º, dont la reliure est en bois et les feuillets en papier et qui renferme plusieurs ouvrages.
Les fables, dont l’écriture est du xve siècle, occupent les vingt-deux premiers feuillets.
Elles sont au nombre de soixante et une et se composent des soixante
authentiques et de la fable complémentaire De Lupo et
Pastore. Elles sont précédées du titre général suivant, qui est
écrit à l’encre rouge : Liber moralis Ezopi fœliciter
incipit.
Les titres spéciaux à chaque fable, laissés
d’abord en blanc par le copiste, n’ont pas tous été remplis : il en manque
plus de la moitié. Quant aux fables elles-mêmes, elles présentent des
variantes nombreuses et même des développements qu’on retrouve rarement
dans les éditions imprimées. Ainsi la fable xlviii
De Milite et Femina, contient, à la suite du
vingt-sixième vers, les quatre qui font voir la veuve brisant les dents de
son défunt mari et puis ceux de la vieille édition d’Ulm qui la montrent
lui arrachant les cheveux.
La fable lxi De Pastore et Lupo se termine au recto du feuillet 22. Pour en remplir le verso, le copiste l’a pourvu de la fable déjà rencontrée, De pueris ludentibus. Comme elle n’entrera pas dans l’appendice qui suivra les fables de Walther, je la transcris ici :
Ludentes pueri suspendunt ridiculoseUnum de sociis, quem servant absque dolore.Tunc lepus hac transit, pueri quem prendere currunt.Sed dolor immensus fuit illis cum rediere :{p. 602}Cernunt defunctum puerili ante (sic pro arte) ligatum.Artem non noscunt qua possint reddere vitam.Cum quid facturus sis, rerum respice finem ;Multa quidem risu fiunt portantia mortem.
Au-dessous de ce dernier vers on lit : Et sic finitur Æsopus.
Après viennent deux feuillets blancs dont le premier a été coupé et un cahier de 12 ffos également dépourvus d’écriture, que suivent d’abord les quarante-deux fables d’Avianus, puis divers poèmes tels que le Phisiologus de l’évêque Théobald et les distiques de Caton.
B. Manuscrit F. VIII. 1. §
Le manuscrit F. VIII. 1 m’a paru avoir moins d’importance que le premier. C’est un volume in-4º, dont le format est moins grand et dont l’épaisse reliure en bois est couverte en veau et garnie d’un fermoir. L’écriture, comme celle du premier manuscrit, est sur papier ; elle est certainement du xve siècle. En effet, un des ouvrages contenus dans le volume porte en souscription la date de 1460.
Les fables sont, au nombre de 62. Elles comprennent les deux complémentaires De Capone et Accipitre et De Lupo et Pastore. Contrairement au classement usuel, ces deux fables précèdent celle qui est intitulée De Cive et Milite et qui dans les manuscrits est ordinairement la soixantième. Ce classement semble donner raison à ceux qui les croient de Walther comme les soixante autres.
Comme dans le précédent manuscrit, les fables sont suivies de celle en vers hexamètres dont j’ai donné copie plus haut.
Éditions des fables de Walther. §
§ 1. — Éditions du XVe siècle. §
Si le nombre considérable des manuscrits de Walther atteste la faveur inouïe dont ses fables ont joui au moyen âge, le nombre aussi grand des éditions qui en furent publiées à la fin du xve siècle montre qu’elle avait continué à subsister pendant les premières années de la Renaissance. Pour simplifier ma tâche, je ne signalerai que les éditions datées.
1º Premières éditions. §
Si l’Allemagne peut revendiquer la première publication des fables du Romulus ordinaire, c’est à l’Italie que revient l’honneur des premières éditions des fables de Walther.
1473. §
Phrigi Æsopi philosophi moralitas e
Græco in latinum traducta.
Tel est le titre de l’édition
la plus ancienne que je connaisse. Elle a été imprimée à Rome en 1473,
dans le format in-4º. Les fables de Walther sont suivies de cette mention
finale : M.cccc.lxxiii. impressus libellus Rome in
domo nobilis viri Ioannis Philippi de Lignamine Messan. s. d. n.
familiaris anno eius tertio sexto mensis Novembris.
Cette
édition est signalée par Hain452 et par Brunet453.
1475. §
Deux ans plus tard une autre édition était également
imprimée à Rome. Elle forme un volume du grand format in-4º, composé de
vingt feuillets. Il porte au verso du premier feuillet la vie abrégée
d’Ésope. En tête du feuillet suivant se trouve ce titre : Phrygum philosophi Esopi moralitas de greco in latinum
traducta Incipit.
Puis viennent les fables élégiaques qui
sont au nombre de soixante.
La dernière est suivie de cette mention : Libellus Esopi fabulatoris maximi per me Vuendellinum de
uuilla in artibus Magistrum Romeque impressus Finit feliciter Anno
salutis Mcccclxxv. Die uero sexta Iulii.
La page qui
porte cette mention est complétée par une épitaphe en l’honneur d’Ésope,
composée de huit vers élégiaques surmontés de ce titre : Esopo Phrygio philosopho Pamphilius.
Cette édition est signalée par Hain454 et par Brunet455. J’en ai trouvé un exemplaire à la bibliothèque publique de Stuttgart.
1476. §
Aesopi fabulae latinis versibus
redditae.
À la fin : Monteregali per
Dominicum de Vivaldis eiusque filios die xvi.
Nouembris Mcccclxxvi.
{p. 604}Je ne connais pas d’exemplaire de cette édition signalée par Panzer (Annales typogr., t. XI, p. 332, nº 2 b) et par Hain (Repert. bibliog., t. I, p. 33, nº 292).
1479. §
Æsopi fabulae carmine
elegiaco.
À la fin : In Tuscolano Lacu
Benaci per Gabrielem Petri Tarvisinum Anno Mcccclxxviiij.
Je ne connais pas cette édition in-4 qui est citée par Panzer (Annales typogr., t. III, p. 57, nº 2) et par Hain (Repert. bibliog., t. I, p. 33, nº 293).
— Dans ses Annales typogr., t. I, p. 22,
nº 31, Panzer signale encore une édition d’écolier, publiée, comme toutes
celles destinées au même usage, dans le format in-4. Elle a été imprimée à
Strasbourg, en 1479 par Martin Flachen. Elle porte ce titre : Æsopus moralisatus cum bono commento et glossa
interlineari
, et se termine par cette souscription :
Impressus in nobili Argentina per me Martinum
Flachen civem Argentinensem, anno Mcccclxxviiij.
1481. §
Plusieurs éditions des fables élégiaques de Walther ont été imprimées en 1481.
— Dans son Repert. bibliog. (t. I, p. 33
et 34) Hain en cite deux qui me sont inconnues, l’une sous le nº 295 et
l’autre sous le nº 296. La première se termine par ces mots : Explect9 Esop9 ꝑ
dominicū de uiualdis una9 || filijs ī mōteregali
octaua madij mo cccclxxxi.
Elle est
du format in-folio et se compose de 30 feuillets. La seconde est
intitulée : Aesopi fabulae uersibus expressae ab
incerto auctore.
À la fin on lit : Brixiae. mcccclxxxi.
Elle est du format
in-4º.
— Je dois enfin une mention à une édition, dont j’ai déjà
parlé et que Morelli a prise pour base d’une fausse hypothèse sur le
véritable auteur des fables de Walther. Intitulée : Esopi fabulae
, elle se termine ainsi : Finit Esopus Mutine impressus impensa et opera Dominici
Rhochociola : per Thomam septemcastrensem et Ioannem Franciscum
socios : compositus per me Nicolaum Ienson. Anno Millesimo
quadringentesimo octuagesimo primo : die decima nona
Maii.
Cette édition, imprimée dans le format in-4º, a été signalée non seulement par Morelli, mais encore par Panzer (Annales typogr., t. II, p. 147, nº 7) et par Hain (Repert. bibliog., t. I, p. 33, nº 294).
1486. §
Dans son Manuel du libraire, 5e édition, t. I, col. 89, Brunet, avec une précision qui ne peut laisser aucun doute sur son existence, cite une petite édition gothique in-4 de 18 feuillets, sous les signatures a-b et à trente lignes par pages pleines. Elle a été achevée d’imprimer à Bologne par Ugo Rugerius, en 1486, le deuxième jour des calendes d’octobre.
1487. §
Panzer, t. I, p. 8, nº 31, signale dans les termes suivants
une édition in-4 qui a été imprimée à Anvers en 1487 : Aesopi Fabulae cum commento. Antverpiae 1487.
Elle est également citée par Bain, dans
son Repert. bibliog., t. I, p. 34. nº 302.
— Une autre édition in-4, publiée sans indication de lieu, est également indiquée par Panzer, t. IV, p. 43, nº 343, et par Hain, t. I, p. 34, nº 301.
1488. §
Aesopus cum commento.
À
la fin : Impressus ꝑ me Gerardū leeu. Anno domini
M.cccc.lxxxviij. decima qūrta die Maïj.
La bibliothèque du British Museum sous la cote C. 1. a. 4, la bibliothèque Bodléienne, sous la cote Douce 60 et la bibliothèque royale de Bruxelles, sous le nº 1529 substitué au nº 997, possèdent chacune un exemplaire de cette édition in-4 composée de 34 feuillets signés de A à E, ornée d’un double portrait d’Ésope sur les deux faces du premier feuillet, et terminée, au verso du dernier, par une gravure qui le recouvre entièrement et qui représente un édifice public.
2º Dernières éditions. §
Jusque-là les fables de Walther avaient en général été
publiées isolément. À partir de 1488, sans cesser de paraître seules, elles
sont réunies à d’autres ouvrages poétiques dans des éditions qui, à raison
de leur titre commençant généralement par les mots Auctores octo
, peuvent être appelées Éditions
des huit auteurs.
Dans ces éditions les fables de Walther sont accompagnées d’un commentaire très différent de celui qu’on rencontrait auparavant dans les éditions d’écolier.
{p. 606}Dans ces dernières, les fables de
Walther, avec les titres : Esopus moralisatus cum
commento
, et Esopus moralisatus cum
bono commento
, avaient quelquefois paru embarrassées d’un
commentaire et de gloses qui avaient toujours été les mêmes. Le commencement
du commentaire était la copie littérale de la préface du Dérivé complet du
Romulus anglo-latin dont on trouvera le texte dans le second volume de cet
ouvrage. Voici les premières phrases qui y faisaient suite :
« Antequam procedatur ad textum, aliqua sunt præmittenda. Et primo
de causis hujus libri. Unde notandum quod præsentis libri, sicut aliorum
librorum, quatuor sunt causæ, scilicet : materialis, formalis, efficiens
et finalis. Unde causa materialis, sive subjectum hujus libri, est sermo
fabulosus in respectu ad virtutes morales. Causa formalis est duplex,
secundum quod est forma, scilicet : forma tractatus et forma tractandi.
Forma tractandi est modus agendi, qui in proposito est metricus. Sed forma
tractatus consistit in compositione et explicabitur per continuas actiones
et divisiones. Causa efficiens dicitur fuisse Æsopus qui erat græcus ;
unde, ut fertur, præsens liber conscriptus erat in græco ; sed postea
jussu Rhomuli imperatoris Romanorum fuit translatus in latinum et hoc
propter filios ejus quos voluit instrui per doctrinas hujus
libri. »
Dans les éditions des huit auteurs le commentaire qui se
rencontre le plus fréquemment est aussi puéril et aussi incohérent ; mais il
a le mérite spécial de fournir un renseignement précieux sur l’auteur
véritable des fables, dont il indique à la fois le nom et la nationalité.
Aussi, malgré sa longueur, me semble-t-il opportun d’en transcrire ici tout
le préambule : « In principio hujus libri quinque sunt inquirenda,
scilicet : causa efficiens, forma materialis, et finalis utilitas, et cui
parti philosophiæ supponitur, et quis titulus. Causa efficiens est duplex,
sc. : movens et non mota et movens et mota. Movens et non mota fuit
Theodosius ipse imperator vel miles qui petiit Æsopum ut sibi aliquas res
jocosas componeret ad removendum curas publicas : qui recusare non valens
hoc opus composuit in græco ; quia ipse fuit græcus, et ille fuit
latinus ; ut Socrates de græco in latinum transtulit logicam. Alii dicunt
quod Galterus anglicus fecit hunc librum sub nomine Æsopi et sic habemus
quod duplex est Æsopus. In principio hujus sunt multæ fabulæ et apologi
vel materia quæ continet utilitates in simplicibus dictis fabularum. {p. 607}Causa formalis est duplex : scilicet forma
tractandi et forma tractatus. Forma tractatus est congregatio vel
multiplicatio vel documenta quæ in hoc libro continentur. Forma tractandi
est modus vel materia, dispositio vel descriptio. Causa finalis sive
utilitas est ut perlecto libro sciamus ea quæ dicta sunt in libro. Titulus
talis est : Incipit Esopus vel Esopus
vel Liber magistri Esopi. Cui parti philosophiæ
supponitur ? Ethicæ, quia de moribus tractat. Ethis enim græce, mos
dicitur esse latine : inde ethica, i. moralis scientia. Magister Æsopus de
civitate Atheniensi, auctor hujus libri, volens omnes homines communiter
informare quid agere et quid vitare debeant, hoc opus composuit in quo
fingit bruta irrationalia animalia et inanimata loqui nobis ; per hoc
inconveniens docet nos cavere cavenda, et sectari sectanda ; nam fingit
gallum loqui et lupum, ut patet in littera ; hoc est totum figurative : ut
id quod minus videtur inesse inest et id quod magis. Istud autem opus fuit
in greco sermone compositum : diu a latinis jacuit intemptatum, donec
Tiberius quidam imperator romanorum rogavit magistrum Romulum ut sibi
aliquas fabulas jocosas, ad removendum publicas curas, compleret et
legeret ; iste autem magister Romulus non audens precibus tanti viri
contradicere, librum suum ut pote auctenticum de græco sermone in latinum
transtulit, dicens : O Tyberine, scribam calumnias malorum, verba blanda
improborum, ut risus multiplicetur et ingenium acuatur per
exempla. »
1488. §
— Auctores cum glosa octo libros
subscriptos continentes, videlicet : Cathonis,
Theodoli, Faceti, Cartule alias de contemptu mundi, Tobiadis,
parabolarum Alani, fabularum Aesopi, Floreti.
À la fin :
Impressi Lugd. per Joan de Prato, anno dñi
M. cccc. lxxxviij Die ultima Decembris.
Je ne connais pas d’exemplaire de cette édition in-4º, citée par Panzer (Annales typographici, t. I, p. 538, nº 68), et par Hain (Repertorium bibliographicum, t. I, p. 240, nº 1914), et en outre signalée dans le manuscrit latin 11395 de la Bibliothèque nationale. Mais il ne me semble pas douteux qu’elle a été la réimpression d’une première édition sans date, dont Hain (Repertorium bibliographicum, t. I, p. 240, nº 1913) donne la description.
1489. §
Esopus moralizatus cum bono
commento.
À la fin : Finit Esopus
fabulator preclarissimus cum suis moralisationibus ad nostri
instructionem pulcherrime appositis. Impressus anno salutis
M. cccc. lxxxix decimo kalendas Aprilis.
La bibliothèque impériale de Vienne sous la cote 16. G. 29, la bibliothèque royale de Munich sous la cote Inc. c. a. 620 et la bibliothèque publique de Nuremberg sous la cote 139, possèdent chacune un exemplaire de cette édition in-4º qui se compose de 42 feuillets.
— Esopus moralisatus cum bono
commento.
À la fin : Finit Esopus
fabulator preclarissimus cum suis moralisationibus ad nostri
instructionem pulcherrime appositis. Impressus anno salutis
M. cccc. lxxxix. decimo kalendas augusti.
La bibliothèque du British Museum sous la cote 12305 e, la bibliothèque royale de Munich sous la cote Inc. c. a. 621, la bibliothèque impériale de Vienne sous la cote VII. H. ii et la bibliothèque publique de Linz sous la cote B. 131. b., possèdent chacune un exemplaire de cette édition in-4º, qui se compose de 32 feuillets.
— Édition classique in-4º des fables de Walther, imprimée
en caractères gothiques, non chiffrée, ne portant ni titre, ni table, ni
commentaire, mais possédant, en sus des soixante authentiques, les fables
De Accipitre et Capone, De Lupo et Pastore et De Pueris ludentibus. Elle se termine par ces mots :
Impressum Brixie (Brescia) per
Boninum de Boninis de Ragusia. Anno salutis domini
M. cccc. lxxxix. xii. kl. Septembris.
Au verso du dernier
feuillet est représenté un soubassement de colonne qui porte cette
inscription : Lepidis-||simi Esopi ||
fabu-|lae.
Un exemplaire de cette édition in-4, coté X. H. 66, se trouve à la bibliothèque impériale de Vienne.
1490. §
Auctores cum glosa octo libros subscriptos continentes, videlicet : Cathonis, Theodoli, Faceti, Cartule : alias de contemptu mundi, Thobiadis, Parabolarum Alani, Fabularum Esopi, Floreti.
Ce frontispice appartient à un gros volume in-4 de grand format, signé de a à z, puis de deux signatures de fantaisie, enfin de {p. 609}A à L. Il se compose de trente-cinq cahiers de huit feuillets chacun et d’un dernier de six, soit, au total, de 286 feuillets. Le recto du premier feuillet est consacré au frontispice ; le verso est blanc.
Les fables de Walther, accrues d’un commentaire, commencent
au verso du feuillet B iiii, c’est-à-dire à la page 424, par un titre
ainsi conçu : Incipit liber fabularum
Esopi.
Elles sont au nombre de soixante seulement et se terminent
au recto du feuillet F ii, c’est-à-dire à la page 483, par cette
souscription : Fabularum liber cum glosa finit
feliciter.
Au verso du dernier feuillet on lit : Auctores cum glosa octo libros subscriptos continentes. Videlicet :
Cathonis. Theodoli. Faceti. Cartule : alias de contemptu mundi.
Tobiadis. Parabolarum Alani. Fabularum Esopi. nec non Floreti finiunt
feliciter. Impressi Lugduni per magistrum Johannem Fabri anno domini.
M.cccc.lxxxx. die xxiii Januarii.
Il existe un exemplaire de cette édition à la Bibliothèque de l’Université de Würtzbourg sous la cote L. B. 9. 44 et un autre à celle de Grenoble sous la cote 173.
— D’après Hain (Repertorium bibliographicum, t. I, p. 241, nº 1916), une autre réimpression semblable fut la même année exécutée dans le format in-4, avec caractères gothiques, à Cologne par Quentel. Le volume est signé et en partie chiffré.
— Esopus moralizatus cum bono
commento.
À la fin : Impressus anno
salutis M. cccc. xc in profesto Bartholomei finit.
Le
volume qui est dans le format in-4 des éditions classiques, se compose de
38 feuillets.
La bibliothèque impériale de Vienne sous la cote 26. G. 32, la bibliothèque Bodléienne sous la cote Auct. 5, Q. 6. 68, la bibliothèque royale de la Haye sous la cote 345, la bibliothèque de Munich sous la cote Inc. c. a. 716 et la bibliothèque royale de Stuttgart possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
— Esopus cum commento optimo et
morali.
À la fin : Impressus
Dauentrie Per me || Jacobum de Breda Anno incarnationis dominice ||
Millesimo quadringentesimo Nonagesimo || quarta die mensis
Novembris.
C’est la première des éditions imprimées à Deventer. Il en existe des exemplaires à la Grenville library sous le nº 7736, à la bibliothèque Bodléienne sous la cote A. q. q. Linc. et à la bibliothèque royale de Stuttgart.
1491. §
Auctores viii : Nempe Catho, Facetus, Theodulus, de contemptu mundi, Floretum, Alanus de parabolis, fabulae Aesopi et Thobias.
À la fin : Felix libellorum finis quos
auctores vulgo appellant corrector. impressor. que Engolisme die XVII.
mensis Maii anno domini M. cccc. lxxxxi.
C’est d’après
Hain (Repertorium bibliographicum, t. I, p. 241,
nº 1917) que je signale cette édition imprimée dans le format in-4º.
— Esopus moralizatus cum bono
commento.
À la fin : Esopus
fabulator, etc. Impressus anno salutis nostre
M. cccc. xci sexto ydus Octobris.
Je possède un exemplaire de cette édition in-4º, que je n’ai trouvée dans aucune bibliothèque publique, et qui est cependant mentionnée par Panzer (t. IV, p. 54, nº 445).
— Indépendamment de cette édition, Panzer (t. I, p. II, nº 64) et Hain (t. I, p. 34, nº 308) en signalent une autre imprimée à Anvers par Gérard Leeu. Mais j’avoue ne pas l’avoir rencontrée.
1492. §
Auctores octo opusculorum || cum
commentariis diligentis-||sime emendati,
videlicet : || Cathonis || Theodoli || Faceti || Cartule : alias de
comptentu (sic) mundi || Thobiadis || Parabolarum
Alani || Fabularum Esopi || Floreti.
À la fin :
Auctores octo opusculorum cum glosematibus ||
diligentissime emendatos explicuit industrius vir || Anthonius
Lambillon. xii. Calendas decembris || Anno M. cccc. xcii.
Au-dessous de cette souscription imprimée au recto du dernier feuillet se
trouvent deux lions, portant une sphère sur laquelle sont les
initiales A. L.
Cette édition est du grand format in-4º. Il en existe, sous le nº 1840 substitué au nº 1620, un exemplaire à la bibliothèque royale de Bruxelles.
— Esopus moralisatus || cum bono
commento.
Réimpression des éditions classiques antérieures, formant un volume in-4º de la dimension habituelle, imprimé en caractères gothiques, signé de a à f et composé de six cahiers de six feuillets chacun, soit, au total, de trente-six feuillets.
Il est uniquement consacré aux fables de Walther qui, comme dans la plupart des éditions semblables antérieurement publiées, {p. 611}ne dépassent pas le nombre de soixante et qui sont grossies du même commentaire.
En tête du verso du premier feuillet se trouve ce titre :
Liber Esopi
, et au bas du recto du
dernier on lit : Esopus fabulator preclarissimus cum
suis moralizationibus ad nostri || instructionem pulcherrime
appositis. Impressus anno salutis nostre M || cccc. xcij. tercio
kalendas Octobris.
Le verso du feuillet est blanc.
Cette édition avait sans doute été tirée à un nombre d’exemplaires relativement considérable ; car ils ne sont pas rares ; il en existe notamment a la bibliothèque royale de Munich, sous les cotes Inc. c. a. 870 et A. Lat. a. 13 g, à la bibliothèque de Wolfenbüttel, sous la cote Aus. 171. 14 Qu., à la bibliothèque du British Museum sous la cote I073.l.28./2, à la Bodléienne sous la cote Auct. 5. Q. 6.80, à la bibliothèque impériale de Vienne sous la cote IX. H. 34, à la bibliothèque de l’Université de Padoue sous la cote Sº XV. 496, et à la bibliothèque royale de Bruxelles sous le nº 1740.
1494. §
Auctores octo opusculorum cum
commenta||riis diligentissime emendatividelicet || Cathonis || Theodoli || Faceti || Cartule :
alias de contemptu mundi : || Thobiadis || Parabolarum Alani ||
Fabularum Esopi || Floreti.
Au-dessous de ce titre le
frontispice offre une vignette sur bois, qui représente un cœur surmonté
d’une croix et divisé en quatre compartiments. Dans chacun d’eux se trouve
sur fond noir une des quatre initiales P, L, I, B. Cette édition, qui
forme un grand volume in-4º, est, comme la précédente, une réimpression de
celle des huit auteurs. Elle ne porte pas de pagination, niais est pourvue
de deux séries de signatures, la première, allant de a
à z, et la seconde, de A à D ; il s’ensuit que le
volume est formé de vingt-sept cahiers, et comme les vingt-six premiers se
composent de huit feuillets et le vingt-septième de quatre, le nombre
total des feuillets est de 212.
Les fables de Walther, au nombre de soixante, commencent au
feuillet v 7 a, c’est-à-dire au
recto du feuillet 159, et sont annoncées par ce titre : Incipit liber fabularum Esopi.
Je n’entre pas dans plus de détails sur le contenu de cette {p. 612}édition ; pour le faire connaître, il me suffit de dire que, comme la précédente, elle n’est qu’une réimpression des premières éditions des huit auteurs publiées à Lyon. Je fais seulement observer que les soixante fables de Walther y sont divisées en trois livres égaux, et que cette division, conforme à celle des fables du Romulus ordinaire, démontre une fois de plus qu’elles en sont bien dérivées.
L’édition se termine par cette souscription qui en précise
la date : Auctores octo opusculorum cum commentariis
diligentissime emendati : videli-||cet Cathonis : Theodoli : Faceti :
Cartule alias de contemptu mundi : Thobia-||dis : Parabolarum Alani :
Fabularum Esopi : nec non Floreti finiunt feliciter. || Impressi
Lugduni. Anno domini. M. cccc. lxxxxiiij die xvi.
Februari.
Un exemplaire parfaitement conservé de cette édition figure, sous la cote 28, parmi les incunables de la bibliothèque publique de Nevers.
— Auctores octo opusculorum cum
commenta-||riis diligentissime emendati videlicet || Cathonis || Theodoli || Faceti || Cartule :
alias de contemptu mundi || Thobiadis || Parabolarum Alani ||
Fabularum Esopi || Floreti.
Tel est le titre d’une
édition copiée, comme les deux précédentes, sur les premières éditions
lyonnaises.
Les feuillets, non paginés, portent seulement des
signatures ; c’est au feuillet portant la signature v 7,
que les fables de Walther commencent par ce titre : Incipit liber fabularum Esopi.
Le volume se termine par cette souscription : Auctores octo opusculorum, etc. Impressi
Lugduni per magistrum Mathiam Husӡ alemanum anno domini
M. cccc. lxxxxiiij. die nona mensis iunii.
Sous la cote 10973 la bibliothèque publique de Dijon possède un exemplaire de cette édition.
— Esopus moralisatus || cum bono
commento.
Au-dessous de ce titre est une gravure sur bois
assez grossière représentant Ésope sous la forme d’un pédagogue et à ses
pieds deux enfants qu’il instruit. Au-dessus de leur tête voltige une
banderole qui porte ce vers hexamètre :
Accipies tanti doctoris dogmata sancti.
À la fin on lit : Impressus anno
salutis nostre M. cccc. xciiii.
Il n’y a pas d’indication
de lieu ; ni de mois. Suivant Hain, cette édition, {p. 613}sans indication de lieu et sans nom d’imprimeur, aurait
été imprimée à Haguenau par Henri Gran456.
La Grenville library, sous la cote 7738, la bibliothèque royale de Munich, sous les cotes Inc. c. a. 1054, A. Gr. b. 59, A. Gr. b. 60 et A. Gr. b. 536, et la bibliothèque publique de Linz, sous la cote B. 100. B, possèdent des exemplaires de cette édition classique in-4º, qui se compose de 36 feuillets, imprimés en caractères gothiques.
— Esopus moralisatus cum bono
commento. Iterum textus de nouo emendatus.
Ce titre
indique qu’il s’agit d’une réédition ; en effet, c’est une réimpression de
l’édition de Deventer. Au-dessous du titre est une gravure différente de
celle de l’édition précédente ; au centre elle porte en gros caractères le
mot Alis
, et aux quatre angles elle offre
quatre médaillons contenant les attributs des quatre évangélistes,
savoir : le premier, un bœuf ailé avec le nom de saint Luc, le deuxième,
un aigle avec le nom de saint Jean, le troisième, un ange avec le nom de
saint Mathieu, et le quatrième, un lion avec le nom de saint Marc.
L’édition se termine par ces mots : Impressus
Dauentrie per me Jacobum de Breda. Anno domini M. cccc. xciiii tercio
kalendas Augusti.
Deux exemplaires de cette édition qui forme un volume in-4º de 39 feuillets, existent l’un, sous la cote B. 73, à la bibliothèque publique de Linz, et l’autre, sous la cote 364, à la bibliothèque royale de la Haye.
1495. §
Esopus moralisatus cum bono commento. Iterum textus de nouo emendatus.
Mêmes
gravures sur la première page que dans l’édition de Jacques de Breda de
1494. À la fin : Impressus Dauentrie per me Jacobum de
Breda. anno dni M. cccc. xcv. xvi mensis februarij.
C’est encore une réimpression in-4º de l’édition de Deventer. Sous la cote Douce 58, il en existe un exemplaire à la bibliothèque Bodléienne.
1496. §
Esopus moralisatus cum bono commento. Iterum textus de nouo emendatus.
À la fin :
Impressus Dauentrie per me Jacobum de Breda Anno
dni M. cccc. xcvi. mensis februari.
{p. 614}C’est encore une réimpression in-4º de l’édition de Deventer : elle est signalée par Panzer, t. I, p. 363, nº 100. Il en existe au British Museum un exemplaire sous la cote I073.l.29./2*.
— Édition d’écolier in-4º, imprimée en caractères gothiques, non paginée, mais signée des lettres a et b et formée de deux cahiers, l’un de 8 feuillets et l’autre de 10.
Je ne connais de cette édition qu’un exemplaire qui existe
à la bibliothèque du palais Brera sous la cote AM. X. 7. S’il est complet,
l’édition n’a pas de frontispice et ne porte pas de titre général. Les
fables ne sont accompagnées d’aucune glose ; elles consistent dans les
soixante-deux plus usuelles, suivies de celle intitulée De
Puero suspenso, au-dessous de laquelle sur le verso du dernier
feuillet on lit ces mots : Finis. Laus deo.
Amen.
Puis viennent ces quatre vers :
Gutta cauat lapidem, non bis, sed sæpe cadendo :Sic homo fit sapiens, non bis, sed sæpe legendo.Clamitat ad caelum vox sanguinis et Sodomorum,Vox oppræssorum (sic) mercesque retenta laborum.
Enfin au-dessous se lit la souscription suivante :
Impressum Mediolani per magistrum Philippum de ||
mantegatiis. M. cccc. lxxxxvi. die. xx. Februario.
— Auctores || octo opusculorum cum
cō||mentariis diligentissime || emendati :
videlicet. || Cathonis. || Theodoli. || Faceti. || Cartule : alias de
contemptu mundi. || Thobiadis. || Parabolarum alani. || Fabularum
Esopi. || Floreti.
Tel est le titre complexe d’ouvrages,
au nombre desquels sont les fables de Walther. Au-dessous du titre le
frontispice est orné d’une grande vignette, au milieu de laquelle un
écusson supporte les initiales P. B.
À la fin on lit : Auctores octo
opusculorum cum commentariis diligentissime emendati : vide-||licet :
Cathonis : Theodoli : Faceti : Cartule alias de cōtemptu mundi :
Thobiadis : || Parabolarum Alani : Fabularum Esopi : necnon Floreti
finiunt feliciter. Imp̄ssi || Lugduni per Petrum Marescalli et
Barnabam Chaussardi. Anno domini mille-||simo cccc. xcvi. Die vero,
xxiiij. Augusti.
Cette édition, qui a été publiée dans le grand format in-4º, n’est qu’une copie de l’édition lyonnaise de 1494. Il s’en trouve, sous la cote 14680, un exemplaire à la bibliothèque publique d’Arras.
{p. 615}— Esopus
moralisatus cum bono commento.
À la fin : Impressus Dauentrie per me Richardum Paffroed.
M. cccc. xcvi.
Cette édition in-4º, qui m’est inconnue, est citée par Panzer, t. I, p. 363, nº 96, et par Hain, t. I, p. 35, nº 315. Si elle existe, il ne faut pas la confondre avec l’édition in-4º du même imprimeur, qui, sans indication d’année, porte la date du 24 décembre et se compose de 37 feuillets457.
1497. §
Esopus moralisatus || cum bono cōmēnto.
C’est une réimpression, en caractères gothiques, faite par Henri Quentell, de l’édition, qui avait été publiée par Henri Gran en 1494. Comme dans cette dernière, au-dessous du titre il y a une gravure qui représente Ésope instruisant deux enfants et dans laquelle sur une banderole on lit le même hexamètre.
La souscription finale, qui ne porte l’indication ni du
lieu, ni du nom de l’imprimeur, est ainsi conçue : Esop9 fabulator preclarissim9 cum suis moralisationib9 ad nostri
instructionem || pulcherrime appositis. Imp̄ssus āno salutis nr̄e
M. cccc. xcvij.
La bibliothèque impériale de Vienne sous la cote X. H. 47, la bibliothèque Bodléienne sous la cote Auct. Q. 5. 53, la bibliothèque royale de Munich sous les cotes Inc. c. a. 1360 et A. Gr. b. 61 et la bibliothèque privée du roi de Wurtemberg possèdent des exemplaires de cette réimpression qui forme un volume in-4º de 39 feuillets.
— Esopus moralisatus cum bono
commento.
Cette édition, imprimée en caractères gothiques dans le format in-4º, n’est pas chiffrée, mais est signée de a à e. Les quatre premiers cahiers comprennent chacun huit feuillets et le cinquième seulement quatre, soit au total trente-six.
Le recto du premier feuillet est occupé par une gravure sur bois, représentant, à gauche, Ésope assis, pensif, le coude gauche appuyé sur un pupitre et la main droite sur un livre tenu debout sur sa cuisse.
Les fables sont précédées de ce préambule en prose latine commun à la plupart des petites éditions classiques du même temps, {p. 616}et chargées en outre de gloses interlinéaires imprimées en caractères minuscules.
La souscription finale est ainsi conçue : Huic lepidissimo fabulatori Esopo finem apposuit Bernardinus
de Misuitis de Papia. Anno dñi. Mcccc||lxxxxvij. Septembris ad honorem
omnipotentis dei nec non Virginis marie. Finis.
Quoique
cette souscription n’en fasse pas mention, cette édition a été imprimée à
Brescia.
Il en existe un exemplaire au British Museum sous la cote 12304 e, et un autre à la Bibliothèque de Vérone sous la cote 79. e.
— Esopus moralisatus cum bono commento
et glossa interlineari.
À la fin : Esopus fabulator preclarissimus cum suis moralisationibus ad nostri
instructionem pulcherrime appositis. Impressus anno salutis nostre
M. cccc. xcvii.
Cette édition, in-4º, signalée par Panzer, t. IV, p. 67, nº 601, et par Hain, t. I, p. 35, nº 317, m’est inconnue.
1498. §
Esopus moralisatus cum
commento.
À la fin : Dauentriae per
Iacobum de Breda M. cccc. xcviii.
C’est une réimpression de l’édition de Deventer, signalée par Panzer, t. IV, p. 288, nº 126 b, et par Hain, t. 1, p. 35, nº 318.
— Auctores octo opusculorum cum
commentariis diligentissime emendati, videlicet :
Cathonis : Theodoli : Faceti : Cartule : alias de contemptu mundi :
Thobiadis : parabolarum Alani : Fabularum Esopi :
Floreti.
Cette édition, qui forme un volume in-4º de grand format,
est une réimpression des éditions lyonnaises de 1494 et 1496. Elle a été
imprimée en caractères gothiques sur deux colonnes, par cahiers signés
de a à z et composés chacun de huit
feuillets, à l’exception du dernier qui en comprend dix. Il s’ensuit que
les feuillets sont au nombre de 186. La souscription finale est ainsi
conçue : Auctores octo opusculorum cum commentariis
diligentissime emendati : videlicet : Cathonis : Theodoli : Faceti :
Cartule : alias de contemptu mundi : Thobiadis : parabolarum Alani :
Fabularum Esopi : necnon Floreti finiunt feliciter. Impressum Lugduni
Anno domini M. cccc. xcviij. Die vero xij Aprilis.
Je n’ai trouvé qu’un seul exemplaire de cette rarissime
édition : il existe à la bibliothèque de l’Université de Bâle sous la {p. 617}cote C. E. VI. 49. « Cette édition lyonnaise de 1498,
m’écrivait le 13 décembre 1881 M. Sieber, conservateur de la
bibliothèque, ne se trouve pas mentionnée dans les bibliographies que je
connais ; elle pourrait bien être sortie de la presse de Nicol. Lupi
(Wolf). »
— Esopus moralisatus cum bono
commento.
Un des exemplaires de cette édition, qui ne
contient aucune indication de lieu, est conservé à la bibliothèque
Bodléienne.
1499. §
Fabule Esopi cum ||
commento.
Au-dessous de ce titre placé sur le recto du
premier feuillet est une vignette au centre de laquelle apparaît un écu
surmonté d’un casque empanaché. Dans l’espace laissé blanc par la vignette
on lit : M. Lenoir
, et l’encadrement du
tout porte ces mots : C’est mon désir
(au
haut) De Dieu servir
(à droite)
Pour acquérir
(au bas) Son doulx plaisir
(à gauche). Le recto du second
feuillet porte ce simple titre : Esopi
,
suivi du prologue dans lequel les fables sont attribuées à Walther
l’Anglais.
La souscription finale est ainsi conçue : Fabularum liber cū glosa per Petrū Leuet impres||sus
Suburbiis sc̄ti Hermani de pratis cū expēsis honesti viri Michaēlis
nigri. Anno dñi milesimo qua||dringentesimo nonagesimo nono. die vero
xxiij. Septembris.
L’édition forme un volume in-4º non
chiffré, mais signé, dont les cahiers A, C, D sont composés de huit
feuillets et tes cahiers B et E de six, soit un total de 36 feuillets.
Il en existe à la bibliothèque royale de Bruxelles, sous le nº 2075 substitué au nº 2044, un exemplaire relié avec d’autres ouvrages.
Telle est la nomenclature chronologique des éditions latines des fables de Walther qui furent imprimées dans les dernières années du xve siècle. On s’étonnera avec raison de la trouver si longue, et cependant elle est loin d’être complète ; en effet, ne pouvant déterminer avec certitude l’époque précise de l’apparition de chacune d’elles, j’ai cru devoir me dispenser de citer les nombreuses éditions qui ne portaient pas de date.
§ 2. — Éditions postérieures au XVe siècle. §
L’engouement pour les fables de Walther qui avait fait tant de tort à celles de Romulus et surtout à celles de Phèdre, ne survécut {p. 618}que quelques années au xve siècle. La Renaissance ne tarda pas à faire justice de leur médiocre valeur littéraire et à les laisser tomber dans l’oubli qu’elles méritaient. Je vais passer en revue les dernières éditions qui marquèrent la fin de leur vogue.
1500. §
Esopus moralisatus cū || bono cōmēto. Iterum textus || de nouo emendatus cum glosa
interliniali.
Tel est le titre qu’on lit sur le premier
feuillet.
Le second feuillet, en tête du recto, porte cet autre titre :
Liber Esopi
, que suit immédiatement le
commentaire commençant par ces mots : Græcia
disciplinarum mater
, etc.
Le volume se compose de six cahiers signés de a à f, et comprenant, savoir : ceux signés a, c, e et f huit feuillets chacun, et ceux signés b et d seulement quatre feuillets chacun.
Au verso du trente-neuvième on lit : Esopus fabulator preclarissimus cum suis moralisati||onibus ad nostri
instructionem pulcerrime appositis. Im||pressus Daentrie per me Jacobum
de Breda. Anno domi-||ni M. ccccc ipso die Sancti Seuerini
ep̄i.
Le dernier feuillet est blanc.
C’est encore une réimpression de l’édition publiée à Deventer, en 1490, par Jacques de Breda.
Il en existe à la bibliothèque de l’Université de Bâle un exemplaire sous la cote D. D. VII. 12 ; il fait, avec d’autres imprimés, partie d’un volume in-4º petit format, dont la reliure à plats de bois est doublée de parchemin et garnie d’un fermoir. À Hanovre, la Bibliothèque du roi, sous la cote 201, possède également un exemplaire de cette réimpression.
— [A]uctores octo cō||tinentes
libros. || Videlicet || Cathonem Facetum || Theodolum
|| De 9tēptu mūdi || Floretum || Alanum de parabolis || Fabulas
Esopi || Thobiam.
Cette édition est contenue dans un volume in-4º, composé de 92 feuillets et imprimé en caractères gothiques à 40 lignes à la page, sans indication de lieu, ni de nom d’imprimeur.
Voici comment Hain le décrit dans son Repertorium bibliographicum, t. I, page 241, nº 1919 :
Fol. 1 b : Focaudi monieri in catho-||nis libellum epigramma.
{p. 619}Fol. 2 a (c. sign. aij) incipit Cato : (C)um aīaduerterē quam plurimos hoīes er-||rare, etc.
In fine : Opus hoc bonis dogmatib’ refultū continēs in||se hos libros p̱tiales : etc. Felicit̄ explicit. Anno a natali xp̄iano. M.CCCCC. die vero. VI. Septēbris.
1502. §
Esopus moralisatus cum
commento.
À la fin : Impressus Daventriae
per me Iacobum de Breda, 1502.
Cette édition forme un volume in-4º qui paraît être une réimpression de la première édition de Deventer.
Il en existe un exemplaire sous le nº 2626 à la Bibliothèque royale de Bruxelles.
1503. §
Fabule Æsopi cum commento.
Tel est le titre qui figure en tête du recto du premier feuillet d’un volume
du format in-4º commun aux éditions classiques du même temps. Non chiffré,
il est signé de a à f et, chaque cahier
se composant de six feuillets, il n’en comprend au total que trente-six.
Au-dessous du titre, est, occupant le reste de la page, une gravure sur bois, qui représente un pédagogue assis dans un grand fauteuil de forme gothique et trois enfants à genoux devant lui.
Le verso du premier feuillet est blanc.
Les soixante fables élégiaques auxquelles le volume est consacré ne sont, contrairement à l’indication fournie par M. Fleutelot458, accompagnées d’aucune traduction et sont seulement pourvues du commentaire, qui, copié sur celui des éditions des huit auteurs, les attribue à Walther l’Anglais. C’est une autorité de plus à l’appui de ma thèse sur leur véritable auteur.
Au recto du dernier feuillet se lit cette souscription :
Explicit liber fabularum Æsopi vna cum
com||mento. Impressus London̄. per winandum || de worde in vico
nuncupato the fletestrete cō||morantem in signo solis.
M.ccccc.iii.
{p. 620}Le verso du même feuillet est rempli par une gravure qui représente la Vierge tenant dans ses bras l’enfant Jésus, et par la marque de l’imprimeur, le tout dans un riche encadrement.
Sous la cote C. 38. d. 1, il existe à la Bibliothèque du British Museum un exemplaire de l’édition de Wynkyn de Worde.
1504. §
Auctores octo continentes, videlicet Cathonem, Facetum, Theodulum, de Contemptu mundi, Floretum, Alanum de Parabolis, Fabulas Æsopi, Tobiam.
Cette édition a été imprimée dans le format in-4º en caractères gothiques et ornée de gravures sur bois. Elle ne porte aucun nom d’imprimeur ; mais à la marque on reconnaît quelle est sortie des presses de Jacques Arnollet qui imprima à Genève et à Lyon.
Elle n’est citée dans aucun répertoire bibliographique. Il en a existé un exemplaire dans la bibliothèque du marquis de Morante.
1507. §
Continentur in hoc Volumine. || Aesopi fabulae LXIII. interprete Salone Parmē. || Aesopi item fabulae. Interprete Auiano.
Précieux volume in-4º, imprimé en caractères italiens, non chiffré, mais signé de a à d.
Les quatre cahiers dont il se compose comprenant chacun huit feuillets, il s’ensuit qu’il n’en possède en tout que 32.
Il contient seulement les fables de Walther et celles d’Avianus.
Les premières qui se composent des soixante-deux le plus ordinairement publiées, commencent au feuillet a ii a et finissent au feuillet c iiii b. Ce qui donne à l’édition sa valeur particulière, c’est qu’elle est, je le crois du moins, la première qui attribue l’œuvre à Salon de Parme et qui porte l’extrait de la lettre latine adressée, à l’appui de cette thèse, par le savant Thadée Ugoleto au prêtre Parmesan Pérégrin Posthume Loticus. Je dois ajouter que, dans la fable de la Matrone d’Éphèse, on trouve, après le vingt-sixième vers, le double distique qui la montre brisant à coups de pierres les dents de son défunt époux.
Je ne dis rien ici des fables d’Avianus qui suivent celles de
Walther, et je me borne à transcrire la souscription par laquelle au verso
du feuillet d viii b se termine le volume : Opera et impensa {p. 621}Francisci Ugoleli
Et || Octaviani Saladi. M. D. vii. Nono Kal. Aprilis.
Un exemplaire de cette édition existe à la Bibliothèque palatine de Parme sous la cote G G.3 II.
1508. §
Esopus moralisatus || cum bono cōmēto : et || glosa interliniari.
Édition in-4º, imprimée en caractères italiens, non chiffrée, mais signée de a à h, dont les cahiers a, d et h se composent de huit feuillets chacun, et les cahiers b, c, e, f et g de quatre seulement, soit au total de 44 feuillets.
Le recto du premier ne porte que le titre sans ornements xylographiques. Le verso du même est occupé par la table.
Les fables de Walther commencent au recto du deuxième
feuillet, précédées du préambule en prose et accompagnées de la glose
interlinéaire communs à la plupart des petites éditions classiques. Elles se
terminent au bas du feuillet 44 a, sans indication de lieu
ni de nom d’imprimeur, par le simple mot Amen
, suivi de la date de : M. D. VIII.
Le
verso de ce feuillet est blanc.
Un exemplaire de cette édition est conservé, sous la cote A. Gr. B. 65, à la Bibliothèque royale de Munich et, sous la cote S N. 8130, à la Bibliothèque de l’Université de Padoue.
— Fabule Esopi || cum
commento
; tel est le titre d’une autre édition de la même
année qui se compose de 30 feuillets, qui a été imprimée à Rouen pour J. Le
Forestier et qui paraît n’être que la réimpression d’une précédente due au
même éditeur. Au-dessous du titre est une gravure, au bas de laquelle on lit
J. Le Forestier
.
La souscription qui se trouve au verso de l’avant-dernier
feuillet est ainsi conçue : Fabularum liber cum glosa
finit feliciter. Impressus Rothomagi per Johā-||nem mauditier pro Iacobo
le forestier. In parrochiā sancti nicolaï cõmoran̄ad || intersigniū
floris lilii iuxta porticū librariorum. Anno dn̄i millesimo
quīquagesi-||mo octavo Die vero. xx. mensis septembris.
Le
frontispice est répété au verso du dernier feuillet.
Un exemplaire de cette édition in-4º existe sous le nº 7740 à la Grenville library.
— Esopi lepidissimi poete fabule
incipiunt.
C’est encore une édition classique in-4º,
imprimée en caractères gothiques, non {p. 622}paginée,
mais signée des lettres A et B, et formée de deux cahiers de huit feuillets
chacun.
Au-dessous du titre placé en tête du recto du premier feuillet vient immédiatement, sur la même page ornée d’un encadrement à fond noir gravé sur bois, le prologue des fables de Walther qui elles-mêmes ne sont accompagnées d’aucune glose et qui ne sont précédées ni suivies d’aucune table.
Les fables se composent des soixante-deux plus usuelles,
suivies de celle intitulée tantôt : De puero
suspenso
, tantôt : De pueris
ludentibus
, après laquelle au verso du dernier feuillet
vient cette souscription : Finis. Collibus Vallistrumpie
per Iacobum de Fracacinis. Die. xxv. Septembris.
M. ccccc. viij.
Au-dessous une gravure sur bois représente
sur un globe un aigle dont les ailes sont déployées.
Il existe à la bibliothèque du palais Brera un exemplaire de cette édition sous la cote AN. IX. 58.
1516. §
Fabule Esopi cum commento.
À la fin : Impressus London per me Winandum de Worde in
vico nuncupato the Fletestrele cõmorantem in signo Solis.
M. ccccc. xvi459.
Cette édition est la réimpression de celle que le même imprimeur avait déjà publiée en 1503.
1517. §
Esopus constructus mora-||liçatus (sic) et hystoriatus vltimo || impressus et correctus ad vtilitatem discipulorum.
Le frontispice au haut duquel figure ce titre est occupé par une gravure différente de celles précédemment décrites : Ésope, couronné de lauriers, est assis et reçoit l’offrande du livre qui lui est faite à genoux par l’auteur de la traduction latine de son œuvre. Les deux personnages sont vus de profil.
Le titre et la gravure sont compris dans un encadrement xylographique contenant huit portraits aux noms de Jérémie, Abacuc, Daniel, Jonas, Grégoire, Jérôme, Ambroise et Augustin.
L’édition a été imprimée dans le format in-4º, non chiffrée, mais {p. 623}signée de a à g et composée de six cahiers de huit feuillets chacun et d’un septième de quatre, soit de cinquante-deux feuillets au total.
Au verso du premier feuillet commencent les fables de Walther précédées du préambule en prose et accompagnées du commentaire qu’on rencontre spécialement dans les éditions classiques.
Chacune des fables est illustrée d’une gravure sur bois.
Leur nombre total est de 65. Aux soixante authentiques placées sous 62 numéros ont été ajoutées cinq autres portant les numéros et titres suivants : lxiij De Capone et Accipitre ; lxiiij De Pastore et Lupo ; lxv De Puero suspenso ; lxvj De Mercatore et eius vxore ; lxvj (sic) De Rustico et Plutone.
À la fin on lit : Impressum Venetiis per
Bernardinum Benalium Anno dñi M. ccccc. xvij mensis
Madij.
Un exemplaire de cette édition in-4º se trouve, sous la cote 7747, à la Grenville library, et un autre, sous la cote A. V. 37. 21, à la bibliothèque de l’Université de Bologne.
1519. §
Fabulae versibus latinis cum commento ;
una cum Catone.
À la fin : Lugd. per
Jo. Marion 1519.
La bibliothèque Bodléienne possède un exemplaire de cette édition classique coté x. x. 83. Th. subst.
— Continentur in hoc || volumine.
|| Esopi Phrygis fabulae CCXIIII. e graeco in latinum ||
elegantissima oratione conuersae || Eiusdem fabulae. XXXIII. per
Laurentium Vallam || virum clarissimum versae || Eiusdem fabulae. LXIII.
a Salone Parmense versu Elego || latinitate donatae. || Eiusdem
fabulae. XLII. Elego quoque versu ab Auia-||no trālatae. || Laurentii
Abstemii Maceratensis Hecatomythium primum, || hoc est centum fabulae. |
Eiusdem Hecatomythium secundum, hoc est centum || fabulae. || Eiusdem
Libellus de verbis communibus.
Au-dessous de ce titre est
une vignette représentant Jésus-Christ ; il est accompagné d’un agneau et
tient de la main gauche une croix et de la droite une banderole portant ces
mots : Ecce agnus.
L’édition forme un volume in-4º de petit format, dont les feuillets, non paginés, sont signés de A à Q. Le cahier A se compose de 6 feuillets, le cahier Q, de 10, et tous les autres, de 8 ; ce qui donne au volume 128 feuillets.
{p. 624}Il renferme les soixante-deux
fables les plus usuelles, précédées de la lettre bien connue de Thadée
Ugoleto à Pérégrin Posthume Loticus, prêtre parmesan, et suivies de la
souscription suivante : Æsopi fabulae per Salonem
Parmensem finiunt.
Au bas du verso de l’avant-dernier feuillet on lit :
Impressum Venetiis aedibus Joannis Tacuini de
Tridino || anno domini. Mdxix. Die. VI. Martii. || Leonardo
Lauretano Principe.
Cette édition, signalée par Panzer460, qui par erreur lui assigne pour éditeur François Massari de Venise, tire son principal intérêt du point d’appui offert par elle, comme par celle de 1507, à ceux qui voudraient attribuer à Salon de Parme les fables en vers élégiaques.
Il existe des exemplaires de cette édition à la Grenville library sous la cote 7749, à l’Ambrosienne sous la cote S. Ṉ. U. VII. 52 ; à la Bibliothèque de l’Université de Bologne, sous la cote A. V. A. IV. 27 : à la Bibliothèque palatine de Parme sous la cote DD. VIII. 29323.
1520. §
CONTINENTUR IN HOC || VOLUMINE ||. Æsopi Phrygis Fabulæ CC. || XIIII. e Graeco in Latinū ele-||gātissima oratione cōuersæ. || Eiusdem fabule. XXXIII. per || Laurentium Vallam virum || clarissimum versæ. || Eiusdem fabule. LXIII. a Sa||lone Parmensæ (sic) versu Elego || latinitate donatæ. || Eiusdem item fabulæ. XLII. || Elego quoque versu ab Auiano trālatæ. || Laurentii Abstemii Macera-||tensis Hecatomythium pri-||mū hoc est centū fabulæ. || Eiusdem Hecatomythium se||cundū hoc est centū fabulæ. || Eiusdem libellus de verbis communibus.
Tel est le frontispice que, dans un encadrement xylographique, présente un volume in-4º de très petite dimension, non chiffré, mais signé de A à R et composé de dix-sept cahiers de huit feuillets et par conséquent de feuillets dont le nombre total est de 136.
Cette édition, quoique d’un autre imprimeur, est la réimpression de celle de 1519. Elle contient, entre autres ouvrages, les fables de Walther attribuées à Salon et précédées de l’extrait de la lettre de Thadée Ugoleto.
L’avant-dernier feuillet, au bas du recto, porte la
souscription suivante : Impressum Venetiis per
Alexandrum et Benedi||ctum de {p. 625} Bindonis. Anno
Domini. M.D. || XX. Die. XV. Decembris. || Registrum operis. || A B C D
E F G H I K L M || N O P Q R. || Omnes sunt quaterni.
Il existe des exemplaires de cette édition à la Bodléienne sous la cote C. P. 415, à la Marcienne sous la cote CXXVIII. 5. 44615, à la Bibliothèque palatine de Parme sous la cote DD.XI. 92, à la Bibliotheca regia Estensis sous la cote Ms. 3. D. 22.
1522. §
Æsopi fabulæ cum interpretatione ||
vulgari : et figuris acri cura ||
emendatæ.
Au-dessous de ce titre placé en tête du recto du
premier feuillet est une gravure sur bois qui remplit presque toute la page.
Elle représente un professeur en chaire et, au-dessous de lui, six élèves,
trois à droite et trois à gauche, assis et attentifs.
Au haut du verso du même feuillet vient le préambule
Græcia disciplinarum mater
, qui,
n’ayant pas été considéré par l’éditeur comme un simple commentaire, a été
imprimé en caractères du même corps que ceux du texte des fables.
La préface en vers et les fables sont précédées chacune du commentaire commun à toutes les éditions qui commencent par le même préambule.
En outre, chaque distique tant de la préface que des fables
est suivi d’une explication latine qui est plutôt une paraphrase qu’une
traduction et à laquelle se rapportent évidemment ces mots du titre
général : cum interpretatione vulgari.
Ce sont ces mots qui, dans ma première édition m’induisant en erreur, m’avaient porté à supposer que l’édition contenait avec le texte une traduction en prose italienne.
Chaque fable est ornée d’une gravure sur bois. La même faveur n’a pas été faite à la préface.
Les fables sont au nombre de soixante-six, composées des soixante ordinaires et de six autres intitulées : De Capone et Accipitre, De Pastore et Lupo, De Puero suspenso, De Cornice et Hirundine, De Coco et Cane cor rapiente, De Avibus et Pavone. Elles portent soixante-sept numéros par suite de la division en deux de celle des Grenouilles qui demandent un roi.
Vers le bas du verso de l’avant-dernier feuillet on lit la
souscription suivante : Brixiæ Impendio Ludouici
Britānici : et fra-||trum, M. D. xxij. Die xij.
Octobris.
{p. 626}Le recto du dernier feuillet est consacré à la table des fables.
L’édition forme un volume in-4º dont les feuillets non chiffrés sont signés de a à f. Les cinq premiers cahiers se composent de huit feuillets et le sixième de six ; ce qui donne un nombre total de quarante-six feuillets.
Il existe un exemplaire de cette édition à la Grenville library sous la cote 7751.
1538. §
Autores || cum svis commentis, || scilicet || Catonis roma||ni sententiæ morales || Distichis descriptæ, et marginalibus Adnota-||mentis illustratæ, cum scholiis || … hoc si-||gno * prænotatis. || Theodulus Ægloga. || Faceti lusus. || Chartula contemptus mundi. || Tobiæ liber elegiacus. || Alani parabolæ. || Æsopi fabellæ aliquot carmine. || Floreti ecclesiastica documenta. || Sulpitij Verulani viri disertissimi mensalis præceptio pueris mire vtilis. Hæc omnia, etc.
Le recto du premier feuillet qui porte ce titre, est orné d’un bel encadrement xylographique, offrant lui-même dans dix médaillons dix portraits, dont neuf ont la prétention d’être ceux des auteurs des ouvrages contenus dans le volume.
Nous sommes ici encore en présence d’une réimpression de la vieille édition lyonnaise, mais d’une réimpression augmentée ; car à la suite des huit ouvrages ordinaires il en existe un neuvième.
Elle forme un volume in-4º de grand format, imprimé sur deux colonnes et composé de 132 feuillets numérotés.
Les fables de Walther commencent au recto du feuillet 102 et
finissent au verso du feuillet 113 vers le milieu de la deuxième colonne. Au
recto du feuillet 102, en tête de la première colonne, est une vignette,
dans laquelle on lit le mot Esopus. Au-dessous l’œuvre de
Walther est annoncée par ce titre : Incipit liber
fabularum Esopi.
Elle ne comprend que ses soixante fables,
accompagnées de la glose qui lui en attribue la paternité. Elles sont
suivies de cette souscription spéciale : Fabularum liber
cum glosa finit feliciter.
Au recto du dernier feuillet du volume les ouvrages qu’il
contient sont terminés par cette souscription générale : Finis. — Excudebantur diligentius Lugd. per Matthiam Bonhome || Anno a
Christo nato. M. ccccc. xxxviij. die. viij. Martii.
{p. 627}Un exemplaire de cette édition est conservé à la bibliothèque Ambrosienne sous la cote E̱. X. 30.
Autores octo morales.
Au-dessous de ce titre, dans un encadrement xylographique, le frontispice se
complète ainsi : Avtores. || Poete morales octocum Appendi||cibus : nonnullorumque opusculorum
lo-||cupletatione postremo recogniti. || Scilicet. || Catonis disticha
moralia. || Faceti libellus. || Theodoli duellum. || De contemptu mundi.
|| Floreti dogmata. || Alani parabole. || Esopi fabule. || Thobie
gesta. Accessit etiam punctorum for-||mula : cum Regimine in men-||sa
seruando. || m.dxxxviii.
Au-dessous de cette date se lisent les
lettres I et M.
Édition in-8º, non chiffrée, mais signée de a à m, composée de 12 cahiers de 8 feuillets chacun, soit, en tout, de 96 feuillets.
Comme toutes les éditions des huit auteurs, elle renferme les fables de Walther, mais pourvues seulement de notes marginales.
Elles sont, au verso du feuillet G ii (fol. 50 b), annoncées par ce titre : Incipit liber
primus fabularum
que suit ce préambule en distiques
élégiaques, inspiré par leur propre prologue :
Jocundus flores fructus editque salubresHortulus Esopi ; carpe quid ipse voles.Jure legendus erit qui miscuit utile dulci.Si bene perpendis, noster hic autor agit.
Les fables se terminent au recto du feuillet H viij (fol. 64 a).
1547. §
Æsopi || Fabvlae || cum vulgari || interpretatione || et figuris acri cura emendatae.
Au-dessous de ce titre est une grande gravure sur bois
qu’interprètent, placés l’un à gauche, l’autre au-dessus et le dernier à
droite, ces trois mots : Virtus securitatem
parit.
Plus bas : Parmae || apvd Seth de Viottis
|| m.d.xlvii.
Tel est le frontispice d’une édition in-4º, très différente des éditions classiques précédemment analysées, non chiffrée, mais signée de A à D, dont les cahiers se composent de huit feuillets, à l’exception du dernier qui n’en a que 6, ce qui donne au total trente feuillets.
Les fables de Walther, accompagnées d’un commentaire en {p. 628}langue italienne et illustrées de gravures sur bois très grossières, sont au nombre de soixante-cinq comprenant, avec les soixante authentiques, cinq complémentaires qui portent les titres suivants : De Cornice et Hirundine, De Pastore et Lupo, De Puero suspenso, De Coco et Cane cor rapiente, De Avibus et Pavone.
Au bas du recto du dernier feuillet, on lit : Parmae || Apvd Seth de Viottis.
Anno m.d.xlvii. || Mense
Maii.
Un exemplaire de cette édition existe à la Bibliothèque Marcienne sous la cote CXXIX. 9. 44955.
1553. §
Aesopi || fabulae || feliciter incipiunt.
L’édition qui porte ce titre consiste dans un volume in-4º de petit format, composé de deux cahiers de 8 feuillets chacun, soit de seize feuillets au total, non chiffrés, mais signés des lettres a et b.
Le recto du premier feuillet est orné d’une gravure sur bois qui encadre le prologue. Puis viennent les fables, au nombre de soixante, qui, comme lorsqu’elles accompagnent celles du Romulus ordinaire, sont divisées en trois livres.
Au recto du dernier feuillet la dernière est suivie de cette
souscription : Fabularum Aesopi finis.
Plus
bas, on lit : Finis. || Apud inclytam Grana||tam. Mense
februa-||rio. m.d.liii.
À Madrid, la Bibliothèque nationale, sous la cote 23. 4, et à Cordoue, la Bibliothèque provinciale, sous la cote 8. 98, possèdent chacune un exemplaire de cette rare édition.
1557. §
Esopus constructus mo-||ralizatus et
Hystoriatus ad vti-||litatem discipulo-||rum.
Au-dessus de
ce titre est une gravure sur bois qui semble représenter un magistrat
siégeant avec quatre assesseurs, tandis que plus bas un greffier se tient
assis devant un bureau. Le titre et la gravure sont englobés dans un
encadrement xylographique.
Cette édition, imprimée dans le format in-4º en caractères gothiques, comprend six cahiers signés de a à f, dont les cinq premiers ont chacun huit feuillets et le dernier quatre, soit en tout quarante-quatre.
En voici le contenu :
F. 1 a (a iª). Frontispice ci-dessus décrit.
{p. 629}F. 1 b (a ib). Préambule en prose qui est, comme celui de la plupart des petites éditions d’écolier, la copie du prologue du dérivé complet du Romulus anglo-latin.
Fol. 2 a (a iiª) à 43 b (f iiib). Fables de Walther précédées de leur prologue métrique, accompagnées d’une glose placée, partie en tête de chacune d’elles, partie en interligne et ornées chacune d’une gravure occupant un espace plus grand que celui qui est ordinairement réservé aux grandes lettres initiales. Les fables, étant au nombre de soixante-trois, se composent des soixante authentiques, des deux qui y sont le plus souvent ajoutées sous les titres suivants : De Capone et Accipitre, De Pastore et Lupo, et de celle intitulée : De Puero suspenso. Cette addition a entraîné la suppression, à la fin de la soixantième fable, du distique qui ordinairement la termine.
Immédiatement après les fables, accompagnés comme elles d’une glose, viennent ces quatre vers, qui y sont quelquefois ajoutés dans les manuscrits :
Gutta cauat lapidem, non bis, sed sepe cadendo.Sic homo fit sapiens, non bis, sed sepe legendo.Clamitat ad celum vox sanguinis [et] Sodomorum :Vox oppressorum mercesque retenta laborum.
Plus bas on lit cette souscription : Huic
lepidissimo fabulatori Esopo finem imposuit.
Fol. 44 a (f iiiiª). Bernardus Zimonis ad lectorem.
Hoc opus Aesopi masculis fedarat ineptis :Qui malas (sic) correctas imprimit ere notas.Sed bene limatum nunc terque quaterque reuisumAuthori reddens : quod fuit ante suum.Hunc prius impressis reliquis studiose libellisPerfer : nec dubia perlege mente, puer.Solue grates igitur loculos : nec parcito nummis :Paruulus hoc paruo venditur ere liber.
Au-dessous de ces vers est le mot Finis, et
plus bas vient cet avis final : Impressum Genue per
Antonium || de Bellonis anno Domini || m.ccccc.lvii.
Fol. 44 b (f iiiib). Page blanche.
À Madrid, la Bibliothèque nationale, sous la cote 144. 11, et à {p. 630}Padoue, la Bibliothèque de l’Université, sous la cote 53. 329, possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
1561. §
Æsopi fabule cum interpretatione || vulgari et figuris acri || cura emen || datæ.
Au-dessous de ce titre est une gravure sur bois qui représente, de face, Ésope siégeant devant un bureau, assisté d’un scribe qui se tient devant une table plus bas placée, et entouré de quatre auditeurs assis. Le titre et la gravure sont enfermés dans un encadrement xylographique.
L’édition forme un volume in-4º, imprimé en caractères gothiques, non chiffré, mais signé de a à e, et composé de cinq cahiers de huit feuillets chacun, soit en tout de quarante feuillets.
Les fables de Walther sont au nombre de 66. Aux 60 authentiques placées sous 61 numéros, ont été, sous les numéros 62 à 67, ajoutées les six suivantes : De Capone et Accipitre ; De Pastore et Lupo ; De Puero suspenso ; De Cornice et Hirundine ; De Coco et Cane cor rapiente ; De Avibus et Pavone.
Au haut du recto du dernier feuillet on lit : Stampato in Milano per Francesco Bernardino || da Valle che sta
alla Pescaria Vecchia ad instantia || de D. Mattheo da Besozzo. Nel anno
del || Signore m.d.lxi.
Il existe à la Bibliothèque palatine de Parme un exemplaire de cette édition, sous la cote DD.IX. 29175.
1586. §
Æsopi || fabulæ || una cum argumentis novis. || ac interpretatione Italica. || hac postrema editione || summa cura emendatae.
Ce titre figure en tête de la première page d’un volume in-4º
de moyen format. Au milieu de la page est une vignette au centre de laquelle
se trouvent les initiales M. B., et au bas on lit ce qui suit : Mediolani, apud Besutios fratres. || Anno salutis. m. d. lxxxvi.
Le volume n’est pas paginé ; il est
pourvu de réclames et porte des signatures qui vont de a
à e et par suite se compose de cinq cahiers ; chaque
cahier comprenant huit feuillets, leur nombre total est de quarante.
Les fables de Walther, auxquelles le volume est consacré, commencent {p. 631}au verso du premier feuillet sans autre titre que le mot Prohemium qui précède le prologue connu. Elles sont accompagnées d’une glose et ornées chacune d’une gravure sur bois. Elles sont au nombre de 66, comprenant les soixante de Walther et les six intitulées : De Capone et Accipitre ; De Pastore et Lupo ; De Puero suspenso ; De Cornice et Hirundine ; De Coco et Cane cor rapiente ; de Avibus et Pavone. Elles se terminent au bas du feuillet 40 a et sont suivies d’une table des matières.
Il existe à la bibliothèque Ambrosienne un exemplaire de cette édition sous la cote Y̱. VII. 118.
1599 et 1600. §
Les dernières éditions des fables de Walther que je viens d’analyser montrent, par les longs intervalles qui séparent l’apparition de chacune d’elles, combien s’affaiblit au xvie siècle l’attention exagérée dont elles avaient été l’objet à la fin du siècle précédent. Elles avaient fini par être presque oubliées, et lorsqu’en 1598 Rigault les retrouva dans un manuscrit de l’abbaye de Saint-Victor, elles furent pour lui une vraie nouveauté, et c’est à ce titre qu’il publia dans sa première édition de Phèdre les six suivantes : 2. De Lupo et Agno, 6. De Leone, Vacca, Capra et Ove, 7. De Femina et Fure, 11. De Asino et Apro, 21. De Ranis regem petentibus, 25. De Terra tumente.
1610. §
Les ayant ensuite rencontrées dans un manuscrit de la
bibliothèque Palatine, Névelet leur donna place dans sa Mythologia Æsopica, publiée à Francfort en 1610 dans le format
in-8º, et rééditée dans la même ville cinquante ans après. Schwabe et
Dressler prétendent qu’il avait aussi connu le manuscrit de Saint-Victor et
qu’il s’en était servi. Mais le contraire paraît ressortir du frontispice de
ses deux éditions qui ne visent que le manuscrit palatin. Celui de la
première est ainsi conçu : Mytholo||gia Æsopica.
|| In qua || Æsopi fabvlæ græ||colatinæ
ccxcvii qva-||rum
cxxxvi.
primùm prodeunt. || Accedunt || Babriæ fabvlæ etiam || auctiores. || Anonymi
veteris Fabulæ, latino carmine redditæ LX. || ex exsoletis editionibus
et Codice MS. || luci redditæ. || Hæc omnia ex Bibliotheca Palatina. ||
Adiiciuntur {p. 632}insuper
Phædri, Avieni, Abstemii, Fabvlæ ; || Opera et studio || Isaaci Nicolai Neveleti ||
Cum notis eiusdem in eadem. || Francforti, Typis Nicolai
Hoffmani ; || Impensa Ionæ Rosæ.
m.dc.x.
Le volume que forme cette première édition se compose de 678 pages chiffrées précédées de seize non chiffrées. Les fables de Walther occupent les pages 487 à 530, et les notes qui les concernent, les pages 668 à 678.
1660. §
L’édition de 1660 n’étant que la réimpression de celle
publiée par Nevelet en 1610, le frontispice est presque identique à celui de
l’édition primitive ; il n’en diffère guère que par ces premiers mots :
Fabulæ variorum auctorum, nempe
Æsopi
, etc., substitués à ceux-ci : Mythologia Æsopica, in qua Æsopi
, etc. Le volume, du même
format in-8º que celui de l’édition primitive, a été imprimé à Francfort
chez Christ. Gerlach et Sim. Beckenstein.
1674. §
ÆSOPI || fabvlæ selectæ || ab Anonymo donatæ olim carmine, || nunc denuo || A P. Francisco Marazzano Ariminensi || e societate iesv || Expurgatæ, notis ac præceptis moralibus illustratæ, et aliis pluribus auctæ. || Ad usum scholarum eiusdem Societ. || In hac secunda editione || Ab eodem expolitiores, locupletiores || que redditæ. || Et || Illustrissimis || in Brixiensi Nobilium Collegio || Sub regimine P P. Societatis Iesu || Conuictoribus dicatæ. || Brixiæ. || Apud Iacobum Turlinum. || Superiorum permissu.
Édition in-12, composée de 167 pages chiffrées.
Les pages 23 à 70 sont remplies par les soixante fables authentiques de Walther, placées sous 61 numéros et augmentées des cinq suivantes : 62. De Capone et Accipitre et Domino ; 63. De Pastore et Lupo ; 64. De Coco et Cane rapiente cor ; 65. De Avibus et Pavone ; 66. Bap. Mantuani De Malo Avari translata et arescente.
À la suite, sous les nos 67 à 140, viennent soixante-quatorze fables qui sont la transformation en vers élégiaques de fables appartenant aux collections en prose. Elles occupent les pages 71 à 149.
Cette édition n’est que la reproduction d’une première dont je n’ai retrouvé aucun exemplaire.
{p. 633}Elle n’est pas datée ; mais le Catalogue de la Bibliothèque de l’Université de Ferrare, où elle existe sous la cote H. 2. 7. in 12, lui assigne la date de 1674.
1681. §
Æsopi, et aliorvm || Fabvlæ selectæ || Elegiaco metro recens || concinnatæ.
De ce titre général la première partie est au-dessus et la deuxième au-dessous d’une grande gravure représentant deux personnages, dont l’un assis est désigné par les mots Xanto filosofo et l’autre debout est appelé Esopo.
Indépendamment de ce premier frontispice, il en existe un second ainsi conçu :
Apologorum, || ac fabellarum || ex Æsopo || et aliis sapientibus, tam Veteribus quam Recentioribus, sanctisque || p. p. Damasceno et Cyrillo || spicilegium ; || cui vacauit elegis ludens P. Franciscus || Marazzanus, || e societate Iesv. || Ad Vsum scholarum eiusdem Soc. || Idem quoque apposuit notas, eruditiones, || et Gnomas ad formandos Puerorum || mores cum dulci voluptate || perutiles. || Et || Illustrissimis in Brixiensi Nobilium || Collegio sub regimine P. P. Soc. || Iesv Conuictoribus semel, || bis, tertiò dicauit. || Editio Tertia || Præ aliis eiusdem Auctoris studio… exacta. Brixiæ, 1681. || Apud Ricciardos, Superior. Permissu.
L’édition forme un petit volume in-12 de 402 pages, dont 399 sont chiffrées.
Les pages 32 à 86 sont occupées par les soixante fables de Walther augmentées de celles dont les titres suivent : 61. De Capone et Accipitre et Domino ; 62. De Pastore et Lupo ; 63. De Coquo et Cane rapiente cor ; 64. De Auibus et Pauone ; 65. Bap : Mantuani De Malo Auari translata et arescente.
Les pages 87 à 390 sont remplies par 179 fables ésopiques en vers élégiaques.
La Bibliothèque Palatine de Parme, sous la cote Sal. M* VIII. 40304, possède un exemplaire de cette édition.
1784 et 1810. §
Après l’édition de 1681, s’écoule un siècle entier dans
lequel je ne trouve aucune édition nouvelle du texte de Walther. Pour en
rencontrer une, il faut attendre celle que, en publiant, en 1784, les {p. 634}fables de Phèdre, les éditeurs Bipontins en
donnèrent sous le titre d’Anonymi fabulæ Æsopiæ. Voici le
frontispice de l’édition de 1784 : Phædri || Augusti
liberti || Fabulæ Æsopiæ || novissime recognitæ et
emendatæ. || Accedunt Publii Syri sententiæ, || Aviani et Anonymi
veteris || Fabulæ denuo castigatæ. || Editio accurata. || Biponti, || ex
Typographia Societatis. || ciɔ iɔ cclxxxiv.
L’édition de 1784 forme un volume in-8 de lii-232 pages, dans lequel les fables de Walther occupent les cinquante dernières.
L’édition de 1784 a été, en 1810, réimprimée dans le même format.
1813. §
Une édition tirée à la fois de celle de Névelet et de celle de Nilant a été publiée à Padoue, en 1813, dans le format in-18. En voici le frontispice :
PHÆDRI || Augusti liberti || Fabularum Æsopiarum || Libri V. || Accedunt Fabulæ || Flavii Aviani, Anonymi Neveleti. || Romuli et Anonymi Nilantii. || Patavi, || Typis Seminarii. || MDCCCXIII.
Le volume se compose de 296 pages.
Il existe un exemplaire de cette édition dans la Bibliothèque de l’Université de Padoue sous la cote 30. 137, et un autre dans la Bibliothèque de Bergame.
1829. §
En 1829, les fables de Walther furent, d’après les éditions Bipontines, introduites dans le dix-septième volume d’une collection d’auteurs latins publiée à Bruxelles par l’imprimeur Tencé. Limitées aux soixante authentiques, elles y font suite à celles de Phèdre et d’Avianus.
1838. §
M. Dressler, dans son édition publiée à Bautzen en 1838, les
ajouta aussi aux fables de Phèdre. En tête de cette édition on lit :
Accedunt Ugobardi Sulmonensis Fabulæ Phædrianæ e
codice Hæneliano et Duacensi cum utriusque varietate accurate
editæ.
1882. §
La dernière édition que je connaisse est celle qui a été publiée {p. 635}par M. Wendelin Fœrster à la suite de la traduction en vers français contenue dans le manuscrit de Lyon.
Le petit volume in-8 qui renferme cette édition est le
cinquième d’une collection de vieux auteurs français qui porte ce titre
général : Altfranzösische || Bibliothek || herausgegeben || von ||
Dr Wendelin Fœrster || Professor der Romanischen
philologie an der universitāt Bonn.
Le titre qui lui est spécial
est le suivant : Der Lyoner Yzopet || Altfranzösische übersetzung ||
des XIII. jahrhunderts || in der mundart der Franche Comté || mit dem
kritischen text des latinischen || originals || (sog. anonymus Neveleti.)
|| Zum ersten mal.
Le volume se compose de xliv-166 pages, non compris le feuillet consacré au frontispice. Les pages i à xliv sont remplies par l’introduction (Einleitung). La traduction en vers français occupe ensuite les pages 1 à 95.
Puis vient le texte de Walther qui, commençant à la page 96, se termine à la page 137. Il est suivi, pages 138 à 157, de longues et savantes observations intitulées Anmerkungen, pages 158 à 164, d’un glossaire (Glossar), et, pages 165 à 166, de la table des matières.
Cette dernière édition n’a pas eu, plus que les précédentes, le pouvoir de rendre aux fables de Walther à notre époque leur vogue ancienne : aujourd’hui on ne croit plus à leur valeur littéraire, et l’intérêt qu’elles peuvent encore offrir est devenu purement historique.
Traductions des fables de Walther. §
§ 1. — Traductions françaises. §
Les fables de Walther ont été, dès le moyen âge, traduites en vers français. J’en ai, comme on l’a vu, rencontré deux traductions dans les manuscrits des bibliothèques publiques. La plus ancienne et en même temps la plus intéressante est, ainsi que je l’ai déjà dit, celle qui est actuellement conservée à Lyon dans le Palais des Arts. Elle a été publiée seulement en 1882 par le professeur Wendelin Fœrster, dans un petit volume in-8 analysé plus haut. La seconde traduction, qui paraît être du commencement du xive siècle, se trouve avec des variantes nombreuses dans les quatre manuscrits {p. 636}français de la Bibliothèque nationale 1594, 1595, 19123 et 24310, dans le manuscrit XIII de la Grenville library et dans le manuscrit 11193 de la Bibliothèque royale de Bruxelles. La publication s’en est aussi fait bien longtemps attendre ; car c’est M. Robert qui, en 1825, l’a pour la première fois entreprise à l’aide du manuscrit 1594.
§ 2. — Traductions allemandes. §
Il a été fait au moyen âge des traductions allemandes, tant en prose qu’en vers, des fables de Walther.
En ce qui touche les traductions en prose, je n’en veux
signaler qu’une. Dans la bibliothèque de Wolfenbüttel, sous la
cote 81. 16, Aug., j’ai trouvé un manuscrit in-4º de grand
format, pouvant être considéré comme contenant une traduction en prose des
fables de Walther, qui, ainsi que la plupart de celles du moyen âge, est
plutôt une paraphrase qu’une véritable traduction. Encore n’est-elle que
partielle. Commençant à la deuxième colonne du feuillet 58 b
et se terminant à la deuxième du feuillet 68 a, elle ne
comprend que vingt-quatre fables, et, comme elle est close par les mots :
Et sic est finis
, il est clair que, si
elle est incomplète, c’est, non parce qu’elle a été en partie perdue, mais
parce que le paraphraste n’a pas ou possédé ou voulu mettre en langue
allemande la totalité du texte latin. Voici les numéros, que les vingt-quatre
fables portent dans le texte latin, rangés dans l’ordre adopté dans le
manuscrit pour celles qui en sont la traduction allemande : 1, 2, 3, 5, 4, 6,
7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 19, 20, 21, 26, 27, 22, 28, 31.
Quant aux traductions en vers, il y a une œuvre qui pourrait être rangée parmi elles : je veux parler des fables du vieux et fameux poète Boner, qui, en partie du moins, semblent avoir été la paraphrase allemande de celles de Walther et qui dans plusieurs manuscrits, probablement à ce titre, y ont été jointes. Mais, quoique je sois bien tenté de les étudier et qu’ici une pareille étude serait bien à sa place, les développements qu’elle exigerait me déterminent à ne pas l’entreprendre.
§ 3. — Traductions anglaises. §
On ne peut guère regarder comme des versions des fables élégiaques celles de Caxton et des autres lettrés anglais, qui, en traduisant {p. 637}les trois premiers livres du Romulus ordinaire, ont, sans le vouloir ou sans le savoir, paraphrasé dans leur langue l’œuvre de Walther. Au surplus, en donnant l’analyse des traductions de ce Romulus, je les ai fait assez connaître pour n’avoir pas à y revenir.
Quant à des traductions anglaises directement faites sur les distiques latins, j’ignore s’il en existe. M. Fleutelot, dans la Préface qu’il a mise en tête de sa traduction de Phèdre, s’est trompé quand il a affirmé que Wynkyn de Worde avait imprimé à Londres, en 1503, une traduction anglaise des fables de Walther. En effet il n’en a fait paraître que le texte latin avec un commentaire semblable à celui qui l’accompagne dans la plupart des éditions des huit auteurs.
Bref, je ne puis, en ce qui touche les traductions anglaises, que déclarer que je n’en connais aucune.
§ 4. — Traductions italiennes. §
En Italie, il en a été autrement : les fables de Walther, dans les derniers siècles du moyen âge et au commencement de la Renaissance, ont été traduites tant en prose qu’en vers.
1º Traductions en prose faites au moyen âge. §
Les traductions qui ont été faites au moyen âge, nous ont été conservées dans des manuscrits dont quelques-uns, au cours tant du siècle dernier que du siècle actuel, ont été plusieurs fois publiés, et qui notamment ont été consciencieusement étudiés par M. Gaëtano Ghivizzani dans deux petits volumes in-8º édités à Bologne en 1866. C’est de ces manuscrits et des éditions qui en ont paru que je vais d’abord m’occuper.
I. — Manuscrits. §
A. Bibliothèque Riccardienne. §
Quoique ayant fréquenté la Bibliothèque Riccardienne, je n’ai pas examiné les manuscrits qu’elle possède des traductions en langage vulgaire des fables de Walther. C’est d’après l’ouvrage de M. Ghivizanni que j’en vais donner une analyse d’ailleurs très sommaire.
Manuscrit 1338. §
Ce manuscrit, qui a été écrit sur papier au xive siècle par une seule main, forme un volume de 109 feuillets. Les feuillets 61, 81 b, 82, 96 b, 97, 98, 99 et les quatre derniers sont blancs.
La traduction des fables en langue vulgaire commence au feuillet 49, {p. 638}qui portait autrefois le nº 51, et finit au feuillet 61. Les titres sont écrits à l’encre rouge, et chaque fable est suivie de sa moralité, sans démarcation qui les sépare.
Manuscrit 1088. §
Ce manuscrit, autrefois coté O. IIII. XLII, est un volume in-fol. dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture est du xive siècle. Les cinquante-trois fables en prose italienne qu’il possède sont contenues dans douze feuillets et se terminent au recto du douzième. Ce sont celles qui ont été publiées par Rigoli en 1818.
Manuscrit 1591. §
La traduction que ce manuscrit renferme est la même que celle d’un autre plus ancien appelé Mocenigo par M. Ghivizzani, du nom de la famille patricienne à laquelle il a appartenu, et, selon lui, il mérite d’être examiné à cause de quelques variantes et corrections tirées d’autres manuscrits et probablement écrites par Smunto ou par Annebiato, ses anciens possesseurs, dont les noms figurent en tête.
Manuscrit 1645. §
La traduction contenue dans ce manuscrit se rapproche, d’après M. Ghivizzani, tantôt du manuscrit Mocenigo, tantôt de ceux de la Laurentienne, mais différencié par des variantes et un peu modernisé.
Manuscrit 2805. §
Ce manuscrit est une simple copie du manuscrit Mocenigo.
Manuscrit 1600. §
Sans plus d’importance est ce manuscrit qui renferme la même traduction.
Si l’on s’en rapporte aux numéros des fables, il en existe soixante-quatre ; mais, par erreur, le nº 40 a été donné à celle qui suit la trente-huitième. Il s’ensuit qu’il n’en possède en réalité que soixante-trois.
Manuscrit 1764. §
Ce manuscrit renferme deux fables en prose intitulées,
l’une : Della Capra che pasciera nel
monte
, l’autre : Della Cichala et
della Formica
, dont la rédaction diffère de celle des
mêmes dans les autres manuscrits.
Manuscrit 2971. §
Ce manuscrit, écrit sur papier, renferme trois fables en
vers ; la première sans titre, qui est celle Del Topo di
cità e del Topo di villa ; les deux autres intitulées, l’une :
Della Gholpe e del Lupo
, l’autre :
Della Formicha.
Manuscrit 1939. §
Ce manuscrit, dont les feuillets sont en papier et dont
l’écriture est du xve siècle, contient
une fable en vers intitulée : Una favola d’Isopo
della Testuggine.
B. — Bibliothèque Laurentienne. §
{p. 639}Ayant pris connaissance des manuscrits de cette Bibliothèque, j’en vais donner une analyse moins brève que celle qui précède.
Manuscrit Gadd. reliqui CLXXVI. §
Ce manuscrit, appartenant à l’un des fonds de la Bibliothèque Léopoldine, qui elle-même est passée dans la Laurentienne, forme un volume in-4º, composé de 64 feuillets en parchemin dont l’écriture italienne à longues lignes est du xive siècle.
Il ne contient que la version italienne en langue vulgaire des fables de Walther par un traducteur Siennois.
Le recto du premier feuillet, où commence le prologue, est orné d’un encadrement et d’une lettre initiale enluminée et dorée.
Le prologue débute ainsi : Esforçasi
la presente scriptura, acciochè con diletto faccia utilità,
elleggiere ricitato per novelle si vuole maggiormente dilettare
l’animo del leggitore.
Il se termine par ces mots :
e in vile et aspro vasello si nasconde cosa
carissima, e di grande dolciezza.
Les fables ne portent
pas de titres ; chacune d’elles est agrémentée d’une miniature dont le
dessin et le coloris sont, l’un et l’autre, également défectueux. Le
copiste ayant laissé au bas des pages un espace blanc destiné à les
recevoir, c’est là qu’elles se trouvent. Leur nombre est de
soixante-deux résultant de la traduction des soixante fables de Walther
et des deux qui en sont le complément habituel. La première fable est
celle du Coq et de la Perle, qui commence par les mots : Per una stagione con grande solecitudine.
Voici comment finit celle du Loup et du Berger, qui est la dernière :
Et per lo puro e simplice pastore colui che
parla ciò che egli à in cuore. Amen.
Le tout se termine au feuillet 62. Les deux derniers sont blancs.
Le catalogue in-fol. des manuscrits de la bibliothèque Léopoldine donne du manuscrit une analyse détaillée461.
Manuscrit Plut. 42. Cod. 30. §
Ce manuscrit forme un volume in-4º, dont les quarante-huit feuillets en papier portent une écriture italienne de la fin du xive siècle, à deux colonnes sur les 29 premiers et à longues lignes sur les autres.
{p. 640}Les quarante-six fables
ésopiques en langue vulgaire qu’il renferme commencent au
feuillet 30 a et se terminent au feuillet 48 b. Il leur a été donné un titre général ainsi conçu :
Questo libro e apellato Esopo rechato di grammatica
, etc. Puis vient un prologue
dont voici le début : Quelli che sanno le scritture,
devrebbono bene mettere le loro cure nelli buoni
exempli.
En voici la fin : Et questa
Pistola mando egli scripta al suo maestro in lingua Grecha, et poi
si trallatò in Francesco, et ora la traslatato in
latino.
Les fables sont pourvues chacune de deux titres, l’un pour elle-même, l’autre pour sa moralité.
Leur texte est très différent de celui du manuscrit Gadd. 176. et ressemble au contraire beaucoup à celui du manuscrit palatin publié à Lucques par Minutoli.
La première fable, qui est intitulée : Del Gallo
, commence par ces mots : Dicie che uno Ghallo andando per prochacciare sua vivanda
sue per uno monte di letame
, etc.
La quarante-sixième et dernière, intitulée : D’una sconcordia di prezzo d’uno muletto trall’ un
venditore el comperatore
, finit ainsi : E lo buono huomo si ripigliò lo puledro suo, e andossene
via con esso, et par bene parlate sue liberato.
Le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Laurentienne donne du manuscrit une analyse détaillée462.
C. — Bibliothèque Magliabecchienne ou Nationale. §
Manuscrit II, II, 83. (Cl. XXI. palch. II). §
Ce manuscrit est un gros volume in-4º de grand format, dont les feuillets en papier sont au nombre de 252, et dont l’écriture, due à une main italienne, est de la fin du xive siècle.
Il est composé de pièces diverses, dont la première, contenue dans les soixante-quinze premiers feuillets, consiste dans l’Esopo volgarizzato per uno da Siena.
Les fables ne sont pas pourvues du long préambule qui les
précède dans le manuscrit Gadd. 176 de la Bibliothèque
Laurentienne ; mais elles débutent par cette invocation, qu’il ne
possède pas : A nome di Dio Amamen !
et
à la suite de laquelle on lit ce titre : Questo
libro si chiama isopo volgarizzato per uno
dassiena.
{p. 641}Elles viennent immédiatement après ce titre, ornées chacune d’un dessin à la plume grossièrement colorié.
La première est annoncée par ces mots : Il comincia dal gallo che ne traua dellescha nella brutture
e trouo la pietra preziosa.
Sous 64 titres, dont deux, comme dans beaucoup de
manuscrits latins, ont été attribués à la fable des Grenouilles
demandant un roi, les fables sont seulement au nombre de 63. Celle qui
porte le nº 64 est intitulée : Della Golpe et del
Granchio
; elle n’existe dans aucun autre manuscrit.
Elle se termine au feuillet 74 b.
Telle est la première pièce du manuscrit. Les autres ne se rapportent pas à la fable ésopique, pour abréger, je m’abstiens de les analyser.
Manuscrit 375 Varior. (classe VII, palch. 9). §
Ce manuscrit contient la traduction en vers de quelques fables dont voici les titres :
Fol. 92 b. Favola del Lione e dell’Uomo.
Fol. 96 b. Favola della Gholpe e del Lupo.
Fol. 97 b. Favola della Gholpe, del Lione e Lupo e Pechora.
Fol. 99 b. Favola del Lione e del Topo che dà noia.
Fol. 100 b. Favola del Topo cittadino e del Topo contadino.
M. Gaetano Ghivizzani, à qui j’emprunte cette
nomenclature, affirme, dans son ouvrage intitulé : Il Volgarizzamento delle Favole di Galfredo
463, que les deux premières de
ces fables ne se trouvent, à sa connaissance, dans aucune des
traductions italiennes en prose.
Manuscrit 92 du fonds Palatin464. §
Ce manuscrit, dont l’écriture est du xve siècle, est un volume in-fol. de 277 millimètres sur 212, composé de 86 feuillets en papier chiffrés par une main ancienne, dont le cinquante-sixième et les deux derniers sont blancs. En outre, il existe en tête quatre feuillets non chiffrés, dont les deux premiers renferment la table et les deux autres sont blancs.
Au bas de la première page de la table se trouve cet
ex-libris : Questo libro è di Piero di Simone Del
Nero, donatomi da Ser Antonio già Sagrestano degli Innocenti,
addi........ d’ottobre 1580.
{p. 642}À la marge supérieure du
feuillet 61 a, on lit la date suivante : A di 20 di Mago 1523.
Le manuscrit renferme deux ouvrages mentionnés en ces
termes par M. Palermo : 1º Volgarizzamento, parte
intero e parte abbreviato, della somma di Frate Lorenzo Gallo,
attribuito a Sere Zucchero Bencivenni
; 2º Esopo volgare.
Comme celles du manuscrit de la Laurentienne Plut. 42, Cod. 30, auxquelles elles ressemblent beaucoup, les fables de cet Esopo volgare sont seulement au nombre de quarante-six.
Manuscrit 200 du fonds Palatin465. §
Ce manuscrit, qui est du xve siècle, est un volume in-fol. de 294 millimètres sur 215, formé de 117 feuillets en papier chiffrés par une main moderne.
L’écriture à deux colonnes est de plusieurs copistes. Les
feuillets 35 à 38, 49 et 85 sont blancs. À la fin, on lit : die xxvi ianuarij hora tertia iam preterita
M.cccc.lxxiij.
Les Favole di Esopo in
volgare
occupent les feuillets 31 a
à 34 b. Il n’y en a que quatorze. La première est
intitulée : Del Ghallo e della Pietra
preziosa
, et la dernière : Del Lupo e
della Grua.
D. Bibliothèque communale de Sienne. §
Manuscrit A. VIII. 8. §
Ce manuscrit, dont les feuillets sont en papier et qui
n’est que la copie d’un vieux codex faite au siècle dernier, commence
ainsi : Questo libro si chiama Isopo volgarizzato
per uno da Siena. Et comincia del Ghallo che cerchava dell’ escha nella
bruttura e trovò la pietra preziosa. Cap. Primo.
Les chapitres sont au nombre de 63. La fable que renferme
le dernier est celle Del Pastore e del Lupo. Elle est
suivie de cette souscription : Finito el libro
d’Ysopo del quale piaccia a Dio che chi lo leggie ne tragga qualche
frutto. Amen.
E. — Bibliothèque de Vérone. §
Manuscrit 528-29. §
Ce manuscrit, que M. Ghivizzani ne mentionne pas, et qu’il ne paraît pas avoir connu, se compose de 68 feuillets en parchemin, dont l’écriture italienne à longues lignes est du xve siècle.
Il est tout entier rempli par la traduction des fables de Walther en langage vulgaire per uno da Siena.
Comme dans le manuscrit Gadd. 176 de la
Laurentienne, les fables sont précédées d’un prologue, qui, au recto du
premier feuillet, commence en ces termes : Sforza si
la presente scriptura
, etc.
{p. 643}Elles ne portent pas de titre général. L’espace blanc qui, au-dessus du prologue, avait été ménagé pour le recevoir, n’a pas été rempli.
Elles sont ornées de miniatures qui, comme celles du manuscrit Gadd. 176, occupent le bas des pages.
F. — Bibliothèque Trivulzienne. §
Manuscrit N. 133. §
Ce manuscrit, du format in-fol., n’est composé que de vingt-neuf feuillets en papier dont l’écriture est du xve siècle.
Les vingt-cinq premières pages sont occupées par les Favole di Esopo volgarizzate per uno da Siena.
Ces fables, en dialecte toscan, sont, tant par la disposition que par les leçons, d’accord avec celles du manuscrit Mocenigo, sur lequel a été faite par l’abbé Berti l’édition de Padoue de 1811.
Elles sont précédées d’une introduction qui commence par
ces mots : Isforzasi la presente scriptura acciochè
de diletto faccia utilità
, et qui, manquant dans
l’édition Berti, se trouve au contraire avec des leçons différentes dans
celle de Manni publiée à Florence en 1778.
Dans ce manuscrit, la fin des fables est ainsi annoncée :
Qui si termina lo pocciolo Ysopacto, et sempre
sia Dio laudato et benedicto ! Amen.
Cette mention
finale existe en termes un peu différents dans l’édition Berti et manque
complètement dans l’édition Manni.
Les fables sont suivies du Libro di
Cato, qui lui-même est terminé par cette souscription :
Finito el libro di Cato sia Xpo benedico e
laudato.
G. — Bibliothèque de Ferrare. §
Manuscrit 340. NB. 5. §
Ce manuscrit, qui autrefois portait la cote 1267, consiste dans un cahier in-fº de petit format, composé de soixante feuillets en papier dont l’écriture est du siècle dernier.
Voici comment, dans le Catalogue de la Bibliothèque, il
est analysé : Copia fedele tratta dall’ originale
edictente presso il Dr Anto
Ma Salvini nel 1719. Vide Meletius monachus
no 34.
C’est donc un simple
apographe.
Il contient l’Esopo volgarizzato per uno da
Siena, qui commence au recto du deuxième feuillet par ce double
titre : Questo libro si chiama Isopo volgha||rezzato
per uno da Siena. Et cho||minça del ghallo che cerchaua || dellescha
nella bruttura, e trouò la || prieta preziosa.
{p. 644}Comme on le voit, il n’y a pas
de préambule : le titre général est immédiatement suivi de la première
fable, qui commence par ces mots : Per una stagione
chon grande sollecitudine chauando
, etc.
Les fables se terminent au bas du recto du feuillet 59
par cette souscription : Finito. El libro di ysopo
del quale piacca || Addio che chi lo leggio ne tragha qualche ||
frutto. Amen.
Le soixantième et dernier feuillet est blanc.
H. — Bibliothèque Phillips. §
Manuscrit 2749. §
Cet intéressant manuscrit, non cité par M. Ghivizzani, qui, ayant limité ses recherches à quelques bibliothèques italiennes, n’avait pu le connaître, est un petit volume in-4º composé de 98 feuillets chiffrés en parchemin dont l’écriture à longues lignes est du xve siècle.
Le premier des ouvrages qu’il renferme est une traduction italienne en langue vulgaire des fables de Walther.
Il y a d’abord, en tête du volume, deux feuillets blancs
ou presque blancs. Puis, au recto du troisième, vient la nomenclature
des fables, annoncée en ces termes : Qui commencia
li capitoli de Eso-||po et prima fa il suo prologo.
Cette nomenclature indique soixante-quatre chapitres ;
mais en réalité il n’existe que soixante-deux fables, les soixante
authentiques et les deux le plus ordinairement ajoutées sous les titres
De Capone et Ancipitre et De Lupo et
Pastore. Le nombre des numéros s’élève à soixante-quatre, parce
qu’il y en a deux affectés au prologue et au préambule de la fable des
Grenouilles qui demandent un roi. La table est close
par cette souscription : Finiscono li capitoli de
Esopo.
Au-dessous commence une préface surmontée de ce titre :
Incomīcia il prologo soura la tras||lacione de
Esopo de gramaticha || in volgare.
Cette préface est
terminée par ces mots : Compie el prologo dello
traslatore de gramatica in volgare.
À la suite de la préface du traducteur vient le véritable
prologue précédé de ce titre : Comīcia el prohemio
exposto soura Exopo.
Tous les titres et souscriptions sont à l’encre rouge.
Puis commencent les fables, suivies chacune d’une morale, qui porte pour titre le mot Notabile écrit aussi à l’encre rouge, et qui est précédée de l’épimythion latin de la fable traduite. Les fables se terminent au verso du feuillet 81.
Elles sont suivies d’un opuscule également en langue
italienne {p. 645}vulgaire, dont la nature est indiquée par ce
titre : Qui comenza le dodexe fatige de
Hercule
, etc., et qui se termine au recto du feuillet 97
par cette souscription : Deo gracias. Amen ||
Compito de Scriuer adi ultimo mazo 1449 cite de
asopiar.
Le verso du feuillet 97 et le feuillet 98 sont remplis
par une longue épître italienne intitulée : Epistola
ad. D. P. Sano.
Enfin le volume possède deux derniers feuillets en parchemin qui n’ont pas été utilisés, et par suite, comme les deux premiers, n’ont pas été numérotés.
II. — Imprimés. §
Après l’analyse des manuscrits, il y a lieu de passer en revue les imprimés.
1496. §
La plus ancienne édition des Favole di Esopo volgarizzate est celle qui a été imprimée en 1496 par Francesco Bonaccorsi.
Il en existe, à la Bibliothèque Riccardienne, un exemplaire malheureusement incomplet, qui, dans le Catalogue des Incunables, porte le nº 560. Mais je ne l’ai pas vu, et c’est d’après la description qui en a été faite par M. Ghivizzani que je le mentionne.
Non chiffré, il est signé de a à q et porte au verso du dernier feuillet la souscription
suivante : Impresso || in Firenze per ser France-||sco
Bonaccorsi ad instatia di || Ser Piero Pacini Anno Domini ||
M.cccc.lxxxxvi || A di xvii. di Septembre.
Le volume contient non seulement la traduction en prose des fables de Walther, mais encore celle en vers d’Accio Zuccho, dont il sera question un peu plus loin. Les deux sonetti, l’un materiale, l’autre morale, par lesquels Zuccho a traduit chaque fable latine, sont suivis de la fable correspondante en prose italienne.
Quoique la traduction en langage vulgaire ne soit pas
l’œuvre de Zuccho, dans l’Inventario e stima della Libreria
Riccardi publié à Florence en 1810, le contenu du volume est, à la
page 60, indiqué par ces simples mots : Esopo favole
volgarizzate da Accio Zucco.
Les leçons du texte en prose italienne ont la plus grande ressemblance avec celles du manuscrit de la Laurentienne Gadd. reliqui 176. Il s’ensuit que la version imprimée par Bonaccorsi est celle du traducteur de Sienne.
1778. §
Volgarizzamento || delle favole || di
Esopo. || Testo antico || di lingua Toscana || non
più stampato.
Au-dessous de ce titre est une vignette
accompagnée de cette légende : Il piu bel fior || ne
coglie.
Plus bas on lit : In Firenze
MDCCLXXVIII. || Nella stamp. di Giuseppe Vanni || con Lic. de’
Super.
Édition in-8º de xliv-204 pages.
Suivant M. Ghivizzani, le texte en dialecte toscan que porte cette édition a été tiré d’un manuscrit de la Bibliothèque Farsetti passé ensuite dans la Marcienne, et l’édition elle-même a été préparée par l’abbé Domenico-Maria Manni, qui a fait précéder les fables d’une savante préface.
Par suite de la division en deux de la fable des Grenouilles demandant un roi, qui porte les nos 15 et 16, elles sont, sous 63 numéros, au nombre de soixante-deux seulement.
La Bibliothèque Bodléienne, sous la cote Mortara 464 ; la Marcienne, sous la cote CXXXIII. A. 3. 46776 ; l’Ambrosienne, sous la cote S. Ṉ. A. VI. 23 ; la Bibliothèque de Vérone, sous la cote 183.4, enfin la Bibliothèque de Bergame détiennent chacune un exemplaire de cette édition.
1782. §
Volgarizzamento delle Favole di Esopo. Testo Antico di lingua toscana per la seconda volta stampato. In Firenze MDCCLXXXII. Nella stamperīa di Lorenzo Vanni.
Il ne faut pas voir ici une réimpression de l’édition de 1778 : on est en présence de cette édition elle-même, que, par un artifice de librairie, on a rajeunie, en en changeant le frontispice.
1811. §
Esopo || volgarizzato || per uno da Siena || testo di lingua. || Padova || nel Seminario || MDCCCXI.
Cette édition, qui forme un volume in-8º de grand format composé de xx-196 pages, a été tirée du manuscrit Mocenigo. Elle a été préparée par l’abbé Pietro Berti, qui l’a enrichie d’une préface et d’un vocabulaire. Il en a été tiré des exemplaires tant sur parchemin que sur papier.
Des premiers l’un existe à la Bibliothèque Bodléienne, sous la {p. 647}cote Mortara 1109, et quelques-uns des derniers sont conservés dans les bibliothèques italiennes et notamment dans l’Ambrosienne, sous la cote S. N. D. X. 17 ; dans la Marcienne, sous la cote CXXXII. 4. 46381 ; dans la Bibliothèque de l’Université de Bologne, sous la cote A. IV. Z. VII. 26, et dans celle de Vérone, sous la cote 191. 7.
1818. §
Esopo || volgarizzato || per uno da Siena || testo di lingua. || Brescia || per Niccolò Bettoni || 1818.
Cette édition forme un volume in-8º de iv-128 pages, qui est la réimpression du manuscrit Mocenigo édité par Berti, privée toutefois de l’Avertissement de l’éditeur et du Vocabulaire.
La Bibliothèque de l’Université de Bologne, sous la cote A. V. Capsula 181. nº 16 ; celle de Vérone sous la cote 178. 1 et celles de Brescia et de Bergame en possèdent chacune un exemplaire.
— Volgarizzamento || delle favole ||
di Esopo || testo Riccardiano || inedito || citato
|| dagli Accademici || della Crusca.
Comme dans l’édition de 1778, le frontispice au-dessous de
ce titre est orné d’une vignette où sur une banderole se lisent ces mots :
Il piu bel fior ne coglie.
Plus bas
le frontispice se complète ainsi : Firenze || nella
stamperia del Giglio || 1818. || A spese di Angiolo Garinei
Librajo.
Cette édition, qui forme un volume in-8º de 120 pages, est la première de la traduction contenue dans le manuscrit 1088 de la Bibliothèque Riccardienne. Elle a été préparée par l’académicien Louis Rigoli.
Les fables, précédées d’un préambule, commencent à la page 20. Leur nombre est de cinquante-trois seulement ; encore sont-elles loin de se rapporter toutes à Walther ; elles sont pour la plupart la version ou, pour être plus exact, la paraphrase tant du Romulus ordinaire que du Romulus anglo-latin.
La Bibliothèque Bodléienne, sous la cote Mortara 656 ; l’Ambrosienne, sous la cote S. C. G̱. VIII. 32 ; celle du palais Brera, la Marucellienne, sous la cote I. N. VII. 15 ; la Marcienne, sous la cote CXXXIII. A. 6. 46869 ; la Bibliothèque d’Este à Modène, sous la cote A. XXXIX. GG. 33, et celle de Vérone, sous la cote 183. 1, possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
1837. §
Favole || di Esopo Frigio || volgarizzate || per uno da Siena || precedute || da || elegante prefazione || del ch. abate || Michele Colombo || Testo di lingua || Parma || Dai tipi di Pietro Fiaccadori || MDCCCXXXVII.
Cette édition est contenue dans un petit volume in-32 de 156 pages.
La Bibliothèque de Vérone, sous la cote 181. 1, et celle de Bergame en possèdent chacune un exemplaire.
1840. §
Esopo || volgarizzato || per uno da Siena, || testo di lingua. || Livorno. || Presso la libreria Gamba, || 1840.
Édition in-18 de 136 pages, dont un exemplaire existe dans la Bibliothèque de Vérone.
1847. §
Esopo || volgarizzato || per uno da Siena || testo di lingua || ridotto || all’uso della gioventu || ed a migliore lezione. || Verona tip. Libanti MDCCCXLVII.
Édition in-12 de xxvi-91 pages, dont il existe des exemplaires à la Bibliothèque Marcienne, sous la cote 52710, et à celles du palais Brera et de Vérone.
1851. §
Esopo || volgarizzato || per uno da Siena || ad uso || Della Gioventu || Testo di Lingua. || Udine. || Onofrio Turchetto Tip. Edit. || 1851.
Édition en 1 volume in-16 de v-141 pages, dont la Bibliothèque Marcienne, sous le nº 58848, et celle de Vérone possèdent chacune un exemplaire.
1854. §
Esopo || volgarizzato per uno da Siena || testo di lingua || ridotto || al uso della gioventù ed a migliore lezione || vì si aggiungono || Le Favole || e || le regole per bene scrivere Italiano || di || P. Giuseppe Manzoni. || Venezia, 1854. || Nel priv. stabilimento nazionale || di G. Antonelli ed.
Édition en 1 volume qui est le vingt-sixième d’une
collection {p. 649}d’ouvrages destinés à l’instruction
de la jeunesse. En conséquence, indépendamment du frontispice qui lui est
spécial, elle en porte un premier plus général qui est ainsi conçu :
Bibliotheca || dei || Giovani colti ed onesti ||
cioè || Raccolta di operette || in prosa ed in versi
|| atte a formare la mente ed il cuore della gioventù || dilettando
ed instruendo. || Volume XXVI. || Venezia, 1854. || nel Priv.
stabilimento nationale || di G. Antonelli ed.
Le volume appartient au format in-16. Il se compose de xv-199 pages chiffrées.
La version italienne des fables de Walther per
uno da Siena occupe les pages 1 à 69. Les pages 71 à 82 sont
remplies par une addition intitulée : Appendice di
Favole scelte dal Testo Riccardiano.
Comme les quatre précédentes, cette édition paraît avoir été calquée sur celle que l’abbé Berti avait publiée en 1811, d’après le manuscrit Mocenigo.
La Bibliothèque de l’Université de Bologne sous la cote Tab. VII. B. III 52 ; celle de l’Université de Ferrare, sous la cote L. 3. 6, et celle de Vérone, sous la cote 182.1, possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
1856. §
Esopo volgarizzato per uno da Siena. Testo di lingua ridotto ad vso della Gioventù ed a miglior lezione. Verona tip. Bibante, 1856.
Édition en 1 volume in-8º préparée par le savant P. Sorio, qui s’est servi du manuscrit Mocenigo, en le corrigeant, dans les passages qui lui semblaient erronés, à l’aide du manuscrit Farsetti publié par Manni.
Cette édition a été mentionnée et appréciée par M. Ghivizzani dans celle qu’il a fait paraître en 1866.
1864. §
Favole d’Esopo || volgarizzate per uno da Siena || cavate del codice Laurenziano inedito || e riscontrate || con tutti i codici Florentini e col Senese. || Felice Le Monnier || 1864.
Édition in-8º de iii-172 pages, dans laquelle
est pour la première fois publié le texte du manuscrit Gadd. reliqui 176 et qui contient trois fables, d’après l’éditeur
inédites, intitulées : Della Volpe e del {p. 650}Granchio
, Del Mercatante e della
sua Moglie
, Del Villano che moriva e
del Diavolo
.
Elle a été élaborée par MM. Ottaviono Targioni, Tozzeti et Torquato Gargani qui avaient l’intention d’ajouter au texte du manuscrit de la Laurentienne trois autres versions anciennes, en langage vulgaire, des fables ésopiques. Mais M. Gargani étant décédé et M. Targioni ayant été absorbé par d’autres occupations, le libraire Le Monnier dut ne faire paraître que le texte de ce manuscrit, avec une courte préface dans laquelle le professeur Pietro Dazzi explique pour lui le motif qui l’a obligé à limiter ainsi sa publication.
Il en existe des exemplaires à la Bibliothèque de l’Université de Bologne, sous la cote A. V. RR. XIII. 10 ; à la Maruccellienne sous la cote 7. J. VI. 49, et à la Marcienne, sous la cote 69863.
— Favole di Esopo in volgare. Testo di lingua inedito dal Codice Palatino già Guadagni.
Lucca, Giuseppe Giusti, 1864.
Édition in-8º en un volume de 166 pages. C’est la première qui ait été publiée du texte du manuscrit 92 de la Bibliothèque Palatine. Malheureusement elle est plus luxueuse que correcte.
Il en existe un exemplaire à la Bibliothèque du palais Brera.
1866. §
Il volgarizzamento || delle || favole di Galfredo || dette di Esopo. Testo di lingua || edito per cura || di Gaetano Ghivizzani || con un discorso || interno la origine della Favola, la sua ragione storica || e i fonti del || volgarizzamenti italici. || Bologna || presso Gaetano Romagnoli || 1866.
Édition en deux volumes in-8º de petit format, composés, le premier, de ccxvii pages, le second, de 288.
Le premier contient, de la page vii à la page clii, la dissertation annoncée dans le frontispice, de la page cliii à la page clviii, une Tavola delle opere consultate o citate, de la page clxi à la page clxxxix, une Bibliografia dei volgarizzamenti manoscritti delle Favole di Esopo et delle loro edizioni a stampa, enfin, de la page cxcv à la page ccxvii, trois tables. Le second volume renferme de la page 1 à la page 261, le texte de 97 fables en prose italienne puisé dans divers manuscrits anciens, de la page 263 à la page 267 quelques additions et corrections (giunte e correzioni), enfin de la page 269 à la page 285, trois tables.
{p. 651}Il existe un exemplaire de cette édition dans la Bibliothèque nationale à la réserve du département des imprimés ; un autre dans celle du British Museum, sous la cote 12226. bbb, et d’autres dans diverses bibliothèques de l’Italie et notamment dans celle du palais Brera.
1870 et 1881. §
Esopo volgarizzato per uno da
Siena. Testo di lingua. Milano, Guigoni,
1870.
Édition in-16 qui a été réimprimée pour le même éditeur,
en 1881, dans le format in-24.
L’édition et la réimpression sont, au palais Brera, représentées chacune par un exemplaire.
2º Traduction en vers d’Accio Zuccho. §
De même que la première traduction des fables du Romulus ordinaire avait paru en Allemagne, de même ce fut en Italie que fut publiée la première traduction des fables de Walther.
1479. §
Un lettré de Summa Campagna, Accio Zuccho, les ayant mises en vers italiens466, son œuvre, sous forme de sonnets écrits dans le dialecte véronais, fut imprimée pour la première fois à Vérone, en 1479.
Cette première édition forme un volume in-4º de petit format, composé de 120 feuillets non chiffrés, mais signés de a à p et répartis entre quinze cahiers de huit feuillets chacun.
Le recto du premier feuillet est orné d’une gravure sur bois circonscrite dans un encadrement de forme gothique qui remplit toute la page. L’auteur y est représenté à genoux devant Ésope à qui il offre sa traduction.
Le verso du même feuillet est entièrement occupé par le sonnet suivant :
(S) api chio son Esopo : o tu lettore :A cui gli detti mei di leggier piace.Gia latino e vulgare fui fallaceE mendoso per colpa del scrittore.Hora son stato in man di correttore :Che in latino e vulgar con mia gran pace :{p. 652}Esser me fa : come gia fui : veraceEsopo et Accio Zuccho translatore.Le cose : che a fanciulli et a ignorantiVano per man : soglion perder sua formaE mutar spesse volte soi sembianti.Vien poi chi per pieta quelle reformaReducendole a quel : cheranno innantiOndio correcto son sotto tal norma.Da Giovanni Aluise e da compagni suiCon diligentia bene impresso fui.
Voici la traduction de ce sonnet :
« Ô toi lecteur, à qui plaisent mes récits, apprends que je suis Ésope. J’ai déjà paru en latin et en langue vulgaire, mais sous une forme fallacieuse et mensongère par la faute de l’écrivain. — Aujourd’hui j’ai passé sous la main du correcteur, qui, à ma grande satisfaction, m’a fait reparaître en latin et en italien, tel que j’ai été déjà, l’Ésope authentique traduit par Accio Zuccho. — Les choses qui circulent dans les mains des enfants et des ignorants ont l’habitude de perdre leur forme et de changer souvent d’apparence. — Vient ensuite un homme qui avec un zèle pieux les réforme, en les ramenant à leur figure ancienne. C’est ainsi que je reparais corrigé. — J’ai été imprimé avec soin par Giovanni Aluise et par ses associés. »
Ce sonnet est suivi de ce sixain en vers élégiaques conçu dans le même esprit :
Esopus fueram deformis : non satis istudAd lasanum stabam sordibus : atque lacer.Hic cartam : hic numeros laniaverat : arte resartusNunc docta : metuo non piper : uncta garumMe lege : nec ludo tibi sit mea fabula lector :Utiliter salibus seria mixta dabit.
Le recto du second feuillet a été réservé à ce titre en
grandes capitales : Accii Zuchi Summa Campaneae
Veronensis viri eruditissimi in Aesopi fabulas interpretatio per
Rythmos in libellum Zucharinum inscriptum contexta foeliciter
incipit.
À ce titre général succèdent deux sonnets
servant de préambule, l’un, au verso du même feuillet {p. 653}intitulé : Proemio
, l’autre au recto du
troisième feuillet intitulé : Idem.
Au
verso de ce feuillet on lit, placés au centre d’une gravure représentant
une sorte de piédestal, ces mots : Lepidis-||simi ||
Aesopi || Fabel-||lae.
Immédiatement après viennent en effet les fables latines
avec leur traduction italienne. Chacune d’elles est immédiatement suivie
de deux sonnets intitulés, l’un : Sonetto
materiale
, l’autre : Sonetto
morale.
À chaque sonnet, en sus des quatorze vers exigés
par notre prosodie, s’ajoutent deux vers complémentaires.
Alors que la plupart des manuscrits qui nous sont parvenus ne contiennent que 60 ou 62 fables, Accio Zuccho a traduit la soixante-troisième et la soixante-quatrième, qu’ils ne renferment que très rarement. L’édition se compose même de 66 numéros ; mais cela tient à ce que le prologue Ut juvet et le préambule de la fable De Ranis et Hydro sont comptés pour deux fables. Les quatre fables ajoutées aux soixante de Walther sont les suivantes : De Capone et Accipitre ; De Pastore et Lupo ; De Mercatore et eius uxore ; De Rustico et Plutone. Chaque fable est ornée d’une gravure sur bois qui occupe une page entière et le plus souvent est intercalée entre le texte latin et le Sonetto materiale.
Au bas du recto du feuillet p 3 se trouve
cette souscription : Impressum Veronae die ||
XXVI Junii. M.CCCC.LXXVIIII.
Au verso du même feuillet
commence une Concionetta qui se termine au milieu du
recto du feuillet suivant. Puis immédiatement vient une Canzon morale, qui finit au haut du recto du feuillet p 7, et qui est immédiatement suivi d’un Ave
Maria affectant la forme d’un sonnet italien. À tout cela s’ajoute
la table à laquelle sont consacrés le verso du feuillet p 7 et le feuillet p 8 et dernier.
La Bibliothèque du British-Museum, sous la cote C. 1. a. 5 et la Grenville Library, sous la cote 7729 possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
1483. §
Publiée d’abord dans le nord de l’Italie, l’œuvre d’Accio Zuccho reçut bientôt dans le centre les mêmes honneurs. Elle fut imprimée à Rome, en 1483, dans le format in-4º, sans chiffres, réclames ni signatures.
Le volume présente d’abord un feuillet blanc ; au recto du
second {p. 654}commence la table comprenant 64 fables classées sous
66 numéros. Puis au verso du troisième feuillet viennent le sonnet italien
et le sixain en vers élégiaques que j’ai déjà fait connaître. Ensuite on
lit : Accii Zuchi summa Campaneæ Veron. viri
eruditissimi in Esopi fabulas : Interp̄tatio per rhithmos in libellum
Zucharinum inscriptum contexta fœliciter incipit.
À la
suite de ce titre viennent deux sonnets italiens intitulés, l’un :
Prohœmio
, l’autre : Idem.
Enfin les fables sont annoncées par ce titre : Lepidissimi Aesopi fabulae.
Elles sont suivies
de ces formules finales :
Intret in has hædes (sic) quisquis sociare bonorumAgmine se exoptat : scelerumque horrere ministros.Entri in la nostra scola chiunque usareVoi con gli boni e li altri lasse stare.
Puis vient cette souscription : Impressum Rome die. XXVIIII. Marcii M.CCCC.LXXXIII.
La
fin du volume est occupée par la Concionetta, la Canzon Morale, la Salutatio angelica et
le Registrum. Le verso du quatre-vingt-deuxième et
dernier feuillet est blanc.
Il existe un exemplaire de cette édition à la Bibliothèque nationale, où, longtemps réuni à d’autres ouvrages, il a porté avec eux la cote 6534 Y. La Grenville library en possède un également, sous la cote 7732.
1487. §
Après les deux éditions qui viennent d’être analysées, la plus ancienne est une édition de 1487 imprimée en caractères gothiques. Le volume se compose de 13 cahiers signés de a à n, et comprenant chacun huit feuillets, sauf le dernier qui n’en a que quatre, soit cent au total.
Fol. 1 a (a 1 rº). — Page blanche.
Fol. 1 b (a 1 vº). — Sonnet italien commençant par le vers :
Sapi chio son Esopo o tu lettore,
et le sixain latin en vers élégiaques commençant par cet hexamètre :
Aesopus fueram deformis : non satis istud.
Fol. 2 a (a 2 rº). — Gravure sur bois rehaussée d’un encadrement xylographique ; elle représente Ésope couronné de lauriers, recevant un exemplaire des mains du traducteur agenouillé, qui est vêtu d’une robe à épaulette.
{p. 655}Fol. 2 b (a
2 vº). — Titre du livre ainsi formulé : Accii Zuchi
summa campanee || Veronensis uiri eruditissimi || in Aesopi fabvlas
interpreta-||tio per Rhythmos in libel-||lum Zucharinum inscriptum ||
contexta foeliciter incipit.
Fol. 2 b (a 2 vº) à 3 a
(a 3 rº). — Deux sonnets italiens sous les titres Proemio
et Idem
.
Fol. 3 b (a 3 vº). — Face, gravée sur
bois, d’un soubassement de colonne portant ces mots : Lepidis||simi || Aesopi || fabv||lae.
Fol. 4 a (a 4 rº) à 4 b (a 4 vº). — Prologue latin suivi d’un Sonetto materiale et d’un Sonetto morale en langue italienne.
Fol. 5 a (a 5 rº) à 96 a (m 8 rº). — Fables illustrées comprenant le texte latin et la traduction italienne. Chacune est ornée d’une gravure au-dessous de laquelle se trouve le titre suivi du texte latin et ensuite d’un double Sonetto en langue italienne. Les fables, sous 66 nos, sont au nombre de 64. La soixantième, qui porte le nº 62, n’est pas terminée par le distique Fine fruor, etc. Les fables 61 à 64, sous les nos lxiii, lxix (sic), lxv, lxvi, portent les titres suivants : De Capone et Accipitre ; De Pastore et Lupo ; De Mercatore et eius Uxore ; De Rustico et Plutone.
Fol. 96 b (m 8 vº). — Impressum Brixie p̱ Boninū de Boninis de Ra-||gusia.
M. cccc. lxxxvii. Septimo martii.
Fol. 96 b (m 8 vº) à 99 b (n 3 vº). — Concionetta et Canzon morale suivis du mot Finis.
Fol. 99 b (n 3 vº) à 100 b (n 4 vº). — Table intitulée : Tavola de le
preditte fabule
et close par le mot Finis.
Panzer a signalé cette édition467.
La bibliothèque du British Museum, la Bodléienne et la
Colombine possèdent chacune un exemplaire de cette édition : la première,
sous la cote C. 20. b ; la deuxième, sous la cote Douce 62 et la troisième, sous la cote 4. 6. 16
(précédemment C. FF. Tab. 169. N. 52). L’exemplaire de la Colombine a
appartenu à Fernand Colomb qui, de sa propre main, a écrit, sur un
feuillet supplémentaire inséré à la fin du volume, la mention suivante :
Este libro ansi en quadernado. costo. 28. mīs en
medīna del Campo por || Junio. de 1537.
1492. §
Esopo historiado.
— Après
avoir été publiée successivement à {p. 656}Vérone, à
Rome et à Brescia, la traduction d’Accio Zuccho fut enfin imprimée à
Venise.
L’édition qui contient à la fois les distiques de Walther et les sonnets du traducteur, est un in-4º non chiffré, mais signé de a à i et, par suite, composé de neuf cahiers qui, étant formés de 8 feuillets chacun, en donnent en tout 72 au volume.
Le frontispice est rempli par une gravure sur bois représentant six personnages, un savant qui professe assis sur un siège élevé, un scribe occupant un siège inférieur et quatre auditeurs placés à droite et à gauche. Le nom du savant est révélé par le mot Esopus inscrit au-dessus de sa tête.
Au haut du verso du premier feuillet on lit : Accii Zuchi Summa Campanee Veronensis uiri eruditissimi in
Aesopi fabulas interpretatio per rhythmas in libellum Zucharinum
inscriptum contexta fœliciter incipit.
Les fables sont au nombre de soixante-quatre.
Chaque fable latine est accompagnée d’une gravure sur bois et suivie des deux sonnets qui en contiennent la traduction.
Les gravures sont d’un dessin de beaucoup supérieur à celui des gravures des incunables allemands.
Au bas du verso de l’avant-dernier feuillet est cette
souscription : Impressum Venetiis per Manfre-||dum de
mōteferato de sustrevo || Mcccclxxxxi a di ultimo ||
zenaro.
Quoique la date indiquée soit celle de la fin de janvier 1491, il faut considérer l’impression du volume comme achevée seulement en 1492. En effet, on ne doit pas oublier qu’à Venise, à cette époque, l’année ne se terminait que le 1er mars.
Panzer, Annal. typ., t. III, p. 172, nº 555 et Hain, Repert. bibliog., t. I, p. 39, nº 346, ont à tort attribué à cette édition la date de 1481. J’en ai trouvé à la Bibliothèque Marcienne sous la cote CXIII. 7. 41304, un exemplaire qui me permet de signaler leur erreur et d’éviter, après avoir été moi-même entraîné par eux à la commettre, d’y retomber une seconde fois.
1493. §
Le Favole d’Esopo ridotte in sonetti da Accio Zucco Somma campagna.
Édition in-4º de petit format non chiffrée, mais signée de a à i. {p. 657}Les cahiers sont de 8 feuillets chacun, et, comme il y en a neuf, il s’ensuit que le volume se compose de 72 feuillets.
Réimpression de l’édition de 1491, elle contient le texte de Walther et la traduction d’Accio Zuccho.
Le recto du premier feuillet est, comme dans la précédente édition, occupé par une gravure sur bois représentant six personnages, Ésope assis qui lit ses fables, sur un siège inférieur un copiste qui les écrit, et quatre auditeurs dont deux sont à droite et deux à gauche.
Les fables sont ornées de gravures sur bois encadrées, pareilles à celles de l’édition précédente.
Au bas du verso de l’avant-dernier feuillet on lit :
Impressum Venetiis per Manfre-||dum de
monteferrato. de sustreuo || Mcccc.93. a di 17. ||
Agosto.
La Bibliothèque de Vérone, sous la cote 77.2 possède un exemplaire de cette édition.
1497. §
Esopo historiado.
Réimpression, in-4º de petit format, de l’édition de 1493, exécutée en
caractères italiens, non chiffrée, mais signée de a
à i et composée de 9 cahiers dont les feuillets, à
raison de 8 par cahier, sont au nombre total de 72.
Le titre placé en tête du recto du premier feuillet est engagé dans une gravure sur bois qui occupe tout le frontispice et qui représente Ésope instruisant des auditeurs assis au-dessous de lui.
Au verso du premier feuillet on lit ce titre : Accii Zuchi Summa Campanee Veronensis || uiri eruditissimi
in Aesopi fabulas interp̄tatio || P̱ rhythmas in libellū Zucharinum
inscriptum || contexta fœliciter incipit.
Comme dans les éditions antérieures du même imprimeur, les fables sont au nombre de soixante-quatre. Chaque fable latine est ornée d’une gravure sur bois et suivie des deux sonnets italiens qui en sont la traduction.
Au bas de la seconde colonne de la table qui occupe le
verso du feuillet 71 on lit : Stampado in Venetia per
Mae-||stro Manfredo de Bonetto de Stre-||uo da Mōfera. nel anno del
signor̄ || M.cccc.lxxxxvij. adi. xxvii. zugno. ||Finis.
La Bibliothèque de Carpentras sous la cote E. 1320, la Bodléienne {p. 658}sous la cote Auct. VI. Q. VI. 74, la Bibliothèque de l’Université de Ferrare sous la cote O. 66 possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
— Esopo con la vita sua historiade
vulgare et latino.
À la fin, on lit : Impressum Mediolani per Uldericum Scinzenzeler. Anno salutis domini
M.CCCCXCVII. die XXIII Decembris.
Cette édition in-4º, imprimée en caractères gothiques et ornée de gravures sur bois, est signalée par Panzer, Annal. typogr., t. II. p. 84, nº 512, et, d’après lui, par Hain, Repertorium bibliographicum, t. I, p. 40, nº 352.
1498. §
Le Fabule de Esopo vulgare || e Latine Historiade.
Édition in-4º imprimée en caractères gothiques, non chiffrée, mais signée de a à i, et formée de neuf cahiers ayant chacun huit feuillets sauf le cahier e qui n’en possède que six, soit au total soixante-dix.
Elle renferme le texte de Walther accompagné de la traduction d’Accio Zuccho.
Le recto du premier feuillet consacré au frontispice, le titre n’en occupant que le bas, est rempli par une gravure qui, comme celle de l’édition de 1493, représente Ésope assis et professant, et au-dessous de lui un scribe également assis, et quatre auditeurs attentifs placés à droite et à gauche. Le tout est enfermé dans un encadrement xylographique à fond noir.
Au haut du verso du premier feuillet, le texte latin et la
traduction sont annoncés par ce titre : Accii Zuchi
Summa Campanee veronensis viri eruditissimi || in Aesopi fabulas
interpretatio per rhytmos in libel-||lum zucharinum inscriptum
contexta foeliciter incipit.
Au-dessous de ce titre sont les deux sonnets servant de préambule, qui ont déjà été signalés dans l’analyse de l’édition originale. Le premier est intitulé Prohemio et le second Idem.
Au recto du deuxième feuillet vient le prologue latin interprété immédiatement par un Sonetto materiale et par un Sonetto morale. Puis commencent les fables, illustrées chacune d’une gravure et suivies chacune des deux sonnets qui la paraphrasent.
Au bas du verso du feuillet antépénultième (i, vi) on lit :
Impressum Mediolani per Guillermum || le Signerre
Rothomagēsem. Anno {p. 659}do-||mini Millesimo.
cccc. nonagesimo. octauo. || Die octauo Jullii (sic)
mense. Regnante illu-||strissimo dn̄o Ludouico dux (sic) Mediolani.
L’avant-dernier feuillet est occupé par la table.
Il existe des exemplaires de cette édition au British Museum sous la cote 1073.l.26, à la Bibliothèque du palais Brera sous les cotes AM.IX.43 et AN.X.20, à l’Ambrosienne sous la cote S.Q̱.Q.II.18 et à la Bibliothèque de l’Université de Padoue sous la cote SºXV.494.
1502. §
Esopo historiado.
Édition
in-4º non chiffrée, mais signée de a à i, et par conséquent formée de neuf cahiers, qui, étant composés
de huit feuillets chacun, en donnent au volume un nombre total de
soixante-douze.
Cette édition, contenant le texte de Walther et la traduction d’Accio Zuccho n’est, comme celle de 1497, que la réimpression par le même imprimeur de celle de 1493.
Le recto du premier feuillet est rempli par une gravure analogue à celle de la première édition.
Le titre et la gravure sont compris dans un encadrement à fond noir.
Les fables sont elles-mêmes ornées de gravures encadrées semblables à celles des éditions précédentes du même imprimeur.
Au bas du verso de l’avant-dernier feuillet on lit :
Stampado ī Venetia per Maestro || Manfredo de
Bonello de Streuo da || Monteferato. nel āno del signore. M. || ccccc
ii. a di. xxv. de Feuraro. || Finis.
La Grenville library sous la cote 7743 et la Bibliothèque de Vérone sous la cote 105.4 possèdent chacune un exemplaire de cette édition.
― Le fabule de Ysopo vol||gare et
latine histo||riade.
Ce titre, placé en tête du recto du
premier feuillet, surmonte une grande gravure sur bois qui en occupe le
reste. Cette édition forme un volume in-4º de 70 feuillets. Au verso de
l’antépénultième on lit : Impressum Mediolani per
dominum Lazarum || de turate. Anno domini M. ccccc. ii. die. xxiii ||
mensis Decembris.
Les deux derniers feuillets sont
occupés par la table des matières et la marque de l’imprimeur.
La Grenville library possède un exemplaire de cette édition sous la cote 7744.
1520. §
Esopo con la vita sua historiate ||
vulgare et latino.
Ce titre, qui est placé en tête du
recto du premier feuillet, surmonte une gravure sur bois. L’édition forme
un volume in-12, orné de gravures sur bois, non paginé, mais signé de a à k. Au verso de l’avant-dernier
feuillet on lit : Impresso in Milano per magi-||stro
Bernardino da Castello. Nel || anno del signore. M. ccccc. xx. A di ||
xxv. de Septembre.
La Grenville library possède un exemplaire de cette édition sous la cote 7750.
1528. §
Fabule de Esopo
hystoriate.
Au-dessous de ce titre qui occupe le recto du
premier feuillet est une gravure sur bois représentant un professeur assis
dans sa chaire et entouré de ses élèves. Les fables, au nombre de 64, sont
suivies de cette souscription : Impressae Venetiis per
Augustinum de Zannis. M. d. xxviii468.
Cette édition forme un volume in-8º orné de gravures sur bois. Il en existe un exemplaire à la bibliothèque Bodléienne sous la cote Douce Z. Z. 7.
1533. §
Fabule de Esopo
hystoriate.
Au-dessous de ce titre placé au haut du recto
du premier feuillet est une gravure qui occupe le reste de la page. Cette
édition in-12 se termine au verso du dernier feuillet par cette
souscription : Venetiis per Simonem de Prello
Ver-||cellensem. Anno Dñi. M. d. xxxiii. ||
Die xxvii. Octobr.
La Grenville library possède un exemplaire de cette édition sous la cote 7754.
1544. §
Fabule di Esopo historiate con sue
allegorie historice et morale.
À la fin : Venetiis per Augustinum de Bindonis, anno Domini
M. d. xxxxiiii.
Il existe un exemplaire de cette édition dans la bibliothèque de Wolfenbüttel.
1566. §
Le Fabule || Di Esopo || latine et volgare || dove si vede mira-||bilissimi {p. 661}et notabili am||maestramenti. || Con le sue figure accomo-||date ad ogni fabula. || Di nuovo Corrette, et nuovamente || Ristampate.
Tel est le titre figurant au recto du premier feuillet d’un
très petit volume in-16 qui contient avec le texte latin la traduction
d’Accio Zuccho. Au-dessus de ce titre une vignette représente la figure
d’Ésope. Au bas de la page on lit : In
Venetia.
Le verso du premier feuillet est rempli par le
sonnet italien qui suit :
Perche l’ingegno mio troppo e legieroOrnar convienmi Esopo di tue fronde,Per far al mio rimar perfette sponde,Volgarizando con stillo sincero.Et egli a me con suo parlar severo,Experto e dotto, accotto mi rispondeI dono a te mie Fabule giocondeChe le commenti con bon magistero.Ma poi che son varie le persone,Convien che nel tuo stil habbi avertentia,Fermando sempre in Dio col tuo sermone.Et perche il frutto di tanta eccellentiaGusti ciascuno con ferma rasone,Fa che dichiara giusta mia sententia.Cosi con tal licentia.Commeato presi, et egli mi benedisseEl suo commento poi per me si scrisse.
Le volume n’est pas paginé, mais porte des signatures de a à e ; chaque lettre s’appliquant à un cahier de seize feuillets, et les cahiers étant au nombre de cinq, il s’ensuit que le volume se compose de quatre-vingts feuillets.
Il se termine par une pièce de vers italiens, intitulée :
Epilogo de tutta l’Opra
, et suivie au
verso du dernier feuillet d’une souscription ainsi conçue : Il fine. || Stampate in Venetia per Francesco || de Leno.
1566.
La bibliothèque Ambrosienne possède un exemplaire de cette édition sous la cote S. Q. O. II. 35.
Là s’arrête la série des éditions de la traduction d’Accio Zuccho. On conçoit, en effet, qu’elle ne pouvait survivre à la faveur que les fables de Walther avaient perdue.
3º Traduction de Francisco del Tuppo. §
À son tour Francisco del Tuppo fit paraître une traduction en prose italienne des fables de Walther.
1485. §
La première édition de la traduction de Francisco del Tuppo a été imprimée en lettres rondes. Elle forme un volume in-fol. de petit format, à longues lignes, remarquable non seulement par la pureté des caractères typographiques, mais encore par la finesse des gravures ornées d’encadrements pompéiens. Le volume se compose de 168 feuillets qui ne présentent ni réclames, ni signatures.
Il commence par un feuillet blanc ; puis au recto du
deuxième feuillet on lit ce préambule d’épître : « Francisco del Tuppo Neapolitano allo illustrissimo Honorato de ||
Aragonia Gaitano. Conte de Fundi. Collaterale dello Serenissimo || Re
don Ferando (sic). Re de Sicilia Prothonotario et
Logotheta be||nemerito Felicitate. »
Ce préambule est
suivi d’une épître à « Honorato de Aragonia », après laquelle vient la vie
d’Ésope, écrite en latin et divisée en chapitres accompagnés chacun d’une
traduction italienne.
À la suite de la vie d’Ésope il y a un feuillet blanc. Puis commencent les fables sur le recto d’une page ornée d’un large encadrement à fond noir, dont les arabesques ressortent en blanc.
Voici la disposition adoptée pour chacune des fables : d’abord le texte latin, puis une grande gravure encadrée, ensuite la traduction italienne qui est plutôt une paraphrase qu’une traduction, divisée en général en plusieurs parties intitulées : 1º Imago, ou Apologus ; 2º Tropologia ; 3º Allegoria, ou Exclamatio allegorica ; 4º Anagoge, ou Historialis Allegoria, ou Anagoge commixta Allegoriæ, ou Anagogiæ, ou Allegoria adjuncta Anagogiæ ; 5º Exemplum, ou Confirmatio cum exemplo, ou Exemplaris confirmatio, ou Imitatio, ou Cronica.
Les fables, quoique réparties sous 66 numéros, sont
seulement au nombre de 64, par le motif qu’il a été attribué deux nos distincts au prologue de Walther et au préambule de
la fable des Grenouilles qui demandent un roi. Les 4 dernières fables,
comme dans les éditions de la traduction d’Accio Zuccho, sont celles
intitulées : De Capone et Accipitre ; De
Pastore et Lupo ; De Mercatore et ejus Uxore et :
De Rustico et Plutone. Elles sont terminées par cette
souscription : {p. 663}« Francisci
Tuppi Parthenopei vtrivsque ivris || dissertissimi
studiosissimique in uitam Esopi fabulatoris læpidissimi philosophique
|| clarissimi traductio materno sermone fidelissima : et in eius
fabulas allegoriæ cū || exemplis antiquis modernisque finiunt
fœliciter. Impressæ Neapoli sub Ferdinan||do Illustrissimo
Sapientissimo atque Justissimo in Siciliæ Regno triumphatore. || Sub
anno Domini M.CCCC.LXXXV. Die XIII. Mensis Februarii || Finis. Deo
gratias. »
Le dernier feuillet, qui vient immédiatement après, porte
au recto la table des matières intitulée : Tabula in
fabulas Esopi
, et au verso le registre des cahiers ou
quaternes entre lesquels se répartissent les 168 feuillets. Il y en a en
tout 22, savoir : 4 de 8 feuillets et 2 de 6, comprenant la dédicace,
l’épître, la vie d’Ésope et deux feuillets blancs placés, l’un au
commencement et l’autre à la fin de cette première partie du volume, puis
13 premiers de 8 feuillets, 2 de 6 et un dernier de 8, contenant les
fables et les table et registre qui les suivent.
J’ai rencontré des exemplaires de cette édition dans de nombreuses bibliothèques et notamment à la bibliothèque impériale de Vienne sous la cote IV. F. 4, à la bibliothèque du British Museum sous la cote 167. f. 14, à la Grenville library sous le nº 7807, à la Bodléienne sous la cote Douce 225, à la bibliothèque du roi de Hanovre sous le nº 54, à la bibliothèque de l’Université d’Heidelberg sous la cote Sch. 69, nº 450, et à la bibliothèque de l’Escurial sous la cote j v. N. 2. Je rappelle enfin qu’elle a été citée par Panzer (t. II, p. 161, nº 50) et par Hain (t. I, p. 40, nº 353).
1493. §
Une deuxième édition, qui, si j’en juge par les exemplaires que j’en ai trouvés, est aujourd’hui encore moins rare que la précédente, a été imprimée en lettres rondes à Aquilée, en 1493.
Comme la première, elle consiste dans un volume in-fol. de petit format, à longues lignes, fort remarquable non seulement par la pureté des caractères typographiques, mais encore par la finesse des gravures rehaussées d’encadrements pompéiens. Signés de a à y, les cahiers dont le volume se compose sont au nombre de 22 formés de 8 feuillets, sauf le cahier f, qui n’en comprend que 4 et les cahiers u et x qui n’en comprennent que 6, de sorte que le nombre total des feuillets est de 168.
{p. 664}Voici maintenant ce qu’ils contiennent :
Fol. 1 a (a. i a). — La première page est blanche.
Fol. 1 b (a. i
b). — Le verso du premier feuillet est entièrement
occupé par une belle gravure sur bois que relève un riche encadrement de
style renaissance ; elle représente Ésope assis de façon à être vu de
profil et donnant son enseignement à divers auditeurs dans une salle dont
le mur du fond porte ces mots : Virtus omnia
vincit.
Fol. 2 (a. ii). — Au deuxième feuillet figure l’épître à « Honorato de Aragonia », avec le même préambule que dans l’édition originale.
Fol. 3 a (a. iii
a). — Prohemium
, à la
suite duquel le commencement de la vie d’Ésope en latin et en italien est
annoncé par ce titre : Libistici fabulatoris Esopi
vita feliciter incipit.
Elle est divisée en chapitres, dans chacun desquels le texte latin est suivi de la paraphrase italienne et n’en est séparé que par une belle gravure presque aussi grande que la page.
Fol. 43 a (f. iii
a). — La vie d’Ésope se termine au recto du feuillet 41
par cette souscription : Clarissimi fabulatoris Esopi
vita feliciter finit. sequuntur fabule.
Fol. 44 (f. iiii). — Le feuillet est blanc.
Fol. 45 a (g. i
a). — Au recto du feuillet 45, qui est agrémenté d’un
encadrement xylographique à arabesques, commencent les fables par ce
titre : Prothesis comparativa. Fabula I.
Sous ce titre figure le prologue de
Walther, qui dans l’édition est considéré comme la première fable. Puis
vient la paraphrase italienne, divisée en cinq parties intitulées : 1º Imago, 2º Tropologia, 3º Allegoria, 4º Anagoge, 5º Exemplum.
Les fables qui défilent ensuite sont ornées de grandes gravures toujours encadrées, placées après le texte latin et suivies elles-mêmes de leur paraphrase italienne divisée en quatre ou cinq parties. Comme dans l’édition originale, dont celle de 1493 n’est en somme que la réimpression, elles sont au nombre de 64 sous 66 numéros. Le distique Fine fruor, etc., qui suit la dernière, fait l’objet d’une paraphrase spéciale divisée en trois parties intitulées : 1º Conclusio allegorica, 2º Confirmatio, 3º Epilogus.
Fol. 166 b (y. iiiiii
b). — Le tout est ensuite terminé par la souscription
suivante : « Francisci de Tuppo Parthenopei utriusque
iuris disertissimi
{p. 665}studiosissimi||que in uitam
Esopi fabulatoris lepidissimi philosophique clarissimi tradu||ctio
materno sermone fidelissima et in eius fabulas allegorie cum exemplis
|| antiquis modernisque finiunt feliciter. Impresse Aquile per
magistrū Eusa||nium de Stella civē Aquilanū virū utique non minus ī
imprimēdis caracte||ribus q̱ aliis rebus agendis miri ingenii : una cū
Ioanne Picardo de Hamell || ac Loisio de Masson Francigena consociis
suis. Sub Ferdinando rege Illu||strissimo. Anno salutis.
M. CCCC. LXXXXIII. Die ultima mensis Maii. »
Fol. 167 a (y. iiiiiii
a). — Le recto de l’avant-dernier feuillet est rempli
par une table à deux colonnes intitulée : Tabula in
fabulas Esopi.
Le verso du même feuillet contient le
registre des cahiers.
Fol. 168 (y. iiiiiiii). — Le dernier feuillet est blanc.
La bibliothèque royale de Munich sous la cote Inc. c. a. 2800, la Colombine sous la cote 2. 6. 26 (précédemment C. K. K. Tab. 196, N. 19) renferment des exemplaires de cette édition qui est citée par Panzer (t. I, p. 16, n. 4), par Hain (t. I, p. 40, n. 355) et par Brunet (5e édit., t. I, col. 98).
— Panzer (t. IV, p. 219, nº 4) mentionne une deuxième édition in-fol. qui, comme la précédente, aurait été imprimée à Aquilée en 1493 ; mais en même temps il fait remarquer que Giustiniani, p. 103, l’a déclarée purement imaginaire.
— Une autre édition, devenue beaucoup plus rare que
l’édition connue d’Aquilée, a été imprimée à la fin de la même année dans
le format in-4º avec gravures sur bois. Il s’en trouve un exemplaire à la
Grenville library sous la cote 7735, et le catalogue de cette bibliothèque
(t. I, p. 14, 2e col.) la décrit dans les termes
suivants : « Vita (et Favole). (Latine et Italice ex
translatione et cum præfat. Francisci Tuppi). Impressum Venetiis per
Manfredum de Monteferato de Sustrevo de Bonellis, M. CCCC. LXXXXIII,
die VIII. Novembris. »
Malgré le luxe artistique avec lequel elle avait toujours été publiée, il paraît que la traduction de Francisco del Tuppo n’eut pas autant de succès que celle d’Accio Zuccho ; car elle ne fut pas autant de fois ni aussi longtemps réimprimée.
4º Traduction de Bartholomi Maschara. §
Une traduction moins prétentieuse que les précédentes fut, en 1532, éditée par un Italien nommé Bartholomi Mascara, qui n’avait voulu en faire qu’un ouvrage classique destiné à être mis entre les mains des écoliers de son pays et à leur faciliter l’étude de la langue latine.
{p. 666}La seule édition qui en soit connue consiste dans un petit volume in-4º, non chiffré, mais signé de A à E et composé de quarante feuillets.
Le frontispice au recto du premier est ainsi conçu :
Esopi fabulae cum interpretatione vulgari : et figuris acri cura emendatae. anno M. D. XXXII. per
Ludovicum Britannicum Brixie.
Au verso se lit un avis intitulé : Vincentius Metellus cirratæ adolescentiæ
, qui fait
connaître le nom du traducteur.
Les fables sont au nombre de soixante-trois. Leurs distiques
sont accompagnés d’une interprétation mot à mot en prose italienne
« dont certains passages, dit Brunet469, sont en patois vénitien »
. Chacune
d’elles est ornée d’une petite gravure sur bois.
Au verso du dernier feuillet se trouve cette souscription :
Brixiæ per Ludouicum Britan̄icum. Anno Dn̄i.
MDXXXII. mense nouēbri.
Fables en prose dérivées des fables en vers de Walther. §
§ 1. — Examen des fables. §
Tout se tient dans la vie des peuples. Cette maxime, vraie pour leur histoire, est également applicable à leur littérature : les productions intellectuelles s’enchaînent comme les événements politiques. Les fables en vers de Walther, nées du Romulus ordinaire, extrait lui-même du Romulus primitif qui était descendu de cet Æsopus ad Rufum directement issu de Phèdre, firent éclore à leur tour des dérivés en prose.
J’ai trouvé un de ces dérivés dans le manuscrit 14961 de la Bibliothèque nationale. La collection qu’il renferme, ne se compose que de 28 fables, dans lesquelles la morale chrétienne a pris la place de l’affabulation philosophique et qui sont certainement l’œuvre de quelque plagiaire monacal.
Voici l’énumération de ces fables, accompagnée de leurs références avec les fables de Walther :
| {p. 667} Ms. 14961. | Walther. |
| 1. Le Coq et la Perle. | 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | 5. |
| 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | 6. |
| 7. Le Loup et la Grue. | 8. |
| 8. La Chienne qui met bas. | 9. |
| 9. Le Serpent mourant de froid. | 10. |
| 10. L’Âne et le Sanglier. | 11. |
| 11. Le Rat de ville et le Rat des champs. | 12. |
| 12. L’Aigle et le Renard. | 13. |
| 13. Le Corbeau et le Renard. | 15. |
| 14. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | 16. |
| 15. L’Âne qui caresse son maître. | 17. |
| 16. Le Lion et le Rat. | 18. |
| 17. L’Épervier malade. | 19. |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | 20. |
| 19. Les Grenouilles qui demandent un roi. | 21. |
| 20. Les Colombes et le Milan. | 22. |
| 21. Le Chien et le Voleur. | 23. |
| 22. Le Loup accoucheur. | 24. |
| 23. L’Agneau, la Chèvre et le Loup. | 26. |
| 24. Le Chien vieilli et son maître. | 27. |
| 25. Le Loup et le Chevreau. | 29. |
| 26. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | 31. |
| 27. L’Inconstance de la Femme. | 48. |
| 28. Le Cerf à la Fontaine. | 47. |
Ces vingt-huit fables sont très certainement le travestissement chrétien de celles de Walther. On retrouve en effet à la fin de chacune d’elles les distiques élégiaques dans lesquels ce dernier avait placé l’épimythion des siennes.
En se référant dans le second volume de cet ouvrage au texte du manuscrit 14961, on verra combien il y a loin de ce texte non seulement à celui de Phèdre, source primitive, mais même à celui de Walther, source directe, mais bien dénaturée. Néanmoins toutes ces collections du moyen âge forment une chaîne, dont les anneaux se tiennent si visiblement qu’il est impossible de mettre la main sur l’un d’eux sans toucher aux autres.
§ 2. — Description du manuscrit. §
{p. 668}Le manuscrit dans lequel j’ai trouvé
la collection dérivée de Walther porte à la Bibliothèque nationale le
nº 14961. Sur l’ancien catalogue du fonds Saint-Victor auquel il a appartenu,
il a la cote 704 et est intitulé : Sermones diversi et
quædam moralia.
Dans le catalogue publié par M. Léopold
Delisle470 après la fusion de tous les fonds latins, le contenu en est
indiqué par ces mots : Sermons et recueil de fables,
d’anecdotes, etc., à l’usage des prédicateurs.
Le manuscrit forme un gros volume in-4º, dont l’écriture,
attribuée d’abord au xive siècle, a été par
M. L. Delisle reportée au xiiie et qui se
compose de 293 feuillets en parchemin. Sur le recto du premier a été inscrite
en tête cette mention qui révèle son origine : Iste liber
est Sancti Victoris parisiensis. Quicumque eum furatus fuerit vel
celaverit vel titulum istum deleverit, anathema sit.
Amen.
Les fables, dans ce volumineux recueil, n’occupent que deux feuillets. Elles commencent au haut du recto du folio 31 et finissent au bas du verso du folio 32.
Je ne connais pas d’autre manuscrit de la même collection, que d’ailleurs le moine, à qui elle est due, n’avait probablement faite que pour son usage personnel.
Deuxième collection.
Fables d’Alexandre Neckam. §
Notice sur Alexandre Neckam. §
Walther n’a pas été, au moyen âge, le seul lettré qui ait mis en vers élégiaques la prose du Romulus ordinaire. Alexandre {p. 669}Neckam, son compatriote et son contemporain, en fut, comme lui, le traducteur poétique.
Il naquit à Saint-Alban, au mois de septembre 1157. Tanner,
d’après Thomas James, prétend que dans un manuscrit qui de son temps appartenait
au comte d’Arundel on pouvait lire l’indication suivante, qui a permis de fixer
l’époque de sa naissance : « Mense Septembri natus est anno 1157 regi
filius, Ricardus nomine, apud Windleshore. Eadem nocte natus est Alexander
Neckam apud Sanctum-Albanum, cuius mater fovit Ricardum ex mamilla dextra, sed
Alexandrum fovit ex mamilla sua sinistra471. »
Venu en France dans sa jeunesse, Neckam acheva à Paris son
éducation littéraire commencée en Angleterre. Il y enseigna même les lettres, et
il est probable qu’il y composa le poème intitulé : Laus
sapientiae divinae.
Il se trouve dans un manuscrit, qui a
appartenu à l’abbaye de Saint-Germain des Prés, et qui est aujourd’hui conservé
à la Bibliothèque nationale, dans le fonds latin, sous le nº 11867.
M. E. du Méril en cite un passage qui est tiré du cinquième livre, et dans
lequel, ébloui des splendeurs de Paris, Alexandre Neckam fait de cette ville une
description enthousiaste.
Après avoir visité l’Italie, revenu en Angleterre et parvenu à
l’âge mûr, il voulut, pour se consacrer plus librement au travail, entrer dans
le monastère de sa ville natale. Il paraît qu’il avait formulé à cet effet une
demande qui commençait par ces mots : « Si vis, veniam ; sin
autem, tu autem »
, que plaisamment l’abbé du lieu lui
répondit : « Si bonus es, venias ; si nequam,
nequaquam »
, et que, blessé de ce jeu de mots fait avec son nom,
Neckam opta pour un autre ordre monastique. Oudin prétend qu’il serait néanmoins
entré à Saint-Alban, et Tanner affirme qu’il aurait ensuite été prieur de
Saint-Nicolas à Oxford, et qu’enfin il serait devenu, en 1213, abbé de
Chichester. Mais il est probable que ces indications sont erronées et je suis
plus porté à croire, comme Bale l’affirme472, qu’après la réponse de l’abbé de
Saint-Alban il entra directement dans l’ordre des chanoines de Saint-Augustin.
Ce qui paraît dans tous les cas {p. 670}établi, c’est qu’il
devint, en 1215, abbé de leur maison établie Exeter et qu’il y écrivit la plus
grande partie de ses ouvrages.
Le nombre en est extraordinaire ; Bale, qui en signale
cinquante-cinq, ne prétend pas en donner la liste complète ; en effet, elle ne
comprend ni celui qui est intitulé : Suppletio defectuum
operis Magistri Alexandri, quod deservit laudi sapientiæ
divinæ
, ni plusieurs de ceux qu’Oudin lui attribue473. Cette fécondité extraordinaire semble
justifier le pompeux éloge que le même bibliographe a fait de lui en ces
termes : Philosophus enim habebatur eruditus, theologus præclarus, rhetor
ac poeta insignis474.
On n’est pas d’accord sur l’année de sa mort. Fabricius pense qu’elle arriva en 1215 ; Tanner ne le fait survivre que trois ans à sa prétendue promotion au titre d’abbé de Chichester ; Warton croit qu’il ne décéda qu’en 1217 ; d’autres, tels que Pits et Leyser, prolongent sa vie jusqu’à l’année 1227.
Quoi qu’il en soit, Bale, Pits et Tanner sont d’accord pour affirmer qu’il mourut, hors de son abbaye, au cours d’un voyage, à Wigorn, où les moines de l’endroit l’inhumèrent dans leur cloître et, suivant Bale475 et Pits476, mirent sur son tombeau l’inscription suivante :
Eclipsi ni patitur sapientia, sol sepelitur ;Cui si par unus, minus esset flebile funus.Vir bene discretus, et in omni more facetus,Dictus erat Nequam, vitam duxit tamen æquam.
Cette épitaphe, qui se terminait par un mauvais jeu de mots, me semble un peu suspecte, et je suppose plus exacte celle que Tanner477 a rapportée en ces termes :
Eclipsin patitur sapientia, sol sepelitur,Qui, dum vivebat, studii genus omne vigebat.Solvitur in cineres Neccham, cui si foret hæresIn terris unus, minus esset flebile funus.
Examen des fables d’Alexandre Neckam. §
Après avoir fait connaître l’auteur, je dois, en quelques mots, donner un aperçu de ses fables.
On ne peut, quand on les compare à celles de Walther, s’empêcher de penser à cette phrase proverbiale du poète romain :
Habent sua. fata libelli.
Tous les deux, contemporains et compatriotes, ils ont eu l’un après l’autre la même idée. Ils ont presque à la même époque traduit le même texte dans le même rythme lyrique. Leurs deux œuvres n’en ont pas moins eu des destinées très différentes. Celle de Walther a eu, pendant plusieurs siècles, un succès immense, et celle de Neckam, quoiqu’elle eût avec une versification plus correcte le mérite d’une exactitude plus grande, fut loin de jouir d’une semblable fortune. Sans doute cette dernière ne fut pas dédaignée, et les deux traductions en vers français, qui en ont été faites au xiiie siècle et dont j’aurai bientôt à parler, montrent bien que son apparition n’a pas été froidement accueillie ; mais elle n’eut qu’une popularité éphémère, que l’indifférence et l’oubli devaient promptement suivre.
Pendant plusieurs siècles, tout ce qu’on sut, c’était que Neckam avait composé sous le titre de Novus Aesopus un recueil d’apologues en vers latins. Le premier, Bale478 l’avait signalé, et avait même cité ces cinq premiers mots du premier vers :
Ingluvie cogente, Lupus dum devor…
Après lui, Pits479, Leyser480, Fabricius481 et Tanner482 en avaient {p. 672}parlé tour à tour, mais n’en avaient point connu le texte ; ce qui le prouve, c’est l’erreur commise par Fabricius, qui, supposant à tort que le premier vers se rapportait à la fable De Lupo et Agno, le reconstitua ainsi :
Ingluvie cogente, Lupus dum devorat Agnum.
C’est à M. Robert qu’était réservée la bonne fortune de commencer la découverte des fables de Neckam ; vers 1825, il en trouva six dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, et les publia dans son édition des Fables inédites des xiie, xiiie et xive siècles.
Enfin M. E. du Méril, en ayant trouvé le texte entier dans un autre manuscrit de la Bibliothèque nationale, en publia, en 1854, la première édition complète.
Elle renferme quarante-deux fables ; en voici la nomenclature accompagnée des numéros de celles du Romulus ordinaire, auxquelles elles ont été empruntées :
| Alex. Neckam. | Romulus ordinaire. |
| 1. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 2. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| 3. Le Taureau et le Moucheron. | |
| 4. Les Brebis et les Loups. | III, 13. |
| 5. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. |
| 6. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 7. Le Vautour et l’Aigle. | |
| 8. Le Lion et l’Âne. | IV, 10. |
| 9. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| 10. Le Loup et l’Agneau. | I. 2. |
| 11. Le Fou et les Mulets. | |
| 12. Le Geai vaniteux. | II, 16. |
| 13. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| 14. Le Lièvre, l’Aigle et le Moineau. | |
| 15. Le Chien et la Brebis. | I. 4. |
| 16. Le Serpent et la Lime. | III, 12. |
| 17. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 19. |
| 19. Le Chauve et la Mouche. | II, 13. |
| 20. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| 21. L’Âne et le Loup. | IV, 15. |
| 22. Le Loup et le Berger. | IV, 3. |
| {p. 673}23. Le Renard et l’Aigle. | II, 8. |
| 24. Le Lion et le Cheval. | III, 2. |
| 25. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 26. Le Cheval et le Cerf. | IV, 9. |
| 27. Le Renard et le Corbeau. | I, 14. |
| 28. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| 29. La Cigale et la Fourmi. | IV, 19. |
| 30. Le Mouton et le Boucher. | IV, 6. |
| 31. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | IV, 8. |
| 32. Le Cheval et l’Âne. | III, 3. |
| 33. Le Cerf à la fontaine. | III, 7. |
| 34. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 9. |
| 35. La Montagne en mal d’enfant. | II, 5. |
| 36. Le Chameau et la Puce. | IV, 18. |
| 37. Les Membres et l’Estomac. | III, 16. |
| 38. La Pie et sa Queue. | |
| 39. Le Loup et le Chien. | III, 15. |
| 40. Le Paon et Junon. | IV, 4. |
| 41. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| 42. La Chèvre, le Chevreau et le Loup. | II, 10. |
De ces quarante-deux fables, trente-sept se rapportent par les sujets à celles du Romulus ordinaire. Celles qui correspondent aux fables connues de Phèdre sont moins nombreuses. Mais l’œuvre du fabuliste romain ne nous étant pas parvenue tout entière, on ne peut de prime abord dire si c’est de lui ou si c’est de son plagiaire que Neckam a fait usage. Pour résoudre la question, il faut comparer les textes ; c’est ce que je vais faire en prenant pour terme de comparaison le premier distique de la première fable de Neckam, c’est-à-dire de la fable du Loup et de la Grue.
Phèdre d’abord avait écrit ce membre de phrase :
Os devoratum fauce quum hæreret Lupi.
L’auteur du Romulus primitif, le paraphrasant, en avait tiré une
phrase prosaïque qui était probablement la suivante conservée dans le Romulus
ordinaire : Ossa lupus cum devoraret, unum ex illis hæsit ei
in faucibus.
Neckam, mettant cette phrase en vers, en fit un distique ainsi conçu :
Ingluvie cogente, Lupus, dum devorat ossa,Pars ossis fracti faucibus hæsit ei.
{p. 674}On voit par cette comparaison que c’est bien du Romulus ordinaire que dérive l’œuvre de Neckam.
Je sais qu’une objection peut être faite et je n’entends pas en éluder l’examen. J’ai dit que des quarante-deux fables de Neckam cinq n’avaient pas été empruntées au Romulus ordinaire ; ce sont les suivantes : Le Taureau et le Moucheron ; Le Vautour et l’Aigle ; Le Fou et les Mulets ; Le Lièvre, l’Aigle et le Moineau ; La Pie et sa Queue. Or, sur ces cinq fables, il y en a deux dont les sujets ont été traités dans les Fabulæ antiquæ : ce sont celle du Taureau et du Moucheron et celle du Lièvre, de l’Aigle et du Moineau. Ne doit-on pas en induire que ce sont les Fabulæ antiquæ que Neckam a mises en vers élégiaques ?
Si l’on soutenait cette thèse, il faudrait admettre que, s’il s’en était servi, il ne leur aurait fait que des emprunts partiels ; car, bien que son œuvre ne comprenne que quarante-deux fables, les sujets dont il a fait usage n’ont pas tous été traités dans les Fabulæ antiquæ.
Mais, en fait, cette distinction est sans intérêt ; car Neckam n’y a rien puisé. Quand le sujet traité par lui, lui était fourni à la fois par les Fabulæ antiquæ et par le Romulus ordinaire, c’est dans ce dernier qu’il prenait le thème à mettre en vers latins, et il est pour moi évident que c’était, non pas parce qu’il le préférait, mais parce que l’autre collection, enfouie dans le monastère où elle était née, ne lui était pas connue.
Il m’est facile de justifier ma thèse. À l’aide du premier
distique de la première fable de Neckam, j’ai déjà montré qu’il avait plutôt
suivi le texte du Romulus ordinaire que celui de Phèdre ; je peux de même
affirmer que, dans les Fabulæ antiquæ, le début de la fable du
Loup et de la Grue est encore plus loin que dans Phèdre du
premier distique de Neckam ; en effet, elle commence ainsi : Lupus osse devorato fauce inhæso.
Et ce n’est pas seulement par le style, par le tour des phrases, par le choix des mots, que l’œuvre de Neckam est plus conforme au texte du Romulus ordinaire qu’à celui des Fabulæ antiquæ, c’est, encore par la façon dont l’action se déroule dans ses fables et par la répartition qu’il fait des rôles entre les divers personnages.
Je vais faire comprendre ma pensée par deux exemples.
J’emprunte le premier à la fable des Brebis et des Loups. Dans
{p. 675}les Fabulæ antiquæ, les Loups, quand ils proposent
la paix, n’envoient pas de délégués aux Brebis : ils s’adressent directement à
elles, et, sans parler d’otages, leur offrent d’être leurs gardiens. Dans le
Romulus ordinaire, au contraire, les Loups envoient des mandataires chargés de
demander que, contre livraison par eux de leurs propres petits, les Brebis leur
remettent leurs Chiens à titre d’otages. C’est également ainsi que les choses se
passent dans la fable de Neckam. On lit dans le Romulus ordinaire ce membre de
phrase : Si Canes obsides darent
, qui n’existe
pas dans les Fabulæ antiquæ, et que Neckam au contraire, s’en
emparant, répète en ces termes : Si datur illis turba
Canum.
Il y a mieux : lorsque le sujet qu’il met en vers ne lui est pas fourni par le Romulus ordinaire, ce n’est pas davantage, grâce sans doute à la raison que j’ai dite, à l’autre collection qu’il s’adresse. Je prends ici pour exemple la fable du Lièvre, de l’Aigle et du Moineau, qui n’existe pas dans le Romulus ordinaire. Elle figure dans ce qui nous est parvenu du texte de Phèdre, et là c’est le Lièvre qui est opprimé par l’Aigle et c’est le Moineau qui le morigène. Dans les Fabulæ antiquæ c’est l’inverse : le Moineau sous les serres de l’Aigle est admonesté par le Lièvre. Neckam, ayant, comme Phèdre, distribué les rôles aux acteurs, ne peut avoir emprunté sa fable à l’autre collection.
Mais alors où avait-il pu rencontrer les cinq fables dont le Romulus ordinaire ne lui fournissait pas la matière ? Voilà ce que je ne saurais dire.
On peut prétendre que c’est de l’Æsopus ad Rufum ou du Romulus primitif qu’il s’est servi. Mais alors il faut soutenir qu’ils renfermaient d’autres fables que celles dont j’ai dressé la table. J’ai exposé les raisons qui m’empêchent de le croire, et je les tiens toujours pour bonnes. J’ajoute que, lorsque Neckam écrivait, l’Æsopus ad Rufum et le Romulus primitif devaient avoir depuis longtemps disparu.
On peut aussi supposer que Neckam a puisé dans Phèdre les sujets ou tout au moins deux des cinq sujets que le Romulus ordinaire ne pouvait lui procurer. Mais il est probable que Phèdre, oublié depuis plusieurs siècles, ne lui était guère connu que de nom.
Ce qui est possible, c’est qu’en dehors des collections alors existantes, les manuscrits aient conservé isolément, mêlées à d’autres {p. 676}matières, quelques fables soustraites, sinon dans leur pureté primitive, au moins sous une autre forme, à la perte des groupes auxquels elles avaient appartenu, et que Neckam, en ayant rencontré plusieurs, les ait traduites en vers élégiaques et en ait accru son œuvre.
Ce qui n’est pas douteux, c’est que sur les quarante-deux fables dont elle se compose, il y en a trente-sept dont le Romulus ordinaire a été la base unique.
En tenant ce langage, je rectifie implicitement une erreur que j’ai commise dans ma première édition et qui m’a entraîné à affirmer que, si ce Romulus avait été la base fondamentale de l’œuvre de Neckam, Walther n’y avait pas été non plus étranger483. Ce dernier, traduisant en vers élégiaques, d’après le Romulus ordinaire, la fable du Loup et de l’Agneau, avait écrit les quatre vers suivants :
Sic iterum tonat ore Lupus : Mihi damna minaris ?Non minor, Agnus ait. Cui Lupus : Immo facis.Fecit idem tuus ante paler, sex mensibus actis.Cum bene patrisses, crimine patris obi.
Dans le manuscrit 8471 de la Bibliothèque nationale qui renferme les fables de Neckam, j’ai remarqué, non sans surprise, que la même fable contenait également ce double distique, et j’en avais conclu qu’elles étaient, au moins en partie, le produit de la combinaison de deux éléments distincts. Mais à peine avais-je publié ma première édition, qu’en relisant dans la collection de Neckam la fable du Loup et de l’Agneau, je m’apercevais que, si l’on retranchait les deux distiques de Walther, le dialogue restait encore très complet, de sorte qu’il est immédiatement devenu certain pour moi que j’étais en présence d’une interpolation due à un copiste. Ce qui rend la chose encore plus claire, c’est que, s’il faut en croire M. du Méril, les deux distiques font défaut dans le manuscrit de la Bibliothèque de Berlin.
Non seulement Neckam n’a pas copié Walther, mais encore, imitant comme lui le Romulus ordinaire, il en a davantage conservé les expressions.
J’ai montré par un exemple le soin qu’il a pris de s’écarter le moins possible du prosateur. Walther au contraire n’en a presque {p. 677}rien gardé, et si l’on veut bien considérer comment il a traduit la phrase que j’ai citée plus haut, on voit qu’il en a complètement changé la forme et qu’il n’en a pris que l’idée, qu’il a exprimée dans ce vers sec et concis :
Arta Lupum cruciat via gutturis osse retento.
Traduisant avec cette indépendance, Walther aurait dû au moins la justifier par une versification meilleure : il n’a pas su donner à son œuvre la qualité qui aurait pu en faire excuser le défaut. Il ne faut pas la comparer longtemps à celle d’Alexandre Neckam pour reconnaître que, par la versification, cette dernière, sans être irréprochable, est moins défectueuse.
Quant aux cinq fables de Neckam qui n’ont pas été puisées par lui dans le Romulus ordinaire, la première correspond à la xxxvie des Fabulæ antiquæ de Nilant ; je ne connais pas de collection ancienne qui contienne les sujets de la deuxième et de la troisième ; la neuvième fable du livre I de Phèdre a été l’origine de la quatrième ; enfin je ne saurais dire de quelle source dérive la cinquième. Peut-être ces cinq fables ont-elles été empruntées à Phèdre ; peut-être Neckam en a-t-il trouvé le sujet dans un manuscrit complet de cet auteur. C’est là une hypothèse qui n’est pas invraisemblable, mais dont l’exactitude ne peut être aisément vérifiée.
Manuscrits des fables d’Alexandre Neckam. §
§ 1. — Manuscrits latins. §
1º Manuscrit 2904 de la Bibliothèque nationale. §
Le manuscrit 2904 de la Bibliothèque nationale, dans lequel M. Robert a trouvé six des fables de Neckam, forme un volume in-4º, dont l’écriture sur parchemin est du xve siècle et auquel le catalogue donne le nom de Codex Bigotianus. M. Robert lui attribue le nº 2094 ; mais c’est une erreur matérielle : avant d’avoir la cote 2904, il a bien porté le nº 261 ; mais la cote 2094 ne lui a jamais appartenu.
Il ne contient des fables de Neckam que les six premières et le {p. 678}titre de la septième. Le reste n’a pas été perdu, et l’espace blanc qui suit ce titre démontre que le copiste n’a pas continué sa copie. J’ajoute que, si courte qu’elle soit, elle présente des fautes assez nombreuses pour qu’on n’ait pas beaucoup à regretter de la voir inachevée.
2º Manuscrit 8471 de la Bibliothèque nationale. §
Le manuscrit de la Bibliothèque nationale qui contient le Novus Aesopus tout entier provient du cabinet de Mentel ; il porte le nº 8471, qui a remplacé le nº 6609 beaucoup plus ancien, mais encore apparent. Il forme un petit volume in-12, dont l’écriture est du xive siècle, et ne se compose aujourd’hui que de 19 feuillets, dont le premier porte le nº 96. Les 95 premiers ont disparu : aussi une pagination plus récente, qui va du nº 1 au nº 19, a-t-elle été substituée à l’ancienne.
Il avait été inscrit au catalogue imprimé des manuscrits latins comme renfermant les fables d’Avianus, et cette erreur, qui s’explique d’ailleurs par l’identité du nombre des fables et du rythme des vers, subsisterait peut-être encore aujourd’hui, si M. E. du Méril ne l’avait pas enfin aperçue.
Les fables occupent les quinze premiers feuillets. Le titre de chaque fable est en marge sur la même ligne que le dernier vers de la fable précédente. Il est signalé à l’attention du lecteur par un trait à l’encre rouge passé horizontalement sur l’encre noire de l’écriture. Au-dessous du titre se trouve écrit à l’encre rouge le numéro de la fable.
Le distique élégiaque qui, à la fin de chaque fable, en contient la morale, est reproduit dans une table qui occupe les feuillets 16 et 17. Sur les marges sont inscrits, à gauche du premier vers de chaque distique, le numéro de la fable, et à droite, le titre.
Les feuillets 18 et 19 contiennent la fin du Luparius, poème en vers élégiaques. « Ce fragment, dit
M. E. du Méril, paraît plus vieux au moins d’un siècle, et le dernier
feuillet très endommagé sans doute depuis longtemps, porte le chiffre 731
et remonte aussi au xiiie siècle. »
3º Manuscrit de la Bibliothèque du British Museum. §
J’ai trouvé à la Bibliothèque du British Museum un troisième manuscrit, auparavant inaperçu, des fables d’Alexandre Neckam. Ce qui avait sans doute empêché de les reconnaître, c’est qu’elles ne portent pas au {p. 679}catalogue le véritable nom de leur auteur, et que, composées en vers élégiaques, elles avaient pu, à première vue, être confondues avec celles de Walther ou d’Avianus.
Le manuscrit qui les conserve dépend du fonds de Robert Cotton, à qui il a appartenu et dont la signature figure sur le deuxième feuillet. Il porte la cote Vesp. M. B. xxiii, et forme un volume in-8º allongé, composé de 126 feuillets en parchemin.
Il renferme les ouvrages suivants :
1. Johannis de Hauvilla liber de potentia laboris et ingenii et impotentia desidiae.
2. Ovidius de Vetula.
3. Centones Probae Falconiae.
4. Alanus de complanctu naturae.
5. Aesopi fabulae.
6. Excidium Troianum.
7. Aenigmata Symphosii.
Les fables de Neckam, qui sont dans cette nomenclature désignées par les mots Aesopi fabulae, commencent à la fin du fol. 110 a et se terminent au fol. 118 b. Il y en a quarante-deux ; la collection est donc complète.
Elle est précédée de ce titre : Hic
incipit Esopus
, et terminée par cette phrase finale :
Expliciunt fabule Ysopi.
4º Manuscrit de la bibliothèque du collège de la Sainte-Trinité à Cambridge. §
Si l’on doit s’en rapporter au Catalogus librorum manuscriptorum Angliæ et Hyberniæ imprimé à Oxford en 1697, il existe à Cambridge, dans le collège de la Sainte-Trinité, un manuscrit contenant le Novus Æsopus d’Alexandre Neckam ; voici, en effet, l’analyse qu’il donne de ce manuscrit sous le nº d’ordre 273484 :
Chronicon breve.
Tractatus qui incipit, Fasciculus Myrrhæ dilectus meus.
Dares Phrygius de bello Trojano.
Epistola Edwardi Regis Angliæ ad Papam in qua jus suum asserit in Scotos.
Alexandri Necham vel Nequam Mythologiæ.
Idem in Martianum Capellam.
Liber utrinque mutilus de Mahomete ejusque successoribus.
Fragmentum Bartholomæi de proprietatibus.
{p. 680}Tractatus Historici de bello contra Saracenos Sacro.
Epistolæ Pontificiæ ad diversos.
Liber bestiarum.
Il est probable que, comme le mot Mythologia dans l’édition bien connue de Névelet sert de titre général à diverses collections de fables ésopiques, de même le mot Mythologiæ, appliqué ici à l’une des œuvres de Neckam, se rapporte à ses fables. Quoi qu’il en soit, n’ayant pas vu le manuscrit, c’est sans en garantir l’exactitude que je formule cette hypothèse.
5º Manuscrit de la bibliothèque royale de Berlin. §
Révélé à M. E. du Méril par une indication des Archives de la Société pour fonder l’ancienne histoire de l’Allemagne485, le manuscrit de la bibliothèque de Berlin, qui paraît avoir été écrit en France en 1449, n’est point passé sous ses yeux. Je ne l’ai pas vu plus que lui. Tout ce que j’en puis dire pour ceux qui auront la curiosité de l’aller voir, c’est qu’il est coté : Santen, 4, et que les fables s’étendent du feuillet 43 au feuillet 47. Du reste, pour éviter aux curieux un déplacement coûteux, M. E. du Méril, en publiant les fables de Neckam, a eu soin d’indiquer les variantes qui le font différer du manuscrit de la Bibliothèque nationale.
§ 2. — Manuscrits français. §
Comme les fables de Walther, celles de Neckam ont été traduites en vers français, et il en a été fait deux traductions, dont l’une même en est plus ancienne, et par suite plus voisine de l’époque où l’ouvrage latin a été composé.
1º Première traduction. §
L’auteur en est inconnu. Il l’a terminée par un épilogue, où il déclare qu’il n’a été que le traducteur français de l’auteur latin ; de sorte qu’il ne doit pas être confondu avec Neckam lui-même. Voici en effet ce qu’on lit dans l’un des quatre sixains dont l’épilogue se compose :
Un clerc de grant scienceEt de grant sapienceLe fist premierement :{p. 681}Et j’el mis en romans,Pour entendre aus enfansEt a laïque gent.
Ce qui ressort de ce sixain, c’est que le traducteur non seulement est étranger à l’auteur des fables latines, mais en ignore même complètement le nom.
Quant à la versification des fables françaises, voici ce
qu’en dit M. Robert : « Elles sont remarquables par l’emploi régulier
des rimes croisées et n’offrent pas toutes le même genre de mesure : ici
ce sont des quatrains, là des sixains, plus loin des octaves, et
quelquefois c’est une suite non interrompue de vers rimant deux à
deux. »
Et, dans une note complétant sa description, M. Robert
ajoute : « Dans les sixains, le 1er et le 2e vers, le 4e et le 5e riment ensemble, tandis que le 3e rime avec
le 6e. Les quatrains sont aussi le plus souvent à
rimes croisées : dans la même fable, l’auteur emploie parfois des sixains
et des quatrains. Dans une seule, on trouve, à la suite des sixains, une
strophe de neuf vers, dont le 3e, le 6e et le 9e riment ensemble, tandis que les
autres riment deux à deux486. »
A. Manuscrit 24432 de la Bibliothèque nationale. §
Le manuscrit 24432, qui a porté dans le fonds Notre-Dame le nº 198, a été signalé par M. Robert sous la cote M. 21-3.
C’est un volume in-fol., dont les derniers feuillets ont disparu, et auquel pourtant il en reste encore 443 en parchemin, écrits sur deux colonnes en caractères gothiques par une main du xive siècle. Il renferme un grand nombre d’opuscules, tels que fabliaux et romans, dont plusieurs sont revêtus, suivant M. Robert487, de la date de leur transcription, qui me semble plutôt celle de leur composition primitive. C’est ainsi qu’on trouve au feuillet 152 a la date de 1320, au feuillet 142 b, celle de 1324, et au feuillet 245 a, celle de 1332.
Le contenu du volume est résumé dans une table des matières
placée en tête. Le dernier ouvrage est intitulé : De
la misère de l’ome.
Il commence à la fin de la deuxième
colonne du feuillet 437 b, et est incomplet comme le
manuscrit lui-même.
{p. 682}Les fables commencent au feuillet 171 a. Le titre a été laissé en blanc ; mais, si on le cherche à la table des matières, on le voit formulé par le simple mot Ysopet.
Au-dessous de l’espace blanc réservé par le copiste à l’artiste qui devait peindre le titre, vient un prologue ainsi conçu :
Qui ce liure voudra entendreMoult de bien y porra aprendre,Qui miex li vaudra assauoirQu’amasser grant planté d’auoir,Et qui tendra ces paraboles,Ces exemples et ces friuoles,A mocquerie et a truffe,Bien ait qui li donra bufle.
Les fables qui viennent ensuite sont seulement au nombre de quarante, écrites à la suite les unes des autres, sans espace qui les sépare, ni titre qui les distingue. Ce qui les réduit au nombre de quarante, c’est que le poète français a omis de traduire les deux fables latines : xi. De Stulto et Mulis, et : xxxviii. De Pica et Cauda sua.
La fin des quarante fables et le commencement de l’épilogue
qui les suit sont indiqués dans le manuscrit, au bas de la 2e col. du feuillet 183 b, par cette phrase
écrite à l’encre rouge : Cy finent les fables d’Ysopes
le philosophe et commence la complainte de celi qui ce livre
rima.
L’épilogue lui-même, vers le bas de la 1re col. du feuillet 184 a, se termine
par ces mots : Requies sit eis. Amen.
B. Manuscrit 15213 de la Bibliothèque nationale. §
Ce manuscrit est le même qui, au temps de M. Robert, portait dans le supplément français le nº 766. Par suite de la fusion de tous les manuscrits français en un seul fonds, le nº 15213 lui a été donné. Quoique ce numéro soit moins élevé que celui du manuscrit précédent, ce dernier étant un peu plus ancien, j’ai trouvé naturel de l’examiner le premier.
Le manuscrit 15213 forme un volume in-8º, écrit sur parchemin en gothique de la fin du xive siècle. Il contient deux ouvrages, les fables françaises qui occupent les 54 premiers feuillets, et le Bestiaire d’amour qui remplit les 40 derniers. Ces deux ouvrages sont séparés par les feuillets 55 et 56, qui sont entièrement blancs.
Le manuscrit est surtout remarquable par les belles miniatures à fond d’or dont il est enjolivé. Il y en a une en tête de chaque {p. 683}fable, et chaque miniature est elle-même surmontée d’un titre à l’encre rouge écrit par une main habile.
Quant au texte lui-même, si on le compare à celui du manuscrit 24432, on y trouve un certain nombre de variantes que M. Robert a d’ailleurs pris la peine de signaler. Ainsi, pour ne parler que du prologue, les deux derniers vers présentent cette leçon plus correcte :
A moquerie ne a truffe,Bien ait qui li donra la bufe.
Quant aux fables elles-mêmes, elles sont au nombre de quarante, qui sont toutes les mêmes que celles du manuscrit 24432 ; les deux mêmes font défaut, et le même épilogue clôt la collection.
Elles commencent au bas du feuillet 1 b,
que décore une superbe miniature, et sont annoncées par cette
suscription : Ci commencent les fables Ysopet et les
moralités qui sont dessus.
Elles sont suivies de
l’épilogue, à la suite duquel se lit cette phrase finale : Expliciunt les fables d’Ysopet Et les moralités
dessus.
2º Deuxième traduction. §
Manuscrit de la bibliothèque de Chartres. §
La traduction des fables de Neckam qui se trouve dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale, n’est pas la seule qui en ait été faite au moyen âge. Il en existe une autre dans un manuscrit de la bibliothèque de Chartres. L’existence en a été révélée par M. Duplessis, conservateur de cette bibliothèque, qui l’a publiée à Chartres, au mois de juillet 1834, dans un petit volume tiré à 48 exemplaires et intitulé : Fables en vers du xiiie siècle.
Comme dans la collection de la Bibliothèque nationale, le traducteur, suivant l’usage du temps, a employé les vers de huit syllabes à rimes croisées ; mais il ne les a pas groupés en sixains.
Les fables sont précédées d’un prologue et suivies d’un épilogue, dans lesquels le traducteur ne se nomme pas.
Elles sont au nombre de quarante, et elles offrent cette particularité qui ne permet aucun doute sur leur origine, que chacune d’elles est suivie du distique élégiaque qui dans le texte latin forme l’épimythion.
La collection de Chartres, comme celle de la Bibliothèque nationale, ne contient pas la traduction de la fable xi de Neckam, De Stulto et Mulis, et en outre elle ne renferme pas celle des trois {p. 684}fables : iii. De Culice et Tauro, x. De Lupo et Agno, xii. De Pavone, Graculo et Avibus, qui au contraire existent dans la collection parisienne. Mais en revanche on y trouve la traduction de la fable xxxviii. De Pica et cauda sua, et deux fables empruntées à Avianus et intitulées : De L’Escreueice et de sa mère, et : Dou Soleil et de Yuer, qui manquent dans les deux manuscrits de la Bibliothèque nationale, et qui, avec des sujets différents, donnent aux deux collections le même nombre de pièces.
Deuxième partie.
Romulus de Vienne et ses dérivés. §
Chapitre premier.
Romulus de Vienne. §
Section I.
Observations sur le Romulus de
Vienne. §
Lorsque j’ai étudié le manuscrit de Wissembourg, j’ai dit, page 288, qu’au xie siècle il avait été corrigé à l’aide d’une collection de fables dérivée du Romulus primitif.
C’est de cette collection que je vais maintenant m’occuper.
Malheureusement les manuscrits qui en existaient au xie siècle ont disparu, et elle ne s’est révélée à moi que par trois manuscrits beaucoup moins anciens qui ne l’ont pas conservée dans toute sa pureté.
Dans ma première édition, en procédant au classement des nombreux matériaux que j’avais réunis, j’avais cru pouvoir leur assigner à tous les trois le même rang, en faire trois exemplaires plus ou moins complets et exacts de la même œuvre, et, à raison des deux localités dans les bibliothèques desquelles ils se trouvaient, donner à la collection elle-même le nom de Romulus de Vienne et de Berlin.
Mon jugement s’est modifié. À mesure qu’on s’appesantit davantage sur les documents que le moyen âge nous a laissés, on aperçoit mieux les lacunes résultant de l’absence de ceux qui ont péri. Après avoir constaté la disparition de l’Æsopus ad Rufum et du Romulus {p. 686}primitif, je suis maintenant dans la nécessité de reconnaître que les Dérivés directs de ce Romulus ne nous sont pas parvenus tous dans leur intégrité. Tandis que de nouvelles copies en étaient faites, les premières disparaissaient ; ces copies nouvelles étaient rarement irréprochables, et de transcription en transcription elles finissaient quelquefois par être assez transformées pour n’être plus que des imitations du texte primitif.
C’est ce qui me paraît s’être produit pour le Romulus que j’ai maintenant à examiner. Les trois manuscrits dans lesquels il m’est apparu ne remontant qu’au xive siècle, il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas gardé dans toute sa pureté une œuvre de trois cents ans au moins plus ancienne. Parmi eux, cependant, il en est un qui, à tort ou à raison, ne me semble pas avoir, autant que les deux autres, subi les conséquences de ces transcriptions successives et que je considérerai, non comme une imitation, mais comme une copie un peu altérée du vrai texte ; et, partant de là, je donnerai seulement le nom de Romulus de Vienne à la collection que j’avais antérieurement appelée Romulus de Vienne et de Berlin.
Il s’agit maintenant de la faire connaître. Tout d’abord je dois dire qu’elle est surtout importante par le nombre des fables dont elle se compose. En comprenant quatre-vingt-une, elle possède toutes celles du Romulus primitif, sauf les trois suivantes, savoir : iii, 32, L’Âne et le Loup ; iii, 39, L’Homme et le Lion ; iii, 41, La Fourmi et le Grillon. Elle mérite donc de retenir quelques instants l’attention.
N’en fût-il pas ainsi, que je serais encore obligé de m’y arrêter ; car j’ai à modifier ce que, dans ma première édition, j’avais exposé au sujet de son origine.
Ayant alors cru voir dans le manuscrit Burnéien et dans les manuscrits similaires le texte pur du Romulus primitif, j’avais dû nécessairement considérer le Romulus de Vienne comme en étant issu. Maintenant que mon opinion s’est amendée et que le texte qui me semblait être le Romulus primitif n’en est plus, pour moi, qu’un dérivé plus rapproché que ses congénères, dois-je persister à faire de ce dérivé la source de l’autre ? Telle est la question à résoudre.
En mettant précédemment le Romulus de Vienne au rang des imitations du Romulus Burnéien, je sentais bien qu’on pouvait n’être pas de mon avis. Si je n’avais pas eu, pour ainsi dire, la main {p. 687}forcée par mon point de départ, il est probable que j’aurais davantage tenu compte d’un obstacle devant lequel aujourd’hui je m’incline ; je veux parler des deux fables du Renard changé en homme et du Taureau et du Veau. Il est en effet difficile de comprendre comment la collection qui possède ces fables peut provenir de celle dans laquelle elles n’existent pas.
Pour l’admettre, j’ai, dans ma première édition488, supposé « que l’auteur de la collection
contenue dans les trois manuscrits de Vienne et de Berlin connaissait non
seulement la collection du Romulus Burnéien, mais encore la source à laquelle
cette dernière devait avoir été puisée, c’est-à-dire l’Æsopus ad
Rufum, et qu’en imitant uniquement l’une il avait cependant voulu la
compléter par l’autre »
. Je reconnais que cette supposition n’était
guère acceptable, et aujourd’hui je n’hésite pas à voir dans le Romulus de Vienne
un dérivé issu, non du Romulus Burnéien, mais, comme le Romulus Burnéien, du
Romulus primitif qui a été la base des deux.
Quiconque sur ce point conservera un doute pourra, par la comparaison des textes, le faire aisément cesser. En effet on rencontre en bon nombre, dans le Romulus de Vienne, des expressions de Phèdre, qui, n’existant pas dans le Romulus ordinaire, n’ont pu être puisées que dans le Romulus primitif. Désirant prouver mon dire, je vais à cet effet me servir de la fable du Lion vieilli, du Sanglier, du Taureau et de l’Âne, qui est dans Phèdre la vingt et unième du livre I, dans le Romulus ordinaire la quinzième du livre I, et dans celui de Vienne la seizième de la collection, et à laquelle, pour ne pas prolonger une démonstration superflue, j’emprunterai seulement deux exemples :
Phèdre : Defectus annis et desertus viribus.
Rom. ord. : Annis deceptus pluribus.
Rom. de Vienne : Annis et viribus defectus.
Phèdre : Asinus ut vidit ferum impune ledi, calcibus frontem extudit.
Rom. ord. : Ut Asinus sic vidit feram, illi frontem aperuit.
Rom. de Vienne : Hoc quoque Asinus cernens calcibus illi frontem contundit.
Il résulte de ces exemples que les deux Romulus ne sont pas issus l’un de l’autre, et qu’ils appartiennent seulement à un auteur commun.
{p. 688}Cette communauté d’origine leur a d’ailleurs valu une ressemblance intime. Comme on trouvera les deux collections dans le deuxième volume de cet ouvrage, on pourra, en les comparant, s’édifier complètement à cet égard. Néanmoins, pour ceux qui désireront ne pas prendre cette peine, je vais y puiser et transcrire ici leurs deux courtes versions de la fable du Chien qui lâche la proie pour l’ombre.
En voici d’abord le texte, tiré du Romulus ordinaire :
« Amittit proprivm qvisqvis avidvs alienvm appetit. De talibvs sic
narrat. Canis flumen transiens partem carnis ore tenebat. Cuius umbram cum
uidisset in aqua. patefecit os suum ut aliam caperet. Statim eam quam prius
tenebat fluuius tulit. et illam quam sub aqua putabat. obtinere non potuit. Sic
quisquis alienum querit. dum plus uult. suum perdit. »
Voici maintenant la même fable extraite du manuscrit 303 de
Vienne : « Qui cupit alienum hic sepe amittit proprium. Canis flumen
transiens. partem carnis ore tenebat. Cuius vmbram cum vidisset in aqua. maiorem
suspicatus est. Sed patefaciens os. ut illam caperet. amisit illam quam prius
ore tenebat. Sic dum quis cupit plus alienum. perdit suum. »
On voit les différences ; elles ne sont guère plus considérables dans les autres fables ; de sorte qu’en définitive, si la collection de Vienne n’est pas un dérivé du Romulus ordinaire, elle constitue une œuvre qui, comme lui, ne s’éloigne pas beaucoup de leur commun modèle.
Section II.
Manuscrit de Vienne 303. §
C’est dans le manuscrit latin 303 de la Bibliothèque impériale de Vienne que se trouve le texte que j’ai pensé pouvoir considérer, non comme une imitation, mais comme une copie altérée du Romulus de Vienne. Ce manuscrit, qui portait autrefois le nº 392 dans le fonds des Codices Novi et que j’ai déjà, pages 579 et 580, partiellement analysé, forme un volume in-8º de petit format ; il se compose de 166 feuillets en parchemin, dont l’écriture très fine est du {p. 689}xive siècle. Ceux qui en désireront l’analyse détaillée la trouveront dans le Catalogus codicum philologicorum latinorum, publié par M. Étienne Endlicher en 1836, à Vienne, chez le libraire F. Beck, en 1 vol. in-4º489. Je me borne à indiquer, d’après lui, les titres des ouvrages qu’il renferme :
I. Fol. 1 a à 9 a. — Dyonysii Catonis Disticha de Moribus ad Filium, cum glossa.
II. Fol. 10 a à 12 b. — Martini Laudunensis Novus Cato.
III. Fol. 12 b à 22 b. — Hildeberti Turonensis fabulæ.
IV. Fol. 22 b à 29 a. — Aviani Fabulæ XLII.
V. Fol. 29 a à 40 a. — Henrici Septimellensis Elegia.
VI. Fol. 40 a à 48 a. — Passio beatæ Catharinæ Virginis.
VII. Fol. 48 b à 51 b. — Facetus sive Liber Morum et Virtutum.
VIII. Fol. 52 a à 64 a. — Hildeberti Turonensis Mohamedes.
IX. Fol. 64 a à 71 b. — Paracletus, sive Sermo inter animam peccatricem et Paracletum.
X. Fol. 72 a à 77 a. — Ioannis de Garlandia Carmen de Synonymis et Æquivocis.
XI. Fol. 78 a à 86 b. — Pamphilus, sive de Documento Amoris.
XII. Fol. 86 b à 92 a. — Facetus Clericalis Iuveuis.
XIII. Fol. 92 b à 102 a. — Baldi Æsopus novus, sive XXIX Fabulæ rhythmicæ.
XIV. Fol. 102 a à 108 a. — Avianus novus, sive XLI Fabulæ rhythmicæ.
XV. Fol. 108 a à 112 b. — Liber quinque Clavium.
XVI. Fol. 112 b à 115 b. — Pseudo-Ovidius de Nuntio sagaci.
XVII. Fol. 116 a à 120 b. — Carmen de Contemptu Mundi.
XVIII. Fol. 121 a à 124 a. — Anonymi Carmen de Pilato.
XIX. Fol. 124 b à 131 b. — Theobaldi de Senis Physiologus, cum commento.
XX. Fol. 132 a à 137 a. — Romuli Fabulæ.
XXI Fol. 138 a à 144 a. — Carmen de Amphitryone et Alcmena.
XXII. Fol. 144 a à 151 a. — Maximiani Etrusci Elegiæ VI.
XXIII. Fol. 151 b à 154 a. — Matthæi Vindocinencis Comœdia de glorioso Milite.
XXIV. Fol. 155 a à 158 a. — Matthæi Vindocinensis Comœdia Milonis.
XXV. Fol. 158 a à 164 a. — Matthæi Vindocinensis Comœdia Aldæ.
XXVI. Fol. 164. — Carmina varia X.
XXVII. Fol. 165 a à 166 a. — Fabula de Vulpe, Lupo et Leone.
XXVIII. Fol. 166. — Versus de componendis Epistolis.
La nomenclature qui précède montre quels nombreux et différents {p. 690}ouvrages sont contenus dans le manuscrit 303. Pour ne parler que de la fable ésopique, on voit qu’il possède plusieurs des collections du moyen âge qui nous sont parvenues. On y aperçoit successivement les fables élégiaques de l’anonyme Névelet, celles d’Avianus, celles de Baldo, celles de l’auteur qu’on a surnommé Novus Avianus, enfin celles du Romulus de Vienne.
Ces dernières n’occupent, ainsi qu’on l’a vu, que les feuillets 132 à 137, et sont au nombre de 80, suivies d’un double épilogue. La collection en comprenant au total 81, il s’ensuit que, sauf une dont il va être question au commencement du chapitre suivant, le manuscrit 303 les a toutes.
Chapitre II.
Dérivés du Romulus de Vienne. §
Section I.
Premier dérivé. §
J’ai dit que l’existence du Romulus de Vienne m’avait été révélée par trois manuscrits. Je me suis expliqué sur le premier ; j’arrive au deuxième qui, dans la bibliothèque autrichienne, porte la cote 901.
Je commence par affirmer que la collection contenue dans ce manuscrit n’est ni une copie ni une imitation faites sur le manuscrit 303 de la même bibliothèque. D’abord, quoique du même siècle, le manuscrit 901 m’a paru un peu plus ancien. Ensuite, quoique ne comprenant que cinquante fables, il en possède une qui n’existe pas dans le manuscrit 303, à savoir : la fable du Loup et du Renard jugés par le Singe, et, comme il est plus que vraisemblable que cette fable n’a pas été puisée à une autre source que les autres, il faut convenir que le manuscrit 303 n’a pas pu donner naissance au manuscrit 901, et que c’est au texte primitif du Romulus de Vienne conservé dans un manuscrit plus ancien que la collection du manuscrit 901 a été empruntée.
Toute la question est de savoir quelle est la nature de cet emprunt. Si la collection du manuscrit 303 est une copie plus ou moins altérée, mais une copie du Romulus de Vienne, on doit regarder le manuscrit 901 comme n’étant qu’un dérivé de ce Romulus, et {p. 692}cela pour deux raisons, d’abord parce que, s’éloignant par de nombreuses variantes du manuscrit 303, on doit le supposer à peu près aussi loin du texte pur, ensuite parce que les moralités y sont en bon nombre accrues d’additions poétiques.
Pour justifier cette double affirmation, il me suffira de me servir de la très courte fable, à l’aide de laquelle j’ai déjà un peu plus haut fait ressortir les différences séparant le Romulus de Vienne du Romulus ordinaire, c’est-à-dire de la fable du Chien qui lâche la proie pour l’ombre :
Rom. de Vienne 303. Canis, flumen transiens, partem carnis ore tenebat. Cujus umbram cum vidisset in aqua, majorem suspicatus est.
Rom. de Vienne 901. Canis flumen transiens, partem carnis in ore tenebat. Cujus umbram cum vidisset in aqua, suspicatus est majorem.
Jusqu’ici les différences ne résultent guère que d’une simple interversion dans l’ordre des mots. Elles sont insignifiantes, et, si dans le reste de la fable elles n’étaient pas plus graves, la collection du manuscrit 901 ne serait, comme celle du manuscrit 303, qu’une copie du Romulus de Vienne. Mais, lorsqu’on poursuit les rapprochements, les divergences s’accentuent et changent de caractère :
Rom. de Vienne 303. Sed patefaciens os ut illam caperet, amisit illam quam prius ore tenebat.
Rom. de Vienne 901. Sed patefaciens os ut caperet, amisit quod tenebat.
Ici, il n’y a plus simple interversion, il y a transformation. La copie est devenue un dérivé. Mais passons à la moralité :
Rom. de Vienne 303. Sic, dum quis cupit plus alienum, suum perdit.
Rom. de Vienne 901. Sic qui quærit alienum, dum plus cupit, suum perdit. Non sua qui cupiunt, merito quæ sunt sua perdunt.
On le voit, la moralité dans le manuscrit 901 se divise en deux parties, l’une et l’autre très différentes du texte du manuscrit 303. La première non seulement s’en écarte, mais encore, se rapprochant par le mot quærit des leçons du Romulus primitif, laisse apercevoir nettement que c’est du vrai texte du Romulus de Vienne issu du Romulus primitif qu’en réalité elle découle. La seconde, en affectant la forme d’un hexamètre, donne au Dérivé contenu dans le manuscrit 901 une nuance poétique qui achève d’en faire une œuvre différente du modèle.
{p. 693}J’arrive ainsi à une solution très différente de celle à laquelle j’avais précédemment abouti ; mais avant tout, ce qui me préoccupe, c’est d’adopter celle qui, aujourd’hui, me semble la plus vraie.
Le manuscrit latin qui, dans la Bibliothèque impériale de Vienne porte la cote 901, est un volume in-8º de très petit format, dont les feuillets sont en parchemin et dont l’écriture, contrairement à la mention du catalogue où le xiiie siècle lui est assigné, est très probablement du xive.
Je ne donnerai du contenu de ce manuscrit qu’une analyse sommaire.
Il renferme les cinquante fables du dérivé viennois du Romulus de
Vienne qui commencent sans dédicace préalable au recto du feuillet 7 et qui se
terminent au verso du feuillet 23. Il ne porte que ce simple titre : Incipit Esopus.
Puis viennent les cinquante fables, à
la fin desquelles on lit ces mots : Explicit
Esopus
, et au-dessous cet hexamètre léonin :
Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste.
Dans le tableau comparatif, que je dresserai plus loin des trois manuscrits de Vienne et de Berlin, devant énumérer les cinquante fables de celui dont je m’occupe actuellement, je m’abstiens, pour éviter un double emploi, d’en donner ici la nomenclature.
Section II.
Deuxième dérivé. §
Ayant fait de la collection contenue dans le manuscrit 901 un dérivé du Romulus de Vienne, je dois logiquement attribuer le même caractère à celle qui existe dans le manuscrit latin in-8º 87 de la Bibliothèque royale de Berlin. En effet, les soixante fables de ce manuscrit s’écartent autant que celles du manuscrit de Vienne {p. 694}901 des leçons du manuscrit de Vienne 303. Je vais prendre pour exemple dans ce dernier manuscrit et dans celui de Berlin et mettre en présence les premières phrases de la fable du Cerf à la fontaine :
Vienne 303.
Berlin 87.
Cervus bibens de fonte sua cornua magna vidit, nimisque ea laudavit cruraque ceu tenuia vituperavit.
Quondam Cervus bibens de fonte, sua cornua vidit, intusque ea laudare cœpit cruraque tenuia vituperare.
Tum subito venatoris vocem audivit, et fugam iniit.
Tunc subito vocem venatoris audiens fugam iniit.
Canesque secuntur eum in silvam ingredientem.
Canibusque eum sequentibus silvam ingreditur.
On peut remarquer qu’ici les différences sont au moins aussi nombreuses et aussi profondes que celles déjà constatées entre les manuscrits de Vienne 303 et 901. Si l’on part de cette idée que le premier des deux est une copie bonne ou mauvaise du Romulus de Vienne, celui de Berlin ne peut plus être qu’un dérivé.
J’ai le regret d’ajouter que c’est un dérivé très défectueux, car il pullule de phrases et de mots défigurés par l’évidente ignorance du copiste, et, par suite, il est dénué de valeur philologique. Aussi me paraît-il très suffisant de l’avoir déjà édité dans ma première édition, et ne lui ferai-je pas une seconde fois le même honneur.
Maintenant il me reste à examiner de quelle source il émane. J’ai affirmé et il m’a été aisé d’établir que le dérivé du manuscrit de Vienne 901 était issu, non du manuscrit de Vienne 303, mais d’un texte plus pur et plus ancien. Il est très vraisemblable qu’il en est de même du dérivé du manuscrit de Berlin 87. En effet, les deux textes des manuscrits de Vienne 901 et de Berlin 87 offrent des leçons identiques qui n’existent pas dans le manuscrit de Vienne 303. Il est évident que, si elles n’appartenaient qu’à l’un d’eux, elles pourraient être le résultat de changements faits, pour la composition de ce dérivé, au texte du manuscrit de Vienne 303 pris pour base ; mais, dès que les deux dérivés les possèdent, elles ne peuvent provenir que des modèles employés. Ce n’est qu’à cette condition que la conformité est possible. J’ai donc à l’établir, et, pour cela, je vais mettre les trois collections en présence par des extraits empruntés à chacune d’elles. Comme précédemment, je me sers d’abord de la fable du Chien qui lâche la proie pour l’ombre :
{p. 695}Rom. de Vienne 303. Sed patefaciens os ut illam caperet, amisit illam quam prius ore tenebat.
Rom. de Vienne 901. Sed patefaciens os ut caperet, amisit quod tenebat.
Rom. de Berlin 87. Sed patefaciens os ut caperet, amisit quod tenebat.
À cet exemple, j’en ajoute un tiré de la fable des deux Rats :
Rom. de Vienne 303. Qui mensam apposuit inferens.
Rom. de Vienne 901. Qui mensa posita intulit.
Rom. de Berlin 87. Qui mensa posita intulit.
Voilà deux exemples qui justifient ma thèse. J’en pourrais citer beaucoup d’autres.
Pour en finir, je ne formule plus qu’une remarque, c’est que, si les manuscrits de Vienne 901 et de Berlin 87 présentent parfois des leçons semblables qui n’existent pas dans le manuscrit de Vienne 303, il est probable que, puisées dans des manuscrits plus anciens et sans doute plus purs, elles sont les vraies et que, par suite, en bien des endroits, les deux dérivés sont plus exacts que la copie. Mais cette constatation ne me détermine pas à changer mon classement, parce qu’en somme le texte du manuscrit de Vienne 303 me semble encore être dans son ensemble le plus conforme au texte primitif.
Le manuscrit contenant les fables du deuxième dérivé du Romulus de Vienne figure dans la Bibliothèque royale de Berlin sous la cote M S. Lat. Octav. 87. Ce manuscrit, qui est dans le format in-8º et dont l’écriture est du xive siècle, renferme les ouvrages suivants :
1º Catonis sententiæ (fol. 1 a à 14 b).
2º Poëma epicum dictum Ecloga Theoduli (fol. 15 a à 33 a).
3º Fabulæ anonymi Neveletani cum versione prosaïca Romulo ascripta (fol. 33 b à 50 a).
Les fables qui commencent au folio 33 b, sont celles de l’Anonyme de Névelet, dont chacune est précédée de la fable correspondante du dérivé du Romulus de Vienne.
Les fables de ce dérivé sont au nombre de 60. Mais 56 seulement sont suivies des fables correspondantes de l’Anonyme. Les 4 dernières ne sont accompagnées d’aucune version poétique. Ce sont {p. 696}celles qui dans le manuscrit portent les titres suivants : De Leone quem feræ in regem legerunt, De Vulpe et Botro, De Mustela et Muribus, De Bubulco et Lupo. À la suite de la dernière fable en prose, le copiste a ajouté les deux fables de l’Anonyme de Névelet, qui dans les manuscrits et les éditions de cet auteur portent les nos 59 et 60 et qui sont généralement intitulées : De Judæo et Pincerna et : De Cive et Milite. Enfin elles sont elles-mêmes suivies de la fable qui est ordinairement la trente-huitième de l’Anonyme et qui n’avait pas été laissée à sa place par suite de l’absence dans le manuscrit de Berlin de la fable correspondante en prose. La fable, ainsi rejetée à la fin du manuscrit, est celle qui, habituellement intitulée : De Lupo et Vulpe, commence par ce vers :
Respondere Lupo de furti labe tenetur.
Le tout est clos par cette double souscription :
Scriptor finivit, quamvis male scribere scivit.Explicit Esopus.
Section III.
Tableau synoptique des fables des trois
manuscrits de Vienne et de Berlin. §
Je vais terminer l’étude du Romulus de Vienne et de ses deux Dérivés par un tableau synoptique, non seulement donnant la nomenclature générale des fables contenues dans les trois manuscrits de Vienne et de Berlin, mais encore permettant d’apprécier leur concordance avec celles du Romulus primitif.
| Romulus primitif. | Vienne 303. | Vienne 901. | Berlin. |
| Prologue. | Prologue. | Prologue. | |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | 2. | 18. | 1. |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | 1. | 1. | 2. |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | 3. | 2. | 3. |
| I, 4. Le Chien et la Brebis. | 4. | 3. | 4. |
| I, 5. Le Chien et l’ombre. | 5. | 4. | 5. |
| I, 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et Lion. | 6. | 5. | 6. |
| {p. 697}I, 7. Le Soleil qui se marie. | 7. | 6. | 7. |
| I, 8. Le Loup et la Grue. | 8. | 7. | 8. |
| I, 9. La Chienne qui met bas. | 9. | 8. | 9. |
| I, 10. Le Serpent mourant de froid. | 10. | 9. | 10. |
| I, 11. L’Âne et le Sanglier. | 11. | 10. | 11. |
| I, 12. Le Rat de ville et le Rat des champs. | 12. | 11. | 12. |
| I, 13. L’Aigle et le Renard. | 13. | 12. | 13. |
| I, 14. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | 14. | 13. | 14. |
| I, 15. Le Corbeau et le Renard. | 15. | 14. | 15. |
| I, 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | 16. | 15. | 16. |
| I, 17. L’Âne qui caresse son maître. | 17. | 16. | 17. |
| I, 18. Le Lion et le Rat. | 18. | 17. | 18. |
| I, 19. L’Épervier malade. | 62. | 20. | |
| I, 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | 19. | 19. | 19. |
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un roi. | 20. | 20. | 21. |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | 21. | 21. | 22. |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | 22. | 22. | 23. |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | 23. | 23. | 24. |
| II, 5. La Montagne en mal d’enfant. | 24. | 24. | |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | 25. | 25. | 25. |
| II, 7. Le Chien vieilli et son maître. | 26. | 26. | 26. |
| II, 8. Les Lièvres et les Grenouilles. | 27. | 27. | 27. |
| II, 9. Le Loup et le Chevreau. | 28. | 28. | 28. |
| II, 10. Le Serpent et le Pauvre. | 29. | 29. | 29. |
| II, 11. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | 30. | 30. | 30. |
| II, 12. Le Chauve et la Mouche. | 32. | 31. | 31. |
| II, 13. Le Renard et la Cigogne. | 33. | 32. | 32. |
| II, 14. La Tête sans cervelle. | 34. | 33. | 33. |
| II, 15. Le Geai vaniteux. | 35. | 34. | 34. |
| II, 16. La Mouche et la Mule. | 31. | 35. | 36. |
| II, 17. La Mouche et la Fourmi. | 36. | 36. | 35. |
| II, 18. Le Loup et le Renard, jugés par le Singe. | 37. | ||
| II, 19. L’Homme et la Belette. | 37. | 38. | 37. |
| II, 20. La Grenouille qui s’enfle. | 38. | 39. | 39. |
| III, 1. Le Lion et le Berger. | 39. | 40. | 40. |
| III, 2. Le Lion médecin. | 40. | 41. | 41. |
| III, 3. Le Cheval et l’Âne. | 41. | 42. | 42. |
| III, 4. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | 42. | 43. | 43. |
| III, 5. Le Rossignol et l’Épervier. | 43. | 44. | 44. |
| III, 6. Le Renard et le Loup. | 44. | 45. | 38. |
| III, 7. Le Cerf à la fontaine. | 45. | 46. | 45. |
| {p. 698}III, 8. Junon et Vénus. | 46. | 46. | |
| III, 9. L’inconstance de la Femme. | 47. | 47. | |
| III, 10. La Courtisane et le Jeune Homme. | 63. | ||
| III, 11. Le Renard changé en homme. | 64. | ||
| III, 12. Le Taureau et le Veau. | 65. | ||
| III, 13. Le Père et le Mauvais Fils. | 48. | 47. | 48. |
| III, 14. La Vipère et la Lime. | 49. | 48. | 49. |
| III, 15. Les Loups et les Brebis. | 50. | 49. | 50. |
| III, 16. La Hache et les Arbres. | 51. | 50. | 51. |
| III, 17. Le Loup et le Chien. | 52. | 52. | |
| III, 18. L’Estomac et les Membres. | 53. | 53. | |
| III, 19. Le Singe et le Renard. | 54. | 54. | |
| III, 20. Le Marchand et l’Âne. | 55. | 55. | |
| III, 21. Le Cerf et les Bœufs. | 56. | 56. | |
| III, 22. Le Lion roi et le Singe. | 57. | 57. | |
| III, 23. Les Raisins trop verts. | 58. | 58. | |
| III, 24. La Belette et les Rats. | 59. | 59. | |
| III, 25. Le Loup et le Berger. | 60. | 60. | |
| III, 26. Le Paon et Junon. | 61. | ||
| III, 27. La Panthère et les Paysans. | 66. | ||
| III, 28. Les Moutons et les Béliers. | 67. | ||
| III, 29. L’Oiseleur et les Oiseaux. | 68. | ||
| III, 30. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | 69. | ||
| III, 31. Le Cheval et le Cerf. | 70. | ||
| III, 32. L’Âne et le Lion. | 71. | ||
| III, 33. Le Corbeau et les Oiseaux. | 79. | ||
| III, 34. Le Lion malade et le Renard. | 72. | ||
| III, 35. La Corneille altérée. | 73. | ||
| III, 36. L’Enfant et le Scorpion. | 74. | ||
| III, 37. L’Âne et le Loup. | |||
| III, 38. Les trois Boucs et le Lion. | 75. | ||
| III, 39. L’Homme et le Lion. | |||
| III, 40. La Puce et le Chameau. | 76. | ||
| III, 41. La Fourmi et le Grillon. | |||
| III, 42. Le Glaive perdu. | 77. | ||
| III, 43. La Corneille et la Brebis. | 78. | ||
| III, 44. La Statue d’Ésope. | 80. | ||
| Épilogue. Rufus. | Épilogue I. | ||
| Épilogue II |
Je crois qu’il est inutile d’ajouter aucun commentaire à ce tableau comparatif des trois manuscrits de Vienne et de Berlin.
Troisième partie.
Romulus de Florence. §
Section I.
Observation préliminaire. §
Dans la première édition de cet ouvrage, il n’a pas été question de la collection que je vais maintenant examiner sous le nom de Romulus de Florence.
Ce qui me l’avait fait négliger, c’est que j’ignorais son existence. Mais l’eussé-je connue, qu’il en eût été de même ; en effet, comme le manuscrit qui la contenait dépendait d’une bibliothèque privée inaccessible au public, j’aurais encore été dans la nécessité de la passer sous silence. Aujourd’hui, la situation est différente : le manuscrit qui renferme ce Romulus appartient à la Bibliothèque Laurentienne où il m’a été facile d’en avoir communication. Je vais profiter de la possibilité que j’ai maintenant d’en parler.
Section II.
Examen du Romulus de Florence. §
Le Romulus de Florence se compose des mêmes fables que le Romulus ordinaire. Semblables par le nombre et peu différentes par la rédaction et le classement, elles sont de même précédées de la dédicace de Romulus à son fils appelé Tyberius et non plus Tiberinus, mais finalement privées de l’épilogue à Rufus.
Lorsqu’à Florence je me suis trouvé en présence de ce texte, j’ai dû tout naturellement me demander à quelle catégorie je {p. 700}devais le rattacher. Devais-je y voir le Romulus ordinaire plus ou moins dénaturé par des variantes, qui, si nombreuses qu’elles fussent, ne l’avaient pas modifié au point d’en faire, non une copie, mais une imitation ? Au contraire, ces variantes avaient-elles assez altéré le modèle pour en faire un Dérivé ? Enfin, fallait-il aller plus loin et voir dans le texte de la Laurentienne un Dérivé, issu, non du Romulus ordinaire, mais du Romulus primitif ?
Dans sa Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés à la Laurentienne, M. Léopold Delisle avait bien fait observer que le texte du manuscrit de Florence n’était pas absolument conforme à ceux des Romulus que j’avais publiés490. Mais le travail bibliographique auquel il se livrait ne comportant pas un examen plus approfondi du manuscrit, il s’en était tenu à cette simple remarque qui ne m’avait donné la réponse à aucune des trois questions précédentes.
En effet, on a pu voir que, parmi les manuscrits que j’ai mis au rang de ceux contenant le texte du Romulus ordinaire, il y en a qui, comme le manuscrit du Mans, renferment des variantes aussi nombreuses qu’importantes. Pour regarder les altérations d’un texte comme constitutives d’une œuvre distincte, j’ai dû y apercevoir l’intention clairement manifestée par leur auteur de jouer un autre rôle que celui de copiste uniquement préoccupé d’améliorer par de simples corrections le travail d’autrui. Si je n’avais pas procédé ainsi, je me serais placé dans la nécessité d’éditer, comme œuvres distinctes, des textes trop rapprochés les uns des autres pour qu’il fût raisonnable de les publier tous. Il pouvait donc se faire que, malgré l’exacte indication fournie par M. Léopold Delisle, je ne dusse considérer le manuscrit de Florence que comme un exemplaire de plus du Romulus ordinaire.
Pour m’éclairer, ce qui m’était nécessaire, c’était le texte même du manuscrit. Pendant mon séjour à Florence, j’en entrepris la copie ; mais le temps me faisant défaut, à peine l’avais-je commencée que je dus l’interrompre, et, l’un des employés de la Bibliothèque m’ayant offert de l’exécuter, je lui confiai ce travail.
Quand il me fut parvenu, j’examinai les variantes qu’il offrait, et, avant de me demander si elles faisaient du texte de Florence {p. 701}une imitation ou une simple copie du Romulus ordinaire, je commençai par rechercher si leur nature ne m’obligeait pas à attribuer au texte une autre origine. Le premier point à trancher était en effet celui de savoir si le texte du manuscrit de Florence n’était pas dans certaines parties plus rapproché de Phèdre que le Romulus ordinaire, et si dès lors il n’était pas, comme ce dernier lui-même, issu du Romulus primitif.
La comparaison des textes pouvant seule me renseigner, j’y recourus. Je vais, à l’aide de deux fables, montrer ce qu’elle m’a appris. Je me sers d’abord de celle du Chien qui lâche la proie pour l’ombre :
Phèdre : Amittit merito proprium qui alienum appetit.
Rom. ord. : Amittit proprium quisquis avidus alienum appetit.
Rom. de F. : Amittit proprium quisque alienum avidius quærit.
De ce premier rapprochement, il ressort que des deux textes c’est celui du Romulus ordinaire qui est le plus conforme à Phèdre. Mais continuons :
Phèdre : Canis per flumen carnem dum ferret natans…
Rom. ord. : Canis, flumen transiens, partem carnis ore tenebat.
Rom. de F. : Canis, flumen transiens, partem carnis in ore suo ferebat.
Phèdre : Lympharum in speculo vidit simulacrum suum.
Rom. ord. : Cujus umbram cum vidisset in aqua.
Rom. de F. : Cuius umbram vidit in aqua.
Phèdre : Et quem tenebat ore, dimisit cibum.
Rom. ord. : Patefecit os suum ut aliam caperet.
Rom. de F. : Patefacto autem ore suo illam dimisit quam prius tenebat.
Ces trois derniers rapprochements conduisent à un résultat tout différent du premier : ils montrent que le texte de Florence est conforme à celui de Phèdre dans plusieurs cas où le Romulus ordinaire s’en écarte.
Pour rendre plus concluant cet examen comparatif, je vais maintenant recourir à la fable dont les personnages sont la Vache, la Chèvre, la Brebis et le Lion :
Phèd. : Vacca et Capella et patiens Ovis injuriæ socii fuerunt cum Leone.
Rom. ord. : Vacca et Capella et Ovis socii fuerunt cum Leone simul.
Rom. de F. : Vacca et Capella et Ovis sodales fuerunt Leonis.
Ici on voit le Romulus ordinaire suivre Phèdre de plus près que {p. 702}celui de Florence ; mais, si l’on continue la comparaison, le contraire se manifeste :
Phèdre : ................... in saltibus.
Rom. ord. : Qui cum in salto venirent.
Rom. de F. : Qui cum in saltibus venarentur.
Phèdre : Ego primam tollo.
Rom. ord. : Ego primus tollo.
Rom. de F. : Ego primam tollo partem.
Phèdre : Sic totam prædam sola improbitas abstulit.
Rom. ord. : Sic totam prædam illam solus improbitate sustulit.
Rom. de F. : Sic totam prædam illam improbitate sua abstulit.
De ce qui précède deux solutions se dégagent : la première c’est que le Romulus de Florence, offrant des expressions de Phèdre que ne possède pas le Romulus ordinaire, ne procède pas de ce dernier, et la seconde, c’est que l’un et l’autre, présentant des expressions qui leur sont communes et que Phèdre n’a pas employées, dérivent directement d’un auteur commun, qui, n’étant pas le fabuliste romain, ne peut être que le Romulus primitif.
Il est donc acquis que le Romulus de Florence n’est pas issu du Romulus ordinaire.
Sans vouloir attacher au classement des fables plus d’importance qu’il ne convient, je crois devoir faire remarquer qu’il est en harmonie avec cette solution. Dans les plus anciens manuscrits du Romulus ordinaire, la fable du Renard et de l’Aigle est la huitième du livre II. Au contraire, dans toutes les collections qui m’ont paru directement nées du Romulus primitif, elle appartient au livre I. Or, dans le manuscrit de Florence, elle fait également partie de ce livre I, dont elle est la treizième. S’il n’en résulte pas une preuve complémentaire, il en ressort au moins qu’aucune particularité n’affaiblit la solution imposée par la comparaison des textes.
Section III.
Nomenclature des fables. §
Il me reste maintenant à dresser la liste des fables du Romulus de Florence. Je pourrais me contenter de renvoyer à celle des {p. 703}fables du Romulus ordinaire et de dire que leur classement, comme leur nombre, serait identique dans les deux collections, si celle qui, dans le Romulus ordinaire, est la huitième du livre II, n’était pas la treizième du livre I dans le Romulus de Florence, et si, tandis que, dans le livre II du Romulus ordinaire, la fable de la Mouche et de la Mule précède celle de la Mouche et de la Fourmi, elle la suit dans le même livre du Romulus de Florence. Mais, comme jusqu’à présent, j’ai explicitement donné la nomenclature des fables de chacune des collections que j’ai analysées, je ne crois pas devoir ici changer de procédé. En conséquence voici, établis d’après l’ordre suivi dans le manuscrit lui-même, les titres des fables qu’il renferme, et, mis en regard de ces titres, les numéros que portent les mêmes fables dans le Romulus ordinaire :
| Romulus de Florence. | Romulus ordinaire. |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| I, 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| I, 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| I, 6. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| I, 7. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| I, 8. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| I, 9. La Chienne qui met bas. | I. 9. |
| I, 10. L’Homme et la Couleuvre. | I, 10. |
| I, 11. L’Âne et le Sanglier. | I, 11. |
| I, 12. Le Rat de ville et le Rat des champs. | I, 12. |
| I, 13. Le Renard et l’Aigle. | II, 8. |
| I, 14. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| I, 15. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. |
| I, 16. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 15. |
| I, 17. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. |
| I, 18. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| I, 19. Le Milan malade. | I, 18. |
| I, 20. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 19. |
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| II, 5. La Montagne en mal d’enfant. | II, 5. |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| II, 7. Le Chien vieilli et son maître. | II, 7. |
| II, 8. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 9. |
| {p. 704}II, 9. Le Loup et le Chevreau. | II, 10. |
| II, 10. Le Serpent et le Pauvre. | II, 11. |
| II, 11. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | II, 12. |
| II, 12. Le Chauve et la Mouche. | II, 13. |
| II, 13. Le Renard et la Cigogne. | II, 14. |
| II, 14. La Tête sans cervelle. | II, 15. |
| II, 15. Le Geai vaniteux. | II, 16. |
| II, 16. La Fourmi et la Mouche. | II, 18. |
| II, 17. La Mouche et la Mule. | II, 17. |
| II, 18. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | II, 19. |
| II, 19. L’Homme et la Belette. | II, 20. |
| II, 20. La Grenouille qui s’enfle. | II, 21. |
| III, 1. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| III, 2. Le Lion médecin. | III, 2. |
| III, 3. Le Cheval et l’Âne. | III, 3. |
| III, 4. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| III, 5. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| III, 6. Le Renard et le Loup. | III, 6. |
| III, 7. Le Cerf à la fontaine. | III, 7. |
| III, 8. Junon et Vénus. | III, 8. |
| III, 9. L’Inconstance de la Femme. | III, 9. |
| III, 10. La Courtisane et le jeune Homme. | III, 10. |
| III, 11. Le Père et le Mauvais fils. | III, 11. |
| III, 12. La Vipère et la Lime. | III, 12. |
| III, 13. Les Loups et les Brebis. | III, 13. |
| III, 14. La Hache et les Arbres. | III, 14. |
| III, 15. Le Loup et le Chien. | III, 15. |
| III, 16. L’Estomac et les Membres. | III, 16. |
| III, 17. Le Singe et le Renard. | III, 17. |
| III, 18. Le Marchand et l’Âne. | III, 18. |
| III, 19. Le Cerf et les Bœufs. | III, 19. |
| III, 20. Le Lion roi et le Singe. | III, 20. |
| III, 21. Le Renard et les Raisins. | IV, 1. |
| III, 22. La Belette et les Rats. | IV, 2. |
| III, 23. Le Loup et le Berger. | IV, 3. |
| III, 24. Le Paon et Junon. | IV, 4. |
| III, 25. La Panthère et les Paysans. | IV, 5. |
| III, 26. Les Moutons et les Béliers. | IV, 6. |
| III, 27. L’Oiseleur et les Oiseaux. | IV, 7. |
| III, 28. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | IV, 8. |
| III, 29. Le Cheval et le Cerf. | IV, 9. |
| III, 30. L’Âne et le Lion. | IV, 10. |
| III, 31. Le Corbeau et les Oiseaux. | IV, 11. |
| {p. 705}III, 32. Le Lion malade et le Renard. | IV, 12. |
| III, 33. La Corneille altérée. | IV, 13. |
| III, 34. L’Enfant et le Scorpion. | IV, 14. |
| III, 35. L’Âne et le Loup. | IV, 15. |
| III, 36. Les trois Boucs et le Cheval. | IV, 16. |
| III, 37. L’Homme et le Lion. | IV, 17. |
| III, 38. La Puce et le Chameau. | IV, 18. |
| III, 39. La Cigale et la Fourmi. | IV, 19. |
| III, 40. Le Glaive perdu. | IV, 20. |
| III, 41. La Corneille et la Brebis. | IV, 21. |
| III, 42. La Statue d’Ésope. | IV, 22. |
Section IV.
Histoire et description du manuscrit de la
Laurentienne. §
Le manuscrit qui renferme le Romulus de Florence a appartenu au trop fameux Libri, des mains duquel il est, avec tous ses manuscrits, passé dans celles de lord Ashburnham.
C’est à la Bibliothèque Laurentienne qu’il m’a été donné de le voir. Comment y était-il entré ; c’est ce que je vais sommairement rappeler.
La collection formée par le bibliophile anglais comprenait quatre fonds : le fonds Libri, le fonds Barrois, le fonds appelé Appendice et le fonds Stowe.
Après la mort de lord Ashburnham, son fils, désirant aliéner tous ses manuscrits, les proposa au gouvernement anglais, qui n’accepta que le fonds Stowe. Les trois autres restaient donc à vendre.
Comme beaucoup des manuscrits dépendant du fonds Libri avaient appartenu à des bibliothèques françaises auxquelles ils avaient été soustraits, le gouvernement français songea à s’en rendre acquéreur, et, à cet effet, M. Léopold Delisle fut chargé d’aller à Londres les examiner et en négocier l’achat. Le savant administrateur général de la Bibliothèque nationale fit porter ses investigations non seulement sur le fonds Libri, mais encore sur le fonds Barrois, et, après avoir jeté un rapide coup d’œil sur chacun des manuscrits dont ils se composaient, il dressa la liste de ceux {p. 706}dont l’acquisition lui paraissait intéressante. Mais, comme il était impossible d’en faire immédiatement l’acquisition, il fut entendu qu’ils seraient mis en réserve pour être l’objet d’un accord ultérieur.
Pour ne parler que du fonds Libri qui comprenait 1923 manuscrits, voici, d’après la liste dressée, les numéros de ceux qui étaient à acheter : 1 à 6, 8 à 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28 à 32, 34 à 37, 39 à 42, 44 à 52, 67, 69, 73 à 75, 78, 80, 84 à 87, 90 à 92, 94, 96, 97, 101, 106 à 112, 1059, 1113, 1198, 1201, 1229, 1304, 1338, 1438, 1515, 1676, 1803, 1819, 1823, 1837, 1843, 1844, 1846 à 1849, 1852, 1856, 1858 à 1860, 1862, 1863, 1865, 1867, 1872, 1875. Le reste étant disponible fut acquis par le gouvernement italien et transporté à la Laurentienne.
C’est ainsi qu’en 1887 j’ai pu y prendre communication du manuscrit qui m’intéressait. C’était celui qui, d’abord dans la collection Libri et ensuite dans la collection Ashburham, avait porté la cote 1555.
Il consiste dans un petit volume de 56 feuillets de parchemin, hauts de 123 millimètres et larges de 97, dont l’écriture est du xiiie siècle.
Les vingt premiers sont remplis par les fables de Romulus. Elles
commencent au haut du recto du premier feuillet par ce titre : Incipit liber
esopi quem transtulit Romulus de græco in latinum ad Tyberium filium suum de
civitate Attica
, et elles se terminent au milieu du verso du feuillet 20,
où l’épilogue à Rufus qui a été omis a été remplacé par cette simple souscription :
Explicit liber Esopi qui fabularius dicitur. Amen.
On a déjà vu, par la liste que j’en ai dressée, que les fables qui sont au nombre de 82 ont été, probablement comme dans le Romulus primitif, divisées en trois livres composés, les deux premiers, chacun de vingt, et le troisième, de quarante-deux, c’est-à-dire de celles dont sont formés les livres III et IV du Romulus ordinaire.
Quant aux autres opuscules qui viennent à la suite des fables dans le manuscrit 1555, M. Léopold Delisle, dans sa Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés à Florence491, en a fait une courte description qui les fait suffisamment connaître. On me permettra, {p. 707}pour compléter l’analyse du manuscrit, de me contenter de la transcrire :
Fol. 20 vº. Dicta collecta ex proverbiis Senece. Alienum est omne quicquid optando evenit. Ab alio expectes laudem de hoc quod alteri feceris…
Fol. 26. Collecta de proverbiis Senece. Beneficia male collata male debentur, de quibus non redditis sero querimur…
Fol. 31. De mente composita ex dictis Senece. Primum argumentum composite mentis existimo posse consistere et secum morari…
Fol. 33 vº. Laus Sapientie. Sapientie servias oportet ut tibi contingat vera libertas…
Fol. 39 vº. Collecta ex epistolis beati Jeronimi…
Fol. 40. De vini vitatione.
Fol. 42. De bono penitentie…
Fol. 42 vº. De vita et moribus clericorum…
Quatrième partie.
Romulus de Nilant et ses dérivés directs
et indirects. §
Chapitre premier.
Romulus de Nilant. §
Section I.
Examen du Romulus de Nilant. §
Lorsque j’ai eu à étudier l’Anonyme de Nilant, j’ai dit qu’à la suite de l’édition des fables de cet Anonyme avaient été publiées 45 autres fables, précédées de la dédicace de Romulus à son fils Tiberinus492, et plus loin, j’ai ajouté qu’en tête de cette dédicace ce Romulus était qualifié d’empereur romain493. J’ai voulu savoir ce que c’était que ce Romulus de Nilant. Pour m’en rendre compte, je n’ai pas seulement recouru au manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Leyde d’après lequel la publication en avait été faite, je me suis mis à la recherche des autres exemplaires qui pouvaient encore en exister, et j’ai été assez heureux pour en découvrir deux, qui avaient sur celui de Leyde l’avantage d’être plus anciens et plus complets, de sorte que dans la publication que je fais à mon tour de la collection du Romulus de Nilant, au lieu des 45 fables précédemment éditées, on en trouvera un nombre plus élevé dont voici la nomenclature :
{p. 709}| Romulus de Nilant. | Romulus primitif. |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| I, 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| I, 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| I, 6. Le Buffle, le Loup et le Lion. | |
| I, 7. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| I, 8. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| I, 9. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| I, 10. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| I, 11. Le Bat de ville et le Rat des champs. | I, 12. |
| I, 12. L’Aigle et le Renard. | I, 13. |
| I, 13. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 14. |
| I, 14. Le Corbeau et le Renard. | I, 15. |
| I, 15. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 16. |
| I, 16. L’Âne qui caresse son maître. | I, 17. |
| I, 17. Le Lion et le Rat. | I, 18. |
| I, 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 20. |
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| II, 5. L’Homme en mal d’enfant. | II, 5. |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| II, 7. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 8. |
| II, 8. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| II, 9. Le Lion médecin. | III, 2. |
| II, 10. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| II, 11. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| II, 12. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. |
| II, 13. L’inconstance de la Femme. | III, 9. |
| II, 14. La Courtisane et le Jeune homme. | III, 10. |
| II, 15. Les Loups et les Brebis. | III, 15. |
| II, 16. La Hache et les Arbres. | III, 16. |
| II, 17. Le Loup et le Chien. | III, 17. |
| II, 18. L’Estomac et les Membres. | III, 18. |
| II, 19. Le Singe et le Renard. | III, 19. |
| II, 20. Le Lion roi et le Singe. | III, 22. |
| III, 1. Le Loup et le Berger. | III, 25. |
| III, 2. Le Paon et Junon. | III, 26. |
| III, 3. Les Moutons et les Béliers. | III, 28. |
| III, 4. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 29. |
| III, 5. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | III, 30 |
| {p. 710}III, 6. L’Âne et le Lion. | III, 32. |
| III, 7. Le Lion malade et le Renard. | III, 34. |
| III, 8. L’Homme et le Lion. | III, 39. |
| III, 9. La Puce et le Chameau. | III, 40. |
| III, 10. La Fourmi et la Cigale. | III, 41. |
| III, 11. La Corneille et la Brebis. | III, 43. |
| III, 12. Statue d’Ésope. | III, 44. |
| Épilogue. Rufus. | Épilogue. |
Cette liste, sous cinquante numéros, ne comprend que quarante-neuf
fables ; car on ne peut considérer comme une vraie fable la dernière pièce
intitulée : La Statue d’Ésope.
Mais
provisoirement j’accepte le nombre de cinquante.
Par cette liste on voit que les sujets des fables du Romulus de Nilant, non seulement sont les mêmes que ceux des fables du Romulus primitif, mais encore ont été traités dans le même ordre. On peut, sans craindre de se tromper, ajouter que le texte des unes est l’amplification de celui des autres, et que, si les fables du Romulus de Nilant s’éloignent sensiblement de celles qui leur ont servi de modèle, elles n’en sont pas moins l’évidente paraphrase.
Par cela même que ce Romulus procède du Romulus primitif, il doit différer et il diffère non seulement par les sujets, mais encore par la rédaction du texte des Fabulæ antiquæ. Dans l’introduction qui précède son édition diplomatique du Romulus Burnéien, M. Hermann Oesterley, avec une gravité convaincue, n’en prétend pas moins que le manuscrit, d’où Nilant a tiré son Romulus, n’était qu’un second exemplaire moins ancien des Fabulæ antiquæ, et, ce qui est peu flatteur pour le savant critique, il ajoute que Nilant ne s’est pas aperçu qu’il publiait deux fois la même œuvre.
J’avoue la surprise que j’ai éprouvée à la lecture d’une pareille assertion. En effet, si le Romulus de Nilant n’était que la copie des Fabulæ antiquæ, il devrait se composer uniquement des mêmes fables. Or, si l’on compare les deux collections, on trouve dans ce Romulus quinze fables et un épilogue, qui ne se rencontrent pas dans les Fabulæ antiquæ ; les voici :
| Nos des fables. | |
| 1. Le Buffle, le Loup et le Lion. | I, 6. |
| 2. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| 3. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| {p. 711}4. L’Homme en mal d’enfant. | II, 5. |
| 5. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 6. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 7. |
| 7. Le Lion médecin. | II, 9. |
| 8. L’Inconstance de la Femme. | II, 13. |
| 9. La Courtisane et le Jeune Homme. | II, 14. |
| 10. L’Estomac et les Membres. | II, 18. |
| 11. Le Paon et Junon. | III, 2. |
| 12. Les Moutons et les Béliers. | III, 3. |
| 13. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 4. |
| 14. L’Âne et le Lion. | III, 6. |
| 15. La Statue d’Ésope. | III, 12. |
| Épilogue. Rufus. | III, 14. |
En revanche, les Fabulæ antiquæ comprennent les 32 fables suivantes, qui n’existent pas dans le Romulus de Nilant, savoir :
| Nos des fables. | |
| 1. Les Chiens affamés. | 2. |
| 2. Les deux Coqs et l’Épervier. | 6. |
| 3. Le Limaçon et le Singe. | 8. |
| 4. Le Serpent mourant de froid. | 11. |
| 5. L’Âne et le Sanglier. | 12. |
| 6. La Grue, la Corneille et le Maître. | 19. |
| 7. Le Chauve et le Jardinier. | 24. |
| 8. Le Hibou, le Chat et la Souris. | 25. |
| 9. Le Geai vaniteux. | 26. |
| 10. La Mouche et la Fourmi. | 27. |
| 11. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | 28. |
| 12. L’Homme et la Belette. | 29. |
| 13. La Perdrix et le Renard. | 30. |
| 14 Le Chien et le Crocodile. | 31. |
| 15. Le Chien et le Vautour. | 32. |
| 16. La Grenouille qui s’enfle. | 33. |
| 17. L’Âne, le Bœuf et les Oiseaux. | 34. |
| 18. Le Taureau et le Moucheron. | 36. |
| 19. Le Rossignol et l’Épervier. | 39. |
| 20. Le Renard et le Loup. | 40. |
| 21. La Vipère et la Lime. | 42. |
| 22. Le Marchand et l’Âne. | 47. |
| 23. Le Cerf et les Bœufs. | 48. |
| 24. La Cigogne, l’Oie et l’Épervier. | 53. |
| 25. Le Lièvre, le Moineau et l’Aigle. | 57. |
| 26. Le Cheval, l’Âne et l’Orge. | 58. |
| {p. 712}27. Le Loup et le Chevreau. | 61. |
| 28. Le Chien vieilli et son maître. | 62. |
| 29. Le Renard et la Cigogne. | 63. |
| 30. Le Serpent et le Pauvre. | 65. |
| 31. Le Chauve et la Mouche. | 66. |
| 32. L’Aigle et le Milan. | 67. |
Les deux collections, composées l’une de 50 fables, l’autre de 67, n’en ont donc au total que 35, qui leur soient communes, et par suite ne peuvent être la copie l’une de l’autre.
Faut-il, pour achever de le démontrer, comparer les textes des
fables, qui, dans les deux collections, traitent des mêmes sujets ? Prenons alors
pour exemple la fable Le Chien et l’Ombre. La voici telle
qu’elle est dans le manuscrit des Fabulæ antiquæ : Cum Canis super fluvium carnem ferret, lympharum speculo vidit
simulacrum suum, alteramque prædam ab altero ferri putans, eripere voluit. At
decepta aviditas : quam ferebat, dimisit offam, et quæ valebat sua non potuit
vel extremo tangere dente. Qui dum aliena quærunt, propria
amittunt.
Voici la même fable tirée de la collection qui nous occupe :
Sæpe amittit propria, quisquis avidius appetit aliena, ut
Æsopus in sequenti fabula refert. Quodam tempore Canis amnem transiens partem
crudæ carnis ore ferebat. Cum umbram repercussam in profunda aqua vidisset,
aperiens os suum, ut illam, quam videbat in profundo, caperet, eam quam ore
tenebat, perdidit ; nec illam quam sub aqua desiderabat, obtinere potuit. Sic
quisquis aliena inhianter quærit, sæpe propria perdit.
On voit que les textes sont bien différents. Mais, si loin qu’elles soient des Fabulæ antiquæ, les fables du Romulus de Nilant ne s’écartent pas assez de celles du Romulus primitif pour n’avoir pas conservé en grand nombre les expressions de Phèdre. Pour qu’on puisse s’en rendre compte, je vais d’abord extraire du premier livre de Phèdre quelques phrases empruntées à diverses fables, et je montrerai ensuite comment elles se retrouvent plus ou moins exactes dans le Romulus de Nilant. Par exemple, dans son premier livre, Phèdre avait écrit :
Fable 1. Ad rivum eundem Lupus et Agnus
venerant. — Tunc fauce improba. — Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi aquam
bibenti ?
{p. 713}Fable 4. Amittit
merito proprium qui alienum adpetit. — Et quem tenebat ore.
Fable 12. Laudat cornua crurumque nimiam
tenuitatem vituperat.
Fable 13. Quum de fenestra Corvus raptum caseum
comesse vellet. — O qui tuarum, Corve, pennarum est nitor ! — Quem celeriter
dolosa Vulpes avidis rapuit dentibus. Tum demum ingemuit Corvi deceptus
stupor.
Fable 21. Quicumque amisit dignitatem
pristinam. — Defectus annis et desertus viribus.
Dans le Romulus de Leyde on trouve :
Fable 2. Agnus et Lupus ad unum rivulum…
venerunt. — Quare mihi perturbas aquam bibenti ? — Tunc Lupus improba fauce
iratus.
Fable 5. Amittit propria, quisquis avidius
adpetit aliena. — Eam quam ore tenebat.
Fable 29. Cornua sua laudare cœpit, et crura
tenuia ultra modum vituperare.
Fable 13. Corvus caseum de fenestra rapuisse
fertur. — Et pennarum tuarum quam magnus est nitor ! — Quem cadentem desuper
celeriter Vulpes dolosa avidis dentibus rapit. Tunc Corvus ingemiscens,
stupore nimio deceptus.
Fable 14. Quisquis pristinas vires suas amisit.
— Annosum Leonem viribus defectum.
Ces traces de l’original n’avaient pas échappé à Nilant ni aux commentateurs qui le suivirent. Mais ces derniers, ne se préoccupant du Romulus de Leyde qu’au point de vue des services à en tirer pour publier du Romulus ordinaire une édition bien exacte, le traitèrent avec un dédain qu’il ne méritait pas.
Partant de cette idée, Lessing494 chercha à démontrer que le texte du manuscrit de Leyde était complètement défectueux, et, tout en rendant hommage au consciencieux travail de Nilant, il pensa qu’il aurait fait une besogne plus utile, s’il s’était borné à publier, en y ajoutant en note les variantes de son manuscrit, les fables de Romulus telles qu’elles avaient paru dans la vieille édition d’Ulm.
Schwabe, tirant du même point de vue des déductions peut-être plus logiques, n’exprimait pas le même regret. Il déclarait ne pas {p. 714}comprendre de quelle utilité pouvaient être des variantes vicieuses. Aussi, lorsqu’il entreprit la publication des fables de ce Romulus, laissa-t-il complètement de côté le texte de l’édition de Nilant. Il se fit communiquer par le conseiller du duc de Brunswick, Lauger, conservateur de la bibliothèque de Wolfenbüttel, la copie prise par Gude du manuscrit de Dijon et l’exemplaire qu’il croyait unique de la vieille édition d’Ulm et que pour cette fausse raison il appela le véritable Phénix des livres, et ces deux documents, joints aux vingt-neuf fables que Vincent de Beauvais avait d’abord transcrites dans son Speculum historiale495 et ensuite dans son Speculum doctrinale496, furent les seules sources qui lui servirent à publier, à Brunswick, en 1806, en même temps que l’œuvre poétique de Phèdre, la prosaïque paraphrase du Romulus ordinaire.
Comme Lessing, Schwabe n’avait pas aperçu le véritable intérêt qu’offrait le Romulus de Leyde. À mon sens, lorsqu’on examine les textes latins du moyen âge, on ne doit pas les envisager au même point de vue que lorsqu’il s’agit d’étudier ceux de la bonne latinité. Si l’on songe à l’état dans lequel était alors tombée la langue latine, on comprend que ce qui doit toucher dans une œuvre de cette longue période d’engourdissement intellectuel, c’est moins sa pureté grammaticale que le rôle qu’elle a joué dans l’histoire littéraire. Et grand a été celui du Romulus de Nilant, car il a donné naissance au Romulus anglo-latin, d’où est indirectement sortie la traduction poétique de Marie de France.
Ceux qui viendront après moi pourront se demander si j’ai eu raison de faire du Romulus de Nilant un dérivé du Romulus primitif et prétendre que c’est du Romulus ordinaire que j’aurais dû le faire descendre. Je reconnais qu’on pourra adopter sur cette question une solution autre que celle à laquelle je me suis arrêté. Mais cela ne me semble présenter qu’un faible intérêt. Qu’importe en effet qu’il soit le fils ou le petit-fils du Romulus primitif ! Ce qui à mes yeux était le point capital, c’était de montrer de quelle grande famille d’œuvres de langues diverses il avait été le chef. Et l’on va bientôt voir que c’est ce que j’ai fait.
Section II.
Manuscrits du Romulus de Nilant. §
Le manuscrit 18270 de la Bibliothèque nationale étant à la fois un peu plus ancien et aussi complet que le plus ancien et le plus complet des deux autres, c’est celui dont je dois donner d’abord la description.
C’est un in-fol. de petit format, dont l’écriture sur parchemin
est bien conservée et très lisible. Il se compose de 43 feuillets. Le premier et
les deux derniers ont été ajoutés tardivement aux 40 autres. Il a appartenu à
Antoine Loysel ; c’est ce qui ressort de ces mots qui se trouvent sur le recto
du 2e feuillet : « Antonius Loysel. »
Il est
ensuite passé dans la bibliothèque de Notre-Dame, ainsi qu’il résulte de cette
mention inscrite sur le premier feuillet ajouté aux anciens : « A la
Bibliothèque de l’église de Paris. »
Cette mention a été mise en
marge, le feuillet étant lui-même rempli par la teneur d’un arrêt du Parlement
de Paris en date du 23 juin 1565. Cet arrêt est précédé de ces mots :
« Extrait des registres du Parlement. »
Le premier des deux
feuillets ajoutés à la fin porte également une décision judiciaire.
Le manuscrit renferme deux ouvrages.
Le premier, qui commence au recto du 2e feuillet, porte ce titre : Incipit epistola Cornelii
ad Crispum Salustium (sic) in Troianorum hystoria || que
in greco a Darete hystoriographo facta est
, et se termine au
milieu du recto du vingtième feuillet par cette souscription : Hucusque hystoria Daretis.
Le second, qui commence au
recto du même feuillet, porte à l’encre rouge ce titre abrégé : Incipiunt f.
, écrit à la suite de la souscription
précédente.
Les fables qui forment le second ouvrage sont au nombre de 51, si l’on y comprend la dernière pièce. Elles sont précédées de la dédicace amplifiée de Romulus à son fils et suivies de l’épilogue à Rufus. Elles ne portent pas de titres. Les dix-sept premières seulement sont accompagnées d’un numéro d’ordre, qui pour chacune, sauf pour la première, est placé à la fin de la précédente.
{p. 716}Les 51 fables, dont se compose la collection, sont divisées en deux livres et comprennent : 1º 18 fables appartenant toutes, sauf la sixième, au livre I du Romulus primitif ; 2º 33 fables appartenant aux deux derniers livres.
Parmi les 51 fables, il y en a deux qui sont incomplètes ; ce
sont les fables 40 et 50. La fable 40, commencée au verso du folio 35, s’arrête
aux mots Cui Iuno iterum
, qui sont séparés du
commencement de la fable suivante par l’espace blanc jugé nécessaire à son
achèvement, et la fable 50, commencée au recto du fol. 39, s’arrête aux mots
iacentem in itinere
, qui sont également
suivis d’un grand espace laissé en blanc pour permettre de la compléter. Dans la
liste que j’ai précédemment dressée, je n’ai pas cru devoir tenir compte de ce
second fragment qui ne figure pas dans les deux autres manuscrits et qui me
semble avoir été une addition du copiste.
Les fables se terminent par le mot Amen
en tête du recto du feuillet 40, dont elles n’occupent que
les 6 premières lignes.
Des deux derniers manuscrits, qui contiennent le Romulus anglo-latin, le plus important est celui qui porte la cote 172 dans le fonds Digbey de la bibliothèque Bodléienne. Il forme un volume in fol., dont les feuillets en parchemin portent une écriture du xiiie siècle à deux colonnes, assez difficile à déchiffrer. Il se compose de 192 feuillets.
La collection de fables qu’il contient commence au recto du feuillet 96.
Ces fables sont classées dans le même ordre que celles du Romulus
primitif, et sont divisées en trois livres précédés de la même dédicace et
suivis du même épilogue. Le premier comprend 18 fables ; le deuxième, 20, et le
troisième, 12 dont la dernière est celle intitulée : La
Statue d’Ésope.
C’est une division évidemment calquée sur celle
du Romulus primitif. En effet, dans les deux collections, les mêmes fables
appartiennent aux mêmes livres.
Sauf la fable du Glaive perdu, qui d’ailleurs, dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale, n’existe qu’à l’état de fragment, toutes les fables de ce manuscrit se retrouvent dans celui d’Oxford. Il s’ensuit que celles de ce dernier manuscrit sont au nombre de 50 et {p. 717}dépassent de 5 celles du manuscrit de Leyde. Ces 5 fables sont les suivantes : i, 6. Le Buffle, le Loup et le Lion ; iii, 4. Les Oiseaux et l’Oiseleur ; iii, 9. Le Chameau et la Puce ; iii, 11. La Corneille et la Brebis ; iii, 12. La Statue d’Ésope.
Les 50 fables du manuscrit Digbéien sont précédées de titres très explicites qui font connaître le sujet de chacune. On les trouvera dans le second volume de cet ouvrage, en tête des fables du Romulus de Nilant qui seront également tirées de ce manuscrit.
Le catalogue in-fol. de la Bibliothèque de l’Université de Leyde, publié dans cette ville par Pierre Vander Aa au commencement du siècle dernier497, attribue à tort au manuscrit latin Vossianus 46 le format in-8º. C’est un volume in-4º, dont les feuillets sont partie en parchemin et partie en papier et dont l’écriture très fine, à deux colonnes, est du commencement du xive siècle.
Il a fait partie de la bibliothèque de Paul Petau. Il ne peut sur ce point exister aucun doute ; car on reconnaît son écriture dans la cote Y. 9 encore apparente qu’il y avait inscrite.
Il paraît qu’après la mort du fils de ce savant antiquaire Isaac Vossius ne s’était pas contenté d’acheter pour la reine de Suède une partie de sa bibliothèque et qu’il avait acquis pour lui-même une certaine quantité de manuscrits qui en dépendaient et notamment celui dont il s’agit ici.
Des mains d’Isaac Vossius il est passé avec toute la bibliothèque de ce célèbre bibliophile dans celle de l’Université de Leyde, où Nilant l’a trouvé et a publié le Romulus qu’il renfermait et auquel il a ainsi attaché son nom.
Dans le catalogue ci-dessus indiqué, le contenu en est analysé en ces termes :
Fabulæ Æsopi.
Integumenta elegiacis versibus scripta, quorum primum distichon est, Parvus majori paret veloxque minatur Quo jubeat dominus prævius ire solet.
{p. 718}Excerpta ex aliis anonymis, et ex Alexandreide, et epistolis Horatii. Hæc in membranis.
Callisthenis Philosophi Atheniensis quinque libri de transmutatione metallorum.
Vincentii Bellovacensis utriusque Alchimiæ libellus.
Arnaldi de Villa Nova doctrinæ practicæ libellus.
Gilgilis Chalcidensis Alchimiæ practicæ libellus.
Cabilistica ars, et ex pluribus auctoribus excerpta ejus artis.
Item ars practica ad cognoscendum futura. In charta.
La collection de Romulus, signalée dans la nomenclature qui précède, en occupe les cinq premiers feuillets.
Elle porte un titre ainsi conçu : Incipit
liber fabularum Esopi Atheniensis
, et se termine par cette
souscription : Explicit liber Esopi.
Le manuscrit de Leyde, moins complet que les deux autres, ne possède que 45 fables, et, comme c’est le seul que Nilant ait connu, il s’ensuit que, dans son édition de 1709, il n’a fait qu’une publication forcément incomplète de la collection à laquelle il a attaché son nom.
Chapitre II.
Dérivés en prose latine. — Romulus
anglo-latin et ses dérivés. §
Section I.
Dissertation sur le Romulus
anglo-latin. §
J’ai dit que le Romulus de Nilant avait été la source d’une importante collection de fables, de laquelle était indirectement venue la version poétique de Marie de France.
Dans ma première édition, voulant attribuer à cette collection un nom qui la distinguât des autres, je l’ai appelée Romulus de Marie. Dorénavant, acceptant la dénomination qu’elle a reçue de M. Gaston Paris498, je la désignerai par la qualification de Romulus anglo-latin.
C’est ce Romulus qui, avec ses dérivés, va faire l’objet de ce deuxième chapitre.
Le Romulus anglo-latin remonte à un temps relativement reculé. S’il avait été traduit directement par Marie de France, on ne pourrait avec certitude le reporter à une époque antérieure au xiiie siècle. Mais il ne faut pas oublier que sa traduction a été composée sur une première version en langue anglaise que plusieurs critiques, et notamment {p. 720}M. P. Chabaille499, ont, avec une certaine apparence de raison selon moi, imputée au roi Henri Beau-Clerc. Il est vrai que, dans la plupart des manuscrits qui nous ont conservé l’œuvre de Marie, son épilogue attribue la traduction anglaise à un autre roi d’Angleterre, dont il dénature toujours le nom et qu’il appelle Almes500, Alrei501, Avree502, Uvres503, Auvrez504, Mires505, Alvrez506. Mais je dois dire aussi que le manuscrit français 1446 de la Bibliothèque nationale et le manuscrit Harley 4333 de la Bibliothèque du British Museum désignent ce roi sous le nom de Henris, et, lorsqu’on songe que celui qui l’a porté le premier a reçu et mérité le surnom de Beau-Clerc, on est tout naturellement conduit à le croire le véritable auteur ou tout au moins le véritable inspirateur de la traduction anglaise. Or, ce roi a régné de 1100 à 1135 ; il s’ensuit que la collection ne peut être plus récente que la fin du xie siècle ou le commencement du xiie.
Dans son analyse de ma première édition507, M. Gaston
Paris a refusé au roi Henri Beau-Clerc la paternité de la traduction anglaise.
Il a prétendu qu’au xiie siècle on avait coutume
d’attribuer à Alfred le Grand « beaucoup d’ouvrages qu’il n’avait pas
faits »
, mais que cette tradition avait été respectée par Marie de
France, et que dès lors « j’avais été mal inspiré en voulant, avec deux
manuscrits sans autorité, lire dans son épilogue Henris au
lieu d’Alvrez508. »
M. G. Paris
n’aurait pas dû s’en tenir là, et, puisque, selon lui, aucun des deux rois
anglais ne devait être considéré comme l’auteur de la traduction, il aurait dû,
aidé de sa haute érudition, risquer une conjecture sur le nom de celui qui
pouvait l’avoir écrite.
Faute par lui d’avoir complété sa critique, le mieux, à mon avis, est de s’en rapporter aux manuscrits. Or, Alfred le Grand remonte {p. 721}à une époque où le texte à traduire n’existait pas encore, et, comme les manuscrits dans lesquels on lit Henris sont tout aussi anciens et ne doivent pas inspirer moins de confiance que les autres, que, si ce n’est pas Marie qui a écrit ce nom, les copistes qui, dans deux manuscrits, l’ont substitué à celui d’Alvrez ont pu n’agir ainsi que par respect pour la vérité historique, et qu’enfin des rois d’Angleterre Henri Beau-Clerc est le seul que ce nom puisse désigner, c’est à lui que je persiste à attribuer la traduction anglaise.
Il ne peut, à mon sens, s’élever de débat sérieux que sur le point de savoir si le roi Henri Beau-Clerc s’est acquitté lui-même ou a chargé quelque érudit de cette tâche. Il y a ici désaccord entre les textes. Dans son épilogue, Marie, très affirmative, s’exprime ainsi :
Ysope apele icest liureQu’il translata et sut escrire ;De grieu en latin le torna.Li roi Henris qui mult l’amaLe translata puis en englois.
Suivant elle, c’est donc le roi d’Angleterre qui écrivit la traduction anglaise.
Si, au contraire, on s’en rapporte au prologue de cette
collection de 136 fables dérivée du Romulus anglo-latin, dont il a déjà été
question aux pages 294 et 478 et à laquelle j’ai donné le nom de Dérivé complet, le roi ne serait plus l’auteur de la traduction ; il
aurait seulement donné l’ordre de l’exécuter. « In anglicam
linguam, disent les manuscrits, eum transferri
præcepit. »
Est-ce au texte latin ou à la version française qu’il faut donner la préférence ? Je n’ose trancher la question, et, laissant à de plus habiles le soin de la résoudre, je ne retiens de ce qui précède qu’une chose, c’est que le Romulus anglo-latin n’est pas postérieur au commencement du xiie siècle.
Lorsque j’ai publié ma première édition, m’étant posé la question de savoir si le Romulus anglo-latin existait encore, j’avais cru en apercevoir un fragment dans cette collection de vingt-deux fables qui, M. Robert en ayant été, en 1825, le premier éditeur, a {p. 722}reçu le nom de Romulus Roberti. C’était une erreur : le texte cherché était bien irrévocablement perdu. Mais on me permettra d’ajouter, à ma décharge, que c’était une erreur excusable ; car on verra plus loin que des deux dérivés latins dont le Romulus anglo-latin a été le père, c’était celui qui lui ressemblait le plus.
Dans le prologue et dans l’épilogue de sa traduction, Marie de France dit qu’Ésope avait adressé à son maître des fables qu’il avait traduites du grec en latin, que Romulus qui fut empereur envoya le recueil à son fils, que le roi Alfred (Henri dans deux manuscrits) le traduisit ensuite en anglais et qu’elle a elle-même mis en français la traduction anglaise.
Qu’en disant tout cela Marie n’ait pas parfaitement interprété ce qu’elle avait lu, cela n’est pas douteux ; mais, ce qui est encore plus certain, c’est qu’elle n’avait rien inventé et que, si elle a fait de Romulus un empereur, c’est qu’elle l’avait vu affublé de ce titre dans la traduction anglaise dont elle s’était servie. Or, si cette traduction en était bien une, le traducteur n’avait pas dû faire au texte latin des additions fantaisistes, et, s’il avait qualifié Romulus d’empereur romain, c’est qu’il avait trouvé cette qualification dans le texte latin.
Si, lorsqu’il s’est agi pour moi de publier ma première édition, je m’étais fait ces réflexions qui, depuis, m’ont spontanément éclairé, j’aurais été tout naturellement conduit à apercevoir le lien intime qui existait entre le Romulus de Nilant et ce mystérieux Romulus anglo-latin, dont j’ai à tort cru voir un fragment dans le Romulus Roberti.
En effet le Romulus de Nilant est de tous les dérivés directs du Romulus primitif le seul qui, dans la dédicace à Tiberinus, donne à l’auteur fictif de cette dédicace le titre d’empereur romain. C’est la seule dans laquelle au nom de Romulus soient accolés les mots urbis Romæ imperator. Il est difficile, après les avoir lus, de les rapprocher du prologue du Dérivé de cent trente-six fables et de l’épilogue de Marie sans apercevoir que le Romulus de Nilant, s’il ne doit pas être confondu avec l’anglo-latin, en a été le point de départ. L’examen auquel je vais me livrer va établir que cette première impression est la bonne. Si elle ne reposait pas sur d’autres bases que celles que je viens d’indiquer, elle pourrait n’être pas unanimement approuvée. Mais elle a d’autres points d’appui.
{p. 723}On sait, par la première édition de cet ouvrage, que du Romulus sur lequel a été faite la version anglaise est sorti le Dérivé latin de cent trente-six fables que j’ai publié.
Dans les divers manuscrits où je l’ai trouvé, les fables étaient toujours rangées dans le même ordre, et cet ordre, qui diffère de celui dans lequel sont disposées les fables du Romulus primitif, est conforme à celui des fables du Romulus de Nilant.
Comme le tableau que j’ai précédemment dressé a montré que, pour ces dernières, le classement du Romulus primitif avait été complètement respecté, on peut penser que je me mets ici en contradiction avec moi-même ; mais, en lisant ce qui suit, on comprendra qu’il n’en est rien.
Le Romulus de Nilant ne se compose au total que de 50 fables empruntées aux trois livres du Romulus primitif, tandis que, dans le dérivé, sur 136 on en trouve 79 qui ont cette origine. Est-ce que ces soixante-dix-neuf fables, indirectement issues du Romulus primitif, apparaissent dans l’ordre dans lequel elles sont dans ce Romulus ? Nullement. Voici comment elles sont disposées : les trente-quatre premières qu’on y remarque sont les mêmes et sont dans le même ordre que celles du Romulus de Nilant, avec cette seule différence que dans le Dérivé ont été omises deux de celles de ce Romulus, celles qui portent les nos ii, 5 et ii, 11. Puis, du nº 35 au nº 75 sont intercalées quarante et une fables qui, si parmi elles ne figurait pas une des deux précédemment omises, seraient toutes étrangères au Romulus de Nilant. Ensuite, du nº 76 au nº 88, les fables qui, au contraire, en sont dérivées, reparaissent et se complètent dans un ordre identique. Du nº 89 au nº 112 ont été réunies vingt-quatre fables qui, appartenant aux divers livres du Romulus primitif, mais n’existant pas dans le Romulus de Nilant, ont été reléguées après celles de ce dernier. Enfin, du nº 113 au nº 136, le Dérivé se termine par vingt-quatre autres fables que les manuscrits attribuent au roi Alfred et qui, comprenant cinq fables puisées dans le Romulus primitif ou tout au moins dans le Romulus ordinaire, sont pour le surplus sorties d’autres sources.
Quand on décompose ainsi les 136 fables on voit que, tout en
s’appropriant presque entièrement le Romulus primitif, la collection commence
par reproduire, séparées en deux groupes, mais rangées dans un ordre identique,
quarante-huit des fables du Romulus {p. 724}de Nilant,
c’est-à-dire toutes sauf une. Je dis toutes sauf une ; car, s’il est vrai que la
cinquantième de ce Romulus, intitulée : La Statue
d’Esope
, a été également omise dans le Dérivé complet, cette
fable n’en est pas une et n’est qu’une pièce inspirée par l’épilogue du livre II
de Phèdre. N’en doit-on pas forcément conclure que le Romulus anglo-latin avait
eu lui-même pour première origine le Romulus de Nilant, auquel avaient été
ajoutés des emprunts faits à des collections diverses ?
Il y a, en outre, une particularité à signaler. Le Romulus primitif et ses dérivés déjà passés en revue possèdent la fable du Lion qui s’est associé avec la Vache, la Chèvre et la Brebis pour partager le produit de leur chasse commune. Mais ce sujet de fable n’y est traité qu’une fois. Dans les manuscrits du Dérivé de 136 fables, on le trouve deux fois, d’abord avec d’autres personnages et tout de suite après avec les mêmes. De là les fables vi et vii intitulées, l’une : Le Buffle, le Loup et le Lion, l’autre : La Vache, la Brebis, le Bélier et le Lion. Or, ces deux fables existent à la même place dans la collection qui porte le nom de Nilant. Comment pourrait-il en être ainsi, si le Romulus anglo-latin, dont la collection de 136 fables est dérivée, n’était pas lui-même issu du Romulus de Nilant ? La généalogie des collections est donc bien établie.
On m’objectera peut-être, en l’absence du Romulus anglo-latin, que rien ne prouve que ce soit lui qui soit issu du Romulus de Nilant et qu’il se pourrait que ce dernier qui ne renferme qu’une partie de son contenu en fût au contraire dérivé. Il faudrait, pour formuler une pareille objection, ne connaître ni le texte de Nilant, ni celui du Dérivé de cent trente-six fables. Aussi ne suis-je pas bien certain qu’elle sera hasardée. Mais lors même que j’en serais sûr, je ne m’attarderais pas à la réfuter ici. En effet, plus loin, lorsque j’étudierai le Romulus Roberti, la réfutation se fera d’elle-même. On verra alors que ce Romulus et le Dérivé de 136 fables offrent des expressions qui leur sont communes, qui, en même temps sont étrangères au Romulus primitif, qui n’ont pu davantage être empruntées au texte de Nilant resté conforme au Romulus primitif, et qui ont été nécessairement puisées dans le Romulus anglo-latin placé entre eux et le texte de Nilant. On acquerra ainsi la certitude que ce texte n’a pu être une imitation partielle du Romulus anglo-latin.
L’importance qu’au moyen âge on a attribuée au Romulus anglo-latin me fait un devoir de ne pas clore cette dissertation sans avoir au moins essayé de dresser la liste des fables dont il s’est composé.
Combien en possédait-il ? Il est difficile de faire à cette question une réponse certaine. Dans ma première édition, j’avais opté pour le chiffre de 104, et voici les raisons qui me l’avaient fait admettre. J’avais tablé sur cette double hypothèse que les vingt-deux fables du Romulus Roberti, dont j’aurai bientôt à parler plus amplement, étaient un fragment du Romulus anglo-latin et que Marie avait dû composer sa version poétique sur un manuscrit à peu près complet de la traduction anglaise. Or, comme sa version ne comprend que 103 fables et que la collection que je prenais pour un fragment du Romulus anglo-latin en offre une qui n’existe pas dans sa version, celle du Renard et des Raisins, l’ajoutant aux siennes, j’étais arrivé à un total de 104 fables.
M. G. Paris509 n’a pas jugé ce compte exact. Pour le rectifier, il est parti de cette idée que la collection de 22 fables et celle de 136, qu’il ne considérait que comme des dérivés, l’un direct, l’autre très indirect, du Romulus anglo-latin, ne renfermaient pas de fables étrangères à ce Romulus, et, voyant que la collection de 22 fables en possédait une qui manquait dans l’autre, il l’a ajoutée et est ainsi arrivé à un nombre total de 137 fables. Il est possible que ce nombre soit le vrai ; mais je ne le crois pas.
Le premier élément à faire entrer dans la composition du Romulus anglo-latin, c’est le texte du Romulus de Nilant. Mais dans le manuscrit de Leyde que Nilant a publié il n’y a que 45 fables. Je me suis demandé s’il n’existait pas d’autres manuscrits plus complets contenant la même collection, et mes recherches m’en ont fait découvrir deux autres qui m’ont permis de fixer à cinquante le nombre des fables du Romulus de Nilant. L’un des deux manuscrits contient même le commencement d’une fable inachevée qui, manquant complètement dans l’autre, m’a paru être une addition de copiste et ne devoir pas être comptée. D’autre part, {p. 726}comme je l’ai déjà dit, la cinquantième fable, provenant du Romulus primitif et indirectement de l’épilogue du livre II de Phèdre, mais ayant trait à la statue d’Ésope, n’est pas une vraie fable et ne doit pas entrer en compte. C’est donc un premier total de 49 fables.
Que faut-il y ajouter ? Ce sont le Dérivé de 136 fables et la traduction de Marie de France qui vont nous l’apprendre. J’ai fait connaître les divers éléments dont le Dérivé était formé. Parmi eux, il en est un dont Marie n’a fait aucun usage, c’est l’addition de 24 fables qui a consisté à mettre à la suite des fables du Romulus de Nilant ce qu’il restait à puiser dans le Romulus primitif. Au contraire, la traduction de Marie comprend, presque dans leur intégrité, les autres éléments du Dérivé. Ce qui semble en ressortir, c’est que le Romulus anglo-latin dont elle est indirectement issue, embrassait, sauf les 24 fables dont il vient d’être question, toutes celles qu’on retrouve dans le Dérivé et même une de plus ; car ce dernier n’a pas conservé la fable de l’Homme en mal d’enfant. On arrive ainsi au résultat suivant : 136 – 24 = 112 + 1 = 113. En outre, il faut remarquer que dans la traduction de Marie il existe une fable, celle des Oiseaux élisant un roi, qui n’existe pas dans le Dérivé, et qui, n’ayant certainement pas été ajoutée par Marie, a dû appartenir au Romulus anglo-latin, ce qui en élève le nombre total à 114.
Reste à examiner la question de savoir si le nombre de 114 ne devrait pas être réduit à 104. Sur les 114 fables, il y en a en effet 11 que Marie n’a pas traduites, savoir : six appartenant au Romulus de Nilant, deux dépendant de l’addition intercalée au milieu de ce Romulus et trois faisant partie du dernier groupe attribué par les manuscrits à Alfred le Grand.
En ce qui touche les six premières fables, je n’hésite pas à penser qu’elles figuraient bien dans le Romulus anglo-latin et que, si Marie les a omises, c’est parce qu’elles faisaient défaut dans la traduction anglaise dont elle s’est servie.
À l’égard des deux qui dépendent de la collection intercalée, je ne saurais être affirmatif : j’ignore si c’est, ou non, une addition qui, due à l’auteur du Dérivé de 136 fables, n’avait pas été trouvée par lui dans le Romulus anglo-latin.
Quant aux trois dernières fables, la place qui leur a été donnée tout à la fin du Dérivé et les sujets même qu’elles traitent, me portent {p. 727}au contraire à y voir une addition de l’auteur du Dérivé.
En résumé, le parti le plus sage dans l’incertitude où je suis est de maintenir le nombre de 114 ; en conséquence, j’établis de la façon suivante la liste des fables du Romulus anglo-latin :
| Romulus anglo-latin. | Romulus primitif. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| 6. Le Buffle, le Loup et le Lion. | |
| 7. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| 8. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| 9. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 10. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| 11. Le Rat de ville et le Rat des champs. | I, 12. |
| 12. L’Aigle et le Renard. | I, 13. |
| 13. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 14. |
| 14. Le Corbeau et le Renard. | I, 15. |
| 15. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 16. |
| 16. L’Âne qui caresse son maître. | I, 17. |
| 17. Le Lion et le Rat. | I, 18. |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 20. |
| 19. Les Grenouilles qui demandent un roi. | II, 1. |
| 20. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 21. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| 22. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| 23. L’Homme en mal d’enfant. | II, 5. |
| 24. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 25. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 8. |
| 26. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| 27. Le Lion médecin. | III, 2. |
| 28. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| 29. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| 30. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. |
| 31. L’Inconstance de la Femme. | III, 9. |
| 32. La Courtisane et le Jeune Homme. | III, 10. |
| 33. Les Loups et les Brebis. | III, 15. |
| 34. La Hache et les Arbres. | III, 16. |
| 35. Le Loup et le Chien. | III, 17. |
| 36. L’Estomac et les Membres. | III, 18. |
| 37. Le Singe et le Renard. | III, 19. |
| 38. Le Lion roi et le Singe. | III, 22. |
| 39. Le Loup et le Berger. | III, 25. |
| {p. 728}40. Le Paon et Junon. | III, 26. |
| 41. Les Moutons et les Béliers. | III, 28. |
| 42. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 29. |
| 43. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | III, 30. |
| 44. L’Âne et le Lion. | III, 32. |
| 45. Le Lion malade et le Renard. | III, 34. |
| 46. L’Homme et le Lion. | III, 39. |
| 47. La Puce et le Chameau. | III, 40. |
| 48. La Fourmi et le Grillon. | III, 41. |
| 49. La Corneille et la Brebis. | III, 43. |
| 50. Le Voleur et l’Escarbot. | |
| 51. La Femme et son Amant. | |
| 52. Encore la Femme et son Amant. | |
| 53. Le Cheval vendu. | |
| 54. Le Voleur et le Diable. | |
| 55. Le Loup et le Bélier. | |
| 56. Le Singe et sa Progéniture. | |
| 57. Le Dragon et l’Homme. | |
| 58. L’Ermite et son Serviteur. | |
| 59. Le Paysan et son Cheval unique. | |
| 60. L’Homme en prière à l’église. | |
| 61. Le Citadin et son Choucas. | |
| 62. Le Paysan et les trois Souhaits. | |
| 63. Le Renard et le reflet de la Lune. | |
| 64. Le Loup et le Corbeau. | |
| 65. Le Coq et le Renard. | |
| 66. Le Renard et le Pigeon. | |
| 67. L’Aigle, l’Épervier et les Pigeons. | |
| 68. Le Cheval affamé. | |
| 69. L’Homme, le Bouc et le Cheval. | |
| 70. Le Loup et l’Escarbot. | |
| 71. Les Bergers et les Loups. | |
| 72. Le Corbeau paré des plumes du Paon. | II, 15. |
| 73. Le Lion malade, le Loup écorché et le Renard. | |
| 74. Le Renard et l’Ourse. | |
| 75. Le Lion malade, le Renard et le Cœur du Cerf. | |
| 76. Le Loup et le Hérisson poursuivis. | |
| 77. Le Paysan et le Bœuf. | |
| 78. L’Abeille et la Mouche. | II, 17. |
| 79. Les deux Loups. | |
| 80. Le Loup et le Renard jugés par le Lion. | |
| 81. La Chèvre et le Chevreau. | |
| 82. Le Peintre et sa Femme. | |
| 83. La Biche et son Faon. | |
| {p. 729}84. Le Corbeau et ses Petits. | |
| 85. Le Milan malade. | I, 19. |
| 86. La Chèvre et le Loup. | |
| 87. L’Homme et la Femme querelleuse. | |
| 88. L’Homme et la Femme noyée. | |
| 89. Le Soldat et les deux Voleurs. | |
| 90. Le Maître et l’Esclave. | |
| 91. Le Riche et sa Fille. | |
| 92. L’Homme et le Serpent. | II, 10. |
| 93. Le Mulot qui cherche Femme. | |
| 94. L’Âne et le Sanglier. | I, 11. |
| 95. L’Escarbot vaniteux. | |
| 96. Les Porcs et le Blaireau. | |
| 97. Le Loup pris au piège et le Hérisson. | |
| 98. Le Loup et le Batelier. | |
| 99. L’Épervier et la Chouette. | |
| 100. L’Aigle et l’Épervier fugitif. | |
| 101. Le Prêtre et le Loup. | |
| 102. La Vipère et la Lime. | III, 14. |
| 103. L’Hirondelle et les Moineaux. | |
| 104. Le Lièvre et le Cerf. | |
| 105. Le Loup et le Pigeon ramier. | |
| 106. Le Chat et le Renard. | |
| 107. L’Homme qui navigue sur mer. | |
| 108. Le Vieillard et son Fils. | |
| 109. Le Chat mitré. | |
| 110. La Femme et sa Poule. | III, 8. |
| 111. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | II, 18. |
| 112. Les Arbres qui se donnent un Roi. | |
| 113. Le Lion et ses Fils. | |
| 114. Les Oiseaux qui élisent un Roi. |
Section II.
Traduction anglaise. §
De ce qui a déjà été expliqué il ressort que le Romulus anglo-latin a, peu de temps après son apparition, été traduit en langue anglaise. Mais, comme cette traduction n’a été conservée par aucun manuscrit, je me contente de la mentionner à cette place. Je ne {p. 730}pourrais d’ailleurs ici que répéter ce que j’ai eu l’occasion d’en dire, ou que dire ce que je serais plus loin obligé de répéter.
Section III.
Traduction en vers français de Marie de
France. §
Une étude sur le Romulus anglo-latin ne serait pas complète, si elle n’était pas au moins suivie d’un coup d’œil sur l’œuvre de la femme, qui, au moyen âge, en a été pour la France la poétique vulgarisatrice.
Pour procéder méthodiquement, je diviserai cette section en trois parties consacrées, la première à sa biographie, la deuxième à ses fables, la troisième aux manuscrits de ses fables.
Quand je n’en serais pas empêché par le défaut d’espace, je n’entreprendrais pas ici d’écrire la biographie complète de Marie : je ne voudrais pas m’exposer à refaire mal ce que de plus habiles ont déjà plusieurs fois bien fait. Je me bornerai donc à rappeler, en ce qui touche cette poétesse illustre, ce qu’il est indispensable d’en savoir et à renvoyer ceux qui désireront la mieux connaître à l’édition de ses œuvres publiée par M. de Roquefort510, à l’article que M. P. Chabaille lui a consacré dans la Nouvelle Biographie générale de MM. Firmin-Didot frères, enfin aux nombreux travaux dont elle a été l’objet et dont la nomenclature se trouve dans le Répertoire des sources historiques du moyen âge de M. Ulysse Chevalier511.
Contrairement à l’usage des trouvères, qui, dans leurs œuvres, se sont presque toujours abstenus de donner sur eux les moindres renseignements, elle nous a fait connaître son nom et sa nationalité dans ce fameux vers de l’épilogue de ses fables :
Marie ai non, si sui de France.
{p. 731}Quant à sa ville natale, on la trouve indiquée par Jehan Dupain, dans ces vers de l’Évangile des femmes :
Evangile des femmes vous weil cy recorder ;Moult grant prouffit y a qui le veult escouter ;Cent jours de hors pardon y pourroit conquester ;Marie de Compiègne le conquist oultremer512.
À l’égard de l’époque, à laquelle elle a vécu, les avis sont partagés. Legrand d’Aussy suppose que le comte Guillaume pour qui dans l’épilogue de ses fables elle déclare avoir fait sa traduction est Guillaume de Dampierre, qui, suivant M. de Roquefort, était mort avant l’année 1246513, et qui, suivant M. P. Chabaille, périt en 1251, à Trasegnies, dans un tournoi.
Cette hypothèse généralement admise souleva néanmoins quelques
contradictions. Dans une dissertation sur les poètes anglo-normands, vulgarisée
par M. de Roquefort514, l’abbé de la Rue prétendit que Marie avait voulu parler d’un
fils naturel de Henri II515.
Puis survint M. Robert qui n’hésita pas à affirmer que Marie avait entendu
désigner Guillaume d’Ypres516. En 1834, dans son ouvrage sur les Bardes, les
Jongleurs et les Trouvères, voulant sans doute donner à la question une solution
définitive, l’abbé de la Rue n’hésita pas à la traiter de nouveau. Voici en
quels termes il s’exprime : « Legrand d’Aussy, dans la préface qu’il a
mise en tête de quelques fables de Marie, imprimées parmi ses Fabliaux, dit
que ce comte était Guillaume, sire de Dampierre en Champagne. Mais ce seigneur
n’avait par lui-même aucun droit au titre de comte, et les gentilshommes
d’alors n’usurpaient pas des titres comme ceux de nos jours. Il est vrai qu’il
avait épousé Marguerite de Flandres ; mais il était mort trois ans avant
qu’elle eût hérité du comté de Flandres, par la mort de sa sœur Jeanne,
décédée sans enfans ; il n’a donc jamais eu le titre de comte, et son fils Guy
de Dampierre ne le prit qu’à la mort de sa mère en 1280. L’auteur des fables
inédites des {p. 732}xiie,
xiiie et xive siècles veut que Guillaume d’Ypres soit le comte de Flandres
dont parle Marie ; mais ou ne le trouve dans aucun historien ; il y eut, il
est vrai, des prétentions mal fondées et qui furent sans succès. Il faudrait
d’ailleurs, si l’opinion de l’éditeur avait quelque poids, placer Marie même
dans la première moitié du xiie siècle, et le
style de cette femme, comme le témoignage des auteurs du siècle suivant,
doivent la faire reléguer à cette dernière époque, puisqu’ils attestent qu’on
aimait autant son personnel (sic) qu’on estimait ses
ouvrages. Pour nous qui croyons que Marie n’écrivait pas en France, mais en
Angleterre, c’est dans ce dernier royaume que nous cherchons le comte
Guillaume. Heureusement l’éloge qu’elle en fait en peu de mots nous indique
facilement que ce prince était Guillaume Longue-Épée, fils naturel du roi
Henri II et de la belle Rosemonde, et créé comte de Salisbury ou de Romare par
Richard Cœur-de-Lion517. »
Les savantes observations de l’abbé de la Rue n’ont pas découragé
les partisans de l’opinion émise par Legrand d’Aussy : M. P. Chabaille n’a pas
hésité à la soutenir, et, pour la faire mieux triompher, s’est appuyé sur le
témoignage de l’auteur de la Branche du Couronnement du
Renart. « Ce trouvère, dit-il, dédie son poème au vaillant
Guillaume, comte de Flandre, pour offrir un modèle d’honneur à sa famille.
Dans leur rage de ne pouvoir obtenir accès auprès du comte, la Médisance,
l’Envie, l’Orgueil firent tant qu’ils parvinrent à le tuer en trahison dans un
tournoi. “Ah ! comte Guillaume, s’écrie le trouvère, vous n’étiez avide que
d’honneur, et l’on vous regardait avec raison comme seigneur légitime : il ne
faut pas s’étonner si le marquis de Namur vous ressemble, car jamais il n’eut
recours à la renardie.” — “Et voilà, continue le trouvère, pourquoi j’ai pris
pour sujet de mon prologue l’éloge du comte Guillaume, à l’exemple de Marie,
qui traduisit pour lui les fables d’Izopet.” »
Qu’il me soit permis maintenant d’intervenir dans le débat. D’abord je ne prendrai pas la peine de réfuter l’hypothèse de M. Robert ; il est trop évident qu’elle est inadmissible. Mais que dire de celle de Legrand d’Aussy ? Quelle que soit la gravité du témoignage qui la fortifie, je n’hésite pas à la croire fausse. Si l’on {p. 733}acceptait sur la personnalité du comte Guillaume l’opinion émise par Legrand d’Aussy, il faudrait admettre que Marie a écrit ses fables vers le milieu du xiiie siècle. C’était d’ailleurs, suivant M. de Roquefort, la thèse professée par tous les biographes et notamment par Fauchet518, Pasquier519 et Massieu520. Or cette thèse est inconciliable avec l’âge des manuscrits que nous possédons. Qu’on examine par exemple le manuscrit français 25405 de la Bibliothèque nationale, et l’on y verra une note qui lui assigne la date de 1204. Cette date, il est vrai, ne peut être qu’hypothétique ; mais, en la supposant inexacte, il suffirait encore que le manuscrit fût réellement du commencement du xiiie siècle pour rendre insoutenable la thèse de Legrand d’Aussy, à tort acceptée par M. P. Chabaille.
Remarquons enfin que Marie, lorsqu’elle écrivait ses fables, vivait depuis longtemps à la cour des rois d’Angleterre et qu’il était plus naturel qu’elle eût, sous l’influence d’un sentiment tendre, entrepris sa traduction pour un prince anglais dont elle connaissait la personne que pour un sire de Dampierre, que, s’il avait été son contemporain, elle n’aurait guère pu connaître que de nom. Aussi suis-je davantage porté à croire avec l’abbé de la Rue qu’elle a existé à la même époque que le bâtard de Henri II, qui, il faut se le rappeler, perdit son père en 1189 et lui survécut jusqu’en 1226.
J’arrive à sa traduction. J’ai déjà dit qu’elle l’avait faite sur la version anglaise. Connaissant la langue latine, elle aurait pu se servir du texte original. Mais il ne faut pas oublier que, vivant en Angleterre, elle devait avoir une connaissance parfaite de la langue anglaise, et l’on s’explique dès lors qu’elle ait eu recours à l’œuvre du roi Henri Beau-Clerc.
J’ajoute que son goût ne la portait pas vers les traductions des ouvrages latins, qu’elle considérait comme très méritantes, mais par lesquelles elle n’espérait pas parvenir à la gloire. Elle savait que l’œuvre du traducteur est une œuvre d’abnégation, et elle songeait bien moins à faire de sa traduction une version littérale qu’une paraphrase poétique. Elle explique elle-même qu’aux traductions des ouvrages latins elle avait préféré la mise en œuvre des récits qu’elle avait entendus et la composition des lais que, comme ses fables, {p. 734}elle écrivit sans doute en Angleterre et dont, selon M. de Roquefort, elle aurait fait hommage au roi Henri III.
Quels motifs avaient pu déterminer Marie à se rendre dans ce pays
et dans quelles conditions y vécut-elle ? Voici sur ces points l’hypothèse
formulée par M. Chabaille : « Marie, aussi bien que Wace, Benoit de
Saint-Maure, Denis Pyrame, Guernes de Pont Saint-Maxence, fut sans doute
attirée à la cour des rois anglo-normands par la protection et les
encouragements que les successeurs de Guillaume le Conquérant accordaient aux
trouvères, et qu’on leur refusait en France depuis les mesures de rigueur
prises contre les jongleurs par Philippe-Auguste et renouvelées sous le règne
de saint Louis. »
Je ne puis dire si l’hypothèse de M. Chabaille est
exacte ; mais, en déchirant au roi « preux et courtois »
à qui
elle dédie ses lais que c’est un devoir de reconnaissance qu’elle accomplit,
Marie l’a d’avance rendue elle-même très vraisemblable.
Si je n’en étais pas empêché par les limites que j’ai dû me tracer, j’examinerais maintenant la valeur littéraire de ses œuvres ; mais on comprend qu’alors que je n’ai pu même me livrer à la critique du texte latin, je puisse encore moins m’occuper de productions poétiques qui sortent d’une étude exclusivement réservée aux fables latines.
La traduction poétique de Marie comprend cent trois fables, composées en vers de huit syllabes, précédées d’un prologue et terminées par un épilogue.
Le prologue, qui est une sorte de paraphrase du texte latin, s’en écarte encore plus que les fables. Il comprend quarante vers, qui, dans un des manuscrits, sont précédés d’un préambule de dix vers et suivis d’un complément de douze, double addition écrite dans le rythme octosyllabique que Marie avait adopté, et composée par quelque copiste lettré peu de temps après l’apparition de son œuvre et en tous cas avant la fin du xiiie siècle.
J’emprunte au manuscrit français 1446 de la Bibliothèque nationale le prologue, ainsi que son préambule et son complément :
Haute honor et bone auenturePuist cil auoir por cui ma cure{p. 735}Ai mis et met de raconterChose, par coi en pris monterEn pourroit à bon entendeur.Or entendés pour diu singneurComment Marie nos traitaDes prouierbes, qu’ele troua,D’Izopet, dont desus a dit,Si entendre com ele dit.Cil qui seuent des escritures,Deuroient bien metre lor curesEs bons exambles (sic) et es dis,Es liures et es bons escris,Que li philozophe trouerent,Et escrisent et ramembrerent.Car par moralité escrisentLes biaus examples que il disent ;Por çou c’amender en porontCil qui entente i meteront ;Ce fisent li anciien pere.Romulus qui fu emperere,A son fil escrit et manda,Et par example li moustra,Com il se deut contregairier (sic)Que on nel peuist engingnier.D’autre part escrit à son mestreYsopes, qui connut son estre,Unes fables qu’il ot trouéesDel greu en latin translatées ;Mieruelle en orent li pluisourQu’il mist son sens en teil labor ;Mais n’i a fable, ne folie.U il n’ait grant philosophieEs exemples qui sont après,U des contes sont tous li fès.A moi qui la rime doi faireNe auenist mie à retrairePlusours paroles qui i sont.Mais ne quedent cil m’en semont,Qui flours est de la cheualerie,D’enseignement, de cortoisie ;Et quant teus hom m’en a recuise,Nel (e) veil laisier en nule guiseQue n’i mere (sic) trauail et paine ;Qui qui m’en tigne por vilaine,{p. 736}Mult doi faire por sa proiiere.Si comence ci la premiereDes fables que Ysopes escrist,Qu’à son maistre manda et dist.Par noble escrit et par painture,Por mieus entendre la natureDe çou qu’il voloit aprouer,Par oïr et par esgarder,Pour çou qu’il dist que pointure est,Une chose qui a l’uel plest,Et parole siert à oïe ;Par coi ici nos senefie,Que cis liures doit iestre poins,Selonc conque tans est et poins ;Vos veil ici encomencier :N’ai soing que plus doie targier.
Je passe maintenant aux fables. M. de Roquefort en a publié cent trois, que je vais indiquer par leurs titres. Ces titres, je ne les emprunterai pas aux manuscrits, et cela pour deux raisons : d’abord il n’y a pas deux manuscrits dans lesquels on les trouve formulés dans les mêmes termes, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme l’œuvre de Marie ; ensuite les termes, dans lesquels ils sont formulés, sont souvent trop vagues ou trop différents de ceux du texte latin, pour qu’on puisse à première vue savoir à quelle fable chacun d’eux se rapporte. Pour la commodité du lecteur, je vais, dans la nomenclature des fables de Marie, faire usage des titres français qui m’ont déjà servi à établir la liste des fables latines. Ce n’est pas tout : l’ordre des fables variant dans chaque manuscrit, je suivrai celui qui a été adopté par M. de Roquefort. Enfin, en face de chacune, j’aurai soin d’indiquer le numéro de la fable latine correspondante dans les Dérivés partiel et complet du Romulus anglo-latin.
| Traduction de Marie. | Dérivé partiel. | Dérivé complet. |
| 1. Le Coq et la Perle. | 1. | |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | 2. | |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | 3. | |
| 4. Le Chien et la Brebis. | 4. | |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | 5. | |
| 6. Le Soleil qui se marie. | 8. | |
| 7. Le Loup et la Grue. | 9. | |
| {p. 737}8. La Chienne qui met bas. | 10. | |
| 9. Le Rat de ville et le Rat des champs. | 11. | |
| 10. L’Aigle et le Renard. | 12. | |
| 11. Le Buffle, le Loup et le Lion. | 6. | |
| 12. La Chèvre, la Brebis et le Lion. | 7. | |
| 13. L’Aigle, la Tortue et la Corneille. | 13. | |
| 14. Le Corbeau et le Renard. | 17. | 14. |
| 15. Le Lion vieilli, le Taureau, l’Âne et le Renard. | 15. | |
| 16. L’Âne qui caresse son maître. | 16. | |
| 17. Le Lion et le Rat. | 17. | |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | 18. | |
| 19. La Cigale et la Fourmi. | 87. | |
| 20. La Corneille et la Brebis. | 88. | |
| 21. L’Homme riche et les deux Serfs. | 113. | |
| 22. Les Oiseaux qui élisent un Roi. | 10. | » |
| 23. La Hache et les Arbres. | 32. | |
| 24. Le Paysan et les trois Souhaits. | 47. | |
| 25. Le Paysan en prière à l’église. | 45. | |
| 26. Les Grenouilles qui demandent un roi. | 19. | |
| 27. Les Colombes et le Milan. | 20. | |
| 28. Le Chien et le Voleur. | 21. | |
| 29. Le Loup et la Truie. | 22. | |
| 30. Les Lièvres et les Grenouilles. | 24. | |
| 31. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | 27. | |
| 32. Le Cerf à la fontaine. | 28. | |
| 33. L’Inconstance de la Femme. | 29. | |
| 34. Le Loup et le Chien. | 33. | |
| 35. L’Estomac et les Membres. | 34. | |
| 36. Le Singe et le Renard. | 76. | |
| 37. Le Lion qui abdique et le Loup. | 22. | 77. |
| 38. Le Riche et sa Fille. | 8. | 114. |
| 39. Le Paysan et l’Escarbot. | 35. | |
| 40. La Femme et son Amant. | 36. | |
| 41. Encore la Femme et son Amant. | 9. | 37. |
| 42. Le Loup et le Berger. | 78. | |
| 43. Le Paon qui se plaint à Junon. | 79. | |
| 44. La Chèvre et l’Agneau. | 23. | |
| 45. Le Breton et les Brebis. | 80. | |
| 46. L’Ermite et son Serviteur. | 43. | |
| 47. Le Paysan et son Cheval unique. | 44. | |
| 48. Le Paysan et le Choucas. | 46. | |
| 49. Le Renard et le reflet de la Lune. | 48. | |
| 50. Le Loup et le Corbeau. | 49. | |
| {p. 738}51. Le Coq et le Renard. | 50. | |
| 52. Le Renard et le Pigeon. | 51. | |
| 53. L’Aigle, l’Épervier et les Pigeons. | 52. | |
| 54. Le Cheval affamé. | 53. | |
| 55. L’Homme riche, le Bouc et le Cheval. | 54. | |
| 56. Le Loup et l’Escarbot. | 20. | 55. |
| 57. Le Rossignol et l’Épervier. | 56. | |
| 58. Le Corbeau paré des plumes du Paon. | 58. | |
| 59. Le Lion malade, le Loup écorché et le Renard. | 21. | 59. |
| 60. Le Renard et l’Ourse. | 60. | |
| 61. Le Lion malade, le Renard et le cœur du Cerf. | 61. | |
| 62. Le Loup et le Hérisson poursuivis. | 62. | |
| 63. Le Paysan et le Serpent. | 115. | |
| 64. Le Rat qui cherche femme. | 116. | |
| 65. L’Escarbot vaniteux. | 7. | 117. |
| 66. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | 1. | 82. |
| 67. L’Âne et le Lion. | 3. | 83. |
| 68. Le Lion malade et le Renard. | 4. | 84. |
| 69. L’Homme et le Lion. | 85. | |
| 70. La Puce et le Chameau. | 86. | |
| 71. Le Cheval vendu. | 11. | 38. |
| 72. Le Voleur et la Sorcière. | 39. | |
| 73. Le Loup et le Mouton. | 14. | 40. |
| 74. Le Singe et sa Progéniture. | 41. | |
| 75. Le Dragon et l’Homme. | 42. | |
| 76. L’Âne et le Sanglier. | 118. | |
| 77. Les Porcs et le Blaireau. | 119. | |
| 78. Le Loup pris au piège et le Hérisson. | 120. | |
| 79. Le Loup et le Batelier. | 121. | |
| 80. L’Épervier et la Chouette. | 12. | 122. |
| 81. L’Aigle et l’Épervier fugitif. | 13. | 123. |
| 82. Le Prêtre et le Loup. | 124. | |
| 83. Le Champ et le Serpent. | 125. | |
| 84. L’Hirondelle et les Moineaux. | 15. | 126. |
| 85. Le Paysan et le Bœuf. | 18. | 63. |
| 86. L’Abeille et la Mouche. | 16. | 64. |
| 87. Le Milan malade. | 71. | |
| 88. Les deux Loups. | 65. | |
| 89. Le Renard et le Loup, jugés par le Lion. | 66. | |
| 90. La Chèvre et son Chevreau. | 67. | |
| 91. Le Mesureur. | 68. | |
| {p. 739}92. La Biche et son Faon. | 69. | |
| 93. Le Corbeau et son Petit. | 70. | |
| 94. Le Bœuf et le Loup. | 5. | 72. |
| 95. L’Homme et la Femme querelleuse. | 73. | |
| 96. L’Homme et la Femme noyée. | 74. | |
| 97. Le Lièvre et le Cerf. | 19. | 127. |
| 98. Le Chat et le Renard. | 6. | 129. |
| 99. Le Loup et le Pigeon ramier. | 128. | |
| 100. L’Homme qui navigue sur mer. | 130. | |
| 101. Le Chevalier et le Vieillard. | 131. | |
| 102. Le Chat mitré. | 132. | |
| 103. La Femme et sa Poule. | 133. |
Les cent trois fables dont la liste précède, sont-elles les
seules que Marie ait composées ? Telle est maintenant la question à résoudre.
Pour la trancher, je n’ai pas cru devoir m’en rapporter à son éditeur. M. de
Roquefort dit bien qu’il a extrait à Paris les fables de Marie d’un manuscrit
« destiné pour Londres »
et qu’il s’est donné la peine
« de transcrire les 98 fables qu’il contenoit521 »
, qu’il s’est en outre servi
« des manuscrits no 1830, fonds de l’abbaye
Saint-Germain ; nos 7615 et 79892,
ancien fonds ; M. no 17, M. no 18,
E. no 6, N. no 2, fonds de l’église
de Paris522 »
, qu’enfin son confrère De la Rue a bien
voulu lui « communiquer les différentes copies des fables françoises
qu’il avoit faites à Londres523 »
sur les trois manuscrits du
British Museum. Mais les sources auxquelles il prétend avoir recouru ne sont pas
les seules, et ensuite il est certain, comme nous le verrons bientôt, qu’il n’a
pas très attentivement examiné celles qu’il avait à sa disposition : en effet,
pour quiconque jette les yeux sur son édition, il est visible qu’il s’est
presque constamment borné à se servir des travaux du complaisant abbé De la
Rue.
Il m’a donc paru prudent de demander aux manuscrits la solution de la question. Je m’empresse de dire qu’ils m’ont semblé lui donner raison. J’en ai compulsé plusieurs qui paraissaient contenir 104 fables ; tels sont, par exemple, les manuscrits français 1593 et 2168 de la Bibliothèque nationale et le manuscrit Harléien 978 du British Museum. Mais, lorsqu’en comptant le nombre des fables que {p. 740}chacun d’eux renferme, on en trouve 104, on est dupe d’une illusion ; car ce nombre est uniquement dû à la division en deux fables de celle qui, dans l’édition de M. de Roquefort, est la quatre-vingt-deuxième ; il en résulte que ces manuscrits n’en possèdent en réalité que 103.
Mais ce n’est pas parce que les manuscrits n’embrassent pas plus de cent trois fables, que la collection de Marie doit être nécessairement restreinte à ce chiffre. Si tel manuscrit qui contient cent trois fables n’offrait pas uniquement les mêmes que tel autre qui en possède une égale quantité, il pourrait se faire que le nombre des fables dues à Marie fût réellement supérieur à ce chiffre. Il faut donc voir si certains manuscrits n’en présentent pas quelques-unes, qui, quoique étrangères aux cent trois connues, doivent lui être néanmoins attribuées. C’est ce que j’ai fait. Parmi les manuscrits français de la Bibliothèque nationale, j’en ai remarqué deux qui contenaient des fables non comprises dans les 103 publiées par M. de Roquefort ; ce sont les manuscrits 2173 et 14971.
Le manuscrit 2173, qui comprend 104 numéros, possède par exception 104 fables, et deux d’entre elles sont indépendantes des 103 qui ont été éditées ; elles ne portent pas de titre et commencent l’une par ce vers :
N’a pas encor passé dix ans,
et l’autre par cet autre vers :
D’un vilain cont(e) qui prist a fame.
Le manuscrit 14971, quoique ne comprenant que cent fables, en
possède deux qui n’existent pas dans l’édition de M. de Roquefort ; la première
est intitulée : De la Corneille qui se vesti des plumes de
tous oisiaux
, l’autre : Du Chat qui sauoit
tenir chandoile.
Les quatre fables que je viens de signaler
sont les seules que j’aie rencontrées. Pour ne pas interrompre mon exposé, je ne
veux pas les reproduire ici ; c’est seulement en analysant les manuscrits qui
les renferment que je les transcrirai. Mais dès à présent j’affirme qu’il suffit
de les lire pour être convaincu qu’elles ne sont pas l’œuvre de Marie. D’abord
une raison, qui s’applique à toutes, c’est que le Romulus latin n’en contient
aucune qui y corresponde. Ensuite, si on les examine séparément, on voit que les
deux premières sont d’une obscénité devant laquelle Marie, même dans une
traduction, eût vraisemblablement {p. 741}reculé, que la
troisième a été écrite en vers de six syllabes, c’est-à-dire en vers d’un mètre
différent de celui des autres fables524, que la quatrième est, comme les deux premières,
plutôt un fabliau qu’une véritable fable, et qu’enfin, dans le manuscrit 14971,
la troisième et la quatrième ne viennent qu’après l’épilogue, qui est lui-même
suivi du mot Explicit et qui semble ainsi les mettre nettement
en dehors des autres fables. Il s’ensuit que les fables de Marie doivent être
maintenues au nombre trouvé par son éditeur.
Maintenant, si l’on compare les cent trois fables bien
authentiques à celles de la collection latine qui en comprend 136, on en trouve
une qui ne correspond à aucune fable latine ; c’est celle que, dans la liste
précédemment dressée, j’ai intitulée : Les Oiseaux qui
élisent un Roi.
La conclusion qui en découle, c’est que la
solution que j’ai déjà adoptée est la seule vraie : quand on considère que le
texte latin, tout en comprenant cent trente-six fables, ne possède pas toutes
celles que Marie a traduites, on est obligé d’admettre que la collection latine
de 136 fables n’est elle-même qu’un dérivé, d’une part notablement augmenté,
d’autre part légèrement amoindri, d’un Romulus plus ancien, sur lequel le roi
anglo-normand avait fait sa traduction anglaise, et qui fut plus tard
indirectement suivi par Marie.
Les cent trois fables, que dans tous les cas il faut attribuer à Marie, se terminent par un épilogue de vingt-deux vers, que, pour ne pas faire deux citations dans deux dialectes différents, j’emprunte comme le prologue au manuscrit 1446 :
Al finement de cest escritQu’en romans ai traitié et dit,Me nomerai par ramenbrance :Marie ai non, si sui de France.Puet cel estre cil clerc pluisorPrendroient sor eus mon labor ;Ne voeil que nus sor moi le die :Gil oueure mal qui soi oublie.Por l’amor le conte Guillaume,Le plus vaillant de cest roiaume,M’entremis de cest oueure a faireEt de l’englois en romans traire.{p. 742}Ysope apele on icest liureQu’il translata et sut escrire ;De greu en latin le torna.Li rois Henris qui mult amaLe translata puis en englois,Et iou l’ai rimé en françois,Si com gel trouai proprement.Or proi a Dieu omnipotentC’a tel oueure me loist entendre,Que iou li puisse l’arme rendre.
Dans le manuscrit 1593 de la Bibliothèque nationale, l’épilogue comprend vingt-quatre vers et se termine par ces deux derniers, que M. de Roquefort a cru devoir emprunter à ce manuscrit et publier, mais qui sont probablement une addition étrangère à Marie :
La suz en Paradiz tut droitDittez amen ke Deus l’ottroit.
1º Bibliothèque nationale. §
A. Manuscrit 1446. §
Ce manuscrit, qui portait autrefois la cote 7534. 3. 3, forme
un volume in-fol., composé de 210 feuillets en parchemin. Les écritures qui
le remplissent, appartiennent aux xiiie et
xive siècles ; elles sont très peu
uniformes, mais très belles. Ce manuscrit a dépendu de la bibliothèque du
président de Thou ; c’est ce qui ressort de la mention suivante, qu’au bas
du recto du premier feuillet il avait sans doute mise de sa main :
Jac. Aug. Thuani.
Le volume renferme de
nombreuses œuvres en vers français, telles que l’histoire de Kanor et de ses
frères, divers fragments de romans, le Couronnement du
Renard et beaucoup d’autres œuvres poétiques.
Les fables de Marie commencent à la deuxième colonne du verso
du feuillet 88 ; elles portent ce titre unique : Ici
apries porres oïr les prouierbes Ysopet.
Le prologue de
Marie, que ce titre surmonte, est lui-même, ainsi que je l’ai déjà dit,
précédé d’un préambule de dix vers et suivi d’un complément de douze, qui ne
se trouvent pas dans les autres manuscrits, et que M. de Roquefort ne paraît
pas avoir connus et tout au moins, malgré leur ancienneté, s’est abstenu de
publier. Le prologue, ainsi augmenté, est orné d’une très grande {p. 743}lettre initiale, dans l’intérieur de laquelle une miniature
représente Marie assise.
Puis viennent les fables, qui, par suite de la division en deux de celle Du Prêtre et du Loup, semblent s’élever à cent ; mais en réalité il n’en existe que 99, dont aucune ne porte de titre ; l’œuvre complète en comprenant 103, il en manque 4, qui sont celles portant, dans le tableau précédemment dressé, les nos 12, 35, 95 et 96.
Ainsi qu’on l’a vu par la copie que j’en ai donnée, l’épilogue qui suit les fables ne se compose que de vingt-deux vers.
B. Manuscrit 1593. §
Le manuscrit 1593, qui portait auparavant la cote 7615, forme un volume in-4º de 218 feuillets écrits, dont l’écriture sur deux colonnes est due à une main du xiiie siècle.
Les 218 feuillets écrits sont précédés de deux autres qui ont
été ajoutés par le relieur. Sur le recto du premier on lit : « Ce
manuscrit a appartenu au président Fauchet, qui en a extrait beaucoup de
choses dans son recueil de l’origine de la langue et poésie françoise.
Voyez ce qu’il a écrit au bas de la première page de ce manuscrit. Les
notes marginales sont aussi de sa main. Ce manuscrit donne en général de
bonnes leçons, mais où il manque des vers. »
Cette notice est
suivie de cette mention ajoutée par une main plus récente : « Le
copiste semble avoir écrit à Paris. Les formes qu’il emploie, surtout dans
les fables de Marie de France, sont le plus rapprochées de celles qui ont
prévalu. »
Au bas du recto du deuxième feuillet ajouté, le président
Fauchet a écrit : « C’est à moi Claude Fauchet par eschange fait
avec… »
. Le nom du précédent propriétaire a été intentionnellement
effacé.
Le volume renferme 75 œuvres diverses en vers français et offre un très grand intérêt pour l’étude des origines de la langue française.
De ces œuvres celle de Marie est la vingt-troisième ; elle commence, au recto du feuillet 74, par le prologue composé de 40 vers. Ce prologue est suivi non pas, comme l’affirme M. de Roquefort, qui, quoi qu’il en dise, n’a pas étudié le manuscrit525, de 88 fables seulement, mais de l’œuvre complète de Marie, qui, ainsi qu’on s’en souvient, se compose de 103 fables. Ces 103 fables sont closes par l’épilogue comprenant exceptionnellement 24 vers. Les 13 derniers {p. 744}sont d’une écriture moins ancienne que le reste. Ils occupent la moitié de la première colonne du feuillet 99 a.
À la suite des fables de Marie, le manuscrit renferme un grand nombre d’œuvres poétiques de la même époque, et notamment des fabliaux qui sont, pour la plupart, d’une obscénité révoltante.
Lorsque précédemment je me suis occupé du dénombrement des fables, j’ai eu l’occasion d’en signaler une, qui, dans le manuscrit 2173, commence par ce vers :
Dou vilain cont(e) qui prist a fame.
Elle figure, parmi les œuvres étrangères à Marie, dans le
manuscrit 1593, où elle est intitulée : Dou vilain à la
coille noire.
On la trouvera plus loin, page 749.
C. Manuscrit 1822. §
Le manuscrit 1822, qui paraît avoir appartenu à Colbert et qui avant la classification actuelle portait la cote 7856.3.3, forme un volume in-4º, dont l’écriture sur deux colonnes est du xiiie siècle. Il se compose de 250 feuillets anciens, auxquels le relieur a ajouté quatre feuillets nouveaux, en parchemin comme les anciens, savoir : deux au commencement et deux à la fin.
Le second des deux feuillets ajoutés en tête porte une table des matières conçue en ces termes :
I. Sermones de Voragine, en Prose.
II. Histoire de la guerre de Troye par Darès le Phrigien, traduitte en francois. Page 46.
III. Histoire romaine par Eutrope traduite en francois. Page 58.
IV. Le liure nômé Secret des Secrets ou du Gouvernement des Roys composé par Aristote et mis en francois par Jofroy de Watreford. Page 84.
Nota. — Ceux qui cest liure liront prient por Jofroi de Watreford et por Servais Copale qui cest trauail emprirent et par l’aide de Dieu l’ont à chief mené et aussi le liure de Darès le Phrigien de la Guerre de Troye, et aussi le liure de Eutropius, du règne des Romains. Page 143 vº.
V. Le liure de Clergie ou l’Image du Monde. En uers. Page 144. Composé l’an 1245.
VI. Le Sermon de la Croix, en Vers. Page 180 vº.
VII. La Passion de N.-S. et la mort de la Vierge. En uers. Page 185.
VIII. Les Fables d’Ésope mises de l’anglois en uers francois par Marie de france. Page 198.
IX. Le Petit Liure de Moralité en Prose. Page 217 vº.
X. Le Lucidaire en prose. Page 226.
À la suite de cette nomenclature la même main a ajouté cette
{p. 745}observation : Ce ms. a esté
dérangé et le Lucidaire devroit précéder le Traité d’Aristote qui est à
la page 84. F I N.
C’est par erreur que l’auteur de la nomenclature qui précède donne, comme numéros de pages, des chiffres qui sont au contraire des numéros de feuillets. Ainsi les fables de Marie commencent au feuillet 198 rº et se terminent au feuillet 218 rº qui porte le nº 217 bis.
Elles sont précédées du prologue ordinaire en quarante vers, se succèdent sans titres et sont terminées par l’épilogue ordinaire, auquel toutefois manquent les quatre derniers vers, remplacés par celui-ci :
Amen, Amen, priies por moi.
Les fables sont seulement au nombre de 94, c’est-à-dire qu’il en manque neuf. Ce sont celles auxquelles j’ai, dans le tableau de l’œuvre de Marie, donné les numéros 12, 26, 45 et 85 à 90.
D. Manuscrit 2168. §
Le manuscrit 2168 forme un volume in-4º de 241 feuillets en
parchemin, dont l’écriture sur deux colonnes est du xiiie siècle. Il a appartenu à Baluze qui lui avait donné le
nº 572. Entré dans la Bibliothèque nationale, il y avait ensuite reçu, avant
la classification actuelle, la cote 79892. Sur un des
trois feuillets en papier que le relieur a ajoutés en tête du volume, on lit
cette mention, qui paraît y avoir été inscrite par M. Michelant, quand il
était conservateur du département des manuscrits : « Bon msc. ;
dialecte de l’Ile de France. »
Ce manuscrit, qui fut un de ceux employés par M. de
Roquefort526, comprend un trop grand
nombre d’œuvres pour que j’en donne ici la liste. Il contient, avant les
fables de Marie, quatorze fabliaux en vers octosyllabiques, et, après, sept
ouvrages en vers français, dont le principal est un Bestiaire, c’est-à-dire une étude sur les animaux envisagés au point
de vue de leur nature morale, qui est intitulé : Chi
commenche li drois || bestiaires de la devine
escripture.
Les fables de Marie commencent en tête du feuillet 159 a et se terminent au milieu de la deuxième colonne du
feuillet 186 a. Elles sont annoncées par ce titre
général : Chi commenche li besti||aires. Che sont les ||
fables de plusieurs bestes.
La collection est complète ;
elle {p. 746}comprend même 104 numéros ; mais cela tient à la division
en deux de la fable du Prêtre et du Loup, de sorte qu’elle ne se compose en
réalité que de 103 fables, précédées des quarante vers du prologue, pourvues
chacune d’un titre spécial, mais non suivies de l’épilogue, qui fait
défaut.
E. Manuscrit 2173. §
Le manuscrit 2173, qui, avant la classification actuelle, portait la cote 7791, est un volume in-4º de grand format, composé de 97 feuillets en parchemin, dont l’écriture sur deux colonnes appartient au xiiie siècle. Voici, d’après le catalogue imprimé, la liste des ouvrages qu’il contient :
1º L’Ymage dou monde.
2º Les fables d’« Isopet », traduites en vers.
3º Le fabliau de la male Honte.
4º Le Dit de la femme.
5º De celle qui fu foutue sur la fosse de son mari.
6º Du Prêtre crucifié.
7º De la Vieille qui oint la paume au Chevalier.
Les fables de Marie commencent au feuillet 58 a et se terminent au feuillet 92 b. Le prologue et l’épilogue ordinaires les précèdent et les suivent. Elles ne sont accompagnées d’aucun titre ; mais chacune est surmontée d’un dessin colorié.
Le manuscrit 2173 est de tous ceux de Marie celui qui renferme le plus de fables ; car il en a 104, tandis que, parmi les autres, les plus complets, sous un nombre égal de numéros, n’en possèdent en réalité que 103. Sur les 104 fables il n’y en a que 102 se rapportant à celles éditées par M. de Roquefort ; la fable qui manque au manuscrit 2173 est celle des deux hommes, l’un véridique et l’autre menteur. En revanche, ainsi que je l’ai précédemment expliqué, il possède, sous les nos 61 et 103, deux fables étrangères à celles qui ont été publiées. En voici le texte :
fable lxi.
N’a pas encor passé dis ans,Que uns enfes molt medisansAu feu son pere se seoit,Tout l’estre sa mere veoit,Com ele aloit, com el venoit,Et com li prestres a lui parloit,Tant qu’il auint que li preudon,{p. 747}Que sires estoit de la meson,Ala un ior en son labour.La dame qui ot le tabourA coi li prestres tabouroit,Que que li preudom labouroit,Fu soule remese en maison,Fors tant san plus de l’enfancon,Qui n’auoit pas .vij, anz, non .vi.,Mes molt fu sages, s’est asisAu feu qui deuant lui ardoit.De lui mie ne se gardoitSa mere qui le preuoire aime,Qui molt souuent lasse se claimePor ce que il demeure tant.En mi l’ere fu en estant ;De sa meson si coumençaA balancier de ça en laUne pierre qu’ilueques i ut,O le pié la bouta et mut.Dementres que le fait ainsi,De sa meson le prestre oissi,Et vint la ou cele boutoitLa pierre, et il la regardoit.Dame, dist-il, laissiez la pierre ;Foi que doi monseignor S. Pierre,Se hui mes la vos voi bouter,Ge vos ferai ia acouterEn ce lit, et si vos foutray ;Ia autre amende n’en prendrai.La dame molt s’en esioï,Quant icelle nouelle oï ;Si s’est un poi plus auanciée ;La piere a auant balanciée,Et es meüe o le pié destre ;Car molt desirroit que le prestreCe qu’il auoit dist li feïst.Et li prestres tantost la pristEntre ses bras et si la porteEn un lit, et euure la porteDe l’abitacion a l’ome.Si ramaine le con de rome,Et, por ce que mielz ieu talentDe faire tretout son talent,La bese à chaucun cop qu’il fiert,Et fait tout quanque il li afiert.{p. 748}Et quant son bon ot acompli,Si li dist : Dame, a vos soupliAutresint comme a un autel,Et se il vos plaisoit autel,Vos feroie souuentes fois.— Or m’en soit baillie la fois,Fait cele qui en velt encore,Par mon chief auoir l’en veilg ore,Puisque vos le m’aues offerte.Cil li pleuist et laisse ouuerteLa porte au vilain et desclose.Si s’en vait et quemande a DeuLa Dame, et li enfes del feuOt bien veü ce qu’il ont fait,Mes n’en tint parole ne plait.Puis n’ala gaires demourantQue li preudon s’en vint courantDela ou il ot labouré,Et cil qui auoit tabouréAu tabor, qui résonne quas,Por ce qu’il est fendus trop bas,S’en fu alés tout maintenant.Et quant li enfes voit venantSon pere, si li saut encontre,A l’entrée de lui l’encontre.Si li fait ioie, si li saut,Et dist : Biaus peres, Dex vos fautEt doint ioie et enneur vos face !Li preudon son effant enbrace ;Si l’emporte ioie faisant,Et treuue en mi l’ere gisantLa pierre : s’il voloit osterEt hors de la meson giter,L’auoit an. ij. ses mains fors traistes,Quant li enfes ne dist : Ne faites,Pere, laissiez la pierre toute,Que nostre prestres ne vos fouteAusint com il fouti ma mere ;Ge le vi bien dou feu ou g’ereCoument il li batoit la croupe.Ce ne sai ge s’ele i ot coupe ;Car ainz point ne se deffendi.Et quant li preudom l’entendi,Sachiés que molt fut angoisseus :Sa fame prist par les cheueus,{p. 749}Si la rue a terre et traïne.Le pié li met sor la poitrine.Ha ! fame ia, Dex ne t’aïst !Si la bat et foule, si dist :Ne ne consaut, ne ne te voie,Que veïs cil qui vont la voie,Vienent tuit fouler ta vendenge.Ainsint la bat et la lesdenge ;Mes por chasti ne por ses cousNe remaindra qu’il ne soit cous.Par ceste fable moustrer voilgQue l’en se gart dou petit eulg,Autresint bien comme del grant :De fol et de petit effantSe fait touz iors molt bon garder ;Car il ne seuent riens celer.
fable ciii.
D’un vilain cont(e) qui prist a fameUne molt orguelleuse dame,Et felenesse et despisant ;Mes ne sot pas du païsantQue il eüst la coille noire :Se elle l’eust sceu, c’est la voire,Ia n’eüst geü lez sa hanche,Mes ele cuidoit que fust blanche.Tant que par auenture auintQue li preudom du labor vint,Et se fu a son feu assis,Mes en ses braies iusque asisOt pertuis, si furent deroutes,Tant que fors issoient tretoutesSes coilles, et cele les vit.Lasse, fait ele, si noir vitEt si noire coille ge voi !Ia ne girra mes delez moiLi vilains qui tel coille porte.Lasse, fait ele, tant sui morte,Quant onques a moi adesa ;A mal eür qu’il m’espousaEt que a lui fus mariée !Dolente en sui molt et irée.Certes si doi ge molt bien estre ;Mes, par celui qui me fit nestre,{p. 750}Les laiserai, et orendroitIrai a l’esuesque tout droit :Si li mosterrai cest afaire.Li vilains fut molt debonnaire ;Si lui dist debonnairement :Dame a Damedex vos quemant !Mes se de moi faites clamour,Ia n’en aurez la Dieu amour,Et si sur vous dirai tel chose,Ou ia n’aura parlé de rose.— Quoi ! fait ele, que dirés vous ?Certes or departirons nous.Or ne lairoie ge por rienQue ge nel moustrasse au daienEt a l’esvesque et au clergiéUne alié ne vos dout gié.Faites le mielz que vos pouroiz,Que par temp nouueles orroiz,Dont vos serez auques iriez ;Or est vostres plès empiriez,Por ce que m’auez menaciée.Lors s’en vait toute courouciéeMolt grant aleüre a Paris.A l’euesque a dit et apris :Sire, deuant vostre presenceSi dirai tout en audience,Por coi ge sui a vos venue :Bien a ij. ans que m’a tenueMes barons, c’onques nes connui,Tant que er soir primes aperçuiL’achoison por coi il remaint,Et ce mestier m’est i’aurai maint,Que ce temoigneront por voir ;Mes barons a le vit plus noirQue fers, et la coille plus noireQue la chape nostre preuoire,Et velue comme pel d’orsse ;N’onques encor nule viés borsseD’userier ne fu plus enflée.Iceste est veritez prouuée,Que por ce ne puis conceuoir,Ne nul enfant ne puis auoir.Lors s’en galent trestuit et rient,Et a l’euesque ensemble dient :Sire, por Dex faites semondre,{p. 751}Por sauoir qu’il voudra respondre,Li vilains, sor ceste besoigne.— Je voilg bien que l’en le semoigne,Fait li euesques, par ma foi,Faites li sauoir, de par moi,A Dant Popin le Chapelain,Que demain amaint le vilain.
Maintenant le fet on sauoirA Dant Popin qu’il face auoirCelui a cort, et il si fetQu’en l’acuse d’un mauez plet.Cil vient a cort et si s’escuseQu’il est venus, et lors l’acuseLa dame, oiant toute la cort :Qui que, fait ele, a mal le tort,Moi n’en chaut, se g’en sui blasmée :Biau sire, a vos me sui claméeDe cest vilain, qui m’a honnieA sa grant coille de Hongrie,Qui semble sac a charbonnier.Certes molt furent pautonnierQu’a lui me firent espouser,Et se ge sesiie oposerEt respondre, ge l’oposa[s]se,Et la raison li demandassePor quoy est plus noire que blanche.Et cil sa parole li trenche,Et dit : Biau sire, a vous me plainDe ma fame, qui tout mon fainA gasté a faire torchons.— Vous mentés parmi les guernons,Fait ele, danz vilains despers ;Plus a de .iij. anz ne fu tersMes cuz de fain ne d’autre rien.— Non, fait il, ge sauoie bien :Por ce est ma coille (si) noircie.A dont n’i a nul qui n’en rie,Et qui rien tiegne a grant parole.Et la dame s’en tint por foleDe la clamor que ele ot faite ;Dont li euesque li a faiteResponse, comme il me semble,Que ilz s’en voisent tous ensemble.Par cest fable pouez sauoir{p. 752}Que fame ne fait pas sauoir,Qui son seignor a en despitPor noir coille et por noir vit ;(Car) autant de force a une noireComme a une blanche por voire.
Le manuscrit 2173 n’a pas été connu de M. de Roquefort.
F. Manuscrit 14971. §
Le manuscrit 14971, qui a porté la cote 63228, forme un grand volume in-4º, qui se compose de 56 feuillets en parchemin et dont l’écriture sur deux colonnes est du xive siècle.
L’œuvre de Marie s’étend du feuillet 1 au feuillet 41. Les
deux premiers feuillets sont occupés par la table des matières qui est
annoncée par ce titre : Ce sont les chapitres des fables
ysope.
La table en comprend 100 ; mais seuls les
98 premiers concernent Marie ; il faut considérer comme lui étant étrangers
les deux derniers qui dans la table sont intitulés, l’un : De la Corneille qui se vesti des plumes de tous
oisiaux
, et l’autre : Du Chat qui savoit
tenir chandeille.
Pour la fable à laquelle se rapporte le premier de ces deux titres, le doute n’est pas possible ; en effet, écrite en vers de six syllabes, elle n’est pas dans le rythme adopté par Marie.
Il n’en est pas de même de la fable à laquelle s’applique le second titre : elle a été écrite en vers octosyllabiques ; mais il faut se rappeler que, si la table des matières la présente, ainsi que la précédente, comme appartenant à la même collection que les autres, le texte de l’une et de l’autre en est, dans le manuscrit, nettement séparé par l’épilogue, qui a été placé immédiatement après la quatre-vingt-dix-huitième fable et qui lui-même est suivi du mot Explicit.
Il s’ensuit que le manuscrit ne peut posséder les fables de Marie qu’à concurrence de 98. Mais il n’en existe en réalité que 97 ; en effet, les deux fables qui dans le manuscrit 14971 portent les nos 65 et 81, ne sont que les deux parties souvent séparées de la fable du Prêtre et du Loup. Il manque donc six fables, qui sont celles portant dans mon tableau les nos 12 et 99 à 103.
Voici maintenant le texte des deux fables qui, dans le manuscrit, portent les nos 99 et 100 :
99. De la Corneille qui se vesti des plumes de tous oisiaux.
Oiez une merueille,Que fist une corneille,{p. 753}Que de chascun oisel,Qu’ele vit gent et bel,Des plumes conqueilli,Dont elle se vesti.Quant bien fu acesmée,Vestue et conreée,Si regarda en soi,Si mena grant nobloi.Si oisel que ce sorentConsentir ne le porent :.I. concile assemblerentEt entr’aux pourparlerentQue chascuns li taudroitSa plume qu’ele auoit.Ci c’ont dit, si ont fait :Chascun sa plume en trait.Quant perdues les a,Nue fu, si pensaQue cis pris qu’il auoitN’iert mie siens par droit.Ceste fable petite,Par example l’ai diteQue tieux se fait moult gensPour ses fiers garnemens,Se il mis se veoit,Moult poi se priseroit.
100. Du coc (sic) qui sauoit tenir chandoile.
D’un chat ci aprez vous vueil dire,Qui apris fu par grant maistireA seruir et tenir chandeille.Moult en auoient grand merueilleTrestout icil que veoient ;L’um a l’autre le disoientQue moult parest bien douctrinez.Uns autres hom s’est pourpensezQue le chat taudra son mestier..I. jour a pris en un moustierUne soris et cil l’emporte,La ou li chas la gent deporte ;D’un filet par le pié l’enserre,Puis le lais aler a la terre,Auant et arriere est saillie ;Li chas le voit, si s’entroublie :De la chandeille ne li chaut ;{p. 754}Ains le laist, si a fait .i. saut :La chandoile cheï enuerse.Li chas a la souris aerse ;Car c’iert ses cuers et ses voloirs.
Salemons dist, et si est voirs :Si est des hoirs a maint haut home,En qui de tel ce est la somme,Fil a duc, a roi ou a conte,Que nul endroit à lui n’en monte,Qu’engendré l’a uns de ses sers,S’est drois qu’il soit fel et cuiuers ;On fait main bien par norreture,Mais tout a dez passe nature.
Les deux pièces de vers qui précèdent, quoique ayant bien le caractère de fables ésopiques, n’en sont pas moins étrangères à Marie.
Le manuscrit n’a pas été connu de M. de Roquefort.
G. Manuscrit 19152. §
Le manuscrit 19152 forme un volume in-fol., qui comprend
205 feuillets en parchemin et dont l’écriture sur 3 colonnes est du
xive siècle. Il a appartenu au duc de
Coislin qui le légua à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C’est ce qui
ressort de l’ex libris suivant : « Ex bibliotheca
mss. Coisliniana, Olim Segueriana, quam Illust. Henricus Du Cambout, dux
de Coislin, Par Franciæ, Episcopus Metensis, etc., monasterio. S. Germani
in Pratis legauit. An. M. D CC. XXXII. »
Il semble résulter d’un
numéro placé au bas du recto du premier feuillet qu’il avait d’abord porté
dans l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés la cote 1830 remplacée plus tard par
la cote 1239. Passé ensuite à la Bibliothèque nationale, il y a fait partie
du fonds Saint-Germain, dans lequel il a longtemps conservé la même cote et
où M. de Roquefort en a pris connaissance527.
Les fables de Marie qu’il renferme commencent au haut du
feuillet 15 a par ce titre à l’encre rouge : Ci commences de Ysopes
, et se terminent au haut de
la deuxième colonne du feuillet 24 b par cette
souscription : Explicit de Ysopes.
Leur nombre, à cause de la division en deux parties de la fable du Prêtre et du Loup, paraît être de 67, mais en réalité n’est que de 66. Il s’ensuit qu’il en manque 37 ; ce sont celles qui, dans le tableau {p. 755}précédemment dressé, portent les nos 16 à 21, 26 à 40, 42 à 45, 66 à 71, 84 et 99 à 103.
Les 66 fables du manuscrit ne portent pas de litres particuliers, mais sont précédées du prologue ordinaire et suivies de l’épilogue composé seulement de 22 vers.
H. Manuscrit 24310. §
Lorsque précédemment j’ai eu à m’occuper des manuscrits contenant la traduction en vers français des fables de Walther, j’ai donné du manuscrit 24310, pages 531 et suivantes, une analyse à laquelle je renvoie. J’ai dit alors que la traduction poétique de Marie ne s’y trouvait pas tout entière et qu’il n’en possédait que quarante-neuf fables. Il s’ensuit que les fables manquantes sont au nombre de 54 ; ce sont celles qui, dans mon tableau, portent les nos suivants : 1 à 18, 23, 26 à 36, 48 à 49, 54, 57 à 58, 76, 78, 81, 83, 86 à 94 et 97 à 102.
Ce manuscrit n’a pas été connu de M. de Roquefort.
I. Manuscrit 24428. §
Avant la fusion de tous les fonds, le manuscrit 24428 dépendait du fonds Notre-Dame, dans lequel il portait la cote 193.
C’est un volume in-fol., composé de 118 feuillets en parchemin, dont l’écriture sur deux colonnes est la gothique du xiiie siècle. Les feuillets en parchemin sont précédés d’un premier feuillet en papier, au verso duquel le contenu du volume est indiqué dans les termes suivants :
1º L’image du Monde par Gautier de Metz qui le composa en 1245. À la fin de cet ouvrage on voit que ce manuscrit a été écrit en 1265.
2º L’histoire des Oiseaux moralisée, alias le Volucraire.
3º Le Bestiaire par Guillaume de Normandie ou histoire des animaux moralisée.
4º Le Lapidaire. C’est une traduction du poème latin de Marbode, évêque de Rennes. Voyez cet ouvrage dans l’édition des ouvrages de ce prélat par le père Beaugendre.
5º Fables d’Ésope par Marie de France.
6º Traité des péchez en prose.
L’œuvre de Marie de France s’étend du feuillet 89 a au feuillet 114 b. Elle porte ce titre
général : Ci commence Esopes.
Le prologue qui précède les fables est orné d’une grande lettre initiale, remplie à l’encre rouge par des traits de forme gothique. Il ne se compose que des 38 premiers vers ; les deux derniers font {p. 756}défaut. Les fables sont toutes pourvues de titres particuliers écrits à l’encre rouge, et chacune d’elles est surmontée d’une miniature à fond d’or.
Malheureusement le volume est incomplet : il y manque un
feuillet, et c’est aux fables qu’il appartenait. Cette lacune, au bas du
recto du feuillet 89, a été indiquée en ces termes par un bibliothécaire,
qui, faute d’y avoir regardé de près, en a exagéré l’étendue : « Na. Il manque plusieurs pages dans
cette collection de fables. »
C’est après le vingt et unième vers de la
fable xlv du manuscrit, intitulée : Coment. I. Bretons ocist grand conpegnie de brebis
, que
s’ouvre la lacune due à la disparition d’un feuillet. La première fable, qui
vient ensuite et dont il ne reste que les dix-sept derniers vers, est celle
de l’Ermite et du Paysan, qui, dans l’édition de M. de Roquefort, fait
immédiatement suite à la fable du Breton. Comme, par exception, l’ordre des
fables dans le manuscrit 24428 est exactement le même que dans l’édition de
M. de Roquefort, il s’ensuit qu’on peut affirmer que le manuscrit n’a perdu
qu’un seul feuillet et que par cette perte il n’a été privé que de la fin
d’une fable et du commencement de la suivante.
Le manuscrit, en somme, n’a jamais possédé que 65 fables, et, sauf les deux devenues incomplètes, il les possède encore. Ces soixante-cinq fables étant les soixante-cinq premières de mon tableau, il s’ensuit que les fables véritablement manquantes sont les trente-huit dernières.
Mais, si la lacune est moins grave que ne le ferait supposer
l’avis que j’ai transcrit, il faut avouer que le manuscrit a été soumis par
la pruderie cléricale à des mutilations qui l’ont gravement déprécié. Ainsi
du titre de la fable xl il ne reste que ces mots : D’un homme qui vit…
Une main pudique a effacé la
fin, qui probablement était ainsi conçue : .I. autre
seur sa fame
, et a détruit en même temps la partie de la
miniature qui représentait un homme et une femme dans une posture indécente.
Le même vandalisme pieux, s’exerçant sur la fable lx, a fait
disparaître la fin du titre dont il ne reste que ces mots : De l’ourse cui le verpil…
, et la partie de la
miniature qui représentait le renard saillissant l’ourse.
Les fables, qui ne sont pas suivies de l’épilogue, se
terminent par la souscription Explicit
Esopes
, écrite en gros caractères.
{p. 757}Le manuscrit qui les contient a été connu de M. de Roquefort qui lui attribue la cote M. 18.
J. Manuscrit 25405. §
Le manuscrit 25405, qui a eu dans le fonds Notre-Dame la cote E. 6 et qui a été également connu de M. de Roquefort, forme un volume in-4º, composé de 145 feuillets anciens en parchemin, que le relieur a fait précéder de deux neufs, le premier en papier, le second en parchemin.
Sur le recto du feuillet en papier a été écrite une note qui
assigne au manuscrit l’année 1204, date de la prise de Constantinople par
Baudouin. Le verso est occupé par une nomenclature des ouvrages contenus
dans le manuscrit, suivie de cette observation : « L’écriture
ci-dessus est celle de Fauchet. Remarquez dans ce manuscrit l’emploi du
point d’interrogation ainsi figuré : 5. Je ne l’ai pas
vu en d’autres textes aussi anciens. Voyez fo 56 ro. Le copiste suit le dialecte du nord de la
France. »
Quand on lit ces lignes, on comprend que, contrairement à l’affirmation de M. de Roquefort, le savant Fauchet, qui a été propriétaire du manuscrit et qui en tous cas l’a examiné, n’a pu placer l’existence de Marie au milieu du xiiie siècle.
Parmi les œuvres contenues dans le manuscrit figurent les fables de Marie, qui commencent par le prologue en 40 vers à la première colonne du feuillet 55 b et qui se terminent par l’épilogue en 22 vers au bas de la première colonne du feuillet 80 b.
L’écriture, qui est sur deux colonnes, offre cette particularité que la lettre v, qui dans le corps des mots est remplacée par un u, conserve au commencement sa forme spéciale.
Les fables ne sont pourvues ni d’un titre général en tête du prologue, ni d’un titre particulier en tête de chacune d’elles.
Le manuscrit en possède non 93, comme un numérotage inexact porterait à le croire, mais seulement 92. Les manquantes sont celles qui, dans mon tableau, portent les nos 12, 25, 42 à 44, 51, et 99 à 103. Au bas de la fable lxxxix, qui dans le manuscrit est la quatre-vingt-troisième, on lit ce distique léonin écrit, sans doute par quelque moine, avec une encre plus pâle :
Oh ! tu qui comedis, tibi conssulo (sic), si mihi credis,Ut retrahas ori, dans Christo, de meliori.
Dans l’épilogue c’est Mires qu’est appelé
le royal auteur de la {p. 758}traduction anglaise. La
collection se termine par cette souscription : Explicit
Ysopes.
K. Manuscrit 25406. §
Le manuscrit 25406 qui, avant la fusion des fonds, portait dans le fonds Notre-Dame la cote 192 et auquel M. de Roquefort donne la cote M. 17, forme un volume in-4º, composé de 49 feuillets en parchemin, dont l’écriture sur 2 colonnes est du xiiie siècle. Il possédait à l’origine 50 feuillets ; mais il est privé du premier, sur lequel commençait un Bestiaire.
Les fables de Marie débutent par le prologue ordinaire en
tête du feuillet 31 a. Au-dessus du prologue avait été
ménagé un espace blanc, qui était destiné à recevoir une miniature et qui, à
une époque relativement récente, a été rempli par ce titre : Fables d’Aesope, Horace, de Phaedrus, d’Avienus et
aultres.
Le prologue est incomplet : les vers 8 à 9, 21
à 22 et 33 à 36 ont été omis.
Les fables portent des titres spéciaux, qui ont été écrits
par la même main que le titre général dans l’espace blanc sans doute destiné
par le copiste primitif à être orné de miniatures. Elles sont en apparence
au nombre de 57, à cause de la division en deux de la fable des deux Hommes,
l’un véridique et l’autre menteur ; mais en réalité, il n’en existe que 56,
et par suite il en manque 47, dont les numéros, d’après mon tableau, sont
les suivants : 22, 24 à 25, 46 à 48, 57 à 65 et 72 à 103. Elles se terminent
au bas de la première colonne du feuillet 49 a par cette
souscription : Expliciunt fabule Isopi. || Deo gracias.
Amen.
Au haut de la deuxième colonne du feuillet 49 a, on lit ce commencement d’ex libris, écrit en
très gros caractères gothiques : Je cuy à
frère…
; à la suite venaient deux mots qui étaient les noms
d’un moine et qu’un propriétaire plus récent a fait disparaître.
Au bas de la même colonne, contrairement à l’indication de M. de Roquefort528, les fables sont suivies de l’épilogue ordinaire, écrit par la même main que les titres ; comme dans celui du manuscrit 25405, le traducteur anglais y est appelé le roi Mires.
L. Manuscrit 25545. §
Le manuscrit 25545, autrefois 274 bis, qui a appartenu à l’église de Paris, et qui a ensuite dépendu du fonds Notre-Dame, forme un volume in-4º, dont les feuillets sont en parchemin et dont l’écriture est sur deux colonnes.
{p. 759}Il contient un grand nombre de
pièces, parmi lesquelles les fables de Marie occupent les feuillets 29 a à 45 b. Au bas du feuillet 28 b, elles sont annoncées par ce titre général : Ci commence ysopet en françois qui contient
LXXXI chapitres.
Puis au commencement du feuillet suivant
vient le prologue en quarante vers.
Les fables qui le suivent sont pourvues de titres spéciaux
écrits à l’encre rouge. Comme le titre général l’indique, elles devraient
être au nombre de 81 ; mais par suite de la disparition de plusieurs
feuillets, il n’en existe plus que soixante-trois. Encore la
soixante-troisième, intitulée : D’un leu qui aprint a.
I. vilain. III. sens
, est-elle incomplète, et n’en
reste-t-il que les quinze premiers vers. M. de Roquefort qui a connu le
manuscrit 25545 et qui lui attribue la cote N. 2, dit, en parlant de la
soixante-troisième fable, que « le copiste a négligé d’en achever la
transcription529 »
. Cela
ne fait pas concevoir une haute idée du soin avec lequel il a étudié les
manuscrits de la Bibliothèque nationale, et donne lieu de penser qu’en
réalité il n’a guère fait usage des sept qu’il a seuls connus.
Les fables qui n’ont jamais figuré dans le manuscrit 25545 ou qui en ont disparu, sont les quarante portant dans mon tableau les numéros suivants : 3, 10 à 18, 26 à 31, et 80 à 103. Il faut naturellement y ajouter l’épilogue.
Quant à l’écriture qui est très nette et qui appartient au commencement du xive siècle, elle offre, comme dans le manuscrit 25405, cette particularité, que le v n’est représenté par un u que dans les mots dont il n’est pas la première lettre, et que les lettres v et u, dans les mots vulpis et vulpil, sont remplacées par un w.
M. Manuscrit 1683 du fonds Moreau. §
Je ne dirai que quelques mots de ce manuscrit in-fol.,
intitulé : Mouchet
, qui, étant moderne, ne
peut être considéré comme une véritable source. Il a été relié en quatre
volumes, et c’est le quatrième, intitulé : Mouchet IV
, qui
renferme les fables de Marie. Elles occupent le commencement du volume. Ici
je dois signaler une bizarrerie : chaque numéro de pagination s’applique à
six pages consécutives ; ainsi les six premières pages du quatrième volume
sont numérotés de la manière suivante : 256 rº, col. 1 ; 256 rº, col. 2 ;
256 rº, col. 3 ; 256 vº, col. 1, 256 vº, col. 2 ; 256 vº, col. 3. Les
fables, au nombre de 102, ne portent pas {p. 760}de
titres, sont pourvues de l’épilogue ordinaire et se terminent au milieu du
feuillet 273 rº, col. 1 ; il s’ensuit qu’à raison du système de pagination
employé, elles occupent les cent trois premières pages. Elles sont
accompagnées de deux séries de variantes. Il y a une première série
commençant par ce titre : Ci commence de
Ysopes.
Sur la première page, l’auteur de la seconde série a
par la note suivante nommé l’auteur de la première et indiqué les sources
des deux séries : « Na. Toutes
les variantes qui suivent sont de la main de M. le comte de Caylus. Il les
a tirées du Ms. du M. de Saint-Germain des Prés parmi les fabliaux. Celles
qui sont de ma main ont été prises sur le Ms. N. D., N. 2,
274 bis. »
2º Bibliothèque du British Museum. §
A. Manuscrit Vespasian B. XIV. §
Ce manuscrit forme un volume in-8º très allongé, composé de 114 feuillets en parchemin, dont l’écriture est à deux colonnes.
Parmi les ouvrages qu’il contient, figurent les fables de Marie qui occupent les feuillets 19 a à 32 b. Elles ont été précédées du prologue, dont, par suite de la disparition des deux premiers feuillets, il ne reste plus que les huit derniers vers. Dépourvues de leur titre général, elles n’ont pas davantage de titres particuliers. Elles sont seulement au nombre de 61, de sorte qu’il en manque 42, qui sont celles portant dans mon tableau les nos 34, 40, 42 à 45, 48, 54, 60 à 65, 73, 76 à 95 et 97 à 103. Quoique aucun feuillet ne paraisse manquer à la fin, elles ne sont pas suivies de l’épilogue.
B. Manuscrit Harley 978. §
Le manuscrit Harley 978 est un volume in-4º de 162 feuillets
en parchemin, dont l’écriture est à 2 colonnes. Sur un feuillet en papier
ajouté par le relieur, un premier bibliothécaire a écrit cette mention :
« 978. Ni fallor, cod. sec. XIV ; cæt. non post sec. XV. »
Signé : « A. G. »
Un second bibliothécaire, en 1862, a
au-dessous exprimé une opinion différente dans deux notes en anglais, dont
la première peut se traduire ainsi : « Le tout est du xiiie siècle, à l’exception de quelques écritures
sur les feuillets 15 b à 17530. »
Cette première note
est paraphée par son auteur. Voici la traduction de la seconde :
« Selon toute probabilité, la plus ancienne partie de ce volume a
été écrite à l’abbaye de Reading vers l’année 1240. Comparez les Obits du
Calendrier avec ceux du Calendrier du Cartulaire de Reading, dans le
manuscrit {p. 761}Cott. Vesp. EV. »
Ici paraphe pareil au précédent, que
suivent les mots : « Avril 1862531 »
.
Les fables de Marie qui sont complètes et qui même, à cause
de la division en deux de la fable du Prêtre et du Loup, paraissent être au
nombre de 104, débutent au haut du feuillet 40 a par ce
titre : Ici cumence le ysope
, que suit le
prologue en 40 vers, ne sont pas pourvues de titres spéciaux, et se
terminent au milieu de la première colonne du feuillet 67 b par l’épilogue en 22 vers, qui attribue la traduction anglaise à
un roi appelé Alurez ou Alvrez,
c’est-à-dire Alfred.
C. Manuscrit Harley 4333. §
Ce manuscrit forme un volume du petit format in-4º, qui est composé de 120 feuillets en parchemin, savoir : 117 écrits et 3 blancs, et dont l’écriture à deux colonnes est du xiiie siècle. L’œuvre de Marie y occupe les feuillets 73 à 96. Elle comprend le prologue, 83 fables dépourvues de titres particuliers et l’épilogue en 22 vers, qui, comme celui du manuscrit 1446 de la Bibliothèque nationale, attribue la traduction anglaise à un roi Henris, qui ne peut être que Henri Beau-Clerc.
Les vingt fables qui manquent à la collection, sont celles qui dans mon tableau portent les nos 5 à 6, 11 à 12, 27, 75, 78 à 80, 85, 87 à 88, 91, 93 à 94, et 98 à 102.
3º Bibliothèque de l’Université de Cambridge. §
Manuscrit E.e.6.11. §
Ce manuscrit, qui est un in-4º de petit format, se compose de 83 feuillets en parchemin, dont l’écriture est de la fin du xiiie siècle.
Les fables de Marie qu’il renferme occupent les feuillets 39
à 83. Elles sont précédées de ce titre général : Incipit
liber qui dicitur esope
, et sont pourvues chacune d’un
titre spécial formulé en latin. Elles ne sont pas au complet et sont
seulement au nombre de 67, de sorte qu’il en manque 36, qui sont celles
portant dans mon tableau les numéros suivants : 6, 12, 54 à 55, 61 à 65,
et 76 à 102.
4º Bibliothèque royale de Bruxelles. §
Manuscrit 10296. §
Ce manuscrit, suivant l’usage adopté à Bruxelles, porte
autant de cotes qu’il contient d’ouvrages divers. Il forme un fort volume
in-fol., composé de 385 feuillets anciens en papier, eux-mêmes précédés de
{p. 762}2 feuillets contenant la table de la vie des saints qui est
la première des œuvres réunies, et suivis de 4 feuillets blancs, dont le
premier (f. 386) porte seulement en tête cet ex-libris :
« En ce livre sont contenues plusieurs vies des saints et des
saintes, en rime et en prose, lequel est à Mons. Charles de Croy, comte de
Chimay. Signé : Charles. »
Les fables de Marie ont été écrites dans le dialecte picard ;
elles s’annoncent par ce titre : Chi cōmenche Ysopes en
romans
, après lequel viennent immédiatement les quarante
vers du prologue. Elles sont au nombre de 88, d’où il suit que, pour être
complète, la collection devait en posséder 15 de plus. Les quinze qui
manquent sont celles qui dans mon tableau portent les nos 22 à 23, 40 à 41, 46, 50 à 52, 71 à 75 et 80 à 81. Elles sont
pourvues chacune d’un titre spécial et suivies d’un épilogue en 26 vers.
Indépendamment des différences qui tiennent à la variété des dialectes, les manuscrits des fables de Marie offrent encore d’innombrables variantes, qui pourtant n’empêchent pas d’y reconnaître une seule et même œuvre. Il en est autrement de l’épilogue du manuscrit qui nous occupe : son texte diffère tellement de celui des autres manuscrits, qu’il constitue une œuvre distincte qu’il est dès lors utile de faire connaître et que je vais transcrire ici :
Au finement de cest escrit,Qu’en rommans ai finet et dit,Me nommerai en ramembrance :Marie ay non, si sui de France.Puet c’estre al cler le pluisourPrenderoient pour moi mon labour,Ne voel que nus pour yaus le die :Cil oeure mal qui lui oublieEt qui Dieu met en non caloir,Por le mond(e) servir main et soir.Diex nous laist faire tel seruiceQue nous (nous) puissons par sa franciseLe Resgne des cieus recouurer.Quand ce venra au deseurer,Et que l’ame en départiraDu cors, quand il a Dieu plaira,Dites amen, que Diex l’otroie,Et se doinst Diex santet et joieA celui qui recopiiet l’a.{p. 763}Parfait le nuit, c’on vous diraTout droit c’on dist de Pentecouste ;C’est bom a savoir et peu cousteAuoecque mille et quatre censEt .xxix., tout droit devensSe cambre lour il se dormoit.Dites amen que Diex l’otroit.
On voit par cet épilogue que l’écriture du manuscrit est de la première moitié du xve siècle.
Section IV.
Dérivé partiel du Romulus
anglo-latin. §
En 1825, pendant qu’il s’occupait de la publication des Fables médites des xiie, xiiie et xive siècles, M. Robert a retrouvé, dans les deux manuscrits de la Bibliothèque nationale 347 B et 347 C, vingt-deux fables en prose latine, qu’il a éditées532, auxquelles on a donné ensuite le nom de Romulus Roberti, et dans lesquelles j’ai cru reconnaître un fragment du Romulus anglo-latin, et c’est à ce titre que je les ai a mon tour introduites dans la première édition de cet ouvrage.
Cette appréciation a été jugée inexacte par M. Gaston Paris533, qui, ainsi que je l’ai déjà expliqué, a soutenu que, si rapproché qu’il fût par son texte du Romulus anglo-latin, il en était, non pas un fragment, mais un dérivé partiel, dénomination qu’il convient de lui donner.
M. Gaston Paris ne s’en est pas tenu à cette affirmation ; il
s’est efforcé de la justifier. À cet effet, se servant notamment de la première
fable du Romulus Roberti, il remarque que ce Romulus « nous offre un
texte fort abrégé »
, et que, tandis que le Romulus primitif nous
montre le Singe, chef des autres, imitant ce qu’il a vu {p. 764}faire à l’Empereur et nous initie aux réflexions qu’après le
menteur l’homme véridique formule pour sa perte, le Romulus Roberti omet ces
détails qu’on retrouve au contraire très amplifiés dans la version poétique de
Marie534. Il en conclut que, si on les y rencontre, c’est qu’ils
existaient déjà dans la traduction anglaise faite sur le Romulus anglo-latin,
dont celui de M. Robert n’a pu dès lors être qu’un abrégé.
Si je suis d’accord avec le savant membre de l’Institut pour voir dans ce dernier texte, non pas un fragment, mais un dérivé partiel du Romulus anglo-latin, en revanche il ne me paraît pas possible de le considérer avec lui comme un abrégé de ce Romulus.
Tout à l’heure je justifierai ma thèse. Auparavant je désire établir que le Dérivé partiel n’est pas un simple fragment d’une imitation plus complète.
Ce qui me paraît fortifier cette supposition, c’est l’ordre même dans lequel se présentent les vingt-deux fables du Romulus Roberti. Si en effet, soit que le copiste n’eût pas achevé sa transcription, soit que les feuillets du manuscrit primitif eussent en partie disparu, le Romulus Roberti n’était qu’un fragment, le classement des fables serait dans le dérivé le même que dans le modèle. Or, il ne paraît pas en être ainsi. Sans doute le Romulus anglo-latin a péri ; mais il est permis de croire que dans la version poétique de Marie, quoiqu’elle l’eût faite sur la traduction anglaise, les fables, sinon toutes, au moins presque toutes, occupent les mêmes places que dans le texte latin. Or, entre le Romulus Roberti et l’œuvre de Marie cette concordance n’existe pas, et dès lors on est tout naturellement porté à penser que l’auteur de ce Romulus n’a créé qu’un recueil de pièces choisies tel que nous le possédons.
Maintenant faut-il, ainsi que l’examen isolé de la première fable pourrait le faire croire, considérer ce recueil comme une imitation abrégée du Romulus anglo-latin ? Adopter cette idée serait commettre une grave erreur. Quand, au lieu de s’arrêter à cette seule fable, on jette les yeux sur toutes, on acquiert la conviction que le Romulus Roberti est un dérivé mixte dont les fables découlent de deux sources, les quatre premières, du Romulus primitif, les dix-huit autres, du Romulus anglo-latin. Or, si les quatre premières, {p. 765}c’est-à-dire celles des deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur, du Renard et des Raisins, du Lion et de l’Âne chassant et du Lion malade et du Renard, doivent être considérées comme des dérivés raccourcis, les autres sont d’une prolixité qui ne permet pas de les juger de même.
Pour revenir à la première des quatre abrégées, dans son texte écourté la tournure des phrases et les expressions du Romulus primitif ont été si bien conservées qu’il est impossible de ne pas y voir une imitation directe. Il y a d’ailleurs, dans le doute, un moyen facile de s’édifier, c’est de comparer ensemble dans cette fable le texte du Romulus primitif, celui du Romulus de Nilant à défaut de celui du Romulus anglo-latin et celui du Romulus Roberti. Pour simplifier les choses, je ne prends, dans chacun des trois textes, qu’une phrase pour terme de comparaison :
Romulus primitif : Hii sunt comites tui, primicerii, campi doctores, milites et cetera officia.
Romulus de Nilant : Hii sunt tui comites, proceres, satellitum doctores, et milites, et ministrales, et officiorum procuratores, et subditi.
Romulus Roberti : Illi sunt comites tui, primicerii, milites et cetera officia.
Il ressort de cet exemple que le Romulus Roberti, plus que celui de Nilant, a suivi de près le Romulus primitif.
Quant aux trois fables qui suivent la première, comme elles sont, dans le Romulus Roberti, la copie presque littérale du texte du Romulus primitif, on doit encore moins hésiter à admettre qu’elles en sont directement issues. Je cite encore un exemple à l’appui, et je le lire de la fable du Lion et de l’Âne chassant :
Romulus primitif : Asinus e diverso occurrit Leoni.
Romulus de Nilant : Jamdudum quidam Asinus occurrens Leoni in quodam deserto…
Romulus Roberti : Asinus e diverso Leoni occurrit.
On voit le résultat. La comparaison faite sur les deux autres fables en donnerait un semblable, et compléterait au besoin ma démonstration.
À l’égard des dix-huit dernières, la question relative à leur origine est un peu plus difficile à résoudre ; c’est qu’elles sont étrangères, toutes sauf trois, au Romulus primitif, et, toutes sauf deux {p. 766}des trois, au Romulus de Nilant. Ces trois fables sont celles de l’Abeille et de la Mouche, du Renard et du Corbeau et du Loup régnant et du Singe.
Je m’arrête d’abord à la fable de l’Abeille et de la Mouche. Elle n’a pas été directement tirée du Romulus primitif. À première vue cela ressort de ce fait que, comme dans la traduction de Marie et comme dans le Dérivé complet, l’Abeille a été substituée à la Fourmi. Mais est-ce à ce Dérivé ou au Romulus anglo-latin lui-même qu’elle doit son existence ? Les fables de ce dernier ne nous étant pas parvenues, il n’y a qu’une façon de résoudre la question, c’est de voir lequel du texte du Dérivé complet et du texte du Romulus Roberti se rapproche le plus du Romulus primitif, source indirecte du Romulus anglo-latin. Il est clair que si c’est le Romulus Roberti qui a le plus gardé les expressions du premier, c’est qu’il les aura prises dans le second. Or, voici ce qu’on lit dans les trois textes :
Romulus primitif : In capite regis sedeo.
Dérivé complet : Juxta regem sedeo, vel, si magis voluero, super caput ipsius sublimis existo.
Romulus Roberti : Super caput regis et reginæ sedeo.
Le Romulus Roberti est donc plus voisin du Romulus primitif que le Dérivé complet qui dès lors ne peut lui avoir donné naissance.
Je passe à la fable du Renard et du Corbeau. Ici, à défaut du texte du Romulus anglo-latin, nous possédons celui du Romulus de Nilant, qui en est le père et qui va nous permettre de savoir d’où vient le texte du Romulus Roberti.
Romulus de Nilant : Quodam tempore jamdudum Corvus caseum de fenestra rapuisse fertur et cum eo conscendit altam arborem.
Dérivé complet : Corvus perfidie pinguem caseum in villa furatus erat, et ad nemus reversus in summa quercu resedit.
Romulus Roberti : Corvus de fenestra quadam frustum casei recentis rapiens, asportavit, et, ad nemus veniens, in quercu resedit.
Dans cet exemple, on voit le Romulus Roberti reproduire les expressions du Romulus de Nilant abandonnées par le Dérivé complet. Il n’est donc pas douteux que c’est, non pas de ce Dérivé, mais du Romulus anglo-latin qu’il descend.
On peut remarquer aussi que de cet exemple il ressort qu’il y a, {p. 767}dans le Romulus Roberti, des expressions qui lui sont communes avec le Dérivé complet et qui ne se trouvent pas dans le Romulus de Nilant. C’est ainsi que, dans ce Romulus, on lit les mots conscendit altam arborem évidemment empruntés au Romulus primitif, tandis que les deux Dérivés partiel et complet portent les mots in quercu resedit étrangers à ce Romulus. Si, dans le Dérivé complet et dans le Romulus Roberti se rencontrent des expressions et même des lambeaux de phrase semblables, qui n’existent pas dans le Romulus de Nilant, c’est qu’ils les ont puisés dans une source qui leur est commune, et si, par ces expressions et ces lambeaux de phrase, cette source commune s’écarte du Romulus primitif plus que le Romulus de Nilant, c’est que, loin d’avoir été la base de ce dernier, elle en est au contraire descendue et s’est interposée entre lui et les deux Dérivés partiel et complet. D’où il suit enfin que, loin d’avoir donné le jour au Romulus de Nilant, le Romulus anglo-latin l’a reçu de lui.
J’arrive maintenant à la fable du Loup régnant et du Singe. La comparaison des textes des deux Dérivés partiel et complet va encore nous montrer qu’ils ne peuvent être issus l’un de l’autre et qu’ils sont nés d’un auteur commun qui ne peut être que le Romulus anglo-latin.
Romulus de Nilant : Tunc ille ait. Nullus mihi cibus tam desiderabilis, sicut et illius Simii ; sed pro fide datâ et verecundia facere non ausus sum.
Dérivé complet : Tum confessus est desiderium se habere comedendi Simiam, sed occasionem deesse qua eam occideret, cum jusjurandum non auderet infringere.
Romulus Roberti : Ille autem dicebat nullum cibum nisi carnes Simiæ sibi placere ; sed citius vellet mori quam Simiæ nocens infringeret jusjurandum.
Comme dans le Romulus de Nilant, le Loup, dans le Dérivé complet, dit qu’il n’oserait pas violer son serment. Le verbe employé est le même : dans l’un, non ausus sum, dans l’autre non auderet. Au contraire, dans le Romulus Roberti le Loup va plus loin ; il déclare qu’il aimerait mieux mourir.
D’autre part, le Romulus Roberti se sert des mêmes mots que le
Romulus de Nilant, pour faire exprimer par le Loup sa préférence pour la chair
de Singe : « Nullus mihi cibus »
, dit celui-ci ; « Nullum
{p. 768}cibum mihi »
, dit celui-là. Or, ces mots ne sont pas
dans le Dérivé complet.
De ce double rapprochement ne doit-on pas conclure que ce dernier et le Romulus Roberti ont été tirés de la même œuvre ? Sans nul doute. Aussi la seule question est-elle de savoir quelle est cette œuvre unique. À cet effet, il faut remarquer que, dans cet exemple, il y a des expressions, qui, communes aux deux Dérivés partiel et complet, n’appartiennent pas au Romulus de Nilant, qu’ils ne peuvent en conséquence devoir leur existence à ce Romulus qui ne s’écarte pas autant du Romulus primitif, et qu’ils ont été engendrés par une collection interposée qui est le Romulus anglo-latin.
Il y a même ici, entre les deux Dérivés partiel et complet, quelque chose de plus probant qu’une simple identité d’expressions, c’est que, tandis que le Romulus de Nilant a, comme le Romulus primitif, laissé au Lion sa royauté, les deux Dérivés, d’accord en cela avec la traduction de Marie, lui ont substitué le Loup par un procédé identique fourni par une collection intermédiaire à la fois plus proche qu’eux du Romulus de Nilant et plus voisine d’eux que lui. Et cette collection intermédiaire ne peut être autre que le Romulus anglo-latin ; car Marie, qui a indirectement exécuté sa traduction sur ce Romulus, a, comme eux, substitué le Loup au Lion.
Ce qui est en même temps constant, c’est que le texte du Romulus de Robert s’est tenu plus près du Romulus anglo-latin que celui du Dérivé complet. Ainsi, comme la version de Marie, le texte du Romulus de Robert a, dans la fable du Loup régnant et du Singe, mis en scène un Chevreuil et les Barons du roi des animaux que le Dérivé complet ne fait pas intervenir.
En ce qui touche les quinze autres fables, on n’a plus de texte latin qui permette de savoir si elles sont nées du Dérivé complet ou si au contraire ce dernier en est issu, ou si enfin les fables des deux collections dérivent d’un auteur commun qui serait le Romulus anglo-latin. Mais, à défaut du texte latin, on peut, à l’aide de la version de Marie, trouver plus d’une solution certaine. Tel est le cas, par exemple, pour la fable v du Romulus Roberti, c’est-à-dire pour la fable du Bœuf et du Loup. Dans cette fable, le Dérivé complet place en présence l’un de l’autre un Loup et une Chèvre, tandis que, dans la traduction de Marie comme dans le Romulus Roberti, ce sont un Bœuf et un Loup qui sont les deux personnages du drame.
{p. 769}Or, comme la traduction de Marie a été faite sur une première version qui, sans nul doute, avait suivi pas à pas le Romulus anglo-latin, il faut en induire que non seulement le Romulus Roberti n’est pas une imitation du Dérivé complet, mais qu’il est même plus conforme que lui au Romulus anglo-latin qui est leur auteur commun.
Je pourrais me livrer à de pareilles recherches sur chacune des quatorze dernières fables du Romulus Roberti ; mais je me rends compte de ce que cet examen, ajouté à celui auquel je viens de me livrer, aurait d’infailliblement fastidieux ; aussi ne suis-je pas d’avis de l’entreprendre. D’ailleurs il n’est nullement nécessaire ; car les résultats qu’il donnerait me semblent tout indiqués. On peut, je crois, tenir dès maintenant pour certain que, en dehors des quatre premières fables qui ne sont que la copie presque littérale du Romulus primitif, ou, si l’on veut du Romulus ordinaire, les fables du Romulus Roberti sont toutes dérivées du Romulus anglo-latin dont elles s’étaient moins écartées que celles du Dérivé complet.
J’ajoute, en terminant, qu’on doit maintenant s’expliquer aisément que, dans ma première édition, j’aie pu confondre avec le Romulus anglo-latin celui de M. Robert et que, dans celle-ci, je donne le pas à ce dernier sur son co-dérivé.
Je passe, sans plus tarder, à la détermination de l’époque à laquelle le Romulus Roberti a dû être écrit. Sur ce point, je n’ai que quelques mots à dire : je crois qu’à défaut d’autre élément d’appréciation, il faut s’en rapporter à l’âge des deux manuscrits qui renferment le Dérivé partiel, et, comme ils sont l’un et l’autre du xive siècle, il me semble vraisemblable que l’œuvre qu’ils nous ont conservée ne remonte pas à un temps antérieur.
Quoi qu’il en soit, voici la liste des vingt-deux fables, accompagnée des numéros que portent les semblables dans le Romulus primitif et dans la traduction de Marie :
| Romulus anglo-latin. | Romulus primitif. | Traduction de Marie. |
| 1. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | III, 30. | 66. |
| 2. Le Renard et les Raisins. | III, 23. | |
| 3. L’Âne et le Lion. | III, 32. | 67. |
| 4. Le Lion malade et le Renard. | III, 34. | 68. |
| {p. 770}5. Le Bœuf et le Loup. | 94. | |
| 6. Le Chat et le Renard. | 98. | |
| 7. L’Escarbot vaniteux. | 65. | |
| 8. Le Riche et sa Fille. | 38. | |
| 9. Le Paysan et sa Femme. | 41. | |
| 10. Les Oiseaux qui élisent un roi. | 22. | |
| 11. Le Paysan et son Cheval. | 71. | |
| 12. L’Épervier et la Chouette. | 80. | |
| 13. L’Aigle et l’Épervier fugitif. | 81. | |
| 14. Le Loup et le Mouton. | 73. | |
| 15. L’Hirondelle et les Moineaux. | 84. | |
| 16. L’Abeille et la Mouche. | II, 17. | 86. |
| 17. Le Renard et le Corbeau. | I, 15. | 14. |
| 18. Le Paysan et le Bœuf. | 85. | |
| 19. Le Lièvre et le Cerf. | 97. | |
| 20. Le Loup et l’Escarbot. | 56. | |
| 21. Le Lion malade, le Renard et le Loup écorché. | 59. | |
| 22. Le Lion qui abdique et le Loup. | III, 22. | 37. |
Ainsi que je l’ai dit, le texte du Dérivé partiel du Romulus anglo-latin n’existe que dans deux manuscrits, appartenant à la Bibliothèque nationale, et portant dans le Catalogue imprimé en 1744, l’un la cote 347 B, l’autre la cote 347 C.
Faute de les avoir suffisamment parcourus, le rédacteur du Catalogue, adoptant pour chacun d’eux la même formule, en a indiqué le contenu en termes trop laconiques pour le faire connaître. Voici en effet comment il en donne l’analyse :
Ibi continentur :
1º Libri novemdecim de proprietabus rerum : authoris nomen non comparet ; is autem est Bartholomæus Anglicus.
2º Nonnullæ fabulæ : authore anonymo.
Is codex decimo quarto sæculo videtur exaratus.
Une telle désignation n’est pas assez explicite pour que je puisse m’en contenter. Je vais en donner une plus détaillée. Si je me conformais à l’ordre suivi par le rédacteur du Catalogue, je devrais d’abord analyser le manuscrit 347 B ; mais, comme le manuscrit 347 C est le plus ancien, c’est lui que j’examinerai le premier.
1º Manuscrit 347 C. §
Ce manuscrit consiste dans un volume in-fol. de très petit format, dont les feuillets, au nombre de 162, sont en parchemin et dont l’écriture à deux colonnes est du xive siècle.
Il a appartenu à plusieurs bibliothèques dans lesquelles il a reçu tour à tour les cotes 1225, 5787 et mcccxxxix.
Au haut du recto du premier feuillet il porte une invocation qui, affectant la forme d’un pentamètre léonin, est ainsi conçue :
Adsit principio Sancta Maria meo.
Il renferme trois œuvres distinctes.
Les 156 premiers feuillets contiennent les dix-neuf livres du traité De Proprietatibus rerum, dont l’auteur innommé a été un moine de l’ordre des Frères mineurs, qui dans les manuscrits est appelé Bartholomæus Anglicus et que les bibliographes ont surnommé Glanville535.
Ce traité est précédé d’un prologue qui commence au haut de la
première colonne du premier feuillet par ce titre : Incipit Prologus in libro de natura rerum
, et qui se termine
au milieu de la première colonne du feuillet 157 a par la
souscription suivante : Explicit liber de naturis rerū.
Deo gracias. Am̄.
Immédiatement après viennent, sans titre général et sans titres
particuliers à chacune d’elles, les fables de la version en prose du texte
d’Avianus, qui finissent à l’antépénultième ligne de la deuxième colonne du
feuillet 159 b et sont closes par ces mots : Expliciūt apologi auiani.
Sans le moindre espace blanc qui les précède, et, comme si elles appartenaient à la même collection, sans titre général qui les annonce, commencent aussitôt, dépourvues également de titres particuliers, les vingt-deux fables du Dérivé partiel du Romulus anglo-latin, qui se terminent vers le bas de la deuxième colonne du verso du dernier feuillet.
{p. 772}Le petit vide qui restait a été
rempli par un ex libris ainsi conçu : Iste liber constat duci Aurelianensi.
Cet ex
libris, dont M. Robert, dans son ouvrage sur les fables inédites des
xiie, xiiie
et xive siècles536, a donné un fac-simile, est un
autographe du duc Charles d’Orléans, dont la signature mise au-dessous est,
suivant son usage, accompagnée du double signe xl et 40. Lorsque, dans le
volume que je consacrerai à Avianus, je m’occuperai du dérivé en prose latine
intitulé Apologi Aviani, j’aurai l’occasion de revenir sur
ce double signe et sur le sens qu’il convient d’y attacher ; je m’abstiens
donc ici d’entrer dans des détails que je serais ailleurs obligé de
reproduire.
2º Manuscrit 347 B. §
Le manuscrit 347 B, qui a appartenu au savant Baluze, bibliothécaire de Colbert, est, comme le précédent, un volume in-fol. de très petit format, dont l’écriture à deux colonnes, sur parchemin, est du xive siècle.
Si l’on s’en rapportait au numérotage en chiffres romains dont il a été pourvu, on devrait dire qu’il se compose de 194 feuillets ; mais, les deux premiers n’étant comptés que pour un seul, en réalité il en existe 195.
Tout au haut du recto du premier feuillet et en dehors de la
première ligne de chacune des deux colonnes, on lit : Ave
Maria.
N’étant que la copie du manuscrit 347 C, le ms. 347 B comprend les mêmes ouvrages dans le même ordre.
Le premier est le traité De Proprietatibus
rerum, dont le prologue, commençant au haut de la première colonne du
recto du premier feuillet, est annoncé par ce titre : Incipit p̱log9 sup̱ libm de naturis
rer/.
L’ouvrage se termine à la septième ligne de la première colonne
du feuillet 184 a (en réalité 185 a), et
la fin en est indiquée par cette souscription à l’encre rouge : Explicit liber de naturis rerum. Deo gr̄as.
Immédiatement après viennent, sans titre général et sans titres
particuliers à chacune d’elles, les fables de la version en prose latine
d’Avianus qui, se terminant au milieu de la première colonne du
feuillet 189 a (en réalité 190 a), sont
closes par ces mots : Expliciunt Apologi
Auiani.
{p. 773}Puis commencent, sans intervalle apparent, les vingt-deux fables du Dérivé du Romulus anglo-latin, qui, au bas de la première colonne du feuillet 194 b (en réalité 195 b), sont suivies de ce mauvais pentamètre léonin écrit à l’encre noire :
Explicit, expliceat, ludere scriptor eat.
La deuxième colonne est vide.
Tel est le manuscrit 347 B. Quoique exécuté au xive siècle, peu d’années après le précédent, il est de bien moindre valeur ; il est en effet l’œuvre d’un scribe inexpérimenté, qui, ignorant le latin et ne pouvant pas bien lire l’écriture mauvaise de son modèle, a tantôt altéré, tantôt supprimé les mots qu’il n’était pas capable de déchiffrer.
La première édition des vingt-deux fables du Dérivé du Romulus anglo-latin est due à M. Robert, qui, en 1825, les a publiées dans son ouvrage sur les Fables inédites des xiie, xiiie et xive siècles537. Il les avait tirées des deux manuscrits 347 B et 347 C de la Bibliothèque nationale, et, reconnaissant sans doute que le second était le plus pur, il en avait généralement adopté les leçons.
Malheureusement, si ce manuscrit était exempt des fautes et des lacunes de l’autre, il n’était pas aussi aisément lisible, et M. Robert, qui paraît avoir manqué des notions paléographiques les plus élémentaires, avait procédé comme le copiste du xive siècle, à qui est dû le manuscrit 347 B : tantôt il avait travesti, tantôt il avait complètement supprimé ce qu’il n’avait pu lire.
Pour qu’on puisse apprécier combien il a commis d’erreurs, je vais, à l’aide de la première et de la vingt-deuxième et dernière fables, faire ressortir les différences qui existent entre le texte du manuscrit 347 C et celui de sa fautive édition.
{p. 774}fable i.
Manuscrit 347 c.
Robert.
circumquaque
circumstantibusque
primicerii, milites
tum principes, tum milites
Quid tibi de me videatur et de mihi astantibus ?
Quid tibi de me videtur et de his astantibus ?
et hii omnes simii similes sunt tibi
et isti omnes simii sunt similes tibi
lacerari.
laniari.
falsitas commendari et veritas lacerari.
fallacitas laudari et veritas laniari.
fable xxii.
loco sui
in loco sui
se vobis astringat
se astringat
judicaret
indicaret
tantum
tam
Tunc per
Per
ad suæ palliationem nequitiæ
ad palliationem nequitiæ
frusta suis distribuit
frusta distribuit
Dannula
Damulà
mentitur eidem et loquitur
mentiretur eidem et loqueretur
Dammulam
Damulam
atque pinguem
ac pinguem
Nec multum gravis erat, nec multum suavis, sed medio modo se habens.
non esset multum gravis (le reste a été omis).
ergo eum bestiæ
ergo bestiæ
ad hoc causam haberem
ad hanc causam habere
aliquod
aliquid
On voit à quel point est défectueuse l’édition de M. Robert.
Elle n’est pas la seule qui existe : dans l’opuscule que M. Herman Oesterley a, en 1870, consacré au Romulus Burnéien538, on retrouve les fables qui, dans l’édition de M. Robert portent les nos 5 à 15 et 18 à 21. Malheureusement M. Oesterley n’a pas recouru aux sources et il s’est borné à faire réimprimer l’édition de son devancier avec les fautes dont elle fourmillait.
Dans cette situation chacun, je crois, sera d’avis qu’en publiant, {p. 775}d’après le manuscrit 347 C, avec les variantes offertes par le manuscrit 347 B, celle qu’on trouvera dans cet ouvrage, ce n’est pas à une besogne superflue que je me serai adonné.
Section V.
Dérivé complet du Romulus
anglo-latin. §
Le dérivé latin, auquel maintenant je passe, comprend un prologue et 136 fables.
En lisant le prologue, on s’aperçoit qu’il est absolument conforme à la partie préliminaire de ces gloses, qu’on trouve à la fois dans certains manuscrits des fables de Walther et dans les éditions de la fin du xve siècle tirées de ces manuscrits, et dont j’ai déjà cité quelques lignes à la page 294. Il fait honneur du texte latin des fables à l’empereur Romulus et signale la traduction anglaise qui en aurait été faite, non par un roi anglais, mais sur l’ordre d’un roi anglais, appelé tantôt Afferus, tantôt Affrus. Ces deux noms, qui, comme on le sait, désignent le roi Alfred le Grand, sont les formes latines de celui dont j’ai indiqué plus haut les formes romanes.
Quant aux 136 fables, je vais en donner la liste dans un tableau qui indiquera leur corrélation avec celles du Romulus primitif :
| Dérivé complet. | Romulus primitif. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| 6. Le Buffle, le Loup et le Lion. | |
| 7. La Vache, la Chèvre, le Bélier et le Lion. | I, 6. |
| 8. Le Soleil qui se marie. | I, 7. |
| 9. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 10. La Chienne qui met bas. | I, 9. |
| 11. Le Rat de ville et le Rat des champs. | I, 12. |
| 12. L’Aigle et le Renard. | I, 13. |
| 13. L’Aigle, la Tortue et la Corneille. | I, 14. |
| {p. 776}14. Le Corbeau et le Renard. | I, 15. |
| 15. Le Loup vieilli, le Bélier, l’Âne et le Renard. | I, 16. |
| 16. L’Âne qui caresse son maître. | I, 17. |
| 17. Le Lion et le Rat. | I, 18. |
| 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 20. |
| 19. Les Grenouilles qui demandent un Roi. | II, 1. |
| 20. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 21. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| 22. Le Loup et la Laie. | II, 4. |
| 23. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 24. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 8. |
| 25. Le Lion et le Berger. | III, 1. |
| 26. Le Lion médecin. | III, 2. |
| 27. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
| 28. Le Cerf à la fontaine. | III, 7. |
| 29. L’Inconstance de la Femme. | III, 9. |
| 30. La Courtisane et le Jeune Homme. | III, 10. |
| 31. Les Loups et les Brebis. | III, 15. |
| 32. La Hache et les Arbres. | III, 16. |
| 33. Le Loup et le Chien. | III, 17. |
| 34. L’Estomac et les Membres. | III, 18. |
| 35. Le Voleur et l’Escarbot. | |
| 36. La Femme et son Amant. | |
| 37. Encore la Femme et son Amant. | |
| 38. Le Cheval vendu. | |
| 39. Le Voleur et le Diable. | |
| 40. Le Loup et le Bélier. | |
| 41. Le Singe et sa Progéniture. | |
| 42. Le Dragon et l’Homme. | |
| 43. L’Ermite et son Serviteur. | |
| 44. Le Paysan et son Cheval unique. | |
| 45. L’Homme en prière à l’église. | |
| 46. Le Citadin et son Choucas. | |
| 47. Le Paysan et les trois Souhaits. | |
| 48. Le Renard et le reflet de la Lune. | |
| 49. Le Loup et le Corbeau. | |
| 50. Le Coq et le Renard. | |
| 51. Le Renard et le Pigeon. | |
| 52. L’Aigle, l’Épervier et les Pigeons. | |
| 53. Le Cheval affamé. | |
| 54. L’Homme, le Bouc et le Cheval. | |
| 55. Le Loup et l’Escarbot. | |
| 56. Le Rossignol et l’Épervier. | III, 5. |
| 57. Les Bergers et les Loups. | |
| {p. 777}58. Le Corbeau paré des plumes du Paon. | II, 15. |
| 59. Le Lion malade, le Loup écorché et le Renard. | |
| 60. Le Renard et l’Ourse. | |
| 61. Le Lion malade, le Renard et le cœur du Cerf. | |
| 62. Le Loup et le Hérisson poursuivis. | |
| 63. Le Paysan et le Bœuf. | |
| 64. L’Abeille et la Mouche. | II, 17. |
| 65. Les deux Loups. | |
| 66. Le Loup et le Renard jugés par le Lion. | |
| 67. La Chèvre et le Chevreau. | |
| 68. Le Peintre et sa Femme. | |
| 69. La Biche et son Faon. | |
| 70. Le Corbeau et ses petits. | |
| 71. Le Milan malade. | I, 19. |
| 72. La Chèvre et le Loup. | |
| 73. L’Homme et la Femme querelleuse. | |
| 74. L’Homme et la Femme noyée. | |
| 75. Le Maître et l’Esclave. | |
| 76. Le Singe et le Renard. | III, 19. |
| 77. Le Lion qui abdique et le Loup. | III, 22. |
| 78. Le Loup et le Berger. | III, 25. |
| 79. Le Paon et le Créateur. | III, 26. |
| 80. Le Berger et les Brebis. | III, 28. |
| 81. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 29. |
| 82. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | III, 30. |
| 83. L’Âne et le Lion. | III, 32. |
| 84. Le Lion malade et le Renard. | III, 34. |
| 85. L’Homme et le Lion. | III, 39. |
| 86. La Mouche et le Chameau. | III, 40. |
| 87. La Cigale et la Fourmi. | III, 41. |
| 88. La Corneille et le Bélier. | III, 43. |
| 89. Le Serpent et l’Homme. | I, 10. |
| 90. La Montagne en mal d’enfant. | II, 5. |
| 91. Le Chien vieilli et son Maître. | II, 7. |
| 92. Le Chauve et la Mouche. | II, 12. |
| 93. Le Renard et la Cigogne. | II, 13. |
| 94. La Mouche et la Mule. | II, 16. |
| 95. L’Homme et la Belette. | II, 19. |
| 96. La Grenouille qui s’enfle. | II, 20. |
| 97. Le Cheval et l’Âne. | III, 3. |
| 98. Le Renard et le Loup. | III, 6. |
| 99. Le Bœuf et le Veau. | III, 12. |
| 100. Le Marchand et l’Âne. | III, 20. |
| {p. 778}101. Le Cerf et les Bœufs. | III, 21. |
| 102. Le Renard et les Raisins. | III, 23. |
| 103. La Belette et les Rats. | III, 24. |
| 104. La Panthère et les Paysans. | III, 27. |
| 105. Le Cheval et le Cerf. | III, 31. |
| 106. Le Corbeau et les Oiseaux. | III, 33. |
| 107. La Corneille altérée. | III, 35. |
| 108. L’Enfant et la Couleuvre. | III, 36. |
| 109. L’Âne et le Loup. | III, 37. |
| 110. Les trois Chevreaux et le Bouc. | III, 38. |
| 111. Le Glaive perdu. | III, 42. |
| 112. Le Cerf, le Loup et la Brebis. | II, 11. |
| 113. Le Soldat et les deux Voleurs. | |
| 114. Le Riche et sa Fille. | |
| 115. L’Homme et le Serpent. | II, 10. |
| 116. Le Mulot qui cherche femme. | |
| 117. L’Escarbot vaniteux. | |
| 118. L’Âne et le Sanglier. | I, 11. |
| 119. Les Porcs et le Blaireau. | |
| 120. Le Loup pris au piège et le Hérisson. | |
| 121. Le Loup et le Batelier. | |
| 122. L’Épervier et la Chouette. | |
| 123. L’Aigle et l’Épervier fugitif. | |
| 124. Le Prêtre et le Loup. | |
| 125. La Vipère et la Lime. | III, 14. |
| 126. L’Hirondelle et les Moineaux. | |
| 127. Le Lièvre et le Cerf. | |
| 128. Le Loup et le Pigeon ramier. | |
| 129. Le Chat et le Renard. | |
| 130. L’Homme qui navigue sur mer. | |
| 131. Le Vieillard et son fils. | |
| 132. Le Chat mitré. | |
| 133. La Femme et sa Poule. | III, 8. |
| 134. Le Loup et le Renard, jugés par le Singe. | II, 18. |
| 135. Les Arbres qui se donnent un Roi. | |
| 136. Le Lion et ses Fils. |
Un des six manuscrits qui renferment ces fables, a été remarqué à l’Université de Göttingen par M. Oesterley, et c’est à lui que revient l’honneur d’avoir le premier songé à les faire paraître. Seulement, au lieu d’en faire une édition complète, il crut devoir ne publier, à la suite du Romulus Burnéien, que les fables, dont les sujets ne se trouvaient ni dans la collection de ce Romulus, ni dans celle du {p. 779}manuscrit de Leyde, ni dans celle du manuscrit de Wissembourg, ni dans le Romulus Roberti. Il en est résulté que des 134 fables contenues dans le manuscrit de Göttingen il n’a publié que 41.
Cette manière de procéder était beaucoup trop sommaire. En effet, les fables, qui, dérivées du Romulus anglo-latin, étaient par le fond communes aux quatre collections précédentes, avaient revêtu une forme souvent très différente, et leur publication n’eût pas constitué un double emploi. On en va pouvoir juger par les extraits comparatifs qui suivent et que j’emprunte à la fable du Corbeau et du Renard.
Premier extrait.
Leyde. Corvus cum de fenestra raptasset caseum et comesse vellet, celsa resedit in arbore.
Wissembourg. Cum de fenestra Corvus caseum sibi raperet, alta consedit in arbore.
Romulus primitif. Cum de fenestra Corvus caseum raperet, alta consedit in arbore.
Romulus de Robert. Corvus de fenestra quadam frustum casei recentis rapiens adsportavit, et ad nemus veniens in quercu resedit.
Dérivé complet du Romulus anglo-latin. Corvus perfidie pinguem caseum in villa furatus erat, et ad nemus reversus in summa quercu resedit.
Deuxième extrait.
Leyde. O quis tuarum, Corve, pennarum vigor est ? Si vocem haberes latiorem, nulla avium prior adesset tibi.
Wissembourg. O Corve, quis similis tibi, et pennarum tuarum quam magnus est nitor et quantum decor tibi inter omnes videtur ! Tu si vocem haberes claram, nulla avis tibi prior fuisset.
Romulus primitif. O Corve, quis similis tibi ? Et pennarum tuarum quam magnus est nitor ! Qualis decor tuus esset ! Si vocem habuisses claram, nulla prior avis esset.
Romulus de Robert. O miram pulchritudinem avis hujus ! Decenti statura corporis et nitore pennarum non esset ei comparabilis ulla avis, si vocis venustas responderet corpori.
Dérivé complet du Romulus anglo-latin. In tota vita mea non vidi avem tibi similem in decore, quia pennæ tuæ plus nitent quam cauda pavonis. Et oculi tui radiant ut stellæ, et rostri tui gratiam quis posset describere ? Si ergo vox tua dulcis esset et sonora, non video quomodo aliqua possit tibi similis inveniri, quæ scilicet tanto sit ornata decore.
Par ces rapprochements, on voit combien le dérivé partiellement {p. 780}publié par M. Oesterley diffère non seulement des trois dérivés directs de Phèdre, mais encore du Romulus Roberti. Il n’en a pas moins considéré ce Romulus comme un fragment du texte qu’il avait rencontré à Göttingen.
Cette inexplicable erreur n’est pas d’ailleurs la seule qui lui soit imputable. Il en a commis deux autres aussi étonnantes. Il a voulu voir dans la collection qu’il avait découverte le Romulus qui avait servi de base à la traduction anglaise, et, sans s’appuyer sur aucune raison probante, il lui a plu également de prétendre que c’était, non sur cette traduction, mais sur le Romulus lui-même, que Marie avait fait sa version française539.
Le prologue du dérivé que M. Oesterley avait sous les yeux, aurait dû lui faire apercevoir la fausseté de la première de ces deux hypothèses. Il est évident que l’auteur de la collection n’aurait pas pu, comme il l’a fait dans ce prologue, parler de la traduction anglaise, si cette traduction n’avait pas déjà été faite sur un Romulus plus ancien, et qu’il a dû emprunter ses fables à ce Romulus dont elles ont été, non pas la copie, mais l’imitation.
Quant au texte sur lequel Marie a fait sa version, c’est un point sur lequel je m’expliquerai plus loin. Quant à présent je me borne à faire remarquer qu’à moins de soutenir qu’elle a écrit un mensonge, on ne peut affirmer qu’elle l’a composée sur le texte latin ; car elle-même dans son épilogue déclare en ces termes que c’est de la traduction anglaise qu’elle a fait usage :
Pur amur le cumte Willaume,Le plus vaillant de cest royaume,M’entremis de cest livre feireEt de l’Angleiz en Roman treire540.
Après avoir réfuté les thèses fantaisistes de M. Oesterley, je ne dois pas passer sous silence une autre opinion que M. Gaston Paris a formulée sur l’origine du Dérivé complet et qui est en contradiction flagrante avec les textes eux-mêmes : il a vu dans ce dérivé, {p. 781}non pas une imitation du Romulus anglo-latin, mais une sorte de thème latin fait sur la version anglaise541.
Ce qui a conduit M. Gaston Paris à une erreur si singulière de la
part d’un esprit aussi judicieux que le sien, c’est la teneur du préambule, qui,
figurant en tête du Dérivé de 136 fables, y remplace la dédicace de Romulus à
son fils. On y lit ces phrases : Liber igitur iste primo græce
conscriptus est ab Æsopo ; post hæc a Romulo imperatore romano, ad instruendum
Tyberium filium suum, in latinum venit. Deinde rex Angliæ Affrus in anglicam
linguam eum transferri præcepit.
Ce que démontre ce texte, c’est que
le Dérivé de 136 fables, puisqu’il y est question de la version anglaise, l’a,
non précédée, mais suivie. Mais de là à en avoir été la traduction latine il y a
un abîme que la comparaison des textes rend infranchissable. En effet, si le
Dérivé de 136 fables était la traduction latine de la version anglaise, entre
son texte et celui du Romulus anglo-latin, il n’existerait aucun rapport ; et,
comme ce Romulus est lui-même issu du Romulus de Nilant, ce dernier et le Dérivé
complet seraient à plus forte raison dissemblables. Or, c’est le contraire qui
éclate aux yeux. Sans doute, le texte du Dérivé de 136 fables s’éloigne du
Romulus primitif beaucoup plus que celui du Romulus de Nilant ; mais ce dernier
et le Dérivé ont entre eux une parenté frappante établie par des expressions qui
ne sont communes qu’à eux.
Pour en fournir la preuve, je vais exhiber un exemple tiré de la fable de l’Hirondelle et des Oiseaux.
Romulus primitif. Spargi et arari lini semen aves omnes cum viderent, pro nihilo hoc habuerunt, Hyrundo autem hoc intellexit.
Romulus de Nilant. Jamdudum, cum omnes aves arari et spargi semen lini viderent, et pro nihilo hoc haberint, et periculum quod illis de hoc opere de cetero imminebat non perviderent, fabulæ ferunt Yrundinem hoc intellexisse.
Dérivé. Dum primo lina seminari videret hyrundo, futurum inde volucribus cognoscens periculum.
Dans le texte de Nilant se répètent sans changements très sensibles les expressions du Romulus primitif, tandis que dans le Dérivé on n’en rencontre que trois d’ailleurs assez modifiées ; car la première qui était au singulier reparaît au pluriel, la seconde qui était un substantif est devenue un verbe, la troisième qui était {p. 782}un verbe à la troisième personne du singulier est restée un verbe, mais à la troisième personne du pluriel. D’autre part, le Dérivé possède une expression qui n’existe pas dans le Romulus primitif, mais qui appartient au texte de Nilant, et qu’il n’offrirait pas, s’il ne se rattachait pas à ce dernier par une filiation évidente.
Non seulement il y a entre le Romulus de Nilant et le Dérivé de 136 fables une parenté palpable, mais encore je peux citer un cas, dans lequel, chose singulière, ce dernier se rapproche du Romulus primitif plus que le Romulus de Nilant lui-même. Je le trouve dans la moralité de la fable du Lion et de l’Âne chassant.
Romulus primitif. Hæc fabula monet derideri hunc potius deberi, qui virtute facere nihil valet et verbis inanibus putat se quemquam terrere posse.
Romulus de Nilant. Promythion : Profert subsequens fabula, quod multi insipientes et impotentes inaniter putant potentiores se et fortiores posse suis verbis inanibus comminari. — Épimythion : Et ideo potius deridendus est qui nihil propriis viribus facere valet, et tamen alios inanibus verbis comminatur.
Dérivé complet. Hæc fabula monet illos derideri, qui, cum viribus nil facere possunt, inanibus verbis se putant esse terribiles.
En produisant cet exemple, je comprends bien que je fournis, à l’avance, un argument non dénué de valeur à ceux qui voudront combattre ma thèse et prétendre que le texte de Nilant n’a pas donné naissance au Romulus anglo-latin. Mais il m’a semblé qu’il y avait là un acte de probité littéraire à accomplir, et je devais d’autant moins y manquer que ce que je désire, c’est avant tout le triomphe de la vérité.
Au surplus, je ne crois pas qu’on doive trouver, dans la révélation que je viens de faire, l’infirmation de la filiation que j’ai établie. En effet, si, sans sortir de la fable du Lion et de l’Âne chassant, on continue à comparer les textes, on voit clairement que celui de Nilant occupe une position intermédiaire entre celui du Romulus primitif et celui du Dérivé complet. Je vais le démontrer par quelques citations :
Romulus primitif. Ascendamus in cacumina montis, et ostendam tibi quia et me multi timent. — Cui Leo contra sic dixisse fertur : Poterat et me terrere vox tua, si son scirem quis esses.
Romulus de Nilant. Ascendamus in cacumina montis, et ostendam {p. 783}tibi quia multæ Bestiæ me timent. — Cui Leo e contrario sic dixisse fertur : Si te non nossem quis esses, posset me terrere vox tua.
Dérivé complet. Veni mecum in proximum montem, et ostendam tibi quod etiam de me timorem habebunt. — Cui respondit Leo : Non miror quod terres bestias quæ te non noverunt. Quæ si te nossent sicut ego, non utique te timerent, sicut nec ego te timeo.
Si, au lieu de citer ainsi des extraits, j’avais transcrit entièrement les trois versions de la fable du Lion et de l’Âne chassant, la démonstration aurait été encore plus probante ; on aurait mieux vu le Romulus de Nilant d’une part se rapprocher du Romulus primitif beaucoup plus que le Dérivé complet, et d’autre part offrir des expressions qui, étrangères au Romulus primitif, lui sont communes avec ce Dérivé.
Maintenant, sans prétendre expliquer comment dans cette fable ce dernier par son épimythion est, plus que le Romulus de Nilant, conforme au Romulus primitif, je suis porté à penser que quelque copiste aura, à une époque antérieure au xive siècle, substitué, en l’altérant, à l’épimythion du Dérivé celui du Romulus primitif qui ensuite aura été maintenu dans les manuscrits postérieurs.
En résumé, deux choses sont bien démontrées, à savoir : que le Dérivé complet ne doit pas être confondu avec le Romulus anglo-latin, et que ce n’est pas davantage sur la traduction anglaise que ce dernier a été composé.
J’aurais pu, à la rigueur, me dispenser de justifier ces deux solutions qui ressortaient suffisamment de tout ce qui avait été déjà dit dans la section IV de ce chapitre.
J’aurais fini, si je ne tenais pas à fixer un dernier point. En étudiant le Romulus Roberti, non seulement j’ai, ce qui n’était peut-être pas bien nécessaire, établi qu’il n’était pas né du Dérivé complet, mais encore j’ai, ce qui était peut-être moins évident, prouvé qu’il n’en avait pas non plus été le père. Allant maintenant plus loin, je crois pouvoir ajouter que le Dérivé complet, quoique moins conforme au Romulus anglo-latin, non seulement n’est pas issu du Romulus Roberti, mais encore est plus ancien que lui. Ce qui, au premier abord doit ou peut porter à croire que le Romulus Roberti est le frère aîné du Dérivé complet, c’est que, comme on l’a vu, son texte est moins éloigné que celui de cette collection du texte du Romulus anglo-latin. Mais ce serait tirer d’un fait vrai une {p. 784}déduction fausse. Rien n’empêche en effet que, tout en étant plus que son co-dérivé l’image du Romulus anglo-latin, le Romulus Roberti ne soit plus récent. Sa similitude plus grande s’explique aisément par ce fait qu’à l’époque où il a été composé le Romulus anglo-latin n’avait pas encore disparu.
Quelque chose montre que le Dérivé partiel ne doit pas être de beaucoup antérieur aux deux manuscrits du xive siècle qui le renferment. Tandis que, dans la fable du Lion malade, telle que la possède le Dérivé complet, le Loup et le Renard sont appelés Lupus et Vulpecula, expressions qui appartiennent à la bonne latinité, le Romulus de M. Robert, dans la même fable, donne au Loup le nom d’Ysengrinus et au Renard celui de Renardus. Or ces noms, ainsi que M. Oesterley542 le constate lui-même, n’ont guère été employés qu’à partir du xiiie siècle. C’est ainsi, par exemple, que Marie de France, qui écrivait à la fin du xiie siècle ou, au plus tard, au commencement du suivant, n’appelle pas, dans sa traduction de la même fable, le Loup autrement que Leu, Leus, Lox, Los et Lous, ni le Renard autrement que Werpill, Gourpis, Golpiz, Goupil et Hopirs. À moins donc qu’on ne suppose que, dans le manuscrit 347 C, le scribe, en exécutant sa copie, a substitué, dans la fable 21, les noms d’Isengrinus et de Renardus à ceux de Lupus et de Vulpes ou Vulpecula, on doit admettre que le Romulus Roberti est postérieur à son co-dérivé, dans lequel les appellations anciennes ont au contraire été maintenues543.
Les seuls manuscrits du Dérivé complet que j’aie pu découvrir sont les sept suivants :
1º Le manuscrit 1108 de la Bibliothèque de la ville de Trèves ;
{p. 785}2º Le manuscrit 1107 de la même Bibliothèque ;
3º Le manuscrit 215 num. loc. 11 de la même Bibliothèque ;
4º Le manuscrit Theol. 140 de la Bibliothèque de l’Université de Göttingen ;
5º Le manuscrit Theol. 126 de la même Bibliothèque ;
6º Le manuscrit 536 de la Bibliothèque royale de Bruxelles ;
7º Le manuscrit 15. A. VII de la Bibliothèque du British Museum.
1º Manuscrit 1108 de la bibliothèque communale de Trèves. §
Le manuscrit 1108, autrefois CV, est celui par lequel je commence mon analyse, d’abord parce que c’est le plus ancien, ensuite parce que la collection du Dérivé complet du Romulus anglo-latin s’y trouve entière.
Il forme un volume du petit format in-fol., dont les 4 premiers
feuillets sont en parchemin et les autres en papier et dont l’écriture à
longues lignes est du commencement du xive siècle. Sur le recto du premier feuillet on lit l’ex libris suivant, écrit sans doute par un des moines du couvent
bénédictin auquel il a appartenu : Codex Monasterii sancti
Mathie apostoli.
Sur la même page, le contenu du volume est
indiqué en ces termes :
Liber fabularum Esopi cum moralisacionibus atque picturis.
Item Tractatus de variis gentium regnis et bellis et de terra sancta.
Item Summa in foro penitentiali domini Beringarii episcopi.
Item Summa eiusdem Beringarii.
Item pulchre deductiones quomodo beata Maria virgo assimilatur Soli et Lune et stellis.
Item quedam miracula.
Le Dérivé complet, qui esi le premier ouvrage contenu dans le
manuscrit, commence au haut du verso du premier feuillet par ce premier titre
qui surmonte le prologue : Incipit prologus cuiusdam in
librum fabularum Esopi.
Puis vient un second titre qui est
ainsi conçu : Incipiunt fabule Esopi
prosaïce.
Le feuillet en parchemin sur lequel se trouvent le
prologue et la première fable, est moins ancien que les autres. Il a été
substitué au premier feuillet primitif, qui sans doute avait été détruit.
Quoique moins ancienne que celle qu’elle a remplacée, l’écriture du premier
feuillet actuel est du xive siècle. Elle
s’arrête avant le bas de la page, où, pour l’illustration de la première
fable, avait été ménagé un espace blanc non rempli.
Les fables sont au nombre de 136, c’est-à-dire que la collection {p. 786}est complète. Chaque fable est surmontée d’un titre écrit à l’encre rouge et suivie d’un dessin à la plume grossièrement exécuté et encore plus mal enluminé par le copiste.
À la suite des 136 fables du Dérivé complet vient sans interruption la version en prose latine de seize fables d’Avianus, dont voici les titres :
1. De Muliere Filium flentem Lupo promittente.
2. De Testudine et Aquila.
3. De Cancero et eius matre.
4. De Vento et Sole.
5. De Asino et Domino.
6. De Rana medica.
7. De Cane nolam portante.
8. De duobus Sociis coniuratis.
9. De Caluo milite.
10. De Agricola et Auro.
11. De Leone et Tauro,
12. De Jupitro (sic).
13. De Quercu et Canna.
14. De Jupitre (sic).
15. De Puero et Fure.
16. De Viatore et Satyro.
Ces seize fables sont suivies de ces deux ineptes distiques placés au bas du feuillet 56 b :
Quem semel horrendis maculis infamia nigrat,Ad bene tergendum multa laborat aqua…Ad fraudis tel[a] te fraudis tegmine vela ;Uti sic scuto non scelus esse puto.
Enfin la collection se termine au haut du feuillet 57 a par la moralité d’une dernière fable qui est étrangère à Avianus et dont voici le texte :
De Vulpe. Lupus cucullatus ypocrita est. Unde in evangelio : Attendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Vulpes vero virum discretum significat qui de facili non fallitur. Unde :
Grandior incauto virtus, sed parvula VulpesPlenius angusta sub brevitate sapit.
Je termine cette analyse par une dernière observation : par une {p. 787}inadvertance que le copiste, en tournant à la fois deux des pages de son cahier, a involontairement commise, les feuillets 32 b et 33 a sont restés entièrement blancs.
2º Manuscrit 1107 de la bibliothèque communale de Trèves. §
Ce manuscrit, qui auparavant a porté la cote LXXVII et plus anciennement la cote IV. 26, forme, comme le précédent, un volume in-fol. de petit format, dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture à longues lignes paraît être de la fin du xive siècle.
Il renferme plusieurs ouvrages disposés dans l’ordre suivant :
1º [Æsopi fabulæ.]
2º Exemplum de tribus latronibus.
3º Tractatus discipuli Wykleff et Hus contra mendicantes condempnatus.
4º Incipit liber de officio sacerdotis.
5º Isti sunt casus in quibus summa excommunicationis maior fertur a iure conpositi per dominum Berengarium cardinalem et episcopum Tusculanum.
6º [Sermo.]
7º Clemens quintus.
Les fables du Dérivé complet occupent les cinquante-quatre
premiers feuillets. Comme dans le manuscrit 1108, elles sont pourvues de
titres à l’encre rouge et ornées par le scribe d’illustrations à la plume
aussi grossièrement dessinées qu’enluminées. Elles ne sont qu’au nombre
de 135, c’est-à-dire qu’il en manque une, celle qui dans le manuscrit 1108 est
la cent trente et unième intitulée : De Sene et eius
Filio.
Les fables du Dérivé sont, comme dans le manuscrit 1108, suivies de seize autres en prose dérivées d’Avianus et de l’épimythion d’une dix-septième également en prose étrangère à ce fabuliste. Par erreur, les deux premières de celles qui sont dérivées d’Avianus ont été placées avant les trois dernières du Dérivé complet.
Pour quiconque a pu les voir, les deux manuscrits que je viens d’analyser ont entre eux un air de famille qui frappe. Après les avoir comparés, je crois pouvoir affirmer qu’ils sont la copie l’un de l’autre. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder leurs illustrations identiques par le dessin et même par le coloris. S’ils avaient été copiés sur un troisième, cette identité obligerait à supposer que ce dernier était lui-même orné des mêmes dessins pareillement coloriés ; ce qui n’est guère vraisemblable.
{p. 788}Quant à celui des deux qui a été copié sur l’autre, le doute ne me paraît pas davantage possible ; c’est celui qui porte la cote 1107. En dehors de celle que donne la différence d’âge, les preuves abondent ; pour abréger, je n’en fournirai que quelques-unes :
1º Le manuscrit 1108 possédant une fable de plus que le manuscrit 1107, il est tout naturel d’en conclure que c’est ce dernier qui est la copie de l’autre.
2º Dans le manuscrit 1107 les deux collections ayant été mélangées, le scribe qui l’aurait copié n’aurait pu rétablir dans sa copie l’ordre détruit dans son modèle.
3º Dans quelques endroits, rares il est vrai, le scribe du manuscrit 1107, qui sans doute ignorait le latin, a laissé des espaces blancs pour les mots qu’il ne pouvait pas lire, et cependant ces mots se trouvent dans le manuscrit 1108, qui dès lors n’a pu être la copie de l’autre. C’est ainsi que l’avant-dernière fable du recueil, intitulée De Viatore et Satyro, présente trois espaces blancs destinés à trois mots omis.
4º Dans d’autres endroits le scribe du manuscrit 1107 a passé par inadvertance des mots qui sont lisibles dans le manuscrit 1108 et pour lesquels il n’a réservé aucune place. Je peux citer comme exemple la fable De Vulpe et Ursa, dans laquelle les mots et lenta, d’abord oubliés, ont ensuite été ajoutés en marge.
Malgré leur parenté, les deux manuscrits ne sont pas parvenus
par la même voie à la bibliothèque de Trèves. Les ex libris
que porte le manuscrit 1107 montrent qu’il a subi de nombreuses vicissitudes.
Sur la face intérieure du premier des plats on lit : Iste
liber pertinet domino Petro zum Raben.
À une époque
postérieure une autre main a ajouté : Nunc autem Nicolao
Luysth presbitero Treverensi.
Enfin au bas du recto du
premier feuillet l’indication des deux derniers propriétaires est donnée par
ce troisième ex libris : Bertrandus
dedit collegio societatis Jesu Treverensis anno 1571.
Ce manuscrit n’existe plus à la bibliothèque de Trèves. Lors de la visite que j’y ai faite en 1881, je n’ai plus revu les deux bibliothécaires que j’y avais antérieurement trouvés. Ils étaient morts et avaient laissé la bibliothèque dans le plus complet désarroi. Leur successeur a, pour me le communiquer, vainement cherché le manuscrit. Malgré le désordre qu’il n’avait pu encore faire cesser et qui pouvait expliquer l’insuccès de ses recherches, il était supposable {p. 789}que, si la bibliothèque l’avait encore possédé, il l’aurait retrouvé. En 1889, étant retourné à Trèves, j’ai acquis, par une mention inscrite sur le catalogue de la Bibliothèque, la certitude qu’il était irrévocablement perdu.
3º Manuscrit 215. num. loc. 11 de la Bibliothèque communale de Trèves. §
Ce manuscrit forme un volume in-4º, dont les feuillets sont partie en papier, partie en parchemin et dont l’écriture est du xve siècle.
Le catalogue de la Bibliothèque donne en ces termes la nomenclature des ouvrages qu’il contient :
1º Sermo de passione domini, incerti auctoris.
2º Speculum peccatorum.
3º Sermones diversi.
Praeterea insunt Aesopi et Aniani fabulae.
La dernière partie du manuscrit est occupée par deux collections de fables, le Dérivé complet du Romulus anglo-latin et le Dérivé d’Avianus en prose latine qui en est le complément habituel.
Le premier, qui est précédé de la préface ordinaire, ne porte
aucun titre général ; mais les fables y sont pourvues de titres particuliers
et se terminent au bas d’une page par cette souscription : Explicit liber fabularum quas esopus grecus homo ingeniosus studiose
collegit.
Puis vient, au haut de la page suivante, le Dérivé d’Avianus
sans titre général, mais avec des titres spéciaux à chacune des quarante-cinq
fables dont il se compose. Plus nombreuses que dans les autres manuscrits,
elles donnent une valeur plus grande à celui qui les renferme. Sur les
45 fables, 37 seulement sont la paraphrase de celles d’Avianus ; ce sont les
fables i à xvi, xxi à xl
et xlv. Trois des huit autres sont dérivées de celles de Walther.
Le tout est clos par cette souscription écrite à l’encre rouge : Explicit Auianus de fabulis deo gracias
, etc.
Les deux collections de fables sont suivies de deux tables des
matières intitulées, l’une : Capitula de
Esopo
, l’autre : Incipiunt capitula de
Auiano.
Finalement se lit cet usuel hexamètre léonin qui a été souvent signalé dans ce volume :
Finito libro, sit laus et gloria Christo.
4º Manuscrit Théol. 140 de la Bibliothèque de l’Université de Göttingen. §
Ce manuscrit qui est classé dans les manuscrits théologiques sous le nº 140, forme un volume in-fol. de petite dimension dont l’écriture à deux colonnes est de la première moitié du xve siècle.
Il renferme, entre autres ouvrages, le Dérivé complet du Romulus anglo-latin, qui s’étend du feuillet 36 a, 1re col. au feuillet 65 b, 2e col. et qui est suivi d’une version en prose des fables d’Avianus aussi complète que celle du manuscrit précédent.
Le feuillet 36 et le recto du feuillet 37 sont occupés tout
entiers par deux tables des matières, celle du Dérivé complet et celle des
fables en prose tirées d’Avianus. La première de ces deux tables porte ce
titre : Incipit Registrum Esopi in librum
faubularum
(sic), et se termine par cette souscription :
Explicit registrum fabularum Esopi
, qui
se lit vers le haut de la première colonne du feuillet 37 a.
Elle est immédiatement suivie de la table de la seconde série de fables qui
est surmontée de ce titre : Incipit Registrum fabularum
Auiani
, et qui, au bas de la deuxième colonne du
feuillet 37 a, se termine par cette souscription :
Explicit registrum fabularum Auiani.
À la suite des deux tables viennent les fables dérivées du
Romulus anglo-latin, dont le prologue annoncé par ces mots : Sequitur prologus Esopi in librum fabularum
,
commence en tête de la première colonne du feuillet 37 b et
qui sont seulement au nombre de 134. La collection, pour être complète,
devrait en posséder deux de plus, celles qui, dans la nomenclature
précédemment établie, portent les nos 7 et 60. Il me
paraît évident que c’est intentionnellement qu’elles ont été négligées ; en
effet, la première fait double emploi avec la fable 6, De Leone,
Bubalo et Lupo, et la seconde est d’une obscénité qui en explique
aisément l’omission.
Le copiste à qui sont dues ces suppressions ne s’en est pas
tenu là ; il a cru devoir faire au texte quelques corrections. Enfin, on lui
doit aussi des additions ; c’est ainsi que, dans la fable 62 intitulée :
Quomodo apes et musca contenderunt de
dignitate
, il a allongé l’affabulation primitive par les
emprunts suivants faits à la fable xxxvii de Walther :
Unde dicit Musca :
Dat tibi terra domum, nobilis aula mihi.Deliciæ sunt grana tuæ, me regia nutrit{p. 791} Mensa ; bibis feces, sed bibo lene merum.Tu bibis a limo sitim (sic), mihi suggerit aurumQuo[d] bibo ; saxa premis, regia terga premo.Reginæ teneris oscula figo genis.Et respondet Apis :
Sunt tibi multa parum, sunt mihi pauca satis.Plus mihi grana placent quam tibi regis opes.Cum nulli noceam, cuilibet ipsa noces.Est mea parcendi speculum, tua vita nocendi.Ut comedas vivis, comedo ne vivere cessem.Dulcia vina bibes, fel bibes ergo necis.Item :
Dulcia pro dulci, pro turpi turpia reddiVerba solent, odium lingua fidemque parare (sic).
Les fables sont terminées par cette souscription : Explicit liber fabularum quas Esopus grecus homo ingeniosus
studiose collegit.
Immédiatement après viennent les fables
dérivées d’Avianus. Seulement, au lieu de n’en présenter que seize augmentées
de l’épimythion d’une dix-septième d’origine différente, le manuscrit en
possède quarante-deux, presque toutes issues de ce fabuliste et, par suite,
mérite de ce chef une attention toute particulière.
5º Manuscrit Théol. 126 de la Bibliothèque de l’Université de Göttingen. §
Ce n’est pas seulement le manuscrit Théol. 140 qui, à la Bibliothèque de l’Université de Göttingen, renferme le Dérivé complet du Romulus anglo-latin ; il se trouve également dans un autre manuscrit qui, dans la même classe, porte le nº 126.
Ce manuscrit, comme le précédent, est un volume in-fol. de petit format, composé de 194 feuillets en papier, dont l’écriture à deux colonnes est du xve siècle.
Il contient plusieurs ouvrages. On y trouve notamment, du feuillet 98 a au feuillet 122 b, les fables de saint Cyrille, du feuillet 123 a au feuillet 126 a, une bonne partie de ces fables en prose dérivées d’Avianus qui, dans les manuscrits, viennent ordinairement à la suite du Dérivé complet du Romulus anglo-latin, enfin du feuillet 127 b au feuillet 145 a, les fables elles-mêmes de ce Dérivé.
Ces dernières paraissent avoir été copiées sur un manuscrit
plus pur, ou, si l’on veut, plus littéralement exact que celui sur lequel ont
été prises celles du manuscrit Théol. 140. Ainsi, par exemple, comme dans les
autres manuscrits, tels que celui de Bruxelles et {p. 792}celui de Trèves 1108, dans le manuscrit Théol. 126 la fable du Renard et du
Corbeau commence par ces mots : Corvus perfidie pinguem
caseum
, etc. Au contraire, dans le manuscrit Théol. 140, le
mot perfidie a disparu.
Malheureusement la collection n’est pas complète. Jusqu’à la soixantième fable le copiste a respecté l’ordre ordinaire et n’a presque rien omis ; il a même conservé les fables vii et lx qui n’existent pas dans le manuscrit Théol. 140. Mais ensuite, soit qu’il ait voulu faire un choix parmi celles qu’il avait encore à transcrire, soit qu’il n’ait eu lui-même en sa possession qu’un manuscrit incomplet, il en a négligé un certain nombre et, pour celles qu’il a retenues, il ne s’est pas conformé au classement usuel. C’est ainsi qu’il a placé le dernier le groupe tiré du Romulus primitif qui n’était pas entré dans le Romulus anglo-latin et qui, par suite, n’a pas été traduit par Marie de France.
6º Manuscrit 536 de la Bibliothèque royale de Bruxelles. §
Ce manuscrit fait partie d’un gros volume in-fol., qui, contenant plusieurs ouvrages, porte les cotes 531 à 536, dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture à deux colonnes est du xve siècle.
Conformément à l’usage adopté dans la Bibliothèque, il lui a
été donné autant de numéros qu’il s’y trouve d’ouvrages différents ; malgré
cela il a été catalogué sous ce seul titre général : Psalterium cum glosis et tractatus varii.
Le Dérivé complet du Romulus anglo-latin qu’il contient commence à la première colonne du feuillet 1 a et se termine à la première colonne du feuillet 26 a.
Il débute par son prologue ordinaire, qui est annoncé par ce
titre à l’encre rouge : Incipit prologus esopi in librum
fabularum.
Puis viennent les fables précédées elles-mêmes de ce titre
également écrit à l’encre rouge : Incipit liber fabularum
quos (sic) Esopus grecus homo ingeniosus studiose
collegit et litteris eas commendari pulchrum indicauit et
utile.
Elles sont au nombre de 136, et chacune d’elles est
pourvue d’un titre toujours écrit à l’encre rouge. Enfin elles sont suivies
des dix-sept fables en prose qui ont déjà été mentionnées dans l’analyse du
manuscrit 1108 de la Bibliothèque de la ville de Trèves.
Ces dix-sept fables ne sont séparées et distinguées des
premières que par ces deux mots : Incipit
Auianus.
Elles commencent à la {p. 793}première colonne du feuillet 26 a et se terminent à la
deuxième du feuillet 28 b.
Depuis la publication de ma première édition je me suis procuré une copie complète du texte contenu dans le manuscrit 215 de la Bibliothèque de Trèves ; néanmoins, comme c’est toujours le manuscrit de Bruxelles qui me paraît renfermer le texte le plus conforme aux leçons primitives, c’est encore ce dernier que je suivrai.
7º Manuscrit 15. A. VII de la Bibliothèque du British Museum. §
Au British Museum la collection du Dérivé complet du Romulus
anglo-latin est contenue dans un manuscrit in-4º du xive siècle, coté 15. A. VII et composé de 84 feuillets en
parchemin, qui portent sur deux colonnes une écriture très fine. Les fables
occupent les feuillets 77 a à 83 a.
Malheureusement, elles sont incomplètes et s’élèvent seulement au nombre
de 56. Elles sont précédées de leur prologue ordinaire, mais ne portent ni
titre général applicable à la collection, ni titres spéciaux applicables à
chacune d’elles. Quoique la dernière inachevée montre que le copiste avait ou
copié un manuscrit incomplet ou laissé sa besogne imparfaite, il l’a fait
suivre de cette souscription : Expliciunt
ethisi.
Sauf les variantes que, lors même qu’ils renferment le même texte, les manuscrits ne manquent jamais de présenter, les quarante-neuf premières fables du manuscrit 15. A. VII sont les mêmes que les quarante-neuf premières des manuscrits complets du Dérivé. Il en est autrement des sept dernières ; en effet, par les sujets elles correspondent bien toutes à celles du Dérivé ; mais par la forme, elles en diffèrent. En voici les titres :
| Ms. 15. A. VII. | Dérivé complet. | Romulus primitif. |
| 50. La Femme et sa Poule. | 133. | III, 8. |
| 51. Le Chauve et la Mouche. | 92. | II, 12. |
| 52. Le Lion Roi et le Singe. | 77. | III, 22. |
| 53. La Grenouille qui s’enfle. | 96. | II, 20. |
| 54. Le Singe et le Renard. | 76. | III, 19. |
| 55. Le Renard et les Raisins. | 102. | III, 23. |
| 56. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | 82. | III, 30. |
Comme ces sept fables présentent un texte, qui, malgré la similitude des sujets, n’est ni celui du Dérivé complet, ni celui du Romulus primitif, mais qui paraît issu de ce dernier, je les publierai dans le second volume de cet ouvrage.
1º Traduction de Gérard de Minden. §
Il y avait déjà plus d’un siècle et demi que Marie de France avait fait sa traduction en vers romans, lorsqu’en 1370 un certain Gérard de Minden écrivit à son tour en bas-allemand une traduction poétique des fables latines dérivées du Romulus anglo-latin.
Cette traduction existe dans un manuscrit du xve siècle, qui appartient à la bibliothèque de la ville de Magdebourg, qui, paraît-il544, a été analysé, par M. Fr. Viggerts dans la Deuxième Série des éléments pour la connaissance des anciens écrits et de l’ancienne langue allemande (Magdebourg, 1836) et qui a été enfin publié par M. Seelmann dans les Niederdeutsche Denkmäler, à Brême, en 1878. Je ne connais pas ce manuscrit et je ne puis le décrire. Mais je dois réfuter les erreurs qu’il a procuré à M. H. Oesterley l’occasion de commettre.
Il prétend, comme je l’ai déjà dit page 780, qu’il ne faut pas ajouter foi à la déclaration de Marie qui affirme avoir composé sa traduction sur une première version anglaise, et il ajoute que son œuvre et celle de Gérard de Minden ont la même origine, et que la source à laquelle ils ont puisé est la collection contenue dans le manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Göttingen.
Se faisant un titre de gloire de la découverte de ce manuscrit,
dont la collection a servi de texte aux traductions allemandes de Gérard et
d’un autre poète, il s’exprime en ces termes : « C’est à moi qu’il a
réussi de découvrir un type du modèle qui a inspiré à la fois Marie et les
deux poètes bas-allemands, type qui résout définitivement tous les
doutes545. »
Je pourrais rappeler que, la même
collection de fables se trouvant plus complète dans plusieurs autres
manuscrits que j’ai analysés et dont M. H. Oesterley n’a pas soupçonné
l’existence, il attache une importance un peu trop grande a sa prétendue
découverte. Mais je ne veux pas troubler sa satisfaction {p. 795}et je me borne à examiner la valeur de son opinion sur la
communauté d’origine des deux traductions française et allemande de Marie de
France et de Gérard de Minden.
Il n’est pas douteux que la collection contenue non seulement dans le manuscrit Th. 140 de Göttingen, mais encore dans six autres manuscrits, est bien celle sur laquelle le poète allemand a travaillé, et j’en trouve la preuve incontestable dans les renseignements fournis par M. H. Oesterley lui-même. J’ai précédemment expliqué, pages 725 et suiv., que le Romulus anglo-latin sur lequel le roi Henri Beau-Clerc avait fait sa traduction anglaise, ne comprenait que 114 fables, c’est-à-dire un nombre sensiblement inférieur à celui du Dérivé complet, et que par suite ce Dérivé contenait bien des fables étrangères au Romulus dont il était issu.
M. Oesterley déclare que la traduction allemande de Gérard comprend 103 fables, c’est-à-dire un nombre de fables inférieur à celui de la collection latine du manuscrit par lui découvert ; mais il ne s’en tient pas là : il prend la peine de donner dans un tableau comparatif546 les titres de 86 des fables allemandes. De ces titres il ressort que sur les 86 fables il y en a 19 qui sont étrangères au Romulus anglo-latin et qui au contraire appartiennent toutes au Dérivé complet. En voici la liste :
| Gérard de Minden. | Dérivé complet. | ||
| 1. Le Lion et le Berger. | 23. | 25. | |
| 2. Le Cheval et le Lion. | 24. | 26. | |
| 3. Le Loup et les Brebis. | 32. | 31. | |
| 4. L’Oiseleur et les Oiseaux. | 74. | 81. | |
| 5. La Montagne en mal d’enfant. | 51. | 90. | |
| 6. Le Chien vieilli et son maître. | 52. | 91. | |
| 7. Le Chauve et la Mouche. | 50. | 92. | |
| 8. Le Renard et la Cigogne. | 76. | 93. | |
| 9. Le Cheval et l’Âne. | 59. | 97. | |
| 10. Le Renard et le Loup. | 60. | 98. | |
| 11. Le Mauvais Fils. | 82. | 99. | |
| 12. Le Marchand et l’Âne. | 63. | 100. | |
| 13. La Belette et les Rats. | 70. | 103. | |
| 14. La Panthère et les Paysans. | 71. | 104. | |
| 15. Le Cheval et le Cerf. | 61. | 105. | |
| 16. L’Enfant et le Serpent. | 98. | 108. | |
| {p. 796}17. L’Âne malade et le Loup. | 72. | 109. | |
| 18. Le Glaive perdu. | 73. | 111. | |
| 19. Le Loup et le Renard jugés par le Singe. | 102. | 134. | |
Il résulte clairement de ce tableau que la traduction allemande a bien été faite sur la collection latine, à laquelle j’ai donné la qualification de Dérivé complet, et sur ce point je suis d’accord avec M. H. Oesterley. Mais il ne s’en est pas tenu là : il n’a pas hésité à affirmer que Marie de France et Gérard de Minden avaient composé leurs traductions sur le même texte latin. Marie de France ayant déclaré qu’elle avait fait sa traduction sur une version anglaise, il s’inscrit en faux, timidement il est vrai, contre cette affirmation formelle547, et cherche immédiatement à justifier la grave attitude qu’il a prise. Mais, ne voulant pas pour cela prendre beaucoup de peine, il se contente d’examiner le prologue et l’épilogue de Marie et de les comparer au prologue de Gérard. Il extrait du prologue de Marie les vers suivants :
Romulus qui fu emperère,A sun fill escrit è manda,E par essample li mustra,Cum il se puist contreguetier,K’hum ne le peust engingnier.Izopes escrit à sun mestreKi bien quenust lui è sun estre,Unes fables k’il ot truvéesDe griu en laitin translatées.
Il cite ensuite ces vers de l’épilogue :
Pur amur le cumte Willaume,Le plus vaillant de cest royaume,M’entremis de cest livre feireEt de l’angleiz en roman treire.Ysopet apeluns ce livreQu’il traveilla et fist escrire ;De griu en latin le turna.Li rois Alvrez qui moult l’amaLe translata puis en engleizEt jeo l’ai rimé en franceiz.
{p. 797}Puis il rapproche de ces deux extraits les vers suivants du prologue de Gérard :
De Koning de van erst Rome stichte,het bringen erst al dit gedichtevan krekeschen in dat latin,to lerende de kinder sin.De Koning Affrus van Engelant,do he de kunst daran bevant,heit he id bringen altobant,dat id al den sinen wart bekant548.
Qu’il y ait une certaine analogie entre les deux premières
citations et la troisième, cela n’est pas douteux ; mais cela ne prouve rien.
Le traducteur anglais avait trouvé dans son modèle latin un prologue qu’il
avait interprété, et cette interprétation avait ensuite servi de base à celui
de Marie, qui enfin dans son épilogue avait parlé de la version anglaise
employée par elle. Il est évident qu’elle n’aurait pas procédé ainsi, si elle
avait composé sa traduction sur le Dérivé complet ; car alors, trouvant dans
le prologue de ce Dérivé l’indication de la version anglaise, c’est aussi dans
son prologue qu’elle en aurait parlé. Elle aurait fait comme le poète
allemand, qui, voyant en tête du Dérivé complet le prologue qui le précède,
l’a littéralement traduit. En effet, dans le prologue du Dérivé complet on
lit : « Liber… iste primo grece conscriptus est ab Esopo ; post hoc a
Romulo imperatore romano ad instruendum filium suum Tyberium in latinum
venit. Deinde rex Anglie Affrus in anglicam linguam eum transferri
precepit. »
Que l’on veuille bien comparer ces phrases à celles de
l’extrait tiré du prologue de Gérard de Minden, et l’on verra que ce dernier
les a dans sa version littéralement suivies.
En résumé, voici ce qui s’est passé : le Romulus anglo-latin a d’abord été composé en Angleterre, et je crois pouvoir ajouter qu’il ne s’est pas propagé au dehors. Ce Romulus, composé en Angleterre, y fut traduit en langue anglaise, et c’est dans ce pays que Marie de France, trouvant la traduction anglaise, l’a mise en vers français. Puis le Romulus anglo-latin a subi la loi commune : il a {p. 798}été imité, et, tandis qu’il restait oublié en Angleterre, son Dérivé complet accueilli avec plus de faveur s’est répandu hors de ce pays, principalement en Allemagne ; ce qui le prouve, c’est que des six manuscrits que j’en ai rencontrés sur le continent, les villes de Güttingen et de Trèves en possèdent cinq. Alors est survenu Gérard de Minden, qui, rencontrant en Allemagne un des manuscrits du Dérivé latin, en a fait au xive siècle en bas-allemand la traduction poétique, et qui, en la faisant ainsi, l’a tirée d’une source différente de celle précédemment employée par Marie de France.
2º — Traduction anonyme. §
En parlant de Gérard de Minden, j’ai dit incidemment qu’un
second poète avait, comme lui, traduit en bas-allemand les fables latines
dérivées du Romulus de Marie. Cette seconde version, probablement un peu moins
ancienne que la précédente, se trouve dans un manuscrit de la fin du
xve siècle appartenant à la bibliothèque de
Wolfenbüttel, où il a reçu, non pas, comme le dit par erreur M. Oesterley, la
cote Nov. 246549, mais la cote 997 Novi.
« Le manuscrit, dit M. Oesterley550, contient encore 125 chapitres, bien qu’il
ait perdu par le retranchement de trois cahiers à la fin un assez grand
nombre de fables ; toutefois il est possible aussi que les feuillets qui
manquent soient demeurés vides ou aient été remplis autrement. »
Les fables sont précédées d’un prologue ainsi conçu :
Esopus eyn wys greke wasInd wonde zo athenas ;Van synne witten hey was kloch,Des screff sey mannich kunstich bochByspele hey zon besten screyff,Die velen luden noch sin leyff.We dere böme sunne vnd maenSprochen hant vnd vil gedaen.Dass en doch nyt egen en is,Dat gedichte hat doch lere wijs,Wat dat der fabel nit wair en sy,{p. 799}Doch ist dar schoine lere by.Die gude sproche geuen kanMeister esopus dus heuet an.
Ces vers peuvent se traduire ainsi : « Ésope était un
sage grec || et habitait à Athènes ; || il avait un esprit ingénieux, || et
a écrit beaucoup de livres artistiques, || pour servir d’exemple à son fils,
|| lesquels sont encore inconnus de bien des gens. || On y voit les Arbres,
le Soleil et la Lune || parler et se mouvoir beaucoup. || Quoique ces
inventions soient sans fondement, || elles comportent une sage morale, || et
si la fable n’est pas véridique, || elle donne d’excellents enseignements.
|| Pour ceux qui veulent entendre de bons préceptes || maître Ésope se
montre aujourd’hui. »
Quant aux 125 fables, M. H. Oesterley, dans le tableau dont j’ai déjà parlé, les a fait figurer toutes à l’exception d’une seule, la quatre-vingt-dix-neuvième, qui sans doute n’avait pas la même origine que les 124 autres. Toutes ces dernières sans exception se rapportent à celles du Dérivé complet ; il y en a même deux qui sont la traduction de la même fable : ce sont les fables xxiii et cxvi ; ce qui en réalité réduit à cent vingt-trois le nombre des fables latines interprétées par les allemandes. Si, comme il le suppose, les feuillets qui manquent à la fin du manuscrit contenaient des fables maintenant perdues, il est vraisemblable qu’elles étaient également tirées du Dérivé complet, et, comme, ainsi qu’on s’en souvient, il comprend 136 fables, il s’ensuit que les feuillets manquants n’en possédaient pas plus de treize, qui auraient été les suivantes :
| Dérivé complet. | |
| 1. La Vache, la Chèvre, le Bélier et le Lion. | 7. |
| 2. Le Cheval affamé. | 53. |
| 3. L’Homme, le Bouc et le Cheval. | 54. |
| 4. Le Renard et l’Ourse. | 60. |
| 5. Le Corbeau et ses Petits. | 70. |
| 6. Le Maître et l’Esclave. | 75. |
| 7. La Mouche et le Chameau. | 86. |
| 8. Le Soldat et les deux Voleurs. | 113. |
| 9. L’Épervier et la Chouette. | 122. |
| 10. L’Aigle et l’Épervier fugitif. | 123. |
| 11. L’Hirondelle et les Moineaux. | 126. |
| 12. L’Homme qui navigue sur mer. | 130. |
| 13. Le Vieillard et son Fils. | 131. |
{p. 800}Mais il est certain que la
supposition de M. Oesterley est erronée. Désirant savoir ce qu’elle valait,
j’ai par lettre demandé à M. von Heinemann, conservateur de la bibliothèque
ducale de Wolfenbüttel, ce qu’elle pouvait avoir de fondé, et voici la réponse
que, le 10 octobre 1882, il m’a faite : « Le manuscrit finit avec la
fable cxxv, et je ne vois aucune raison de croire qu’il soit à
la fin mutilé, puisqu’il conclut par la morale qui est toujours attachée à
la fin des fables. »
Mais la liste que je viens de dresser n’en a
pas moins sa raison d’être ; car elle permet de voir, indirectement sans
doute, mais avec facilité, de quelles fables du Dérivé complet celles du poète
allemand sont la traduction.
Chapitre III.
Dérivés en vers latins du Romulus de
Nilant. §
Ce n’est pas seulement à une imitation en prose que le Romulus de Nilant a donné naissance ; il a aussi servi de base à des paraphrases poétiques dont l’examen va faire l’objet de ce chapitre.
Section I.
Dérivé hexamétrique. §
C’est ici pour la première fois qu’il aura été question de la collection de fables en vers hexamètres dont je vais maintenant m’occuper. En effet, à l’heure à laquelle j’en aborde l’examen, elle est encore inconnue.
Tirée du seul Romulus de Nilant, elle est nécessairement restreinte. Voici au surplus, avec les numéros des fables correspondantes de ce Romulus, la nomenclature de celles dont elle se compose :
| Dérivé hexamétrique. | Romulus de Nilant. |
| 1. Prologue. | Prologue. |
| 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5 |
| {p. 802}6. Le Buffle, le Loup et le Lion. | I, 6. |
| 7. Le Loup et la Grue. | I, 9. |
| 8. La Chienne qui met bas. | I, 10. |
| 9. Le Rat de Ville et le Rat des Champs. | I, 11. |
| 10. Le Renard et l’Aigle. | I, 12. |
| 11. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| 12. Le Renard et le Corbeau. | I, 14. |
| 13. Le Lion vieilli, le Sanglier et le Taureau. | I, 15. |
| 14. L’Âne et le petit Chien. | I, 16. |
| 15. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| 16. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 18. |
| 17. Les Grenouilles qui demandent un Roi. | II, 1. |
| 18. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| 19. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| 20. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| 21. L’Homme en mal d’enfant. | II, 5. |
| 22. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| 23. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 7. |
| 24. Le Lion et le Berger. | II, 8. |
| 25. Le Lion médecin. | II, 9. |
| 26. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | II, 10. |
| 27. Le Rossignol et l’Épervier. | II, 11. |
| 28. Le Cerf à la Fontaine. | II, 12. |
| 29. La Courtisane et le jeune Homme. | II, 14. |
| 30. Les Loups et les Brebis. | II, 15. |
| 31. La Hache et les Arbres. | II, 16. |
| 32. Le Loup et le Chien. | II, 17. |
| 33. L’Estomac et les Membres. | II, 18. |
| 34. Le Singe et le Renard. | II, 19. |
| 35. Le Loup régnant et le Singe. | II, 20. |
| 36. Le Loup et le Berger. | III, 1. |
| 37. Le Paon et le Rossignol. | III, 2. |
| 38. Les Moutons et le Berger voleur. | III, 3. |
| 39. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 4. |
| 40. Les deux Hommes, l’un véridique, l’autre menteur. | III, 5. |
| 41. L’Âne et le Lion. | III, 6. |
| 42. Le Lion malade et le Renard. | III, 7 |
| 43. L’Homme et le Lion. | III, 8 |
| 44. La Puce et le Chameau. | III, 9 |
| 45. La Cigale et la Fourmi. | III, 10. |
| 46. La Corneille et la Brebis. | III, 11. |
Ces fables ne figurent pas toutes dans le seul manuscrit qui nous en soit parvenu. Ce manuscrit malheureusement est incomplet : il {p. 803}présente des lacunes, l’une entre les feuillets qui portent les nos 40 et 41, et l’autre entre ceux qui portent les nos 50 et 51. À chacun de ces deux endroits, il y avait un ou deux feuillets qui ont été arrachés ou perdus à une époque ou, si le manuscrit était relié, il n’était pas encore dans sa reliure actuelle. Il est probable que les feuillets qui font défaut à l’une des deux lacunes correspondaient avec ceux manquant dans l’autre. Quoi qu’il en soit, la première lacune comprend la fin de la fable de l’Estomac et des Membres, la fable du Singe et du Renard tout entière et le commencement de celle du Lion régnant ; la seconde, les fables de l’Homme et du Lion et de la Puce et du Chameau et le commencement de celle de la Cigale et de la Fourmi.
Ces quarante-six fables sont-elles bien dérivées du Romulus de Nilant ? À cet égard, le doute ne me paraît pas possible. On se rappelle que le Romulus de Nilant, quoique étant loin de posséder autant de fables que le Romulus primitif, en contenait deux qui n’existaient pas dans ce dernier, celle du Buffle, du Loup et du Lion et celle de l’Homme en mal d’enfant. Or, de la nomenclature qui précède il ressort que ces deux sujets de fables sont également traités dans le Dérivé hexamétrique.
Il suffirait d’ajouter que ce Dérivé ne possède aucune fable étrangère au Romulus de Nilant, pour que la démonstration fût complète. Mais, pour la rendre plus irréfutable, je vais signaler, tant dans le prologue que dans l’une des fables du Dérivé hexamétrique, quelques particularités tout à fait probantes.
Nous avons vu que le premier plagiaire qui ait eu l’idée de qualifier Romulus d’empereur, c’est celui à qui est dû le Romulus de Nilant. Or, dans la dédicace à Tiberinus que l’auteur du Romulus hexamétrique a traduite, quel est le premier vers qui s’offre aux yeux ? C’est le suivant :
Magnus Romanæ regnator Romulus urbis.
Je passe aux fables, et je m’arrête à la troisième, c’est-à-dire
à celle du Rat et de la Grenouille. Dans le Romulus ordinaire qui, on le sait,
n’est guère que la copie du Romulus primitif et dans le Romulus de Vienne, les
termes de la réponse que la Grenouille fait à la demande du Rat ne sont pas
explicitement reproduits. Voici au contraire ce qu’on lit dans le Romulus de
Nilant : Cui Rana, callide {p. 804}respondens, ait :
Libens tibi auxilium feram, si prius grossum et longum huc filum mihi
adduxeris.
Or, tout cela se retrouve dans les deux vers suivants du
Dérivé hexamétrique :
Cuique doli fallax respondens esse daturamSi lini possit præsens nunc esse ligamen.
Ce n’est pas tout. Dans la même fable, le Romulus ordinaire dit
seulement que la Grenouille, avec la ficelle qu’elle a demandée, a attaché le
Rat à sa patte, et, plus laconique encore, le Romulus de Vienne se borne à
indiquer qu’elle l’a attaché à elle-même. Au contraire, beaucoup plus explicite,
le Romulus de Nilant précise davantage et explique qu’elle a passé solidement
autour du col du Rat la ficelle qu’elle a en même temps attachée à sa patte, et
voici en quels termes ces détails sont fournis : Rana illud circa collum
firmiter, necnon et suo proprio pedi, insidias sibi tendens, ligavit.
Si maintenant on se reporte au Dérivé hexamétrique, on y trouve ce qui
suit :
Sed muris collum per fraudem Rana ligavitAcque pedem prepetem.
La démonstration pourrait se continuer avec d’autres exemples ; mais, ceux produits me paraissant plus que suffisants, je m’en contente.
Je dois cependant me préoccuper d’une objection qui pourra m’être faite : on pourra faire remarquer que, tandis que, dans la fable du Loup régnant et du Singe, le Romulus de Nilant, comme le Romulus ordinaire et comme celui de Vienne, laisse au Lion son titre et son rôle de roi des animaux, le Dérivé hexamétrique a, comme les deux Dérivés en prose du Romulus anglo-latin et comme la traduction de Marie de France, fait passer sa royauté sur la tête du Loup. On en pourra conclure que la collection hexamétrique est dérivée, non pas du Romulus de Nilant, mais du Romulus anglo-latin. L’objection est sérieuse, et peut-être ceux qui la soulèveront auront-ils raison. Mais, si leur thèse est juste, elle ne prouvera qu’une chose : c’est que le Romulus anglo-latin devait être une copie presque littérale du Romulus de Nilant. En effet, lorsqu’on a simultanément devant soi le texte de ce dernier Romulus et celui de la collection hexamétrique, on retrouve si constamment dans la seconde {p. 805}les expressions de la première que l’affinité qu’elles ont entre elles est saisissante. Dans ces conditions, alors que la collection du véritable Romulus anglo-latin a disparu, on ne me blâmera pas, je l’espère, d’avoir fait de la collection hexamétrique un dérivé direct du Romulus de Nilant, dont peut-être elle n’est qu’indirectement issue.
L’origine du Dérivé hexamétrique étant ainsi fixée, il s’agit maintenant de déterminer approximativement l’époque à laquelle il a été composé. Il me paraît supposable qu’il a été écrit fort peu de temps après la première apparition de son modèle, qui, on le sait, n’est pas plus récente que le xie siècle. L’ancienneté du manuscrit unique qui nous l’a conservé ne permet point, en tout cas, de lui assigner une époque moins éloignée que le xiie.
Il ne me reste plus qu’à examiner sommairement ce que vaut le Dérivé hexamétrique, tant au point de vue du style qu’à celui de la pureté des expressions et de l’observation des règles grammaticales et prosodiques.
Je dois d’abord observer, en ce qui touche le style, que partout la pensée, comme dans ces pièces de vers latins dues aux collégiens encore inexpérimentés, est rendue par un langage ampoulé qui l’outrepasse. Si M. E. du Méril avait connu ce Dérivé, il est probable que ce défaut l’aurait porté à y voir le résultat du système d’enseignement préconisé par Quintilien. Quant à moi, je ne le crois pas et je suis convaincu que, lorsqu’on saura à quel point les fables de ce Dérivé étaient peu dignes d’être transcrites sur le cahier d’honneur, on partagera mon sentiment. J’ajoute qu’à ce premier défaut de style s’en joint un second qui consiste dans une déplorable prolixité ; ainsi, pour m’en tenir à la fable du Loup régnant et du Singe dont il a été précédemment question, elle embrasse à elle seule cent soixante et un vers : ce n’est plus une fable, c’est un poème.
Ces défauts, qui, à la rigueur, ne seraient pas incompatibles avec le respect de la langue, ne sont pas rachetés par cette qualité. Les fables fourmillent de phrases dont la construction grammaticale est irrégulière et dont le sens est inintelligible, et de mots barbares qui non seulement ne se rencontrent pas dans les lexiques ordinaires, mais qu’on chercherait même en vain dans ceux de la basse-latinité.
Enfin les règles de la prosodie ne sont pas mieux observées. {p. 806}Ainsi beaucoup de vers manquent de la césure obligatoire après le deuxième pied, et, à défaut de cette césure n’ont pas, après le premier et le troisième, les deux qui doivent la remplacer. L’auteur abuse aussi d’une licence que se permettaient les mauvais versificateurs de son temps et qui consistait, quand même elles étaient brèves, à rendre les syllabes longues par la force de la césure : dans la fable du Loup régnant et du Singe déjà citée, cette irrégularité est fréquenté. Mais ce qui trahit surtout une véritable inexpérience d’écolier, ce sont les fautes de quantité qui pullulent et les vers rendus boiteux tantôt par un pied de moins, tantôt par un pied de trop.
Et cependant l’auteur ne dédaigne aucun des procédés susceptibles de lui faciliter sa tâche.
D’une part, il a souvent recours aux élisions, qui, comme nuisant à l’élégance du vers, étaient, de son temps, sinon interdites, au moins généralement évitées, et qui, dans certaines conditions, l’ont été à toutes les époques. Telle est celle qu’on trouve dans ce vers de la fable De Leone regnante, où l’élision fait disparaître un mot entier :
Per Stiga jurabit vel vi ast rex numina Divum.
D’autre part, et c’est là son procédé de versification le plus habituel, il ne laisse pas aux mots la place que rationnellement ils devraient occuper : il les range dans l’ordre que la mesure exige, et pour cela il va jusqu’à mêler ceux de la proposition subordonnée avec ceux de la proposition principale, comme dans cette phrase de la fable De Leone regnante, qui, commençant par le vers précité, se complète par le suivant :
Ut nostræ nullum gentis post læderet unquam.
Si en effet on veut rétablir les mots dans leur ordre logique, on doit les écrire ainsi : Ast per Styga jurabit vel per numina Divum, ut unquam post læderet vi nullum nostræ gentis.
Le plus souvent l’auteur met au milieu d’une phrase la conjonction qui, pour la rattacher à la précédente, devrait être en tête, comme dans le premier des deux vers précédents et comme dans le passage suivant de la même fable :
Bestia non aliud fuerat que infirmior ausaDicere,
{p. 807}passage où grammaticalement on devrait lire : Bestiaque infirmior non ausa fuerat aliud dicere.
Souvent aussi c’est le pronom relatif qui subit une semblable transposition, comme dans ces deux vers de la fable De Ancipitre et Luscinia :
Turbida cui tremulis pandit Luscinia rostrisTalia ter ternæ dictant quæ carmina Musæ.
Rationnellement la phrase contenue dans ces deux vers devrait être ainsi construite : Cui turbida tremulis pandit Luscinia rostris talia carmina quæ ter ternæ Musæ dictant.
Quand ce n’est pas la conjonction ni le pronom relatif, c’est la préposition que l’auteur transpose pour les besoins du vers : tantôt il la place après le mot qu’elle régit, tantôt, en la mettant avant, il interpose d’autres mots, comme dans ce promythion de la fable De Leone rege et Bubalo et Lupo venantibus :
Partiri misero cum nec est utile forti.
Ce vers doit être compris comme si les mots qui le composent se présentaient ainsi : Nec est utile misero partiri cum forti. On remarque à quel point la phrase a été torturée ; ce qui d’ailleurs n’empêcherait pas le vers d’être boiteux, si l’on n’était pas assez accommodant pour voir dans le mot nec une syllabe rendue longue par la puissance de la césure.
Tout cela, il faut le dire à la décharge de l’auteur, est considérablement aggravé par l’ignorance évidente du copiste, qui, ayant sans doute sous les yeux un modèle difficile à lire, laissait quelquefois un espace blanc à la place des mots qu’il ne pouvait déchiffrer, mais plus fréquemment leur substituait des mots ou plutôt des simulacres de mots qui étaient assez différents des véritables pour en rendre la restitution impossible.
Il me serait facile de citer de nombreux exemples à l’appui de ces critiques. J’éviterais de la sorte à ceux qui voudront en vérifier l’exactitude la peine de se reporter au texte qui sera publié dans le second volume de cet ouvrage. Ils m’excuseront, je l’espère, d’avoir sacrifié leur commodité à mon désir de ne donner à cette notice que des proportions très restreintes. Les justifications qu’il me serait aisé de produire feraient d’ailleurs double emploi ; car, dans {p. 808}les notes placées au bas du texte, ils trouveront relevées une à une toutes les fautes qu’en ce moment je me contente d’indiquer en termes généraux.
Au surplus, mes critiques, si quant à présent elles ne sont pas appuyées de preuves, sont assez précises pour qu’ils soient fixés sur l’absence totale de valeur du Dérivé hexamétrique, qui, à mon sens, n’a guère d’intérêt qu’au point de vue de l’histoire littéraire du moyen âge. S’il en offre un autre plus spécial, ce sera au lexicographe qui voudra ajouter un supplément aux dictionnaires de Ducange et de Forcellini.
Ce manuscrit, qui, dans la Bibliothèque Bodléienne, dépend du fonds Rawlinson et porte la cote B. N. Rawl. 111, forme un volume in-8º, composé de cinquante et un feuillets en parchemin, dont l’écriture à longues lignes est des xie et xiie siècles.
Il ne renferme que deux opuscules, l’un et l’autre en vers : d’abord les fables d’Avianus, qui s’étendent du haut du feuillet 1 a au milieu du feuillet 16 a, puis celles du Dérivé hexamétrique qui occupent le reste du volume. Si peu intéressant que soit ce Dérivé, n’existant que dans ce manuscrit, il le rend particulièrement précieux.
Section II.
Dérivé en vers rythmiques. §
Le Dérivé hexamétrique n’est pas la seule collection poétique née de la prose du Romulus de Nilant. Il en existe une autre moins ancienne que j’ai déjà publiée et dont j’avais cru à tort être le premier éditeur. Je veux parler de cette collection en vers rythmiques disposés en quatrains qui, dans le second volume de la première édition de cet ouvrage, occupe les pages 436 à 479.
Les quatrains y sont formés de trois vers rythmiques et d’un {p. 809}hexamètre final. Les trois vers rythmiques, dont la composition repose uniquement sur le nombre des syllabes se divisent chacun en deux hémistiches qui en ont, le premier, sept et, le second, six et qui riment entre eux et avec le vers hexamètre. La même rime est ainsi reproduite quatre fois de suite.
On conçoit que, pour se conformer aux exigences de ce système de versification, l’auteur a dû se trouver dans la nécessité de remplacer presque partout par d’autres mots ceux du texte dans lequel il puisait ses inspirations. Il faut ajouter qu’une autre cause devait le porter à s’écarter de son modèle, à savoir l’esprit religieux, dont il paraît avoir été profondément pénétré, et qui, dès le début de sa paraphrase, se traduit par cette invocation :
Jam te cuncti poscimus, pater pacis dator,Sic et te, paraclete pie consolator ;Trinitatis mediae Jhesu legislator,Hujus sis operis finis, caput et mediator.
Malgré cette transformation, il ne peut exister de doute sur l’origine de l’œuvre : il me paraît certain que c’est le texte du Romulus de Nilant qui en en a été la base directe. La preuve en est immédiatement fournie, avant tout examen comparatif des textes, par la complète concordance que l’ordre des fables présente dans les deux collections. On va pouvoir en juger. Voici d’ailleurs l’énumération des fables rythmiques, accompagnée de leurs références avec celles de ce Romulus :
| Fables rythmiques. | Romulus de Nilant. |
| I, 1. Le Coq et la Perle. | I, 1. |
| I, 2. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| I, 3. Le Rat et la Grenouille. | I, 3. |
| I, 4. Le Chien et la Brebis. | I, 4. |
| I, 5. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| I, 6. Le Buffle, le Loup et le Lion. | I, 6. |
| I, 7. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 7. |
| I, 8. Le Soleil qui se marie. | I, 8. |
| I, 9. Le Loup et la Grue. | I, 9. |
| I, 10. La Chienne qui met bas. | I, 10. |
| I, 11. Le Rat de ville et le Rat des champs. | I, 11. |
| I, 12. L’Aigle et le Renard. | I, 12. |
| I, 13. L’Aigle, la Tortue et le Corbeau. | I, 13. |
| I, 14. Le Corbeau et le Renard. | I, 14. |
| {p. 810}I, 15. Le Lion vieilli, le Sanglier et le Taureau. | I, 15. |
| I, 16. L’Âne qui caresse son maître. | I, 16. |
| I, 17. Le Lion et le Rat. | I, 17. |
| I, 18. Les Oiseaux et l’Hirondelle. | I, 18. |
| II, 1. Les Grenouilles qui demandent un Roi. | II, 1. |
| II, 2. Les Colombes et le Milan. | II, 2. |
| II, 3. Le Chien et le Voleur. | II, 3. |
| II, 4. Le Loup accoucheur. | II, 4. |
| Il, 5. L’Homme en mal d’enfant. | II, 5. |
| II, 6. Le Chien et l’Agneau. | II, 6. |
| II, 7. Les Lièvres et les Grenouilles. | II, 7. |
| II, 8. Le Lion et le Berger. | II, 8. |
| II, 9. Le Lion médecin. | II, 9. |
| II, 10. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | II, 10. |
| II, 11. Le Rossignol et l’Épervier. | II, 11. |
| II, 12. Le Cerf à la fontaine. | II, 12. |
| II, 13. L’inconstance de la Femme. | II, 13. |
| II, 14. La Courtisane et le Jeune Homme. | II, 14. |
| II, 15. Les Loups et les Brebis. | II, 15. |
| II, 16. La Hache et les Arbres. | II, 16. |
| II, 17. Le Loup et le Chien. | II, 17. |
| II, 18. L’Estomac et les Membre. | II, 18. |
| II, 19. Le Singe et le Renard. | II, 19. |
| II, 20. Le Lion roi et le Singe. | II, 20. |
| II, 21. Le Loup et le Berger. | III, 1. |
| II, 22. Le Paon et Junon. | III, 2. |
| II, 23. Les Moutons et les Béliers. | III, 3. |
| II, 24. L’Oiseleur et les Oiseaux. | III, 4. |
| II, 25. Les deux Hommes, l’un véridique et l’autre menteur. | III, 5. |
| II, 26. L’Âne et le Lion. | III, 6. |
| II, 27. Le Lion malade et le Renard. | III, 7. |
| II, 28. L’Homme et le Lion. | III, 8. |
| II, 29. La Puce et le Chameau. | III, 9. |
| II, 30. La Fourmi et le Grillon. | III, 10. |
| II, 31. La Corneille et les Brebis. | III, 11. |
| II, 32. Le Bouc, le Loup et le Renard. | |
| II, 33. Le Loup qui va à Rome. | |
| II, 31. Le Cerf, le Hérisson et le Sanglier. |
Cette nomenclature justifie mon assertion ; non seulement elle démontre, comme je l’ai affirmé, que dans les deux collections l’ordre des fables est absolument le même, mais encore on y trouve les mêmes traces d’accord dans leur division en livres.
{p. 811}Il faut en outre observer que les sujets traités dans chacune sont également pareils, et à ce point de vue la parité n’est pas chose négligeable ; car on sait que la fable du Lion, du Buffle et du Loup, qui n’existe pas dans le Romulus primitif, a été une forme nouvelle donnée à l’une des fables de ce Romulus par l’auteur du Romulus de Nilant ; or cette forme nouvelle que ce dernier a seul pu lui fournir, a été traduite dans le Dérivé en vers rythmiques. Il est vrai que, dans la fable xxiii du Livre II de ce Dérivé, les personnages parmi lesquels figurent le Lion ne sont pas tous les mêmes que dans la correspondante du Romulus de Nilant, qui, au lieu du Lion, met en scène un Boucher ; mais le fond est resté semblable.
On peut enfin ajouter que, dans les deux collections, le nombre des fables, dont le Romulus primitif a été pour l’une la source directe et pour l’autre la source indirecte, est également identique ; car, si la collection rythmique renferme trois dernières fables que le Romulus de Nilant ne possède pas, il faut remarquer que c’est une petite addition qui, étant étrangère à leur origine commune et constituant une exception unique à leur conformité, ne la fait que mieux ressortir.
Mais je comprends que, lorsqu’on désire bien déterminer la corrélation qui peut exister entre deux collections de fables, on ne doive pas s’en tenir à ces signes extérieurs, et que, pour résoudre le problème de leur filiation, il faille examiner de près leurs textes respectifs. C’est ce que je vais faire, en comparant ensemble des extraits empruntés aux trois fables du Rat et de la Grenouille, du Chien et de la Brebis, du Lion, du Buffle et du Loup, dans les trois collections du Romulus primitif, du Romulus de Nilant et du Dérivé rythmique.
La Grenouille et le Rat.
Romulus primitif. A Rana petiit auxilium.
Romulus de Nilant. Auxilium a Rana simpliciter petivit.
Dérivé rythmique. A Rana simpliciter juvamen petebat.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Cui Rana callide respondens ait.
Dérivé rythmique. Rana dolo callida Muri respondebat.
Romulus primitif. Murem sibi ad pedem ligavit.
{p. 812}Romulus de Nilant. Rana illud circa Muris collum firmiter necnon et suo proprio pedi, insidias Muri tradens, ligavit.
Dérivé rythmique. Muris collum proprio pedi connectebat.
Le Chien et la Brebis.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Qua vendita, morte periit, cujus carnem tres falsi testes partiti sunt.
Dérivé rythmique. Vellere deposito, caro testibus esca paratur.
Le Lion, le Buffle et le Loup.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Mirum Cervum occiderunt.
Dérivé rythmique. Miræ magnitudinis Cervum prendiderunt.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Tunc fertur Lupum percuntasse a Bubalo qualiter Cervus partiri deberet.
Dérivé rythmique. Tunc Lupus et Bubalus mutuo dixerunt qualiter hunc Cervum partiri proposuerunt.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Bubalus inquit in judicio senioris hoc constare.
Dérivé rythmique. Tunc respondit Bubalus totum jus constare Leonis judicio.
Romulus primitif. Néant.
Romulus de Nilant. Mihi prima pars contingit, quia rex sum.
Dérivé rythmique. Mihi prima portio debet venerari, quia sum rex pecorum.
Ces exemples sont tout à fait démonstratifs ; car les uns font voir le Dérivé en vers rythmiques traduisant, aussi littéralement que possible, certaines additions faites au Romulus primitif par le Romulus de Nilant, qui dès lors a seul fourni les éléments de cette traduction, et, dans les autres où les deux Romulus sont en discordance, on voit le Dérivé adopter les modifications introduites dans l’idée et dans les mots par celui de Nilant, dont il est clairement la directe transformation.
Quant aux trois dernières fables du Dérivé qui sont étrangères au Romulus de Nilant, le versificateur n’en a pas inventé les sujets ; il en a trouvé des rédactions en prose, les a traduites et les a ajoutées aux autres. Où les a-t-il trouvées ? Pour deux je l’ignore. Ce qui me paraît constant, c’est que dans leur forme prosaïque les trois fables {p. 813}n’appartenaient pas à une seule et même collection ; car le sujet de l’une d’elles, celle du Loup qui va à Rome, a été traité par la fable 79 Dou Leu et d’un Vileins, dans la traduction de Marie, et par la fable 121 De Lupo et Nauta dans le Dérivé complet du Romulus anglo-latin d’où l’une et l’autre ont été tirées, et les deux autres fables n’ont appartenu ni à ce Romulus ni à ses dérivés.
Il ne faut pas d’ailleurs s’étonner que le versificateur ait ajouté à sa version celle de trois fables étrangères à la collection qu’il avait entrepris de traduire. En procédant ainsi, il a agi comme beaucoup de ses devanciers et notamment comme Walther l’Anglais, qui, on se le rappelle, a pris en dehors du Romulus ordinaire les sujets de ses dernières fables.
Maintenant, si, en l’absence de document précis, j’osais risquer une hypothèse sur la nationalité de l’auteur du Dérivé rythmique, je dirais qu’il devait être Anglais. Lorsqu’on songe que l’un des trois exemplaires connus du Romulus de Nilant est encore aujourd’hui en Angleterre et que c’est à Londres et à Cambridge que sont conservés les deux seuls exemplaires du Dérivé, on doit trouver que ma supposition n’est pas invraisemblable.
Quant à l’époque à laquelle l’auteur a exécuté sa traduction, M. Thomas Wright lui assigne le xiiie siècle, et pour ma part je crois cette opinion très admissible.
1º Manuscrit du British Museum. §
Je ne connais que deux manuscrits contenant les fables rimées. Le plus complet appartient à la bibliothèque du British Museum, où il porte le nº 11619 : c’est un volume qui, très petit, pourrait presque être classé dans le format in-36, et qui, relativement très gros, se compose de 277 feuillets en parchemin, couverts d’une écriture microscopique par une main du xive siècle.
Les cinquante-deux fables qu’il renferme occupent les feuillets 189 à 210, et se divisent en deux livres, comprenant l’un 18 fables et l’autre 34.
Quoique je ne connaisse aucun autre exemplaire complet de la même œuvre, il me paraît très certain que le manuscrit du British Museum n’est pas un autographe. Il est, en effet, rempli de fautes {p. 814}qui démontrent que le copiste n’avait aucune connaissance de la langue latine, et que, sans la comprendre, il copiait l’œuvre d’un auteur qui déjà depuis longtemps sans doute n’existait plus.
Je m’en tiens à ces courtes réflexions : la publication que je dois faire du manuscrit, me dispense d’en faire une plus ample description.
2º Manuscrit du collège du Corpus Christi de Cambridge. §
Indépendamment du manuscrit du British Museum, il en existe un autre, qui m’a d’abord été révélé par le Catalogue in-fol. des manuscrits des bibliothèques anglaises et irlandaises, publié à Oxford en 1697.
Ce manuscrit, qui appartient au collège du Corpus Christi de Cambridge, porte, dans la bibliothèque qui le possède, non pas le nº 85 qui lui a été attribué par les auteurs du Catalogue publié à Oxford, ni le nº 1362 que, par suite de la classification adoptée pour leur ouvrage, ils ont ajouté au précédent, mais bien le nº 177, qui au contraire n’est pas indiqué par eux551.
Avec une affabilité et une complaisance, à laquelle je ne saurais trop rendre hommage, il m’a été communiqué par M. S. S. Lewis, professeur de langues grecque et latine au collège du Corpus Christi, dont la mort, survenue depuis, sera longtemps regrettée de tous ceux qui l’ont connu.
Le manuscrit forme un volume in-fol. et se compose de 269 feuillets, dont les uns sont en papier et les autres en parchemin, et dont l’écriture, disposée en deux colonnes, est du xvie siècle.
Il ne renferme qu’un extrait de la collection complète des fables rythmiques. Cet extrait, qui s’étend du milieu de la deuxième colonne du feuillet 204 a au milieu de la première colonne du feuillet 206 b, comprend le prologue et 20 fables choisies, dont la dernière, inachevée, s’arrête à ce vers :
Plaudens atque Lupus ad Pastorem veniebat.
La fin de la colonne n’a pas été remplie par le copiste, qui a évidemment laissé sa tâche incomplète. Au surplus, l’ignorance dont il a donné la preuve fait peu regretter qu’il ne l’ait pas terminée ; {p. 815}car, si le manuscrit du British Museum est défectueux, celui de Cambridge fourmille de fautes plus grossières encore.
Les vingt fables que renferme le manuscrit de Cambridge sont celles auxquelles j’ai, dans la nomenclature générale établie plus haut, donné les numéros suivants : I, 1 ; I, 2 ; I, 3 ; I, 4 ; I, 5 ; I, 6 ; I, 7 ; I, 8 ; I, 9 ; I, 10 ; I, 11 ; I, 15 ; I, 17 ; I, 18 ; II, 1 ; II, 2 ; II, 3 ; II, 7 ; II, 8 ; II, 21.
J’ai eu soin de relever moi-même au collège du Corpus Christi, sur le manuscrit qui les renferme, les nombreuses variantes qu’elles présentent, et, quoique ces variantes soient très fautives, je n’ai pas cru devoir les négliger ; dans le second volume de cet ouvrage, on les trouvera ajoutées, sous forme de notes, au texte du manuscrit du British Museum.
J’ai dit qu’à tort j’avais cru être le premier éditeur des fables du Dérivé rythmique. Par son compte-rendu de ma première édition dans le Journal des savants, M. Gaston Paris m’a appris que je m’étais trompé.
Elles ont en effet paru, en 1842, dans le huitième volume de la
collection de la Percy Society, collection dont le titre
général est ainsi conçu : Early English Poetry, || Ballads,
|| and Popular Literature || of the Middle Ages.|| Edited from original manuscripts || and scarce publications.
|| Vol. VIII. || London. || Printed for the Percy Society. || By
T. Richards, St. Martins lane. || M. DCCC. XLIII.
Voici le frontispice du huitième volume : A
Selection || of || latin stories, || from manuscripts of the thirteenth and
|| fourteenth centuries ; || a contribution to the || Historry of
fiction || during the middle ages. || Edited by || Thomas Wright, esq.
M. A. F. S. A. || Member of the royal Society of northern antiquaries of
Copenhagen, || and of the historical commission of France, etc., etc. || of
Trinity college, Cambridge. || London : || Printed for the Percy Society. ||
M. DCCC. XLII.
Le volume est un in-12 de xxvi-256 pages.
Cinquième partie.
Romulus de Berne. §
Section I. Examen du Romulus de Berne. §
Le Romulus de Berne est le moins complet des dérivés du Romulus primitif. Il ne comprend en effet que les treize fables suivantes, puisées dans les trois livres de son modèle :
| Romulus de Berne. | Romulus primitif. |
| 1. Le Loup et l’Agneau. | I, 2. |
| 2. Le Rat et la Grenouille : | I, 3. |
| 3. Le Chien et l’Ombre. | I, 5. |
| 4. Le Loup et la Grue. | I, 8. |
| 5. La Vache, la Brebis, la Chèvre et le Lion. | I, 6. |
| 6. Le Lion vieilli, le Sanglier, le Taureau et l’Âne. | I, 16. |
| 7. L’Âne qui caresse son maître. | I, 17. |
| 8. Le Lion et le Rat. | I, 18. |
| 9. La Chauve-Souris vaniteuse. | II, 15. |
| 10. Le Cerf à la Fontaine. | III, 7. |
| 11. La Mouche et la Fourmi : | II, 17. |
| 12. La Grenouille qui s’enfle. | II, 20. |
| 13. Les Quadrupèdes et les Oiseaux. | III, 4. |
Ces fables sont précédées du titre suivant, qui montre que c’est bien
d’un Romulus qu’elles sont issues : Hæc sunt fabulæ Æsopi
morales, quas Romulus de græco in latinum transtulit.
Lorsque du titre on passe au texte, on ne tarde pas à être convaincu que le seul Romulus dont elles puissent être descendues est le Romulus primitif. On y rencontre des expressions qui, quoique n’existant pas dans le Romulus ordinaire, n’en ont pas moins été empruntées à Phèdre. Je vais, au moyen d’exemples tirés de la fable {p. 817}du Loup et de l’Agneau, faire ressortir ce fait, dont j’aurai ensuite à déduire les conséquences :
Phèdre. Superior stabat Lupus, longeque inferior Agnus.
Rom. ordin. Sursum bibebat Lupus, longeque inferius Agnus.
Rom. de Berne. Sursum bibebat Lupus, et longe inferior Agnus.
On voit, par ce premier exemple, que, tandis que dans le Romulus ordinaire, le mot inferius a été substitué au mot inferior, employé par Phèdre, la leçon du fabuliste romain a été conservée dans le Romulus de Berne.
Lorsqu’on arrive à la moralité de la même fable, la similitude dans les deux textes antique et Bernois des expressions répudiées par le Romulus ordinaire devient encore plus sensible :
Phèdre. Hæc propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt.
Rom. ordin. Hæc de illis dicta est fabula, qui hominibus calumniantur.
Rom. de Berne. Sic damnosi et oppressores sine causa innocentes opprimunt.
Devant ce second exemple, on peut croire que l’auteur du Romulus de Berne connaissait Phèdre, et que, tout en prenant pour principal guide le Romulus ordinaire, il a fait en même temps quelques emprunts au poète ancien.
Quant à moi, je ne partage pas ce sentiment. Sans doute les compilateurs, pour grossir le nombre de leurs fables, ont pu en emprunter les sujets à des collections diverses. C’est un fait qui a été fréquent et qui est attesté par trop de manuscrits pour être contestable. Mais ce que je ne crois pas, c’est que pour une seule et même fable ils aient eu recours à plusieurs textes. Ce qui me paraît beaucoup plus vraisemblable, c’est que, si l’on rencontre dans le Romulus de Berne des expressions de Phèdre omises dans le Romulus ordinaire, c’est parce qu’il était dérivé non de ce Romulus, mais du Romulus primitif, qui, directement issu de l’Æsopus ad Rufum, avait dû respecter davantage le texte du fabuliste romain.
Cette opinion est corroborée par la leçon du manuscrit de
Wissembourg, également dérivé de l’Æsopus. La morale de la même
fable y porte les mots : lædunt innocentes
, qui
sont une légère métamorphose de la locution : innocentes
opprimunt
, et qui montrent que ces derniers ont existé presque
certainement dans l’Æsopus et {p. 818}très
probablement dans le Romulus primitif. C’est donc à bon droit, on le reconnaîtra,
que j’ai mis le Romulus de Berne au nombre de ses dérivés.
Section II.
Manuscrit du Romulus de Berne. §
Ce manuscrit qui, dans la Bibliothèque cantonale, porte le nº 141, forme un volumineux in-folio, dont les feuillets sont en papier et dont l’écriture est du xve siècle. Le Romulus qu’il renferme est le trois-cent vingt-huitième des opuscules dont il se compose, et sur le cahier où il figure il occupe les feuillets 11b à 12b.
FIN.