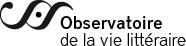Morceaux choisis des auteurs français XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Avertissement pour la nouvelle édition §
Cette nouvelle édition de nos Morceaux choisis des auteurs français, à l’usage du premier cycle de l’enseignement secondaire, est destinée à la fois aux élèves de la section A et à ceux de la section B : c’est qu’en effet, dans un grand nombre de lycées et de collèges, les deux sections se trouvent, pour l’explication des textes, réunies sous la direction d’un même maître.
En raison des besoins plus divers auxquels ce volume doit désormais répondre, on ne s’étonnera pas que nous l’ayons enrichi d’un certain nombre d’extraits nouveaux. Aussi bien, nous sommes-nous toujours efforcé, dans cette édition comme dans les précédentes, de choisir des morceaux de caractère différent et d’étendue variée, et qui parussent mieux faits les uns pour être appris par cœur, les autres pour être lus en classe ou dans la famille.
Nous n’avons pas renoncé à mettre, comme nous l’avions toujours fait, sous les yeux de nos enfant quelques pages de notre ancienne littérature, de la Chanson de Roland à Villon et de Villehardouin à Commynes. Mais nous avons groupé ces extraits dans une introduction paginée à part : les plus anciens sont accompagnés d’une traduction ; ceux du xve siècle, de notes nombreuses. Notre recueil proprement dit s’ouvre avec le xvie siècle, à partir duquel nous avons résolument ramené tous les textes à l’orthographe moderne.
Cette modification exceptée, tous sont conformes aux éditions originales ou aux éditions publiées d’après les manuscrits ou qui font le plus autorité1.
Nous avons, autant que possible, évité d’emprunter nos extraits aux ouvrages que les élèves doivent lire ou étudier en entier dans l’une des années du premier cycle. Toutefois, dans un petit nombre de cas, nous ne nous sommes pas fait scrupule d’insérer, en pensant aux élèves de sixième ou de cinquième, certains passages célèbres et aisés à comprendre d’ouvrages inscrits au programme des classes ultérieures.
Quant aux notices, elles sont très courtes dans ce volume, qui s’adresse en général à des élèves encore jeunes. Le recueil destiné à ceux du second cycle en contient de plus étendues : ici nous n’avons dit que le strict nécessaire, en nous attachant du moins à fournir toujours au lecteur des renseignements exacts et précis.
Introduction
Choix de textes antérieurs au xvie siècle §
Chanson de Roland2
(fin du xie siècle) §
Mort de la Belle Aude, La Fiancée de Roland §
Au moment où commence le récit qu’on va lire, Charlemagne revient de battre les Sarrasins, qui ont fait périr son neveu Roland dans une embuscade.
(Vers 5705-3733.)
L’empereur est rentré d’Espagne — et vient à Aix, au milieu du siège de France. — Monte au palais, est venu en la chambre. — Voici à lui venue Aude, une belle dame. — Dit ceci au roi : « Où est Roland, le capitaine, — qui me jura de (me) prendre comme sa compagne ? » — Charles en a et douleur et chagrin pesant, — pleure des yeux, tire sa barbe blanche : — « Sœur, chère amie (au sujet) d’homme mort (tu) m’interroges. — Je t’en donnerai un échange très renforcé (je te donnerai en échange quelque chose de considérable) : — c’est Louis ; je ne sais meilleur (homme) en France : — il est mon fils (né) de ma femme la noble, — et certes tiendra mes marches (pays frontières) et mon royaume, » — Aude répond : « Ce mot m’est étrange. — Ne plaise à Dieu, ni à ses saints, ni à ses anges, — après Roland que vivante je demeure ! — Perd la couleur, choit aux pieds de Charlemagne, — immédiatement est morte. Dieu ait merci de l’âme ! — Barons français en pleurent, et ainsi la plaignent.
Aude la belle est à sa fin allée. — Cuide [croit] le roi qu’elle s’est pâmée. — Pitié en a ; aussi l’empereur en pleure ; — la prend aux mains, et ainsi l’a relevée de là ; — (mais) sur les épaules (elle) a laissé retomber la tête. — Quand Charles voit qu’ (il) l’a trouvée morte, — (il) a mandé là immédiatement quatre comtesses ; — à un moutier (monastère) de non-nains (Aude) est portée, — (les femmes) la veillent la nuit jusqu’au lever du jour. — Le long d’un autel bellement l’enterrèrent. — Là le roi lui a accordé très grand honneur6.
Marie de France7
(Sous Henri II D’Angleterre, 1154-1189) §
Le loup et l’agneau8 §
(Fables, édit. Karl Warnke, Halle, 1898, in-8°. — Fable II.)
(Ésope) ici parle du loup et de l’agneau — qui buvaient à une rigole : — le loup à la source buvait, — et l’agneau en aval se tenait. — D’une manière irritée parla le loup, — qui beaucoup était querelleur ; — avec mauvaise intention lui parla : — « Tu me fais, dit-il, grand ennui ».
— L’agneau a répondu : — « Sire, [au sujet] de quoi ? — Donc tu ne vois pas ? — Tu m’as ici troublé cette eau ; — je n’en puis boire mon saoul ; — je m’en irai, je le crois, ainsi — comme je vins, ici mourant de soif. » — L’agneau lui répond alors : — « Sire, mais vous buvez en amont ! — c’est de vous que me vient ce que j’ai bu. — Quoi ! fit le loup, tu m’outrages ? » »
— L’autre lui a dit : « Je n’en ai vouloir ». — Le loup répond : « J’en sais la vérité ; — - c’est cela même que me fit ton père — à cette source où avec lui j’étais. — Il y a six mois à cette heure, ainsi que je crois. — Pourquoi imputez-vous cela, fait-il, à moi ? — Je n’étais pas né ainsi que je pense. — Qu’est-ce que cela prouve ? A dit le loup ; — tu me fais à présent de l’opposition, — et chose que tu ne dois faire ». — Donc le loup prit le petit agneau, — l’étrangle avec ses dents, ainsi le tue. — Ainsi font les puissants voleurs (dérobeurs), — les vicomtes et les juges, — [à propos] de ceux qu’ils ont en leur justice. — Faux prétexte (occasion) par convoitise — trouvent assez pour les confondre. — Souvent les font citer en procès, — leur enlèvent la chair et la peau, — de la manière que le loup fit à l’agneau.
Le roman de Renart13
(XIIe-XIIIe siècles) §
La Pêche aux anguilles §
(Le Roman de Renart, édition Martin, Strasbourg, 1882-1887, premier volume, III, vers 377-432).
Ce fut un peu avant Noël, — [alors] qu’on mettait jambons au sel. — Le ciel était clair et étoilé, — et le vivier était tellement gelé, — où Ysengrin devait pêcher, — qu’on eut pu danser par-dessus, — excepté ceci, qu’il y avait un trou, — qui y avait été fait par les campagnards, — où ils menaient leur bétail — chaque nuit s’ébattre et boire. — Ils y avaient laissé un seau- — Là vint Renart tout empressé, — et regarda son compère : — « Seigneur, fait-il, tirez-vous de ce côté. — Là est l’abondance des poissons — et l’engin avec lequel nous péchons — les anguilles et les barbeaux — et autres poissons bons et beaux ». — Ysengrin dit : « Frère Renart, — maintenant prenez-le (l’engin, le seau) d’un côté — et attachez-le moi bien à la queue ». — Renart le prend et ainsi le noue — autour de la queue, du mieux qu’il peut. — « Frère, fait-il, maintenant il vous convient — de vous maintenir très sagement — pour faire venir les poissons. » — Alors il s’est établi près d’un buisson ; — ainsi il mit son museau entre ses pieds, — de manière à voir ce que fait Ysengrin. — Et Ysengrin est sur la glace ; — le seau est dans le vivier, — plein de glaçons en grande abondance. — L’eau commence à se glacer, — et à enlacer le seau, — qui était noué à la queue ; — il était tout enserré par la glace. — Voilà la queue gelée dans l’eau — et scellée dans la glace. — Ysengrin crut bien se soulever — et tirer le seau à lui ; — il s’y essaie de mainte façon, — ne sait que faire ; ainsi il est en émoi. — Il commence à appeler Renart, — au moment où il ne peut pas être caché plus longtemps — (vu) que déjà l’aube avait percé. — Renart a levé la tête ; — il se tient sur ses gardes et ouvre les yeux. — « Frère, fait-il, or çà laissez votre œuvre ; — allons-nous-en, beau doux ami ; — nous avons assez pris de poisson. » — Et Ysengrin lui répondit en jetant un cri : — « Renart, fait-il, il y en a trop ; — j’en ai tant pris (que) je ne sais que dire ». — Et Renart commença à rire ; — et ainsi lui a dit tout ouvertement : — « Celui qui convoite tout, perd tout ».
Geoffroy de Villehardouin19
(1165 - entre 1207 et 1213) §
Les croisés devant Constantinople §
Lors se partirent del port d’Avie tuit ensemble. Si peüssiez veoir flori le Braz-Saint-Jorge contremont de nés et de galies et de uissiers ; et molt granz mervoille ère la bialtez a regarder. Et ensi corurent contremont le Braz-Saint-Jorge, tant que il vindrent, la veille de la saint Jehan-Baptiste, en juin, a Saint-Estiène, a une abbaïe qui ère a trois lieues de Constantinoble. Et lors virent tot à plain Constantinoble cil des nés et des galies et des uissiers : et pristrent port, et ancrerent lor vaissiaus. Or poez savoir que mult esgarderent Constantinoble cil qui onques mais ne l’avoient veue ; que il ne pooient mie cuidier que si riche vile peust estre eu tot le monde, cum il virent ces halz murs et ces riches tours dont ele ere close tot entor à la reonde, et ces riches palais, et ces haltes yglises, dont il i avoit tant que nuls nel poist croire, se il ne le vëist à l’oil, et le lonc et le lé de la vile que de totes les autres ere soveraine. Et sachiez que il n’i ot si hardi cui la chars ne fremist ; et ce ne fu mie mervoille ; que oncques si granz affaires ne fu enpris de nulle gent, puis que li monz fut estorez20.
(La Conquête de Constantinople, édit. N. de Wailly, 127-128.)
Alors21 ils partirent du port d’Avie22 tous ensemble. Ainsi vous eussiez pu voir le Bras-Saint-George23, en remontant, fleuri de nefs et de galères et d’huissiers24 ; et bien grande merveille était la beauté de ce spectacle. Et ainsi ils parcoururent en le remontant le Bras-Saint-George, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, en juin25 à Saint-Étienne, à une abbaye qui était à trois lieues de Constantinople. Et alors ceux des nefs et des galères et des huissiers virent tout à plein Constantinople, et prirent port et ancrèrent leurs vaisseaux. Or vous pouvez savoir qu’ils regardèrent beaucoup Constantinople, ces gens qui jamais ne l’avaient vue ; [au point] qu’ils ne pouvaient pas croire qu’une si riche ville pût être en tout le monde, quand ils virent ces hautes murailles et ces riches tours dont elle était close tout autour à la ronde, et ces riches palais, et ces hautes églises, dont il y avait tant que nul n’aurait pu le croire, s’il ne l’eût vu de ses yeux, et la longueur et la largeur de la ville, qui, parmi toutes les autres, était souveraine. Et sachez qu’il n’y eut [homme] si hardi, à qui la chair ne frémît ; et ce ne fut pas merveille, [vu] que jamais si grande affaire ne fut entreprise par aucune nation, depuis que le monde fut établi.
Le Roman de la Rose §
I
Guillaume de Lorris26
(vers 1230) §
Le printemps §
Le morceau qu’on va lire est un fragment du début du Roman de la Rose27, dont le cadre, comme celui de beaucoup d œuvres poétiques du moyen âge, est le récit d’un songe. Quant au sujet du poème c’est la conquête de la Rose, gardée par Danger (Domination, Tyrannie), Jalousie, Avarice, et qui est enfin cueillie par le héros, aidé de Bel-Accueil, Pitié, Franchise.
(Roman de la Rose, vers 47-86. Édition Francisque Michel, Paris, 1864.)
J’étais en mai, voilà ce que je rêvais, — au temps amoureux, plein de joie, — au temps où toute chose s’égaye, — au point que l’on ne voit buisson ni haie — qui en mai ne se veuille parer — et couvrir de feuilles nouvelles. — Les bois recouvrent leur verdure, — eux qui sont desséchés tant que dure l’hiver ; — la terre même s’enorgueillit, — à cause de la rosée qui la mouille, — et oublié la pauvreté — où elle a été tout l’hiver. — Alors la terre devient si enflée de vanité, — qu’elle veut avoir robe nouvelle ; — et certes sait se faire une robe si élégante, — qu’il y a là cent paires de couleurs, — d’herbes, de fleurs indiennes et persanes — et de maintes nuances diverses. — C’est la robe que je décris, — en raison de laquelle la terre se prise davantage. — Les oiseaux, qui se sont tus — tant qu’ils ont eu le froid — et le temps changeant et mauvais, — sont, en mai, à cause du temps serein, — si joyeux qu’ils montrent en chantant — -qu’en leur cœur il y a tant de joie — qu’il leur faut chanter forcément. — Le rossignol alors s’efforce de chanter et de faire bruit ; — alors s’évertuent et alors se divertissent — le perroquet et l’alouette ; — alors il faut que jeunes gens s’occupent — à être gais et amoureux, — à cause du temps beau et doux. — Très dur cœur a celui qui, en mai, n’est pas amoureux, — quand il entend chanter sur les branches — aux oiseaux les doux chants émouvants. — C’est dans ce temps délicieux, — alors que toute chose s’émeut d’aimer, — que je songeais, une nuit, que j’étais.
II
Jean de Meüng31
(vers 1250 — vers 1305) §
Plaintes d’un mari §
(Roman de la Rose, v. 9310-9339. Edition Francisque Michel.)
Ah ! Si j’avais cru Théophraste, — jamais je n’eusse pris femme ; — il ne regarde pas comme homme sage — celui qui prend une femme en mariage. — Celui-là a une vie trop lourde, — pleine de travail et de peine, — et de contestations et de disputes, — à cause de l’orgueil des femmes sottes, — et des dangers et des reproches — qu’elles font et disent par leur bouche, — et des réclamations et des plaintes — qu’elles inventent en mainte occasion. — Il y a même en outre grand peine à les tenir, — pour s’opposer à leurs folles volontés. — Et qui veut prendre une femme pauvre, — il lui faut songer à la nourrir — et à la vêtir et à la chausser : — et s’il pense à s’élever tellement — qu’il la prenne fortement riche, — il a grand tourment à la supporter ; — il la trouve si orgueilleuse et fière — et outrecuidante et fanfaronne, — qu’elle n’estimera son mari — nullement, et partout dépréciera — ses parents et toute sa lignée — par son langage orgueilleux.
Jean de Joinville35
(1224-1317) §
Comment Saint Louis rendait la justice §
Maintes foiz avint que en estei il se aloit seoir ou bois de Vinciennes après sa messe, et se acostoioit à un chesne et nous fesoit seoir entour li ; et tuit cil qui avoient affaire venoient parler à li, sanz destourbier de huissier ne d’autre. Et lors il leur demandoit de sa bouche : « A-il ci nullui qui ait partie ? » Et cil se levoient qui partie avoient. Et lors il disoit : « Taisiés-vous tuit, et on vous déliverra l’un après l’autre. » Et lors il appeloit mon signor Perron de Fonteinnes et mon signor Geffroy de Villette et disoit à l’un d’aus : « Delivrez-moi ceste partie ».
Et quand il veoit aucune chose à amender en la parole de ceus qui parloient pour li, ou en la parole de ceus qui parloient pour autrui, il-meismes l’amendoit de sa bouche. Je le vi aucune foiz, en estei, que, pour delivrer sa gent, il venoit ou jardin de Paris, une cote de chamelot vestue, un seurcot de tyreteinne sanz manches, un mantel de cendal noir entour son col, mout bien pigniez et sans coife, et un chapel de paon blanc sus sa teste. Et fesoit estendre tapis pour nous seoir entour li ; et touz li peuples qui avoit afaire par devant li estoit entour li en estant. Et lors il les faisoit délivrer en la manière que je vous ai dit devant dou bois de Vincennes.
(Histoire de Saint Louis, XII, édit. de Wailly.)
Mainte fois (il) advint qu’en été il allait s’asseoir au bois de Vincennes après la messe et s’accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient (une) affaire venaient lui parler, sans empêchement d’huissier ou d’autre. Et alors il leur demandait de sa bouche : « Y a-t-il ici nul (homme) qui ait procès ? » Et ceux qui avaient procès se levaient. Et alors il disait : « Taisez-vous tous et on vous expédiera l’un après l’autre. » Et alors il appelait monseigneur Pierre de Fontaine36 et monseigneur Geoffroy de Villette37 et disait à l’un d’eux : « Expédiez-moi ce procès ».
Et quand il voyait quelque chose à corriger dans la parole de ceux qui parlaient pour lui38, ou dans la parole de ceux qui parlaient pour autrui, lui-même le corrigeait de sa bouche. Je le vis quelquefois, en été, lorsque, pour expédier ses gens, il venait au jardin de Paris39 ayant revêtu une cotte de camelot40, un surtout de tiretaine41 sans manches, un manteau de taffetas noir autour du cou, très bien peigné et sans coiffe42, et un chapeau de paon blanc sur sa tête. Et (il) faisait étendre un tapis pour nous asseoir autour de lui ; et tous les gens qui avaient (une) affaire par-devant lui étaient autour de lui en se tenant debout. Et alors il les faisait expédier, en la manière que je vous ai dite ci-dessus (à propos) du bois de Vincennes.
Jean Froissart43
(1337 — vers 1410) §
Les Six bourgeois de Calais devant Édouard iii44 §
Cil six bourgois se misent45 tantost en genoulz par devant le roy46 et disent ensi en joindant leurs mains : « Gentilz sires et gentilz rois, ves nous chi six, qui avons esté d’ancisserie bourgois de Calais et grans marceans. Si vous aportons les clés de la ville et dou chastiel de Calais, et les vous rendons à vostre plaisir, et nous mettons en tel point que vous nous veés, en vostre pure volenté, pour sauver le demorant dou peuple de Calais ; si voelliès avoir de nous pité et merci par vostre très haute noblèce. » Certes il n’i eut adonc en le place signeur, chevalier ne vaillant homme, qui se peuist abstenir de plorer de droite pité, ne qui peuist en grant pièce parler. Li rois regarda sus yaus très ireusement, car il avoit le coer si dur et si espris de grant courous que il ne peut parler ; et quant il parla, il commanda que on leur copast les tiestes tantost. Tout li baron et li chevalier qui là estoient, en plorant prioient si acertes que faire le pooient au roy qu’il en vosist avoir pité, merci ; mais il n’i voloit entendre.
Adonc parla messires Gautiers de Mauni47 et dist : « Ha ! gentilz sires, voelliés rafrener vostre corage. Vous avés le nom et la renommée de souverainne gentillèce et noblèce. Or ne voelliés donc faire cose par quoi elle soit noient amenrie, ne que on puist parler sur vous en nulle manière villainne. Se vous n’avés pité de ces gens, toutes aultres gens diront que ce sera grant cruaultés, se vous faites morir ces honnestes bourgois, qui de lor propre volenté se sont mis en vostre merci pour les aultres sauver. » A ce point se grigna li rois et dist : « Messire Gautier, souffrés vous, il ne sera aultrement, mès on face venir le cope teste. Chil de Calais ont fait morir tant de mes hommes, que il convient chiaus morir ossi. »
Adonc fist la noble royne d’Engleterre grant humilité, qui ploroit si fermement de pité que on ne le pooit soustenir. Elle se jeta en jenoulz par devant le roy son signeur et dist ensi : « Ha ! gentilz sires, puis que je apassai la mer par deçà en grand péril, si com vous savés, je ne vous ay riens rouvet ne don demandet. Or vous pri jou humblement et requier en propre don que, pour le fil sainte Marie et pour l’amour de mi, vous voelliés avoir de ces six hommes merci. »
Li rois attendi un petit de parler et regarda la bonne dame sa femme, qui ploroit devant lui en jenoulz moult tenrement. Se li amolia li coers, car envis l’euist couroucie ens ou point là où elle estoit ; si dist : « Ha ! dame, je aimaisse mieulz que vous fuissiés d’autre part que ci. Vous me priiés si acertes que je ne le vous ose escondire ; et comment que je le face envis, tenés, je les vous donne : si en faites vostre plaisir. » La bonne dame dist : « Monseigneur, très grans mercis ».
Lors se leva la royne et fist lever les six bourgois, et leur fist oster les chevestres d’entours les colz, et les amena avoec-ques lui en sa cambre et les fist revestir et donner à disner tout aise ; et puis donna à cascun six nobles48 et les fist conduire hors de l’ost à sauveté.
(Chroniques, livre I, § 312.)
Ces six bourgeois se mirent aussitôt à genoux par devant le roi et dirent ainsi en joignant les mains : « Gentil seigneur et gentil roi, nous voici six, qui avons été, d’ancienneté, bourgeois de Calais et grands marchands. Ainsi49 nous vous apportons les clefs de la ville et du château de Calais et vous les rendons à votre plaisir, et nous remettons, dans l’état que vous voyez, à votre entière volonté, pour sauver le reste du peuple de Calais ; aussi veuillez, par votre très haute noblesse, avoir pitié et merci de nous. » Certes il n’y eut alors en ce lieu seigneur, chevalier ni vaillant homme, qui se pût abstenir de pleurer de juste pitié, ni qui pût de longtemps parler. Le roi jeta un regard sur eux tout à fait en colère, car il avait le cœur si dur et si rempli de grand courroux qu’il ne put parler ; et quand il parla, il commanda qu’on leur coupât la tête tout de suite. Tous les barons et les chevaliers qui étaient là en pleurant priaient le roi aussi instamment qu’ils le pouvaient faire de vouloir bien avoir pitié d’eux, miséricorde ; mais il n’y voulait entendre.
Alors parla messire Gautier de Mauni et dit : « Ha ! gentil seigneur veuillez réfréner votre cœur. Vous avez la gloire et la renommée de souveraine gentillesse et noblesse. Ne veuillez donc pas maintenant faire chose par laquelle elle soit en rien amoindrie, ni (telle) qu’on pût parler sur vous en aucune manière vilaine. Si vous n’avez pitié de ces gens, tous les autres gens diront que ce sera grande cruauté de faire mourir ces honnêtes bourgeois, qui, de leur propre volonté, se sont remis à votre merci pour sauver les autres. » A ce moment, le roi se fâcha et dit : « Messire Gautier, taisez-vous, il n’en sera pas autrement : mais qu’on fasse venir le coupe-tête. Ceux de Galais ont fait mourir tant de mes hommes qu’il convient que ceux-ci meurent aussi. »
Alors la noble reine d’Angleterre, qui pleurait si tendrement de pitié qu’on ne pouvait la soutenir, fit une grande humilité. Elle se jeta à genoux devant le roi son seigneur et dit ainsi : « Ah ! gentil seigneur, depuis que je passai la mer pour venir ici en grand danger, ainsi que vous savez, je ne vous ai prié de rien ni demandé un présent. Or vous prié-je humblement et vous demande en présent personnel que, pour le Fils de sainte Marie et pour l’amour de moi, vous veuillez avoir pitié de ces six hommes. »
Le roi attendit un peu pour parler et regarda la bonne dame sa femme, qui pleurait devant lui à genoux très tendrement. Ainsi son cœur s’amollit, car c’est à contre-cœur qu’il l’eût fâchée, dans l’état où elle était. Ainsi il dit : « Ha, madame, j’eusse mieux aimé que vous eussiez été d’un autre côté qu’ici. Vous me priez si instamment que je n’ose vous refuser ; et quoique je le fasse malgré moi, tenez, je vous les donne ; ainsi faites-en votre plaisir. » La bonne dame dit : « Monseigneur, très grand merci ».
Alors la reine se leva et fit lever les six bourgeois et leur fit ôter les cordes d’autour du cou et les emmena avec elle dans sa chambre et les fit revêtir et leur fit donner à dîner tout à leur aise ; et puis donna à chacun six nobles et les fit conduire hors du camp en sauvegarde.
Charles d’Orléans50
(1391-1465) §
Rondeaux51 §
I
Le printemps §
(Rondeaux, LXIII.)
II
L’été §
(Rondeaux, LXI.)
Villon63
(né en 1431) §
Ballade64 des dames du temps jadis §
Envoi82 §
(Le Grand Testament, vers 319-356.)
L’égalité dans la mort §
(Le Grand Testament, vers 1744-1767.)
Philippe de Commynes101
(vers 1445-1511) §
Louis XI à Plessis-Lès102-Tours §
Ledict seigneur, vers la fin de ses jours, feit clorre, tout à l’entour de sa maison de Plessis lez Tours, de gros barreaulx de fer103, en forme de grosses grilles ; et aux quatre coings de la maison, quatre moyneaulx104 de fer, bons, grans et espes105. Lesdictes grilles estoient contre le mur, du costé de la place, de l’aultre part du fossé (car il estoit à fons de cuve), et y feit mettre plusieurs broches de fer massonnées dedans le mur, qui avoient chacune trois ou quatre poinctes106, et les feit mettre fort près l’une de l’aultre. Et davantaige107 ordonna108 dix arbalestriers dedans lesdictz fossez pour tirer à ceulx109 qui en approucheroient avant que la porte fust ouverte ; et entendoit qu’ils couchassent ausditz fossez et se retirassent ausdictz moyneaulx de fer. Et il entendoit bien que ceste fortification ne suffisoit point contre grant nombre de gens, ne contre une armée ; mais de cela il n’avoit point paour, mais craignoit que quelque seigneur, ou plusieurs, ne feissent une entreprinse de prendre la place, demy par amour110 et demy par force, avec quelque peu d’intelligence111, et que ceulx-là prinssent l’auctorité et le feissent vivre comme homme sans sens et indigne de gouverner.
La porte du Plessis ne se ouvroit qu’il ne fust112 huict heures du matin, et ne baissoit le pont113 jusques à ladicte heure, et lors y entroient les officiers : et les cappitaines des gardes mettoient les portiers ordinaires, et puis ordonnoient leur guet d’archiers, tant à la porte que parmy la court, comme en une place de frontière estroictement gardee : et nul n’y entroit que par le guichet et que ce ne fust du sceu114 du Roy, excepté quelque maistre d’hostel et gens de ceste sorte, qui n’alloient point devers luy. Est-il donc possible de tenir ung roy, pour le garder plus honnestement, en plus estroicte prison que luy mesmes se tenoit ? Les caiges115 où il avoit tenu les aultres avoient quelques116 huict pieds en carré ; et luy, qui estoit si grant roy, avoit une bien petite court de chasteau à se proumener : encores n’y venoit il gueres, mais se tenoit en la gallerie, sans partir de là, sinon que par les chambres alloit à la messe, sans passer par ladicte court. Vouldroit l’on dire que ce Roy ne souffrist pas aussi bien que les aultres, qui ainsi s’enfermoit et se faisoit garder, qui estoit ainsi en paour de ses enfans et de tous ses prouchains parens, qui changeoit et muoit117 de jour en jour ses serviteurs et nourriz118, et qui ne tenoient bien ne honneur que de luy, et en nul d’eux ne se osoit fier, et s’enchainoit ainsi de si estrange chaîne et clostures ? Si le lieu estoit plus grant que d’une prison commune, aussi estoit-li plus grant que prisonniers communs119.
On pourroit dire que d’aultres ont été plus souspesonneux que luy ; mais ce n’a pas esté de nostre temps, ne par adventure homme si saige que luy, ny ayant si bons subjectz : et avoient ceulx-là, par adventure120, esté cruelz et tyrans ; mais cestuy cy n’a faict mal à nul qui ne luy eust faict quelque offense : je ne diz pas tous de qualité de mort121.
Je n’ay point dict ce que dessus122 pour seullement parler des suspections123 de nostre Roy, mais pour dire que la patience qu’il a porté en ses passions124, semblables à celles qu’il a faict porter aux aultres, je la repute à pugnition125 que Nostre Seigneur luy a donnée en ce monde pour en avoir126 moins en l’aultre, tant es choses dont j’ay parlé, comme en ses malladies127, bien grandes et douloureuses pour luy, et qu’il craignoit beaucoup avant qu’elles lui advinssent : et aussi affin que ceulx qui viendront après luy soient ung peu plus piteux128 au peuple, et moins aspres a pugnir qu’il n’avoit esté : combien que je ne luy vueil donner charge129, ne dire avoir veu ung meilleur prince, car se il pressoit130 ses subjectz, toutes fois il n’eust point souffert que ung aultre l’eust faict, ne privé, ny estrange131. (Mémoires, livre VI, chap. xi.)
Rabelais
(1495-1553) §
Né à Chinon, probablement en 1494, mort en 1553 ou dans les premiers mois de 1554, François Rabelais est l’auteur d’une sorte de roman allégorique, la Vie de Gargantua et de Pantagruel, tissu d’aventures bouffonnes, qui recouvre à la fois l’exposé des connaissances et la satire des ridicules et des abus de son époque. Son style, naturel et savant, d’une richesse et d’une variété extraordinaires, souvent familier jusqu’à la grossièreté, et quelquefois élevé, toujours plein de verve et de mouvement, toujours approprié à la pensée, l’a fait mettre au nombre de nos plus grands écrivains.
Garguantua devant un chateau fort §
Adonc132 monta Gargantua sur sa grande jument. Et trouvant en son chemin un haut et grand arbre (lequel communément on nommait l’arbre de saint Martin, pource qu’ainsi était cru un bourdon133 que jadis saint Martin y planta), dit : « Voici ce qu’il me fallait. Cet arbre me servira de bourdon et de lance. » Et l’arracha facilement de terre, et en ôta les rameaux, et le para134 pour son plaisir… Gargantua venu à l’endroit135 du bois fut avisé136 par Eudémon137 que dedans le château138 était quelque reste des ennemis139, pour laquelle chose savoir Gargantua s’écria tant qu’il put : « Êtes-vous là, ou n’y êtes pas140 ? Si vous y êtes, n’y soyez plus ; si n’y êtes, je n’ai que dire141. » Mais un ribaud142 canonnier, qui était au mâchicoulis143, lui tira un coup de canon, et l’atteint144 par la tempe dextre145 furieusement : toutefois ne lui fit pour ce146 mal en plus que s’il lui eût jeté une prune : « Qu’est-ce là ? dit Gargantua. Nous jetez-vous ici des grains de raisin ? La vendange vous coûtera cher », pensant de vrai que le boulet fût un grain de raisin. Ceux qui étaient dedans le château amusés à la pille147, entendant le bruit, coururent aux tours et forteresses, et lui tirèrent plus de neuf mille vingt et cinq coups de fauconneau148 et arquebuse, visant tous à sa tête ; et si menu tiraient contre lui qu’il s’écria : « Ponocrates149, mon ami, ces mouches ici m’aveuglent ; baillez-moi150 quelque rameau de ces saules pour les chasser », pensant des plombées et pierres d’artillerie151 que fussent152 mouches bovines153.
Ponocrates l’avisa que n’étaient autres mouches que les coups d’artillerie que l’on tirait du château.
Alors choqua de son grand arbre contre le château et à grands coups abattit et tours et forteresses, et ruina154 tout par terre. Par ce moyen furent tous rompus155 et mis en pièces ceux qui étaient en icelui156.
(La vie de Gargantua et de Pantagruel, livre 1, chap. xxxvi.)
Le son et la fumée §
A Paris, en la rôtisserie du petit Châtelet157 au devant158 de l’ouvroir159 d’un rôtisseur, un faquin160 mangeait son pain à la fumée du rôt, et le trouvait, ainsi parfumé, grandement savoureux. Le rôtisseur le laissait faire. Enfin, quand tout fut baufré161, le rôtisseur happe le faquin au collet, et voulait162 qu’il lui payât la fumée de son rôt. Le faquin disait en rien n’avoir ses viandes163 endommagé, rien n’avoir du sien pris164, en rien ne lui être débiteur. La fumée165 dont était question évaporait166 par dehors : ainsi comme ainsi167 se perdait-elle168 ; jamais n’avait169 été ouï que, dedans Paris, on eût vendu fumée de rôt en rue. Le rôtisseur répliquait que de fumée de son rôt n’était tenu170 nourrir les faquins, et reniait171, en cas qu’il ne le payât, qu’il lui ôterait ses crochets. Le faquin tire son tribart172, et se mettait en défense.
L’altercation fut grande. Le badaud173 peuple de Paris accourut au débat de toutes parts. Là se trouva à propos Seigny Joan174 le fol citadin de Paris. L’ayant aperçu, le rôtisseur demanda au faquin : « Veux-tu sus notre différend croire ce noble Seigny Joan ? — Oui, par le sambreguoi175 », répondit le faquin. Adonc176 Seigny Joan, après avoir leur discord entendu, commanda au faquin qu’il lui tirât de son baudrier177 quelque pièce d’argent. Le faquin luy mit en main un tournois philippus178. Seigny Joan le prit, et le mit sus son épaule gauche, comme explorant s’il était de poids179 ; puis le timpait180 sus la paume de sa main gauche, comme pour entendre s’il était de bon aloi181 ; puis le posa sus la prunelle de son œil droit, comme pour voir s’il était bien marqué182. Tout ce183 fut fait en grand silence de tout le badaud peuple, en ferme attente du rôtisseur et désespoir du faquin. Enfin le fit sus l’ouvroir sonner par plusieurs fois. Puis, en majesté présidentale184, tenant sa marote185 au poing, comme si fût186 un sceptre, et affublant187 en tête188 son chaperon de martres singesses à oreilles de papier, fraisé à points d’orgues189, toussant préalablement deux ou trois bonnes fois, dit à haute voix : « La cour190 vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du rôt, civilement191 a payé le rôtisseur au son de son argent. Ordonne ladite cour que chacun se retire en sa chacunière192, sans dépens, et pour cause193 ». Cette sentence du fol parisien tant a semblé équitable voire admirable ès194 docteurs, qu’ils font doute, en cas que la matière eût été au parlement dudit lieu195, ou en la Rote à Rome196, voire certes entre les aréopagistes197 décidée, si plus juridiquement eût été par eux sentencié198.
(Pantagruel, livre III, chap. xxxvii.)
Bonaventure Des Périers
(commencement du XVIe siècle — vers 1544) §
Bonaventure des Périers, d’Arnay-le-Duc199 était valet de chambre de Marguerite de Navarre, sœur de François Ier. Catholique converti au protestantisme, il publia sur les controverses religieuses une suite de quatre dialogues satiriques, à propos desquels il fut inquiété, et finit par se tuer. La postérité s’est surtout souvenue de ses Nouvelles récréations et joyeux devis200, contes en prose pleins de bonne humeur, dont le recueil ne fut publié qu’après sa mort201.
Du savetier Blondeau §
Qui ne fut onc202 en sa vie mélancolique que deux fois, et comment il y pourvut et de son épitaphe.
A Paris sus203 Seine trois bateaux y a204 ; mais il y avait aussi un savetier que l’on appelait Blondeau, lequel avait sa loge près la Croix du Tiroir205, là où il refaisait les souliers, gagnant sa vie joyeusement, et aimait le bon vin sur tout, et l’enseignait206 volontiers à ceux qui y allaient ; car, s’il y en avait dans tout le quartier, il fallait qu’il en tâtât, et était content d’en avoir davantage et qu’il fût bon. Tout le long du jour il chantait et réjouissait tout le voisiné207. Il ne fut onc vu en sa vie marri208 que deux fois : l’une quand il eut trouvé en une vieille muraille un pot de fer auquel y avait grande quantité de pièces antiques de monnaie, les unes d’argent, les autres d’aloi209, desquelles il ne savait la valeur. Lors, il commença de devenir pensif. Il ne chantait plus ; il ne songait plus qu’en210 ce pot de quinquaille211. Il fantasiait212 en soi même : « La monnaie n’est pas de mise213, je n’en saurais avoir ni pain ni vin. Si je la montre aux orfèvres, ils me déceleront214 ou ils en voudront avoir leur part, et ne m’en bailleront215 pas la moitié de ce qu’elle vaut. » Tantôt il craignait de n’avoir pas bien caché ce pot et qu’on le lui dérobât. A toutes heures il partait de sa tente216 pour l’aller remuer217.
Il était en la plus grande peine du monde ; mais à la fin il se vint à reconnaître218, disant en soi-même : « Comment ! je ne fais que penser en mon pot ; les gens connaissent bien à ma façon219 qu’il y a quelque chose de nouveau en mon cas. Bah ! le diable y ait part au pot ! il me porte malheur. » En effet, il le va prendre gentiment et le jette en la rivière, et noya toute sa mélancolie avec ce pot220.
Une autre fois, il se trouva fâché d’un monsieur qui demeurait tout vis-à-vis de sa logette ; au moins il avait sa logette tout vis-à-vis de monsieur, lequel quidam221 monsieur avait un singe qui faisait mille maux au pauvre Blondeau ; car il l’épiait d’une fenêtre haute quand il taillait son cuir et regardait comme il faisait ; et aussitôt que Blondeau était allé dîner ou en quelque part222 à son affaire, ce singe descendait et venait en la loge de Blondeau, et prenait son tranchet et découpait le cuir de Blondeau, comme il l’avait vu faire ; et de cela faisait coutume à tous les coups que Blondeau s’écartait223De sorte que le pauvre homme fut tout un temps qu’il n’osait aller boire ni manger hors de sa boutique sans enfermer son cuir. Et si quelquefois il oubliait à le serrer224, le singe n’oubliait pas à le lui tailler en lopins, chose qui lui fâchait fort225, et si226 n’osait pas faire mal à ce singe par crainte de son maître.
Quand il en fut bien ennuyé, il délibéra de s’en venger. Après s’être bien aperçu de la manière qu’avait ce singe, qui était de faire en la propre sorte qu’il voyait faire (car, si Blondeau avait aiguisé son tranchet, ce singe l’aiguisait après lui ; s’il avait poissé du ligneul227, ainsi faisait ce singe ; s’il avait cousu quelque carrelure228, ce singe s’en venait jouer des coudes comme il lui avait vu faire), à l’une des fois Blondeau aiguisa un tranchet et le fit couper comme un rasoir, et puis, à l’heure qu’il vit ce singe en aguet, il commença à se mettre ce tranchet contre la gorge et le mener et ramener comme s’il se fût voulu égosiller. Et quand il eut fait cela longuement pour le faire aviser229 à ce singe, il s’en part230 de la boutique et s’en va dîner. Ce singe ne faillit pas incontinent à descendre231, car il voulait s’ébattre à ce nouveau passe-temps qu’il n’avait pas encore vu faire. Il vint prendre ce tranchet et tout incontinent se le met contre la gorge, en le menant et ramenant comme il avoit vu faire à Blondeau. Mais il l’approcha de trop près et ne se prit garde232 qu’en le frayant233 contre sa gorge, il se couppe le gosier de ce tranchet, qui était si bien affilé, dont234 il mourut avant qu’il fût une heure de là. Ainsi Blondeau fut vengé de son singe sans danger, et se remit à sa coutume première de chanter et faire bonne chère235, laquelle lui dura jusqu’à la mort : et, en la souvenance de la joyeuse vie qu’il avait menée, fut fait un épitaphe236 de lui qui s’ensuit237 :
(Les Nouvelles récréations et joyeux devis, nouvelle XIX.)
Bernard Palissy
(vers 1510-1587) §
Né dans le diocèse d’Agen, Bernard Palissy a surtout vécu à Saintes jusqu’au moment où, inquiété et arrêté comme protestant, il put, grace à de puissantes protections, partir pour La Rochelle (1563) et, un peu plus tard, pour Paris, et c’est à Paris qu’il est mort, probablement à la Bastille, au cours d’un procès criminel que le gouvernement de la Ligue lui avait intenté pour hérésie. Artisan et géomètre, artiste de génie en même temps qu’inventeur des procédés qu’il met en œuvre pour réaliser ses conceptions, géologue qui mérite, au moins par l’originalité de ses vues et par ses qualités d’observateur, une place dans l’histoire de la science, écrivain d’une éloquence simple, mâle et variée, ajoutons à cela homme de conscience et de foi ardente, dévoué à sa religion jusqu’au sacrifice héroïque, Bernard Palissy, par la diversité de ses talents et son énergie multiple est, en France, parmi tous les artistes et les écrivains de son époque, l’un de ceux qui, en nous étonnant le plus, la représentent le mieux. Il a laissé deux ouvrages enferme de dialogues où sont exposées ses vues scientifiques et industrielles. Recette véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et augmente leurs trésors (1564) et Discours admirables de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu’artificielles, des métaux, etc. (1580).
Les efforts et les angoisses de Palissy à la recherche des émaux §
Sache238 qu’il y a vingt et cinq ans passés239 qu’il me fut montré une coupe de terre, tournée et émaillée d’une telle beauté240 que dès lors j’entrai en dispute avec ma propre pensée, en me remémorant plusieurs propos qu’aucuns241 m’avaient tenus en se moquant de moi lorsque je peignais les images242. Or voyant que l’on commençait à les délaisser au pays de mon habitation243, aussi que244 la vitrerie n’avait pas grande requête245, je vais246 penser que, si j’avais trouvé l’invention de faire des émaux, je pourrais faire des vaisseaux247 de terre et autre chose de belle ordonnance248, parce que Dieu m’avait donné d’entendre quelque chose de la portraiture249 ; et dès lors, sans avoir égard que250 je n’avais nulle connaissance des terres argileuses, je me mis à chercher les émaux comme un homme qui tâte251 en ténèbres. Sans avoir entendu de quelles matières se faisaient les dits émaux, je pilais en ces jours là de toutes les matières que je pouvais penser qui pourraient faire quelque chose, et, les ayant pilées et broyées, j’achetais une quantité de pots de terre, et, après les avoir mis en pièces, je mettais des matières que j’avais broyées dessus icelles252, et, les ayant marquées253, je mettais en écrit à parties drogues que j’avais mises sus254 chacune d’icelles, pour mémoire ; puis ayant fait un fourneau à ma fantaisie255, je mettais cuire les dites pièces pour voir si mes drogues pourraient faire quelques couleurs de blanc : car je ne cherchais autre émail que le blanc, parce que j’avais ouï dire que le blanc était le fondement de tous les autres émaux256. Or, parce que je n’avais jamais vu cuire terre, ni ne savais à quel degré de feu le dit émail se devait fondre, il m’était impossible de pouvoir rien faire par ce moyen, ores257 que mes drogues eussent été bonnes, parce qu’aucunes fois258 la chose avait trop chauffé et autres fois trop peu, et quand les dites matières étaient trop peu cuites ou brûlées, je ne pourais rien juger de la cause pour quoi je ne faisais rien de bon, mais en donnais le blâme aux matières, combien que259 quelquefois la chose se fût peut-être trouvée bonne, ou pour le moins j’eusse trouvé quelque indice pour parvenir à mon intention si j’eusse pu faire le feu selon que les matières le requéraient. Mais encore en ce faisant je commettais une faute plus lourde que la susdite : car en mettant les pièces de mes épreuves dedans260 le fourneau, je les arrangeais sans considération261 ; de sorte que les matières eussent été262 les meilleures du monde et le feu le mieux à propos, il était impossible de rien faire de bon. Or, m’étant ainsi abusé plusieurs fois, avec grands frais et labeurs, j’étais tous les jours à piler et à broyer nouvelles matières et construire nouveaux fourneaux avec grande dépense d’argent et consommation de bois et de temps.
Quand j’eus batelé263 plusieurs aimées ainsi imprudemment, avec tristesse et soupirs, à cause que je ne pouvais parvenir à rien de mon intention, et me souvenant de la dépense perdue, je m’avisai, pour obvier à si grande dépense, d’envoyer les drogues que je voulais approuver264 à quelque fourneau de potier ; et ayant conclu en mon esprit telle chose, j’achetai derechef plusieurs vaisseaux de terre, et les ayant rompus en pièces, comme de coutume, j’en265 couvris trois ou quatre cents pièces d’émail, et les envoyai en une poterie distante d’une lieue et demie de ma demeurance266, avec requête envers les potiers qu’il leur plût permettre cuire les dites épreuves dedans aucuns de leurs vaisseaux : ce qu’ils faisaient volontiers ; mais quand ils avaient cuit leur fournée et qu’ils venaient à tirer mes épreuves, je n’en recevais que honte et perle, parce qu’il ne se trouvait rien de bon, à cause que le feu des dits potiers n’était assez chaud, aussi que267 mes épreuves n’étaient enfournées au devoir requis268 et selon la science ; et parce que je n’avais connaissance de la cause pourquoi mes épreuves ne s’étaient bien trouvées, je mettais, comme j’ai dit ci-dessus, le blâme sus les matières ; derechef je faisais nombre de compositions nouvelles et les envoyai aux mêmes potiers, pour en user comme dessus269 : ainsi fis-je par plusieurs fois, toujours avec grands frais, perte de temps, confusion et tristesse.
Quand je vis que je ne pouvais par ce moyen rien faire de mon intention, je pris relâche quelque temps, m’occupant à mon art de peinture et de vitrerie, et me mis comme en nonchaloir de plus chercher270 les secrets des émaux. Quelques jours après survinrent certains commissaires, députés par le roi, pour ériger la gabelle271 au pays de Saintonge, lesquels m’appelèrent pour figurer272 les îles et pays circonvoisins de tous les marais salants du dit pays. Or, après que la dite commission fut parachevée, et que je me trouvai muni d’un peu d’argent, je repris encore l’affection273 de poursuivre à la suite274 des dits émaux, et voyant que je n’avais pu rien faire dans mes fourneaux ni à ceux des potiers susdits, je rompis environ trois douzaines de pots de terre tout neufs, et, ayant broyé grande quantité de diverses matières, je couvrai tous les lopins des dits pots des dites drogues275 couchées276 avec le pinceau : mais il te faut entendre que de deux ou trois cents pièces, il n’y en avait que trois de chacune composition277. Ayant ce fait, je pris toutes ces pièces et les portai à une verrerie, afin de voir si mes matières et compositions se pourraient trouver bonnes aux fours des dites verreries. Or, d’autant que278 leurs fourneaux sont plus chauds que ceux des potiers, ayant mis toutes mes preuves dans les dits fourneaux, le lendemain, que279 je les fis tirer, j’aperçus partie de mes compositions qui avaient commencé à fondre, qui280 fut cause que je fus encore davantage encouragé de281 chercher l’émail blanc, pour lequel j’avais tant travaillé.
Touchant des282 autres couleurs, je ne m’en mettais aucunement en peine ; ce peu d’apparence283 que je trouvai lors me fit travailler pour chercher le dit blanc deux ans outre le temps susdit, durant lesquels deux ans je ne faisais qu’aller et venir aux verreries prochaines, tendant aux fins de parvenir à mon intention284. Dieu voulut qu’ainsi que285 je commençais à perdre courage, et que pour le dernier coup286 je m’étais transporté à une verrerie, ayant avec moi un homme chargé de plus de trois cents sortes d’épreuves, il se trouva287 une des dites épreuves qui fut fondue dedans288 quatre heures après avoir été mise au fourneau, laquelle épreuve se trouva blanche et polie, de sorte qu’elle me causa une joie telle que je pensais être devenu nouvelle créature. Et pensais dès lors avoir une perfection entière de l’émail blanc ; mais je fus fort éloigné de ma pensée : cette épreuve était fort heureuse d’une part, mais bien malheureuse de l’autre, heureuse en ce qu’elle me donna entrée à ce que289 je suis parvenu, et malheureuse en ce qu’elle n’était mise en dose ou mesure requise290.
Je fus si grand291 bête en ces jours-là que, soudain que j’eus fait le dit blanc qui était singulièrement beau, je me mis à faire des vaisseaux de terre, combien que jamais je n’eusse connu terre292, et ayant employé l’espace de sept ou huit mois à faire les dits vaisseaux, je me pris à ériger un fourneau semblable à ceux des verriers, lequel je bâtis avec un labeur indicible : car il fallait que je maçonnasse tout seul, que je détrempasse mon mortier, que je tirasse l’eau pour la détrempe d’icelui, aussi293 me fallait moi-même aller quérir la brique sur mon dos, à cause que je n’avais nul moyen d’entretenir un seul homme pour m’aider en cet affaire294. Je fis cuire mes vaisseaux en première cuisson ; mais quand ce fut à la seconde cuisson, je reçus des tristesses et labeurs tels que nul homme ne voudrait croire. Car, en lieu295 de me reposer de mes labeurs passés, il me fallut travailler l’espace de plus d’un mois, nuit et jour, pour broyer les matières desquelles j’avais fait ce beau blanc au fourneau des verriers ; et quand j’eus broyé les dites matières, j’en couvrai les vaisseaux que j’avais faits. Ce fait, je mis le feu dans mon fourneau par deux gueules, ainsi que j’avais vu faire aux dits verriers ; je mis aussi mes vaisseaux dans le dit fourneau, pour cuider296 faire fondre les émaux que j’avais mis dessus. Mais c’était une chose malheureuse pour moi : car, combien que je fusse six jours et six nuits devant le dit fourneau sans cesser de brûler bois par les deux gueules, il ne fut possible de pouvoir faire fondre le dit émail, et j’étais comme un homme désespéré.
Et combien que je fusse tout étourdi du travail, je me vais aviser que dans mon émail il y avait trop peu de la matière qui devait faire fondre les autres297 : ce que voyant, je me pris à piler et à broyer la dite matière, sans toutefois laisser refroidir mon fourneau ; par ainsi298 j’avais double peine, piler, broyer, et299 chauffer le dit fourneau. Quand j’eus ainsi composé mon émail, je fus contraint d’aller encore acheter des pots, afin d’éprouver le dit émail, d’autant que j’avais perdu tous les vaisseaux que j’avais faits ; et, ayant couvert les dites pièces du dit émail, je les mis dans le fourneau, continuant toujours le feu en sa grandeur. Mais sur cela il me survint un autre malheur, lequel me donna grande fâcherie, qui est que, le bois m’ayant failli300, je fus contraint brûler les étapes301 qui soutenaient les trailles302 de mon jardin ; lesquelles étant brûlées, je fus contraint brûler les tables et plancher de la maison, afin de faire fondre la seconde composition303. J’étais en une telle angoisse que je ne saurais dire : car j’étais tout tari et desséché à cause du labeur et de la chaleur du fourneau ; il y avait plus d’un mois que ma chemise n’avait séché sur moi ; encore, pour me consoler, on se moquait de moi, et même ceux qui me devaient304 secourir allaient crier par la ville que je faisais brûler le plancher ; et par tel moyen l’on me faisait perdre mon crédit, et m’estimait-on305 être fou.
Les autres disaient que je cherchais à faire la fausse monnaie, qui était un mal306 qui me faisait sécher sur les pieds ; et m’en allais par les rues tout baissé, comme un homme honteux ; j’étais endetté en plusieurs lieux, et avais ordinairement307 deux enfants aux nourrices, ne pouvant payer leur salaire personne ne me secourait, mais au contraire ils se moquaient de moi, en disant : « Il lui appartient bien de mourir308 de faim, parce qu’il délaisse son métier ». Toutes ces nouvelles venaient à mes oreilles quand je passais par la rue : toutefois il me resta encore quelque espérance, qui m’accourageait309 et soutenait, d’autant que les dernières épreuves310 s’étaient assez bien portées311 et dès lors en pensais savoir assez pour pouvoir gagner ma vie, combien que j’en fusse fort éloigné (comme tu entendras ci-après), et ne dois trouver mauvais si j’en fais un peu long discours312, afin de te rendre plus attentif à ce qui te pourra servir.
Quand je me fus reposé un peu de temps, avec regret de ce que nul n’avait pitié de moi, je dis à mon âme : « Qu’est-ce qui te triste313, puisque tu as trouvé ce que tu cherchais ? Travaille, à présent, et tu rendras honteux tes détracteurs. » Mais mon esprit disait d’autre part ; « Tu n’as rien de quoi poursuivre ton affaire ; comment pourras-tu nourrir ta famille et acheter les choses requises pour passer le temps de quatre ou cinq mois qu’il faut auparavant que314 tu puisses jouir de ton labeur ? » Or, ainsi que j’étais en telle tristesse et débat d’esprit, l’espérance me donna un peu de courage, et, ayant considéré que je serais beaucoup plus long pour faire une fournée toute de ma main315, pour abréger et gagner le temps et pour plus soudain faire apparoir316 le secret que j’avais trouvé du dit émail blanc, je pris un potier commun317 et lui donnai certains portraits318, afin qu’il me fît des vaisseaux selon mon ordonnance, et tandis qu’il faisait ces choses, je m’occupais à quelques médailles319. Mais c’était une chose pitoyable : car j’étais contraint nourrir le dit potier en une taverne à crédit, parce que je n’avais nul moyen320 en ma maison.
Quand nous eûmes travaillé l’espace de six mois, et qu’il fallait321 cuire la besogne faite, il fallut faire un fourneau et donner congé au potier, auquel, par faute d’argent, je fus contraint donner de mes vêtements pour son salaire. Or, parce que je n’avais point d’étoffes322 pour ériger mon fourneau, je me pris à défaire celui que j’avais fait à la mode des verriers, afin de me servir des étoffes de la dépouille d’icelui. Or, parce que le dit four avait si fort chauffé l’espace de six jours et nuits, le mortier et la brique du dit four s’étaient liquéfiés et vitrifiés de telle sorte qu’en démaçonnant j’eus les doigts coupés et incisés en tant d’endroits que je fus contraint manger mon potage323 ayant les doigts enveloppés de drapeau324. Quand j’eus défait le dit fourneau, il fallut ériger l’autre, qui325 ne fut pas sans grand peine : d’autant qu’il me fallait quérir l’eau, le mortier et la pierre, sans aucun aide et sans aucun repos. Ce fait, je fis cuire l’œuvre susdite en première cuisson, et puis, par emprunt ou autrement, je trouvai moyen d’avoir des étoffes pour faire des émaux, pour couvrir la dite besogne, s’étant bien portée en première cuisson : mais, quand j’eus acheté les dites étoffes, il me survint un labeur qui me cuida326 faire rendre l’esprit. Car, après que par plusieurs jours je me fus lassé à piler et calciner mes matières, il me les convint327 broyer sans aucune aide, à un moulin à bras, auquel il fallait ordinairement deux puissants hommes pour le virer328 : le désir que j’avais de parvenir à mon entreprise me faisait faire des choses que j’eusse estimées impossibles.
Quand les dites couleurs furent broyées, je couvris tous mes vaisseaux et médailles du dit émail ; puis, ayant le tout mis et arrangé dedans le fourneau, je commençai à faire du feu, pensant retirer de ma fournée trois ou quatre cents livres329, et continuai le dit feu jusqu’à ce que j’eus330 quelque indice et espérance que mes émaux fussent fondus331 et que ma fournée se portait bien. Le lendemain, quand je vins à tirer mon œuvre, ayant premièrement ôté le feu, mes tristesses et douleurs furent augmentées si abondamment que je perdis toute contenance. Car, combien que mes émaux fussent bons et ma besogne bonne, néanmoins deux accidents étaient survenus à la dite fournée, lesquels avaient tout gâté : et afin que tu t’en donnes de garde332, je te dirai quels ils sont : aussi333 après ceux-là je t’en dirai un nombre d’autres, afin que mon malheur te serve de bonheur et que ma perte te serve de gain. C’est parce que le mortier de quoi334 j’avais maçonné mon four était plein de cailloux, lesquels sentant la véhémence du feu, lorsque mes émaux se commençaient à liquéfier, se crevèrent335 en plusieurs pièces. Or, ainsi que336 les éclats des dits cailloux sautaient contre ma besogne, l’émail, qui était déjà liquéfié et rendu en matière glueuse337, prit les dits cailloux et se les attacha par toutes les parties de mes vaisseaux et médailles, qui sans cela se fussent trouvés beaux. Ainsi, connaissant que mon fourneau était assez chaud, je le laissai refroidir jusqu’au lendemain ; lors je fus si marri que je ne te saurais dire, et non sans cause : car ma fournée me coûtait plus de six vingts écus338. J’avais emprunté le bois et les étoffes, et avais emprunté partie de ma nourriture en faisant la dite besogne. J’avais tenu en espérance mes créditeurs339 qu’ils seraient payés de l’argent qui proviendrait des pièces de la dite fournée, qui fut cause que plusieurs accoururent dès le matin, quand je commençais à désenfourner. Dont par ce moyen furent redoublées mes tristesses, d’autant qu’en tirant340 la dite besogne je ne recevais que bonté et confusion. Car toutes mes pièces étaient semées de petits morceaux de cailloux, qui étaient si bien attachés autour des dits vaisseaux et liés avec l’émail, que, quand on passait les mains par dessus, les dits cailloux coupaient comme rasoir ; et combien que la besogne fût par ce moyen perdue, toutefois aucuns en voulaient acheter à vil prix : mais parce que c’eût été un décriement et rabaissement de mon honneur, je mis en pièces entièrement le total de la dite fournée341, et me couchai de mélancolie, non sans cause, car je n’avais plus de moyen de subvenir à ma famille ; je n’avais en ma maison que reproches ; en lieu de me consoler, l’on me donnait des malédictions : mes voisins, qui avaient entendu cet affaire342, disaient que je n’étais qu’un fol, et que j’eusse eu plus de huit francs de la besogne que j’avais rompue, et étaient toutes ces nouvelles jointes avec mes douleurs.
Quand j’eus demeuré quelque temps au lit, et que j’eus considéré en moi-même qu’un homme qui serait tombé en un fossé, son devoir serait de tâcher à se relever, en cas pareil, je me mis à faire quelques peintures, et, par plusieurs moyens, je pris peine de recouvrer un peu d’argent ; puis je disais en moi-même que toutes mes pertes et hasards343 étaient passés, et qu’il n’y avait rien plus qui me pût empêcher que je ne fisse de bonnes pièces ; et me pris, comme auparavant, à travailler au dit art. Mais en cuisant une autre fournée, il survint un accident duquel je ne me doutais pas : car la véhémence de la flambe344 du feu avait porté quantité de cendres contre mes pièces, de sorte que, par tous les endroits où la dite cendre avait touché, mes vaisseaux étaient rudes et mal polis, à cause que l’émail, s’étant liquéfié, s’était joint avec les dites cendres : nonobstant toutes ces pertes, je demeurai en espérance de me remonter par le moyen du dit art, car je fis faire grand nombre de lanternes de terre à certains potiers pour enfermer mes vaisseaux quand je les mettais au four345, afin que, par le moyen des dites lanternes, mes vaisseaux fussent garantis de la cendre. L’invention se trouva bonne, et m’a servi jusques aujourd’hui : mais, ayant obvié au hasard de la cendre, il me survint d’autres fautes et accidents tels que, quand j’avais fait une fournée, elle se trouvait trop cuite, et aucunes fois trop peu, et tout perdu346 par ce moyen. J’étais si nouveau347 que je ne pouvais discerner du trop ou du348 peu ; aucune fois349 ma besogne était cuite sur le devant et point cuite à la partie de derrière : l’autre350, après que je voulais obvier à tel accident, je faisais brûler le derrière, et le devant n’était point cuit ; aucune fois, il était cuit à dextre et brûlé à senestre351 ; aucune fois mes émaux étaient mis trop clairs, et autre fois trop épais, qui me causait de grandes pertes ; aucune lois que352 j’avais dedans le four diverses couleurs d’émaux, les uns étaient brûlés premier que353 les autres fussent fondus. Bref, j’ai ainsi batelé l’espace de quinze ou seize ans ; quand j’avais appris à me donner garde d’un danger, il m’en survenait un autre, lequel je n’eusse jamais pensé354.
Durant ces temps-là, je fis plusieurs fourneaux, lesquels m’engendraient de grandes pertes auparavant que j’eusse connaissance du moyen pour les échauffer également355 ; enfin je trouvai moyen de faire quelques vaisseaux de divers émaux entremêlés en manière de jaspe356 : cela m’a nourri quelques ans ; mais, en me nourrissant de ces choses, je cherchais toujours à passer plus outre357 avec frais et mises358, comme tu sais que je fais encore à présent. Quand j’eus inventé le moyen de faire des pièces rustiques359, je fus en plus grande peine et en plus d’ennui qu’auparavant. Car, ayant fait un certain nombre de bassins rustiques et les ayant fait cuire, mes émaux se trouvaient les uns beaux et bien fondus, autres mal fondus ; autres étaient brûlés, à cause qu’ils étaient composés de diverses matières qui étaient fusibles à divers degrés ; le vert des lézards était brûlé premier que la couleur des serpents fût fondue ; aussi360 la couleur des serpents, écrevisses, tortues et cancres était fondue auparavant que le blanc eût reçu aucune beauté. Toutes ces fautes m’ont causé un tel labeur et tristesse d’esprit, qu’auparavant que j’aie eu rendu361 mes émaux fusibles à un même degré de feu, j’ai cuidé entrer jusques à la porte du sépulcre : aussi en me travaillant à tels affaires, je me suis trouvé l’espace de plus de dix ans si fort écoulé362 en ma personne qu’il n’y avait aucune forme ni apparence de bosse363 aux bras ni aux jambes : ains364 étaient mes dites jambes toutes d’une venue365, de sorte que les liens de quoi j’attachais mes bas de chausses366 étaient, soudain que je cheminais, sur les talons avec le résidu de mes chausses367.
Je m’allais souvent promener dans la prairie de Saintes, en considérant mes misères et ennuis, et, sur toute chose, de ce qu’en368 ma maison même je ne pouvais avoir369 nulle patience, ni faire rien qui fût trouvé bon. J’étais méprisé et moqué de tous. Toutefois je faisais toujours quelques vaisseaux de couleurs diverses, qui me nourrissaient tellement quellement370 : mais en ce faisant, la diversité des terres desquelles je cuidais m’avancer371 me porta plus de dommage en peu de Temps que tous les accidents du paravant372. Car, ayant373 fait plusieurs vaisseaux de diverses terres, les unes étaient brûlées devant que les autres fussent cuites ; aucunes recevaient l’émail et se trouvaient fort aptes pour cet affaire, les autres me décevaient en toutes mes entreprises. Or, parce que mes émaux ne venaient bien en une même chose374, j’étais déçu par plusieurs fois : dont375 je recevais toujours ennuis et tristesse. Toutefois, l’espérance que j’avais me faisait procéder en mon affaire si virilement que plusieurs fois, pour entretenir les personnes qui me venaient voir, je faisais mes efforts de rire, combien qu’intérieurement je fusse bien triste.
Je poursuivis mon affaire de telle sorte que je recevais beaucoup d’argent d’une partie de ma besogne qui se trouvait bien. Mais il me survint une autre affliction concaténée376 avec les susdites, qui est que la chaleur, la gelée, les vents, pluies et gouttières me gâtaient la plus grande part de mon œuvre aupavarant qu’elle fût cuite ; tellement qu’il me fallut emprunter charpenterie377, lattes, tuiles et clous pour m’accommoder378. Or bien souvent, n’ayant point de quoi bâtir, j’étais contraint m’accommoder de lierres et autres verdures. Or, ainsi que ma puissance379 s’augmentait, je défaisais ce que j’avais fait et le bâtissais un peu mieux ; qui faisait qu’aucuns artisans, comme chaussetiers, cordonniers, sergents380 et notaires, un tas de vieilles, tous ceux-ci, sans avoir égard que mon art ne se pouvait exercer sans grand logis, disaient que je ne faisais que faire et défaire, et me blâmaient de ce qui les devait inciter à pitié, attendu que j’étais contraint d’employer les choses nécessaires à ma nourriture381 pour ériger les commodités requises à382 mon art. Et qui pis est, le motif des dites moqueries et persécutions sortait de ceux de ma maison, lesquels étaient si éloignés de raison qu’ils voulaient que je fisse la besogne sans outils, chose plus que déraisonnable. Or, d’autant plus que la chose était déraisonnable, de tant plus l’affliction m’était extrême383. J’ai été plusieurs années que n’ayant rien de quoi faire couvrir mes fourneaux, j’étais toutes les nuits à la merci des pluies et des vents, sans avoir aucun secours, aide, ni consolation, sinon des chats-huants384 qui chantaient d’un côté et les chiens qui hurlaient de l’autre ; parfois il se levait des vents et tempêtes qui soufflaient de telle sorte le dessus et le dessous de mes fourneaux, que j’étais contraint quitter là tout, avec perte de mon labeur ; et me suis trouvé plusieurs fois qu’ayant tout quitté, n’avant rien de sec sur moi, à cause des pluies qui étaient tombées, je m’en allais coucher à la minuit385 ou au point du jour, accoutré de telle sorte comme386 un homme que l’on aurait traîné par tous les bourbiers de la ville ; et en m’en allant ainsi retirer, j’allais bricolant387 sans chandelle et tombant d’un côté et d’autre, comme un homme qui serait ivre de vin, rempli de grandes tristesses : d’autant qu’après avoir longuement travaillé je voyais mon labeur perdu. Or en me retirant ainsi souillé et trempé, je trouvais en ma chambre une seconde persécution pire que la première, qui me fait à présent émerveiller que je ne suis388 consumé de tristesse.
(Discours admirables : de l’art de terre, de son utilité, des émaux et du feu.)
Amyot
(1513-1593) §
Né à Melun en 1513 d’une humble famille, Jacques Amyot, après avoir étudié à Paris en menant la vie la plus pauvre et la plus laborieuse, devint professeur à l’Université de Bourges. Il fut ensuite nommé successivement abbé de Bellozane, dans le diocèse de Rouen, précepteur des enfants de Henri II, évêque d’Auxerre et grand aumônier de France, et mourut en 1593. Il a traduit du grec plusieurs ouvrages, notamment les Vies des hommes illustres de Plutarque et les petits traités de cet auteur connus sous le nom d’Œuvres morales ; cette traduction, qui rendait populaire le plus riche en anecdotes morales de tous les écrivains de l’antiquité, est en même temps, par la richesse, la souplesse, la régularité de la langue, un des ouvrages qui font époque dans l’histoire de la prose française.
Trop parler §
Le sénat romain fut une fois par389 plusieurs jours en conseil bien étroit390 sur quelque matière secrète, et étant la chose d’autant plus enquise et soupçonnée391 que moins elle était apparente et connue, une dame romaine, sage au demeurant392, mais femme pourtant, importuna son mari, et le pria très instamment de lui dire quelle était cette matière secrète, avec grands serments et grandes exécrations393 qu’elle ne le révélerait jamais à personne, et quand et quand394 larmes à commandement395, disant qu’elle était bien malheureuse de ce que son mari n’avait autrement fiance396 en elle. Le Romain, voulant éprouver sa folie : « Tu me contrains, dit-il, m’amie397, et suis forcé de te découvrir une chose horrible et épouvantable : c’est que les prêtres nous ont rapporté que l’on a vu voler en l’air une alouette avec un armet398 doré et une pique, et pour ce399 nous sommes en peine de savoir si ce prodige est bon ou mauvais pour la chose publique, et en conférons avec les devins qui savent que400 signifie le vol des oiseaux : mais garde-toi bien de le dire. » Après qu’il lui eut dit cela, il s’en alla au palais401 : et sa femme incontinent402, tirant à part la première de ses chambrières qu’elle rencontre, commence à battre son estomac403 et arracher ses cheveux, criant : « Hélas ! mon pauvre mari, ma pauvre patrie, hélas ! que ferons-nous ? » enseignant404 et conviant sa chambrière à lui demander : « Qu’y a-t-il ? » Après que donc la servante lui eut demandé, et elle lui eut le tout conté, y ajoutant le commun refrain de tous les babillards : « Mais donnez-vous bien garde de le dire, tenez-le bien secret », à grand’peine405 fut la servante départie d’avec sa maitrese, qu’elle s’en alla décliquer406 tout ce qu’elle lui avait dit à une sienne compagne qu’elle trouva la moins embesognée407, et elle d’autre côté à un sien ami qui l’était venu voir, de sorte que ce bruit fut semé et su par tout le palais, avant que celui qui l’avait controuvé408 y fût arrivé. Ainsi quelqu’un de ses familiers le rencontrant : « Comment, dit-il, ne faites-vous que d’arriver maintenant de votre maison ? — Non409, répondit-il. — Vous n’avez donc rien ouï de nouveau ? — Comment, dit-il, est-il survenu quelque chose nouvelle ? — L’on a vu, répondit l’autre, une alouette volant avec un armet doré et une pique : et doivent les consuls tenir conseil sur cela. » Lors le Romain en se souriant410 : « Vraiment,, dit-il à part soi, ma femme, tu n’as pas beaucoup attendu, quand411 la parole que je t’ai naguère dite a été devant412 moi au palais », et de là s’en alla parler aux consuls pour les ôter du trouble. Et pour châtier sa femme, incontinent qu’il fut de retour en sa maison : « Ma femme, dit-il, tu m’as détruit : car il s’est trouvé que le secret du conseil a été découvert et publié de ma maison : et pourtant413 ta langue effrénée est cause qu’il me faut abandonner mon pays, et m’en aller en exil. » Et comme elle le voulut nier, et dit pour sa défense : « N’y a-t-il pas trois cents sénateurs qui l’ont ouï comme loi ? — Quels trois cents ? dit-il, c’était une bourde414 que j’avais controuvée pour t’éprouver. » Ce sénateur fut homme sage et bien avisé, qui, pour essayer sa femme, comme un vaisseau mal relié415, ne versa pas du vin ni de l’huile dedans, ains416 seulement de l’eau417.
(Œuvres morales de Plutarque418 : Du trop parler.)
Montaigne
(1553-1592) §
Michel Eyquem de Montaigne, né au château de Montaigne, près de Bergerac, en 1533, y est mort en 1592. Sous le titre d’Essais, il a publié, puis incessamment retouché (livres I et II, 1580 ; livre III, 1588), un ouvrage, également remarquable par l’originalité de la pensée et de la ferme, écrit dans le ton d’une causerie vive et familière, et traitant, sans ordre déterminé, de quelques-unes des plus hautes questions de la philosophie morale.
Clémence Du Duc De Guise §
Jacques Amyot, grand aumônier de France419, me récita420 un jour cette histoire à l’honneur d’un prince des nôtres (et nôtre était-il à très bonnes enseignes, encore que son origine fût étrangère421), que, durant nos premiers troubles, au siège de Rouen422, ce prince ayant été averti, par la reine mère du roi423, d’une entreprise qu’on faisait sur sa vie, et instruit particulièrement, par ses lettres, de celui qui la devait conduire à chef424, qui était un gentilhomme angevin, ou manceau, fréquentant lors ordinairement pour cet effet la maison de ce prince, il ne communiqua à personne cet avertissement ; mais se promenant l’endemain425 au mont sainte Catherine426, d’où se faisait notre batterie à Rouen (car c’était au temps que nous la tenions assiégée), ayant à ses côtés ledit seigneur grand aumônier et un autre évêque, il aperçut ce gentilhomme qui lui avait été remarqué427, et le fit appeler. Comme il fut en sa présence, il428 lui dit ainsi, le voyant déjà pâlir et frémir des alarmes de sa conscience : « Monsieur de tel lieu429, vous vous doutez bien de ce que je vous veux, et votre visage le montre. Vous n’avez rien à me cacher : car je suis instruit de votre affaire si avant430, que vous ne feriez qu’empirer votre marché431 d’essayer à le couvrir432. Vous savez bien telle chose et telle (qui étaient les tenants et aboutissants des plus secrètes pièces de cette menée) : ne faillez433, sur votre vie, à me confesser la vérité de tout ce dessein. » Quand ce pauvre homme se trouva pris et convaincu (car le tout avait été découvert à la reine par l’un des complices), il n’eut qu’à joindre les mains et requérir la grâce et miséricorde de ce prince, aux pieds duquel il se voulut jeter ; mais il l’en garda434, suivant ainsi son propos435 : « Venez ça ; vous ai-je autrefois fait déplaisir ? Ai-je offensé quelqu’un des vôtres par haine particulière ? Il n’y a pas trois semaines que je vous connais ; quelle raison vous a pu mouvoir à entreprendre ma mort ? » Le gentilhomme répondit à cela, d’une voix tremblante, que ce n’était aucune occasion particulière qu’il en eût, mais l’intérêt de la cause générale de son parti, et qu’aucuns436 lui avaient persuadé que ce serait une exécution pleine de piété, d’extirper, en quelque manière que ce fut, un si puissant ennemi de leur religion. « Or, suivit ce prince, je vous veux montrer combien la religion que je tiens est plus douce que celle de quoi437 vous faites profession. La vôtre vous a conseillé de me tuer sans m’ouïr, n’ayant reçu de moi aucune offense ; et la mienne me commande que je vous pardonne, tout convaincu que vous ôtes de m’avoir voulu tuer sans raison438. Allez-vous-en, retirez-vous ; que je ne vous voie plus ici : et, si vous êtes sage, prenez dorénavant en vos entreprises des conseillers plus gens de bien que ceux-là. »
(Essais, livre I, chap. xxiii.)
Sur l’éducation des enfants contre les collèges du temps de Montaigne §
Cette institution439 se doit conduire par une sévère douceur, non comme il se fait : au lieu de convier les enfants aux lettres440, on ne leur présente, à la vérité441, qu’horreur et cruauté. Otez-moi la violence et la force : il n’est rien, à mon avis, qui abâtardisse et étourdisse si fort une nation bien née. Si vous avez envie qu’il craigne la honte et le châtiment, ne l’y endurcissez pas : endurcissez-le à la sueur et au froid, au vent, au soleil et aux hasards qu’il lui faut mépriser ; ôtez-lui toute mollesse et délicatesse au442 vêtir et coucher, au manger et au boire ; accoutumez-le à tout ; que ce ne soit pas un beau garçon et dameret443, mais un garçon vert et vigoureux.
Enfin, homme vieil444, j’ai toujours cru et jugé de même. Mais, entre autres choses, cette police445 de la plupart de nos collèges m’a toujours déplu : on eût failli446, à l’aventure447, moins dommageablement448 s’inclinant449 vers l’indulgence. C’est une vrai geôle de jeunesse captive… Arrivez-y sur le point de leur office450 : vous n’oyez que cris, et d’enfants suppliciés, et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière, pour éveiller l’appétit envers leur leçon à ces tendres âmes et craintives, de les y guider d’une trogne effroyable, les mains armées de fouets ! Inique et pernicieuse forme451 !… Combien leurs classes seraient plus décemment jonchées de fleurs et de feuillées452 que de tronçons d’osier sanglants ! J’y ferais portraire453 la joie, l’allégresse, et Flora454 et les Grâces, comme fit en son école le philosophe Speusippus455. Où est leur profit, que456 là fût aussi leur ébat.
(Id., livre I, chap. xxv.)
Les « pertes457 triomphantes à l’envi des victoires » §
C’est la qualité d’un portefaix, non de la vertu458, d’avoir les bras et les jambes plus raides ; c’est une qualité morte et corporelle que la disposition459 ; c’est un coup de la fortune de faire broncher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil ; c’est un tour d’art et de science, qui peut tomber en une personne lâche et de néant, d’être suffisant à l’escrime. L’estimation et le prix un homme consiste au cœur et en la volonté : c’est là où gît son vrai bonheur. La vaillance, c’est, la fermeté, non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l’âme ; elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval, ni de nos armes, mais en la nôtre. Celui qui tombe obstiné en son courage ; qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relâche aucun point de son assurance ; qui regarde encore, en rendant l’âme, son ennemi d’une vue ferme et dédaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune ; il est tué, non pas vaincu : les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-il des pertes triomphantes à l’envi des victoires. Ni ces quatre victoires sœurs, les plus belles que le soleil ait onques460 vues de ses yeux, de Salamine, de Platée, de Mycale, de Sicile, n’osèrent onques opposer toute leur gloire ensemble à la gloire de la déconfiture du roi Léonidas et des siens au pas des Thermopyles461… Est-il quelque trophée assigné pour les vainqueurs qui ne soit mieux dû à ces vaincus ? Le vrai vaincre462 a pour son rôle l’estour463, non pas le salut ; et consiste l’honneur de la vertu à combattre, non à battre.
(Id., livre 1, chap. xxx.)
Balzac
(1594-1654) §
Né en 1594 à Angoulême, mort en 1654, Jean-Louis Guez de Balzac remplit, de 1611 à 1622, plusieurs fonctions à l’étranger et fut nommé par Richelieu, à son retour à Paris, où ses Lettres l’avaient fait connaître, conseiller d’État et historiographe de France. Cependant, soit amour de la retraite, soit regret de n’avoir pu jouer un rôle politique aussi important qu’il l’eût souhaité, il s’en alla vivre, peu de temps après, dans sa terre de Balzac, près d’Angoulême, et ne quitta plus cette résidence, quoiqu’il eût été, dès 1634, choisi pour faire partie de l’Académie française, qui se fondait alors. Il n’en fut pas moins l’oracle de toute la société polie du temps. Le premier, en effet, il trouva la forme définitive de la phrase française, qui n’a plus chez lui rien de gauche ni d’archaïque. Aussi mérite-t-il une grande place dans l’histoire de notre langue, quoique ses Lettres manquent souvent de naturel. Outre ses Lettres et diverses dissertations, Balzac a laissé trois traités de morale mondaine, religieuse et politique, Aristippe, le Socrate chrétien, le Prince, dans lesquels il trouve souvent la juste expression de pensées élevées, sinon bien originales.
La terre de Balzac464 §
Je ne veux pas vous faire le portrait d’une maison, dont le dessein n’a pas été conduit selon les règles de l’architecture, et la matière n’est pas si précieuse que le marbre et le porphyre465. Je vous dirai seulement qu’à la porte il y a un bois, où, en plein midi, il n’entre de jour que ce qu’il en faut pour n’être pas nuit… Les arbres y sont verts jusqu’à la racine, tant de leurs propres feuilles que de celles du lierre qui les embrasse, et, pour466 le fruit qui leur manque, leurs branches sont chargées de tourtres467 et de faisans en toutes les saisons de l’année. De là j’entre en une prairie où je marche sur les tulipes et les anémones que j’ai fait mêler avec les autres fleurs, pour me confirmer en l’opinion que j’ai apportée de mes voyages que les françaises lieront pas si belles que les étrangères468.
Je descends aussi quelquefois dans cette vallée, qui est la plus secrète partie de mon désert et qui, jusques ici, n’avait été connue de personne. C’est un pays à souhaiter et à peindre, que j’ai choisi pour vaquer à mes plus chères occupations et passer les plus douces heures de ma vie. L’eau et les arbres ne le laissent jamais manquer de frais et de vert. Les cygnes, qui couvraient autrefois toute la rivière, se sont retirés en ce lieu de sûreté et vivent dans un canal, qui fait rêver les plus grands parleurs469 aussitôt qu’ils s’en approchent, et au bord duquel je suis toujours heureux, soit que je sois joyeux, que je sois triste. Pour peu que je m’y arrête, il me semble que je retourne en ma première innocence. Mes désirs, mes craintes et mes espérances cessent tout d’un coup ; tous les mouvements dé mon âme se relâchent, et je n’ai point de passions, ou, si j’en ai, je les gouverne comme des bêtes apprivoisées....
Au demeurant par quelque porte que je sorte du logis, et de quelque part que je tourne les yeux en cette agréable solitude, je rencontre toujours la Charente, dans laquelle les animaux qui vont boire, voient le ciel aussi clairement que nous faisons470, et jouissent de l’avantage qu’ailleurs les hommes leur veulent ôter471. Mais cette belle eau aime tellement cette belle terre, qu’elle se divise en mille branches, et fait une infinité d’îles et de détours, afin de s’y amuser davantage472, et quand elle se déborde473, ce n’est que pour rendre l’année plus riche, et pour nous faire prendre à la campagne474 ses truites et ses brochets, qui valent bien les crocodiles du Nil et le faux or de toutes les rivières des poètes475.
(Lettres, 4 septembre 1622).
Descartes
(1596-1650) §
Né à la Haye, en Touraine476, en 1596, mort en 1650, à Stockholm, où l’avait appelé la reine de Suède, Christine, René Descartes, qui renouvela l’étude de la philosophie et des mathématiques, est surtout célèbre par son Discours de la Méthode477 (1637) : il n’y a peut-être en effet point de livre dont l’apparition marque une date aussi importante dans l’histoire de la philosophie moderne ; d’autre part c’est le premier ouvrage de ce genre qui ait été écrit en français. Descartes a encore laissé un grand nombre d’autres traités sur la philosophie et les sciences, et des Lettres.
La ville et la campagne
A M. de Balzac. §
Quelque accomplie que puisse être une maison des champs478, il y manque toujours une infinité de commodités, qui ne se trouvent que dans les villes ; et la solitude même qu’on y espère ne s’y rencontre jamais toute parfaite. Je veux bien que vous y trouviez un canal qui fasse rêver les plus grands parleurs479, et une vallée si solitaire qu’elle puisse leur inspirer du transport et de la joie ; mais malaisément se peut-il faire que vous n’ayez aussi quantité de petits voisins, qui vous vont quelquefois importuner, et de qui les visites sont encore plus incommodes que celles que vous recevez à Paris ; au lieu qu’en cette grande ville où je suis480, n’y ayant aucun homme ; excepté moi, qui n’exerce la marchandise481, chacun y est tellement attentif à son profit, que j’y pourrais demeurer toute ma vie sans être jamais vu de personne. Je me vais promener tous les jours parmi la confusion d’un grand peuple, avec tant de liberté et de repos que vous sauriez faire482 dans vos allées ; et je n’y considère pas autrement les hommes que j’y vois, que je ferais les arbres qui se rencontrent en vos forêts ou les animaux qui y paissent ; le bruit même de leurs tracas n’interrompt pas plus mes rêveries que ferait celui de quelque ruisseau. Que si je fais quelquefois réflexion sur leurs actions, j’en reçois le même plaisir que vous feriez de voir les paysans qui cultivent vos campagnes ; car le vois que tout leur travail sert à embellir le lieu de ma demeure, et à faire que je n’y aie manque d’aucune chose. Que s’il y a du plaisir à voir croître les fruits en vos vergers et à y être dans l’abondance jusques aux yeux483, pensez-vous qu’il n’y en ait pas bien autant à voir venir ici des vaisseaux qui nous apportent abondamment tout ce que produisent les Indes et tout ce qu’il y a de rare en l’Europe ? Quel autre lieu pourrait-on choisir au484 reste du monde, où toutes les commodités de la vie et toutes les curiosités qui peuvent être souhaitées soient si faciles à trouver qu’en cettui-ci485 ?
(Lettres, mai 1631).
Le bons sens et la méthode §
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes, et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses.
Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus ; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s’ils suivent toujours le droit chemin, que486 ne font ceux qui courent et qui s’en éloignent.
(Discours de la Méthode, première partie.)
Mezeray
(1610-1683) §
Notre littérature a dû beaucoup, à partir du xvie siècle, à l’imitation de l’antiquité grecque et latine. L’histoire cependant est peut-être le seul genre qui ait plutôt perdu que gagné à se proposer comme modèles les chefs-d’œuvre des anciens. A leur exemple, en effet, les historiens français du xvie et du xviie siècle se sont trop souvent souciés de faire preuve d’éloquence plus que de critique et de véracité. Eudes de Mézeray, né en 1610 à Ry, près d’Argentan (Orne), mort en 1683, et qui, après avoir fait, en qualité de commissaire des guerres487, les campagnes de 1635 et de 1636, se mit à travailler à sa volumineuse Histoire de France, dont la première partie parut en 1643, et la troisième et dernière en 1651, n’échappe pas entièrement à ce reproche. Mais, outre que, pour le xvie siècle, sinon pour la période antérieure, Mézeray est un guide assez sûr, il faut louer la sincérité, l’indépendance vraiment dignes d’un bon Français, qui recommandent et qui, non moins que son style un peu rude et archaïque, caractérisent son histoire, et notamment la dernière partie de cette histoire, remplie par le récit des guerres de religion. Aussi peut-on le regarder comme le plus remarquable des écrivains qui, entre Commines et Voltaire488, se sont occupés de notre histoire nationale, et, si nos historiens n’ont plus rien à apprendre de lui, il y aurait beaucoup d’injustice et d’ingratitude à laisser son nom tomber tout à fait dans l’oubli.
Les français en Floride §
L’an 1562, Jean Ribaud489, capitaine dieppois, vaillant homme, mais de la nouvelle religion, ayant équipé deux navires, prit terre dans la Floride490, dont les Espagnols ne s’étaient point encore saisis… Ribaud, ayant visité toutes les côtes de cette terre, donné les noms des rivières de France aux principales, et planté en plusieurs endroits des colonnes de pierre avec les armes de France, commença à bâtir un fort auquel il imposa491 le nom du roi Charles, et fit alliance avec les roitelets du pays. Cela fait, il s’en revint en France, y492 laissant une partie de ses gens, auxquels il promit d’amener bientôt du secours et des rafraîchissements493. Mais, après son départ, la discorde s’étant mise parmi ceux qui y demeurèrent, et les vivres leur manquant, ils reprirent la route de France.
Deux ans après, l’amiral494, étant bien en cour, persuada au roi de renouer cette entreprise, dont fut fait chef, à sa recommandation, René Laudonnière495, qui avait accompagné Ribaud au premier voyage ; et on lui donna cent mille francs pour les frais, dont il équipa trois vaisseaux à Dieppe.
Étant heureusement arrivé là, il bâtit un autre fort du même nom que le premier sur l’embouchure de la rivière de May496, et renouvela les alliances avec les roitelets. Mais la division et la jalousie se glissèrent bientôt parmi ses gens, de telle sorte qu’ils se saisirent de sa personne et le mirent aux fers, et, qui pis est, quelques-uns d’eux, portés497 d’une dangereuse et funeste avidité de gain, ayant pris dessein d’aller chercher de l’or aux mines de la Nouvelle-Espagne498, prirent un vaisseau espagnol où était le gouverneur de l’île d’Havane499. Sa femme, en étant avertie, mit incontinent500 tant d’hommes en armes qu’elle leur fit lâcherprise ; mais les Espagnols n’oublièrent pas cette injure.
Or comme les Français, ayant souffert des extrémités incroyables de disette, étaient sur le point de quitter la Floride, Ribaud y arriva avec sept vaisseaux et quantité de toutes sortes de munitions.
Son arrivée ne servit pourtant qu’à accroître leur malheur. Ceux qui, en haine de l’amiral, entretenaient des correspondances avec le conseil d’Espagne501, y donnèrent avis du partement502 de Ribaud ; de sorte qu’il fut suivi en queue par sept autres vaisseaux espagnols, commandés par le chevalier Pierre de Melandez, qui y arriva presque aussitôt que lui, descendit et s’y campa503. Ribaud, mal conseillé, au lieu de le combattre, remonta sur ses vaisseaux qui504, venant à être tous fracassés par la tempête, il fallut qu’il remît pied à terre. Cependant Melandez surprit le fort, guidé par un transfuge des nôtres505, et Ribaud fut contraint par les siens de se rendre.
Il parut en cette occasion, autant qu’il ait fait506 en aucune autre, combien l’inhumanité barbare et la cruelle perfidie sont naturelles aux Espagnols vainqueurs. Ils passèrent au fil de l’épée tout ce qu’ils rencontrèrent dans le fort, jusqu’aux enfants à la mamelle. Mais quelle horrible cruauté ces peuples n’exercèrent-ils pas sur ceux qui se rendirent ! Quoiqu’ils leur eussent donné leur foi de parole507 et par écrit, ils les poignardèrent tous, hormis un tambour et un qui savait jouer de la flûte, qu’ils réservèrent pour les faire danser508. Après leur mort, Melandez fit écorcher Ribaud, dont il envoya la peau en Espagne pour trophée, et pendit les corps de ces misérables509 aux arbres d’alentour avec cette inscription : Non comme Français, mais comme luthériens510.
Ribaud et presque tous ceux qui l’avaient accompagné étant huguenots511, le roi, en haine de cette religion, dissimula une injure si atroce, au grand déshonneur du nom français ; mais il se trouva un particulier qui eut le courage assez généreux512 pour la venger, savoir, Dominique de Gourgues513, natif du Mont de Marsan, en Gascogne, homme d’esprit vif et de hardie entreprise, qui demeurait alors à Bordeaux. Les Espagnols, l’ayant autrefois pris durant la guerre de Sienne514, lui avaient fait mille outrages et l’avaient enchaîné aux galères ; d’où ayant été tiré, il avait juré une haine immortelle contre cette nation et ne cherchait que les occasions de se ressentir515 de cet indigne traitement. Étant donc de nouveau incité par l’injure de sa patrie à venger la sienne propre, il vend une partie de ses biens, et, tant de cet argent que de celui que lui prêta son frère Oger, trésorier de France516, il équipe trois vaisseaux, armés seulement de deux cents hommes de guerre, avec lesquels, feignant de vouloir aller au Brésil où il avait déjà fait un voyage, il descend dans la Floride, où, avec l’aide des roitelets du pays, il reprend le fort Charles et deux autres que les Espagnols avaient bâtis, massacre tous ceux qui étaient dedans, à la réserve de quelques-uns qu’il fit pendre aux mêmes arbres où ils avaient pendu les corps des Français, leur ayant reproché leur perfide barbarie, et leur attacha des écriteaux sur le front contenant : Non comme Espagnols, mais comme pirates et fausseurs de foi. Il rasa ensuite tous les forts et porta les munitions et l’artillerie dans ses vaisseaux ; puis, ainsi glorieux de cette mémorable vengeance et d’avoir redonné la liberté à la Floride, il fit voile en517 France, où il arriva à la Rochelle, ayant, par un rare bonheur, fait onze cents lieues en dix-huit jours.
(Histoire de France518 : Charles IX.)
Cardinal De Retz
(1613-1679) §
Né en 1613 à Montmirail, Jean-François-Paul de Gondi, qui devint plus tard cardinal de Retz, joua pendant la Fronde un rôle prépondérant, et nous a laissé de cette époque le tableau le plus vivant, dans ses célèbres Mémoires, qui suffisent à le faire placer au nombre de nos plus grands écrivains. Il a aussi prononcé quelques Sermons et publié, dans sa jeunesse, une histoire de la Conjuration de Fiesque519, dans laquelle il affectait de déceler des instincts de perturbateur et qui fit dire de lui à Richelieu : « Voilà un dangereux esprit ». Il mourut dans la retraite en 1679.
La journée des barricades520 §
I §
Le lendemain de la fête521, c’est-à-dire le 26 d’août de 1648, le roi alla au Te Deum. L’on borda, selon la coutume, depuis le Palais-Royal jusques à Notre-Dame, toutes les rues de soldats du régiment des gardes. Aussitôt que le roi fut revenu au Palais-Royal, l’on forma de tous ces soldats trois bataillons, qui demeurèrent sur le Pont-Neuf et dans la place Dauphine. Comminges, lieutenant des gardes de la reine, enleva dans un carrosse fermé le bonhomme Broussel, conseiller de la grande chambre, et le mena à Saint-Germain. Blancménil, président aux enquêtes522, fut pris en même temps aussi chez lui, et il fut conduit au bois de Vincennes. Vous vous étonnerez du choix de ce dernier ; et si vous aviez connu le bonhomme Broussel, vous ne seriez pas moins surprise523 du sien. Je vous expliquerai ce détail en temps et lieu ; mais je ne vous puis exprimer la consternation qui parut dans Paris, le premier quart d’heure de l’enlèvement de Broussel, et le mouvement qui s’y fit dès le second. La tristesse ou plutôt l’abattement saisit jusques aux enfants ; l’on se regardait et l’on ne se disait rien.
L’on éclata tout d’un coup ; l’on s’émut, l’on courut, l’on cria, l’on ferma les boutiques. J’en fus averti, et quoique je ne fusse pas insensible à la manière dont j’avais été joué524 la veille au Palais-Royal, ou l’on m’avait même prié de faire savoir à ceux qui étaient de mes amis dans le Parlement que la bataille de Lens n’y avait causé que des mouvements de modération et de douceur, quoique, dis-je, je fusse très piqué, je ne laissai pas de prendre le parti, sans balancer, d’aller trouver la reine525 et de m’attacher à mon devoir préférablement à toutes choses.
Je sortis en rochet et camail526, et je ne fus pas au Marché Neuf527 que je fus accablé d’une foule de peuple qui hurlait plutôt qu’il ne criait. Je m’en démêlai en leur disant que la reine leur ferait justice. Je trouvai sur le Pont-Neuf le maréchal de la Meilleraie528 à la tête des gardes, qui, bien qu’il n’eût encore en tête529 que quelques enfants qui disaient des injures et qui jetaient des pierres aux soldats, ne laissait pas d’être fort embarrassé, parce qu’il voyait que les nuages commençaient à se grossir530 de tous côtés. Il fut très aise de me voir. Il m’exhorta à dire à la reine la vérité. Il s’offrit d’en venir lui-même rendre témoignage. J’en fus très aise à mon tour, et nous allâmes ensemble au Palais-Royal, suivis d’un nombre infini de peuple qui criait : « Broussel, Broussel ! »
(Mémoires, IIe partie.)
II §
La démarche de Gondi est restée infructueuse : Anne d’Autriche a refusé de céder. Le lendemain matin, tout Paris est en révolte : le Parlement, dès la première heure, s’est rendu au Palais-Royal ; mais la reine n’a pas daigné l’entendre.
Le Parlement étant sorti du Palais-Royal et ne disant rien au peuple de la liberté de Broussel ne trouva d’abord qu’un morne silence au lieu des acclamations passées. Comme il fut à la Barrière des Sergents531, où était la première barricade, il y rencontra du murmure qu’il apaisa en assurant que la reine lui avait promis satisfaction. Les menaces de la seconde furent éludées par le même moyen. La troisième, qui était à la Croix du Tiroir532, ne se voulut pas paver de cette monnaie ; et un garçon rôtisseur, s’avançant avec deux cents hommes et mettant la hallebarde dans le ventre du premier président, lui dit : « Tourne, traître ; et, si tu ne veux être massacré toi-même, ramène-nous Broussel ou le Mazarin et le chancelier en otage. » Vous ne doutez pas, à mon opinion533, ni de la confusion ni de la terreur qui saisit presque tous les assistants : cinq présidents au mortier534 et plus de vingt conseillers se jetèrent dans la foule pour s’échapper. L’unique premier président535, le plus intrépide homme, à mon sens, qui ait paru dans son siècle, demeura ferme et inébranlable. Il se donna le temps de rallier ce qu’il put de la compagnie536 ; il conserva toujours la dignité de la magistrature et dans ses paroles et dans ses démarches, et il revint au Palais-Royal au petit pas, sous le feu des injures, des menaces, des exécrations et des blasphèmes.
Cet homme avait une sorte d’éloquence qui lui était particulière : il ne connaissait point d’interjection ; il n’était pas congru537 dans sa langue ; mais il parlait avec une force qui suppléait à tout cela ; et il était naturellement si hardi, qu’il ne parlait jamais si bien que dans le péril. Il se passa538 lui-même lorsqu’il revint au Palais-Royal, et il est constant qu’il toucha tout le monde, à la réserve de la reine qui demeura inflexible.
Monsieur539 fit mine de se jeter à genoux devant elle : quatre ou cinq princesses, qui tremblaient de peur, s’y jetèrent effectivement. Le cardinal, à qui un jeune conseiller des enquêtes540 avait dit en raillant qu’il serait assez à propos qu’il allât lui-même dans les rues voir l’état des choses, le cardinal, dis-je, se joignit au gros de la cour, et l’on tira enfin à toute peine cette parole de la bouche de la reine : « Eh bien ! Messieurs du parlement, voyez donc ce qu’il est à propos de faire ». L’on s’assembla en même temps dans la grande galerie ; l’on délibéra, et l’on donna arrêt par lequel la reine serait remerciée de la liberté accordée aux prisonniers.
Aussitôt que l’arrêt fut rendu, l’on expédia les lettres de cachet541, et le Premier Président montra au peuple les copies qu’il avait prises en forme de l’un et de l’autre542 ; mais l’on ne voulut pas quitter les armes que l’effet ne s’en fût ensuivi.
Le Parlement même ne donna point d’arrêt pour les faire poser, qu’il n’eût vu Broussel dans sa place543. Il y revint le lendemain, ou plutôt il y fut porté sur la tête des peuples avec des acclamations incroyables. L’on rompit les barricades, l’on ouvrit les boutiques, et en moins de deux heures Paris parut plus tranquille que je ne l’ai jamais vu le vendredi saint.
(Mémoires, IIe partie.)
La Rochefoucauld
(1613-1680) §
Né en 1613, mort en 1680, le duc François de la Rochefoucauld, qui fut mêlé aux troubles de la Fronde, est surtout connu par le petit livre intitulé Réflexions et Sentences ou Maximes morales, dans lequel il a le tort de soutenir que l’homme, même lorsqu’il paraît mû par les plus nobles sentiments, n’agit jamais que par égoïsme, mais dont le style est un modèle achevé de précision et de propriété. La Rochefoucauld a encore laissé, sur les événements de la Fronde, des Mémoires, qui pâlissent à côté de ceux du cardinal de Retz.
Maximes §
On ne donne rien si libéralement que ses conseils (cx).
La flatterie est une fausse monnaie, qui n’a de cours que par notre vanité (clviii).
L’avarice est plus opposée à l’économie que la libéralité
(clxvil).
L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu (ccxviii).
Rien n’empêche tant d’être naturel que l’envie de le paraître544 (cdxxxi).
La plus véritable marque d’être né avec de grandes qualités, c’est d’être né sans envie (cdxxxiii).
On est quelquefois un sot avec de l’esprit, mais on ne Lest jamais avec du jugement (cdlvi).
La Fontaine
(1621-1695) §
Pour la notice, voir page 516.
Une journée de voyage §
Lettre de la Fontaine a sa femme545 §
Notre seconde couchée fut Bellac546. L’abord de ce lieu m’a semblé une chose singulière, et qui vaut la peine d’être décrite. Quand, de huit ou dix personnes qui y ont passé sans descendre de cheval ni de carrosse, il n’y en a que trois ou quatre qui se soient rompu le cou, on remercie Dieu.
Ce sont morceaux de rochers547.
Entés les uns sur les autres,
Et qui font dire aux cochers
De terribles patenôtres548.
Des plus sages à la fin
Ce chemin Épuise la patience.
Qui n’v fait que murmurer
Sans jurer,
Gagne cent ans d’indulgence.
M de Chateauneuf549
L’aurait cent fois maudit,
Si d’abord je n’eusse dit :
« Ne plaignons point notre peine ;
Ce sentier rude et peu battu
Doit être celui qui mène
Au séjour de la vertu. »
Votre oncle reprit qu’il fallait donc que nous nous fussions détournés550 : « Ce n’est pas, ajouta-t-il, qu’il n’y ait d’honnêtes gens à Bellac aussi bien qu’ailleurs ; mais quelques rencontres551 ont mis ses habitants en mauvaise odeur. » Là-dessus il nous conta qu’étant de la commission des Grands Jours552, il fit le procès à un lieutenant de robe courte553 de ce lieu-là pour avoir obligé un gueux à prendre la place d’un criminel condamné à être pendu, moyennant vingt pistoles554 données à ce gueux et quelque assurance de grâce dont on le leurra. Il se laissa conduire et guinder555 à la potence fort gaiement, comme un homme qui ne songeait qu’à ses vingt pistoles, le prévôt556 lui disant toujours qu’il ne se mît point en peine, et que la grâce allait arriver. A la fin le pauvre diable s’aperçut de sa sottise ; mais il ne s’en aperçut qu’en faisant le saut, temps mal propre à se repentir et à déclarer qui on est. Le tour est bon, comme vous voyez, et Bellac se peut vanter d’avoir eu un prévôt aussi hardi et aussi pendable qu’il y en ait.
Autant que557 l’abord de cette ville est fâcheux, autant elle est désagréable, ses rues vilaines, ses maisons mal accommodées et mal prises. Dispensez-moi, vous qui êtes propre, de vous en rien dire. On place en ce pays-là la cuisine au second étage. Qui a une fois vu ces cuisines, n’a pas grande curiosité pour les sauces qu’on y apprête. Ce sont gens capables de faire un très méchant mets d’un très bon morceau. Quoique nous eussions choisi la meilleure hôtellerie, nous y humes du vin à teindre les nappes, et qu’on appelle communément la tromperie de Bellac. Ce proverbe558 a cela de bon que Louis XIII en est l’auteur.
Molière
(1622-1673) §
Jean-Baptiste Poquelin, qui prit le nom de Molière, est né à Paris le 15 janvier 1622. A la fois auteur et acteur, il fit représenter un grand nombre de comédies, dans lesquelles il joua toujours le principal rôle, et dont les plus célèbres sont : les Précieuses ridicules (1659), l’Ecole des maris (1661), les Fâcheux (1661), l’Ecole des Femmes (1662), Don Juan (1665), le Misanthrope (1666), le Médecin malgré lui (1666), l’Avare (1668), Tartuffe (représenté en 1669, mais achevé dès 1664), Monsieur de Pourceaugnac (1669), le Bourgeois gentilhomme (1670), les Fourberies de Scapin (1671), les Femmes savantes 1672), le Malade imaginaire (1673). C’est pendant la quatrième représentation de cette dernière pièce qu’il fut saisi d’un violent accès du mal de poitrine dont il souffrait depuis longtemps ; il mourut quelques heures après (17 février 1673). La verve comique dont ses comédies sont animées, la variété, le naturel, la profondeur de ses peintures, lui assurent le premier rang parmi les auteurs comiques de tous les temps et de tous les pays.
Le créancier d’un grand seigneur559 §
Don Juan, M. Dimanche, Sganarelle560 . §
Don Juan, faisant de grandes civilités. — Ah ! Monsieur Dimanche, approchez. Que je suis ravi de vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d’abord561 ! J’avais donné ordre qu’on ne me fît parler personne562; mais cet ordre n’est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi.
M. Dimanche. — Monsieur, je vous suis fort obligé.
Don Juan, parlant à ses laquais. — Parbleu563 ! coquins, je vous apprendrai à laisser M. Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens.
M. Dimanche. — Monsieur, cela n’est rien.
Don Juan. — Comment ! vous dire que je n’y suis pas, à M. Dimanche, au meilleur de mes amis !
M. Dimanche. — Monsieur, je suis votre serviteur. J’étais venu....
Don Juan. — Allons vite, un siège pour M. Dimanche.
M. Dimanche. — Monsieur, je suis bien comme cela.
Don Juan. — Point, point, je veux que vous soyez assis contre moi564.
M. Dimanche. — Cela n’est point nécessaire.
Don Juan. — Otez 565 ce pliant, et Apportez un fauteuil.
M. Dimanche. — Monsieur, vous vous moquez, et....
Don Juan. — Non, non, je sais ce que je vous dois, et je ne veux point qu’on mette de différence entre nous deux.
M. Dimanche. — Monsieur....
Don Juan. — Allons, asseyez-vous.
M. Dimanche. — Il n’est pas besoin, Monsieur, et je n’ai qu’un mot à vous dire. J’étais....
Don Juan. — Mettez-vous là, vous dis-je.
M. Dimanche. — Non, Monsieur, je suis bien. Je viens pour....
Don Juan. — Non, je ne vous écoute point si vous n’êtes assis.
M. Dimanche. — Monsieur, je fais ce que vous voulez. Je....
Don Juan. — Parbleu ! Monsieur Dimanche, vous vous portez bien.
M. Dimanche. — Oui, Monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu....
Don Juan. — Vous avez un fonds de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil, et des yeux vifs.
M. Dimanche. — Je voudrais bien....
Don Juan. — Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse ?
M. Dimanche. — Fort bien, Monsieur, Dieu merci.
Don Juan. — C’est une brave femme.
M. Dimanche. — Elle est votre servante, Monsieur. Je venais....
Don Juan. — Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle ?
M. Dimanche. — Le mieux du monde.
Don Juan. — La jolie petite fille que c’est ! je l’aime de tout mon cœur.
M. Dimanche. — C’est trop d’honneur que vous lui faites, Monsieur. Je vous....
Don Juan. — Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour ?
M. Dimanche. — Toujours de même, Monsieur. Je....
Don Juan. — Et votre petit chien Brusquet ? gronde-t-il toujours aussi fort, et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous ?
M. Dimanche. — Plus que jamais, Monsieur, et nous ne saurions en chevir566.
Don Juan. — Ne vous étonnez pas si je m’informe des nouvelles de toute la famille, car j’y prends beaucoup d’intérêt.
M. Dimanche. — Nous vous sommes, Monsieur, infiniment obligés. Je....
Don Juan, lui tendant la main. — Touchez donc là567, Mon sieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis ?
M. Dimanche. — Monsieur, je suis votre serviteur.
Don Juan. — Parbleu ! je suis à vous de tout mon cœur.
M. Dimanche. — Vous m’ honorez trop. Je....
Don Juan. — Il n’y a rien que je ne fisse pour vous.
M. Dimanche. — Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi.
Don Juan. — Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire.
M. Dimanche. — Je n’ai point mérité cette grâce assurément. Mais, Monsieur....
Don Juan. — Oh çà, Monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi ?
M. Dimanche. — Non, Monsieur, il faut que je m’en retourne tout à l’heure. Je....
Don Juan, se levant. — Allons, vite un flambeau pour conduire M. Dimanche, et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l’escorter568.
M. Dimanche, se levant de même. — Monsieur, il n’est pas nécessaire, et je m’en irai bien tout seul. Mais....
(Sganarelle ôte les sièges promptement.)
Don Juan. — Comment ? Je veux qu’on vous escorte, et je m’intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur, et de plus votre débiteur.
M. Dimanche. — Ah ! Monsieur....
Don Juan. — C’est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le monde.
M. Dimanche. — Si....
Don Juan. — Voulez-vous que je vous reconduise ?
M. Dimanche. — Ah ! Monsieur, vous vous moquez. Monsieur....
Don Juan. — Embrassez-moi569 donc, s’il vous plaît. Je vous prie encore une fois d’être persuadé que je suis tout à vous, et qu’il n’y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. (Il sort.)
Sganarelle. — Il faut avouer que vous avez en Monsieur un homme qui vous aime bien.
M. Dimanche. — Il est vrai ; il me fait tant de civilités et tant de compliments, que je ne saurais jamais lui demander de l’argent.
(Don Juan acte IV. sc. iii.)
Reproches de Don Louis, père de Don Juan a son fils570 §
Je vois bien que je vous embarrasse, et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. A dire vrai, nous nous incommodons étrangement l’un et l’autre ; et si vous êtes las de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements571. Hélas ! que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu’il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l’importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées ! J’ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles : je l’ai demandé sans relâche avec des transports incroyables ; et ce fils, que j’obtiens en fatiguant le ciel de vœux, est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu’il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d’actions indignes, dont on a peine572, aux yeux du monde, d’adoucir le mauvais visage573, cette suite continuelle de méchantes affaires, qui nous réduisent, à toutes heures, à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis ? Ah ! quelle bassesse est la vôtre ! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance ? Etes-vous en droit, dites-moi, d’en tirer quelque vanité ? Et qu’avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme ? Croyez-vous qu’il suffise d’en porter le nom et les armes574, et que ce nous soit une gloire d’être sorti d’un sang noble lorsque nous vivons en infâmes ? Non, non, la naissance n’est rien où la vertu n’est pas. Aussi nous n’avons part à la gloire de nos ancêtres qu’autant que nous nous efforçons de leur ressembler ; et cet éclat de leurs actions qu’ils répandent sur nous, nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu’ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leurs vertus, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né : ils vous désavouent pour leur sang575, et tout ce qu’ils ont fait d’illustre ne vous donne aucun avantage ; au contraire, l’éclat n’en rejaillit sur vous qu’à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau576 qui éclaire aux yeux d’un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu’un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu’on signe qu’aux actions qu’on fait, et que je ferais plus d’état du fils577 d’un crocheteur qui serait honnête homme, que du fils d’un monarque qui vivrait comme vous.
(Don Juan ou le Festin de Pierre, acte IV, sc. iv.)
Le festin de l’avare §
Harpagon, Valère, Dame Claude, Maitre Jacques, Brindavoine, La Merluche. §
Harpagon578. — Allons. Venez çà tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt, et règle à chacun son emploi. Approchez, dame Claude. Commençons par vous. (Elle tient un balai.) Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin579 de nettoyer partout : et surtout prenez garde ne point frotter les meubles trop fort de peur de les user. Outre cela, je vous constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles580 ; et, s’il s’en écarte581 quelqu’une, et qu’il se casse quelque chose, je m’en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages.
Maître Jacques. — Châtiment politique582.
Harpagon. — Allez583. Vous, Brindavoine, et vous, la Merluche, je vous établis clans la charge de rincer les verres et de donner à boire, mais seulement lorsque l’on aura soif, et non pas selon la coutume de certains impertinents584 de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu’on n’y songe pas. Attendez qu’on vous en demande plus d’une fois, et vous ressouvenez585 de porter toujours beaucoup d’eau.
Maître Jacques. — Oui, le vin pur monte à la tête.
La Merluche. — Quitterons-nous nos siquenilles586, monsieur ?
Harpagon. — Oui, quand vous verrez venir les personnes ; et gardez bien de gâter vos habits.
Brindavoine. — Vous savez bien, monsieur, qu’un des devants de mon pourpoint587 est couvert d’une grande tache de l’huile de la lampe.
La Merluche. — Et moi, monsieur, que j’ai mon haut-de-chausses588 tout troué par derrière, et qu’on me voit, révérence parler589....
Harpagon, à la Merluche. — Paix. Rangez cela adroitement du coté de la muraille, et présentez toujours le devant au monde, (Harpagon met son chapeau au-devant de son pourpoint, pour montrer à Brindavoine comment il doit faire pour cacher la tache d’huile.) Et vous tenez toujours votre chapeau ainsi, lorsque vous servirez… Valère, aide-moi à ceci. Ho çà, maître Jacques, approchez-vous ! Je vous ai gardé pour le dernier.
Maître Jacques. — Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler ? car je suis l’un et l’autre.
Harpagon. — C’est à tous les deux.
Maître Jacques. — Mais à qui des deux le premier ?
Harpagon. — Au cuisinier.
Maître Jacques. — Attendez donc, s’il vous plaît. (Il ôte sa casaque de cocher et parait vêtu en cuisinier.)
Harpagon. — Quelle diantre590 de cérémonie est-ce là ?
Maître Jacques. — Vous n’avez qu’à parler.
Harpagon. — Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper.
Maître Jacques. — Grande merveille !
Harpagon. — Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère591 ?
Maître Jacques. — Oui, si vous me donnez bien de l’argent.
Harpagon. — Que diable, toujours de l’argent ! Il semble qu’ils n’aient autre chose à dire : de l’argent, de l’argent, de l’argent. Ah ! ils n’ont que ce mot à la bouche : de l’argent. Toujours parler d’argent, Voilà leur épée de chevet592, de l’argent !
Valère. — Je n’ai jamais vu de réponse plus impertinente593 que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l’argent. C’est une chose la plus aisée du monde, et il n’y a si pauvre esprit qui n’en fît bien autant ; mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d’argent.
Maître Jacques. — Bonne chère avec peu d’argent !
Valère. — Oui.
Maître Jacques. — Par ma foi, monsieur l’intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier : aussi bien vous mêlez-vous céans d’être le factoton594.
Harpagon. — Taisez-vous. Qu’est-ce qu’il nous faudra ?
Maître Jacques. — Voilà monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d’argent.
Harpagon. — Haye ! je veux que tu me répondes.
Maître Jacques. — Combien serez-vous de gens à table ?
Harpagon. — Nous serons huit ou dix ; mais il ne faut prendre que huit. Quand il y a à manger pour huit, il y en a bien pour dix.
Valère. — Cela s’entend.
Maître Jacques. — Hé bien ! il faudra quatre grands potages et cinq assiettes595. Potages,… entrées....
Harpagon. — Que diable, voilà pour traiter toute une ville entière !
Maître Jacques. — Rôt....
Harpagon, en lui mettant la main sur la bouche. — Ah ! traître, tu manges tout mon bien.
Maître Jacques. — Entremets....
Valère. — Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde ? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille ? Allez-vous-en lire un peu les préceptes de la santé, et demander aux médecins s’il y a rien de plus préjudiciable à l’homme que de manger avec excès596.
Harpagon. — Il a raison.
Valère. — Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c’est un coupe-gorge qu’une table remplie de trop de viandes597; que, pour se bien montrer ami de ceux que l’on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu’on donne, et que, suivant le dire d’un ancien598, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Harpagon. — Ah ! que cela est bien dit ! Approche, que je t’embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j’aie entendue de ma vie : Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vi… Non, ce n’est pas cela. Comment est-ce que tu dis ?
Valère. — Qu’il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Harpagon. — Oui. Entends-tu ? Qui est le grand homme qui a dit cela ?
Valère. — Je ne me souviens pas maintenant de son nom.
Harpagon. — Souviens-toi de m’écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d’or sur la cheminée de ma salle.
Valère. — Je n’y manquerai pas. Et, pour votre souper, vous n’avez qu’à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut.
Harpagon. — Fais donc.
Maître Jacques. — Tant mieux ; j’en aurai moins de peine.
Harpagon. — Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d’abord599 : quelque bon haricot600 bien gras, avec quelque paté en pot601, bien garni de marrons.
Valère. — Reposez-vous sur moi.
Harpagon. — Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse.
Maître Jacques. — Attendez. Ceci s’adresse au cocher (Il remet sa casaque). Vous dites... ?
Harpagon. — Qu’il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire....
Maître Jacques. — Vos chevaux, monsieur ? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu’ils sont sur la litière602, les pauvres bêtes n’en ont point, et ce serait fort mal parler ; mais vous leur faites observer des jeûnes si austères, que ce ne sont plus rien que des idées603 ou des fantômes, des façons de chevaux.
Harpagon. — Les voilà bien malades ! Ils ne font rien.
Maître Jacques. — Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu’il ne faut rien manger ? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués604; car enfin j’ai une tendresse pour mes chevaux, qu’il605 me semble que c’est moi-même quand je les vois pâtir ; je m’ôte tous les jours pour eux les choses de la bouche ; et c’est être, monsieur, d’un naturel trop dur, que de n’avoir nulle pitié de son prochain.
Harpagon. — Le travail ne sera pas grand d’aller jusqu’à la foire.
Maître Jacques. — Non, monsieur, je n’ai pas le courage de les mener, et je ferais conscience606 de leur donner des coups de fouet en l’état où ils sont. Comment voudriez-vous qu’ils traînassent un carrosse, qu’ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes ?
Valère. — Monsieur, j’obligerai607 le voisin Le Picard à se charger de les conduire ; aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper.
Maître Jacques. — Soit. J’aime mieux encore qu’ils meurent sous la main d’un autre que sous la mienne.
(L’Avare, acte III, sc. 1.)
Le bourgeois gentilhomme §
M. Jourdain608, Un Garçon Tailleur §
Garçon tailleur. — Mon gentilhomme609, donnez, s’il vous plaît, aux garçons quelque chose pour boire.
Monsieur Jourdain. — Comment m’appelez-vous ?
Garçon tailleur. — Mon gentilhomme.
Monsieur Jourdain. — « Mon gentilhomme ! » Voilà ce que c’est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous-en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point : « Mon gentilhomme ». Tenez, voilà pour « Mon gentilhomme ».
Garçon tailleur. — Monseigneur610, nous vous sommes bien obligés.
Monsieur Jourdain. — « Monseigneur », oh ! oh ! « Monseigneur ! » Attendez, mon ami : « Monseigneur » mérite quelque chose, et ce n’est pas une petite parole que « Monseigneur ». Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne.
Garçon tailleur. — Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de Votre Grandeur.
Monsieur Jourdain. — « Votre Grandeur ! » Oh, oh, oh ! Attendez, ne vous en allez pas. A moi « Votre Grandeur ! » Ma foi, s’il va jusqu’à l’Altesse611, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour Ma Grandeur.
Garçon tailleur. — Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités.
Monsieur Jourdain. — Il a bien fait : je lui allais tout donner.
(Le Bourgeois gentilhomme, acte II, sc. v.)
Un plaisant philosophe §
Un Maitre De Philosophie, Un Maitre De Musique Un Maitre A Danser, Un Maitre D’armes, M. Jourdain §
Monsieur Jourdain. — Holà, monsieur le philosophe, vous arrivez tout612 à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci613.
Maître de philosophie. — Qu’est-ce donc ? qu’y a-t-il, messieurs ?
Monsieur Jourdain. — Ils se sont mis en colère pour la préférence de leurs professions614, jusqu’à se dire des injures, et vouloir en venir aux mains.
Maître de philosophie. — Hé quoi ? Messieurs, faut-il s’emporter de la sorte ? et n’avez-vous point lu le docte traité que Sénèque615 a composé de la colère ? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion, qui fait d’un homme une bête féroce ? et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements ?
Maître a danser. — Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse, que j’exerce, et la musique, dont il616 fait profession ?
Maître de philosophie. — Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu’on peut lui dire ; et la grande réponse qu’on doit faire aux outrages, c’est la modération et la patience.
Maître d’armes. — Ils ont tous deux l’audace de vouloir comparer leurs professions à la mienne.
Maître de philosophie. — Faut-il que cela vous émeuve ? Ce n’est pas de vaine gloire et de condition617 que les hommes doivent disputer entre eux ; et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c’est la sagesse et la vertu.
Maître a danser. — Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d’honneur.
Maître de musique. — Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée.
Maître d’armes. — Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes618 est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.
Maître de philosophie. — Et que sera donc la philosophie619 ? Je vous trouve tous trois bien impertinents620 de parler devant moi avec cette arrogance, et de donner impudemment le nom de science à des choses que l’on ne doit pas même honorer du nom d’art621, et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin622.
Maître d’armes. — Allez, philosophe de chien623.
Maître de musique. — Allez, belître624 de pédant.
Maître a danser. — Allez, cuistre fieffé625.
Maître de philosophie. — Comment ? marauds626 que vous êtes....
(Le philosophe se jette sur eux, et tous trois le chargent de coups, et sortent en se battant.)
Monsieur Jourdain. — Monsieur le philosophe !
Maître de philosophie. — Infâmes ! coquins ! insolents !
Monsieur Jourdain. — - Monsieur le philosophe !
Maître d’armes. — La peste l’animal627 !
Monsieur Jourdain. — Messieurs !
Maître de philosophie. — Impudents !
Monsieur Jourdain. — Monsieur le philosophe !
Maître a danser. — Diantre628 soit de l’âne bâté !
Monsieur Jourdain. — Messieurs !
Maître de philosophie. — Scélérats !
Monsieur Jourdain. — Monsieur le philosophe !
Maître de musique. — Au diable l’impertinent !
Monsieur Jourdain. — Messieurs !
Maître de philosophie. — Fripons ! gueux ! traîtres ! imposteurs ! (Ils sortent.)
Monsieur Jourdain. — Monsieur le philosophe ! Messieurs ! Monsieur le philosophe ! Messieurs ! Monsieur le philosophe ! Oh ! battez-vous tant qu’il vous plaira : je n’y saurais que faire, et je n’irai pas gâter ma robe629 pour vous séparer. Je serais bien fou de m’aller fourrer parmi eux, pour recevoir quelque coup qui me ferait mal.
(Le Bourgeois gentilhomme, acte II, sc. iii.)
Une demande en mariage §
M. Jourdain. Mme Jourdain, Cléonte, Nicole §
Cléonte. — Monsieur, je n’ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m’en charger630 moi-même ; et, sans autre détour, je vous dirai que l’honneur d’être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m’accorder.
M. Jourdain. — Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme.
Cléonte. — Monsieur, la plupart des gens, sur cette question, n’hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l’usage aujourd’hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l’avoue, j’ai les sentiments, sur cette matière, un peu plus délicats : je trouve que toute imposture est indigne d’un honnête homme, et qu’il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer, aux yeux du monde, d’un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu’on n’est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l’honneur de six ans de services, et je me trouve assez de biens pour tenir dans le monde un rang assez passable ; mais, avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où631 d’autres, en ma place, croiraient pouvoir prétendre ; et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme.
M. Jourdain. — Touchez là632, monsieur ; ma fille n’est pas pour vous.
Cléonte. — Comment ?
M. Jourdain. — Vous n’êtes point gentilhomme, vous n’aurez pas ma bile.
Mme Jourdain633. — Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme ? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de saint Louis634 ?
M. Jourdain. — Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir.
Mme Jourdain. — Descendons-nous tous deux que635 de bonne bourgeoisie ?
M. Jourdain. — Voilà pas le coup de langue ?
Mme Jourdain. — Et votre père n’était-il pas marchand aussi bien que le mien ?
M. Jourdain. — Peste soit de la femme ! Elle n’y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui ; mais, pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j’ai à vous dire, moi, c’est que je veux avoir un gendre gentilhomme.
Mme Jourdain. — Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre ; et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait, qu’un gentilhomme gueux et mal bâti.
Nicole. — Cela est vrai636. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne637 et le plus sot dadais638 que j’aie jamais vu.
M. Jourdain. — Taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la conversation. J’ai du bien assez pour ma fille ; je n’ai besoin que d’honneurs, et je la veux faire marquise.
Mme Jourdain. — Marquise ?
M. Jourdain. — Oui, marquise.
Mme Jourdain. — Hélas ! Dieu m’en garde !
M. Jourdain. — C’est, une chose que j’ai résolue.
Mme Jourdain. — C’est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu’un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu’elle ait des enfants qui aient honte de m’appeler leur grand’maman. S’il fallait qu’elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu’elle manquât, par mégarde, à saluer quelqu’un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire cent sottises. « Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse ? C’est la fille de M. Jourdain, qui était trop heureuse, étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle n’a pas toujours été si relevée que la voilà ; et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent639. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu’ils payent maintenant peut-être bien cher en l’autre monde ; et l’on ne devient guère si riches à être honnêtes gens. » Je ne veux point tous ces caquets, et je veux un homme, en un mot, qui m’ait obligation de ma fille, et à qui je puisse dire : « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. »
M. Jourdain. — Voilà bien les sentiments d’un petit esprit, de vouloir toujours demeurer dans la bassesse640. Ne me répliquez pas davantage ; ma fille sera marquise en dépit de tout le monde ; et, si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse.
(Le Bourgeois gentilhomme, acte III, sc. xii.)
Les sciences occultes641 §
Tous les esprits ne sont pas nés avec les qualités qu’il faut pour la délicatesse de ces belles sciences qu’on nomme curieuses642, et il y en a de si matériels, qu’ils ne peuvent aucunement comprendre ce que d’autres conçoivent le plus facilement du monde643. Il n’est rien de plus agréable, Madame, que toutes les grandes promesses de ces connaissances sublimes. Transformer tout en or, faire vivre éternellement, guérir par des paroles, se faire aimer de qui l’on veut, savoir tous les secrets de l’avenir, faire descendre, comme on veut, du ciel sur les métaux des impressions de bonheur644, commander aux démons, se faire des armées invisibles et des soldats invulnérables : tout cela est charmant, sans doute ; et il y a des gens qui n’ont aucune peine à en comprendre la possibilité645 : cela leur est le plus aisé du monde à concevoir. Mais pour moi, je vous avoue que mon esprit grossier a quelque peine à le comprendre et à le croire, et j’ai toujours trouvé cela trop beau pour être véritable. Toutes ces belles raisons de sympathie646, de force magnétique647 et de vertu occulte, sont si subtiles et délicates, qu’elles échappent à mon sens matériel, et, sans parler du reste, jamais il n’a été en ma puissance de concevoir comme648 on trouve écrit dans le ciel jusqu’aux plus petites particularités de la fortune du moindre homme. Quel rapport, quel commerce649, quelle correspondance peut-il y avoir entre nous et des globes éloignés de notre terre d’une distance si effroyable ? et d’où cette belle science enfin peut-elle être venue aux hommes ? Quel dieu l’a révélée, ou quelle expérience l’a pu former de l’observation de ce grand nombre d’astres qu’on n’a pu voir encore deux fois dans la même disposition650 ?
(Les Amants magnifiques, acte III, sc. i.)
Pascal
(1623-1662) §
Né en 1623 à Clermont-Ferrand, Blaise Pascal donna dès son enfance des marques d’une intelligence qui tenait du prodige et d’une aptitude exceptionnelle aux mathématiques. Après s’être illustré par plusieurs découvertes et travaux scientifiques, emporté par une foi ardente, il se livra tout entier à la méditation religieuse. Ami des Messieurs de Port-Royal651, il écrivit, pour attaquer les Jésuites, leurs adversaires, les célèbres Lettres provinciales (1656-1657). Quand il mourut, en 1662, à trente-neuf ans, après avoir passé dans des souffrances continuelles les dernières années de sa vie, il laissait des fragments d’un grand ouvrage, qui devait être intitulé Apologie de la religion chrétienne ; ce sont ces fragments, auxquels on a joint des notes et des réflexions diverses trouvées dans ses papiers, qui ont été publiées (1670) sous le nom de Pensées.
Facheux effet de l’amour-propre §
L aversion pour la vérité est inséparable de l’amour-propre652. C’est cette mauvaise délicatesse653 qui oblige ceux qui sont dans la nécessité de reprendre les autres de choisir tant de détours et de tempéraments654 pour éviter de les choquer. Il faut qu’ils diminuent nos défauts, qu’ils fassent semblant de les excuser, qu’ils y mêlent des louanges et des témoignages d’affection et d’estime. Avec tout cela, cette médecine ne laisse pas d’être amère à l’amour-propre. Il en prend le moins qu’il peut, et toujours avec dégoût, et souvent même avec un secret dépit contre ceux qui la lui présentent.
Il arrive de là que, si l’on a quelque intérêt d’être aimé de nous, on s’éloigne655 de nous rendre un office qu’on sait nous être désagréable ; on nous traite comme nous voulons être traités : nous haïssons la vérité, on nous la cache ; nous voulons être flattés, on nous flatte ; nous aimons à être trompés, on nous trompe.
C’est ce qui fait que chaque degré de bonne fortune qui nous élève dans le monde nous éloigne davantage de la vérité, parce qu’on appréhende plus de blesser ceux dont l’affection est plus utile et l’aversion plus dangereuse. Un prince sera la fable de toute l’Europe, et lui seul n’en saura rien. Je ne m’en étonne pas : dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu’ils se font haïr. Or ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu’ils servent ; et ainsi ils n’ont garde de lui procurer un avantage en se nuisant à eux-mêmes.
Ce malheur est sans doute plus grand et plus ordinaire dans les plus grandes fortunes ; mais les moindres n’en sont pas exemptes, parce qu’il y a toujours quelque intérêt à se faire aimer des hommes. Ainsi la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; on ne fait que s’entre-tromper et s’entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L’union qui est entre les hommes n’est fondée que sur cette mutuelle tromperie ; et peu d’amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y est pas, quoiqu’il en parle alors sincèrement et sans passion.
(Pensées, édition Brunschvicg, sect. II, 100.)
L’imagination §
Ne diriez-vous pas que ce magistrat, dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple, se gouverne par une raison pure et sublime, et qu’il juge des choses par leur nature, sans s’arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que l’imagination des faibles ? Voyez-le entrer dans un sermon656 où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de la raison par l’ardeur de la charité657. Le voilà prêt à l’ouïr avec un respect exemplaire. Que le prédicateur vienne à paraître : si la nature lui a donné une voix enrouée, et un tour de visage bizarre, que son barbier l’ait mal rasé, si le hasard l’a encore barbouillé de surcroît, quelques grandes vérités qu’il annonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur658.
Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination659 prévaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.
Qui ne sait que la vue de chats, de rats, l’écrasement d’un charbon emportent la raison hors des gonds ? Le ton de voix impose660 aux plus sages et change un discours et un poème de face.
L’affection ou la haine changent la justice de face ; et combien un avocat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide ! Combien son geste hardi le fait-il paraître meilleur aux juges dupés par cette apparence ! Plaisante raison661 qu’un vent manie, et à tous sens !
Je ne veux pas rapporter tous les effets de l’imagination ; je rapporterais presque toutes les actions des hommes, qui ne branlent662 presque que par ses secousses.
Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillotent en chats fourrés663, les palais où ils jugent, les fleurs de lis664, tout cet appareil auguste était fort nécessaire : et si les médecins n’avaient des soutanes665 et des mules666, et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés, et des robes trop amples de quatre parties667, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre668 si authentique669.
Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête, sans une opinion avantageuse de sa suffisance670.
(Pensées, édition Havet, article III, 3.)
Madame De Sévigné
(1626-1696) §
Née en 1626, morte en 1696, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, a laissé des lettres, dont la plupart sont adressées à sa fille, Mme de Grignan, qu’elle aima toujours d’une affection passionnée. Ces lettres, que leur auteur ne destinait pas à la publicité, n’en sont que plus précieuses à nos yeux : car, en y racontant tout ce qu’elle a vu, tout ce qu’elle a appris, tout ce qu’elle a entendu dire, Mme de Sévigné s’y peint surtout elle-même avec sa tendresse maternelle, toujours profonde, parfois déçue, avec ses vertus et ses faiblesses, ses hautes qualités et ses petits travers ; prenant place ainsi, sans l’avoir cherché, parmi les écrivains français les plus originaux, parmi ceux qu’on égale peut-être, mais qu’on n’imite et qu’on ne surpasse pas.
Le madrigal §
Il faut que je vous671 conte une petite historiette, qui est très vraie et qui vous divertira. Le Roi se mêle depuis peu de faire des vers ; MM. de Saint-Aignan672 et Dangeau673 lui apprennent comme il s’y faut prendre. Il fit l’autre jour un petit madrigal674, que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin il dit au maréchal de Gramont6751 : « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent6762. Parce qu’on sait que depuis peu j’aime les vers, on m’en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au Roi : « Sire, Votre Majesté juge divinement bien de toutes choses : il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j’aie jamais lu. » Le Roi se mit à rire, et lui dit : « N’est-il pas vrai que celui qui l’a fait est bien fat677 ?
— Sire, il n’y a pas moyen de lui donner un autre nom.
— Oh bien ! dit le Roi, je suis ravi que vous m’en ayez parlé si bonnement ; c’est moi qui l’ai fait. — Ah ! Sire, quelle trahison ! Que Votre Majesté me le rende ; je l’ai lu brusquement. — Non, Monsieur le maréchal : les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le Roi a fort ri de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l’on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le Roi en fît là-dessus, et qu’il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la vérité.
(Lettre du ler décembre 1664.)
Première lettre à de Grignan après son départ de Paris §
A Paris, vendredi, 6678 février [1671].
Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre ; je ne l’entreprendrai pas aussi. J’ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu’elle fait l’éloignent de moi. Je m’en allai donc à Sainte-Marie679, toujours pleurant, et toujours mourant : il me semblait qu’on m’arrachait le cœur et lame ; et en effet quelle rude séparation ! Je demandai la liberté d’être seule ; on me mena dans la chambre de Mme du Housset, on fit du feu ; Agnès680 me regardait sans me parler, c’était notre marché ; j’y passai jusqu’à cinq heures sans cesser de sangloter : toutes mes pensées me faisaient mourir.
J’écrivis à M. de Grignan, vous pouvez penser sur quel ton. J’allai ensuite chez Mme de Lafayette681, qui redoubla mes douleurs par la part qu’elle y prit. Elle était seule, et malade, et triste de la mort d’une sœur religieuse ; elle était comme je la pouvais désirer. M. de La Rochefoucauld682 y vint ; on ne parla que de vous, de la raison que j’avais d’être touchée. Je revins enfin à huit heures de chez Mme de Lafayette ; mais en entrant ici, bon Dieu ! comprenez-vous bien ce que je sentis en montant ce degré683 ? Cette chambre où j’entrais toujours, hélas ! j’en trouvai les portes ouvertes ; mais je vis tout démeublé, tout dérangé, et votre pauvre petite fille684 qui me représentait la mienne. Comprenez-vous bien tout ce que je souffris ? Les réveils de la nuit ont été noirs, et le matin je n’étais point avancée d’un pas pour le repos de mon esprit. L’après-dînée se passa avec Mme de la Troche685 à l’Arsenal686. Le soir, je reçus votre lettre qui me remit dans les premiers transports, et, ce soir, j’achèverai celle-ci chez M. de Coulanges687, où j’apprendrai des nouvelles6883 ; car, pour moi, voilà ce que je sais689, avec les douleurs de tous ceux que vous avez laissés ici. Toute ma lettre serait pleine de compliments, si je voulais.
Lettre de printemps
A Madame De Grignan. §
A Livry690, ce mercredi 29e avril [1671],
J’ai fait hier, ma chère bonne, un fort joli voyage. Je partis assez matin de Paris : j’allais dîner à Pompone691; j’y trouvai notre bonhomme692 qui m’attendait ; je n’aurais pas voulu manquer à lui dire adieu. Je le trouvai dans une augmentation de sainteté qui m’étonna693 : plus il approche de la mort et plus il s’épure. Il me gronda très sérieusement : et transporté de zèle et d’amitié pour moi, il me dit que j’étais folle de ne point songer à me convertir694; que j’étais une jolie païenne ; que je faisais de vous une idole dans mon cœur695; que cette sorte d’idolâtrie était aussi dangereuse qu’une autre, quoiqu’elle me parût moins criminelle ; qu’enfin je songeasse à moi. Il me dit tout cela si fortement que je n’avais pas le mot à dire. Enfin, après six heures de conversation très agréable, quoique très sérieuse, je le quittai, et vins ici, où je trouvai tout le triomphe du mois de mai. Le rossignol, le coucou, la fauvette.
Dans nos forêts ont ouvert le printemps.
Je m’y suis promenée tout le soir toute seule ; j’y ai trouvé toutes mes tristes pensées696; mais je ne veux plus vous en parler. Ce matin on m’a apporté vos lettres du 4e de ce mois : qu’elles viennent de loin quand elles arrivent à Paris ! J’ai destiné une partie de cet après-dîner à vous écrire dans ce jardin, où je suis étourdie de trois ou quatre rossignols qui sont sur ma tête. Ce soir je m’en retourne à Paris pour faire mon paquet697 et vous l’envoyer....
N’avez-vous point trouvé jolies les cinq ou six fables de La Fontaine qui sont dans un des tomes que je vous ai envoyés698 ? Nous en étions l’autre jour ravis chez M. de la Rochefoucauld699. Nous apprîmes par cœur celle du Singe et du Chat700 :
D’animaux malfaisants c’était un très bon plat ;
Ils n’y701 craignaient tous deux aucun, tel qu’il pût être ;
Trouvait-on quelque chose au logis de gâté,
On ne s’en prenait point à ceux du voisinage702 :
Bertrand dérobait tout ; Raton, de son côté,
Etait moins attentif aux souris qu’au fromage.
Et le reste. Cela est peint. Et la Citrouille, et le Rossignol703 ! Cela est digne du premier tome704....
Pensez-vous que je ne vous aille point voir cette année ? Hélas ! c’est bien moi qui dois dire qu’il n’y a plus de pays fixe pour moi, que celui où vous êtes. Votre portrait triomphe sur ma cheminée : vous êtes adorée présentement en Provence et à Paris, à la cour et à Livry. Enfin, ma bonne, il faut bien que vous soyez705 ingrate : le moyen de rendre tout cela ? Je vous embrasse et vous aime, et vous le dirai toujours, parce que c’est toujours la même chose.
Maître Paul706 mourut il y a huit jours ; notre jardin en est tout triste.
Les Foins
A M. De Coulanges707 §
Aux Rochers, 22e juillet [1671]
Ce mot sur la semaine est par-dessus le marché708 de vous écrire seulement tous les quinze jours, et pour vous donner avis, mon cher cousin, que vous aurez bientôt l’honneur de voir Picard709; et comme il est frère du laquais de Mme de Coulanges, je suis bien aise de vous rendre compte de mon procédé. Vous savez que Mme la duchesse de Chaulnes est à Vitré710; elle y attend le duc, son mari, dans dix ou douze jours, avec les états de Bretagne711; vous croyez que j’extravague712; elle attend donc son mari avec tous les états, et, en attendant, elle est à Vitré toute seule mourant d’ennui. Vous ne comprenez pas que cela puisse jamais revenir à Picard. Elle meurt donc d’ennui ; je suis sa seule consolation, et vous croyez bien que je l’emporte d’une grande hauteur sur Mlles de Kerbone et de Kerqueoison713. Voici un grand circuit ; mais pourtant nous arriverons au but. Comme je suis donc sa seule consolation, après l avoir été voir714, elle viendra ici, et je veux qu’elle trouve mon parterre net, et mes allées nettes, ces grandes allées que vous aimez. Vous ne comprenez pas encore où cela peut aller. Voici une autre petite proposition incidente : vous savez qu’on fait les foins ; je n’avais pas d’ouvriers ; j’envoie dans cette prairie que les poètes ont célébrée715, prendre tous ceux qui travaillaient, pour venir nettoyer ici (vous n’y voyez encore goutte), et, en leur place, j’envoie tous mes gens faner. Savez-vous ce que c’est que faner ? Il faut que je vous l’explique : faner est la plus jolie chose du monde ; c’est retourner du foin en batifolant dans une prairie ; dès qu’on en sait tant, on sait faner. Tous mes gens y allèrent gaiement ; le seul Picard me vint dire qu’il n’irait pas, qu’il n’était pas entré à mon service pour cela, que ce n’était pas son métier, et qu’il aimait mieux s’en aller à Paris. Ma foi ! la colère me monte à la tête. Je songeai que c’était la centième sottise qu’il m’avait faite, qu’il n’avait ni cœur, ni affection ; en un mot, la mesure était comble. Je l’ai pris au mot, et, quoi qu’on m’ait pu dire pour lui, je suis demeurée ferme comme un rocher, et il est parti. C’est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c’est le garçon du monde qui aime le moins à faner, et qui est le plus indigne qu’on le traite bien.
Voilà l’histoire en peu de mots. Pour moi, j’aime les narrations où l’on ne dit que ce qui est nécessaire, où l’on ne s’écarte point ni à droite ni à gauche, où l’on ne reprend point les choses de si loin : enfin je crois que c’est ici, sans vanité, le modèle des narrations agréables.
Mort de Turenne
A Mme De Grignan §
A Paris, mercredi 28e août [1675].
Vraiment, ma fille, je m’en vais bien vous parler encore716 de M. de Turenne. Mme d’Elbeuf, qui demeure pour quelques jours chez le cardinal de Bouillon, me pria de dîner avec eux deux, pour parler de leur affliction. Mme de La Fayette717 y était. Nous fîmes bien précisément ce que nous avions résolu : les yeux ne nous séchèrent pas. Elle avait un portrait divinement bien fait de ce héros, et tout son train718 était arrivé à onze heures : tous ces pauvres gens étaient fondus719 en larmes, et déjà tout habillés de deuil. Il vint trois gentilshommes, qui pensèrent mourir de voir ce portrait : c’étaient des cris qui faisaient fendre le cœur ; ils ne pouvaient prononcer une parole ; ses valets de chambre, ses laquais, ses pages, ses trompettes, tout était fondu en larmes et faisait fondre les autres. Le premier qui put prononcer une parole répondit à nos tristes questions : nous nous fîmes raconter sa mort.
Il voulait se confesser le soir, et en se cachotant720 il avait donné les ordres pour le soir, et devait communier le lendemain, qui était le dimanche » Il croyait donner la bataille, et monta à cheval à deux heures le samedi, après avoir mangé. Il avait bien des gens avec lui ; il les laissa tous à trente pas de la hauteur où il voulait aller » Il dit au petit d’Elbeuf : « Mon neveu, demeurez là ; vous ne faites que tourner autour de moi, vous me feriez reconnaître » Il trouva M. d’Hamilton721 près de l’endroit où il allait, qui lui dit : « Monsieur, venez par ici ; on tirera où vous allez. — Monsieur, lui dit-il, je m’y en vais : je ne veux point du tout être tué aujourd’hui ; cela sera le mieux du monde. » Il tournait son cheval, il aperçut Saint-Hilaire, qui lui dit, le chapeau à la main : « Jetez les yeux sur cette batterie que j’ai fait mettre là ». Il retourne deux pas, et, sans être arrêté, il reçu le coup qui emporta le bras et la main qui tenaient le chapeau de Saint-Hilaire, et perça le corps après avoir fracassé le bras de ce héros722. Ce gentilhomme le regardait toujours ; il ne le voit point tomber ; le cheval l’emporta où il avait laissé le petit d’Elbeuf ; il n’était point encore tombé, mais il était penché le nez sur l’arçon : dans ce moment, le cheval s’arrête ; il tomba entre les bras de ses gens ; il ouvrît deux fois de grands yeux et la bouche, et puis demeura tranquille pour jamais : songez qu’il était mort et qu’il avait une partie du cœur emportée. On crie, on pleure ; M. d’Hamilton fait cesser ce bruit et ôter le petit d’Elbeuf, qui était jeté sur ce corps, qui ne le voulait pas quitter et qui se pâmait de crier. On jette un manteau ; on le porte dans une haie ; on le garde à petit bruit ; un carrosse vient ; on l’emporte dans sa tente ; ce fut là où723 M. de Lorges, M. de Roye724, et beaucoup d’autres pensèrent mourir de douleur ; mais il fallut se faire violence et songer aux grandes affaires qu’il avait sur les bras.
On lui a fait un service militaire dans le camp, où les larmes et les cris faisaient le véritable deuil725 : tous les officiers pourtant avaient des écharpes de crêpe, tous les tambours en étaient couverts, qui726 ne frappaient qu’un coup ; les piques traînantes et les mousquets renversés ; mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter sans que l’on n’en727 soit ému. Ses deux neveux étaient à cette pompe, dans l’état que vous pouvez penser : M. de Roye tout blessé s’y fit porter ; car cette messe ne fut dite que quand ils eurent repassé le Rhin728. Je pense que le pauvre chevalier729 était bien abîmé de douleur.
Quand ce corps a quitté son armée, ç’a été encore une autre désolation ; partout où il a passé, ç’a été des clameurs ; mais à Langres ils730 se sont surpassés : ils allèrent tous au-devant de lui, tous habillés de deuil, au nombre de plus de deux cents, suivis du peuple ; tout le clergé en cérémonie ; ils firent dire un service solennel dans la ville, et en un moment se cotisèrent tous pour cette dépense, qui monte à cinq mille francs, parce qu’ils reconduisirent le corps jusqu’à la première ville, et voulurent défrayer tout le train. Que dites-vous de ces marques naturelles d’une affection fondée sur un mérite extraordinaire ?
Il arrive à Saint-Denis ce soir ou demain ; tous ses gens l’allaient reprendre à deux lieues d’ici. Il sera dans une chapelle en dépôt, en attendant qu’on prépare la chapelle. Il y aura un service, en attendant celui de Notre-Dame, qui sera solennel.
Un guerrier de dix-sept ans
A Madame De Grignan §
A Paris, ce mercredi, 8 décembre (1688).
Le petit fripon731, après nous avoir mandé qu’il n’arriverait qu’hier mardi, arriva comme un petit étourdi avant-hier, à sept heures du soir, que732 je n’étais pas revenue de la ville733. Son oncle734 le reçut et fut ravi de le voir ; et moi, quand je revins, je le trouvai tout gai, tout joli, qui m’embrassa cinq ou six fois de très bonne grâce ; il me voulait baiser les mains, je voulais baiser ses joues, cela faisait une contestation : enfin, je pris possession de sa tête, je la baisai à ma fantaisie ; je voulus voir sa contusion ; mais comme elle est, ne vous déplaise, à la cuisse gauche, je ne trouvai pas à propos de lui faire mettre chausses735 bas. Nous causâmes le soir avec ce petit compère ; il adore votre portrait, il voudrait bien voir sa chère maman ; mais la qualité de guerrier est si sévère, que l’on n’oserait rien proposer736. Je voudrais que vous l’eussiez entendu conter négligemment sa contusion » et la vérité du peu de cas qu’il en fit737 et du peu d’émotion qu’il en eut, lorsque dans la tranchée tout en était en peine. Au reste, ma chère enfant, s’il avait retenu vos leçons, et qu’il se fût tenu droit, il était mort ; mais suivant sa bonne coutume, étant assis sur la banquette738, il était penché sur le comte de Guiche739, avec qui il causait : vous n’eussiez jamais cru, ma fille, qu’il eût été si bon d’être un peu de travers740. Nous causons avec lui sans cesse, nous sommes ravis de le voir, et nous soupirons que vous n’ayez pointée même plaisir… Enfin je ne vous dirai plus : « Il reviendra » ; vous ne le voulez pas : vous voulez qu’on vous dise : « Le voilà ». Oh ! tenez donc, le voilà lui-même en personne741.
Bossuet
(1627-1704) §
Né en 1627 à Dijon, mort en 1704, Jacques-Bénigne Bossuet est avant tout célèbre comme prédicateur. Mais, outre ses Sermons et ses Oraisons funèbres, il a écrit des ouvrages de philosophie (Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même), d’histoire (Discours sur l’histoire universelle), de controverse (Histoire des variations, des églises protestantes). Quelques-uns de ses livres ont été composés pour le dauphin, dont il fut précepteur (1670-1679). Il a été, au xviie siècle, le représentant le plus éminent et le plus autorisé de l’Eglise de France. Comme orateur et comme écrivain, il est digne d’être comparé aux plus célèbres de l’antiquité ; en France nul prosateur ne s’est élevé plus haut que lui.
Le mauvais riche §
La félicité toute seule742 est capable d’endurcir le cœur de l’homme. L’aise, la joie, l’abondance remplissent l’âme de telle sorte, qu’elles en éloignent tout le sentiment de la misère des autres, et mettent à sec, si l’on n’y prend garde, la source de la compassion. C’est ici la malédiction de grandes fortunes ; c’est ici que l’esprit du monde paraît le plus opposé à l’esprit du christianisme : car qu’est-ce que l’esprit du christianisme ? esprit de fraternité, esprit de tendresse et de compassion, qui nous fait sentir les maux de nos frères, entrer dans leurs intérêts, souffrir de tous leurs besoins. Au contraire l’esprit du monde, c’est-à-dire l’esprit de grandeur, c’est un excès d’amour-propre743, qui, bien loin de penser aux autres, s’imagine qu’il n’y a que lui… Je suis744, il n’y a que moi ; toute cette multitude, ce sont des têtes de nul prix, et, comme on parle745, des gens de néant. Ainsi chacun ne compte que soi ; et tenant tout le reste dans l’indifférence, on tâche de vivre à son aise, dans une souveraine tranquillité des fléaux746 qui affligent le genre humain.
Ah ! Dieu est juste et équitable. Vous y viendrez vous-même, riche impitoyable, aux jours de besoin et d’angoisse. Ne croyez pas que je vous menace du changement de votre fortune : l’événement en est casuel747 ; mais ce que je veux dire n’est pas douteux. Elle viendra au jour destiné748, cette dernière maladie, où, parmi un nombre infini d’amis, de médecins, et de serviteurs, vous demeurerez sans secours, plus délaissé, plus abandonné que ce pauvre qui meurt sur la paille, et qui n’a pas un drap pour sa sépulture. Car, en cette fatale749 maladie, que serviront ces amis, qu’à750 vous affliger par leur présence ; ces médecins, qu’à vous tourmenter ; ces serviteurs, qu’à courir deçà et delà dans votre maison avec un empressement inutile ? Il vous faut d’autres amis, d’autres serviteurs : ces pauvres, que vous avez méprisés, sont les seuls qui seraient capables de vous secourir751. Que n’avez-vous pensé de bonne heure à vous faire de tels amis, qui maintenant vous tendraient les bras, afin devons recevoir dans les tabernacles éternels752 ?
(Sermon sur l’Impénitence finale, troisième point.)
Le sol de la patrie §
La société humaine demande753 qu’on aime la terre où l’on habite ensemble : on la regarde comme une mère et une nourrice commune, on s’y attache, et cela unit.
Les hommes, en effet, se sentent liés par quelque chose de fort, lorsqu’ils songent que la même terre qui les a portés et nourris étant vivants les recevra en son sein quand ils seront morts. « Votre demeure sera la mienne ; votre peuple sera le mien, disait Ruth754 à sa belle-mère Noémi ; je mourrai dans la terre où vous serez enterrée et j’y choisirai ma sépulture. »
Joseph mourant dit à ses frères755 : « Dieu vous visitera et vous établira dans la terre qu’il a promise à nos pères ; emportez mes os avec vous. » Ce fut là sa dernière parole. Ce lui est une douceur, en mourant, d’espérer de suivre ses frères dans la terre que Dieu leur donne pour leur patrie, et ses os y reposeront plus tranquillement au milieu de ses citoyens756.
C’est un sentiment naturel à tous les peuples. Thémistocle, Athénien, était banni de sa patrie comme traître ; il en machinait la ruine avec le roi de Perse, à qui il s’était livré. Et, toutefois, en mourant, il oublia Magnésie757, que le roi lui avait donnée, quoiqu’il y eût été si bien traité, et il ordonna q ses amis de porter ses os dans l’Attique, pour les y inhumer secrètement, à cause que la rigueur des décrets publics ne permettait pas qu’on le fit d’une autre sorte758. Dans les approches de la mort où la raison revient et où la vengeance cesse, l’amour de la patrie759 se réveille ; il croit satisfaire à sa patrie : il croit être rappelé de son exil après sa mort, et, comme ils parlaient alors760, que la terre serait plus bénigne et plus légère à ses os.
C’est pourquoi de bons citoyens761 s’affectionnent à leur terre natale. « Jetais devant le roi, dit Néhémias762, et je lui présentais à boire, et je paraissais languissant en sa présence. » Et le roi dit : « Pourquoi votre visage est-il si triste, puisque je ne vous vois pas malade ? » Et je dis au roi : « Comment pourrais-je n’avoir pas le visage triste, puisque la ville où mes pères sont ensevelis est déserte, et que ses portes sont brûlées ! Si vous voulez me faire quelque grâce, renvoyez-moi en Judée, en la terre du sépulcre de mon père, et je la rebâtirai. »
Étant arrivée en Judée, il appelle ses concitoyens, que l’amour de leur commune patrie unissait ensemble. « Vous savez, dit-il763, notre affliction ; Jérusalem est là déserte ; ses portes sont consumées par le feu ; venez et unissons-nous pour la rebâtir. » Tant que les juifs demeurèrent dans un pays étranger et si éloigné de leur patrie, ils ne cessèrent de pleurer et d’enfler, pour ainsi parler, de leurs larmes, les fleuves de Babylone, en se souvenant de Sion. Ils ne pouvaient se résoudre à chanter leurs agréables cantiques, qui étaient les cantiques du Seigneur, dans une terre étrangère. Leurs instruments de musique, autrefois leur consolation et leur joie, demeuraient suspendus aux saules plantés sur la rive, et ils en avaient perdu l’usage. « O Jérusalem ! disaient-ils, si jamais je puis t’oublier, puissé-je m’oublier moi-même !764 » Ceux que les vainqueurs avaient laissés dans leur terre natale s’estimaient heureux, et ils disaient au Seigneur, dans les psaumes qu’ils lui chantaient durant la captivité : « Il est temps, ô Seigneur ! que vous ayez pitié de Sion ; vos serviteurs en aiment les ruines mêmes et les pierres démolies, et leur terre natale, toute désolée qu’elle est, a encore toute leur tendresse et toute leur compassion765. »
(Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, livre I, article ii.)
La bonté §
Loin de nous les héros sans humanité ! Ils pourront bien forcer766 les respects et ravir l’admiration, comme font tous les objets extraordinaires ; mais ils n’auront pas les cœurs. Lorsque Dieu forma le cœur et les entrailles de l’homme, il y mit premièrement la bonté comme le propre caractère767 de la nature divine, et pour être comme la marque de cette main bienfaisante dont nous sortons. La bonté devait donc faire comme le fond de notre cœur, et devait être en même temps le premier attrait que nous aurions en nous-mêmes pour gagner les autres hommes. La grandeur qui vient par-dessus, loin d’affaiblir la bonté, n’est faite que pour l’aider à se communiquer davantage, comme une fontaine publique qu’on élève pour la répandre. Les cœurs sont à ce prix ; et les grands dont la bonté n’est pas le partage, par une juste punition de leur dédaigneuse insensibilité, demeureront privés éternellement du plus grand bien de la vie humaine, c’est-à-dire des douceurs de la société.
(Oraison funèbre du prince de Condé.)
Bienheureux les pacifiques ! §
« Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu768. » Dieu est appelé769 le Dieu de paix : « il fait habiter dans sa maison ceux qui sont de même esprit et de même cœur770 ». Sa bonté concilie tout. Il a composé cet univers des natures et des qualités les plus discordantes : il fait concourir ensemble la nuit et le jour, l’hiver et l’été, le froid et le chaud, et ainsi du reste pour la bonne constitution de l’univers et pour la conservation du genre humain. Il reçoit ses ennemis en sa paix, et « il faut », dit Jésus-Christ771, « qu’à son exemple, vous aimiez vos ennemis et que vous fassiez du bien à ceux qui vous haïssent ».
Le soleil n’en est pas plus nébuleux dans les pays où Dieu n’est pas connu, la pluie n’en arrose pas moins les champs et les pâturages, et n’y est pas moins rafraîchissante ni moins féconde. Ainsi, comme disait saint Paul772 : « Dieu ne se laisse point sans témoignage ». Le soleil, quand il se lève, nous avertit de son immense bonté, puisqu’il ne se lève pas plus tard, ni avec des couleurs moins vives, pour les ennemis de Dieu que pour ses amis. Adorez donc, quand il se lève, la bonté de Dieu qui pardonne, et ne témoignez pas à votre frère un visage chagrin, pendant que le ciel, et Dieu même, si l’on peut parler de la sorte, lui en montre un si serein et si doux.
Jésus-Christ, le Fils unique du Père céleste, est le grand pacificateur… A l’exemple du Fils unique, les enfants d’adoption doivent prendre le caractère de leur Père, et se montrer vrais enfants de Dieu par l’amour de la paix....
Soyons donc vraiment pacifiques : avons toujours des paroles de réconciliation et de paix, pour adoucir l’amertume que nos frères témoigneront contre nous ou contre les autres, cherchant toujours à adoucir les mauvais rapports, à prévenir les inimitiés, les froideurs, les indifférences ; enfin à réconcilier ceux qui seront divisés. C’est faire l’œuvre de Dieu et se montrer ses enfants en imitant sa bonté.
Combien sont éloignés de cet esprit ceux qui se plaisent à brouiller les uns avec les autres ; qui, par de mauvais rapports, souvent faux dans le tout, souvent augmentés dans leurs circonstances, en disant ce qu’il fallait taire, en réveillant le souvenir de ce qu’il fallait laisser oublier, ou par des paroles piquantes et dédaigneuses, aigrissent leurs frères et leurs sœurs déjà émus et infirmes773 par leurs colères !
(Méditations sur l’Évangile, Sermon sur la montagne, 8e jour).
Bourdaloue
(1632-1744) §
Né à Bourges en 1632, mort en 1704, Louis Bourdaloue, de la Société de Jésus, est le plus grand de nos sermonnaires après Bossuet. Il est surtout admirable par les peintures morales qui remplissent ses sermons : l’austérité de sa vie donnait d’ailleurs plus de poids encore à sa prédication, et l’on peut voir, dans plusieurs lettres de Mme de Sévigné, des témoignages enthousiastes de l’estime que ses contemporains faisaient de son génie.
La médisance §
Si la médisance était réduite à ne s’y produire qu’en public et devant les témoins, à peine y aurait-il des médisants dans le monde : pourquoi ? parce qu’il y aurait fort peu de gens qui pussent ou qui voulussent essuyer la tache que la médisance imprime à celui qui la fait. Mais aujourd’hui l’on en est quitte pour un peu de prudence et pour une discrétion apparente ; avec cela on médit librement et impunément : d’où il arrive que les plus lâches y deviennent les plus hardis. Peut-on mieux les dépeindre que le Saint-Esprit dans la Sagesse774, quand il les compare à des serpents qui piquent sans faire de bruit ? Ils demandent le secret à tout le monde, et ils ne voient pas, dit saint Jean Chrysostome, que cela même les rend méprisables. Car demander à celui que j’ai fait le confident de ma médisance qu’il garde le secret, c’est proprement775 lui confesser mon injustice. C’est lui dire : Soyez plus sage et plus charitable que moi : je suis un médisant, ne le soyez pas ; en vous parlant de telle personne, je blesse la charité, ne suivez pas mon exemple....
Ce n’est pas tout. D’où vient qu’aujourd’hui la médisance s’est rendue si agréable dans les entretiens et dans les conversations du monde ? Pourquoi emploie-t-elle tant d’artifices et cherche-t-elle tant de tours ? Ces manières de s’insinuer, cet air enjoué qu’elle prend, ces bons mots qu’elle étudie, ces termes dont elle s’enveloppe, ces équivoques dont elle s’applaudit, ces louanges suivies de certaines restrictions et de certaines réserves, ces réflexions pleines d’une compassion cruelle, ces œillades qui parlent sans parler, et qui disent bien plus que les paroles mêmes : pourquoi tout cela ?… Parce qu’autrement la médisance n’aurait pas le front de se montrer ni de paraître… Et de tout ceci je conclus qu’entre les vices, la médisance est évidemment un des plus lâches.
J’ai dit encore que c’était un des plus odieux… Car qu’y a-t-il de plus odieux qu’un homme à la censure de qui chacun se trouve exposé ; dont il n’y a personne, de quelque condition qu’il soit, qui se puisse dire exempt ; et de qui les puissances mêmes ne peuvent éviter les traits ? Quoi de plus odieux qu’un tribunal érigé d’une autorité particulière, où l’on décide souverainement du mérite des hommes ; où l’un est déclaré tel que l’on veut qu’il soit ; où l’autre quelquefois est noté776 pour jamais et flétri d’une manière à ne s’en pouvoir laver ; où tous reçoivent leur arrêt, qui leur est prononcé sans distinction et sans compassion ?
C’est pour cela que l’Écriture, dans le portrait du médisant, nous le représente comme un homme terrible et redoutable. En effet, il est redoutable dans une ville, redoutable dans une communauté, redoutable dans les maisons particulières, redoutable chez les grands, redoutable parmi les petits : dans une ville, parce qu’il y suscite des factions et des partis ; dans une communauté777, parce qu’il en trouble la paix et l’union ; dans une maison particulière, parce qu’il y entretient des inimitiés et des froideurs ; chez les grands, parce qu’il abuse de la créance778 qu’ils ont en lui, pour détruire auprès d’eux qui il lui plaît ; parmi les petits, parce qu’il les anime les uns contre les autres. Combien de familles divisées par une seule médisance ! combien d’amitiés rompues par une raillerie ! combien de cœurs aigris et envenimés par les rapports indiscrets !
(Dominicales : Sermon sur la médisance, Ire partie.)
L’ami de tout le monde §
On dit communément, et on a raison de le dire : « L’ami de tout le monde n’est ami de personne. » Il y a en effet des gens de ce caractère : ils vous aperçoivent ; ils viennent à vous avec un visage ouvert, vous tendent les bras, vous saluent, vous embrassent779, vous font les plus belles offres de service. Mais enfin, après mille protestations d’amitié, ils vous quittent, et demandent au premier qu’ils rencontrent, comment vous vous appelez et qui vous êtes780.
(Pensées sur divers sujets de religion et de morale : Sur la Charité du prochain et les Amitiés humaines.)
Fléchier
(1632-1710) §
Né dans le comtat d’Avignon, Esprit Fléchier, qui est mort évêque de Lavaur, a été longtemps célèbre comme orateur : on vantait certaines de ses Oraisons funèbres presque à l’égal de celles de Bossuet. Cette réputation ne s’est pas soutenue, et l’élégance de son style nous paraît à la fois monotone et vide. Mais il avait été, dans la première partie de sa carrière, précepteur chez Lefèvre de Caumartin, maître des requêtes au Conseil d’État ; il accompagna ce magistrat aux Grands Jours d’Auvergne (1665-1666)781 et rédigea dès lors de ce voyage une relation, qui est restée longtemps inédite, mais qui mérite de survivre comme un document très agréable et très instructif, il a aussi écrit, entre autres ouvrages, une Vie de Théodose le Grand (1679) et une Histoire du cardinal Ximenès (1693).
Noble de province au xviie siècle §
Entre ceux qui furent jugés dignes du dernier supplice, M. le marquis de Canillac782 tient le premier rang, qui783 passe pour le plus grand et le plus vieux pécheur de la province784. Il y a plus de soixante ans qu’il a commencé d’être méchant, et n’a jamais cessé de l’être depuis ce temps-là. Aussi il tient à sa gloire de s’être toujours soutenu sans se démentir. C’est le propre de ceux qui mènent une vie déréglée d’être chagrins, parce qu’ils méditent toujours quelque injustice, ou parce que le crime est toujours accompagné de honte et de remords, qui785 est le supplice intérieur des coupables : mais le caractère de celui-ci était d’être méchant sans remords et de faire le mal en riant. Il avait toujours quelque prétexte d’être tyran, et ne répondait aux plaintes qu’on lui faisait que par des railleries qui divertissaient assez ceux qu’il ne rendait pas malheureux....
Aux premières nouvelles qu’il eut des Grands Jours, il fit son petit équipage de fuite, et sans perdre un moment, il quitta l’Auvergne et traversa le Languedoc. Le grand prévôt786 ayant rencontré sa litière787 voulut savoir qui était dedans. On lui dit que c’était une dame malade, qui revenait d’une de ses maisons de campagne. Cet homme, qui avait des ordres particuliers contre quelques gentilshommes de sa province, ne s’en fia pas d’abord à la réponse qu’on lui avait faite, et, comme c’est une vertu de prévôt de n’être pas trop crédule, il eut la curiosité de voir si ce n’était point quelque fugitif déguisé, et, ayant tiré le rideau, il aperçut une terrible dame, dont la figure lui aurait fait peur, si elle n’eût été de sa connaissance. Le marquis le salua fort humblement, comme il convenait, et après l’avoir fait souvenir de l’amitié qu’ils avaient eue autrefois ensemble, lui voulut dire le compliment de congé788, ne trouvant pas qu’il fût à propos, dans la conjoncture des affaires, de converser longtemps avec un homme de sa profession. Mais il fut prié d’arrêter un moment, jusqu’à ce qu’on eût parcouru le nom des coupables qu’on avait ordre d’arrêter. Le sien par bonheur ne s’y789 trouva pas ; ainsi le prévôt lui donna congé, quoiqu’il fût bien assuré qu’il ne serait point désavoué s’il eût fait cette belle capture, et lui pardonna, soit parce qu’il n’osa point excéder sa commission790, soit parce qu’il ne voulut point perdre un vieux gentilhomme qu’il avait autrefois connu particulièrement, et qui n’avait que fort peu de temps à vivre. Il est croyable qu’il791 pressa depuis son voyage et qu’il ht faire à ses mulets de grandes journées, de peur d’être incommodé par la rencontre de quelque nouveau prévôt qui n’aurait peut-être pas eu toute la complaisance de l’autre....
Je ne m’arrêterai point à raconter tous les dérèglements dont il est accusé. Il suffit de dire qu’il a pratiqué tout ce que la tyrannie peut inventer en matière d’imposition. On levait dans ses terres la taille792 de Monsieur, celle de Madame et celle de tous les enfants de la maison, que ses sujets étaient obligés de payer outre celle du roi. Il est vrai qu’il y a des droits justifiés par des titres fort anciens qui permettent à quelques seigneurs de faire quelques impositions en certains cas, comme lorsque eux-mêmes ou leurs fils aînés se marient ; mais le marquis savait l’art d’étendre les droits, et faisait tous les ans ce que les autres ne font qu’une fois en leur vie. Pour exécuter ses desseins plus facilement et pour empêcher les murmures, il entretenait dans des tours douze scélérats dévoués à toute sorte de crimes, qu’il appelait ses douze apôtres, qui catéchisaient avec l’épée ou avec le bâton ceux qui étaient rebelles à sa loi et faisaient de terribles violences, lorsqu’ils avaient reçu la cruelle mission de leur maître. Il leur avait donné des noms fort apostoliques, appelant l’un Sans-Fiance793, l’autre Brise-Tout et ainsi du reste. Sur la terreur que donnaient ces noms effroyables il imposait des sommes assez considérables sur les viandes qu’on mange ordinairement, et, comme on pratiquait un peu trop d’abstinence, il tournait l’imposition sur ceux qui n’en mangeaient pas.
Le plus grand revenu qu’il avait était celui de la justice. Il faisait, pour la moindre chose, emprisonner et juger des misérables, et les obligeait de racheter leurs peines par argent. Il eût voulu que tous ses justiciables eussent été de son humeur, et les engageait souvent à de méchantes actions pour les tous faire payer après avec beaucoup de rigueur. Enfin, personne n’a jamais tant fait et n’a jamais tant souhaité794, et n’a jamais tant profité des crimes que lui. Non seulement il faisait payer les mauvaises actions qu’on avait faites ; il fallait encore acheter la liberté d’en faire, et lorsqu’on avait de l’argent à lui donner, on pouvait être criminel ou le devenir ;… il était permis de contenter toutes ses passions, pourvu qu’on satisfît son avarice.
Il avait beaucoup dépensé et s’était incommodé795 pendant ses longues années de service796, et il n’avait point d’autre voie pour remettre ses affaires que la tyrannie. Il se sentait du penchant à ces sortes de vexations ; il était éloigné de la cour et presque assuré de l’impunité. Ainsi il agissait sans crainte et suivait aveuglément toutes ses passions, les couvrant la plupart sous des apparences de justice. Toutes ces concussions et plusieurs autres violences dont on eut peine à trouver des preuves, à cause de la terreur qu’avaient encore laissée dans l’esprit des peuples le marquis et ses émissaires, obligèrent Messieurs des Grands Jours à le juger à mort. Il fut effigié797 au grand contentement de tout le monde. Il l’avait été autrefois par arrêt du parlement de Toulouse ; il avait vu lui-même d’une fenêtre voisine son exécution et il avait trouvé fort plaisant d’être fort en repos dans une maison pendant qu’on le décapitait dans une place, et de se voir mourir dans la rue, pendant qu’il se portait bien chez soi798. Il n’eut pas le moindre mal de tête de ce coup, et je crois qu’il fut bien fâché de n’avoir pas eu encore une fois ce divertissement. Mais il avait jugé expédient799 pour sa santé de se retirer800, ayant perdu beaucoup de sa belle humeur passée par le chagrin et par la pesanteur que l’âge apporte. Il fut condamné à une grosse amende et à la confiscation de ses biens et l’on fit raser deux ou trois tours qui avaient été longtemps la retraite de ses apôtres.
(Mémoire sur les Grands Jours d’Auvergne en 1665, édition Chéruel, p. 259-263.)
Malebranche
(1638-1715) §
Né à Paris en 1638, mort en 1715, l’oratorien801 Nicolas de Malebranche fut le plus célèbre des cartésiens802 ; mais il tira des doctrines du maître des conséquences toutes nouvelles, et fut lui-même un philosophe original qui eut au xviie siècle des partisans et des adversaires illustres. Comme écrivain il est fort digne d’estime : son style est tour à tour rigoureux et ému, et partout abondant et facile. Ses principaux ouvrages sont le traité De la recherche de la vérité (1674-1675) et les Entretiens sur la métaphysique et sur la religion (1688).
La grandeur de Dieu attestée par les merveilles de la nature §
De quelque côté qu’on jette les yeux dans l’univers, on y voit une profusion de prodiges. Et si nous cessons de les admirer, c’est assurément que nous cessons de les considérer avec l’attention qu’ils méritent ; car les astronomes qui mesurent la grandeur des astres, et qui voudraient bien savoir le nombre des étoiles, sont d’autant plus surpris d’admiration qu’ils deviennent plus savants. Autrefois le soleil leur paraissait grand comme le Péloponnèse803; mais aujourd’hui les plus habiles804 le trouvent un million de fois plus grand que la terre805. Les anciens ne comptaient que mille vingt-deux étoiles ; mais personne aujourd’hui n’ose les compter. Dieu même nous avait dit autrefois que nul homme n’en saurait jamais le nombre ; mais l’invention des télescopes nous force bien maintenant à reconnaître que les catalogues que nous en avons sont fort imparfaits. Ils ne contiennent que celles qu’on découvre sans lunette ; et c’est assurément le plus petit nombre. Je crois même qu’il y en a beaucoup plus qu’on ne découvrira jamais, qu’il y en a de visibles par les meilleurs télescopes806 : et cependant il y a bien de l’apparence qu’une fort grande partie de ces étoiles ne le cède point, ni en grandeur, ni en majesté, à ce vaste corps qui nous paraît, ici-bas, le plus lumineux et le plus beau. Que Dieu est donc grand dans les cieux ! Qu’il est élevé dans leur profondeur ! Qu’il est magnifique dans leur éclat ! Qu’il est sage, qu’il est puissant dans leurs mouvements réglés !
Mais quittons le grand. Notre imagination se perd dans ces espaces immenses que nous n’oserions limiter, et que nous craignons de laisser sans bornes. Combien d’ouvrages admirables sur la terre que nous habitons, sur ce point imperceptible à ceux qui ne mesurent que les corps célestes ! Mais cette terre, que messieurs les astronomes comptent pour rien, est encore trop vaste pour moi. Je me renferme dans votre807 parc : que d’animaux, que d’oiseaux, que d’insectes, que de plantes, que de fleurs et que de fruits !
L’autre jour que j’étais couché à l’ombre, je m’avisai de remarquer la variété des herbes et des petits animaux que je trouvai sous mes veux. Je comptai, sans changer de place, plus de vingt sortes d’insectes dans un fort petit espace, et pour le moins autant de diverses plantes. Je pris un de ces insectes, dont je ne sais point le nom… Je le considérai attentivement ; et je ne crains point de vous dire de lui ce que Jésus-Christ assure des lis champêtres : que Salomon, dans toute sa gloire, n’avait point de si magnifiques ornements808. Après que j’eus admiré quelque temps cette petite créature si injustement méprisée, et même si indignement et si cruellement traitée par les autres animaux, à qui apparemment elle sert de pâture, je me mis à lire un livre que j’avais sur moi, et j’y trouvai une chose fort étonnante : c’est qu’il y a dans le monde un nombre infini d’insectes pour le moins un million de fois plus petits que celui que je venais de considérer, cinquante mille fois plus petits qu’un grain de sable.
Nous nous perdons dans le petit aussi bien que dans le grand. Il n’y a personne qui puisse dire qu’il a découvert le plus petit des animaux. Autrefois, c’était le ciron809, mais aujourd’hui ce petit ciron est devenu monstrueux par sa grandeur. Plus on perfectionne les microscopes, plus on se persuade que la petitesse de la matière ne borne point la sagesse du Créateur et qu’il forme du néant même, pour ainsi dire, d’un atome qui ne tombe point sous nos sens, des ouvrages qui passent l’imagination, et même qui vont bien au-delà des plus vastes intelligences.
(Entretiens sur la métaphysique, Xe entretien, 1, 2.)
Racine
(1639-1699) §
Pour la notice, voir page 572,
Lettres a son fils810 §
Au camp devant Namur811, le 31e mai [1692].
Vous aurez pu voir, mon cher enfant, par les lettres que j’écris à votre mère, combien je suis touché de votre maladie812, et la peine extrême que je ressens de n’être pas auprès de vous pour vous consoler. Je vois que vous prenez avec beaucoup de patience le mal que Dieu vous envoie, et que vous êtes fort exact à faire tout ce qu’on vous dit. Il est extrêmement important pour vous de ne vous point impatienter. J’espère qu’avec la grâce de Dieu, il ne vous arrivera aucun accident. C’est une maladie dont peu de personnes sont exemptes, et il vaut mieux en être attaqué à votre âge qu’à un âge plus avancé.
J’aurai une sensible joie de recevoir de vos lettres ; mais ne m’écrivez que quand vous serez entièrement hors de danger, parce que vous ne pourriez écrire sans mettre vos bras à l’air et vous refroidir. Quand je ne serai plus inquiet de votre mal, je vous écrirai des nouvelles du siège de Namur. Il y a lieu d’espérer que la place se rendra bientôt ; et je m’en réjouis d’autant plus que cela pourra me mettre en état de vous revoir bientôt après… Adieu, mon cher fils. Offrez bien au bon Dieu tout le mal que vous souffrez, et remettez-vous entièrement à sa sainte volonté. Assurez-vous qu’on ne peut pas vous aimer plus que je vous aime, et que j’ai une fort grande impatience de vous embrasser.
II §
Au camp devant Namur, le 10 juin [1692].
Vous pouvez juger, par toutes les inquiétudes que m’a causées votre maladie, combien j’ai de joie de votre guérison. Vous avez beaucoup de grâces à rendre à Dieu, de ce qu’il a permis qu’il ne vous soit arrivé aucun fâcheux accident, et que la fluxion qui vous était tombée sur les yeux n’ait point eu de suite. Je loue extrêmement la reconnaissance que vous témoignez pour tous les soins que votre mère a pris de vous. J’espère que vous ne les oublierez jamais, et que vous vous acquitterez de toutes les obligations que vous lui avez, par beaucoup de soumission à tout ce qu’elle désirera de vous. Votre lettre m’a fait beaucoup de plaisir ; elle est fort sagement écrite, et c’était la meilleure et la plus agréable marque que vous me puissiez donner de votre guérison. Mais ne vous pressez pas encore de retourner à l’étude ; je vous conseille de ne lire que des choses qui vous fassent plaisir sans vous donner trop de peine, jusqu’à ce que le médecin qui vous a traité vous donne la permission de recommencer votre travail… Adieu, mon Cher fils : faites bien mes compliments à vos sœurs813; je ne sais pourtant si on leur permet de vous rendre visite ; je crois que ce ne sera pas sitôt ; réservez donc à814 leur faire mes compliments quand vous serez en état de les voir.
Le fusilier §
Un soldat du régiment des fusiliers815 qui travaillait à la tranchée y avait posé un gabion ; un coup de canon vint qui emporta son gabion ; aussitôt il en alla poser à la même place un autre, qui fut sur-le-champ emporté par un autre coup de canon. Le soldat, sans rien dire, en prit un troisième et l’alla poser ; un troisième coup de canon emporta ce troisième gabion. Alors le soldat rebuté se tint en repos ; mais son officier lui commanda de ne point laisser cet endroit sans gabion. Le soldat dit : « J’irai, mais j’y serai tué ». Il y alla et en posant son quatrième gabion eut le bras fracassé d’un coup de canon. Il revint soutenant son bras pendant avec l’autre bras, et se contenta de dire à son officier : « Je l’avais bien dit ». Il fallut lui couper le bras, qui ne tenait presque à rien. Il souffrit cela, sans desserrer les dents ; et après l’opération dit froidement : « Je suis donc hors d’état de travailler ; c’est maintenant au roi à me nourrir816. »
(Correspondance, lettre du 3 juin 1692.)
La Bruyère
(1645-1695) §
Jean de la Bruyère, né à Paris en 1645, mort en 1695, entra en 1684, sur la recommandation de Bossuet, dit-on, dans la maison du grand Condé comme précepteur de son petit-fils. En 1688, il publia une traduction des Caractères du philosophe grec Théophraste, le plus célèbre des disciples d’Aristote, et y joignit une suite d’observations et de portraits originaux intitulés les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Ce petit ouvrage eut un succès extraordinaire, et La Bruyère en donna jusqu’à sa mort huit éditions, de plus en plus augmentées. Ce succès ne s’est pas démenti : les Caractères, où la société de la fin du xviie siècle revit, saisie et jugée par un esprit singulièrement personnel et perspicace, sont en effet un des livres les mieux écrits, les plus fins et les plus variés de notre langue.
Le bavard §
Arrias817 a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi ; c’est un homme universel, et il se donne pour tel : il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord : il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ; il s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en était originaire ; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes ; il récite des historiettes qui y sont arrivées ; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se hasarde de818 le contredire, et lui prouve nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble point, prend feu au contraire contre l’interrupteur : « Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original819 : je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des conviés lui dit : « C’est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. »
(Les Caractères : De la société et de la conversation.)
L’homme de mauvais ton §
J’entends Théodecte820 de l’antichambre ; il grossit sa voix à mesure qu’il s’approche. Le voilà entré : il rit, il crie, il éclate ; on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre. Il n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton dont il parle. Il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et des sottises. Il a si peu d’égard au temps821, aux personnes, aux bienséances, que chacun a son fait822 sans qu’il ait eu intention de le lui donner ; il n’est pas encore assis qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier à table et dans823 la première place ; les femmes sont à sa droite et à sa gauche824. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n’a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés825; il abuse de la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Euthydème qui donne le repas ? Il rappelle à soi826 toute l’autorité de la table ; et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer. Le vin et les viandes827 n’ajoutent rien à son caractère828 Si l’on joue, il gagne au jeu ; il veut railler celui qui perd, et il l’offense, les rieurs sont pour lui : il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux qui le souffrent. (Id., ibid.)
Les manies §
Le fleuriste a un jardin dans un faubourg ; il y court au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire829 : il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de joie ; il la quitte pour l’Orientale ; de là il va à la Veuve ; il passe au Drap d’or ; de celle-ci à l’Agathe ; d’où il revient enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s’assied, où il oublie de dîner ; aussi est-elle830 nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées831 ; elle a un beau vase832 ou un beau calice ; il la contemple, il l’admire ; Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point ; il ne va pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera pour rien, quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée : il a vu des tulipes.
Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une ample récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de fruits ; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Parlez-lui de figues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette année, que les pêchers ont donné avec abondance ; c’est pour lui un idiome inconnu. il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers : il n’a de l’amour que pour une certaine espèce ; tout autre que vous lui nommez le fait sourire et se moquer ; il vous mène à l’arbre, cueille artistement cette prune exquise ; il l’ouvre, vous en donne la moitié, et prend l’autre : « Quelle chair ! dit-il ; goûtez-vous833 cela ? cela est-il divin ? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. » Et là-dessus ses narines s’enflent, il caches die avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. O l’homme divin, en effet ! homme qu’on ne peut jamais assez louer et admirer ! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles ! que je voie sa taille et son visage pendant qu’il vit ; que j’observe les traits et la contenance d’un homme qui seul entre les mortels possède une telle prune !...
Diphile834 commence par un oiseau et finit par mille : sa maison n’en est pas égayée, mais empestée. La cour, la salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet835, tout est volière ; ce n’est plus un ramage, c est un vacarme ; les vents d’automne et les eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu, on ne s’entend non plus parler les uns les autres que dans ces chambres où il faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un agréable amusement ; c’est une affaire laborieuse, et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au flageolet, et de faire couver des Canaries836. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car ses enfants sont sans maîtres et sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil ; lui-même il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche ; il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve....
Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de nouvelles emplettes ; c’est surtout le premier homme de l’Europe pour les papillons ; il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite ? il est plongé dans une amère douleur, il a l’humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre837 aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez, regardez ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus de vie et qui vient d’expirer : c’est une chenille, et quelle chenille !
(Id. De la mode.)
Le riche et le pauvre §
Giton838 a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes839, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut840, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance ; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit ; il crache fort loin, et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit, et profondément ; il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la promenade plus de place qu’un autre. Il tient le milieu841 en se promenant avec ses égaux ; il s’arrête, et l’on s’arrête ; il continue de marcher, et l’on marche : tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole : on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler ; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin842, politique843, mystérieux sur les affaires du temps844 ; il se croit des talents et de l’esprit845. Il est riche.
Phédon a les yeux creux, le teint échauffé846, le corps sec et le visage maigre ; il dort peu et d’un sommeil fort léger ; il est abstrait847, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide848 ; il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont connus ; et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal, il croit peser849 à ceux à qui il parle, il conte brièvement mais froidement ; il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à ce que les autres lui disent, il est de leur avis ; il court, il vole pour leur rendre de petits services. Il est complaisant, flatteur, empressé ; il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur ; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement, il semble craindre de fouler la terre ; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir ; il se met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient point de place ; il va les épaules serrées, le chapeau baissé sur ses yeux pour n’être point vu ; il se replie et se renferme dans son manteau ; il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et si remplies de monde, où il ne trouve moyen de passer sans effort, et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siège ; il parle bas dans la conversation, et il articule mal : libre néanmoins avec ses amis sur les affaires publiques850, chagrin contre le siècle851, médiocrement prévenu des ministres852 et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour répondre ; il tousse, il se mouche sous son chapeau ; il crache presque sur soi853 et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si cela lui arrive, c’est à l’insu de la compagnie : il n’en coûte à personne ni salut ni compliment854. Il est pauvre.
(Id. Des Biens de fortune.)
Le Testament §
Titius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère recueillir la succession. Un article lui donne la charge855, un autre les rentes de la ville856, un troisième le rend maître d’une terre à la campagne ; il y a une clause qui, bien entendue857, lui accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles : son affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux. Le moyen de les contenir ? il se voit officier858, logé aux champs et à la ville, meublé de même ; il se voit une bonne table et un carrosse : « Y avait-il au monde un plus honnête homme que le défunt, un meilleur homme ? » Il y a un codicille859, il faut le lire : il fait Mævius légataire universel, et il renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied860. Il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’affliger.
(Caractères, chap. xiv : De quelques usages.)
Les pensées §
La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donnera propos. (Du cœur.)
Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux misérables. (Ibid.)
Il y a autant de faiblesse à suivre la mode qu’à l’affecter. (De la mode.)
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de faire une sottise. (De l’homme.)
Hamilton
(vers 1646-1720) §
Né vers 1646 en Irlande, d’une vieille et noble famille d’Écosse, Antoine Hamilton fut, après la chute du roi d’Angleterre Charles ler (1648), amené en France où s’écoula son enfance. Il retourna à la cour d’Angleterre quand Charles II remonta sur le trône de ses pères (1660) et revint définitivement, en France, où il avait fait dans l’intervalle plusieurs séjours, à la suite de Jacques II détrôné (1688) ; il mourut à Saint-Germain en 1720. Outre quatre contes, écrits, avec une spirituelle affectation, à la manière de ceux des Mille et une Nuits, et quelques poésies, il a publié le récit des aventures, souvent plus divertissantes qu’honorables, d’un brillant gentilhomme français qui, exilé pendant quelques années en Angleterre, y était devenu son beau-frère : ce sont les Mémoires du Chevalier de Gramont. C’est un livre d’une rare frivolité et l’on se demande, après l’avoir lu, si toutes les aventures — réelles ou imaginaires — qui y sont rapportées méritaient bien qu’un écrivain prît là peine de nous les raconter. Mais le style de ce petit ouvrage est un modèle d’élégance aisée et naturelle, et l’on ne trouverait guère de narrations tout ensemble plus gaies, plus fines et qui semblent avoir coûté moins de peine à l’auteur, que celles qui remplissent les meilleures pages des Mémoires : c’est à ce titre qu’il faut garder à ce livre un souvenir.
Histoire d’un habit de bal §
I §
Le chevalier de Gramont861 avait un vieux valet de chambre, nommé Termes, hardi voleur, et menteur encore plus effronté… Le seigneur Ternies était employé pour les habits que son maître faisait venir de Paris et ne s’acquittait pas toujours fidèlement de cette commission, comme on va voir....
La reine862 avait imaginé une mascarade863 où ceux qu’elle nomma pour danser devaient représenter différentes nations. Elle donna du temps pour s’y préparer, et, durant ce temps, on peut croire que les tailleurs, les couturières et les brodeurs ne furent pas sans occupation....
Le roi864, qui ne cherchait qu’à faire plaisir au chevalier de Gramont, lui demanda s’il voulait être de la mascarade… Il865 ne se piquait pas d’être assez danseur pour une occasion comme celle-là ; cependant il n’avait garde de refuser cette proposition… « Monsieur le chevalier, lui dit le roi, de quelle manière vous mettrez-vous pour le bal ? Je vous laisse le choix des nations. — Si cela est, reprit le chevalier de Gramont, je m’habillerai à la française pour me déguiser ; car on me fait déjà l’honneur de me prendre pour un Anglais dans votre ville de Londres… Je ferai partir Termes demain matin, et, si je ne vous fais voir à son retour l’habit le plus galant que vous ayez encore vu, tenez-moi pour la nation la plus déshonorée de votre mascarade. »
Termes partit avec des instructions réitérées sur le sujet du voyage, et, son maître redoublant d’impatience dans une conjoncture comme celle-là, le courrier ne pouvait pas encore être débarqué qu’il commençait à compter les moments dans l’attente de son retour....
Le jour du bal venu, la cour, plus brillante que jamais, étala toute sa magnificence dans cette mascarade. Ceux qui la devaient composer étaient assemblés, à la réserve du chevalier de Gramont. On s’étonna de ce qu’il arrivât des derniers dans cette occasion, lui dont l’empressement était si remarquable dans les plus frivoles ; mais on s’étonna bien plus de le voir enfin paraître en habit de ville866 qui avait déjà paru867. La chose était monstrueuse pour la conjoncture868 et nouvelle pour lui. Vainement portait-il le plus beau point869, la perruque la plus vaste et la mieux poudrée qu’on pût voir : son habit, d’ailleurs magnifique, ne convenait point à la fête.
Le roi s’en aperçut d’abord870 : « Chevalier de Gramont, lui dit-il, Termes n’est donc point arrivé ?… — Pardon-nez-moi, sire, dit-il, Dieu merci… — Comment, Dieu merci, dit le roi ; lui serait-il arrivé quelque chose par les chemins ? — Sire, dit le chevalier de Gramont, voici l’histoire de mon habit et de M. Termes, mon courrier ». A ces mots, le bal, tout prêt à commencer, fut suspendu. Tous ceux qui devaient danser faisaient un cercle autour du chevalier de Gramont ; il poursuivit ainsi son récit :
« Il y a deux jours que ce coquin devrait être ici, suivant mes ordres et ses serments. On peut juger de mon impatience tout aujourd’hui, voyant qu’il n’arrivait pas. Enfin, après l’avoir bien maudit871, il n’y a qu’une heure qu’il est arrivé, crotté depuis la tête jusqu’aux pieds, botté jusqu’à la ceinture, fait enfin comme un excommunié. « Hé bien ! monsieur le faquin872, lui dis-je, voilà de vos façons de faire ! vous vous faites attendre jusqu’à l’extrémité ; encore est-ce un miracle que vous soyez arrivé. — Oui, mor873..., dit-il, c’est un miracle. Vous êtes toujours à gronder. Je vous ai fait faire le plus bel habit du monde, que M. le duc de Guise874 lui-même a pris la peine de commander. — Donne-le donc, bourreau ! lui dis-je — Monsieur, dit-il, si je n’ai mis douze brodeurs après, qui n’ont fait que travailler jour et nuit, tenez-moi pour un infâme. Je ne les ai pas quittés d’un moment. — Et où est-il, traître, qui ne fais que raisonner dans le temps que je devrais être habillé ? — Je l’avais, dit-il, empaqueté, serré, ployé, que875 toute la pluie du monde n’en eût point approché. Me voilà à courir jour et nuit, connaissant votre impatience et qu’il ne faut pas lanterner avec vous. — Mais où est-il, m’écriai-je, cet habit si bien empaqueté ? — Péri876, monsieur, me dit-il en joignant les mains. — Comment, péri ! lui dis-je en sursaut.
— Oui ; péri, perdu, abîmé : que vous dirai-je de plus ?
— Quoi ! le paquebot a fait naufrage ? lui dis-je. — Oh ! vraiment, c’est bien pis, comme vous allez voir, me ré-pondit-il. J’étais à une demi-lieue de Calais, hier au matin, et voulus prendre le long de la mer pour faire plus de diligence : mais ma foi, l’on dit bien vrai qu’il n’est rien tel que le grand chemin : car je donnai tout au travers d’un sable mouvant877, où j’enfonçai jusqu’au menton. — Un sable mouvant auprès de Calais ! lui dis-je. — Oui, monsieur, me dit-il ; et si bien sable mouvant, que je me donne au diable si on me voyait autre chose que le haut de la tête quand on m’en a tiré. Pour mon cheval, il a fallu plus de quinze hommes pour l’en sortir ; mais, pour mon portemanteau, où malheureusement j’avais mis votre habit, jamais on ne l’a pu trouver ; il faut qu’il soit pour le moins une lieue sous terre. »
« Voilà, sire, poursuivit le chevalier de Gramont, l’aventure et le récit que m’en a fait cet honnête homme. »
Le maître de la poste d’Abbeville878 était une ancienne connaissance du chevalier de Gramont. Son hôtellerie était la mieux fournie qu’il y eût entre Calais et Paris ; et le chevalier de Gramont, en mettant pied à terre, dit à Termes qu’il avait envie d’y boire un coup en attendant que leurs chevaux fussent prêts. Il était près de midi. Depuis la nuit précédente qu’879 ils étaient débarqués, jusqu’à ce moment, ils n’avaient pas mangé. Termes, louant le Seigneur de ce que des sentiments humains l’emportaient cette fois sur l’inhumanité de son impatience880 ordinaire, le confirma tant qu’il put dans des sentiments si raisonnables.
Ils furent surpris, en entrant dans la cuisine, où le chevalier rendait volontiers sa première visite, de voir six broches chargées de gibier devant le feu, et l’appareil d’un festin magnifique par toute la cuisine. Le cœur de Termes en tressaillit. Il donna sous main ordre de déferrer quelques-uns des chevaux pour n’être pas arraché de ce lieu sans y repaître881.
Bientôt une foule de violons et de hautbois, suivie des galopins de la ville, entra dans la cour. L’hôte, à qui l’on demandait raison de tant de préparatifs, dit à M. le chevalier de Gramont que c’était pour la noce d’un gentilhomme des plus riches des environs avec la plus belle fille de toute la province ; que le repas se faisait chez lui ; qu’il ne tiendrait qu’à Sa Grandeur882 de voir bientôt arriver les mariés de la paroisse, puisque la musique était déjà venue. Il en jugea bien ; car, à peine achevait-il de parler, que trois grands corbillards883 comblés de laquais grands comme des Suisses884 et chamarrés de livrées tranchantes885, parurent dans la cour, et débarquèrent toute la noce. Jamais on n’a vu la magnificence campagnarde si naturellement étalée. Le clinquant rouillé, les passements ternis, le taffetas rayé brillaient partout.
Si le premier coup d’œil du spectacle surprit le chevalier de Gramont, le second n’étonna pas moins le fidèle Termes...
Le nouvel époux était aussi ridiculement paré que les autres, à la réserve d’un justaucorps886 de la plus grande magnificence et du meilleur goût du monde. Le chevalier de Gramont, en s’approchant de lui pour examiner de près son habit, se mit à louer la broderie de son justaucorps. Le marié tint cet examen à grand honneur, et lui dit qu’il avait acheté ce justaucorps cent cinquante louis887. « Vous ne l’avez donc pas fait faire ici ? » lui dit le chevalier de Gramont. « Bon ! lui répondit l’autre ; je l’ai d’un marchand de Londres, qui l’avait commandé pour un milord888 d’Angleterre. » Le chevalier de Gramont, qui sentait le dénouement de l’aventure, lui demanda s’il reconnaîtrait bien le marchand, « Si je le reconnaîtrais ? Ne fus-je pas obligé de boire avec lui toute la nuit à Calais pour en avoir bon marché ! » Termes s’était absenté dès que ce justaucorps avait paru, sans pourtant s’imaginer que le maudit marié dût en entretenir son maître.
L’envie de rire et l’envie de faire pendre le seigneur Termes partagèrent quelque temps les sentiments du chevalier de Gramont ; mais l’habitude de se laisser voler par ses domestiques, jointe à la vigilance du coupable, à qui son maître ne pouvait reprocher d’avoir dormi dans son service, le portèrent à la clémence ; et, cédant aux importunités du campagnard, pour confondre son fidèle écuyer, il se mit à table, lui trente-septième.
Quelques moments après, il dit aux gens de la maison de faire monter un gentilhomme nommé Termes. Il vint : et, dès que le maître de la fête le vit, il se leva de table, et lui tendant la main : « Touchez là, notre ami, lui dit-il : vous voyez que j’ai bien conservé le justaucorps que vous aviez tant de peine à me vendre, et que je n’en fais pas un mauvais usage. »
Termes, s’étant fait un front d’airain, fit semblant de ne le pas connaître, et se mit à le repousser assez brutalement. « Oh, parbleu ! lui dit l’autre, puisqu’il m’a fallu boire avec vous pour conclure le marché, vous me ferez raison de la santé889 de madame la mariée. » Le chevalier de Gramont, qui le vit tout déconcerté, malgré son effronterie, lui dit en le regardant civilement : « Allons, monsieur le marchand de Londres, mettez-vous là, puisqu’on vous en prie de si bonne grâce ; nous ne sommes pas tant à table qu’il n’y ait encore place pour un aussi honnête homme que vous ». A ces mots, trente-cinq des conviés890 se mirent en mouvement pour recevoir ce nouveau convié..., et l’audacieux Termes, ayant bu la première honte de cet événement, s’y prenait d’une manière à boire tout le vin de la noce, si son maître ne se fût levé de table comme on ôtait vingt-quatre potages pour servir autant d’entrées.
Il n’y avait pas d’apparence de retenir jusqu’à la fin d’un repas de noce un homme qui paraissait si pressé : mais tout fut debout quand il sortit de table, et tout ce qu’il put obtenir du marié fut que toute la noce ne le reconduirait pas jusqu’à la porte de l’hôtellerie. Termes eût voulu qu’ils ne l’eussent point quitté jusqu’à la fin du voyage, tant il craignait de se trouver tête à tête avec son maître.
Il y avait déjà quelque temps qu’ils étaient sortis d’Abbeville, et qu’ils couraient dans un profond silence. Termes, qui s’attendait bien à le voir rompre dans peu de temps, n’était en peine que de la manière : savoir891 si son maître l’attaquerait par un torrent d’injures mêlées de certaines épithètes qui pouvaient lui convenir ; ou si, se servant de quelque outrageante ironie, l’on emploierait toutes les louanges qui seraient les plus capables de le confondre. Mais voyant, au lieu de tout cela, qu’on s’obstinait à ne lui rien dire, il crut qu’il valait mieux prévenir la harangue qu’on méditait que d’y laisser rêver plus longtemps ; et, s’armant de toute son effronterie : « Vous voilà bien en colère, monsieur, lui dit-il, et vous croyez avoir raison. Mais je me donne au diable si vous n’avez pas tort dans le fond. — Comment, traître, dans le fond ! dit le chevalier de Gramont ; c’est donc parce que je ne te fais pas rouer comme tu l’as depuis longtemps mérité ? — Voilà-t-il pas892 ! dit Termes. Toujours de l’emportement, au lieu d’entendre raison ! Oui, monsieur, je vous soutiens que ce que j’en ai fait était pour votre bien. — Et le sable mouvant893 n’était-il pas pour mon service ? dit le chevalier de Gramont. — Patience, s’il vous plaît, poursuivit l’autre. Je ne sais comment diable894 ce nigaud895 de marié s’est rencontré chez les gens de la douane quand on visita ma valise à Calais ; mais… dès qu’il vit votre justaucorps, il en devint amoureux. Je vis bien dès là que c’était un sot ; car il était à deux genoux devant moi pour l’acheter. Outre qu’il était tout froissé de la valise896, la sueur du cheval l’avait tout taché par devant, et je ne sais comment diable il a fait pour raccommoder tout cela ; mais tenez-moi pour un excommunié, si vous l’eussiez jamais voulu mettre. Conclusion : il vous revenait à cent quarante louis ; et, voyant qu’on m’en offrait cent cinquante : mon maître, dis-je, n’a pas besoin de cette oriflamme897 pour se distinguer au bal, et, quoiqu’il eût beaucoup d’argent quand je l’ai quitté, que sais-je s’il en aura quand je le reverrai ? Cela dépend du jeu898. Bref, monsieur, je vous en fais donner dix louis de plus qu’il ne vous coûte ; c’est un profit tout clair. Je vous en tiendrai compte899, et vous savez que je suis bon900 pour cette somme. Dites à présent, en auriez-vous eu la jambe mieux faite au bal, d’être paré de ce diable de justaucorps qui vous aurait donné la même mine qu’à ce marié de village à qui nous l’avons vendu ? Et cependant il faut voir comme vous tempêtiez à Londres quand vous l’avez cru perdu ; les beaux contes que vous avez faits au roi du sable mouvant, et qu’elle chienne de mine901 vous avez faite quand vous vous êtes douté que ce pied-plat902 le portait à sa noce ! »
Que répondre à tant d’impudence ? S’il écoutait l’indignation, le rouer de coups ou le chasser était le traitement le plus favorable que son maître lui devait ; mais il en avait besoin pour le reste de son voyage.
(Mémoires du chevalier de Gramont, chap. VII et XIII.)
Fénelon
(1651-1715) §
Né au château de Fénelon, dans le Périgord, en 1651, mort archevêque de Cambrai en 1715, François de Salignac de la Mothe-Fénelon, qui, parmi ses premiers ouvrages, avait composé un important Traité de l’Education des filles, fut nommé en 1689 précepteur du duc de Bourgogne, fils du grand Dauphin903, et écrivit pour lui ses Fables, ses Dialogues des morts et probablement son Télémaque, où se trouvent bien des critiques indirectes du gouvernement de Louis XIV. La publication de ce dernier ouvrage, faite sans l’aveu de Fénelon (1699), acheva de lui aliéner l’esprit du roi ; car celui-ci l’avait déjà, en 1697, relégué dans son diocèse, lors de la lutte que Fénelon soutint contre Bossuet pour la défense du quiétisme, doctrine religieuse qui fut condamnée par le pape en 1699. Dans les dernières années de sa vie, Fénelon écrivit, outre quelques opuscules politiques, le Traité de l’Existence et des attributs de Dieu, et la Lettre à l’Académie ou Lettre sur les occupations de l’Académie française, et l’on publia encore, après sa mort, ses Dialogues sur l’éloquence, qu’il doit avoir écrits dans la première partie de sa carrière littéraire.
Les enfants indolents §
Il faut avouer que, de toutes les peines de l’éducation, aucune n’est comparable à celle d’élever des enfants qui manquent de sensibilité904. Les naturels vifs et sensibles sont capables de terribles égarements : les passions et la présomption les entraînent ; mais aussi ils ont de grandes ressources905 et reviennent souvent de loin ; l’instruction est en eux un germe caché qui pousse et qui fructifie quelquefois, quand l’expérience vient au secours de la raison et que les passions s’attiédissent ; au moins on sait par où on peut les rendre attentifs et réveiller leur curiosité ; on a en eux de quoi les intéresser à ce qu’on leur enseigne et les piquer d’honneur, au lieu qu’on n’a aucune prise sur les naturels indolents. Toutes les pensées de ceux-ci sont des distractions ; ils ne sont jamais où ils doivent être ; on ne peut même les toucher jusqu’au vif par les corrections : ils écoutent tout et ne sentent rien. Cette indolence rend l’enfant négligent et dégoûté de tout ce qu’il fait. C’est alors que la meilleure éducation court risque d’échouer si on ne se hâte d’aller au-devant du mal dès la première enfance.
Beaucoup de gens qui n’approfondissent guère concluent de ce mauvais succès906 que c’est la nature qui fait tout pour former des hommes de mérite et que l’éducation n’y peut rien ; au lieu qu’il faudrait seulement conclure qu’il y a des naturels semblables aux terres ingrates, sur qui la culture fait peu.
C’est encore bien pis quand ces éducations si difficiles sont traversées ou négligées, ou mal réglées dans leurs commencements.
Il faut encore observer qu’il y a des naturels d’enfants auxquels on se trompe beaucoup. Ils paraissent d’abord jolis, parce que les premières grâces de l’enfance ont un lustre qui couvre tout ; on y voit je ne sais quoi de tendre et d’aimable, qui empêche d’examiner de près le détail des traits du visage. Tout ce qu’on trouve d’esprit en eux surprend, parce qu’on n’en attend point de cet âge ; toutes les fautes de jugement leur sont permises et ont la grâce de l’ingénuité ; on prend une certaine vivacité du corps, qui ne manque jamais de paraître, dans les enfants, pour celle de l’esprit. De là vient que l’enfance semble promettre tant et qu’elle donne si peu. Tel a été célèbre par son esprit à l’âge de cinq ans, qui est tombé dans l’obscurité et dans le mépris à mesure qu’on l’a vu croître....
Tâchez donc de découvrir, au travers des grâces de l’enfance, si le naturel que vous avez à gouverner manque de curiosité et s’il est peu sensible à une honnête émulation. En ce cas, il est difficile que toutes les personnes chargées de son éducation ne se rebutent bientôt dans un travail si ingrat et si épineux. Il faut donc remuer promptement tous les ressorts de l’âme de l’enfant pour le tirer de cet assoupissement. Si vous prévoyez cet inconvénient, ne pressez pas d’abord les instructions suivies ; gardez-vous bien de charger sa mémoire, car c’est ce qui étonne907 et qui appesantit le cerveau ; ne le fatiguez point par des règles gênantes ; égayez-le ; puisqu’il tombe, dans l’extrémité contraire, à la présomption, ne craignez point de lui montrer avec discrétion de quoi il est capable ; contentez-vous de peu ; faites-lui remarquer ses moindres succès908; représentez-lui combien mal à propos il a craint de ne pouvoir réussir dans des choses qu’il fait bien ; mettez en œuvre l’émulation… Faites-lui voir des gens timides comme lui, qui surmontent enfin leur tempérament ; apprenez-lui par des instructions indirectes, à l’occasion d’autrui, que la timidité et la paresse étouffent l’esprit ; que les gens mous et inappliqués, quelque génie909 qu’ils aient, se rendent imbéciles et se dégradent eux-mêmes. Mais gardez-vous bien de lui donner ces instructions d’un ton austère et impatient ; car rien ne renfonce tant au dedans de lui-même un enfant mou et timide que la rudesse. Au contraire, redoublez vos soins pour assaisonner de facilités et de plaisirs proportionnés à son naturel le travail que vous ne pouvez lui épargner. Enfin il faut tâcher de donner du goût910 à l’esprit de ces sortes d’enfants, comme on tâche d’en donner au corps de certains malades. On leur laisse chercher ce qui peut guérir leur goût ; on leur souffre quelques fantaisies aux dépens mêmes des règles, pourvu qu’elles n’aillent pas à des excès dangereux. Il est bien plus difficile de donner du goût à ceux qui n’en ont pas que de former le goût de ceux qui ne l’ont pas tel qu’il doit être.
(De l’Éducation des filles, chap. v.)
Le jeune Bacchus et le faune §
Un jour le jeune Bacchus911, que Silène912 instruisait, cherchait les Muses913 dans un bocage dont le silence n’était troublé que par le bruit des fontaines et par le chant des oiseaux. Le soleil n’en pouvait, avec ses rayons, percer la sombre verdure. L’enfant de Sémélé, pour étudier la langue des dieux914, s’assit dans un coin au pied d’un vieux chêne, du tronc duquel plusieurs hommes de l’âge d’or915 étaient nés. Il avait même autrefois rendu des oracles916, et le temps n’avait osé l’abattre de sa tranchante faux. Auprès de ce chêne sacré et antique se cachait un jeune faune917, qui prêtait l’oreille aux vers que chantait l’enfant, et qui marquait à Silène, par un ris moqueur, toutes les fautes que faisait son disciple. Aussitôt les naïades et les autres nymphes du bois918 souriaient aussi. Ce critique était jeune, gracieux et folâtre ; sa tête était couronnée de lierre et de pampre ; ses tempes étaient ornées de grappes de raisin ; de son épaule gauche, pendait à son côté droit, en écharpe, un feston de lierre ; et le jeune Bacchus se plaisait à voir ces feuilles consacrées à sa divinité919. Le faune était enveloppé au-dessous de la ceinture par la dépouille affreuse et hérissée d’une jeune lionne qu’il avait tuée dans les forêts. Il tenait dans sa main une houlette920 courbée et noueuse. Sa queue paraissait derrière comme se jouant sur son dos. Mais comme Bacchus ne pouvait souffrir un rieur malin, toujours prêt à se moquer de ses expressions, si elles n’étaient pures et élégantes, il lui dit d’un ton fier et impatient : « Comment oses-tu te moquer du fils de Jupiter ? » Le faune répondit sans s’émouvoir : « Hé ! comment le fils de Jupiter ose-t-il faire quelque faute921 ? »
(Fables, XXL)
Le singe §
Un vieux singe malin étant mort, son ombre descendit dans la sombre demeure de Pluton922, où elle demanda à retourner parmi les vivants. Pluton voulait la renvoyer dans le corps d’un âne pesant et stupide, pour lui ôter sa souplesse, sa vivacité et sa malice ; mais elle fit tant de tours plaisants et badins, que l’inflexible roi des Enfers ne put s’empêcher de rire, et lui laissa le choix d’une condition. Elle demanda à entrer dans le corps d’un perroquet. « Au moins, disait-elle, je conserverai par là quelque ressemblance avec les hommes, que j’ai si longtemps imités. Étant singe, je faisais des gestes comme eux ; et étant perroquet, je parlerai avec eux dans les plus agréables conversations. » À peine l’âme du singe fut introduite dans ce nouveau métier, qu’une vieille femme causeuse l’acheta. Il fit ses délices ; elle le mit dans une belle cage. Il faisait bonne chère923, et discourait toute la journée avec la vieille radoteuse, qui ne parlait pas plus sensément que lui, Il joignait à son nouveau talent d’étourdir tout le monde je ne sais quoi de son ancienne profession : il remuait sa tête ridiculement924 ; il faisait craquer son bec ; il agitait ses ailes de cent façons, et faisait de ses pattes plusieurs tours qui sentaient encore les grimaces de Fagotin925. La vieille prenait à toute heure ses lunettes pour l’admirer. Elle était bien fâchée d’être un peu sourde, et de perdre quelquefois des paroles de son perroquet, à qui elle trouvait plus d’esprit qu’à personne. Le perroquet gâté devint bavard, importun et fou. Il se tourmenta si fort dans sa cage, et but tant de vin avec la vieille, qu’il en mourut. Le voilà revenu devant Pluton, qui voulut cette fois le faire passer dans le corps d’un poisson, pour le rendre muet ; mais il fit encore une farce devant le roi des ombres, et les princes ne résistent guère aux demandes des mauvais plaisants qui les flattent926. Pluton accorda donc à celui-ci qu’il irait dans le corps d’un homme. Mais, comme le dieu eut honte de l’envoyer dans le corps d’un homme sage et vertueux, il le destina au corps d’un harangueur ennuyeux et importun, qui mentait, qui se vantait sans cesse, qui faisait des gestes ridicules, qui se moquait de tout le monde, qui interrompait toutes les conversations les plus polies et les plus solides, pour des riens ou les sottises les plus grossières. Mercure927, qui le reconnut dans ce nouvel état, lui dit en riant : « Ho ! ho ! je te reconnais ; tu n’es qu’un composé du singe et du perroquet que j’ai vus autrefois. Qui t’ôterait tes gestes et tes paroles apprises par cœur sans jugement, ne laisserait rien de toi. D’un joli singe et d’un bon perroquet on n’en928 fait qu’un sot homme. »
O combien d’hommes dans le monde, avec des gestes façonnés, un caquet et un air capable, n’ont ni sens ni conduite !
(Id. XVIII.)
Louis XI et Philippe de Commines §
Louis. — On dit que vous avez écrit mon histoire.
Commines. — Il est vrai, sire ; et j’ai parlé en bon domestique929.
Louis. — Mais on assure que vous avez raconté bien des choses dont je me passerais volontiers.
Commines. — Cela peut-être ; mais en gros j’ai fait de vous un portrait fort avantageux. Voudriez-vous que j’eusse été un flatteur perpétuel, au lieu d’être un historien ?
Louis. — Vous deviez parler de moi comme un sujet comblé des grâces de son maître.
Commines. — C’eût été le moyen de n’être cru de personne. La reconnaissance n’est pas ce qu’on cherche dans un historien : au contraire, c’est ce qui le rend suspect.
Louis. — Pourquoi faut-il qu’il y ait des gens qui aient la démangeaison d’écrire ? Il faut laisser les morts en paix et ne flétrir point leur mémoire.
Commines. — La vôtre était étrangement noircie ; j’ai tâché d’adoucir les impressions déjà faites ; j’ai relevé930 toutes vos bonnes qualités ; je vous ai déchargé de toutes les choses odieuses, qu’on vous imputait sans preuves décisives. Que pouvais-je faire de mieux ?
Louis. — Ou vous taire, ou me défendre en tout. On dit que vous avez représenté toutes mes grimaces, toutes mes contorsions lorsque je parlais tout seul, toutes mes intrigues avec de petites gens. On dit que vous avez parlé du crédit de mon prévôt931, de mon médecin, de mon barbier et de mon tailleur : vous avez étalé mes vieux habits. On dit que vous n’avez pas oublié mes petites dévotions, surtout à la fin de mes jours ; mon empressement à ramasser des reliques ; à me faire frottes depuis la tête jusqu’aux pieds, de l’huile de sainte ampoule932, et à faire des pèlerinages où je prétendais toujours avoir été guéri. Vous avez fait mention de ma barrette933 chargée de petits saints et de ma petite Notre-Dame de plomb, que je baisais dès que je voulais faire un mauvais coup ; enfin de la croix de Saint-Lô934, par laquelle je n’osais jurer sans vouloir garder mon serment, parce que j’aurais cru mourir dans l’année, j’y avais manqué. Tout cela est fort ridicule.
Commines. — Tout cela n’est-il pas vrai ? pouvais-je le taire ?
Louis. — Vous pouviez n’en rien dire.
Commines. — Vous pouviez n’en rien faire.
Louis. — Mais cela était fait, et il ne fallait pas le dire.
Commines. Mais cela était fait et je ne pouvais le cacher à la postérité.
Louis. — Quoi ! ne peut-on pas cacher certaines choses ?
Commines. — Hé ! croyez-vous qu’un roi puisse être caché après sa mort comme vous cachiez certaines intrigues pendant votre vie ? Je n’aurais rien sauvé pour vous par mon silence, et je me serais déshonoré. Contentez-vous que je pouvais935 dire bien pis et être cru ; mais je ne l’ai pas voulu faire.936
Louis. — Quoi ! l’histoire ne doit-elle pas respecter les rois ?
Commines. — Les rois ne doivent-ils pas respecter l’histoire et la postérité, à la censure de laquelle ils ne peuvent échapper ? Ceux qui veules qu’on ne parle pas mal d’eux n’ont qu’une seule ressource, qui est de bien faire.
(Dialogues des morts, lix.)
Fontenelle
(1657-1757) §
Né à Rouen en 1657, mort en 1757, Bernard Le Bovier de Fontenelle, qui était neveu de Corneille, débuta par d’assez fades productions en vers et en prose. Il réussit mieux quand il tenta de faire connaître au public les lois de l’astronomie et les découvertes des savants dans ses Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), et surtout dans les Eloges des académiciens, qu’il composa comme secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, et qui sont un modèle tout ensemble de finesse, d’aisance et de clarté. Recherché dans les sociétés les plus délicates du temps pour l’agrément de sa conversation, Fontenelle passa à juste titre pour un homme d’un esprit brillant, mais d’un cœur sec et dénué de toute passion généreuse.
La dent d’or §
Assurons-nous bleu du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Il est Vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point.
Ce malheur arriva si plaisamment, sur la fin du siècle passé, à quelques savants d’Allemagne, que je ne puis m’empêcher d’en parler ici.
En 1593, le bruit courut que, les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de sept ans, il lui en était venu une d’or à la place d’une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l’Université de Helmstad937, écrivit en 1595 l’histoire de cette dent, et prétendit quelle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux Turcs938 ! En la même année, afin que cette dent d’or ne manquât pas d’historiens, Rullandus939 en écrit encore l’histoire. Deux ans après, Ingolsteterus940, autre savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d’or, et Rullandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius941, ramasse tout ce qui avait été dit de la tient et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu’il fût vrai que la dent était d’or. Quand un orfèvre l’eut examinée, il se trouva que c’était une feuille d’or appliquée à la dent avec beaucoup d’adresse ; mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre.
Rien n’est plus naturel que d’en faire autant sur toutes sortes de matières… De grands physiciens ont fort bien trouvé pourquoi les lieux souterrains sont chauds en hiver et froids en été. De plus grands physiciens ont trouvé depuis peu que cela n’était pas.
Les discussions historiques sont encore plus susceptibles de cette sorte d’erreur. On raisonne sur ce qu’ont dit les historiens ; mais ces historiens n’ont-ils été ni passionnés, ni crédules, ni mal instruits, ni négligents ? Il en faudrait trouver un qui eût été spectateur de toutes choses, indifférent et appliqué.
(Histoire des oracles, Ire dissertation, chap. iv.)
Caractère de Newton942 §
Il était né fort doux et avec un grand amour pour la tranquillité. Il aurait mieux aimé être inconnu que de voir le calme de sa vie troublé par ces orages littéraires, que l’esprit et la science attirent à ceux qui s’élèvent trop. On voit, par une de ses lettres, que son Traité d’optique étant prêt à imprimer943, des objections prématurées qui s’élevèrent lui firent abandonner alors ce dessein. « Je me reprochais, dit-il, mon imprudence de perdre une chose aussi réelle que le repos, pour courir après une ombre944. » Mais cette ombre nie lui a pas échappé dans la suite, il ne lui en a pas coûte son repos qu’il estimait tant, et elle a eu pour lui autant de réalité que ce repos même.
Un caractère doux promet naturellement de la modestie, et on atteste que la sienne s’est toujours conservée sans altération, quoique tout le monde fût conjuré contre elle945. Il ne parlait jamais ou de lui ou des autres ; il n’agissait jamais d’une manière à faire soupçonner aux observateurs les plus malins946 le moindre sentiment de vanité. Il est vrai qu’on lui épargnait assez le soin de se faire valoir947 ; mais combien d’autres n’auraient pas laissé de prendre948 encore un soin dont on se charge si volontiers, et dont il est si difficile de se reposer sur personne ? combien de grands hommes généralement applaudis ont gâté le concert de leurs louanges en y mêlant leurs voix !
Il était simple, affable, toujours de niveau avec tout le monde. Les génies de premier ordre ne méprisent point ce qui est au-dessous d’eux, tandis que les autres méprisent même ce qui est au-dessus. Il ne se croyait dispensé ni par son mérite, ni par sa réputation, d’aucun des devoirs du commerce ordinaire de la vie ; nulle singularité, ni naturelle, ni affectée ; il savait n’être, dès qu’il le fallait, qu’un homme du commun.
Quoiqu’il fût attaché à l’église anglicane, il n’eût pas persécuté les non-conformistes949 pour les y ramener. Il jugeait les hommes par les mœurs, et les vrais non-conformistes étaient pour lui les vicieux et les méchants. Ce n’est pas cependant qu’il s’en tint à la religion naturelle950 : il était persuadé de la révélation, et, parmi les livres de toute espèce qu’il avait sans cesse entre les mains, celui qu’il lisait le plus assidûment était la Bible.
L’abondance951 où il se trouvait, et par952 un grand patrimoine et par son emploi953, augmentée encore par la sage simplicité de sa vie, ne lui offrait pas inutilement les moyens de faire du bien. Il ne croyait pas que donner par son testament, ce fût donner ; aussi n’a-t-il point laissé de testament, et il s’est dépouillé toutes les fois qu’il a fait fies libéralités ou à ses parents, ou à ceux qu’il savait dans quelque besoin. Les bonnes actions qu’il a faites dans l’une et l’autre espèce n’ont été ni rares, ni peu considérables. Quand la bienséance exigeait de lui, en certaines occasions, de la dépense et de l’appareil, il était magnifique954 sans aucun regret, et de très bonne grâce. Hors de là, tout ce faste, qui ne paraît quelque chose de grand qu’aux petits caractères, était sévèrement retranché, et les fonds réservés à des usages plus solides. Ce serait effectivement un prodige qu’un esprit accoutumé aux réflexions, nourri de raisonnements, et en même temps amoureux de cette vaine magnificence.
(Eloge des académiciens de l’Académie royale des sciences, morts depuis l’an 1699 : Éloge de M. Newton.)
Caractère de Leibnitz955 §
Il était d’une forte complexion. Il n’avait guère eu de maladies, excepté quelques vertiges dont il était quelquefois incommodé, et la goutte. Il mangeait beaucoup et buvait peu, quand on ne le forçait pas, et jamais de vin sans eau. Chez lui il était absolument le maître, car il y mangeait toujours seul956. Il ne réglait pas ses repas à de certaines heures, mais selon ses études ; il n’avait point de ménage, et envoyait quérir chez un traiteur la première chose trouvée. Depuis qu’il avait la goutte, il ne dînait que d’un peu de lait, mais il faisait un grand souper, sur lequel il se couchait à une heure ou deux après minuit. Souvent il ne dormait qu’assis sur une chaise, et ne s’en réveillait pas moins frais à sept ou huit heures du matin. Il étudiait de suite957, et il a été des mois entiers sans quitter le siège, pratique fort propre à avancer beaucoup un travail, mais fort malsaine. Aussi croit-on qu’elle lui attira une fluxion sur la jambe droite, avec un ulcère ouvert. Il y voulut remédier à sa manière, car il consultait peu les médecins, et il vint à ne pouvoir presque plus marcher ni quitter le lit.
Il faisait des extraits de tout ce qu’il lisait, et y ajoutait ses réflexions ; après quoi il mettait tout cela à part, et ne le regardait plus. Sa mémoire, qui était admirable, ne se déchargeait point, comme à l’ordinaire, des choses qui étaient écrites ; mais seulement l’écriture avait été nécessaire pour les y graver à jamais. Il était toujours prêt à répondre sur toutes sortes de matières, et le roi d’Angleterre958 l’appelait son Dictionnaire vivant.
Il s’entretenait volontiers avec toutes sortes de personnes, gens de cour, artisans, laboureurs, soldats. Il n’y a guère d’ignorant qui ne puisse apprendre quelque chose au plus savant homme du monde ; et en tout cas le savant s’instruit encore quand il sait bien considérer l’ignorant. Il s’entretenait même souvent avec les dames, et ne comptait point pour perdu le temps qu’il donnait à leur conversation. Il se dépouilla parfaitement avec elles du caractère de savant et de philosophe, caractères cependant presque indélébiles, et dont elles aperçoivent bien finement et avec bien du dégoût les traces les plus légères. Cette facilité de se communiquer le faisait aimer de tout le monde ; un savant illustre qui est populaire et familier, c’est presque un prince qui le serait aussi ; le prince a pourtant beaucoup d’avantage959.
M. Leibnitz avait un commerce960 de lettres prodigieux. Il se plaisait à entrer dans les travaux ou dans les projets de tous les savants de l’Europe ; il leur fournissait des vues ; il les animait, et certainement il prêchait d’exemple. On était sûr d’une réponse dès qu’on lui écrivait, ne se fût-on proposé que l’honneur de lui écrire. Il est impossible que ses lettres ne lui aient emporté un temps très considérable : mais il aimait autant l’employer au profit ou à la gloire d’autrui qu’à son profit ou à sa gloire particulière.
Il était toujours d’une humeur gaie ; et à quoi servirait sans cela d’être philosophe ? On l’a vu fort affligé à la mort du feu roi de Prusse et de l’électrice Sophie961. La douleur d’un tel homme est la plus belle oraison funèbre.
Il se mettait aisément en colère, mais il en revenait aussitôt. Ses premiers mouvements n’étaient pas d’aimer la contradiction sur quoi que ce fût, mais il ne fallait qu’attendre les seconds ; et en effet, ces seconds mouvements, qui sont les seuls dont il reste des marques, lui feront éternellement honneur....
On l’accuse d’avoir aimé l’argent. Il avait un revenu très considérable en pensions du duc de Wolfenbuttel962, du roi d’Angleterre, de l’empereur, du czar, et vivait toujours assez grossièrement. Mais un philosophe ne peut guère, quoiqu’il devienne riche, se tourner à des dépenses inutiles et fastueuses, qu’il méprise. De plus M. Leibnitz laissait aller le détail de sa maison comme il plaisait à ses domestiques, et il dépensait beaucoup en négligence. Cependant la recette était toujours la plus forte, et on lui trouva après sa mort une grosse somme d’argent comptant qu’il avait cachée. C’étaient deux années de son revenu. Ce trésor lui avait causé pendant sa vie de grandes inquiétudes, qu’il avait confiées à un ami ; mais il fut encore plus funeste à la femme de son seul héritier, fils de sa sœur, qui était curé963 d’une paroisse près de Leipsick. Cette femme, en voyant tant d’argent ensemble qui lui appartenait, fut si saisie de joie qu’elle en mourut subitement.
(Éloge de M. Leibnitz.)
Varignon964 et l’abbé de Saint-Pierre §
Un goût commun pour les choses de raisonnement, soit physiques, soit métaphysiques, et des disputes continuelles furent le lien de leur amitié965. Ils avaient besoin l’un de l’autre pour approfondir et pour s’assurer que tout était vu dans un sujet. Leurs caractères différents faisaient un assortiment complet et heureux : l’un966 par une certaine vigueur d’idées, par une vivacité féconde, par une fougue de raison ; l’autre par une analyse subtile, par une précision scrupuleuse, par une sage et ingénieuse lenteur à discuter tout.
M. l’abbé de Saint-Pierre, pour jouir plus à son aise de M. Varignon, le logea avec lui967, et enfin, toujours plus touché de son mérite, il résolut, de lui faire une fortune qui le mît en état de suivre pleinement ses talents et son génie. Cependant cet abbé, cadet de Normandie, n’avait que mille huit cents livres de rente ; il en détacha trois cents qu’il donna par contrat à M. Varignon. Ce peu, qui était beaucoup par rapport au bien du donateur, était beaucoup aussi par rapport aux besoins et aux désirs du donataire. L’un se trouva riche, et l’autre encore plus d’avoir enrichi son ami.
L’abbé, persuadé qu’il n’y avait point de meilleur séjour que Paris pour des philosophes raisonnables, vint, en 1686, s’y établir avec M. Varignon dans une petite maison du faubourg Saint-Jacques. Là ils pensaient chacun de son côté, car ils n’étaient plus tant en communauté de pensées : l’abbé, revenu des subtilités inutiles et fatigantes968, s’était tourné principalement du côté des réflexions sur l’homme, sur les mœurs, et sur les principes du gouvernement. M. Varignon s’était totalement enfoncé dans les mathématiques. J’étais leur compatriote969, et allais les voir assez souvent, et quelquefois passer deux ou trois jours avec eux ; il y avait encore de la place pour un survenant, et même pour un second, sorti de la même province, aujourd’hui l’un des principaux membres de l’Académie des belles-lettres, et fameux par les histoires qui ont paru de lui970. Nous nous rassemblions avec un extrême plaisir, jeunes, pleins de la première ardeur de savoir, fort unis et, ce que nous ne comptions peut-être pas alors pour un assez grand bien, peu connus.
(Éloge de M. Varignon.)
Massillon
(1663-1742) §
Né à Hyères, mort évêque de Clermont, l’oratorien Massillon a joui, comme prédicateur, de la plus grande réputation. Bien inférieur cependant à Bossuet et même à Bourdaloue, il est du moins remarquable par l’abondance — excessive, serait-on quelquefois tenté de dire — de sa dialectique, et l’élégance soutenue de son style. On cite particulièrement ceux de ses sermons qui composent le Petit Carême, prêché devant le jeune roi Louis XV, et parmi ses Oraisons funèbres, celle de Louis XIV.
La joie de faire le bien §
Qu’on est digne de mépris, dit saint Ambroise971, quand on peut faire des heureux et qu’on ne le veut pas !… Quel usage plus doux et plus Batteur, mes frères972, pourriez-vous faire de votre élévation et de votre opulence ? Vous attirer des hommages ? mais l’orgueil lui-même s’en lasse. Commander aux hommes et leur donner des lois ? mais ce sont là les soins de l’autorité, ce n’en est pas le plaisir. Voir autour de vous multiplier à l’infini vos serviteurs et vos esclaves ? mais ce sont des témoins qui vous embarrassent et vous gênent, plutôt qu’une pompe qui vous décore. Habiter des palais somptueux ? mais vous vous édifiez, dit Job973, des solitudes où les soucis et les noirs chagrins viennent bientôt habiter avec vous.
Y rassembler tous les plaisirs ? ils peuvent remplir ces vastes édifices, mais ils laisseront toujours votre cœur vide. Trouver tous les jours dans votre opulence de nouvelles ressources à vos caprices ? la variété des ressources tarit bientôt ; tout est bientôt épuisé : il faut revenir sur ses pas et recommencer sans cesse ce que l’ennui rend insipide et ce que l’oisiveté a rendu nécessaire. Employez tant qu’il vous plaira vos biens et votre autorité à tous les usages que l’orgueil et les plaisirs peuvent inventer : vous serez rassasiés, mais vous ne serez pas satisfaits ; ils vous montreront la joie, mais ils ne la laisseront pas dans votre cœur.
Employez-les à faire des heureux, à rendre la vie plus douce et plus supportable à des infortunés que l’excès de la misère a peut-être réduits mille fois à souhaiter, comme Job974, que le jour qui les vit naître eût été lui-même la nuit éternelle de leur tombeau ; vous sentirez alors le plaisir d’être nés grands ; vous goûterez la véritable douceur de votre état : c’est le seul privilège qui le rend digne d’envie. Toute cette vaine montre975 qui vous environne est pour les autres ; ce plaisir est pour vous seuls. Tout le reste a ses amertumes ; ce plaisir seul les adoucit toutes. La joie de faire du bien est tout autrement douce et touchante que la joie de le recevoir. Revenez-y encore, c’est un plaisir qui ne s’use point : plus on le goûte, plus on se rend digne de le goûter : on s’accoutume à sa prospérité propre, et on y devient insensible ; mais on sent toujours la joie d’être l’auteur de la prospérité d’autrui ; chaque bienfait porte avec lui ce tribut doux et secret dans notre âme ; le long usage, qui endurcit le cœur à tous les plaisirs, le rend ici tous les jours plus sensible.
(Petit Carême, 4e dimanche.)
Le Sage
(1668-1747) §
Alain-René Le Sage est né à Sarzeau976 en 1668 et mort à Boulogne-sur-Mer en 1747. Il obtint son premier succès en 1707 avec la petite comédie de Crispin rival de son maître, et donna la même année un roman, imité de l’espagnol, le Diable boiteux. Ses deux chefs-d’œuvre sont la comédie de Turcaret ou le Financier (1709) et l’Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1724-1735), le plus célèbre de nos romans de mœurs.
Le parasite977 §
Je978 demandai à souper dès que je fus dans l’hôtellerie. C’était un jour maigre : on m’accommoda des œufs. Lorsque l’omelette fut en état de m’être servie, je m’assis tout seul à une table. Je n’avais pas encore mangé le premier morceau, que l’hôte entra suivi de l’homme qui l’avait arrêté dans la rue. Ce cavalier portait une longue rapière979, et pouvait bien avoir trente ans. Il s’approcha de moi d’un air empressé. « Seigneur écolier, me dit-il, je viens d’apprendre que vous êtes le seigneur Gil Blas de Santillane980, l’ornement d’Oviédo981 et le flambeau de la philosophie. Est-il bien possible que vous soyez ce savantissime982, ce bel esprit dont la réputation est si grande en ce pays-ci ? Vous ne savez pas, continua-t-il en s’adressant à l’hôte et à l’hôtesse, vous ne savez pas ce que vous possédez : vous avez un trésor dans votre maison : vous voyez dans ce jeune gentilhomme la huitième merveille du monde983. » Puis, se tournant de mon côté et me jetant les bras au cou : « Excusez mes transports, ajouta-t-il : je ne suis point maître de la joie que votre présence me cause. »
Je ne pus lui répondre sur-le-champ, parce qu’il me tenait si serré que je n’avais pas la respiration libre ; et ce ne fut qu’après que j’eus la tête dégagée de l’embrassade, que je lui dis : « Seigneur cavalier, je ne croyais pas mon nom connu à Peñaflor984. — Comment, connu ! reprit-il sur le même ton ; nous tenons registre de tous les grands personnages qui sont à vingt lieues à la ronde. Vous passez ici pour un prodige ; et je ne doute pas que l’Espagne ne se trouve un jour aussi vaine de vous avoir produit que la Grèce d’avoir vu naître ses sages985. » Ces paroles furent suivies d’une nouvelle accolade, qu’il me fallut encore essuyer au hasard d’avoir le sort d’Antée986. Pour peu que j’eusse eu d’expérience, je n’aurais pas été la dupe de ses démonstrations ni de ses hyperboles987 ; j’aurais bien connu, à ces flatteries outrées, que c’était un de ces parasites que l’on trouve dans toutes les villes, et qui, dès qu’un étranger arrive, s’introduisent auprès de lui pour remplir leur ventre à ses dépens ; mais ma jeunesse et ma vanité m’en firent juger tout autrement. Mon admirateur me parut un fort honnête homme988, et je l’invitai à souper avec moi. « Ah ! très volontiers, s’écria-t-il : je sais trop bon gré à mon étoile989 de m’avoir fait rencontrer l’illustre Gil Blas de Santillane, pour ne pas jouir de ma bonne fortune le plus longtemps que je pourrai. Je n’ai pas grand appétit, poursuivit-il ; je vais me mettre à table pour vous tenir compagnie seulement, et je mangerai quelques morceaux par complaisance. »
En parlant ainsi, mon panégyriste990 s’assit vis-à-vis de moi. On lui apporta un couvert. Il se jeta d’abord sur l’omelette avec tant d’avidité, qu’il semblait n’avoir mangé de trois jours. A l’air complaisant dont il s’y prenait, je vis bien qu’elle serait bientôt expédiée. J’en ordonnai une seconde, qui fut faite si promptement, qu’on nous la servit comme nous achevions, ou plutôt comme il achevait de manger la première. Il y procédait pourtant d’une vitesse toujours égale991 et trouvait moyen, sans perdre un coup de dent, de me donner louanges sur louanges, ce qui me rendait fort content de ma petite personne. Il buvait aussi fort souvent : tantôt c’était à ma santé, et tantôt à celle de mon père et de ma mère, dont il ne pouvait assez vanter le bonheur d’avoir un fils tel que moi. En même temps, il versait du vin dans mon verre, et m’excitait à lui faire raison992. Je ne répondais point mal aux santés qu’il me portait ; ce qui, avec ses flatteries, me mit insensiblement de si belle humeur, que, voyant notre seconde omelette à moitié mangée, je demandai à l’hôte s’il n’avait pas de poisson à nous donner.
Le seigneur Corcuelo993, qui, selon toutes les apparences, s’entendait avec le parasite, me répondit : « J’ai une truite excellente ; mais elle coûtera cher à ceux qui la mangeront ; c’est un morceau trop friand pour vous. — Qu’appelez-vous trop friand994 ? dit alors mon flatteur d’un ton de voix élevé ; vous n’y pensez pas, mon ami : apprenez que vous n’avez rien de trop bon pour le seigneur Gil Blas de Santillane, qui mérite d’être traité comme un prince. »
Je fus bien aise qu’il eût relevé les dernières paroles de l’hôte, et il ne fit en cela que me prévenir. Je m’en sentais offensé, et je dis fièrement à Corcuelo : a Apportez-nous votre truite, et ne vous embarrassez pas du reste ». L’hôte, qui ne demandait pas mieux, se mit à l’apprêter, et ne tarda guère à nous la servir. A la vue de ce nouveau plat, je vis briller une grande joie dans les yeux du parasite, qui fit paraître une nouvelle complaisance, c’est-à-dire qu’il donna sur le poisson comme il avait donné sur les œufs. Il fut pourtant obligé de se rendre, de peur d’accident, car il en avait jusqu’à la gorge. Enfin, après avoir bu et mangé tout son soûl995, il voulut finir la comédie : « Seigneur Gil Blas, me dit-il en se levant de table, je suis trop content de la bonne chère996 que vous m’avez laite pour vous quitter sans vous donner un avis important dont vous me paraissez avoir besoin. Soyez désormais en garde contre les louanges. Défiez-vous des gens que vous ne connaîtrez point. Vous en pourrez rencontrer d’autres qui voudront, comme moi, se divertir de votre crédulité, et peut-être pousser les choses encore plus loin ; n’en soyez point la dupe, et ne vous croyez point, sur leur parole, la huitième merveille du monde. » En achevant ces mots, il me rit au nez et s’en alla.
Je fus aussi sensible à cette baie997 que je l’ai été dans la suite aux plus grandes disgrâces qui me sont arrivées. Je ne pouvais me consoler de m’être laissé tromper si grossièrement, ou, pour mieux dire, de sentir mon orgueil humilié. Eh quoi ! dis-je, le traître s’est donc joué de moi ? Il n’a tantôt abordé mon hôte que pour lui tirer les vers du nez, ou plutôt ils étaient d’intelligence tous deux. Ah ! pauvre Gil Blas, meurs de honte d’avoir donné à ces fripons un juste sujet de te tourner en ridicule. Ils vont composer de tout ceci une belle histoire qui pourra bien aller jusqu’à Oviédo, et qui t’y fera beaucoup d’honneur. Tes parents se repentiront sans doute d’avoir tant harangué un sot : loin de m’exhorter à ne tromper personne, ils devaient me recommander de ne me pas laisser duper. Agité de ces pensées mortifiantes, enflammé de dépit, je m’enfermai dans ma chambre et me mis au lit ; mais je ne pus dormir, et je n’avais pas encore fermé l’œil lorsque le muletier me vint avertir qu’il n’attendait plus que moi pour partir. Je me levai aussitôt ; et, pendant que je m’habillais, Corcuelo arriva avec un mémoire de la dépense, dans lequel la truite n’était pas oubliée ; et non seulement il m’en fallut passer par où il voulut, mais j’eus encore le chagrin, en lui livrant mon argent, de m’apercevoir que le bourreau se ressouvenait de mon aventure. Après avoir bien payé un souper dont j’avais fait si désagréablement la digestion, je me rendis chez le muletier avec ma valise en donnant à tous les diables le parasite, l’hôte et l’hôtellerie.
(Histoire de Gil Blas de Santillane, liv. I, chap. ii.)
Le client du Docteur Sangrado §
Je998 servis pendant trois mois le licencié999 Sédillo sans me plaindre des mauvaises nuits qu’il me faisait passer. Au bout de ce temps-là il tomba malade. La fièvre le prit ; et avec le mal qu’elle lui causait il sentit irriter1000 sa goutte. Pour la première fois de sa vie, qui avait été longue, il eut recours aux médecins. Il demanda le docteur Sangrado, que tout Valladolid1001 regardait comme un Hippocrate1002… J’allai donc chercher ce docteur ; je l’amenai au logis. C’était un grand homme sec et pâle, et qui, depuis quarante ans pour le moins, occupait le ciseau des Parques1003. Ce savant médecin avait l’extérieur grave, il pesait ses discours et donnait de la noblesse à ses expressions. Ses raisonnements paraissaient géométriques1004 et ses opinions fort singulières.
Après avoir observé mon maître, il lui dit d’un air doctoral : « Il s’agit ici de suppléer au défaut1005 de la transpiration arrêtée. D’autres, à ma place, ordonneraient sans doute des remèdes salins, urineux, volatils1006, et qui, pour la plupart, participent du soufre ou du mercure ; mais les purgatifs et les sudorifiques sont des drogues pernicieuses et inventées par des charlatans ; toutes les préparations chimiques ne semblent faites que pour nuire. J’emploie des moyens plus simples et plus sûrs. A quelle nourriture, continua-t-il, êtes-vous accoutumé ? — Je mange ordinairement, répondit le chanoine, des bisques1007 et des viandes succulentes. — Des bisques et des viandes succulentes ! s’écria le docteur avec surprise. Ah ! vraiment je ne m’étonne plus si vous êtes malade ! Les mets délicieux sont des plaisirs empoisonnés ; ce sont des pièges que la volupté tend aux hommes pour les faire périr plus sûrement. Il faut que vous renonciez aux aliments de bon goût1008 ; les plus fades sont les meilleurs pour la santé. Comme le sang est insipide, il veut des mets qui tiennent de sa nature1009. Et buvez-vous du vin ? ajouta-t-il. — Oui, dit le licencié, du vin trempé1010. — Oh ! trempé tant qu’il vous plaira, reprit le médecin. Quel dérèglement ! voilà un régime épouvantable ! Il y a longtemps que vous devriez être mort. Quel âge avez-vous ? — J’entre dans ma soixante-neuvième année, répondit le chanoine. — Justement, répliqua le médecin ; une vieillesse anticipée1011 est toujours le fruit de l’intempérance. Si vous n’eussiez bu que de l’eau claire toute votre vie, et que vous vous fussiez contenté d’une nourriture simple, de pommes cuites, par exemple, de pois ou de fèves, vous ne seriez pas présentement tourmenté de la goutte, et tous vos membres feraient encore facilement leurs fonctions. Je ne désespère pas toutefois de vous remettre sur pied, pourvu que vous vous abandonniez à mes ordonnances. » Le licencié, tout friand1012 qu’il était, promit de lui obéir en toutes choses.
Alors Sangrado m’envoya chercher un chirurgien qu’il me nomma, et fit tirer à mon maître six bonnes palettes de sang, pour commencer à suppléer au défaut de la transpiration. Puis il dit au chirurgien : « Maître Martin Onez, revenez dans trois heures en faire autant, et demain vous recommencerez. C’est une erreur de penser que le sang soit nécessaire à la conservation de la vie : on ne peut trop saigner un malade1013. Comme il n’est obligé à aucun mouvement ou exercice considérable, et qu’il n’a rien à faire que de ne point mourir, il ne lui faut pas plus de sang pour vivre qu’à un homme endormi ; la vie, dans tous les deux, ne consiste que dans le pouls et dans la respiration. » Le bon chanoine, s’imaginant qu’un si grand médecin ne pouvait faire de faux raisonnements, se laissa saigner sans résistance. Lorsque le docteur eut ordonné de fréquentes et copieuses saignées, il dit qu’il fallait aussi donner au chanoine de l’eau chaude à tout moment, assurant que l’eau bue en abondance pouvait passer pour le véritable spécifique1014 contre toutes sortes de maladies.
Il sortit ensuite, en disant d’un air de confiance, à la dame Jacinte1015 et à moi, qu’il répondait de la vie du malade si on le traitait de la manière qu’il venait de prescrire. La gouvernante, qui jugeait peut-être autrement que lui de sa méthode1016, protesta qu’on la suivrait avec exactitude. En effet, nous mîmes promptement de l’eau chauffer ; et comme le médecin nous avait recommandé sur toutes choses de ne la point épargner, nous en fîmes d’abord boire à mon maître deux ou trois pintes1017 à longs traits. Une heure après, nous réitérâmes ; puis, retournant encore de temps en temps à la charge, nous versâmes dans son estomac un déluge d’eau. D’un autre côté, le chirurgien nous secondant par la quantité de sang qu’il tirait, nous réduisîmes, en moins de deux jours, le vieux chanoine à l’extrémité....
Comme il rendait les derniers soupirs, le médecin parut, et demeura un peu sot1018, malgré l’habitude qu’il avait de dépêcher ses malades. Cependant, loin d’imputer la mort du chanoine à la boisson et aux saignées, il sortit en disant d’un air froid qu’on ne lui avait pas tiré assez de sang ni fait boire assez d’eau chaude.
L’exécuteur de la haute médecine1019, je veux dire le chirurgien, voyant aussi qu’on n’avait plus besoin de son ministère, suivit le docteur Sangrado, l’un et l’autre disant que dès le premier jour ils avaient condamné le licencié. Effectivement ils ne se trompaient presque jamais quand ils portaient un pareil jugement.
(Histoire de Gil Blas de Santillane, livre II, chap. ii.)
Saint-Simon
(1675-1755) §
Louis de Rouvray, duc de Saint-Simon, né à Versailles en 1675, mort en 1755, ne put, malgré la noblesse de sa naissance et l’élévation de ses sentiments, et peut-être à cause de la rigidité hautaine de son caractère, se maintenir ni dans l’armée, sous Louis XIV, ni dans la carrière diplomatique, pendant la Régence. Ses Mémoires sont d’un mécontent et d’un ennemi de Louis XIV : il ne faut donc les consulter qu’en se défiant de la partialité passionnée de l’auteur. Mais, dans un style dont l’étrange incorrection tourne souvent au profit de la pensée, Saint-Simon dépeint les personnages qu’il met en scène avec une netteté et une profondeur qui le rendent égal et peut-être supérieur à celui que Racine appelait « le plus grand peintre de l’antiquité », à l’historien latin Tacite.
Plaisante mésaventure de quelques dames de la cour §
Il y avait une prière publique tous les soirs dans la chapelle à Versailles à la fin de la journée, qui était suivie d’un salut avec la bénédiction du Saint-Sacrement tous les dimanches et les jeudis. L’hiver, le salut était à six heures ; l’été, à cinq, pour pouvoir1020 s’aller promener après. Le Roi n’y manquait point les dimanches et très rarement les jeudis en hiver. A la fin de la prière, un garçon bleu1021, en attente dans la tribune, courait avertir le Roi, qui arrivait toujours un moment avant le salut ; mais, qu’il dût venir ou non, jamais le salut ne l’attendait. Les officiers des gardes du corps postaient les gardes d’avance dans la tribune, d’où le Roi l’entendait toujours. Les dames étaient soigneuses d’y garnir les travées1022 des tribunes, et, l’hiver, de s’y faire remarquer par de petites bougies, qu’elles avaient pour lire dans leurs livres et qui donnaient à plein sur leur visage. La régularité1023était un mérite, et chacune, vieille et souvent jeune, tâchait de se l’acquérir auprès du Roi et de Mme de Maintenon. Brissac1024, fatigué d’y voir des femmes qui n’avaient pas le bruit1025de se soucier beaucoup d’entendre le salut, donna le mot un jour aux officiers qui postaient1026 ; et pendant la prière il arrive dans la travée du Roi, frappe dessus de son bâton, et se met à crier d’un ton d’autorité : « Gardes du Roi, retirez-vous, le roi ne vient point au salut ». A cet ordre tout obéit, les gardes s’en vont, et Brissac se colle derrière un pilier. Grand murmure dans les travées qui étaient pleines ; et un moment après chaque femme souffle sa bougie, et s’en va, tant et si bien qu’il n’y demeura en tout que Mme de Dangeau1027et deux autres assez du commun.
C’était dans l’ancienne chapelle. Les officiers, qui étaient avertis, avaient arrêté les gardes dans l’escalier de Bloin1028et dans les paliers, où ils étaient bien cachés, et quand Brissac eut donné tout loisir aux dames de s’éloigner et de ne pouvoir entendre le retour des gardes, il les fit reposter1029. Tout cela fut ménagé si juste que le Roi arriva un moment après, et que le salut commença. Le Roi. qui faisait toujours des yeux le tour des tribunes, et qui les trouvait toujours pleines et pressées, fut dans la plus grande surprise du monde de n’y trouver en tout et pour tout que Mme de Dangeau et ces deux autres femmes. Il en parla, dès en sortant de sa travée, avec un grand étonnement. Brissac, qui marchait toujours près de lui, se mit à rire et lui conta le tour qu’il avait fait à ces bonnes dévotes de cour, dont il s’était lassé de voir le Roi la dupe. Le Roi en rit beaucoup, et encore plus le courtisan. On sut à peu près qui étaient celles qui avaient soufflé leurs bougies et pris leur parti sur ce que1030 le Roi ne viendrait point, et il y en eut de furieuses qui voulaient dévisager1031 Brissac, qui ne le méritait pas mal par tous les propos qu’il tint sur elles.
(Mémoires, édit. Chéruel, tome IX, chap. xviii.)
La disgrâce d’un grand citoyen : Vauban §
On a vu quel était Vauban, à l’occasion de son élévation à l’office de maréchal de France1032. Maintenant nous l’allons voir réduit au tombeau par l’amertume de la douleur, pour cela même qui le combla d’honneur, et qui ailleurs qu’en France lui eût tout mérité et acquis....
Patriote1033 comme il l’était, il avait toute sa vie été touché de la misère du peuple et de toutes les vexations qu’il souffrait. La connaissance que ses emplois lui donnaient de la nécessité des dépenses1034, et du peu d’espérance que le roi fût pour1035 retrancher celles de splendeur et d’amusements, le faisait gémir de ne voir point de remède à un accablement qui augmentait son poids de jour en jour.
Dans cet esprit, il ne fit point de voyage (et il traversait souvent le royaume de tous les biais) qu’il ne prît partout des informations exactes sur la valeur et le produit des terres, sur la sorte de commerce et d industrie des provinces et des villes, sur la nature et l’imposition des levées1036, sur la manière de les percevoir. Non content de ce qu’il pouvait voir et faire par lui-même, il envoya secrètement partout où il ne pouvait aller, et même où il avait été et où il devait aller, pour être instruit de tout, et comparer les rapports avec ce qu’il aurait connu par lui-même. Les vingt dernières années de sa vie au moins furent employés à ces recherches, auxquelles il dépensa beaucoup. Il les vérifia souvent, avec toute l’exactitude et la justesse qu’il y put apporter, et il excellait en ces deux qualités. Enfin il se convainquit que les terres étaient le seul bien solide, et il se mit à travailler à un nouveau système.
Il était bien avancé, lorsqu’il parut divers petits livres du sieur de Boisguilbert, lieutenant général au siège de Rouen1037, homme de beaucoup d’esprit de détail et de travail, frère d’un conseiller au parlement de Normandie, qui de longue main touché des mêmes vues que Vauban, y travaillait aussi depuis longtemps. Il y avait déjà fait du progrès avant que le chancelier eût quitté les finances1038. Il vint exprès le trouver, et comme son esprit vif avait du singulier1039, il lui demanda de l’écouter avec patience, et tout de suite lui dit que d’abord il le prendrait pour un fou, qu’ensuite il verrait qu’il méritait attention, et qu’à la fin il demeurerait content de son système. Pontchartrain, rebuté de tant de donneurs d’avis qui lui avaient passé par les mains, et qui était tout salpêtre, se mit à rire, lui répondit brusquement qu’il s’en tenait au premier1040, et lui tourna le dos. Boisguilbert, revenu à Rouen, ne se rebuta point du mauvais succès1041 de son voyage : il n’en travailla que plus infatigablement à son projet, qui était à peu près le même que celui de Vauban, sans se connaître l’un l’autre1042. De ce travail naquit un livre savant et profond sur la matière1043, dont le système allait à une répartition exacte, à soulager le peuple de tous les frais qu’il supportait et de beaucoup d’impôts, qui faisait entrer les levées directement dans la bourse du Roi, et, conséquemment, ruineux à l’existence des traitants, à la puissance des intendants, au souverain domaine des ministres des finances1044. Aussi déplut-il à tous ceux-là autant qu’il fut applaudi de tous ceux qui n’avaient pas les mêmes intérêts. Chamillart, qui avait succédé1045 à Pontchartrain, examina ce livre ; il en conçut de l’estime : il manda Boisguilbert deux ou trois fois à l’Estang1046, et y travailla avec lui à plusieurs reprises, en ministre dont la probité ne cherche que le bien.
En même temps, Vauban, toujours appliqué à son ouvrage, vit celui-ci avec attention, et quelques autres du même auteur, qui le suivirent ; de là il voulut entretenir Boisguilbert. Peu attaché aux siens1047, mais ardent pour le soulagement des peuples et pour le bien de l’État, il les retoucha et les perfectionna sur ceux-ci, et y mit la dernière main.
Ils convenaient1048 sur les choses principales, mais non en tout. Boisguilbert voulait laisser quelques impôts sur le commerce étranger et sur les denrées à la manière de Hollande, et s’attachait principalement à ôter les plus odieux, et surtout les frais immenses1049, qui, sans entrer dans les coffres du roi, ruinaient les peuples à la discrétion des traitants et de leurs employés, qui s’y enrichissaient sans mesure, comme cela est encore aujourd’hui et n’a fait qu’augmenter sans avoir jamais cessé depuis.
Vauban, d’accord sur ces suppressions, passait jusqu’à celle des impôts mêmes : il prétendait n’en laisser qu’un unique, et, avec cette simplification, remplir également leurs vues communes sans tomber en aucun inconvénient. Il avait l’avantage sur Boisguilbert de tout ce qu’il avait examiné, pesé, comparé et calculé lui-même, en ses divers voyages, depuis vingt ans, de ce qu’il avait tiré du travail de ceux que, dans le même esprit, il avait envoyés depuis plusieurs années en diverses provinces, toutes choses que Boisguilbert, sédentaire à Rouen, n’avait pu se proposer, et l’avantage encore de se rectifier par les lumières et les ouvrages de celui-ci, par quoi il avait raison de se flatter de le surpasser en exactitude et en justesse, base fondamentale de pareille besogne. Vauban donc abolissait toutes sortes d’impôts, auxquels il en substituait un unique, divisé en deux branches, auxquelles il donnait le nom de dime royale, l’une sur les terres, par un dixième de leur produit, l’autre léger, par estimation1050, sur le commerce et l’industrie, qu’il estimait devoir être encouragés l’un et l’autre, bien loin d’être accablés. Il prescrivait des règles très simples, très sages et très faciles pour la levée et la perception de ces deux droits, suivant la valeur de chaque terre, et par rapport au nombre d’hommes sur lequel on peut compter avec le plus d’exactitude dans l’étendue du royaume. Il ajouta la comparaison de la répartition en usage avec celle qu’il proposait, les inconvénients de l’une et de l’autre, et réciproquement leurs avantages, et conclut par des preuves en faveur de la sienne, d’une netteté et d’une évidence à ne s’y pouvoir refuser. Aussi cet ouvrage reçut-il les applaudissements publics, et l’approbation des personnes les plus capables de ces calculs et de ces comparaisons et les plus versées en toutes ces matières, qui en admirèrent la profondeur, la justesse, l’exactitude et la clarté.
Mais ce livre avait un grand défaut1051 : il donnait, à la vérité, au roi plus qu’il1052 ne tirait par les voies jusqu’alors pratiquées ; il sauvait aussi les peuples de ruine et de vexations, et les enrichissait en leur laissant tout ce qui n’entrait point dans les coffres du roi, à peu de chose près : mais il ruinait une armée de financiers, de commis, d’employés de toute espèce ; il les réduisait à chercher à vivre à leurs dépens, et non plus à ceux du public, et il sapait par les fondements ces fortunes immenses qu’on voit naître en si peu de temps. C’était déjà de quoi échouer.
Mais le crime fut qu’avec cette nouvelle pratique tombait l’autorité du contrôleur général, sa faveur, sa fortune, sa toute-puissance, et, par proportion, celles des intendants des finances, des intendants de provinces, de leurs secrétaires, de leurs commis, de leurs protégés, qui ne pouvaient plus faire valoir leur capacité et leur industrie, leurs lumières et leur crédit, et qui de plus tombaient du même coup dans l’impuissance de faire du bien ou du mal à personne. Il n’est donc pas surprenant que tant de gens si puissants en tout genre, à qui ce livre arrachait tout des mains, conspirassent contre un système si utile à l’État, si heureux pour le roi, si avantageux aux peuples du royaume, mais si ruineux pour eux. La robe1053 entière en rugit pour son intérêt. Elle est la modératrice des impôts par les places qui en regardent toutes les sortes d’administrations1054, et qui lui sont affectées privativement à1055 tous autres, et elle se le croit en corps avec plus d’éclat1056 par la nécessité de l’enregistrement des édits bursaux1057.
Les liens du sang fascinèrent les yeux aux deux gendres de M. Colbert1058, de l’esprit et du gouvernement duquel ce livre s’écartait fort, et furent trompés1059 par les raisonnements vifs et captieux de Desmarets, dans la capacité duquel ils avaient toute confiance, comme au disciple unique de Colbert, son oncle, qui l’avait élevé et instruit ; Chamillart, si doux, si amoureux du bien, et qui n’avait pas, comme on l’a vu, négligé de travailler avec Boisguilbert, tomba sous la même séduction de Desmarets ; le chancelier, qui se sentait toujours d’avoir été, quoique malgré lui, contrôleur général des finances1060, s’emporta ; en un mot, il n’y eut que les impuissants et les désintéressés pour Vauban et Boisguilbert, je veux dire l’Église et la noblesse ; car pour les peuples, qui y gagnaient tout, ils ignorèrent qu’ils avaient touché à leur salut, que les bons bourgeois seuls déplorèrent.
Ce ne fut donc pas merveille si le roi, prévenu et investi de la sorte, reçut très mal le maréchal de Vauban lorsqu’il lui présenta son livre, qui lui était adressé dans tout le contenu de l’ouvrage. On peut juger si les ministres à qui il le présenta lui firent un meilleur accueil. De ce moment, ses services, sa capacité militaire, unique en son genre, ses vertus, l’affection que le roi y avait mise, jusqu’à croire se couronner de lauriers en l’élevant1061, tout disparut à l’instant à ses yeux : il ne vit plus en lui qu’un insensé pour l’amour du public, et qu’un criminel qui attentait à l’autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne ; il s’en expliqua de la sorte sans ménagement.
L’écho en retentit plus aigrement encore dans toute la nation offensée1062, qui abusa sans aucun ménagement de sa victoire ; et le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître, pour qui il avait tout fait, et mourut peu de mois après, ne voyant plus personne, consommé de douleur et d’une affliction que rien ne put adoucir, et à laquelle le roi fut insensible, jusqu’à ne pas faire semblant de s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. Il1063 n’en fut pas moins célébré par toute l’Europe, et par les ennemis mêmes, ni moins regretté en France de tout ce qui n’était pas financier ou suppôt1064 de financier.
(Mémoires, édit. de Boilisle, tome XIV : 1707.)
Montesquieu
(1689-1755) §
Né en 1689 au château de la Brède, près de Bordeaux, mort en 1755, Charles de Secondat, baron de Montesquieu, qui, dès l’âge de vingt-sept ans, hérita de la charge de président à mortier1065 au parlement de Bordeaux, a publié, outre différents opuscules, trois ouvrages célèbres : les Lettres persanes (1721), ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734), l’Esprit des lois (1748). Le premier est une espèce de roman satirique par lettres, dans lequel il attaque les ridicules et les abus de son temps ; les deux autres sont des études de politique qui révèlent une grande force et une grande originalité de pensée. Le style de Montesquieu sent peut-être un peu trop le travail, et ce n’est pas sans raison qu’on l’accusait, de son temps même, de viser trop à l’esprit en traitant des sujets sérieux ; sa langue n’en est pas moins, la plupart du temps, d’une précision et d’une netteté admirables ; il excelle surtout à résumer toute une théorie ou toute une série d’événements par un de ces traits courts et incisifs qui se gravent d’eux-mêmes dans l’esprit.
Un persan a paris §
Les habitants de Paris sont d’une curiosité qui va jusqu’à l’extravagance. Lorsque j’arrivai, je1066 fus regardé comme si j’avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j’étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi ; les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs1067 qui m’entourait. Si j’étais aux spectacles, je trouvais d’abord cent lorgnettes dressées contre ma figure ; enfin, jamais homme n’a tant été vu que moi.
Je souriais quelquefois d’entendre des gens qui n’étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux : « Il faut avouer qu’il a l’air bien persan. » Chose admirable ! je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m’avoir pas assez vu.
Tant d’honneurs ne laissent pas d’être à charge : je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare ; et, quoique j’aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d’une grande ville où je n’étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l’habit persan et à en endosser un à l’européenne, pour voir s’il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d’admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement ; libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J’eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m’avait fait perdre en un instant l’attention et l’estime publiques ; car j’entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu’on m’eût regardé et qu’on m’eût mis en occasion d’ouvrir la bouche ; mais si quelqu’un, par hasard, apprenait à la compagnie que j’étais Persan, j’entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah ! ah ! monsieur est Persan ! C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? »
(Lettres persanes, XXX.)
L’homme universel1068 §
Je1069 me trouvai l’autre jour dans une compagnie où je vis un homme bien content de lui. Dans un quart d’heure, il décida trois questions de morale, quatre problèmes historiques et cinq points de physique. Je n’ai jamais vu un décisionnaire1070 si universel ; son esprit ne fut jamais suspendu par le moindre doute. On laissa les sciences ; on parla des nouvelles du temps : il décida sur les nouvelles du temps. Je voulus l’attraper, et je dis en moi-même : « Il faut que je me mette dans mon fort ; je vais me réfugier dons mon pays. » Je lui parlai de la Perse ; mais à peine lui eus-je dit quatre mots, qu’il me donna deux démentis, fondés sur l’autorité de MM. Tavernier et Chardin1071. « Ah ! bon Dieu ! dis-je en moi-même, quel homme est-ce là ? Il connaîtra tout à l’heure les rues d’Ispahan1072 mieux que moi ! » Mon parti fut bientôt pris ; je me tus, je le laissai parler ; et il décide encore.
(Lettres persanes, LXXII.)
La vraie grandeur §
Il y a quelques jours qu’un homme de ma connaissance me dit1073 : « Je vous ai promis de vous produire1074 dans les bonnes maisons de Paris ; je vous mène à présent chez un grand seigneur qui est un des hommes qui représentent1075 le mieux. — Que cela veut-il dire1076, monsieur ? Est-ce qu’il est plus poli, plus affable qu’un autre ? — Ce n’est pas cela, me dit-il. — Ah ! j’entends : il fait sentir à tous les instants la supériorité qu’il a sur tous ceux qui rapprochent ; si cela est, je n’ai que faire d’y aller ; je prends déjà condamnation et je la lui passe tout entière1077. »
Il fallut pourtant marcher ; et je vis un petit homme si fier, il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, il se moucha si impitoyablement, il cracha avec tant de flegme, il caressa ses chiens d’une manière si offensante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de l’admirer1078. « Ah ! bon Dieu ! dis-je en moi-même, si, lorsque j’étais à la cour de Perse, je représentais ainsi, je représentais un grand sot ! » Il aurait fallu, Usbek, que nous eussions un bien mauvais naturel pour aller faire cent petites insultes à des gens qui venaient tous les jours chez nous nous témoigner leur bienveillance. Ils savaient bien que nous étions au-dessus d’eux ; et, s’ils l’avaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris chaque jour. N’ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables ; nous nous communiquions aux plus petits : au milieu des grandeurs, qui endurcissent toujours, ils nous trouvaient sensibles ; ils ne voyaient que notre cœur au-dessus d’eux1079 ; nous descendions jusqu’à leurs besoins. Mais lorsqu’il fallait soutenir la majesté du prince dans les cérémonies publiques ? lorsqu’il fallait faire respecter la nation aux étrangers, lorsque enfin, dans les occasions périlleuses, il fallait animer les soldats, nous remontions cent fois plus haut que nous n’étions descendus ; nous ramenions la fierté sur notre visage, et l’on trouvait quelquefois que nous représentions assez bien.
(Lettres persanes, LXXIV.)
Charles XII §
Ce prince, qui ne fit usage que de ses seules forces, détermina sa chute en formant des desseins qui ne pouvaient être exécutés que par une longue guerre : ce que son royaume ne pouvait soutenir1080.
Ce n’était pas un État qui fût dans la décadence qu’il entreprit de renverser, mais un empire naissant. Les Moscovites se servirent de la guerre qu’il leur faisait comme d’une école. À chaque défaite, ils s’approchaient de la victoire ; et, perdant au dehors, ils apprenaient à se défendre au dedans.
Charles se croyait le maître du monde dans les déserts de la Pologne, où il errait, et dans lesquels la Suède était comme répandue, pendant que son principal ennemi se fortifiait contre lui, le serrait, s’établissait sur la mer Baltique, détruisait ou prenait la Livonie1081.
La Suède ressemblait à un fleuve dont on coupait les eaux dans sa source, pendant qu’on les détournait dans son cours.
Ce ne fut point Pultava qui perdit Charles ; s’il n’avait pas été détruit dans ce lieu, il l’aurait été dans un autre. Les accidents de la fortune se réparent aisément ; mais comment parer à des événements qui naissent continuellement de la nature des choses ?
Mais la nature ni la fortune ne furent jamais si fortes contre lui que lui-même.
Il ne se réglait point sur la disposition actuelle des choses, mais sur un certain modèle qu’il avait pris : encore le suivit-il très mal. Il n’était point Alexandre ; mais il aurait été le meilleur soldat d’Alexandre.
(De l’Esprit des Lois, livre X, chap. xiii.)
Voltaire
(1694-1778) §
Né à Paris le 20 novembre 1694, François-Marie Arouet, qui devait prendre le nom de Voltaire, donna de très bonne heure des marques de son talent de poète et d’écrivain. En 1718, il fit représenter sa tragédie d’Œdipe, dont le succès fut très vif. Forcé en 1726 de s’exiler en Angleterre, il y publia la Henriade, poème épique en dix chants. Rentré en France en 1729, il donna, entre autres ouvrages, les tragédies de Brutus (1730), Zaïre (1732), la Mort de César (1735), Alzire (1736), Mahomet (1741), Mérope (1743), l’Orphelin de la Chine (1755), Tancrède (1760). Les plus remarquables de ses œuvres en prose, pendant la même période de sa vie, sont l’Histoire de Charles XII, les Lettres philosophiques ou Lettres sur les Anglais (1731), le Siècle de Louis XI V (1752), l’Essai sur l’esprit et les mœurs des nations (1758). Quand Voltaire, qui, de 1734 à 1749, avait séjourné surtout en Champagne, à Cirey, chez Mme du Châtelet, et, de 1750 à 1753, en Prusse, à la cour de Frédéric II, se fut établi définitivement dans sa terre de Ferney, sur la frontière de la France et de la Suisse, il donna encore quelques grandes œuvres historiques et dramatiques, et des romans satiriques, dont le style est admirable de pureté, de finesse et de vivacité. Mais ce sont surtout les lettres, les poésies légères et les opuscules polémiques qui se multiplient sous sa plume à cette époque : il correspond avec tout ce qu’il y a d’illustre et de puissant en Europe, et élève victorieusement la voix dans toutes les affaires qui passionnent l’opinion publique. Il rentre enfin à Paris, le 10 février 1778. Le 30 mars, la sixième représentation de sa dernière tragédie, Irène, fut pour les Parisiens l’occasion de le faire assister vivant à sa propre apothéose. Dans la nuit du 30 au 31 mai il mourut, laissant l’exemple d’une activité intellectuelle qu’on ne retrouve au même degré chez aucun écrivain, et méritant d’être regardé comme le plus grand de tous nos prosateurs, à l’exception de Bossuet, qu’il égale toutefois, quoiqu’il ne lui ressemble en rien.
Le Vaniteux §
Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l’itimadoulet1082 de Médie, nommé Irax. C’était un grand seigneur dont le fond n’était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât contredire… Il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs. Zadig1083 entreprit de le corriger.
Il lui envoya, de la part du roi, un maître de musique avec douze voix1084 et vingt-quatre violons, un maître d’hôtel avec six cuisiniers et quatre chambellans1085, qui ne devaient pas le quitter. L’ordre du roi portait que l’étiquette1086 suivante serait inviolablement observée, et voici comment les choses se passèrent.
Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons ; on chanta une cantate qui dura deux heures, et, de trois minutes en trois minutes, le refrain était :
Que son mérite est extrême !
Que de grâces ! que de grandeur !
Ah ! combien monseigneur
Doit être content de lui-même !
Après l’exécution de la cantate, un chambellan lui fit une harangue de trois quarts d’heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura trois heures. Dès qu’il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit : « Il aura raison ». A peine eut-il prononcé quatre paroles, que le second chambellan s’écria : « Il a raison ! » Les deux autres chambellans firent de grands éclats de rire des bons mots qu’Irax avait dits ou qu’il avait dû dire. Après dîner, on lui répéta la cantate.
Cette première journée lui parut délicieuse, il crut que le roi des rois l’honorait selon ses mérites ; la seconde lui parut moins agréable ; la troisième fut gênante ; la quatrième fut insupportable ; la cinquième fut un supplice ; enfin, outré d’entendre toujours chanter :
Ah ! combien monseigneur
Doit être content de lui-même !
d’entendre toujours dire qu’il avait raison, et d’être harangué chaque jour à la même heure, il écrivit en cour pour supplier le roi qu’il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître d’hôtel ; il promit d’être désormais moins vain et plus appliqué ; il se fit moins encenser, eut moins de fêtes, et fut plus heureux ; car, comme dit le Sadder1087, toujours du plaisir n’est pas du plaisir.
(Romans : Zadig ou la Destinée, histoire orientale, chap.)
Une sédition militaire à Moscou au xviie siècle §
À peine Fœdor1088 fut-il expiré1089, que la nomination d’un prince de dix ans au trône, l’exclusion de l’aîné et les intrigues de la princesse Sophie, leur sœur, excitèrent dans le corps des strélitz1090 une des plus sanglantes révoltes. Les janissaires ni les gardes prétoriennes1091 ne furent jamais si barbares. D’abord, deux jours après les obsèques du czar Fœdor, ils courent en armes au Kremlin ; c’est, comme on sait, le palais des czars à Moscou : ils commencent par se plaindre de neuf de leurs colonels qui ne les avaient pas assez exactement payés. Le ministère est obligé de casser les colonels, et de donner aux strélitz l’argent qu’ils demandent. Ces soldats ne sont pas contents ; ils veulent qu’on leur remette les neuf officiers, et les condamnent, à la pluralité des voix, au supplice qu’on appelle les batoques. Voici comme on inflige ce supplice.
On dépouille nu le patient, on le couche sur le ventre, et deux bourreaux le frappent sur le dos avec des baguettes jusqu’à ce que le juge dise : C’est assez. Les colonels, ainsi traités par leurs soldats, furent encore obligés de les remercier, selon l’usage oriental des criminels, qui, après avoir été punis, baisent la main de leurs juges ; ils ajoutèrent à leurs remerciements une somme d’argent, ce qui n’était pas d’usage.
Tandis que les strélitz commençaient ainsi à se faire craindre, la princesse Sophie, qui les animait sous main pour les conduire de crime en crime, convoquait chez elle une assemblée des princesses du sang, des généraux d’armée, des boïards1092, du patriarche1093, des évêques, et même des principaux marchands : elle leur représentait que le prince Ivan, par son droit d’aînesse et par son mérite, devait avoir l’empire, dont elle espérait en secret tenir les rênes. Au sortir de l’assemblée, elle fait promettre aux strélitz une augmentation de paye et des présents. Ses émissaires excitent surtout la soldatesque contre la famille des Nariskin1094, et principalement contre les deux Nariskin, frères de la jeune czarine douairière, mère de Pierre ler1095. On persuade aux strélitz qu’un de ces frères, nommé Jean, a pris la robe du czar, qu’il s’est mis sur le trône, et qu’il a voulu étouffer le prince Ivan ; on ajoute qu’un malheureux médecin hollandais, nommé Daniel Vangad, a empoisonné le czar Fœdor. Enfin Sophie fait remettre entre leurs mains une liste de quarante seigneurs, qu’elle appelle leurs ennemis et ceux de l’État, et qu’ils doivent massacrer....
On jette d’abord par les fenêtres les knès1096 Dolgorouki et Maffeu1097 : les strélitz les reçoivent sur la pointe de leurs piques, les dépouillent, et les traînent sur la grande place. Aussitôt ils entrent dans le palais, ils y trouvent un des oncles du czar Pierre, Athanase Nariskin, frère de la jeune czarine ; ils le massacrent de la même manière. Ils forcent les portes d’une église voisine où trois proscrits s’étaient réfugiés ; ils les arrachent de l’autel, les dépouillent, et les assassinent à coups de couteau.
Leur fureur était si aveugle, que, voyant passer un jeune seigneur de la maison de Soltikoff, qu’ils aimaient, et qui n’était point sur la liste des proscrits, quelques-uns d’eux ayant pris ce jeune homme pour Jean Nariskin qu’ils cherchaient, ils le tuèrent sur-le-champ. Ce qui découvre bien les mœurs de ces temps-là, c’est qu’ayant reconnu leur erreur, ils portèrent le corps du jeune Soltikoff à son père pour l’enterrer ; et le père malheureux, loin d’oser se plaindre, leur donna des récompenses pour lui avoir rapporté le corps sanglant de son fils. Sa femme, ses filles et l’épouse du mort, en pleurs, lui reprochèrent sa faiblesse. « Attendons le temps de la vengeance », leur dit le vieillard. Quelques strélitz entendirent ces paroles : ils rentrent furieux dans la chambre, traînent le père par les cheveux, et l’égorgent à la porte de sa maison.
D’autres strélitz vont chercher partout le médecin hollandais Vangad : ils rencontrent son fils, ils lui demandent où est son père ; le jeune homme, en tremblant, répond qu’il l’ignore, et sur cette réponse il est égorgé. Ils trouvent un autre médecin allemand : « Tu es médecin, lui disent-ils ; si tu n’as pas empoisonné notre maître Fœdor, tu en as empoisonné d’autres ; tu mérites bien la mort » ; et ils le tuent.
Enfin ils trouvent le Hollandais qu’ils cherchaient ; il s’était déguisé en mendiant : ils le traînent devant le palais ; les princesses, qui aimaient ce bonhomme, et qui avaient confiance en lui, demandent sa grâce aux strélitz, en les assurant qu’il est un fort bon médecin et qu’il a très bien traité leur frère Fœdor. Les strélitz répondent que non seulement il mérite la mort comme médecin, mais aussi comme sorcier, et qu’ils ont trouvé chez lui un grand crapaud séché et une peau de serpent. Ils ajoutent qu’il leur faut absolument livrer le jeune Ivan Nariskin, qu’ils cherchent en vain depuis deux jours ; qu’il est sûrement caché dans le palais, qu’ils y mettront le feu si on ne leur donne leur victime. La sœur d’Ivan Nariskin, les autres princesses épouvantées vont dans la retraite où Jean Nariskin est caché ; le patriarche le confesse, lui donne le viatique et l’extrême-onction ; après quoi il prend une image de la vierge qui passait pour miraculeuse, il mène par la main le jeune homme, et s’avance aux strélitz en leur montrant l’image de la Vierge. Les princesses en larmes entourent Nariskin, se mettent à genoux devant les soldats, les conjurent, au nom de la Vierge, d’accorder la vie à leur parent ; mais les soldats l’arrachent des mains des princesses, ils le traînent au has des escaliers avec Vaugad : alors ils forment entre eux une espèce de tribunal ; ils appliquent à la question Nariskin et le médecin. Un d’entre eux, qui savait écrire, dresse un procès-verbal ; ils condamnent les deux infortunés à être hachés en pièces ; c’est un supplice usité à la Chine1098 et en Tartarie pour les parricides : on l’appelle le supplice des dix mille morceaux. Après avoir ainsi traité Nariskin et Vangad, ils exposent leurs têtes, leurs pieds et leurs mains sur les pointes de fer d’une balustrade.
Pendant qu’ils assouvissaient leur fureur aux yeux des princesses, d’autres massacraient tous ceux qui leur étaient odieux, ou suspects à Sophie.
Cette exécution horrible finit par proclamer1099 souverains les deux princes Ivan et Pierre, en leur associant leur sœur Sophie en qualité de corégente. Alors elle approuva tous leurs crimes et les récompensa, confisqua les biens des proscrits et les donna aux assassins : elle leur permit même d’élever un monument, sur lequel ils firent graver les noms de ceux qu’ils avaient massacrés comme traîtres à la patrie ; elle leur donna enfin des lettres patentes1100, par lesquelles elle les remerciait de leur zèle et de leur fidélité.
Voilà par quels degrés la princesse Sophie monta en effet1101 sur le trône de Russie sans être déclarée czarine, et voilà les premiers exemples qu’eut Pierre Ier devant les yeux. Sophie eut tous les honneurs d’une souveraine : son buste sur les monnaies, la signature pour toutes les expéditions1102, la première place au conseil, et surtout la puissance suprême. Elle avait beaucoup d’esprit, faisait même des vers dans sa langue, écrivait et parlait bien : une figure agréable relevait encore tant de talents ; son ambition seule les ternit.
(Histoire de la Russie sous Pierre le Grand, première partie, chap. iv-v.)
Une erreur judiciaire §
Nous avons déjà parlé du supplice de la roue, dans lequel périt, il y a peu d’années1103, ce bon cultivateur, ce bon père de famille, nommé Martin, d’un village du Barrois1104 ressortissant au parlement de Paris. Le premier juge condamna ce vieillard à la torture qu’on appelle ordinaire et extraordinaire1105, et à expirer sur la roue1106 et il le condamna non seulement sur les indices les plus équivoques, mais sur des présomptions qui devaient établir son innocence.
Il s’agissait d’un meurtre et d’un vol commis auprès de sa maison, tandis qu’il dormait profondément entre sa femme et ses sept enfants. On confronte l’accusé avec un passant qui avait été témoin de l’assassinat. « Je ne le reconnais pas, dit le passant ; ce n’est pas là le meurtrier que j’ai vu ; l’habit est semblable, mais le visage est différent.
— Ah ! Dieu soit loué, s’écria le bon vieillard, ce témoin ne m’a pas reconnu. »
Sur ces paroles, le juge s’imagine que le vieillard, plein de l’idée de son crime, a voulu dire : « Je l’ai commis, on ne m’a pas reconnu, me voilà sauvé » ; mais il est clair que ce vieillard, plein de son innocence, voulait dire : « Ce témoin a reconnu que je ne suis pas coupable ; il a reconnu que mon visage n’est pas celui du meurtrier ». Cette étrange logique d’un bailli1107, et des présomptions encore plus fausses, déterminent la sentence précipitée de ce juge et de ses assesseurs. Il ne leur tombe pas dans l’esprit d’interroger la femme, les enfants, les voisins, de chercher si l’argent volé se trouve dans la maison, d’examiner la vie de l’accusé, de confronter la pureté de ses mœurs avec ce crime. La sentence est portée ; la Tournelle1108, trop occupée alors, signe sans examen : Bien jugé.
L’accusé expire sur la roue devant sa porte ; son bien est confisqué ; sa femme s’enfuit en Autriche avec ses petits enfants. Huit jours après, le scélérat qui avait commis le meurtre est supplicié pour d’autres crimes : il avoue à la potence, qu’il est coupable de l’assassinat pour lequel ce bon père de famille est mort.
Une fatalité1109 singulière fait que je suis instruit de cette catastrophe. J’en écris à un de mes neveux, conseiller au parlement de Paris1110. Ce jeune homme vertueux et sensible trouve, après bien des recherches, la minute1111 de l’arrêt de la Tournelle égarée dans la poudre1112 d’un greffe. On promet de réparer ce malheur ; les temps ne l’ont pas permis : la famille reste dispersée et mendiante dans le pays étranger avec d’autres familles que la misère a chassées de leur patrie.
Des censeurs me reprochent que j’ai déjà parlé de ces désastres1113 : oui, j’ai peint et je veux repeindre ces tableaux nécessaires, dont il faut multiplier les copies....
N’est-il pas bien permis, que dis-je ! bien nécessaire d’avertir souvent les hommes qu’ils doivent ménager le sang des hommes.
Je voudrais que le récit de toutes les injustices retentît sans cesse à toutes les oreilles.
(Mélanges ; La méprise d’Arras.)
Les pichons §
J’ai une grâce à vous1114 demander ; c’est pour les Pichons. Ces Pichons sont une race de femmes de chambre et de domestiques, transplantée à Paris par Mme Denis1115 et consorts. Un Pichon vient de mourir à Paris, et laisse de petits Pichons. J’ai dit qu’on m’envoyât1116 un Pichon de dix ans pour l’élever ; aussitôt un Pichon est parti pour Lyon. Ce pauvre petit est arrivé, je ne sais comment ; il est à la garde de Dieu. Je vous prie de le prendre sous la vôtre. Cet enfant est ou va être transplanté de Paris à Lyon par le coche ou par charrette. Comment le savoir ? où le trouver ? J’apprends par un Pichon des Délices que ce petit est au panier de la diligence1117. Pour Dieu, daignez vous en informer ; envoyez-le-nous de panier en panier ; vous ferez une bonne œuvre. J’aime mieux élever un Pichon que servir un roi, fût-ce le roi des Vandales1118.
(Lettres, 28 juillet 1757.)
Jeannot et Colin §
Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l’école dans la ville d’Issoire1119 en Auvergne, ville fameuse dans tout l’univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d’un marchand de mulets très renommé ; Colin devait le jour à un brave laboureur des environs, qui cultivait la terre avec quatre mulets, et qui, après avoir payé la taille, le taillon, les aides et gabelles, le sou pour livre, la capitation et les vingtièmes1120, ne se trouvait pas puissamment riche au bout de l’année.
Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats ; ils s’aimaient beaucoup, et ils avaient ensemble de petites privautés, de petites familiarités, dont on se ressouvient toujours avec agrément quand on se rencontre ensuite dans le monde.
Le temps de leurs études était sur le point de finir, quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à trois couleurs, avec une veste de Lyon de fort bon goût : le tout était accompagné d’une lettre à M. de la Jeannotière. Colin admira l’habit et ne fut point jaloux ; mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment, Jeannot n’étudia plus, se regarda au miroir, et méprisa tout le monde. Quelque temps après, un valet de chambre arrive en poste1121, et apporte une seconde lettre à M. le marquis de la Jeannotière ; c’était un ordre de monsieur son père de faire venir monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire.
Les lecteurs qui aiment à s’instruire doivent savoir que M. Jeannot le père avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires. Vous demandez comment on fait ces grandes fortunes ? C’est parce qu’on est heureux....
C’est ce qui arriva à Jeannot le père, qui fut bientôt ML de la Jeannotière, et qui, ayant acheté un marquisat au bout de six mois, retira de l’école M. le marquis son fils pour le mettre à Paris dans le beau monde.
Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compliments à son ancien camarade, et lui fit ces lignes pour le congratuler1122. Le petit marquis ne lui fit point de réponse : Colin en fut malade de douleur.
Le père et la mère donnèrent d’abord un gouverneur au jeune marquis : ce gouverneur, qui était un homme du bel air et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son pupille. Monsieur voulait que son fils apprît le latin, madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner. Le maître de la maison commença par lui dire : « Monsieur, comme vous savez le latin et que vous êtes un homme de la cour… — Moi, monsieur, du latin ! je n’en sais pas un mot, répondit le bel esprit, et bien m’en a pris : il est clair qu’on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son application entre elle et les langues étrangères1123. Voyez toutes nos dames, elles ont l’esprit plus agréable que les hommes ; leurs lettres sont écrites avec cent fois plus de grâce ; elles n’ont sur nous cette supériorité que parce qu’elles ne savent pas le latin… »
Madame fut entièrement de cet avis. Le petit marquis était au comble de la joie ; le père était très indécis. « Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils ? disait-il. — A être aimable, répondit l’ami que l’on consultait ; et s’il sait les moyens de plaire, il saura tout ; c’est un art qu’il apprendra chez madame sa mère, sans que ni l’un ni l’autre se donnent la moindre peine. »
Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant et lui dit : « On voit bien, monsieur, que vous êtes l’homme du monde le plus savant ; mon fils vous devra toute son éducation… »
Enfin, après avoir examiné le fort et le faible des sciences, il fut décidé que M. le marquis apprendrait à danser.
La nature, qui fait tout, lui avait donné un talent qui se développa bientôt avec un succès prodigieux : c’était de chanter agréablement des vaudevilles1124. Les grâces de la jeunesse, jointes à ce don supérieur, le firent regarder comme le jeune homme de la plus grande espérance....
Mme la marquise crut alors être la mère d’un bel esprit, et donna à souper aux beaux esprits de Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renversée : il acquit l’art de parler sans s’entendre1125 et se perfectionna dans l’habitude de n’être propre à rien. Quand son père le vit si éloquent, il regretta vivement de ne lui avoir pas fait apprendre le latin, car il lui aurait acheté une grande charge dans la robe1126. La mère, qui avait des sentiments plus nobles, se chargea de solliciter un régiment1127 pour son fils....
Une jeune veuve de qualité, leur voisine, qui n’avait qu’une fortune médiocre, voulut bien se résoudre à mettre en sûreté les grands biens de M. et de Mme de la Jeannetière, en se les appropriant et en épousant le jeune marquis. Elle devint la meilleure amie du père et de la mère. Une vieille voisine proposa le mariage ; les parents, éblouis de la splendeur de cette alliance, acceptèrent avec joie la proposition ; ils donnèrent leur fils unique à leur amie intime. Le jeune marquis allait épouser une femme qu’il adorait et dont il était aimé ; les amis de la maison le félicitaient ; on allait rédiger les articles1128, en travaillant aux habits de noce et à l’épithalame1129.
Il était un matin aux genoux de la charmante épouse que l’amour, l’estime et l’amitié allaient lui donner, lorsque un valet de chambre de madame la mère arrive tout effaré. « Voici bien d’autres nouvelles, dit-il ; des huissiers déménagent la maison de monsieur et de madame ; tout est saisi par des créanciers ; on parle de prise de corps et je vais faire mes diligences pour être payé1130 de mes gages. — Voyons un peu, dit le marquis, ce que c’est que ça, ce que c’est, que cette aventure-là. — Oui, dit la veuve, allez punir ces coquins-là, allez vite. » Il y court, il arrive à la maison ; son père était déjà emprisonné ; tous les domestiques avaient fui chacun de leur côté, en emportant tout ce qu’ils avaient pu. Sa mère était seule, sans secours, sans consolation, noyée dans les larmes ; il ne lut restait rien que le souvenir de sa fortune, de sa beauté, de ses fautes et de ses folles dépenses.
Après que le fils eut longtemps pleuré avec la mère, il lui dit enfin : « Ne nous désespérons pas ; cette jeune veuve m’aime éperdument ; elle est plus généreuse encore que riche, je réponds d’elle : je vole à elle et je vais vous l’amener. » Il retourne donc chez la dame. « Quoi ! c’est vous, monsieur de la Jeannotière ; que venez-vous faire ici ? abandonne-t-on ainsi sa mère ? Allez chez cette pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours du bien : j’ai besoin d’une femme de chambre, et je lui donnerai la préférence. »
Le marquis, stupéfait, la rage dans le cœur, alla chercher son ancien gouverneur, déposa ses douleurs dans son sein, et lui demanda des conseils. Celui-ci lui proposa de se faire, comme lui, gouverneur d’enfants. « Hélas ! je ne sais rien, vous ne m’avez rien appris et vous êtes la première cause de mon malheur » ; et il sanglotait en lui parlant ainsi....
Il fut traité à peu près de même par tous ses amis, et apprit mieux à connaître le monde dans une demi-journée que dans tout le reste de sa vie.
Comme il était plongé dans l’accablement du désespoir, il vit avancer une chaise roulante à l’antique, espèce de tombereau couvert, accompagné de rideaux de cuir, suivi de quatre charrettes énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu : c’était un visage rond et frais, qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite femme, brune et assez grossièrement agréable, était cahotée à côté de lui. La voiture n’allait pas comme le char d’un petit-maître : le voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile, abîmé dans sa douleur. « Eh ! mon Dieu ! s’écria-t-il, je crois que c’est là Jeannot. » A ce nom le marquis lève les yeux ; la voiture s’arrête : « C’est Jeannot lui-même, c’est. Jeannot ! » Le petit homme rebondi ne fait qu’un saut et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin ; la honte et les pleurs couvrirent son visage : « Tu m’as abandonné, dit Colin ; mais tu as beau être grand seigneur, je t’aimerai toujours. » Jeannot, confus et attendri, lui conta en sanglotant une partie de son histoire. « Viens dans l’hôtellerie où je loge me conter le reste, lui dit Colin ; embrasse ma petite femme et allons dîner ensemble. »
Ils vont tous trois à pied, suivis du bagage. « Qu’est-ce donc que tout cet attirail ? Vous appartient-il ? — Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays ; je suis à la tête d’une bonne manufacture de fer étamé et de cuivre : j’ai épousé la fille d’un riche négociant en ustensiles nécessaires aux grands et aux petits nous travaillons beaucoup ; Dieu nous bénit ; nous n’avons point changé d’état1131, nous sommes heureux : nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis ; toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays, je t’apprendrai le métier : il n’est pas bien difficile ; je te mettrai de part1132 et nous vivrons gaiement dans le coin de terre où nous sommes nés. »
Jeannot éperdu se sentait partagé entre la douleur et la joie, la tendresse et la honte ; et il se disait tout bas : « Tous mes amis du bel air m’ont trahi, et Colin, que j’ai méprisé, vient seul à mon secours. Quelle instruction ! » La bonté d’âme de Colin développa dans le cœur de Jeannot le germe du bon naturel, que le monde n’avait pas encore étouffé : il sentit qu’il ne pouvait abandonner son père et sa mère. « Nous aurons soin de ta mère, dit Colin ; et quant à ton bonhomme de père, qui est en prison, j’entends un peu les affaires ; ses créanciers, voyant qu’il n’a plus rien, s’accommoderont pour peu de chose ; je me charge de tout. » Colin fit tant qu’il tira le père de prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin, laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils virent que le bonheur n’est pas dans la vanité.
(Romans : Jeannot et Colin.)
Le chevalier d’Assas §
Les braves actions de tant d’officiers et de soldats sont innombrables dans toutes les guerres ; mais il y en a eu de si singulières, de si uniques dans leur espèce, que ce serait manquer à la patrie que de les laisser dans l’oubli. En voici une, par exemple, qui mérite d’être à jamais conservée dans la mémoire des Français.
Le prince héréditaire de Brunswick1133 assiégeait Vésel1134, dont la prise eût porté la guerre sur le bas Rhin et dans le Brabant ; cet événement eût pu engager les Hollandais à se déclarer contre nous (15 octobre 1758). Le marquis de Castries1135 s’avança avec rapidité, emporta Rhinsberg1136 l’épée à la main, et jeta des secours dans Vésel. Méditant une action plus décisive encore, il vint camper le 15 octobre à un quart de lieue de l’abbaye appelée Closter-Camp1137. Le prince ne crut pas devoir l’attendre devant Vésel ; il se décida à l’attaquer, et se porta au-devant de lui, par une marche forcée, la nuit du 15 au 16.
Le général français, qui se doute du dessein du prince, fait coucher son armée sous les armes ; il envoie à la découverte pendant la nuit M. d’Assas, capitaine au régiment d’Auvergne1138. A peine cet officier a-t-il fait quelques pas, que des grenadiers ennemis, en embuscade, l’environnent et le saisissent à peu de distance de son régiment. Ils lui présentent la baïonnette et lui disent que, s’il fait du bruit, il est mort. M. d’Assas se recueille un moment pour mieux renforcer sa voix, il crie : « A moi, Auvergne ! voilà les ennemis ! » Il tombe aussitôt percé de coups.
Ce dévouement digne des anciens Romains aurait été immortalisé par eux. On dressait alors des statues à de pareils hommes ; dans nos jours ils sont oubliés, et ce n’est que longtemps après avoir écrit cette histoire que j’ai appris cette action si mémorable1139.
(Précis du siècle de Louis XV, chap. XXXIII.)
La voute étoilée §
La nuit était venue ; elle était belle ; l’atmosphère était une voûte d’azur transparent, semée d’étoiles d’or ; ce spectacle touche toujours les hommes et leur inspire une douce rêverie : le bon Parouba1140 admirait le ciel, comme un Allemand admire Saint-Pierre de Rome1141 ou l’Opéra de Naples1142, quand il le voit pour la première fois. « Cette voûte est bien hardie », disait Parouba à Freind1143 ; et Freind lui disait : « Mon cher Parouba, il n’y a point de voûte ; ce cintre bleu n’est autre chose qu’une étendue de nuages légers, que Dieu a tellement1144 disposés et combinés avec la mécanique de vos yeux, qu’en quelque endroit que vous soyez, vous êtes toujours au centre de votre promenade et vous voyez ce qu’on nomme le ciel, et qui n’est point le ciel, arrondi sur votre tête. — Et ces étoiles, monsieur Freind ? — Ce sont, comme je vous l’ai déjà dit, autant de soleils autour desquels tournent d’autres mondes ; loin d’être attachées à cette voûte bleue, souvenez-vous qu’elles en sont à des distances différentes et prodigieuses : cette étoile, que vous voyez, est à douze cents millions de mille pas1145 de notre soleil. » Alors il lui montra le télescope qu’il avait apporté : il lui fit voir nos planètes, Jupiter avec ses quatres lunes, Saturne avec ses cinq lunes1146 et son inconcevable anneau lumineux. « C’est la même lumière, lui disait-il, qui part de tous ces globes et qui arrive à nos yeux : de cette planète-ci en un quart d’heure, de cette étoile-ci en six mois. » Parouba se mit à genoux et dit : « Les cieux annoncent Dieu ». Tout l’équipage était autour du vénérable Freind, regardait et admirait.
(Romans : Histoire de Jenni, ou l’Athée et te Sage, chap. x.)
Buffon
(1707-1788) §
Jean-Louis Leclerc de Buffon est né à Montbard1147 en 1707 et mort à Paris en 1788. Dès 1739, après avoir publié d’importants travaux, il entrait à l’Académie des sciences et était nommé intendant du jardin du Roi1148. Son Histoire naturelle, également remarquable par l’éclat des descriptions, par la profondeur de l’esprit philosophique qui anime cette vaste composition et par les idées générales qui en font l’unité, lui assure, ainsi que son fameux Discours sur le style, prononcé lors de sa réception à l’Académie française (1753), une place parmi nos plus grands prosateurs. Ses contemporains ont dit de lui que son génie égalait la majesté de la nature.
L’âne1149 §
Pourquoi tant de mépris pour cet animal si bon, si patient, si sobre, si utile ? Les hommes mépriseraient-ils jusque dans les animaux ceux qui les servent trop bien et à trop peu de frais ? On donne au cheval de l’éducation, on le soigne, on l’instruit, on l’exerce, tandis que l’âne, abandonné à la grossièreté du dernier des valets ou à la malice des enfants, bien loin d’acquérir, ne peut que perdre par son éducation ; et s’il n’avait pas un grand fonds de bonnes qualités, il les perdrait en effet par la manière dont on le traite : il est le jouet, le plastron, le bardeau1150 des rustres qui le conduisent le bâton à la main, qui le frappent, le surchargent, l’excèdent sans précaution, sans ménagement. On ne fait pas attention que l’âne serait par lui-même, et pour nous, le premier, le plus beau, le mieux fait, le plus distingué des animaux, si dans le monde il n’y avait point de cheval ; il est le second au lieu d’être le premier, et par cela seul il semble n’être plus rien. C’est la comparaison qui le dégrade : on le regarde, on le juge, non pas en lui-même, mais relativement au cheval ; on oublie qu’il est âne, qu’il a toutes les qualités de sa nature, tous les dons attachés à son espèce, et on ne pense qu’à la figure et aux qualités du cheval, qui lui manquent et qu’il ne doit pas avoir.
Il est de son naturel, aussi humble, aussi patient, aussi tranquille que le cheval est fier, ardent, impétueux ; il souffre avec constance, et peut-être avec courage, les châtiments et les coups : il est sobre et sur la quantité et sur la qualité de la nourriture ; il se contente des herbes les plus dures, les plus désagréables, que le cheval et les autres animaux lui laissent et dédaignent : il est fort délicat sur l’eau, il ne veut boire que de la plus claire et aux ruisseaux qui lui sont connus. Il boit aussi sobrement qu’il mange… Il est susceptible d’éducation, et l’on en a vu d’assez bien dressés pour faire curiosité de spectacle.
Dans la première jeunesse il est gai, et même assez joli ; il a de la légèreté et de la gentillesse ; mais il la perd bientôt, soit par l’âge, soit par les mauvais traitements, et il devient lent, indocile et têtu.
(Histoire naturelle : Quadrupèdes ; animaux domestiques.)
Le chameau §
Les Arabes regardent le chameau comme un présent du ciel, un animal sacré, sans le secours duquel ils ne pourraient ni subsister, ni commercer, ni voyager. Le lait des chameaux fait leur nourriture ordinaire ; ils en mangent aussi la chair, surtout celle des jeunes, qui est très bonne à leur goût ; le poil de ces animaux, qui est fin et moelleux et qui se renouvelle tous les ans par une mue complète, leur sert à faire les étoffes dont ils se vêtissent1151 et se meublent. Avec leurs chameaux, non seulement ils ne manquent de rien, mais même ils ne craignent rien ; ils peuvent mettre en un seul jour cinquante lieues de désert entre eux et leurs ennemis ; toutes les armées du monde périraient à la suite d’une troupe d’Arabes ; aussi ne sont-ils soumis qu’autant qu’il leur plaît. Qu’on se figure un pays sans verdure et sans eau, un soleil brûlant, un ciel toujours sec, des plaines sablonneuses, des montagnes encore plus arides, sur lesquelles l’œil s’étend et le regard se perd sans pouvoir s’arrêter sur aucun objet vivant ; une terre morte et, pour ainsi dire, écorchée par les vents, laquelle ne présente que des ossements, des cailloux jonchés, des rochers debout ou renversés, un désert entièrement découvert, où le voyageur n’a jamais respiré sous l’ombrage, où rien ne l’accompagne, rien ne lui rappelle la nature vivante : solitude absolue, mille fois plus affreuse que celle des forêts ; car les arbres sont encore des êtres pour l’homme qui se voit seul ; plus isolé, plus dénué, plus perdu dans ces lieux vides et sans bornes, il voit partout l’espace comme son tombeau ; la lumière du jour, plus triste que l’ombre de la nuit1152, ne renaît que pour éclairer sa nudité, son impuissance, et pour lui présenter l’horreur de sa situation, en reculant à ses yeux les barrières du vide, en étendant autour de lui l’abîme de l’immensité qui le sépare de la terre habitée : immensité qu’il tenterait en vain de parcourir ; car la faim, la soif et la chaleur brûlante pressent1153 tous les instants qui lui restent entre le désespoir et la mort.
Cependant l’Arabe, à l’aide du chameau, a su franchir et même s’approprier ces lacunes de la nature1154, elles lui servent d’asile, elles assurent son repos et le maintiennent dans son indépendance. Mais de quoi les hommes savent-ils user sans abus ? ce même Arabe, libre, indépendant, tranquille, et même riche, au lieu de respecter ces déserts comme les remparts de sa liberté, les souille par le crime ; il les traverse pour aller chez les nations voisines, enlever des esclaves et de l’or ; il s’en sert pour exercer son brigandage, dont malheureusement il jouit plus encore que de sa liberté ; car ses entreprises sont presque toujours heureuses : malgré la défiance de ses voisins et la supériorité de leurs forces, il échappe à leur poursuite et emporte impunément tout ce qu’il leur a ravi. Un Arabe qui se destine à ce métier de pirate de terre, s’endurcit de bonne heure à la fatigue des voyages, il s’essaye à se passer du sommeil, à souffrir la faim, la soif et la chaleur ; en même temps il instruit ses chameaux, il les élève et les exerce dans cette même vue ; peu de jours après leur naissance, il leur plie les jambes sous le ventre, il les contraint à demeurer à terre, et les charge, dans cette situation, d’un poids assez fort qu’il les accoutume à porter et qu’il ne leur ôte que pour leur en donner un plus fort. Au lieu de les laisser paître à toute heure et boire à leur soif, il commence par régler leurs repas, et peu à peu les éloigne à de grandes distances, en diminuant aussi la quantité de la nourriture. Lorsqu’ils sont un peu forts, il les exerce à la course, il les excite par l’exemple des chevaux et parvient à les rendre aussi légers et plus robustes. Enfin, dès qu’il est sûr de la force, de la légèreté et de la sobriété de ses chameaux, il les charge de ce qui est nécessaire à sa subsistance et à la leur ; il part avec eux, arrive sans être attendu aux confins du désert, arrête les premiers passants, pille les habitations écartées, charge ses chameaux de son butin ; et s’il est poursuivi, s’il est forcé de précipiter sa retraite, c’est alors qu’il développe tous ses talents et les leurs : monté sur un des plus légers, il conduit la troupe, la fait marcher jour et nuit, presque sans s’arrêter, ni boire, ni manger ; il fait aisément trois cents lieues en huit jours, et pendant tout ce temps de fatigue et de mouvement il laisse ses chameaux chargés ; il ne leur donne chaque jour qu’une heure de repos et une pelote de pâte. Souvent ils courent ainsi neuf ou dix jours sans trouver de l’eau ; ils se passent de boire, et lorsque par hasard il se trouve une mare à quelque distance de la route, ils sentent l’eau de plus d’une demi-lieue ; la soif qui les presse leur fait doubler le pas et ils boivent en une seule fois pour tout le temps passé et pour autant de temps à venir, car souvent leurs voyages sont de plusieurs semaines et leurs temps d’abstinence durent aussi longtemps que leurs voyages.
(Histoire naturelle. Quadrupèdes. Du chameau et du dromadaire.)
J.-J. Rousseau
(1712-1778) §
Jean-Jacques Rousseau est né à Genève le 28 juin 1712 et mort à Ermenonville, près de Paris, le 2 juillet 1778. C’est seulement à trente-huit ans qu’après s’être essayé à bien des métiers divers, sans avoir pu parvenir, malgré la protection de personnages illustres ou puissants, à se faire connaître du public, il conquit tout d’un coup la célébrité en publiant un discours paradoxal et brillant sur cette question proposée par l’Académie de Dijon : « Si le rétablissement des sciences et des lettres a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ». Rousseau démontra que la civilisation avait été plus nuisible qu’utile à l’humanité. Cette même idée fait encore le fond d’ouvrages d’ailleurs fort différents entre eux, le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), la Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1758), le Contrat social (1762), Emile ou de l’éducation (1762). Il faut enfin citer, pour compléter la liste des plus importants ouvrages de Rousseau, le roman de Julie ou la Nouvelle Héloïse (1760), ses trop hardies Confessions et le délicieux ouvrage qui les complète, les Rêveries du promeneur solitaire. Les plus belles pages de Rousseau lui ont été inspirées par son amour ardent de la nature, et c’est à lui que se rattachent en quelque manière les écrivains, si nombreux au xixe siècle, qui ont donné dans leur œuvre une grande place à l’expression de ce sentiment.
La peur §
J’étais1155 à la campagne en pension chez un ministre1156 appelé M. Lambercier ; j’avais pour camarade un cousin plus riche que moi, et qu’on traitait en héritier, tandis qu’éloigné de mon père1157, je n’étais qu’un pauvre orphelin. Mon grand cousin Bernard était singulièrement poltron, surtout la nuit. Je me moquai tant de sa frayeur, que M. Lambercier, ennuyé de mes vanteries, voulut mettre mon courage à l’épreuve. Un soir d’automne qu’il faisait très obscur, il me donna la clé du temple, et me dit d’aller chercher dans la chaire la Bible qu’on y avait laissée. Il ajouta, pour me piquer d’honneur, quelques mots qui me mirent dans l’impuissance de reculer.
Je partis sans lumière : si j’en avais eu, ç’aurait peut-être été pis encore. Il fallait passer par le cimetière ; je le traversai gaillardement ; car tant que je me sentais en plein air, je n’eus jamais de frayeurs nocturnes.
En ouvrant la porte, j’entendis à la voûte un certain retentissement que je crus ressembler à des voix, et qui commença d’ébranler ma fermeté romaine1158. La porte ouverte, je voulus entrer ; mais à peine eus-je fait quelques pas, que je m’arrêtai. En apercevant l’obscurité profonde qui régnait dans ce vaste lieu, je fus saisi d’une terreur qui me fit dresser les cheveux : je rétrograde, je sors, je me mets à fuir tout tremblant. Je trouvai dans la cour un petit chien, nommé Sultan, dont les caresses me rassurèrent. Honteux de ma frayeur, je revins sur mes pas, tâchant pourtant d’emmener avec moi Sultan qui ne voulut pas me suivre. Je franchis brusquement la porte ; j’entre dans l’église. A peine y fus-je rentré, que la frayeur me reprit, mais si fortement que je perdis la tête ; et, quoique la chaire fût à droite et que je le susse très bien, ayant tourné sans m’en apercevoir, je la cherchai longtemps à gauche. Je m’embarrassais dans les bancs ; je ne savais plus ou j’étais ; et, ne pouvant trouver ni la chaire ni la porte, je tombai dans un bouleversement inexprimable. Enfin, j’aperçois la porte, je viens à bout de sortir du temple, et je m’en éloigne comme la première fois, bien résolu de n’y jamais rentrer seul qu’en plein jour.
Je reviens jusqu’à la maison. Prêt à entrer, je distingue la voix de M. Lambercier à de grands éclats de rire. Je les prends pour moi d’avance ; et, confus de m’y voir exposé, j’hésite à ouvrir la porte. Dans cet intervalle, j’entends Mlle Lambercier1159 s’inquiéter de moi, dire à la servante de prendre la lanterne, et M. Lambercier se disposer à me venir chercher, escorté de mon intrépide cousin, auquel ensuite on n’aurait pas manqué de faire tout l’honneur de l’expédition. A l’instant toutes mes frayeurs cessent et ne me laissent que celle d’être surpris dans ma fuite : je cours, je vole au temple ; sans m’égarer, sans tâtonner, j’arrive à la chaire ; j’y monte, je prends la Bible, je m’élance en bas ; dans trois sauts je suis hors du temple, dont j’oubliai même de fermer la porte ; j’entre dans la chambre hors d’haleine ; je jette la Bible sur la table, effaré, mais palpitant d’aise d’avoir prévenu le secours qui m’était destiné.
(Émile ou de l’Éducation, livre II)
Les chansons de Tante Suson §
Hors le temps que je passais à lire ou à écrire auprès de mon père, j’étais toujours avec ma tante1160, à la voir broder, à l’entendre chanter, assis ou debout à côté d’elle ; et j’étais content. Son enjouement, sa douceur, sa figure agréable, m’ont laissé de si fortes impressions, que je vois encore son air, son regard, son attitude ; je me souviens de ses petits propos caressants ; je dirais comment elle était vêtue et coiffée, sans oublier les deux crochets que ses cheveux noirs faisaient sur ses tempes selon la mode de ce temps-là.
Je suis persuadé que je lui dois le goût ou plutôt la passion pour la musique qui ne s’est bien développée en moi que longtemps après1161. Elle savait une quantité prodigieuse d’airs et de chansons qu’elle chantait avec un filet de voix fort douce. La sérénité d’âme de cette excellente fille éloignait d’elle et de tout ce qui l’environnait la rêverie et la tristesse. L’attrait que son chant avait pour moi fut tel, que non seulement plusieurs de ses chansons me sont toujours restées dans la mémoire, mais qu’il m’en revient même, aujourd’hui que je l’ai perdue1162, qui, totalement oubliées depuis mon enfance, se retracent, à mesure que je vieillis, avec un charme que je ne puis exprimer. Dirait-on que moi, vieux radoteur, rongé de soucis et de peines, je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant en marmottant ces petits airs d’une voix déjà cassée et tremblante ? Il y en a un surtout qui m’est bien revenu tout entier quant à l’air ; mais la seconde moitié des paroles s’est constamment refusée à tous mes efforts pour me la rappeler, quoiqu’il m’en revienne confusément les rimes.
Je cherche où est le charme attendrissant que mon cœur trouve à cette chanson : c’est un caprice auquel je ne comprends rien ; mais il m’est de toute impossibilité de la chanter jusqu’à la fin sans être arrêté par mes larmes. J’ai cent fois projeté d’écrire à Paris pour faire chercher le reste des paroles, si tant est que quelqu’un les connaisse encore. Mais je suis presque sûr que le plaisir que je prends à me rappeler cet air s’évanouirait en partie, si j’avais la preuve que d’autres que ma pauvre tante Suson l’ont chanté,
(Les Confessions, première partie, livre I, 1719-1723.)
Les voyages a pied §
Je ne conçois qu’une manière de voyager plus agréable que d’aller à cheval, c’est d’aller à pied. On part à son moment, on s’arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d’exercice qu’on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche ; on examine tout ce qui nous flatte ; on s’arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie ; un bois touffu, je vais sous son ombre ; une grotte, je la visite ; une carrière, j’examine les minéraux. Partout où je me plais, j’y reste. A l’instant que1163 je m’ennuie, je m’en vais. Je ne dépends ni des chevaux, ni du postillon. Je n’ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes ; je passe partout où un homme peut passer ; je vois tout ce qu’un homme peut voir ; et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir....
Voyager à pied, c’est voyager comme Thalès, Platon et Pythagore1164. J’ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement, et s’arracher à l’examen des richesses qu’il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue.
Qui est-ce qui, aimant un peu l’agriculture, ne veut pas connaître les productions particulières au climat des lieux qu’il traversé, et la manière de les cultiver ? Qui est-ce qui, ayant un peu de goût pour l’histoire naturelle, peut se résoudre à passer1165 un terrain sans l’examiner, un rocher sans l’écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles ? Vos philosophes de ruelles1166 étudient l’histoire naturelle dans des cabinets1167 ; ils ont des colifichets1168, ils savent des noms, et n’ont aucune idée de la nature. Mais notre cabinet est plus riche que ceux des rois ; ce cabinet est la terre entière. Chaque chose y est à sa place ; le naturaliste qui en prend soin a rangé le tout dans un fort bel ordre : Daubenton1169 ne ferait pas mieux.
Combien de plaisirs différents on rassemble par cette agréable manière de voyager ! sans compter la santé qui s’affermit, l’humeur qui s’égaye. J’ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces, rêveurs, tristes, grondants ou souffrants ; et les piétons toujours gais et contents de tout. Combien le cœur rit quand on approche du gîte ! combien un repas grossier parait savoureux ! avec quel plaisir on se repose à table ! quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit ! Quand on ne veut qu’arriver, on peut courir en chaise de poste1170, mais, quand on veut voyager, il faut aller à pied.
(Émile ou de l’Éducation, livre V.)
En Suisse §
Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis un jour du côté de la Robaila1171. J’étais seul, je m’enfonçai dans les anfractuosités de la montagne ; et, de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché, que je n’ai vu de ma vie un aspect plus sauvage. De noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux, dont plusieurs tombés de vieillesse et entrelacés les uns dans les autres, fermaient ce réduit de barrières impénétrables ; quelques intervalles, que laissait cette sombre enceinte, n’offraient au-delà que des roches coupées à pic et d’horribles précipices, que je n’osais regarder qu’en me couchant sur le ventre. Le duc, la chevêche et l’orfraie1172 faisaient entendre leurs cris dans les fentes de la montagne ; quelques petits oiseaux, rares1173, mais familiers, tempéraient cependant l’horreur de cette solitude… Je me mis à rêver, en pensant que j’étais là dans un refuge ignoré de tout l’univers. Un mouvement d’orgueil se mêla bientôt à cette rêverie. Je me comparais à ces grands voyageurs qui découvrent une île déserte, et je me disais avec complaisance : « Sans doute je suis le premier mortel qui ait pénétré jusqu’ici ». Je me regardais presque comme un autre Colomb1174. Tandis que je me pavanais1175 dans cette idée, j’entendis peu loin de moi un certain cliquetis que je crus reconnaître ; j’écoute : le même bruit se répète et se multiplie. Surpris et curieux, je me lève, je perce à travers un fourré débroussailles du côté d’où venait le vent, et dans une combe1176, à vingt pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier, j’aperçois une manufacture de bas....
Qui jamais eût dû s’attendre à trouver une manufacture dans un précipice ! Il n’y a que la Suisse au monde qui présente ce mélange de la nature sauvage et de l’industrie humaine. La Suisse entière n’est, pour ainsi dire, qu’une grande ville, dont les rues, larges et longues plus que celle de Saint-Antoine1177, sont semées de forêts, coupées de montagnes, et dont les maisons éparses et isolées ne communiquent entre elles que par des jardins anglais. Je me rappelai à ce sujet une autre herborisation que nous1178 avions faite il y avait quelque temps sur la montagne de Chasseron, du sommet de laquelle on découvre sept lacs1179. On nous dit qu’il n’y avait qu’une seule maison sur cette montagne, et nous n’eussions sûrement pas deviné la profession de celui qui l’habitait, si l’on n’eût ajouté que c’était un libraire, et qui même faisait fort bien ses affaires dans le pays. Il me semble qu’un seul fait de cette espèce fait mieux connaître la Suisse que toutes les descriptions des voyageurs.
(Les Rêveries du promeneur solitaire, septième promenade.)
Les oublies1180 §
Un dimanche1181 nous étions allés, ma femme et moi, dîner à la porte Maillot : après le dîner, nous traversâmes le bois de Boulogne jusqu’à la Muette ; là, nous nous assîmes sur l’herbe à l’ombre en attendant que le soleil fût baissé, pour nous en retourner ensuite tout doucement par Passy1182. Une vingtaine de petites filles, conduites par une manière1183 de religieuse, vinrent les unes s’asseoir, les autres folâtrer assez près de nous. Durant leurs jeux vint à passer un oublieur avec son tambour et son tourniquet1184, qui cherchait pratique : je vis que les petites filles convoitaient fort les oublies, et deux ou trois d’entre elles, qui apparemment possédaient quelques liards1185, demandèrent la permission de jouer. Tandis que la gouvernante1186 hésitait et disputait, j’appelai l’oublieur et je lui dis : « Faites tirer toutes ces demoiselles chacune à son tour ; et je vous payerai le tout ». Ce mot répandit dans toute la troupe une joie qui seule eut plus que payé ma bourse, quand je l’aurais toute employée à cela.
Comme je vis qu’elles s’empressaient avec un peu de confusion, avec l’agrément de la gouvernante, je les fis ranger toutes d’un côté, et puis passer de l’autre côté l’une après l’autre à mesure qu’elles avaient tiré. Quoiqu’il n’y eût point de billet blanc1187, et qu’il revînt au moins une oublie à chacune de celles qui n’auraient rien, qu’aucune d’elles ne pouvait donc être absolument mécontente, afin de rendre la fête encore plus gaie, je dis en secret à l’oublieur d’user de son adresse ordinaire en sens contraire en faisant tomber autant de bons lots qu’il pourrait, et que je lui en tiendrais compte. Au moyen de cette prévoyance, il y eut plus d’une centaine d’oublies distribuées, quoique les jeunes filles ne tirassent chacune qu’une seule fois ; car là-dessus je fus inexorable, ne voulant ni favoriser des abus, ni marquer des préférences qui produiraient des mécontentements. Ma femme insinua à celles qui avaient de bons lots d’en faire part à leurs camarades, au moyen de quoi le partage devint presque égal, et la joie plus générale.
Je priai la religieuse de tirer à son tour, craignant fort qu’elle ne rejetât dédaigneusement mon offre ; elle l’accepta de bonne grâce, tira comme les pensionnaires, et prit sans façon ce qui lui revint. Je lui en sus un gré infini, et je trouvai à cela une sorte de politesse qui me plut fort, et qui vaut bien, je crois, celle des simagrées1188. Pendant toute cette opération, il y eut des disputes qu’on porta devant mon tribunal ; et ces petites filles, venant plaider tour à tour leur cause, me donnèrent occasion de remarquer que, quoiqu’il n’y en eût aucune de jolie, la gentillesse de quelques unes faisait oublier leur laideur.
Nous nous quittâmes enfin très contents les uns des autres, et cet après midi fut un de ceux de ma vie dont je me rappelle le souvenir avec le plus de satisfaction. La fête, au reste, ne fut pas ruineuse : pour trente sous qu’il m’en coûta tout au plus, il y eut pour plus de cent écus de contentement, tant il est vrai que le plaisir ne se mesure pas sur la dépense.
(Les Rêveries du promeneur solitaire. Neuvième promenade.)
La campagne §
Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais1189 une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts ; et, quoique une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préférerais magnifiquement1190, non la triste ardoise, mais la tuile, parce qu’elle a l’air plus propre et plus gai que le chaume, qu’on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays, et que cela me rappellerait un peu l’heureux temps de ma jeunesse. J’aurais pour cour une basse-cour, et pour écurie une étable avec des vaches, pour avoir du laitage, que j’aime beaucoup. J’aurais un potager pour jardin, et pour parc un joli verger. Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seraient ni comptés ni cueillis par mon jardinier, et mon avare magnificence n’étalerait point aux yeux des espaliers superbes auxquels à peine on osât toucher. Or cette petite prodigalité serait peu coûteuse, parce que j’aurais choisi mon asile dans quelque province éloignée où l’on voit peu d’argent et beaucoup de denrées, et où règnent l’abondance et la pauvreté.
Là, je rassemblerais une société, plus choisie que nombreuse, d’amis aimant le plaisir et s’y connaissant, de femmes qui pussent sortir de leur fauteuil et se prêter aux jeux champêtres, prendre quelquefois, au lieu de la navette et des cartes1191, la ligne, les gluaux1192, le râteau des faneuses et le panier des vendangeurs. Là, tous les airs de la ville seraient oubliés, et, devenus villageois au village, nous nous trouverions livrés à des foules d’amusements divers, qui ne nous donneraient chaque soir que l’embarras du choix pour le lendemain. L’exercice et la vie active nous feraient un nouvel estomac et de nouveaux goûts. Tous nos repasseraient des festins, où l’abondance plairait plus que la délicatesse. La gaieté, les travaux rustiques, les folâtres jeux sont les premiers cuisiniers du monde, et les ragoûts fins sont bien ridicules à des gens en haleine depuis le lever du soleil. Le service n’aurait pas plus d’ordre que d’élégance ; la salle à manger serait partout, dans le jardin, dans un bateau, sous un arbre ; quelquefois au loin, près d’une source vive, sur l’herbe verdoyante et fraîche, sous des touffes d’aunes et de coudriers ; une longue procession de gais convives porterait en chantant l’apprêt du festin ; on aurait le gazon pour table et pour chaises ; les bords de la fontaine serviraient de buffet, et le dessert pendrait aux arbres. Les mets seraient servis sans ordre, l’appétit dispenserait des façons : chacun, se préférant ouvertement à tout autre, trouverait bon que tout autre se préférât de même à lui ; de cette familiarité cordiale et modérée naîtrait, sans grossièreté, sans fausseté, sans contrainte, un conflit badin, plus charmant cent fois que la politesse1193 et plus fait pour lier les cœurs. Point d’importun laquais épiant nos discours, critiquant tout bas nos maintiens, comptant nos morceaux d’un œil avide, s’amusant à nous faire attendre à boire, et murmurant d’un trop long dîner. Nous serions nos valets pour être nos maîtres ; chacun serait servi par tous ; le temps passerait sans le compter1194, le repas serait le repos et durerait autant que l’ardeur du jour. S’il passait près de nous quelque paysan retournant au travail, ses outils sur l’épaule, je lui réjouirais le cœur par quelques bons propos, par quelques coups de bon vin, qui lui feraient porter plus gaiement sa misère ; et moi, j’aurais aussi le plaisir de me sentir émouvoir un peu les entrailles, et de me dire en secret : « Je suis encore homme1195 ».
Si quelque fête champêtre rassemblait les habitants du lieu, j’y serais des premiers avec ma troupe1196. Si quelques mariages, plus bénis du ciel que ceux des villes, se faisaient à mon voisinage1197, on saurait que j’aime la joie, et j’y serais invité. Je porterais à ces bonnes gens quelques dons simples comme eux, qui contribueraient à la fête, et j’y trouverais en échange des biens d’un prix inestimable, des biens si peu connus de mes égaux, la franchise et le vrai plaisir. Je souperais gaiement au bout de leur longue table ; j’y ferai chorus au refrain d’une vieille chanson rustique, et je danserais dans leur grange de meilleur cœur qu’au bal de l’Opéra.
(Emile, livre IV.)
Le pot de beurre
A M. Le Comte De Lastic1198 §
Paris, le 29 décembre 1754.
Sans avoir l’honneur, monsieur, d’être connu de vous, j’espère qu’ayant à vous offrir des excuses et de l’argent, ma lettre ne saurait être mal reçue.
J’apprends que Mlle de Cléry a envoyé de Blois un panier à une bonne vieille femme, nommée madame Le Vasseur1199 et si pauvre qu’elle demeure chez moi ; que ce panier contenait, entre autres choses, un pot de vingt livres de beurre ; que le tout est parvenu, je ne sais comment, dans votre cuisine ; que la bonne vieille, l’ayant appris, a eu la simplicité de vous envoyer sa fille, avec la lettre d’avis1200, vous demander son beurre ou le prix qu’il a coûté, et qu’après vous être moqué d’elle, selon l’usage, vous et madame votre épouse, vous avez, pour toute réponse, ordonné à vos gens de la chasser.
J’ai tâché de consoler la bonne femme affligée, en lui expliquant les règles du grand monde et de la grande éducation ; je lui ai prouvé que ce ne serait pas la peine d’avoir des gens, s’ils ne servaient à chasser le pauvre quand il vient réclamer son bien ; et, en lui montrant combien justice et humanité sont des mots roturiers1201, je lui ai fait comprendre, à la fin, qu’elle est trop honorée qu’un comte ait mangé son beurre. Elle me charge donc, monsieur, de vous témoigner sa reconnaissance de l’honneur que vous lui avez fait, son regret de l’importunité qu’elle vous a causé, et le désir qu’elle aurait que son beurre vous eût paru bon.
Que si, par hasard, il vous en a coûté quelque chose pour le port du paquet à cette adresse, elle offre de vous le rembourser, comme il est juste. Je n’attends là-dessus que vos ordres pour exécuter ses intentions, et vous supplie d’agréer les sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être, etc1202.
(Correspondance.)
Les délices de la solitude §
Quand mes douleurs me font tristement mesurer la longueur des nuits, et que l’agitation de la fièvre m’empêche de goûter un seul instant de sommeil, souvent je me distrais de mon état présent en songeant aux divers événements de ma vie ; et les repentirs, les doux souvenirs, les regrets, l’attendrissement se partagent le soin de me faire oublier quelques moments mes souffrances. Quels temps croiriez-vous, monsieur1203, que je me rappelle le plus souvent et le plus volontiers dans mes rêves ? Ce ne sont point les plaisirs de ma jeunesse ; ils furent trop rares, trop mêlés d’amertume, et sont déjà trop loin de moi. Ce sont ceux de ma retraite1204, ce sont mes promenades solitaires, ce sont ces jours rapides, mais délicieux, que j’ai passés tout entiers avec moi seul, avec ma bonne et simple gouvernante1205, avec mon chien bien-aimé, ma vieille chatte, avec les oiseaux de la campagne et les biches de la forêt, avec la nature entière et son inconcevable auteur.
En me levant avant le soleil pour aller voir, contempler son lever dans mon jardin, quand je voyais commencer une belle journée, mon premier souhait était que ni lettres, ni visites n’en vinssent troubler le charme. Après avoir donné la matinée à divers soins que je remplissais tous avec plaisir parce que je pouvais1206 les remettre à un autre temps, je me hâtais de dîner pour échapper aux importuns, et me ménager un plus long après-midi. Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil avec le fidèle Achate1207, pressant le pas dans la crainte que quelqu’un ne vînt s’emparer de moi avant que j’eusse pu m’esquiver. Mais quand une fois j’avais pu doubler un certain coin, avec quel battement de cœur, avec quel pétillement de joie je commençais à respirer en me sentant sauvé, en me disant : « Me voilà maître de moi pour le reste de ce jour ! » J’allais alors d’un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la forêt, quelque lieu désert où rien ne montrant la main des hommes n’annonçât la servitude et la domination, quelque asile où je pusse croire avoir pénétré le premier et où nul tiers importun ne vînt s’interposer entre la nature et moi.
C’était là qu’elle semblait déployer à mes yeux une magnificence toujours nouvelle. L’or des genêts et la pourpre des bruyères frappaient mes yeux d’un luxe qui touchait mon cœur ; la majesté des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m’environnaient, l’étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds tenaient mon esprit dans une alternative continuelle d’observation et d’admiration : le concours de tant d’objets intéressants qui se disputaient mon attention, m’attirant sans cesse de l’un à l’autre, favorisait mon humeur rêveuse et paresseuse, et me faisait souvent redire en moi-même : « Non, Salomon dans toute sa gloire ne fut jamais vêtu comme l’un d’eux1208 »....
Bientôt de la surface de la terre j’élevais mes idées à tous les êtres de la nature, au système universel des choses, à l’être incompréhensible qui embrasse tout. Alors, l’esprit perdu dans cette immensité, je ne philosophais pas ; je me sentais, avec une sorte de volupté, accablé du poids de cet univers ; je me livrais avec ravissement à la contusion de ces grandes idées, j’aimais à me perdre en imagination dans l’espace ; mon cœur resserré dans les bornes des êtres s’y trouvait trop à l’étroit ; j’étouffais dans l’univers ; j’aurais voulu m’élancer dans l’infini. Je crois que si j’eusse dévoilé tous les mystères de la nature, je me serais senti dans une situation moins délicieuse que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue, et qui, dans l’agitation de mes transports, me faisait écrier quelquefois : « O grand Être ! O grand Être ! » sans pouvoir dire ni penser rien de plus.
Ainsi s’écoulaient dans un délire continuel les journées les plus charmantes que jamais créature humaine ait passées ; et, quand le coucher du soleil me faisait songer à la retraite, étonné de la rapidité du temps, je croyais n’avoir pas assez mis à profit ma journée, je pensais en pouvoir jouir davantage encore ; et, pour réparer le temps perdu, je me disais : « Je reviendrai demain. »
Je revenais à petits pas, la tête un peu fatiguée, mais le cœur content ; je me reposais agréablement au retour, en me livrant à l’impression des objets, mais sans penser, sans imaginer, sans rien faire autre chose que sentir le calme et le bonheur de ma situation. Je trouvais mon couvert mis sur ma terrasse. Je soupais de grand appétit dans mon petit domestique1209 ; nulle image de servitude et de dépendance ne troublait la bienveillance qui nous unissait tous. Mon chien lui-même était mon ami, non mon esclave : nous avions toujours la même volonté, mais jamais il ne m’a obéi....
Enfin, après avoir fait encore quelques tours dans mon jardin ou chanté quelque air sur mon épinette1210, je trouvais dans mon lit un repos de corps et d’âme cent fois plus doux que le sommeil même.
Ce sont là les jours qui ont fait le vrai bonheur de ma vie ; bonheur sans amertume, sans ennuis, sans regrets, et auquel j’aurais borné volontiers tout celui de mon existence.
(Correspondance, lettre du 26 janvier 1762.)
Diderot
(1713-1784) §
Né à Langres en 1713, mort à Paris en 1784, Denis Diderot est un des esprits les plus brillants, les plus étendus et en même temps les plus profonds que le xviiie siècle ait produits. Il eut la plus grande part à la rédaction de l’Encyclopédie1211, publiée avec la collaboration de d’Alembert et de tout ce que le parti philosophique contenait de plus illustre. Parmi ses autres ouvrages, trop nombreux et trop divers pour être seulement cités, mentionnons seulement ses Salons, renfermant la description critique des principaux tableaux exposés dans les années 1759-1771, 1775, 17811212, le Paradoxe sur le comédien, dialogue sur le rôle de la réflexion et du sentiment dans la composition et l’interprétation des œuvres d’art et des œuvres littéraires, la brillante fantaisie du Neveu de Rameau, enfin une correspondance pleine de vivacité et d’intérêt, que nous ne possédons malheureusement pas complètement.
Regrets sur une vieille robe de chambre §
Pourquoi ne l’avoir pas gardée ? Elle était faite à moi ; j’étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner ; j’étais pittoresque et beau. L’autre, raide, empesée, me mannequine1213. Il n’y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêtât ; car l’indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière, un de ses pans s’offrait à l’essuyer. L’encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume, elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services qu’elle m’avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l’écrivain, l’homme qui travaille. À présent, j’ai l’air d’un riche fainéant ; on ne sait qui je suis.
Sous son abri je ne redoutais ni la maladresse d’un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l’eau. J’étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre ; je suis devenu l’esclave de la nouvelle.
Le dragon qui surveillait la toison d’or1214 ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci m’enveloppe....
Je ne pleure pas, je ne soupire pas ; mais à chaque instant je dis : Maudit soit celui qui inventa l’art de donner du prix à l’étoffe commune en la teignant en écarlate ! Maudit soit le précieux vêtement que je révère ! Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calmande1215 ?
Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l’atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises ; l’opulence a sa gêne....
Ce n’est pas tout, mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d’un luxe conséquent1216. Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m’environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de Bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure1217, clouées par les angles sur cette tapisserie ; entre ces estampes, trois ou quatre plâtres suspendus formaient avec ma vieille robe de chambre l’indigence la plus harmonieuse.
Tout est désaccordé. Plus d’ensemble, plus d’unité, plus de beauté....
J’ai vu la bergame1218 céder la muraille, à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, à la tenture de damas ; deux estampes qui n’étaient pas sans mérite : la Chute de la manne dans le désert du Poussin1219 et l’Esther devant Assuérus du même, l’une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c’est la triste Esther ; la Chute de la manne dissipée par une Tempête de Vernet ; la chaise de paille reléguée dans l’antichambre par le fauteuil de maroquin ; Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulager le faible sapin courbé sous leur masse, et se renfermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d’eux que de moi ; une grande glace s’emparer du manteau de ma cheminée ; ces deux jolis plâtres que je tenais de l’amitié de Falconet, et qu’il avait réparés lui-même, déménagés par une Vénus accroupie1220 : l’argile moderne brisée par le bronze antique. La table de bois disputait encore le terrain, à l’abri d’une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle, et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l’injure qui la menaçait. Un jour elle subit son sort, et, en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres1221 d’un bureau précieux.
Instinct funeste des convenances ! Tact délicat et ruineux, goût sublime, qui change1222, qui déplace, qui édifie, qui renverse, qui vide les coffres des pères, qui laisse les filles sans dot, les fils sans éducation, qui fait tant de belles choses et de si grands maux ; toi qui substitues chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois, c’est toi qui perds les nations, c’est toi qui peut-être un jour conduiras mes effets sur le pont Saint-Michel, où l’on entendra la voix enrouée d’un juré crieur1223 dire : « À vingt louis une Vénus accroupie ! »
L’intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la Tempête de Vernet, qui est au-dessus, faisait un vide désagréable à l’œil. Ce vide fut rempli par une pendule ; et quelle pendule encore ! une pendule à la Geoffrin1224, une pendule où l’or contraste avec le bronze.
Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire, qu’il obtint.
Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens ; il fut rempli par deux La Grenée1225.
Ici est une Magdeleine du même artiste ; là, c’est une esquisse ou de Vien ou de Machy ; car je donnai aussi dans les esquisses. Et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain1226. J’insulte ainsi à la misère nationale.
De ma médiocrité première il n’est resté qu’un tapis de lisières1227. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j’ai juré et je jure que je réserverai ce tapis, comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots1228. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j’entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j’aperçois mon ancien tapis de lisières : il me rappelle mon premier état, et l’orgueil s’arrête à l’entrée de mon cœur. Non, mon ami, non, je ne suis point corrompu. Ma porte s’ouvre toujours au besoin qui s’adresse à moi ; il me trouve la même affabilité. Je l’écoute, je le conseille, je le secours, je le plains. Mon âme ne s’est point endurcie, ma tête ne s’est point relevée1229. Mon dos est bon et rond, comme ci-devant. C’est le même ton de franchise ; c’est la même sensibilité.
Mon luxe est de fraîche daté, et le poison n’a point encore agi. Mais, avec le temps, qui sait ce qui peut arriver ?...
(Miscellanea philosophiques, éd. Assézat, t. IV.)
L’homme de lettres et le financier §
Vous savez que M. Tronchin1230 avait été appelé en poste à Lyon pour la maladie de son associé, et que mes seize mille livres1231 étaient restées entre les mains de M. Colin de Saint-Marc1232… Je reçois de M. Tronchin une lettre pour M. de Saint-Marc. Je la garde sept ou huit jours, parce que les choses d’intérêt ne sont pas celles qui me remuent ; cependant sur les six heures du soir, un jour que j’allai causer avec la chère sœur1233, je me trouve à la porte de l’hôtel des Fermes1234, je me ressouviens de ma lettre, et j’entre. M. de Saint-Marc n’était pas à son bureau, mais il allait y entrer : c’est ce que ses commis me dirent, car ils sont fort polis. En effet il arrive, comme ils me parlaient. Je vais au-devant de M. Colin de Saint-Marc qui ne m’entend pas. M. Colin de Saint-Marc, le chapeau sur la tête, marche ; je le suis presque en courant. Il arrive dans la seconde pièce de son bureau ; il s’assied dans son fauteuil, et je reste droit. Je lui présente ma lettre ; il la prend, l’ouvre, et la lit ; se met à regarder un moment au plafond, et me rendant ma lettre en la jetant sur un coin de sa table, me dit : Je n’ai pas mémoire de cela ; puis il prend une plume, se met à écrire, et me laisse debout, là, sans me parler davantage. Tandis qu’il écrivait sans me regarder, je lui déclinais mon nom, et je lui faisais mon histoire. Sur la fin de cette histoire, mon homme s’arrête, et se tracassant avec un de ses doigts la main droite, il me dit : « Ah ! oui, je me rappelle cela. J’ai touché vos lettres de change1235. Je n’ai point de billets à vous donner. Ils veulent tous de ces billets ; c’est une rage, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quand j’en aurai1236 ; je n’irai point dépouiller pour vous ceux qui en ont. Revenez ; mais ne revenez point demain : dans huit jours, dans un mois, dans deux » ; et puis mon homme se remet à écrire, et moi je m’en vais.
Eh bien, comment cela vous semble-t-il ? Parce que M. Colin de Saint-Marc a cent mille écus de rente, il faut qu’il me traite comme un faquin. J’étais enragé dans ce moment de n’être pas le comte de Charolais1237, ou quelque autre personnage important, et de ne pouvoir renouveler avec M. Colin de Saint-Marc la scène du président de Meinières1238avec un procureur1239 au Parlement. C’était le matin ; il était en redingote, en mauvaise perruque ronde, en bas de laine gris, un mouchoir de soie autour du cou, ce qui n’était pas propre à sauver sa mauvaise mine. Il était pour une somme considérable dans un état1240 de créances que ce procureur ne se pressait pas d’acquitter. Il entre dans l’étude sans façon, il s’adresse au procureur honnêtement, parce que le président de Meinières est l’homme de France le plus doux et le plus honnête, qu’il en a la réputation, et que c’est ainsi que je l’ai vu chez lui et chez moi. « Monsieur, il y a longtemps que j’attends, pourriez-vous me dire quand je serai payé ? — Je n’en sais rien. » Le président était debout, le procureur assis, le président chapeau bas, le procureur la tête couverte de son bonnet ; le président parlait, le procureur écrivait. « Monsieur, c’est que je suis pressé. — Ce n’est pas ma faute. — Cela se peut. Cependant voilà mes titres ; je les ai apportés, et vous m’obligerez de les regarder. — Je n’ai pas le temps. — Monsieur, de grâce, faites-moi ce plaisir. — Je ne saurais, vous dis-je. — Monsieur… — Vous m’interrompez. Est-ce que vous croyez, mon ami, que je n’ai que votre affaire en tête ? Vous serez payé avec les autres. Allez-vous-en, et ne m’ennuyez pas davantage. — Monsieur, je suis fâché de vous ennuyer, mais vous n’êtes pas le premier. — Tant pis il ne faut ennuyer personne.. — Il est vrai, mais il ne faut brusquer personne. — Cela fait le plaisant ! — Le plus plaisant des deux, je vous jure, monsieur, que ce n’est pas moi ; on me doit, j’ai besoin, je voudrais toucher mon argent. Je ne vous demande que de jeter un coup d’œil sur mes titres. — Voyons donc, voyons ces titres ; si on avait affaire à deux hommes comme vous par jour, il faudrait renoncer au métier. » Le président déploie ses titres, et le procureur lit : Monsieur le président de Meinières, etc. ; et aussitôt le voilà qui se lève : « Monsieur le président, je vous demande mille pardons..., je n’avais pas l’honneur de vous connaître… ; sans cela… » Le président le prend par la main, l’éloigne de son fauteuil, s’y place, et lui dit : « Maître un tel, vous êtes un insolent ; il ne s’agit pas de moi, je vous pardonne ; mais je viens de voir la manière indigne et cruelle dont vous en usez avec les malheureux qui ont affaire à vous. Prenez garde à ce que vous ferez à l’avenir ; s’il me revient jamais une plainte sur votre compte, je vous fais perdre un état que vous remplissez si mal. Adieu. » Eh bien, qu’en pensez-vous ? Tandis que M. Colin de Saint-Marc me traitait comme le procureur, n’aurait-il pas été fort doux d’être le. président ? Vous riez de cela, et j’en ris aussi à présent. Mme Le Gendre dit qu’elle se serait assise sur la table de M. Colin de Saint-Marc ; mais on est si surpris, si peu fait à se trouver tout à coup un valet !...
(Correspondance : Lettres à Mlle Volland, 21 juillet 1765.)
Vauvenargues
(1715-1747) §
Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, né à Aix en Provence en 1715, fut forcé par sa mauvaise santé de quitter l’état militaire, dans lequel il s’était cependant distingué, et se consacra tout entier aux lettres, après avoir vainement tenté d’entrer dans la diplomatie. Il mourut à Paris en 1747, à l’âge de trente-deux ans, laissant, outre des lettres et divers opuscules de morale et de critique, une Introduction à la connaissance de l’esprit humain, des Réflexions et maximes et des Caractères, écrits moins remarquables peut-être par l’éclat du style que par la fierté mélancolique, la générosité, la haute moralité dont ils sont tous empreints.
Le travail et l’oisiveté §
Insensés que nous sommes, nous craignons toujours d’être dupes ou de l’activité, ou de la gloire, ou de la vertu ! Mais qui fait plus de dupes véritables que l’oubli de ces mêmes choses ? qui fait des promesses plus trompeuses que l’oisiveté ?
Quand vous êtes de garde au bord d’un fleuve, où la pluie éteint tous les feux pendant la nuit, et pénètre dans vos habits, vous dites : « Heureux qui peut dormir sous une cabane écartée, loin du bruit des eaux ! » Le jour vient, les ombres s’effacent, et les gardes sont relevées ; vous rentrez dans le camp ; la fatigue et le bruit vous plongent dans un doux sommeil, et vous vous levez plus serein pour prendre un repas délicieux, au contraire d’un jeune homme né pour la vertu, que la tendresse d’une mère retient dans les murailles d’une ville forte : pendant que ses camarades dorment sous la toile et bravent les
hasards, celui-ci qui ne risque rien, qui ne fait rien, à qui rien ne manque, ne jouit ni de l’abondance, ni du calme de ce séjour : au sein du repos, il est inquiet et agité ; il cherche les lieux solitaires ; les fêtes, les jeux, les spectacles ne l’attirent point ; la pensée de ce qui se passe en Moravie1241 occupe ses jours, et, pendant la nuit, il rêve des combats qu’on donne sans lui.
Que veux-je dire par ces images ? que la véritable vertu ne peut se reposer ni dans les plaisirs, ni dans l’abondance, ni dans l’inaction : qu’il est vrai que l’activité a ses dégoûts et ses périls ; mais que ces inconvénients, momentanés dans le travail, se multiplient dans l’oisiveté, où un esprit ardent se consume lui-même et s’importune.
(Sur la gloire, second discours.)
Réflexions et maximes §
C’est un grand signe de médiocrité de louer toujours modérément. (12)
On ne peut être juste si on n’est humain. (28)
Nous blâmons beaucoup les malheureux des moindres fautes et les plaignons peu des plus grands malheurs. (168)
Nous querellons les malheureux pour nous dispenser de les plaindre. (172)
Marmontel
(1723-1799) §
Né à Bort1242, dans le Limousin, en 1723, mort en 1799, Jean-François Marmontel vint à Paris en 1745 et, soutenu de l’appui de Voltaire et de ses amis, remporta d’assez grands succès au théâtre et dans les concours académiques. Nous trouvons cependant aujourd’hui bien médiocres ses tragédies et ses poèmes. Ses Contes moraux, ses romans philosophiques, Bélisaire (1767) et les Incas (1778), semblent aussi bien démodés. Du moins on cite encore quelquefois ses Eléments de littérature1243, et on lit avec plaisir ses Mémoires d’un père pour servir à l’instruction de ses enfants, œuvre dont toutes les parties ne sont pas également recommandables, mais où l’on rencontre quelques pages pleines de charme et d’intérêt.
Souvenirs d’enfance §
L’entrée au collège §
Au sortir de ma onzième année, mon maître ayant jugé que j’étais en état d’être reçu en quatrième, mon père consentit, quoique à regret, à me mener lui-même au collège de Mauriac1244, qui était le plus voisin de Bort1245.
Ce regret de mon père était d’un homme sage, et je dois le justifier. J’étais l’aîné d’un grand nombre d’enfants,… Ajoutez au ménage trois sœurs de mon aïeule1246, et la sœur de ma mère, cette tante qui m’est restée ; c’était au milieu de ces femmes et d’un essaim d’enfants que mon père se trouvait seul1247 : avec très peu de bien, tout cela subsistait. L’ordre, l’économie, le travail, un petit commerce, et surtout la frugalité, nous entretenaient dans l’aisance. Le petit jardin produisait presque assez de légumes pour les besoins de la maison ; l’enclos nous donnait des fruits, et nos coings, nos pommes, nos poires, confits au miel de nos abeilles, étaient durant l’hiver, pour les enfants et pour les bonnes vieilles, les déjeuners les plus exquis. Le troupeau de la bergerie de Saint-Thomas1248 habillait de sa laine tantôt les femmes et tantôt les enfants ; mes tantes la filaient ; elles filaient aussi le chanvre du champ qui nous donnait du linge ; et les soirées où, à la lueur d’une lampe qu’alimentait l’huile de nos noyers, la jeunesse du voisinage venait teiller1249, avec nous ce beau chanvre, formaient un tableau ravissant. La récolte des grains de la petite métairie assurait notre subsistance ; la cire et le miel des abeilles, que l’une de mes tantes cultivait avec soin, étaient un revenu qui coûtait peu de frais ; l’huile, exprimée de nos noix encore fraîches, avait une saveur, une odeur, que nous préférions au goût et au parfum de celle de l’olive. Nos galettes de sarrasin, humectées, toutes brûlantes, de Ce bon beurre du Mont-Dore, étaient pour nous le plus friand régal. Je ne sais pas quel mets nous eût paru meilleur que nos raves et nos châtaignes : et en hiver, lorsque ces belles raves grillaient le soir à l’entour du foyer, ou que nous entendions bouillonner l’eau du vase où cuisaient ces châtaignes si savoureuses et si douces, le cœur nous palpitait de joie. Je me souviens aussi du parfum qu’exhalait un beau coing rôti sous la cendre, et du plaisir qu’avait notre grand’mère à le partager entre nous. La plus sobre des femmes nous rendait tous gourmands. Ainsi, dans un ménage où rien n’était perdu, de petits objets réunis entretenaient une sorte d’aisance, et laissaient peu de dépense à faire pour suffire à tous nos besoins. Le bois mort dans les forêts voisines était en abondance, et presque en non-valeur ; il était permis à mon père d’en tirer sa provision. L’excellent beurre de la montagne et les fromages les plus délicats étaient communs et coûtaient peu ; le vin n’était pas cher, et mon père lui-même en usait sobrement.
Mais enfin, quoique bien modique, la dépense de la maison ne laissait pas d’être à peu près la mesure de nos moyens ; et, quand je serais au collège, la prévoyance de mon père s’exagérait les frais de mon éducation. D’ailleurs, il regardait comme un temps assez mal employé celui qu’on donnait aux études : le latin, disait-il, ne faisait que des fainéants. Peut-être aussi avait-il quelque pressentiment du malheur que nous eûmes de nous le voir ravir par une mort prématurée1250, et, en me faisant de bonne heure prendre un état d’une utilité moins tardive et moins incertaine, pensait-il à laisser en moi un second père à ses enfants. Cependant, pressé par ma mère, qui désirait passionnément qu’au moins son fils aîné fît ses études, il consentit à me mener au collège de Mauriac.
Accablé de caresses, baigné de douces larmes et chargé de bénédictions, je partis donc avec mon père. Il me portait en croupe, et le cœur me battait de joie ; mais il me battit de frayeur quand mon père me dit ces mots : « On m’a promis, mon fils, que vous seriez reçu en quatrième ; si vous ne l’êtes pas, je vous remmène, et tout sera fini ». Jugez avec quel tremblement je parus devant le régent1251, qui allait décider démon sort ! Heureusement c’était ce bon P. Malosse1252dont j’ai eu tant à me louer : il y avait dans son regard, dans le son de sa voix, dans sa physionomie, un caractère de bienveillance si naturel et si sensible, que son premier abord annonçait un ami à l’inconnu qui lui parlait. Après nous avoir accueillis avec cette grâce touchante, et invité mon père à revenir savoir quel serait le succès de l’examen que j’allais subir, me voyant encore bien timide, il commença par me rassurer ; il me donna ensuite, pour épreuve, un thème : ce thème était rempli de difficultés presque toutes insolubles pour moi. Je le fis mal ; et, après l’avoir lu : « Mon enfant, me dit-il, vous ôtes bien loin d’être en état d’entrer dans cette classe ; vous aurez même bien de la peine à être reçu en cinquième. » Je me mis à pleurer. « Je suis perdu, lui dis-je ; mon père n’a aucune envie de me laisser continuer mes études ; il ne m’amène ici que par complaisance pour ma mère, et en chemin il m’a déclaré que, si je n’étais pas reçu en quatrième, il me remmènerait chez lui : cela me fera bien du tort et bien du chagrin à ma mère ! Ah ! par pitié, recevez-moi ; je vous promets, mon père, d’étudier tant, que dans peu vous aurez lieu d’être content de moi. » Le régent, touché de mes larmes et de ma bonne volonté, me reçut, et dit à mon père de ne pas être inquiet de moi ; qu’il était sûr que je ferais bien.
Je fus logé, selon l’usage du collège, avec cinq autres écoliers, chez un honnête artisan de la ville ; et mon père, assez triste de s’en aller sans moi, m’y laissa avec mon paquet, et des vivres pour la semaine. Ces vivres consistaient en un gros pain de seigle, un petit fromage, un morceau de lard, et deux ou trois livres de bœuf : ma mère y avait ajouté une douzaine de pommes. Voilà, pour le dire une fois, quelle était toutes les semaines la provision des écoliers les mieux nourris du collège. Notre bourgeoise nous faisait la cuisine ; et pour sa peine, son feu, sa lampe, ses lits, son logement, et même les légumes de son petit jardin qu’elle mettait au pot, nous lui donnions par tête vingt-cinq sous par mois ; en sorte que, tout calculé, hormis mon vêtement, je pouvais coûter à mon père de quatre à cinq louis1253 par an. C’était beaucoup pour lui, et il me tardait bien de lui épargner cette dépense.
Le lendemain de mon arrivée, comme je me rendais le matin dans ma classe, je vis à sa fenêtre mon régent, qui, du bout du doigt, me fit signe de monter chez lui. « Mon enfant, me dit-il, vous avez besoin d’une instruction particulière et de beaucoup d’études pour atteindre vos condisciples : commençons par les éléments, et venez ici, demi-heure1254 avant la classe, tous les matins, me réciter les règles que vous aurez apprises ; en vous les expliquant, je vous en marquerai l’usage. » Je pleurai aussi ce jour-là, mais ce fut de reconnaissance. En lui rendant grâces de ses bontés, je le priai d’y ajouter celle de m’épargner, pour quelque temps, l’humiliation d’entendre lire à haute voix mes thèmes dans la classe. Il me le promit, et j’allai me mettre à l’étude.
Je ne puis dire assez avec quel tendre zèle il prit soin de m’instruire, et quel attrait il sut donner à ses leçons....
Du mois d’octobre où nous étions, jusqu’aux fêtes de Pâques, il n’y eut pour moi ni amusement ni dissipation ; mais, après cette demi-année, familiarisé avec toutes mes règles, ferme dans leur application, et comme dégagé des épines de la syntaxe, je cheminai plus librement. Dès lors je fus l’un des meilleurs écoliers de la classe, et peut être le plus heureux ; car j’aimais mon devoir, et presque sûr1255 de le faire assez bien, ce n’était pour moi qu’un plaisir. Le choix des mots et leur emploi, en traduisant de l’une en l’autre langue, même déjà quelque élégance dans la construction des phrases commencèrent à m’occuper ; et ce travail, qui ne va point sans l’analyse des idées, me fortifia la mémoire. Je m’aperçus que c’était l’idée attachée au mot qui lui faisait prendre racine1256 ; et la réflexion me fît bientôt sentir que l’étude des langues était aussi l’art de démêler les nuances de la pensée, de la décomposer, d’en former le tissu, d’en saisir avec précision les caractères et les rapports ; qu’avec les mots autant de nouvelles idées s’introduisaient et se développaient dans la tête des jeunes gens ; et qu’ainsi les premières classes étaient un cours de philosophie élémentaire bien plus riche, plus étendu et plus réellement utile qu’on ne pense, lorsqu’on se plaint que, dans les collèges, on n’apprenne que du latin.
(Mémoires d’un père, livre I.)
Beaumarchais
(1732-1799) §
Né à Paris en 1732, mort en 1799, Pierre Caron de Beaumarchais, qui fut tour à tour horloger, musicien, financier, écrivain, est surtout connu pour avoir écrit, d’abord, à propos d’un procès dans lequel il était engagé, des Mémoires pleins de verve et d’éloquence contre des accusateurs sans bonne foi et des juges prévaricateurs (1774-1775), plus tard, deux comédies étincelantes et hardies, le Barbier de Séville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). Beaumarchais a encore donné au théâtre trois drames, qui eurent peu de succès, Eugénie (1767), les Deux Amis ou le Négociant de Lyon (1770), la Mère coupable (1791), et laissé quelques poésies diverses, quelques opuscules politiques et des lettres.
La calomnie §
La calomnie, monsieur ! vous ne savez guère ce que vous dédaignez : j’ai vu les plus honnêtes gens près d’en être accablés. Croyez qu’il n’y a pas de plate méchanceté, pas d’horreurs, pas de conte absurde, qu’on ne fasse adopter aux oisifs d’une grande ville en s’y prenant bien : et nous avons ici1257 des gens d’une adresse !… D’abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l’orage, pianissimo1258 murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano, piano, vous le glisse en l’oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de bouche en bouche, il va le diable ; puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s’enfler, grandir à vue d’œil. Elle s’élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ?
(Le Barbier de Séville, acte II, sc. viii.)
Apologie de Beaumarchais par lui-même §
Vous qui m’avez connu, vous qui m’avez suivi sans cesse, ô mes amis, dites si vous avez jamais vu autre chose en moi qu’un homme constamment gai ; aimant avec une égale passion l’étude et le plaisir ; enclin à la raillerie, mais sans amertume ; et l’accueillant dans autrui contre soi quand elle est assaisonnée ; soutenant peut-être avec trop d’ardeur son opinion quand il la croit juste, mais honorant hautement et sans envie tous les gens qu’il reconnaît supérieurs ; confiant sur ses intérêts jusqu’à la négligence ; actif quand il est aiguillonné, paresseux et stagnant1259 après l’orage ; insouciant dans le bonheur, mais poussant la constance et la sérénité dans l’infortune jusqu’à l’étonnement de ses plus familiers amis1260. Si j’ai jamais barré quelqu’un en son chemin de faveur, de fortune ou de considération, qu’il me le reproche. Si j’ai fait tort à quelqu’un, qu’il se présente et m’accuse hautement, je suis prêt à lui faire justice. Que si la haine qui me poursuit a quelquefois altéré mon caractère, que celui que j’ai pu offenser sans le vouloir dise de moi que je suis un homme malhonnête, j’y consens ; mais qu’il ne dise pas que je suis un malhonnête homme ; car je jure que je le prendrai à partie si je puis le découvrir, et le forcerai, par la voie la plus courte, à prouver son dire, ou à se rétracter publiquement.
(Supplément au Mémoire à consulter.)
Le père de Beaumarchais §
Vous entamez ce chef-d’œuvre1261 par me reprocher l’état de mes ancêtres. Hélas ! il est trop vrai que le dernier de tous réunissait, à plusieurs branches de commerce, une assez grande célébrité dans l’art de l’horlogerie1262. Forcé de passer condamnation sur cet article, j’avoue avec douleur que rien ne peut me laver du juste reproche que vous me faites d’être le fils de mon père… Mais je m’arrête ; car je le sens derrière moi qui regarde ce que j’écris, et rit en m’embrassant.
O vous qui me reprochez mon père, vous n’avez pas d’idée de son généreux cœur ; en vérité, horlogerie à part, je n’en vois aucun contre qui je voulusse le troquer. Mais je connais trop bien le prix du temps, qu’il m’apprit à mesurer, pour le perdre à relever de pareilles fadaises.
(Addition au Supplément du Mémoire à consulter.)
L’audience §
Une vieille fille, Marceline, veut se faire épouser par Figaro, valet de chambre du comte Almaviva, et elle prétend l’obliger à ce mariage en lui intentant le procès que l’on va voir, le jour même où il doit épouser une jeune camériste de la comtesse, Suzanne. Elle se fait assister, pour défendre sa cause, d’un vieux médecin, Bartholo, dans la maison duquel elle sert depuis longtemps, et qui, détestant Figaro, espère trouver là l’occasion de satisfaire sa haine. Le procès, n’étant pas très important, relève, suivant la jurisprudence de l’ancien régime, de la justice seigneuriale- C’est donc le comte Almaviva, assisté de Brid’oison, juge principal ou « lieutenant du siège » et de deux autres juges, qui prononcera la sentence. Or le comte est, à ce moment même, assez irrité contre son domestique. C’est, dans ces conditions que s’ouvre la scène. On verra quelle occasion Beaumarchais y trouve de flétrir certains abus de la justice et de la jurisprudence de son temps, et l’on jugera par là de la hardiesse du Mariage de Figaro, d’où cette scène est extraite. — On comprend d’ailleurs que, si l’action se passe en apparence en Espagne, c’est bien la France et es abus de la justice française que vise en réalité l’écrivain.
Le Comte Almaviva sur un grand fauteuil ; Brid’oison sur une chaise à côté ; Doublemain, greffier, sur le tabouret derrière sa table ; Les Juges, Les Avocats, sur les banquettes ; Marceline à côté de Bartholo ; Figaro sur l’autre banquette ; Antonio, jardinier du château ; Paysans et Valets debout derrière ; un Huissier.
Brid’oison, à Doublemain. — Doublemain, a-appelez les causes1263.
Doublemain lit un papier. — « Noble, très noble, infiniment noble Don Pedro George, hidalgo1264, baron de los Altos, y Montes Fieros, y otros montes1265, contre Alonzo Calderon, jeune auteur dramatique. » Il est question d’une comédie mort-née, que chacun désavoue et rejette sur l’autre.
Le Comte. — Ils ont raison tous deux. Hors de cour. S’ils font ensemble un autre ouvrage, pour qu’il marque un peu dans le grand monde, ordonné que le noble y mettra son nom, le poète son talent.
Doublemain lit un autre papier. — « André Petrutchio, laboureur, contre le receveur de la province. » Il s’agit d’un forcement1266 arbitraire.
Le Comte. — L’affaire n’est pas de mon ressort. Je servirai mieux mes vassaux en les protégeant près du roi. Passez.
Doublemain en prend un troisième. (Bartholo et Figaro se lèvent.) — « Barbe-Agar-Raab-Madeleine-Nicole-Marceline de Verte-Allure, fille majeure (Marceline se lève et salue), contre Figaro… nom de baptême en blanc. »
Figaro. — Anonyme.
Brid’oison. — A-anonyme ! Què-el patron est-ce là ?
Figaro. — C’est le mien.
Doublemain écrit. — Contre Anonyme Figaro. Qualités ?
Figaro. — Gentilhomme.
Le Comte. — Vous êtes gentilhomme ? (Le greffier écrit.)
Figaro. — Si le ciel l’eût voulu, je serais le fils d’un prince.
Le Comte, au greffier. — Allez.
L’Huissier, glapissant. — Silence, messieurs !
Doublemain lit. — « … Pour cause d’opposition faite au mariage dudit Figaro par ladite de Verte-Allure, le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse1267, et ledit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l’usage1268 et la jurisprudence du siège1269. »
Figaro. — L’usage, maître Doublemain, est souvent un abus : le client un peu instruit sait toujours mieux sa cause que certains avocats qui, suant à froid, criant à tue-tête et connaissant tout, hors le fait, s’embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que d’ennuyer l’auditoire et d’endormir messieurs1270, plus boursouflés après que s’ils eussent composé l’Oratio pro Murena1271. Moi, je dirai le fait en peu de mots. Messieurs....
Doublemain. — En voilà beaucoup d’inutiles, car vous n’êtes pas demandeur1272, et n’avez que la défense. Avancez, docteur, et lisez la promesse.
Figaro. — Oui, promesse1273 !
Bartholo, mettant ses lunettes. — - Elle est précise.
Brid’oison. — I-il faut la voir.
Doublemain. — Silence donc, messieurs !
L’Huissier, glapissant. — - Silence !
Bartholo lit. — « Je, soussigné, reconnais avoir reçu de damoiselle, etc..., Marceline de Verte-Allure, dans le château d’Aguas-Frescas1274, la somme de deux mille piastres fortes cordonnées1275, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition, dans ce château, et je l’épouserai, par forme de reconnaissance, etc. » Signé : Figaro, tout court. Mes conclusions sont au payement du billet, et à l’exécution de la promesse, avec dépens. (Il plaide.) Messieurs..., jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la Cour, et, depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Thalestris1276....
Le Comte, interrompant. — Avant d’aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre ?
Brid’oison, à Figaro. — Qu’oppo… qu’oppo-osez-vous à cette lecture ?
Figaro. — Qu’il y a, messieurs, malice1277, erreur, ou distraction clans la manière dont on a lu la pièce ; car il n’est, pas dit dans l’écrit : « Laquelle somme je lui rendrai et je l’épouserai ; mais laquelle somme je lui rendrai, ou je l’épouserai » ; ce qui est bien différent.
Le Comte. — Y a-t-il et dans l’acte, ou bien ou ?
Bartholo. — Il y a et.
Figaro. — Il y a ou.
Brid’oison. — Dou-oublemain, lisez vous-même.
Doublemain, prenant le papier. — Et c’est le plus sûr ; car souvent les parties déguisent en lisant. (Il lit.) E, e, e, e, « Damoiselle… » e, e, e, « de Verte-Allure... » e, e, e, Ah1278 ! « … laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition, dans ce château… et… ou… et… ou… » Le mot est si mal écrit… il y a un pâté.
Brid’oison. — Un pâ-âté ? Je sais ce que c’est.
Bartholo, plaidant. — Je soutiens, moi, que c’est la conjonction copulative et qui lie les membres corrélatifs de la phrase : je payerai la demoisélle et je l’épouserai.
Figaro, plaidant. — Je soutiens, moi, que c’est la conjonction alternative ou qui sépare lesdits membres : je payerai la donzelle, ou je l’épouserai. A pédant, pédant et demi ; qu’il s’avise de parler latin, j’y suis grec1279; je l’extermine.
Le Comte. — Comment juger pareille question ?
Bartholo. — Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous passons qu’il y ait ou.
Figaro. — J’en demande acte.
Bartholo. — Et nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable : examinons le titre en ce sens. (Il lit.) « Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l’épouserai. » C’est ainsi qu’on dirait, messieurs : « Vous vous ferez saigner dans ce lit où vous resterez chaudement », c’est : dans lequel. « Il prendra deux gros1280 de rhubarbe où vous mêlerez un peu de tamarin » : dans lesquels on mêlera. Ainsi : « château où je l’épouserai, » messieurs, « c’est château dans lequel… ».
Figaro. — Point du tout : la phrase est dans le sens de celle-ci : « ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin » : ou bien le médecin ; c’est incontestable. Autre exemple : « ou vous n’écrirez rien qui plaise, ou les sots vous dénigreront » ou bien les sots ; le sens est clair… Maître Bartholo croit-il donc que j’aie oublié ma syntaxe ? Ainsi : je la payerai dans ce château, virgule1281, ou je l’épouserai....
Bartholo, vite. — Sans virgule.
Figaro, vite. — Elle y est. C’est, virgule, messieurs, ou bien je l’épouserai.
Bartholo, regardant le papier, vite. — Sans virgule, messieurs.
Figaro, vite. — Elle y était, messieurs. D’ailleurs, l’homme qui épouse est-il tenu de rembourser1282 ?
Bartholo, vite. — Oui ; nous nous marions séparés de biens.
Figaro, vite. — Et nous de corps, dès que mariage n’est pas quittance. (Les juges se lèvent et opinent tout bas.)
Bartholo. — Plaisant acquittement1283 !
Doublemain. — Silence, messieurs !
L’Huissier, glapissant. — Silence !
Bartholo. — Un pareil fripon appelle cela payer ses dettes.
Figaro. — Est-ce votre cause, avocat, que vous plaidez ?
Bartholo. — Je défends cette demoiselle.
Figaro. — Continuez à déraisonner, mais cessez d’injurier. Lorsque, craignant l’emportement des plaideurs, les tribunaux ont toléré qu’on appelât des tiers, ils n’ont pas entendu que ces défenseurs modérés deviendraient impunément des insolents privilégiés. C’est dégrader le plus noble institut1284. (Les juges continuent d’opiner bas.)
Antonio, à Marceline, montrant les juges. - — Qu’ont-ils tant à balbucifier1285 ?
Marceline. — On a corrompu le grand juge ; il corrompt l’autre, et je perds mon procès.
Bartiiolo, bas, d’un ton sombre. — J’en ai peur.
Figaro, gaiement. — Courage, Marceline !
Doublemain se lève ; à Marceline. — Ah ! c’est trop fort ! je vous dénonce, et, pour l’honneur du tribunal, je demande qu’avant faire droit sur l’autre affaire il soit prononcé sur celle-ci.
Le Comte s’assied. — Non, greffier, je ne prononcerai point sur mon injure personnelle : un juge espagnol n’aura point à rougir d’un excès digne au plus des tribunaux asiatiques1286: c’est assez des autres abus. J’en vais corriger un second en vous motivant mon arrêt1287: tout juge qui s’y refuse est un grand ennemi des lois. Que peut requérir la demanderesse ? Mariage à défaut de payement ; les deux ensemble impliqueraient1288
Doublemain. — Silence, messieurs !
L’Huissier, glapissant. — Silence !
Le Comte. — Que nous répond le défendeur ? Qu’il veut garder sa personne ; à lui permis.
Figaro, avec joie. — J’ai gagné.
Le Comté. — Mais comme le texte dit : « Laquelle somme je payerai à sa première réquisition, ou bien j’épouserai, etc. » ; la Cour condamme le défendeur à payer deux mille piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l’épouser dans le jour1289. (Il se lève.)
Figaro, stupéfait. — J’ai perdu....
L’Huissier, glapissant. — Passez, messieurs. (Le peuple sort.)
Marceline s’assied. — Ah ! je respire.
Figaro. — Et moi j’étouffe.
Le Comte, à part. — Au moins je suis vengé, cela soulage1290.
(Le Mariage de Figaro, acte III, sc. xv.)
Bernardin De Saint-Pierre
(1737-1814) §
Né au Havre en 1737, mort en 1814, Jacques Henri-Bernardin de Saint-Pierre, après une jeunesse aventureuse, indécise et tourmentée, avait été envoyé à Pile de France, en qualité de capitaine-ingénieur. A son retour en France, il écrivit le récit de son voyage (1773) et publia ensuite tour à tour l’Arcadie, sorte de poème en prose (1781), les Etudes de la nature (1784). Paul et Virginie (1787), les Harmonies de la nature (1796). Dans tous ces ouvrages il fait preuve d’un grand talent de description, et dans Paul et Virginie il a ce mérite suprême de parvenir, par les moyens les plus simples, à exciter la plus forte émotion.
Bienfaisance populaire §
Je dois rendre cette justice à notre peuple que je n’en connais point, en Europe, de plus généreux. Je pourrais citer une multitude de traits de sa bienfaisance, si le temps me le permettait....
J’ai remarqué, par exemple, que beaucoup de petits marchands livrent leurs marchandises à un plus bas prix à un homme pauvre qu’à un riche ; et quand je leur en ai demandé la raison, ils m’ont répondu : « Il faut, monsieur, que tout le monde vive ». J’ai observé aussi que beaucoup de gens du petit peuple ne marchandent jamais, lorsqu’ils achètent à des pauvres comme eux : « Il faut, disent-ils, qu’ils gagnent leur vie ». J’avais, dans la rue de la Madeleine1291, un porteur d’eau auvergnat, appelé Christal, qui a nourri pendant cinq mois gratis un tapissier qui lui était inconnu et qui était venu à Paris pour un procès, « parce que, me dit-il, ce tapissier, le long de la route, dans la voiture publique, avait donné de temps en temps le bras à sa femme malade ». Ce même homme avait un fils de dix-huit ans, né paralytique et imbécile, qu’il nourrissait avec le plus tendre attachement, sans avoir jamais voulu le mettre aux Incurables, quoique des personnes qui en avaient le crédit le lui eussent offert : « Dieu, me disait-il, me l’a donné : c’est à moi à en prendre soin ». Je ne doute pas qu’il ne le nourrisse encore, quoiqu’il soit obligé de le faire manger lui-même, et que sa femme soit souvent malade. Je me suis arrêté une fois avec admiration à contempler un pauvre honteux assis sur une borne, dans la rue Bergère1292, près des boulevards. Il passait près de lui des messieurs bien vêtus, qui ne lui donnaient jamais rien ; mais il y avait peu de servantes, ou de femmes chargées de hottes, qui ne s’arrêtassent pour lui faire la charité. Il était en perruque bien poudrée, le chapeau sous le bras, en redingote, en linge blanc, et si proprement arrangé, qu’on eût dit, quand ces pauvres gens lui faisaient l’aumône, que c’était lui qui la leur donnait. On ne peut certainement pas rapporter ce sentiment de générosité dans le peuple à aucun retour secret d’intérêt sur lui-même, ainsi que le prétendent les ennemis du genre humain, qui ont voulu nous expliquer les causes de la pitié1293. Aucune de ces pauvres bienfaitrices ne se mettait à la place de cet infortuné, qui, disait-on, avait été horloger et avait perdu la vue ; mais elles étaient émues par cet instinct sublime qui nous intéresse plus aux malheurs des grands qu’à ceux des autres hommes, parce que nous mesurons la grandeur de leurs maux sur celle de leur élévation et de leur chute. Un horloger aveugle était un Bélisaire1294 pour des servantes.
(Études de la nature, XIII.)
Probité §
Bans la dernière guerre d’Allemagne1295, un capitaine de cavalerie est commandé pour aller au fourrage. Il part à la tète de sa compagnie et se rend dans le quartier1296qui lut était assigné. C’était un vallon solitaire, où l’on ne voyait guère que des bois. Il y aperçoit une pauvre cabane, il y frappe ; il en sort un vieux hernouten1297à barbe blanche : « Mon père, lui dit l’officier, montrez-moi un champ où je puisse faire fourrager mes cavaliers. — Tout à l’heure1298 », reprit l’hernouten. Ce bon homme1299se met à leur tête et remonte avec eux le vallon. Après un quart d’heure de marche, ils trouvent un beau champ d’orge : « Voilà ce qu’il nous faut, dit le capitaine.
— Attendez un moment, lui dit son conducteur, vous serez content. » Ils continuent à marcher, et ils arrivent, à un quart de lieue plus loin, à un autre champ d’orge. La troupe aussitôt met pied à terre, fauche le grain, le met en trousse1300, et remonte à cheval. L’officier de cavalerie dit alors à son guide : « Mon père, vous nous avez fait aller trop loin sans nécessité ; le premier champ valait mieux que celui-ci. — Cela est vrai, Monsieur, reprit le bon vieillard, mais il n’était pas à moi. »
(Études de La nature, notes de l’auteur, 18.)
Les délices de la foret et de la prairie §
Comment exprimer les ravissantes harmonies des vents qui agitent le sommet des graminées, et changent la prairie en une mer de verdure et de fleurs, et celles des forêts, où les chênes antiques agitent leurs sommets vénérables ; le bouleau, ses feuilles pendantes ; et les sombres sapins, leurs longues flèches toujours vertes. Du sein de ces forêts s’échappent de doux murmures, et s’exhalent mille parfums. Le matin, au lever de l’aurore, tout est chargé de gouttes de rosée qui argentent les flancs des collines et les bords des ruisseaux ; tout se meut au gré des vents ; de longs rayons de soleil dorent la cime des arbres et traversent les forêts. Cependant des êtres d’un autre ordre, des nuées de papillons peints de mille couleurs, volent sans bruit sur les fleurs ; ici l’abeille et le bourdon murmurent ; là des oiseaux font leurs nids ; les airs retentissent de mille chansons. Les notes monotones du coucou et de la tourterelle servent de basse aux ravissants concerts du rossignol et aux accords vifs et gais de la fauvette. La prairie a aussi ses oiseaux ; les cailles, qui couvent sous les herbes ; les alouettes, qui s’élèvent vers le ciel, au-dessus de leurs nids. On entend de tous côtés les accents maternels, dans les vallons, dans les bois, dans les prés. Oh ! qu’il est doux alors de quitter les cités, qui ne retentissent que du bruit des marteaux des ouvriers et de celui des lourdes charrettes, ou des carrosses qui menacent l’homme de pied1301, pour errer dans les bois, sur les collines, au fond des vallons, sur des pelouses plus douces que les tapis de la Savonnerie1302, et qu’embellissent chaque jour de nouvelles fleurs et de nouveaux parfums !
(Études de la nature, V.)
Virginie1303 et l’esclave marronne1304 §
Le bon naturel de Paul et de Virginie se développait de jour en jour. Un dimanche, au lever de l’aurore, leurs mères étant allées à la première messe de l’église des Pamplemousses1305, une négresse marronne se présenta sous les bananiers qui entouraient leur habitation. Elle était décharnée comme un squelette, et n’avait pour vêtement qu’un lambeau de serpillière1306autour des reins. Elle se jeta aux pieds de Virginie, qui préparait le déjeuner de la famille, et lui dit : « Ma jeune demoiselle, ayez pitié d’une pauvre esclave fugitive ; il y a un mois que j’erre dans ces montagnes, demi-morte de faim, souvent poursuivie par des chasseurs et par leurs chiens..Je fuis mon maître, qui est un riche habitant de la Rivière Noire1307; il m’a traitée comme vous le voyez. » En même temps, elle lui montra son corps sillonné de cicatrices profondes par les coups de fouet qu’elle en1308 avait reçus. Elle ajouta : « Je voulais aller me noyer ; mais, sachant que vous demeuriez ici, j’ai dit : Puisqu’il y a encore de bons blancs dans ce pays, il ne faut pas encore mourir. » Virginie, tout émue, lui répondit : « Rassurez-vous, infortunée créature ! Mangez, mangez ! » Et elle lui donna le déjeuner de la maison, qu’elle avait apprêté. L’esclave, en peu de moments, le dévora tout entier. Virginie, la voyant rassasiée, lui dit : « Pauvre misérable ! j’ai envie d’aller demander votre grâce à votre maître ; en vous voyant, il sera touché de pitié. Voulez-vous me conduire chez lui ? — Ange de Dieu, repartit la négresse, je vous suivrai partout où vous voudrez. » Virginie appela son frère et le pria de l’accompagner.
L’esclave marronne les conduisit, par des sentiers au milieu des bois, à travers de hautes montagnes qu’ils grimpèrent avec bien de la peine, et de larges rivières qu’ils passèrent à gué.. Enfin, vers le milieu du jour, ils arrivèrent au bas d’un morne1309 sur les bords de la Rivière Noire. Ils aperçurent là une maison bien bâtie, des plantations considérables, et un grand nombre d’esclaves occupés à toutes sortes de travaux. Leur maître se promenait au milieu d’eux, une pipe à la bouche et un rotin1310 à la main. C’était un grand homme sec, olivâtre, aux yeux enfoncés et aux sourcils noirs et joints. Virginie, tout émue, tenant Paul par le bras, s’approcha de l’habitant1311et le pria, pour l’amour de Dieu, de pardonnera son esclave, qui était à quelques pas de là derrière eux.
D’abord, l’habitant ne fit pas grand compte de ces deux enfants pauvrement vêtus ; mais quand il eut remarqué la taille élégante de Virginie, sa belle tête blonde sous une capote bleue, et qu’il eut entendu le doux son de sa voix, qui tremblait ainsi que tout son corps en lui demandant grâce, il ôta sa pipe de sa bouche, et, levant son rotin vers le ciel, il jura, par un affreux serment, qu’il pardonnait à son esclave, non pas pour l’amour de Dieu, mais pour l’amour d’elle. Virginie aussitôt fit signe à l’esclave de s’avancer vers son maître ; puis elle s’enfuit et Paul courut après elle. (Paul et Virginie.)
Lettre à M. Hennin1312 §
Monsieur et ami,
J’ai suivi votre conseil, je me suis mis dans mes meubles1313. Mon nouveau logement est rue Neuve-Saint-Étienne, maison de M. Clarisse, faubourg Saint-Victor1314. La tranquillité et l’honnêteté de ma demeure, la beauté de la vue, le bon marché, une multitude de petites commodités, réunies dans quatre petites pièces dont deux étaient tapissées d’un joli papier, les jardins qui m’environnent et m’embaumeront dans quelques semaines d’ici, sont, après le séjour de la campagne pour lequel je soupire depuis si longtemps, ce qui pouvait peut-être m’agréer le plus dans Paris. Mais, nil ab omni parte beatum1315je loge dans un grenier au quatrième, et la maison est sur le point d’être vendue, ce qui peut-être m’obligera d’en déloger dans six mois ; je suis épuisé par les dépenses de mon ameublement, je suis loin de mes promenades accoutumées, et de mes anciens amis, loin de vous1316 de plus d’une lieue !
J’irai vous voir à la première violette ; j’aurai bien près de cinq lieues à aller, j’irai gaiement, et je compte vous faire une telle description de mon séjour, que je vous ferai naître l’envie de m’y venir voir et d’y prendre une collation. Horace invitait Mécène à venir manger dans sa petite maison de Tivoli un quartier d’agneau et boire du vin de Falerne : comme il s’en faut bien que ma fortune approche de sa médiocrité d’or1317, je ne vous donnerai que des fraises et du lait dans des terrines, mais vous aurez le plaisir d’entendre les rossignols chanter dans les bosquets des dames anglaises1318, et de voir leurs pensionnaires et leurs jeunes novices folâtrer dans leur jardin.
A Paris, ce 7 février 1781.
Le logement de J.-J. Rousseau. §
Au mois de juin 17721319, un ami m’ayant proposé de me mener chez J.-J. Rousseau, il me conduisit dans une maison rue Plâtrière1320, à peu près vis-à-vis l’hôtel de la Poste. Nous montâmes au quatrième étage, nous frappâmes, et Mme Rousseau vint nous ouvrir la porte. Elle nous dit : « Entrez, messieurs, vous allez trouver mon mari ». Nous traversâmes un fort petit antichambre1321, où des ustensiles de ménage étaient proprement arrangés ; de là, nous entrâmes dans une chambre où J.-J. Rousseau était assis en redingote et en bonnet blanc, occupé à copier de la musique1322. Il se leva d’un air riant, nous présenta des chaises et se remit à son travail, en se livrant toutefois à la conversation.
Près de lui était une épinette1323sur laquelle il essayait de temps en temps des airs1324. Deux petits lits, de cotonnine1325 rayée de bleu et de blanc comme la tenture de sa chambre, une commode, une table et quelques chaises faisaient tout son mobilier. Aux murs étaient attachés un plan de la forêt et du parc de Montmorency, où il avait demeuré1326, et une estampe du roi d’Angleterre, son ancien bienfaiteur1327. Sa femme était assise, occupée à coudre du linge ; un serin chantait dans sa cage suspendue au plafond ; des moineaux venaient manger du pain sur ses fenêtres ouvertes du côté de la rue, et sur celles de l’antichambre on voyait des caisses et des pots remplis de plantes telles qu’il plaît à la nature de les semer. Il y avait dans l’ensemble de son petit ménage un air de propreté, de paix et de simplicité qui faisait plaisir.
(La vie et les ouvrages de J.-J. Rousseau1328, II.)
Madame Roland
(1754-1793) §
Marie-Jeanne Philipon, née à Paris pu 1754, épousa en 1780 Roland de la Platière (1732-1793), écrivain politique d’un caractère austère qui devint ministre en 1792. Enveloppée, avec son mari, dans la disgrâce du parti girondin, elle fut arrêtée le 2 juin 1793, jugée le 8 novembre et exécutée le 9, sans que son courage eût jamais faibli. C’est pendant sa captivité qu’elle composa ses célèbres Mémoires d’un style si vivant, mais déparés malheureusement par une certaine emphase, dont les lettres mêmes qui nous restent d’elle ne sont pas non plus toujours exemptes.
Une promenade a Meudon §
Nous allions souvent à Meudon : c’était ma promenade favorite ; je préférais ses bois sauvages, ses étangs solitaires, ses allées de sapins, ses hautes futaies, aux routes fréquentées, aux taillis uniformes du Bois de Boulogne, aux décorations de Bellevue1329, aux allées peignées de Saint-Cloud. « Où irons-nous demain, s’il fait beau ? » disait mon père, le soir des samedis d’été ; puis il me regardait en souriant : « A Saint-Cloud ; les eaux doivent jouer, il y aura du monde. — Ah ! papa, si vous vouliez aller à Meudon, je serais bien plus contente. » A cinq heures du matin, le dimanche, chat un était debout : un habit léger, frais, très simple, quelques fleurs, un voile de gaze annonçaient les projets du jour. Les Odes de Rousseau1330, un volume de Corneille ou autre1331, faisaient tout mon bagage. Nous partions tous les trois1332 ; on allait s’embarquer au Pont-Royal, que je voyais de mes fenêtres1333, sur un petit batelet qui, clans le silence d’une navigation douce et rapide, nous conduisait aux rivages de Bellevue, non loin de la verrerie, dont on aperçoit, d une grande distance, l’épaisse et noire fumée. Là, par des sentiers escarpés, nous gagnions l’avenue de Meudon, vers les deux tiers de laquelle, sur la droite, nous remarquâmes une petite maisonnette qui devint l’une de nos stations. C’était le logis d’une laitière, femme veuve, qui vivait là avec deux vaches et quelques poules. Comme il était pressant de profiter du jour pour la promenade, nous arrêtâmes qu’il nous servirait de pause au retour, et que la ménagère nous y donnerait une jatte de lait fraîchement trait. Cet arrangement fut établi de telle façon que, toutes les fois que nous montions l’avenue, nous entrions chez la laitière pour la prévenir que le soir ou le lendemain elle nous verrait, et qu’elle n’oubliât point la jatte de lait. Cette bonne vieille nous accueillait fort bien ; le goûter, assaisonné d’un peu de pain bis et de fort bonne humeur, se passait toujours comme une petite fête, qui laissait chaque fois quelques souvenirs dans la poche de la laitière. Le dîner se faisait chez l’un des suisses du parc1334. Mais l’envie que j’avais de m’éloigner des lieux fréquentés nous fit découvrir une retraite bien conforme à mes goûts.
Un jour, après avoir longtemps marché dans une partie inconnue du bois, nous parvînmes dans un espace solitaire, fort dégagé, auquel aboutissait une allée de grands arbres, sous lesquels on voyait rarement des promeneurs ; quelques autres arbres, épars sur une pelouse charmante, voilaient, pour ainsi dire, une petite maison à deux étages, fort proprement bâtie. « Qu’est-ce que cela ? » Deux jolis enfants jouaient devant la porte ouverte : ils n’avaient ni l’air des villes, ni ces enseignes de la misère, si communes dans les campagnes. Nous approchons, nous apercevons sur la gauche un jardin potager, où travaillait un vieillard. Entrer, converser avec lui fut bientôt fait ; nous apprîmes que ce local s’appelait Villebonne ; que celui qui l’habitait était fontainier du Moulin-Bouge, chargé de veiller à l’entretien des canaux qui conduisaient les eaux dans quelques parties du parc ; que les faibles appointements de cette place soutenaient en partie un jeune ménage dont nous voyions les petits enfants, et dont lui, vieillard, était le grand-père ; que les soins de la famille occupaient la femme, tandis qu’il cultivait ce jardin, dont son fils allait vendre les produits à la ville, dans ses moments de loisir. Le jardin était un carré long, divisé en quatre portions autour desquelles était ménagée une allée assez large ; un bassin occupait le centre, et fournissait des moyens d’arrosement ; au fond une niche d’ifs, sous laquelle était un grand banc de pierre, offrait le repos et l’abri. Des fleurs mêlées aux légumes rendaient l’aspect du jardin riant et gracieux ; le vieillard, robuste et content, me rappelait celui des bords du Galèse1335, que Virgile a chanté ; il causait avec plaisir et bon sens ; et, s’il ne fallait que des goûts simples pour apprécier une telle rencontre, mon imagination ne manquait pas d’y joindre tout ce qui pouvait lui prêter des charmes. Nous nous informons si l’on n’est pas dans l’usage de recevoir des étrangers : « Il n’en vient guère, nous dit le vieillard ; ce lieu est peu connu ; mais quand il s’en présente, nous ne refusons pas de leur servir ce que renferment la basse-cour et le jardin. » Nous demandons à dîner ; on nous donne des œufs frais, des légumes, de la salade, sous un joli berceau de chèvrefeuille, derrière la maison. Je n’ai jamais fait de repas plus agréable ; mon cœur se dilatait dans l’innocence et la joie d’une situation charmante. Je caressai beaucoup les petits enfants ; je témoignai de la vénération au vieillard ; la jeune femme parut bien aise de nous avoir reçus : on parla de deux chambres de leur maison dont ils pouvaient disposer pour les personnes qui voudraient les louer durant trois mois, et nous fîmes le projet de les occuper.
(Mémoires, IIe partie.)
A la campagne
A M. Bosc1336 §
12 octobre 17851337.
Eh ! bonjour donc, notre ami. Il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit ; mais aussi je ne touche guère la plume depuis un mois, et je crois que je prends quelques-unes des inclinations de la bête dont le lait me restaure1338 : j’asine à force et m’occupe de tous les petits soins de la vie cochonne de la campagne. Je fais des poires tapées qui seront délicieuses ; nous séchons des raisins et des prunes ; on fait des lessives, on travaille au linge ; on déjeune avec du vin blanc ; on suit les vendangeurs, on se repose au bois ou dans les prés ; on abat les noix ; on a cueilli tous les fruits d’hiver, on les étend dans les greniers… Adieu, il s’agit de déjeuner et puis d’aller en corps cueillir les amandiers. Salut, santé et amitié pardessus tout1339.
Joseph de Maistre
(1754-1821)
et
Xavier de Maistre
(1763-1852) §
Joseph-Marie, comte de Maistre, n’était pas Français, quoique la littérature française puisse le revendiquer comme l’un de nos plus brillants écrivains, puisqu’il naquit à Chambéry en 1754, et que la Savoie ne fut conquise par la France qu’en 1792. Adversaire déclaré des idées révolutionnaires, il servit le roi de Sardaigne comme ministre plénipotentiaire à la cour de Russie (1802). Il ne rentra qu’en 1817 dans sa patrie, que les événements politiques l’avaient forcé d’abandonner en 1793. Ses ouvrages, écrits avec une verve passionnée, le font, à juste titre, considérer comme l’un des plus zélés défenseurs de l’ancien régime et de la religion ; les principaux sont les Considérations sur la France (1796), le livre Du Pape (1819) et les Soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence (1821). On a encore publié de lui des Lettres familières et diplomatiques, qui, quelque sujet qu’elles traitent, sont toutes également des modèles de naturel et d’aisance.
Son frère Xavier (1763-1852), qui s’expatria comme lui, après la conquête de la Savoie par les Français, passa la plus grande partie de sa vie à Saint-Pétersbourg, où il occupa différentes fonctions. Il a laissé cinq charmants et célèbres opuscules : le Voyage autour de ma chambre, le Lépreux de la cité d’Aoste, les Prisonniers du Caucase, la Jeune Sibérienne et l’Expédition nocturne autour de ma chambre.
La vertu seule assure le vrai bonheur §
Si quelquefois la vertu paraît avoir moins de talent que le vice pour obtenir les richesses, les emplois, si elle est gauche pour toute espèce d’intrigues, c’est tant mieux pour elle, même temporellement1340 ; il n’y a pas d’erreur plus commune que celle de prendre une bénédiction pour une disgrâce : n’envions jamais rien au crime ; laissons-lui ses tristes succès, la vertu en a d’autres ; elle a tous ceux qu’il lui est permis de désirer, et quand elle en aurait moins, rien ne manquerait encore à l’homme juste, puisqu’il lui resterait la paix, la paix du cœur ! trésor inestimable, santé de l’âme, charme de la vie, qui tient lieu de tout et que rien ne peut remplacer ! Par quel inconcevable aveuglement semble-t-on souvent n’y pas faire attention ? D’un côté est la paix et même la gloire : une bonne renommée du moins est la compagne inséparable de la vertu, et c’est une des jouissances les plus délicieuses de la vie ; de l’autre, se trouve le remords et souvent aussi l’infamie. Tout le monde convient de ces vérités, mille écrivains les ont mises dans tout leur jour, et l’on raisonne ensuite comme si on ne les connaissait pas. Cependant peut-on s’empêcher de contempler avec délice le bonheur de l’homme qui peut se dire chaque jour avant de s’endormir : Je n’ai pas perdu la journée1341 ; qui ne voit dans son cœur aucune passion haineuse, aucun désir coupable ; qui s’endort avec la certitude d’avoir fait quelque bien, et qui s’éveille avec de nouvelles forces pour devenir encore meilleur ? Dépouillez-le, si vous voulez, de tous les biens que les hommes convoitent si ardemment, et comparez-le à l’heureux, au puissant Tibère, écrivant de l’île de Caprée sa fameuse lettre au sénat romain1342 ; il ne sera pas difficile, je crois, de se décider entre ces deux situations.
Dire que le crime est heureux dans ce monde, et l’innocence malheureuse, c’est une véritable contradiction dans les termes ; c’est dire précisément que la pauvreté est riche et l’opulence pauvre : mais l’homme est fait ainsi : toujours il se plaindra, toujours il argumentera contre son père. Ce n’est point assez que Dieu ait attaché un bonheur ineffable à l’existence de la vertu ; ce n’est pas assez qu’il lui ait promis le plus grand lot sans comparaison dans le partage général des biens de ce monde ; ces têtes folles dont le raisonnement a banni la raison1343 ne seront point satisfaites : il faudra absolument que leur juste imaginaire soit impassible1344, qu’il ne lui arrive aucun mal, que la pluie ne le mouille pas, que la nielle1345 s’arrête respectueusement aux limites de son champ, et que, s’il oublie par hasard de pousser ses verrous, Dieu soit tenu d’envoyer à sa porte un ange avec une épée flamboyante, de peur qu’un voleur heureux1346 ne vienne enlever l’or et les bijoux du juste.
(Soirées de Saint-Pétersbourg, IIIe Entretien.)
Une nuit d’été à Saint-Petersbourg §
Il était à peu près neuf heures du soir ; le soleil se couchait par un temps superbe ; le faible vent qui nous poussait expira dans la voile, que nous vîmes badiner. Bientôt le pavillon qui annonce du haut du palais impérial la présence du souverain, tombant immobile le long du mât qui le supporte, proclama le silence des airs. Nos matelots prirent la rame ; nous leur ordonnâmes de nous conduire lentement.
Bien n’est plus rare, mais rien n’est plus enchanteur qu’une belle nuit d’été à Saint-Pétersbourg, soit que la longueur de l’hiver et la rareté de ces nuits leur donnent, en les rendant plus désirables, un charme particulier, soit que réellement, comme je le crois, elles soient plus douces et plus calmes que dans, les plus beaux climats.
Le soleil, qui, dans les zones tempérées, se précipite à l’occident et ne laisse après lui qu’un crépuscule fugitif, rase ici lentement une terre dont il semble se détacher à regret. Son disque, environné de vapeurs rougeâtres, roule, comme un char enflammé, sur les sombres forêts qui couronnent l’horizon, et ses rayons, réfléchis par le vitrage des palais, donnent au spectateur l’idée d’un vaste incendie.
Les grands fleuves ont ordinairement un lit profond et des bords escarpés qui leur donnent un aspect sauvage. La Neva coule à pleins bords au sein d’une cité magnifique : ses eaux limpides touchent le gazon des îles qu’elle embrasse, et, dans toute l’étendue de la ville, elle est contenue par deux quais de granit, alignés à perte de vue ; espèce de magnificence répétée dans les trois grands canaux qui parcourent la capitale, et dont il n’est pas possible de trouver ailleurs le modèle ni l’imitation.
Mille chaloupes se croisent et sillonnent l’eau en tous sens ; on voit de loin les vaisseaux étrangers qui plient leurs voiles et jettent l’ancre. Ils apportent sous le pôle les fruits des zones brûlantes et toutes les productions de l’univers. Les brillants oiseaux d’Amérique voguent sur la Neva avec des bouquets d’orangers : ils retrouvent en arrivant la noix du cocotier, l’ananas, le citron et tous les fruits de leur terre natale. Bientôt le Russe opulent s’empare des richesses qu’on lui présente, et jette l’or, sans compter, à l’avide marchand.
Nous rencontrions de temps en temps d’élégantes chaloupes dont on avait retiré les rames et qui se laissaient aller doucement au paisible courant de ces belles eaux. Les rameurs chantaient un air national, tandis que leurs maîtres jouissaient en silence de la beauté du spectacle et du calme de la nuit.
Près de nous, une longue barque emportait rapidement une noce de riches négociants. Un baldaquin cramoisi, garni de franges d’or, couvrait le jeune couple et les parents. Une musique russe, resserrée entre deux files de rameurs, envoyait au loin le son de ses bruyants cornets.
La statue équestre de Pierre ler1347s’élève sur le bord de la Néva, à l’une des extrémités de l’immense place d’Isaac. Son visage sévère regarde le fleuve et semble encore animer cette navigation créée par le génie du fondateur. Tout ce que l’oreille entend, tout ce que l’œil contemple sur ce superbe théâtre, n’existe que par une pensée de la tête puissante qui fit sortir d’un marais tant de monuments pompeux. Sur ces rives désolées, d’où la nature semblait avoir exilé la vie, Pierre assit sa capitale et se créa des sujets. Son bras terrible est encore étendu sur leur postérité qui se presse autour de l’auguste effigie : on regarde et l’on ne sait si cette main de bronze protège ou menace.
A mesure que notre chaloupe s’éloignait, le chant des bateliers et les bruits confus de la ville s’éteignaient insensiblement. Le soleil était descendu sous l’horizon : des nuages brillants répandaient une clarté douce, un demi-jour doré qu’on ne saurait peindre et que je n’ai jamais vu ailleurs. La lumière et les ténèbres semblent se mêler et comme s’entendre pour former le voile transparent qui couvre alors ces campagnes.
Si le ciel, dans sa bonté, me réservait un de ces moments si rares dans la vie où le cœur est inondé de joie par quelque bonheur extraordinaire et inattendu, si une femme, des enfants, des frères séparés de moi depuis longtemps et sans espoir de réunion, devaient tout à coup tomber dans mes bras1348, je voudrais, oui, je voudrais que ce fût dans une de ces belles nuits, sur les rives de la Néva, en présence de ces Russes hospitaliers1349.
(Soirées de Saint-Pétersbourg, ler Entretien.)
Madame de Staël
(1766-1817) §
Anne-Louise-Germaine Necker, fille du célèbre ministre de Louis XVI, naquit à Paris en 1766. Elle épousa en 1786 le baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède à Paris, et mourut en 1817. Ame ardente et passionnée pour la liberté, Mme de Staël vécut dans l’exil presque pendant toute la durée du Consulat et de l’Empire. Rentrée en France en 1815, elle y composa son intéressant récit Dix Années d’exil et son œuvre la plus fortement conçue peut-être, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Elle avait donné auparavant, outre des opuscules de moindre importance, deux romans demeurés célèbres, Delphine (1802) et Corinne ou l’Italie (1807), et deux livres remplis d’idées neuves et qui devaient exercer une assez grande influence sur la littérature du dix-neuvième siècle : De la littérature considérée dans ses rapports avec l’état moral et politique des nations (1800), et De l’Allemagne (1810).
Scène d’incendie §
Un jeune seigneur anglais, Oswald, lord Nelvil, qui vient d’être frappé d’un deuil cruel, la mort de son père, et dont la santé est ébranlée par le chagrin, s’est résolu à partir pour l’Italie. En Autriche, il a rencontré un jeune émigré français (l’action se passe à la fin de 1794), le comte d’Erfeuil, qui sera son compagnon de route. Les deux amis se sont arrêtés à Ancône1350, quand, une nuit, un incendie d’une extrême violence y éclate. Oswald, âme généreuse et énergique, a rapidement jugé de l’incapacité des habitants à se défendre eux-mêmes contre le fléau et de l’insuffisance de leurs ressources. Heureusement deux bâtiments anglais mouillent dans le port, et ces bâtiments ont à bord des pompes excellentes. Oswald obtient rapidement le concours de ses compatriotes et dirige lui-même les opérations de sauvetage dont on va lire le dernier épisode. — Ce récit est une espèce d’introduction au roman de Corinne : il a pour but de faire naître dans l’esprit des lecteurs l’estime et l’admiration pour cet Oswald, qui va en être le héros.
Il ne restait plus qu’une maison au haut de la ville, que les flammes entouraient tellement qu’il était impossible de les éteindre, et plus impossible encore d’y pénétrer. Les habitants d’Ancône avaient montré si peu d’intérêt pour cette maison que les matelots anglais, ne la croyant point habitée, avaient ramené leurs pompes vert le port. Oswald lui-même, étourdi par les cris de ceux qui l’entouraient et l’appelaient à leur secours, n’y avait pas fait attention. L’incendie s’était communiqué plus tard de ce côté, mais y avait fait de grands progrès, Lord Nelvil demanda si vivement quelle était cette maison qu’un homme enfin lui répondit que c’était l’hôpital de fous. À cette idée, toute son âme fut bouleversée ; il se retourna et ne vit plus aucun de ses matelots autour de lui ; le comte d’Erfeuil n’y était pas non plus, et c’était en vain qu’il se serait adressé aux habitants d’Ancône : ils étaient presque tous occupés à sauver ou à faire sauver leurs marchandises, et trouvaient absurde de s’exposer pour des hommes dont il n’y avait pas un qui ne fût fou sans remède. « C’est une bénédiction du ciel, disaient-ils, pour eux et pour leurs parents, s’ils meurent ainsi sans que ce soit la faute de personne. »
Pendant qu’on tenait de semblables discours autour d’Oswald, il marchait à grands pas vers l’hôpital, et la foule, qui le blâmait, le suivait avec un sentiment d’enthousiasme involontaire et confus. Oswald, arrivé près de la maison, vit, à la seule fenêtre qui n’était pas entourée par les flammes, des insensés qui regardaient les progrès de l’incendie, et souriaient de ce rire déchirant qui suppose ou l’ignorance de tous les maux de la vie, ou tant de douleur au fond de l’âme, qu’aucune forme de la mort ne peut plus épouvanter. Un frissonnement inexprimable s’empara d’Oswald à ce spectacle ; il avait senti, dans le moment le plus affreux de son désespoir1351, que sa raison était prête à se troubler ; et, depuis cette époque, l’aspect de la folie lui inspirait toujours la pitié la plus douloureuse. Il saisit une échelle qui se trouvait près de là, il l’appuie contre le mur, monte au milieu des flammes, et entre par la fenêtre dans une chambre où les malheureux qui restaient à l’hôpital étaient tous réunis.
Leur folie était assez douce pour que dans l’intérieur de la maison tous fussent libres, excepté un seul qui était enchaîné dans cette même chambre où les flammes se faisaient jour à travers la porte, mais n’avaient pas encore consumé le plancher.
Oswald, apparaissant au milieu de ces misérables créatures, toutes dégradées par la maladie et la souffrance, produisit sur elles un si grand effet de surprise et d’enchantement, qu’il s’en fit obéir d’abord sans résistance. Il leur ordonna de descendre devant lui, l’un après l’autre, par l’échelle que les flammes pouvaient dévorer dans un moment. Le premier de ces malheureux obéit sans proférer une parole : l’accent et la physionomie de lord Nelvil l’avaient entièrement subjugé. Un troisième voulut résister, sans se douter du danger que lui faisait courir chaque moment de retard, et sans penser au péril auquel il exposait Oswald en le retenant plus longtemps. Le peuple, qui sentait toute l’horreur de cette situation, criait à lord Nelvil de revenir, de laisser ces insensés s’en retirer comme ils le pourraient ; mais le libérateur n écoutait rien avant d’avoir achevé sa généreuse entreprise.
Sur les six malheureux qui étaient dans l’hôpital, cinq étaient déjà sauvés ; il ne restait plus que le sixième, qui était enchaîné. Oswald détache ses fers, et veut lui faire prendre, pour échapper, les mêmes moyens qu’à ses compagnons ; mais c’était un pauvre jeune homme privé tout à fait de la raison, et, se trouvant en liberté après deux ans de chaîne, il s’élançait dans la chambre avec une joie désordonnée. Cette joie devint de la fureur, lorsque Oswald voulut le faire sortir par la fenêtre. Lord Nelvil, voyant alors que les flammes gagnaient toujours de plus en plus la maison, et qu’il était impossible de décider cet insensé à se sauver lui-même, le saisit dans ses bras, malgré les efforts du malheureux qui luttait contre son bienfaiteur. Il l’emporta sans savoir où il mettait les pieds, tant la fumée obscurcissait sa vue ; il sauta les derniers échelons au hasard, et remit l’infortuné, qui l’injuriait encore, à quelques personnes, en leur faisant promettre d’avoir soin de lui.
Oswald, animé par les dangers qu’il venait de courir, les cheveux épars, le regard fier et doux, frappa d’admiration et presque de fanatisme la foule qui le considérait ; les femmes surtout s’exprimaient avec cette imagination qui est un don presque universel en Italie, et prête sou vent de la noblesse aux discours des gens du peuple… Cependant il cherchait une manière de s’échapper. Le comte d’Erfeuil arriva et lui dit en lui serrant la main : « Cher Nelvil, il faut pourtant partager quelque chose avec ses amis ; c’est mal fait de prendre ainsi pour soi seul tous les périls. — Tirez-moi d’ici, lui dit Oswald à voix basse. » Un moment d’obscurité favorisa leur fuite, et tous les deux en hâte allèrent prendre des chevaux à la poste.
(Corinne ou l’Italie, livre 1, chap. iv.)
Schiller §
Schiller était1352 un homme d’un génie rare et d’une bonne foi parfaite ; ces deux qualités devraient être inséparables, au moins dans un homme de lettres. Sa conscience était sa muse : celle-là n’a pas besoin d’être invoquée, car on l’entend toujours quand on l’écoute une fois. Il aimait la poésie, l’art dramatique, l’histoire, la littérature pour elle-même. Il aurait été résolu à ne pas publier ses ouvrages, qu’il y aurait donné le même soin ; et jamais aucune considération tirée ni du succès, ni de la mode, ni des préjugés ni de tout ce qui vient des autres, enfin, n’aurait pu lui faire altérer ses écrits, car ses écrits étaient lui : ils exprimaient son âme, et il ne concevait pas la possibilité de changer une expression, si le sentiment intérieur qui l’inspirait n’était pas changé. Sans doute Schiller ne pouvait pas être exempt d’amour-propre. S’il en faut pour aimer la gloire, il en faut même pour être capable d’une activité quelconque ; mais rien ne diffère autant dans ses conséquences que la vanité et l’amour de la gloire : l’une tâche d’escamoter le succès, l’autre veut le conquérir ; l’une est inquiète d’elle-même et ruse avec l’opinion, l’autre ne compte que sur la nature et s’y fie pour tout soumettre. Enfin, au-dessus même de l’amour de la gloire, il y a encore1353 un sentiment plus pur, l’amour de la vérité, qui fait des hommes de lettres comme les prêtres guerriers d’une noble cause....
C’est une belle chose que l’innocence dans le génie et la candeur dans la force. Ce qui nuit à l’idée qu’on se fait de la bonté, c’est qu’on la croit de la faiblesse ; mais quand elle est unie au plus haut degré de lumières et d’énergie, elle nous fait comprendre comment la Bible a pu nous dire1354 que Dieu fit l’homme à son image. Schiller s’était fait tort, à son entrée dans le monde, par des égarements d’imagination1355; mais avec la force de l’âge il reprit cette pureté sublime qui naît des hautes pensées. Jamais il n’entrait en négociation avec les mauvais sentiments. Il vivait, il parlait, il agissait comme si les méchants n’existaient pas ; et quand il les peignait dans ses ouvrages, c’était avec plus d’exagération et moins de profondeur que s’il les avait vraiment connus....
Schiller était le meilleur ami, le meilleur père, le meilleur époux ; aucune qualité ne manquait à ce caractère doux et paisible que le talent seul enflammait : l’amour de la liberté, le respect pour les femmes, l’enthousiasme des beaux-arts, l’adoration pour la divinité animaient son génie ; et, dans l’analyse de ses ouvrages, il sera facile de montrer à quelle vertu ses chefs-d’œuvre se rapportent....
La première fois que j’ai vu Schiller c’était dans le salon du duc et de la duchesse de Weimar1356, en présence d’une société aussi éclairée qu’imposante ; il lisait très bien le français, mais il ne l’avait jamais parlé. Je soutins avec chaleur la supériorité de notre système dramatique1357 sur tous les autres ; il ne se refusa point à me combattre, et, sans s’inquiéter des difficultés et des lenteurs qu’il éprouvait en s’exprimant en français, sans redouter non plus l’opinion des auditeurs, qui était contraire à la sienne, sa conviction intime le fit parler. Je me servis d’abord, pour le réfuter, des armes françaises, la vivacité et la plaisanterie ; mais bientôt je démêlai, dans ce que disait Schiller, tant d’idées à travers l’obstacle des mots, je fus si frappée de cette simplicité de caractère qui portait un homme de génie à s’engager ainsi dans une lutte où les paroles manquaient à ses pensées, je le trouvai si modeste et si insouciant dans ce qui ne concernait que ses propres succès, si fier et si animé dans la défense de ce qu’il croyait la vérité, que je lui vouai, dès cet instant, une amitié pleine d’admiration1358.
(De l’Allemagne, seconde partie, chap. VIII.)
Chateaubriand
(1768-1848) §
Né à Saint-Malo en 1768, mort en 1848, François-Auguste de Chateaubriand, qui émigra pendant la Révolution, combattit l’Empire et se montra, après la Restauration, comme ministre, comme ambassadeur, comme polémiste, le serviteur dévoué et clairvoyant de la monarchie légitime, est l’un des écrivains qui ont exercé le plus d’influence sur la littérature et l’esprit français dans la première moitié du xixe siècle. Ses plus importants ouvrages sont : le Génie du Christianisme (1802), dans lequel il vengeait en poète le christianisme des reproches que les philosophes du xviiie siècle lui avaient adressés, les deux courts romans d’Atala (1801) et de René (1802), auxquels viendra s’ajouter plus tard le chevaleresque récit des Aventures du dernier Abencérage (1826), et la belle épopée en prose des Martyrs (1809). Après sa mort furent publiés ses Mémoires d’outre-tombe, œuvre inégale, mais dont certaines parties sont peut-être ce qu’il a produit de plus sincère et de plus digne d’admiration.
Le printemps en Bretagne §
Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu’aux environs de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt. Les cinq oiseaux qui l’annoncent, l’hirondelle, le loriot, le coucou, la caille et le rossignol arrivent avec des brises qui hébergent1359 dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d’hyacinthes1360, de renoncules, d’anémones, comme les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome1361. Des clairières se panachent d’élégantes et hautes fougères ; des champs de genêts et d’ajoncs resplendissent de leurs fleurs qu’on prendrait pour des papillons d’or. Les haies, au long desquelles abondent la fraise, la framboise et la violette, sont décorées d’aubépines, de chèvrefeuille, de ronces, dont les rejets bruns et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques. Tout fourmille d’abeilles et d’oiseaux ; les essaims et les nids arrêtent les enfants à chaque pas. Dans certains abris, le myrte et le laurier-rose croissent en pleine terre, comme en Grèce ; la figue mûrit comme en Provence ; chaque pommier, avec ses fleurs carminées1362, ressemble à un gros bouquet de fiancée de village.
(Mémoires d’Outre-Tombe, livre II.)
Les pèlerinages §
Dans les siècles de barbarie, les pèlerinages étaient fort utiles : ce principe religieux, qui attirait les hommes hors de leurs foyers, servait puissamment au progrès de la civilisation et des lumières....
Il n’y avait point de pèlerin qui ne revînt dans son village avec quelque préjugé de moins et quelque idée de plus. Tout se balance dans les siècles : certaines classes riches de la société voyagent peut-être à présent plus qu’autrefois ; mais, d’une autre part, le paysan est plus sédentaire. La guerre l’appelait sous la bannière de son seigneur, et la religion dans les pays lointains. Si nous pouvions revoir un de ces anciens vassaux que nous nous représentons comme une espèce d’esclave stupide, peut-être serions-nous surpris de lui trouver plus de bon sens et d’instruction qu’au paysan libre d’aujourd’hui.
Avant de partir pour les royaumes étrangers, le voyageur s’adressait à son évêque qui lui donnait une lettre apostolique avec laquelle il passait en sûreté dans toute la chrétienté. La forme de ces lettres variait selon le rang et la profession du porteur. Ainsi la religion n’était occupée qu’à renouer les fils sociaux, que la barbarie rompait sans cesse.
En général, les monastères étaient des hôtelleries où les étrangers trouvaient en passant le vivre et le couvert. Cette hospitalité, qu’on admire chez les anciens et dont on voit encore les restes en Orient, était en honneur chez nos religieux : plusieurs d’entre eux, sous le nom d’hospitaliers1363se consacrèrent particulièrement à cette vertu touchante. Elle se manifestait, comme aux jours d’Abraham, dans toute sa beauté antique, par le lavement des pieds, la flamme du foyer et les douceurs du repas et de la couche. Si le voyageur était pauvre, on lui donnait des habits, des vivres, et quelque argent pour se rendre à un autre monastère, où il recevait les mêmes secours. Les dames montées sur leur palefroi1364, les preux cherchant aventures, les rois égarés à la chasse, frappaient, au milieu de la nuit, à la porte des vieilles abbayes, et venaient partager l’hospitalité qu’on donnait à l’obscur pèlerin. Quelquefois deux chevaliers s’y rencontraient ensemble et se faisaient joyeuse réception jusqu’au lever du soleil, où, le fer à la main, ils maintenaient l’un contre l’autre la supériorité de leurs dames et de leurs patries. Boucicaut1365, au retour de la croisade de Prusse1366, logeant dans un monastère avec plusieurs chevaliers anglais, soutint seul contre tous qu’un chevalier écossais, attaqué par eux dans les bois, avait été traîtreusement mis à mort.
Dans ces hôtelleries de la religion, on croyait faire beaucoup d’honneur à un prince quand on lui proposait de rendre quelques soins aux pauvres qui s’y trouvaient par hasard avec lui. Le cardinal de Bourbon1367, revenant de conduire l’infortunée Élisabeth1368 en Espagne, s’arrêta à l’hôpital de Roncevaux1369 dans les Pyrénées ; il servit à table trois cents pèlerins, et donna à chacun deux trois réaux1370 pour continuer leur voyage. Le Poussin1371 est un des derniers voyageurs qui ait profité de cette coutume chrétienne : il allait à Rome, de monastère en monastère, en peignant des tableaux d’autel pour prix de l’hospitalité qu’il recevait, et renouvelant ainsi chez les peintres l’aventure d’Homère1372.
(Génie du Christianisme, quatrième partie, livre VI, chap. viii.)
M. Violet §
Je me trouvais en Amérique, sur la frontière du pays des sauvages1373 : j’appris qu’à la première journée je rencontrerais parmi les Indiens1374 un de mes compatriotes. Arrivé chez les Cayongas, tribu qui faisait partie de la nation des Iroquois, mon guide me conduisit dans une forêt. Au milieu de cette forêt on voyait une espèce de grange ; je trouvai dans cette grange une vingtaine de sauvages, hommes et femmes, barbouillés comme des sorciers, le corps demi-nu, les oreilles découpées, des plumes de corbeau sur la tête et des anneaux passés dans les narines. Un petit Français poudré et frisé, habit vert-pomme, veste de droguet1375, jabot et manchettes de mousseline, raclait un violon de poche1376, et faisait danser Madelon Friquet1377 à ces Iroquois. M. Violet (c’était son nom) était maître de danse chez les sauvages. On lui payait ses leçons en peaux de castors et en jambons d’ours. Il avait été marmiton au service du général Rochambeau1378 pendant la guerre d’Amérique. Demeuré à New-York après le départ de notre armée, il résolut d’enseigner les beaux-arts aux Américains. Ses vues s’étant agrandies avec ses succès, le nouvel Orphée porta la civilisation jusque chez les hordes errantes du Nouveau Monde. En me parlant des Indiens, il me disait toujours : « Ces messieurs sauvages et ces dames sauvagesses. » Il se louait beaucoup de la légèreté de ses écoliers ; en effet, je n’ai jamais vu faire de telles gambades. M. Violet, tenant son petit violon entre son menton et sa poitrine, accordait l’instrument fatal. Il criait en iroquois : « A vos places ! » Et toute la troupe sautait comme une bande de démons.
(Itinéraire de Paris à Jérusalem, septième et dernière partie.)
La jeune grecque malade §
Les Grecs, ainsi que les Turcs, supposent que tous les Français ont des connaissances en médecine et des secrets particuliers. La simplicité avec laquelle ils s’adressent à un étranger dans leurs maladies a quelque chose de touchant et rappelle les anciennes mœurs : c’est une noble confiance de l’homme envers l’homme. Les sauvages, en Amérique, ont le même usage. Je crois que la religion et l’humanité ordonnent dans ce cas au voyageur de se prêter à ce qu’on attend de lui : un air d’assurance, des paroles de consolation, peuvent quelquefois rendre la vie à un mourant et mettre une famille dans la joie.
Un Grec vint donc me chercher1379 pour voir sa fille. Je trouvai une pauvre créature étendue à terre sur une natte et ensevelie sous les haillons dont on l’avait couverte. Elle dégagea son bras avec beaucoup de répugnance et de pudeur des lambeaux de la misère et le laissa tomber mourant sur la couverture. Elle me parut attaquée d’une fièvre putride ; je fis débarrasser sa tête des petites pièces d’argent dont les paysannes albanaises ornent leurs cheveux ; le poids des tresses et du métal concentrait la chaleur au cerveau. Je portais avec moi du camphre pour la peste : je le partageai avec la malade ; on l’avait nourrie de raisins : j’approuvai le régime. Enfin nous priâmes Christos et la Panagia (la Vierge)1380, ’ et je promis prompte guérison. J’étais bien loin de l’espérer ; j’ai tant vu mourir que je n’ai là-dessus que trop d’expérience.
Je trouvai en sortant tout le village assemblé à la porte ; les femmes fondirent sur moi en criant : Crasi ! crasi ! « Du vin ! du vin !1381 » Elles voulaient me témoigner leur reconnaissance en me forçant à boire : ceci rendait mon rôle de médecin assez ridicule. Mais qu’importe si j’ai ajouté à Mégare une personne de plus à celles qui peuvent me souhaiter un peu de bien dans les différentes parties du monde où j’ai erré ! C’est un privilège du voyageur de laisser après lui beaucoup de souvenirs, et de vivre dans le cœur des étrangers quelquefois plus longtemps que dans la mémoire de ses amis1382.
(Itinéraire de Paris à Jérusalem, lre partie : Voyage de la Grèce.)
Les larmes de Boabdil §
Lorsque Boabdil, dernier roi de Grenade, fut obligé d’abandonner le royaume de ses pères1383, il s’arrêta au sommet du mont Padul. De ce lieu élevé on découvrait la mer où l’infortuné monarque allait s’embarquer pour l’Afrique ; on apercevait aussi Grenade, la Véga1384 et le Xénil1385 au bord duquel s’élevaient les tentes de Ferdinand et d’Isabelle. A la vue de ce beau pays et des cyprès qui marquaient encore çà et là les tombeaux des musulmans, Boabdil se prit à verser des larmes. La sultane Aïxa, sa mère, qui raccompagnait dans son exil avec les grands qui composaient jadis sa cour, lui dit : « Pleure maintenant comme une femme un royaume que tu n’as pas su défendre comme un homme ». Ils descendirent de la montagne, et Grenade disparut à leurs yeux pour toujours.
(Les Aventures du dernier Abencérage.)
Le Meschacebé1386 §
Le Meschacebé, dans un cours de plus de mille lieues, arrose une délicieuse contrée que les habitants des États-Unis appellent le Nouvel Éden, et à laquelle les Français ont laissé le doux nom de Louisiane1387. Mille autres fleuves, tributaires du Meschacebé, le Missouri, l’Illinois, l’Akanza, l’Ohio, le Wabache, le Tenase1388, l’engraissent de leur limon et la fertilisent de leurs eaux. Quand tous ces fleuves sont gonflés des déluges de l’hiver, quand les tempêtes ont abattu dès pans entiers de forêts, les arbres déracinés s’assemblent sur les sources. Bientôt la vase les cimente, les lianes les enchaînent : et les plantes, y prenant racine de toutes parts, achèvent de consolider ces débris. Charriés par les vagues écumantes, ils descendent au Meschacebé ; le fleuve s’en empare, les pousse au golfe Mexicain, les échoue1389 sur des bancs de sable, et accroît ainsi le nombre de ses embouchures. Par intervalles, il élève sa voix en passant sur les monts, et répand ses eaux débordées autour des colonnades des forêts et des pyramides des tombeaux indiens ; c’est le Nil des déserts. Mais la grâce est toujours unie à la magnificence dans les scènes de la nature : tandis que le courant du milieu entraîne vers la mer les cadavres des pins et des chênes, on voit sur les deux courants latéraux remonter, le long des rivages, des îles flottantes de pistia1390 et de nénuphar, dont les roses jaunes s’élèvent comme de petits pavillons. Des serpents verts, des hérons bleus, des flamants roses, de jeunes crocodiles, s’embarquent passagers sur ces vaisseaux de fleurs ; et la colonie, déployant au vent ses voiles d’or, va aborder endormie dans quelque anse retirée du fleuve.
Les deux rives du Meschacebé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, des savanes1391 se déroulent à perte de vue ; leurs flots de verdure, en s’éloignant, semblent monter dans l’azur du ciel, où ils s’évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes errer à l’aventure des troupeaux de trois ou quatre mille buffles sauvages. Quelquefois un bison chargé d années, fendant les flots à la nage, se vient coucher, parmi de hautes herbes, dans une île du Meschacebé. A son front orné de deux croissants1392, à sa barbe antique et limoneuse, vous le prendriez pour le dieu du fleuve1393, qui jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives.
Telle est la scène sur le bord occidental ; mais elle change sur le bord opposé, et forme avec la première un admirable contraste. Suspendus sur le cours des eaux, groupés sur les rochers et sur les montagnes, dispersés dans les vallées, des arbres de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs qui fatiguent les regards. Les vignes sauvages, les bignonias, les coloquintes1394 s’entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l’extrémité des branches, s’élancent de l’érable au tulipier, du tulipier à l’alcée1395, en formant mille grottes, mille voûtes, mille portiques. Souvent, égarées d’arbre en arbre, ces lianes traversent des bras de rivières, sur lesquels elles jettent des ponts de fleurs. Du sein de ces massifs, le magnolia1396 élève sou cône immobile ; surmonté de ses larges roses blanches, il domine toute la forêt, et n’a d’autre rival que le palmier, qui balance légèrement auprès de lui ses éventails de verdure.
Une multitude d’animaux placés dans ces retraites par la main du Créateur y répandent l’enchantement et la vie. De l’extrémité des avenues on aperçoit des ours enivrés de raisin, qui chancellent sur les branches des ormeaux ; des cariboux1397 se baignent dans un lac ; des écureuils noirs se jouent dans l’épaisseur des feuillages ; des oiseaux moqueurs1398, des colombes de Virginie, de la grosseur d’un passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises ; des perroquets verts à tête jaune, des piverts empourprés, des cardinaux de feu grimpent en circulant au haut des cyprès ; des colibris étincellent sur le jasmin des Florides, et des serpents oiseleurs1399 sifflent suspendus aux dômes des bois, en s’y balançant comme des lianes.
Si tout est silence et repos dans les savanes de l’autre côté du fleuve, tout ici, au contraire, est mouvement et murmure : des coups de bec contre le tronc des chênes, des froissements d’animaux qui marchent, broutent ou broient entre leurs dents les noyaux des fruits ; des bruissements d’onde, de faibles gémissements, de sourds meuglements, de doux roucoulements, remplissent ces déserts d’une tendre et sauvage harmonie. Mais quand une brise vient à animer ces solitudes, à balancer ces corps flottants, à confondre ces masses de blanc, d’azur, de vert, de rose, à mêler toutes les couleurs, à réunir tous les murmures : alors il sort de tels bruits du fond des forêts, il se passe de telles choses aux yeux, que j’essayerais en vain de les décrire à ceux qui n’ont point parcouru ces champs primitifs de la nature.
(Atala, prologue.)
Une nuit en Messénie1400 §
C’était une de ces nuits dont les ombres transparentes semblent craindre de cacher le beau ciel de la Grèce : ce n’étaient point des ténèbres, c’était seulement l’absence du jour. L’air était doux comme le lait, et le miel, et l’on sentait à le respirer un charme inexprimable. Les sommets du Taygète, les promontoires opposés de Colonides et d’Acritas1401, la mer de Messénie brillaient de la plus tendre lumière ; une flotte ionienne baissait ses voiles pour entrer au port de Coronée1402, comme une troupe de colombes passagères ploie ses ailes pour se reposer sur un rivage hospitalier ; Alcyon1403 gémissait doucement sur son nid, et le vent de la nuit apportait à Cymodocée1404 les parfums du dictame et la voix lointaine de Neptune1405 : assis dans la vallée, le berger contemplait la lune au milieu du brillant cortège des étoiles, et il se réjouissait dans son cœur.
(Les Martyrs, livre I.)
Un martyr §
Le peuple s’assemblait à l’amphithéâtre de Vespasien1406 : Rome entière était accourue pour boire le sang des martyrs. Cent mille spectateurs, les uns voilés d’un pan de leur robe, les autres portant sur la tête une ombrelle, étaient répandus sur les gradins. La foule, vomie1407 par les portiques, descendait et montait le long des escaliers extérieurs, et prenait son rang sur les marches revêtues de marbre. Des grilles d’or défendaient le banc des sénateurs de l’attaque des bêtes féroces. Pour Rafraîchir l’air, des machines ingénieuses faisaient monter des sources de vin et d’eau safranée, qui retombaient en rosée odoriférante. Trois mille statues de bronze, une multitude infinie de tableaux, des colonnes de jaspe et de porphyre, des balustres de cristal, des vases d’un travail précieux, décoraient la scène. Dans un canal creusé autour de l’arène, nageaient un hippopotame et des crocodiles ; cinq cents lions, quarante éléphants, des tigres, des panthères, des taureaux, des ours, accoutumés à déchirer des hommes, rugissaient dans les cavernes de l’amphithéâtre. Des gladiateurs non moins féroces essayaient çà et là leurs bras ensanglantés....
Les prétoriens1408, chargés de conduire les confesseurs1409 au martyre, assiégeaient déjà les portes de la prison de Saint-Pierre1410, Eudore1411, selon les ordres de Galérius, devait être séparé de ses frères, et choisi pour combattre le premier : ainsi, dans une troupe valeureuse, on cherche à terrasser d’abord le héros qui la guide. Le gardien de la prison s’avance à la porte du cachot et appelle le fils de Lasthénès.
« Me voici, dit Eudore ; que voulez-vous ?
— Sors pour mourir, s’écria le gardien.
— Pour vivre ! » répondit Eudore.
Et il se lève de la pierre où il était couché. Cyrille1412, Gervais, Protais, Rogatien et son frère, Victor, Genès, Perséus, l’ermite du Vésuve, ne peuvent retenir leurs larmes.
« Confesseurs, leur dit Eudore, nous allons bientôt nous retrouver. Un instant séparés sur la terre, nous nous rejoindrons dans le ciel. »
Eudore avait réservé pour ce dernier moment une tunique blanche, destinée jadis à sa pompe nuptiale ; il ajoute à cette tunique un manteau brodé par sa mère ; il parait plus beau qu’un chasseur d’Arcadie qui va disputer le prix des combats de l’arc ou de la lyre, dans les champs de Mantinée1413.
Le peuple et les prétoriens impatients appellent le fils de Lasthénès à grands cris.
« Allons ! » dit le martyr.
Et, surmontant les douleurs du corps1414 par la force de l’âme, il franchit le seuil du cachot. Cyrille s’écrie :
« Fils de la femme, on vous a donné un front de diamant1415 : ne les craignez point, et n’avez pas peur devant eux. »
Les évêques entonnent le cantique des louanges, nouvellement composé à Carthage par Augustin1416, ami d’Eudore.
« O Dieu, nous te louons ! ô Dieu, nous te bénissons ! Les cieux, les anges, les trônes, les chérubins, te proclament trois fois saint, Seigneur, Dieu des armées ! »
Les évêques chantaient encore l’hymne de la victoire, Eudore, sorti de prison, jouissait déjà de son triomphe : […] tait livré aux outrages. Le centurion de la garde le […] sa rudement, et lui dit :
« Tu te fais bien attendre.
— Compagnon, répondit Eudore en souriant, je marchais aussi vite que vous à l’ennemi : mais aujourd’hui, vous le voyez je suis blessé. »
On lui attacha sur la poitrine une feuille de papyrus portant ces deux mots ;
« Eudore chrétien. »
Le peuple le chargeait d’opprobres.
« Où est maintenant son Dieu ? disaient-ils. Que lui a servi de préférer son culte à la vie ? Nous verrons s’il ressuscitera avec son Christ, ou si le Christ sera assez puissant pour l’arracher de nos mains. »
Et cette foule cruelle rendait mille louanges à ses dieux, et elle se réjouissait de la vengeance qu’elle tirait des ennemis de ses autels….
On lançait des pierres au nouvel apôtre, on jetait sous ses pieds blessés des débris de vases et des cailloux ; on le traitait comme s’il eût été lui-même le Christ, pour lequel ces infortunés avaient tant d’horreur. Il s’avançait lentement du pied du Capitole à l’amphithéâtre, en sui-vaut la voie Sacrée1417. Au temple de Jupiter Stator, aux Rostres, à l’arc de Titus1418, partout où se présentait quelque simulacre des dieux, les hurlements de la foule redoublaient : on voulait contraindre le martyr à s’incliner devant les idoles.
« Est-ce au vainqueur à saluer le vaincu ? disait Eudore. Encore quelques instants, et vous jugerez de ma victoire. O Rome, j’aperçois un prince qui met son diadème aux pieds de Jésus-Christ1419. Le temple des esprits des ténèbres est fermé, ses portes ne Couvriront plus, et des verrous d’airain en défendront l’entrée aux siècles à venir !
— Il nous prédit des malheurs, s’écrie le peuple ; écrasons, déchirons cet impie ! »
Les prétoriens peuvent à peine défendre le prophète martyr de la rage de ces idolâtres.
« Laissez-les faire, dit Eudore. C’est ainsi qu’ils ont souvent traité leurs empereurs : mais vous ne serez point obligés d’employer la pointe de vos épées pour me forcer à lever la tête1420. »
On avait brisé toutes les statues triomphales d’Eudore1421. Une seule était restée, et elle se trouva sur le passage du martyr ; un soldat, ému de ce singulier hasard, baissa son casque pour cacher l’attendrissement de son visage. Eudore l’aperçut, et lui dit :
« Ami, pourquoi pleurez-vous ma gloire ? C’est aujourd’hui que je triomphe ! Méritez les mêmes honneurs. » Ces paroles frappèrent le soldat, et quelques jours après il embrassa la religion chrétienne.
Eudore parvient ainsi jusqu’à l’amphithéâtre, comme un noble coursier, percé d’un javelot sur un champ de bataille, s’avance encore au combat sans paraître sentir sa blessure mortelle.
Mais tous ceux qui pressaient le confesseur n’étaient pas des ennemis : un grand nombre étaient des fidèles qui cherchaient à toucher le vêtement du martyr, des vieillards qui recueillaient ses paroles, des prêtres qui lui donnaient l’absolution du milieu de la foule, des jeunes gens, des femmes qui criaient :
« Nous demandons à mourir avec lui. »
Le confesseur calmait d’un mot, d‘un geste, d’un regard, ces élans de la vertu, et ne paraissait occupé que du péril de ses frères. L’enfer l’attendait à la porte de l’arène, pour lui livrer un dernier assaut. Les gladiateurs, selon l’usage1422, voulurent revêtir le chrétien d’une robe des prêtres de Saturne.
« Je ne mourrai point, s’écrie Eudore, dans le déguisement d’un lâche déserteur et sous les couleurs de l’idolâtrie : je déchirerai plutôt de mes mains l’appareil de mes blessures. J’appartiens au peuple romain et à César : si vous les privez par ma mort du combat que je leur dois, vous en répondrez sur votre tête. »
Intimidés par cette menace, les gladiateurs ouvrirent les portes de l’amphithéâtre, et le martyr entra seul et triomphant dans l’arène.
Aussitôt un cri universel, des applaudissements furieux, prolongés depuis le faîte jusqu’à la base de l’édifice, en font mugir les échos. Les lions, et toutes les bêtes renfermées dans les cavernes, répondent dignement aux éclats de cette joie féroce : le peuple lui-même tremble d’épouvante ; le martyr seul n’est point effrayé. Tout à coup il se souvient du pressentiment qu’il eut jadis dans ce même lieu1423. Il rougit de ses erreurs passées ; il remercie Dieu, qui l’a reçu dans sa miséricorde, et la conduit, par un merveilleux conseil1424, à une fin si glorieuse. Il songe avec attendrissement à son père, à ses sœurs, à sa patrie ; il recommande à Eternel Démodocus et Cymodocée1425 : ce fut sa dernière pensée de la terre, il tourne son esprit et son cœur uniquement vers le ciel.
(Les Martyrs, livre XXIV.)
Les Francs1426 §
Parés de la dépouille des ours, des veaux marins1427, des urochs1428 et des sangliers, les Francs se montraient de loin comme un troupeau de bêtes féroces. Une tunique courte et serrée laissait voir toute la hauteur de leur taille et ne leur cachait pas le genou. Les yeux de ces Barbares ont la couleur d’une mer orageuse ; leur chevelure blonde, ramenée en avant sur leur poitrine, et teinte d’une liqueur rouge, est semblable à du sang et à du feu. La plupart ne laissent croître leur barbe qu’au-dessus de la bouche, afin de donner à leurs lèvres plus de ressemblance avec le mufle des dogues et des loups. Les uns chargent leur main droite d’une longue framée1429 et leur main gauche d’un bouclier qu’ils tournent comme une roue rapide ; d’autres, au lieu de ce bouclier, tiennent une espèce de javelot, nommé angon, où s’enfoncent deux fers recourbés ; mais tous ont à la ceinture la redoutable francisque, espèce de hache à deux tranchants, dont le manche est recouvert d’un dur acier ; arme funeste que le Franc jette en poussant un cri de mort et qui manque rarement de toucher le but qu’un œil intrépide a marqué.
Ces Barbares, fidèles aux usages des anciens Germains, s’étalent formés en coin, leur ordre accoutumé de bataille1430. Le formidable triangle, où l’on ne distinguait qu’une forêt de framées, des peaux de bêtes et des corps demi-nus, s’avançait avec impétuosité, mais d’un mouvement égal, pour percer la ligne romaine. A la pointe de ce triangle étaient placés des braves qui conservaient une barbe longue et hérissée, et qui portaient au bras un anneau de fer. Ils avaient juré de ne quitter ces marques de servitude qu’après avoir sacrifié un Romain. Chaque chef, dans ce vaste corps, était environné des guerriers de sa famille, afin que, plus ferme dans le choc, il remportât la victoire ou mourût avec ses amis. Chaque tribu se ralliait sous un symbole ; la plus noble d’entre elles se distinguait par des abeilles ou trois fers de lance1431. Le vieux roi des Sicambres, Pharamond1432, conduisait l’armée entière et laissait une partie du commandement à son petit-fils Mérovée. Les cavaliers francs, en face de la cavalerie romaine, couvraient les deux côtés de leur infanterie ; à leurs casques en forme de gueules ouvertes, ombragées de deux ailes de vautour, à leurs corselets de fer, à leurs bouchers blancs, on les eût pris pour des fantômes ou pour ces figures bizarres que l’on aperçoit au milieu des nuages pendant une tempête. Clodion, fils de Pharamond et père de Mérovée1433, brillait à la tête de ces cavaliers menaçants.
Sur une grève, derrière cet essaim d’ennemis, on apercevait leur camp, semblable à un marché de laboureurs et de pêcheurs ; il était rempli de femmes et d’enfants, et retranché avec des bateaux de cuir et des chariots attelés de grands bœufs. Non loin de ce camp champêtre, trois sorcières en lambeaux faisaient sortir de jeunes poulains d’un bois sacré, afin de découvrir par leur course, à quel parti Tuiston1434 promettait la victoire. La mer d’un côté, des forêts de l’autre, formaient le cadre de ce grand tableau.
(Les Martyrs, livre VI.)
Paul-Louis Courier
(1772-1825) §
Paul-Louis Courier de Méré, né à Paris en 1772, mort assassiné en 1825, servit comme officier d’artillerie dans les armées de la République et de l’Empire. Sous la Restauration, il se rendit célèbre par les pamphlets qu’il lança contre le gouvernement, et qui sont en effet écrits avec beaucoup de verve et dans un style d’une grande pureté, et l’on lit encore avec plaisir un grand nombre de ses Lettres, vives et malicieuses.
Une terrible histoire
A Madame Pigalle1435 §
Résina, près Portici, le ler septembre 18071436.
Vos lettres sont rares, chère cousine ; vous faites bien, je m’y accoutumerais et je ne pourrais plus m’en passer. Tout de bon, je suis en colère : vos douceurs ne m’apaisent point. Comment, cousine, depuis trois ans voilà deux fois que vous m’écrivez ! en vérité, mamzelle Sophie1437… Mais quoi ! si je vous querelle, vous ne m’écrirez plus du tout. Je vous pardonne donc, crainte de pis.
Oui sûrement je vous conterai mes aventures, bonnes et mauvaises, tristes et gaies, car il m’en arrive des unes et des autres. Laissez-nous faire, cousine, on vous en donnera de toutes les façons. C’est un vers de La Fontaine. Mon Dieu, m’allez-vous dire, on a lu La Fontaine ; on sait ce que c’est que de Curé et le Mort1438. Eh bien ! pardon. Je disais donc que mes aventures sont diverses, mais toutes curieuses, intéressantes ; il y a plaisir à les entendre, et plus encore, je m’imagine, à vous les conter. C’est une expérience que nous ferons au coin du feu quelque jour. J’en ai pour tout un hiver. J’ai de quoi vous amuser, et par conséquent vous plaire, sans vanité, tout ce temps-là ; de quoi vous attendrir, vous faire rire, vous faire peur, vous faire dormir. Mais pour vous écrire tout, ah ! vraiment, vous plaisantez : Mme Radcliffe1439 n’y suffirait pas. Cependant je sais que vous n’aimez pas à être refusée, et comme je suis complaisant, quoi qu’on en dise, voici en attendant un petit échantillon de mon histoire ; mais c’est du noir, prenez-y garde. Ne lisez pas cela en vous couchant, vous en rêveriez, et pour rien au monde je ne voudrais vous avoir donné le cauchemar.
Un jour, je voyageais en Calabre ; c’est un pays de méchantes gens, qui, je crois, n’aiment personne, et en veulent surtout aux Français. De vous dire pourquoi, cela serait long ; suffit qu’ils nous haïssent à mort, et qu’on passe mal son temps lorsqu’on tombe entre leurs mains. J’avais pour compagnon un jeune homme d’une figure..., ma foi, comme ce monsieur que nous vîmes au Raincy1440 ; vous en souvenez-vous ? et mieux encore peut-être. Je ne dis pas cela pour vous intéresser, mais parce que c’est la vérité. Dans ces montagnes, les chemins sont des précipices ; nos chevaux marchaient avec beaucoup de peine ; mon camarade allant devant, un sentier qui lui parut plus praticable et plus court nous égara. Ce fut ma faute ; devais-je me fier à une tête de vingt ans ? Nous cherchâmes, tant qu’il fit jour, notre chemin à travers ces bois ; mais plus nous cherchions, plus nous nous perdions, et il était nuit noire quand nous arrivâmes près d’une maison fort noire. Nous y entrâmes, non sans soupçon ; mais comment faire ? Là nous trouvons toute une famille de charbonniers à table, où du premier mot on nous invita. Mon jeune homme ne se fit pas prier ; nous voilà mangeant et buvant, lui du moins ; car, pour moi, j’examinais le lieu et la mine de nos hôtes. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers ; mais la maison, vous l’eussiez prise pour un arsenal : ce n’étaient que fusils, pistolets, sabres, couteaux, coutelas. Tout me déplut, et je vis bien que je déplaisais aussi. Mon camarade, au contraire ; il était de la famille, il riait, il causait avec eux, et, par une imprudence que j’aurais du prévoir (mais quoi ! s’il était écrit...), il dit d’abord1441 d’où nous venions, où nous allions, qui nous étions. Français, imaginez un peu ! chez nos plus mortels ennemis, seuls, égarés, si loin de tout secours humain ! et puis, pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous perdre, il fit le riche, promit à ces gens, pour la dépense et pour nos guides du lendemain, ce qu’ils voulurent. Enfin il parla de sa valise, priant fort qu’on en eût grand soin, qu’on la mît au chevet de son lit ; il ne voulait point, disait-il, d’autre traversin. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! que votre âge est à plaindre ! Cousine, on crut que nous portions les diamants de la couronne.
Le souper fini, on nous laisse ; nos hôtes couchaient en bas, nous dans la chambre haute où nous avions mangé, Une soupente élevée de sept à huit pieds, où l’on montait par une échelle, c’était là le coucher qui nous attendait, espèce de nid dans lequel on s’introduisait en rampant sous des solives chargées de provisions pour toute l’année.
Mon camarade y grimpa seul et se coucha tout endormi, la tête sur la précieuse valise. Moi, déterminé à veiller, je fis bon feu et m’assis auprès. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquillement, et je commençais à me rassurer, quand, sur l’heure où il me semblait que le jour ne pouvait être loin, j’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer ; et prêtant l’oreille par la cheminée qui communiquait avec celle d’en bas, je distinguai parfaitement ces propres mots du mari : Eh bien ! enfin, voyons, faut-il les tuer tous deux ? À quoi la femme répondit : Oui. Et je n’entendis plus rien.
Que vous dirai-je ? Je restai respirant à peine, tout mon corps froid comme un marbre ; à me voir, vous n’eussiez su si j’étais mort ou vivant. Dieu ! quand j’y pense encore !… Nous deux presque sans armes, contre eux, douze ou quinze qui en avaient tant ! Et mon camarade, mort de sommeil et de fatigue ! L’appeler, faire du bruit, je n’osais ; m’échapper tout seul, je ne pouvais ; la fenêtre n’était guère haute, mais en bas, deux gros dogues hurlant comme des loups… En quelle peine je me trouvais, imaginez-le si vous pouvez. Au bout d’un quart d’heure, qui fut long, j’entends sur l’escalier quelqu’un, et par la fente de la porte, je vis le père, sa lampe dans une main, dans l’autre un de ses grands couteaux. Il montait, sa femme après lui ; moi derrière la porte : il ouvrit ; mais avant d’entrer, il posa la lampe, que sa femme vint prendre ; puis il entre pieds nus, et elle, de dehors, lui disait à voix basse, masquant avec ses doigts le trop de lumière de la lampe : Doucement, va doucement. Quand il fut à l’échelle, il monte, son couteau dans les dents ; et venu à la hauteur du lit, ce pauvre jeune homme étendu offrant sa gorge découverte, d’une main il prend son couteau, et, de l’autre… Ah ! cousine… Il saisit un jambon qui pendait au plancher, en coupe une tranche et se retire comme il était venu. La porte se ferme, la lampe s’en va, et je reste seul à mes réflexions.
Dès que le jour parut, toute la famille à grand bruit vint nous éveiller, comme nous l’avions recommandé. On apporte à manger : on sert un déjeuner fort propre, fort bon, je vous assure. Deux chapons en faisaient partie, dont il fallait, dit notre hôtesse, emporter l’un et manger l’autre. En les voyant, je compris enfin le sens de ces terribles mots : Faut-il les tuer tous deux ? Et je vous crois, cousine, assez de pénétration pour deviner à présent ce que cela signifiait.
Cousine, obligez-moi : ne contez point cette histoire. D’abord, comme vous voyez, je n’y joue pas un beau rôle, et puis vous me la gâteriez. Tenez, je ne vous flatte point, c’est votre figure qui nuirait à l’effet de ce récit. Moi, sans me vanter, j’ai la mine qu’il faut pour les contes à faire peur. Mais vous, voulez-vous conter ? prenez des sujets qui aillent à votre air, Psyché, par exemple1442.
(Lettres écrites de France et d’Italie.)
Un tyranneau de village sous la restauration §
Monsieur1443,
Je suis malheureux ; j’ai fâché monsieur le maire ; il me faut vendre tout, et quitter le pays. C’est fait de moi, monsieur, si je ne pars bientôt.
Un dimanche, l’an passé, après le Pentecôte, en ce temps-ci justement, il chassait aux cailles dans mon pré, l’herbe haute, prête à faucher, et si belle !… c’était pitié. Moi, voyant ce manège, monsieur, mon herbe confondue, perdue, je ne dis mot, et pourtant il m’en faisait grand mal ; mais il ne fait pas bon cosser 1444 avec telles gens, et j’en sais des nouvelles. Je regardais et laissais monsieur le maire fouler, fourrager tout mon pré, comme eussent pu faire douze ou quinze sangliers, quand de fortune1445 passent Pierre Houry d’Azai1446, Louis Bezard et sa femme, Jean Proust, la petite Bodin, allant à l’assemblée1447. Pierre s’arrête, rit, et en gaussant1448 me dit : « La voilà bonne ton herbe ; vends-la-moi, Nicolas ; je t’en donne dix sous, et tu me la faucheras1449. » Moi, piqué, je réponds : « Gageons que je vas lui dire !… — Quoi1450 ? — Gageons que j’y vas. — Bouteille1451, me dit-il, que lu n’y vas pas ! — Bouteille ? je lui tape dans la main. — Bouteille chez Panvert, aux Portes de Fer. Va. » Je pars, tenant mon chapeau ; j’aborde monsieur le maire. « Monsieur, lui dis-je, monsieur, cela n’est pas bien à vous ; non, cela n’est pas bien. » Je gagnai la bouteille ainsi ; je me perdis. Je fus ruiné dès l’heure.
Ce qui plus lui fâchait1452, c’était sa compagnie, ces deux messieurs, et tous les passants regardant. M. le maire est gentilhomme par sa femme, née demoiselle1453 : voilà pourquoi il nous tutoie et rudoie nous autres paysans, gens de peu, bons amis pourtant de feu son père. Il semble toujours avoir peur qu’on ne le prenne pour un de nous. S’il était noble de son chef, nous le trouverions accostable. Les nobles d’origine sont moins fiers, nous accueillent au contraire, nous caressent, et ne haïssent guère qu’une sorte de gens, les vilains1454 anoblis, enrichis, parvenus.
Il ne répondit mot, et poursuivit sa chasse. Le lendemain, on m’assigne comme ayant outragé le maire dans ses fonctions ; on me met en prison deux mois, monsieur, deux mois dans le temps des récoltes, au fort de nos travaux ! Hors de là, je pensais reprendre ma charrue. Il me fait un procès pour un fossé, disant que ce fossé, au lieu d’être sur mon terrain, était sur le chemin. Je perdis encore un mois à suivre ce procès, que je gagnai vraiment ; mais je payai les frais. Il m’a fait cinq procès pareils dont j’ai perdu trois, gagné deux ; mais je paye toujours les frais. Il s’en va temps1455, monsieur, il est grand temps que je parte.
Quand j’épousai Lise Baillet, il me joua d’un autre tour. Le jour convenu, à l’heure dite, nous arrivons pour nous marier à la chambre de la commune. Il s’avise alors que mes papiers n’étaient pas en règle, n’en ayant rien dit jusque-là ; et cependant la noce prête, tout le voisinage paré, trois veaux, trente-six moutons tués… Il nous en coûta nos épargnes de plus de dix ans. Qu’y faire ? il me fallut renvoyer les conviés, et m’en aller à Nantes quérir d’autres papiers. Ma fiancée en pensa mourir de tristesse, et de regret de sa noce perdue. Nous empruntâmes à grosse usure, afin de faire une autre noce quand je fus de retour, et cette fois il nous maria. Mais le soir… écoutez ceci : Nous dansions gaiement sur la place. Monsieur le maire envoie ses gens et ses chevaux caracoler tout au travers de nos contredanses. Son valet, qui est Italien, disait, en nous foulant aux pieds, que notre nation est lâche, et capable de tout endurer désormais ; que ces choses chez lui ne se font point. Ils ont, dit-il, dans son pays, deux remèdes contre l’insolence de messieurs les maires, l’un appelé stilettata, l’autre scopettata1456. Ce sont leurs garanties, bien meilleures, selon lui, que notre conseil d’État. Où scopettade manque, stilettade s’emploie ; au moyen de quoi là le peuple se fait respecter. Sans cela, dit-il, le pays ne serait pas tenable. Pour moi, je ne sais ce qui en est ; mais semblable recette chez nous n’étant point d’usage, il ne me reste qu’un parti, de vendre ma besace et déloger sans bruit. Si je le rencontrais seulement, je serais un homme perdu. Il me ferait remettre en prison comme ayant outragé le maire : il conte ce qu’il veut dans ses procès-verbaux. Les témoins, au besoin, ne lui manquent jamais ; contre lui ne s’en trouve1457 aucun. Déposer contre le maire en justice, qui oserait ?
Si vous parlez de ceci, monsieur, dans votre estimable journal, ne me nommez pas, je vous prie. Quelque part que je sois, il peut toujours m’atteindre. Un mot au maire du lieu, et me voilà coffré. Ces messieurs entre eux ne se refusent pas de pareils services.
(Gazette du Village.)
Nodier
(1780-1844) §
Né à Besançon en 1780, mort en 1844, Jean-Charles-Emmanuel Nodier, qui publia quelques travaux d’histoire naturelle, de philologie et de bibliographie, est surtout connu comme conteur. L’expérience qu’il avait acquise de toutes les ressources, de tous les tours variés de la langue française, devait en effet le servir admirablement dans un genre où il excella. Charles Nodier, par ses conseils et ses encouragements, exerça une assez grande influence sur quelques-uns des plus illustres écrivains de l’école romantique.
Histoire du chien de Brisquet §
En notre forêt de Lions1458, vers le hameau de la Goupillière, tout près d’un grand puits-fontaine qui appartient à la chapelle Saint-Mathurin, il y avait un bonhomme, bûcheron de son état, qui s’appelait Brisquet, ou autrement le fendeur à la bonne hache, et qui vivait pauvrement du produit de ses fagots, avec sa femme, qui s’appelait Brisquette. Le bon Dieu leur avait donné deux jolis petits enfants, un garçon de sept ans, qui était brun, et qui s’appelait Biscotin, et une blondine de six ans, qui s’appelait Biscotine. Outre cela, ils avaient un chien à poil frisé, noir par tout le corps, si ce n’est au museau qu’il avait couleur de feu ; et c’était bien le meilleur chien du pays pour son attachement à ses maîtres.
On l’appelait la Bichonne, parce que c’était une chienne.
Vous vous souvenez du temps où il vint tant de loups dans la forêt de Lions ? C’était dans l’année des grandes neiges, que1459 les pauvres gens eurent si grand’peine à vivre. Ce fut une terrible désolation dans le pays.
Brisquet, qui allait toujours à sa besogne, et qui ne craignait pas les loups, à cause de sa bonne hache, dit un matin à Brisquette : « Femme, je vous prie de ne laisser courir ni Biscotin, ni Biscotine, tant que M. le grand louvetier1460 ne sera pas venu. Il y aurait du danger pour eux. Ils ont assez de quoi marcher entre la butte et l’étang, depuis que j’ai planté des piquets le long de l’étang pour les préserver d’accident. Je vous prie aussi, Brisquette, de ne pas laisser courir la Bichonne qui ne demande qu’à trotter. »
Brisquet disait tous les matins la même chose à Brisquette. Un soir, il n’arriva pas à l’heure ordinaire. Brisquette venait sur le pas de la porte, rentrait, ressortait, et disait, en se croisant les mains :
« Mon Dieu, qu’il est attardé ! »
Et puis elle sortait encore, en criant :
« Eh ! Brisquet ! »
Et la Bichonne lui sautait jusqu’aux épaules, comme pour lui dire : « N’irai-je pas ?
— Paix ! lui dit Brisquette. Écoute, Biscotine, va jusque devers1461 la butte pour savoir si ton père ne revient pas. Et toi, Biscotin, suis le chemin au long de l’étang, en prenant bien garde s’il n’y a pas de piquets qui manquent. Et crie fort : Brisquet ! Brisquet !… Paix ! la Bichonne ! »
Les enfants allèrent, allèrent, et quand ils se furent rejoints à l’endroit où le sentier de l’étang vient couper celui de la butte :
« Mordienne ! dit Biscotin, je retrouverai notre pauvre père ou les loups m’y mangeront.
— Pardienne1462 ! dit Biscotine, ils m’y mangeront bien aussi. »
Pendant ce temps-là, Brisquet était revenu par le grand chemin de Puchay, en passant à la Croix-aux-Anes sur1463 l’abbaye de Mortemer, parce qu’il avait une hottée de cotrets à fournir chez Jean Paquier.
« As-tu vu nos enfants ? lui dit Brisquette.
— Nos enfants ? dit Brisquet. Nos enfants ? mon Dieu ! sont-ils sortis ?
— Je les ai envoyés à ta rencontre jusqu’à la butte et à l’étang ; mais tu as pris par un autre chemin. »
Brisquet ne posa pas sa bonne hache. Il se mit à courir du côté de la butte.
« Si tu menais la Bichonne ? » lui cria Brisquette.
La Bichonne était déjà bien loin.
Elle était si loin que Brisquet la perdit bientôt de vue. Et il avait beau crier : « Biscotin, Biscotine ! » on ne lui répondait pas.
Alors il se prit à pleurer, parce qu’il s’imagina que ses enfants étaient perdus.
Après avoir couru longtemps, longtemps, il lui sembla reconnaître la voix de la Bichonne. Il marcha droit dans le fourré, à l’endroit où il l’avait entendue, et il y entra sa bonne hache levée. La Bichonne était arrivée là au moment où Biscotin et Biscotine allaient être dévorés par un gros loup. Elle s’était jetee devant en aboyant, pour que ses abois avertissent Brisquet. Brisquet d’un coup de sa bonne hache renversa le loup roide1464 mort, mais il était trop tard pour la Bichonne. Elle ne vivait déjà plus.
Brisquet, Biscotin et Biscotine rejoignirent Brisquette. C’était une grande joie, et cependant tout le monde pleura. Il n’y avait pas un regard qui ne cherchât la Bichonne.
Brisquet enterra la Bichonne au fond de son petit courtil1465 sous une grosse pierre sur laquelle le maître d’école écrivit en latin
C’est ici qu’est la Bichonne,
Le pauvre chien de Brisquet.
Et c’est depuis ce temps-là qu’on dit en commun proverbe : Malheureux comme le chien à Brisquet, qui n’allit qu’une fois au bois, et que le loup mangit1466.
(Contes de la veillée1467.)
Marbot
(1782-1854) §
Marcellin, baron de Marbot, était fils du général Antoine de Marbot, qui, après avoir siégé à l’Assemblée législative, servit avec distinction dans les armées de la République, et mourut en 1800 au siège de Gènes. Engagé volontaire en 1799, il fut successivement aide de camp d’Augereau de Lamies, de Massé n a, fut nommé colonel en 1812 et suivit la fortune de Napoléon jusqu’à Waterloo. Exile par le gouvernement de la Restauration, il fut plus tard chargé par le duc d’Orléans, qui devait devenir roi sous le nom de Louis-Philippe, de l’éducation militaire de son fils aîné. Aussi fut-il nommé général après la révolution de 1830 et c’est en cette qualité qu’il assista au siège d’Anvers et prit part à la guerre d’Afrique. Il mourut en 1854 ; mais ce n’est qu’en 1891 que furent publiés ses Mémoires, qui vont de sa naissance à la bataille de Waterloo. Le style, dit-il lui-même, en est « sans prétention, comme il convient à une simple narration faite en famille ». Mais Marbot se vante d’avoir assisté à tous les grands combats de l’Empire, et aucune confidence du même genre et du même temps ne nous éclaire mieux sur les sentiments de ces guerriers enthousiastes que ne lassèrent, même après ses victoires, ni les exigences, ni les revers de Napoléon1468.
Un épisode de la bataille d’Eylau §
M. Finguerlin1469 avait une nombreuse écurie dans laquelle figurait au premier rang une charmante jument appelée Lisette, excellente bête du Mecklembourg, aux allures douces, légère comme une biche, et si bien dressée qu’un enfant pouvait la conduire. Mais cette jument, lorsqu’on la montait, avait un défaut terrible et heureusement fort rare : elle mordait comme un bouledogue et se jetait avec furie sur les personnes qui lui déplaisaient, ce qui détermina M. Finguerlin à la vendre.
J’en offris mille francs, et M. Finguerlin me livra Lisette, bien qu’elle lui en eut coûté cinq mille. Pendant plusieurs mois, cette bête me donna beaucoup de peine ; il fallait quatre ou cinq hommes pour la seller et l’on ne parvenait à la brider qu’en lui couvrant les yeux et en lui attachant les quatre jambes. Mais une fois qu’on était placé sur son dos, on trouvait une monture incomparable. Cependant, comme depuis qu’elle m’appartenait, elle avait déjà mordu plusieurs personnes et ne m’avait point épargné, je pensais à m’en défaire, lorsque, ayant prisa mon service François Woirland, homme qui ne doutait de rien, celui-ci, avant d’approcher Lisette..., se munit d’un gigot rôti bien chaud, et lorsque la bête se jeta sur lui pour le mordre, il lui présenta le gigot, qu’elle saisit entre ses dents ; mais, s’étant brûlé les gencives, le palais et la langue, la jument poussa un cri, laissa tomber le gigot et dès ce moment fut soumise à Woirland, qu’elle n’osa plus attaquer. J’employai le même moyen et j’obtins un pareil résultat. Lisette, docile comme un chien, se laissa très facilement approcher par moi et par mon domestique… mais malheur aux étrangers qui passaient auprès d’elle ! ___
Telle était la jument que je montais à Eylau1470, au moment où les débris du corps d’armée du maréchal Augereau1471, écrasés par une grêle de mitraille et de boulets, cherchaient à se réunir auprès du grand cimetière… Le 14e de ligne était resté seul sur un monticule qu’il ne devait quitter que par ordre de l’Empereur. La neige ayant cessé momentanément, on aperçut cet intrépide régiment (fui, entouré par l’ennemi, agitait son aigle en l’air pour prouver qu’il tenait toujours et demandait du secours. L’Empereur, touché du magnanime dévouement de ces braves gens, résolut d’essayer de les sauver, en ordonnant au maréchal Augereau d’envoyer vers eux un officier chargé de leur dire de quitter le monticule, de former un petit carré et de se diriger vers nous, tandis qu’ une brigade de cavalerie marcherait à leur rencontre pour seconder leurs efforts.
C’était avant la grande charge faite par Murat1472; il était presque impossible d exécuter la volonté de l’Empereur, parce qu’une nuée de Cosaques nous séparant du 14e de ligne il devenait évident que l’officier qu’on allait envoyer vers ce malheureux régiment serait tué ou pris avant d’arriver jusqu’à lui. Cependant l’ordre étant positif, le maréchal dut s’y conformer.
Il était d’usage, dans l’armée impériale, que les aides de camp se plaçassent en file à quelques pas de leur général, et que celui qui se trouvait en tête marchât le premier, puis vînt se placer à la queue lorsqu’il avait rempli sa mission, afin que, chacun portant un ordre à son tour, les dangers fussent également partagés. Un brave capitaine du génie, nommé Froissard, qui, bien que n’étant pas aide de camp, était attaché au maréchal, se trouvant plus près de lui, fut chargé de porter l’ordre au 14e. M. Froissard partit au galop ; nous le perdîmes de vue au milieu des Cosaques, et jamais nous ne le revîmes ni sûmes ce qu’il était devenu. Le maréchal, voyant que le 14e de ligne ne bougeait pas, envoya un officier nommé David : il eut le même sort que Froissard, nous n’entendîmes plus parler de lui… Pour la troisième fois, le maréchal appelle : « L’officier à marcher ». — C’était mon tour !…
En voyant approcher le fils de son ancien ami, et, j ose le dire, son aide de camp de prédilection, la figure du bon maréchal fut émue, ses yeux se remplirent de larmes, car il ne pouvait se dissimuler qu’il m’envoyait à une mort presque certaine ; mais il fallait obéir à l’Empereur : j’étais soldat, on ne pouvait faire marcher un de mes camarades à ma place, et je ne l’eusse pas souffert ; c’eût été me déshonorer. Je m’élançai donc. Mais, tout en faisant le sacrifice de ma vie, je crus devoir prendre les précautions nécessaires pour la sauver. J’avais remarqué que les deux officiers partis avant moi avaient mis le sabre à la main, ce qui me portait à croire qu’ils avaient le projet de se défendre contre les Cosaques qui les attaqueraient pendant le trajet, défense irréfléchie selon moi, puisqu’elle les avait forcés à s’arrêter pour combattre une multitude d’ennemis qui avaient, fini par les accabler. Je m’y pris donc autrement, et, laissant mon sabre au fourreau, je me considérai comme un cavalier qui, voulant gagner un prix de course, se dirige le plus rapidement possible et par la ligne la plus courte vers le but indiqué, sans se préoccuper de ce qu’il va, ni à droite, ni à gauche, sur son chemin. Or, mon but étant le monticule occupé par le 14e de ligne, je résolus de m’y rendre sans faire attention aux Cosaques, que j’annulai par la pensée.
Ce système me réussit parfaitement. Lisette, plus légère qu’une hirondelle, et volant plus qu’elle ne courait, dévorait l’espace, franchissant les monceaux de cadavres d’hommes et de chevaux, les fossés, les affûts brisés, ainsi que les feux mal éteints des bivouacs. Des milliers de Cosaques éparpillés couvraient la plaine. Les premiers qui m’aperçurent firent comme des chasseurs dans une traque1473, lorsque, voyant un lièvre, ils s’annoncent mutuellement sa présence par les cris : « À vous ! à vous !… » Mais aucun de ces Cosaques n’essaya de m’arrêter, d’abord à cause de l’extrême rapidité de ma course, et probablement aussi parce qu’étant en très grand nombre chacun d’eux pensait que je ne pourrais éviter ses camarades placés plus loin ; si bien que j’échappai à tous et parvins au 14e de ligne, sans que moi ni mon excellente jument eussions la moindre égratignure !
Je trouvai le 14e formé en carré sur le haut du monticule ; mais, comme les pentes de terrain étaient fort douces, la cavalerie ennemie avait pu exécuter plusieurs charges contre le régiment français, qui, les ayant vigoureusement repoussées, était entouré par un cercle de cadavres de chevaux et de dragons russes, formant une espèce de rempart, qui rendait désormais la position presque inaccessible à la cavalerie ; car, malgré l’aide de nos fantassins, j’eus beaucoup de peine à passer par-dessus ce sanglant et affreux retranchement.
J’étais enfin dans le carré ! — Depuis la mort du colonel Savary, tué au passage de l’Ukra1474, le 14e était commandé par un chef de bataillon. Lorsque, au milieu d’une grêle de boulets, je transmis à ce militaire l’ordre de quitter sa position pour tâcher de rejoindre le corps d’armée, il me fit observer que l’artillerie ennemie, tirant depuis une heure sur le 14e, lui avait fait éprouver de telles pertes que la poignée de soldats qui lui restait serait infailliblement exterminée si elle descendait en plaine ; qu’il n’aurait d’ailleurs pas le temps de préparer l’exécution de ce mouvement, puisqu’une colonne d’infanterie russe, marchant sur lui, n’était plus qu’à cent pas de nous.
« Je ne vois aucun moyen de sauver le régiment, dit le chef de bataillon ; retournez vers l’Empereur, faites-lui les adieux du 14e de ligne, qui a fidèlement exécuté ses ordres, et portez-lui l’aigle qu’il nous avait donnée et que nous ne pouvons plus défendre ; il serait trop pénible en mourant de la voir tomber aux mains des ennemis ! » Le commandant me remit alors son aigle, que les soldats, glorieux débris de cet intrépide régiment, saluèrent pour la dernière fois des cris de : Vive l’Empereur !… eux qui allaient mourir pour lui ! C’était le Caesar, morituri te salutant de Tacite1475 ; mais ce cri était ici poussé par des héros !
Les aigles d’infanterie étaient fort lourdes, et leur poids se trouvait augmenté d’une grande et forte hampe en bois de chêne, au sommet de laquelle on la1476 fixait. La longueur de cette hampe m’embarrassait beaucoup, et, comme ce bâton dépourvu de son aigle ne pouvait constituer un trophée pour les ennemis, je résolus, avec l’assentiment du commandant, de la briser pour n’emporter que l’aigle ; mais au moment où, du haut de ma selle, je me penchais, le corps en avant, pour avoir plus de force pour arriver à séparer l’aigle de la hampe, un des nombreux boulets que nous lançaient les Lusses traversa la corne de derrière de mon chapeau à quelques lignes de ma tête !… La commotion fut d’autant plus terrible que mon chapeau, étant retenu par une forte courroie de cuir fixée sous le menton, offrait plus de résistance au coup. Je fus comme anéanti, mais ne tombai pas de cheval. Le sang me coulait par le nez, les oreilles et même les yeux ; néanmoins j’entendais encore, je voyais, je comprenais et conservais mes facultés intellectuelles, bien que mes membres fussent paralysés au point qu’il m’était impossible de remuer un seul doigt !...
Cependant, la colonne d’infanterie russe que nous venions d’apercevoir abordait le monticule ; c’étaient des grenadiers, dont les bonnets garnis de métal avaient la forme de mitres. Ces hommes, gorgés d’eau-de-vie, et en nombre infiniment supérieur, se jetèrent avec furie sur les faibles débris de l’infortuné 14e, dont les soldats ne vivaient, depuis quelques jours, que de pommes de terre et de neige fondue ; encore, ce jour-là, n’avaient-ils pas eu le temps de préparer ce misérable repas !… Néanmoins nos braves Français se défendirent vaillamment avec leurs baïonnettes, et, lorsque le carré eut été enfoncé, ils se groupèrent en plusieurs pelotons et soutinrent fort longtemps ce combat disproportionné.
Durant cette affreuse mêlée, plusieurs des nôtres, afin de n’être pas frappés par derrière, s’adossèrent aux flancs de ma jument, qui, contrairement à ses habitudes, restait fort impassible. Si j’eusse pu remuer, je l’aurais portée en avant pour l’éloigner de ce champ de carnage ; mais il m’était absolument impossible de serrer les jambes pour faire comprendre ma volonté à ma monture !… Ma position était d’autant plus affreuse que, ainsi que je l’ai déjà dit, j’avais conservé la faculté de voir et de penser. Non seulement on se battait autour de moi, ce qui m’exposait aux coups de baïonnettes, mais un officier russe, à la figure atroce, faisait de vains efforts pour me percer de son épée, et, comme la foule des combattants l’empêchait de me joindre, il me désignait du geste aux soldats qui l’environnaient et qui, me prenant pour le chef des Français, parce que j’étais seul à cheval, tiraient sur moi par-dessus la tête de leurs camarades, de sorte que de très nombreuses balles sifflaient constamment à mes oreilles. L’une d’elles m’eût certainement ôté le peu de vie qui me restait lorsqu’un incident terrible vint m’éloigner de cette affreuse mêlée.
Parmi les Français qui s’étaient adossés au flanc gauche de ma jument se trouvait un fourrier que je connaissais. Cet homme, attaqué et blessé par plusieurs grenadiers ennemis, tomba sous le ventre de Lisette et saisissait ma jambe pour tâcher de se relever, lorsqu’un grenadier russe, dont l’ivresse rendait les pas fort incertains, ayant voulu l’achever en lui perçant la poitrine, perdit l’équilibre, et la pointe de sa baïonnette mal dirigée vint s’égarer dans mon manteau gonflé par le vent. Le Russe, voyant que je ne tombais pas, laissa le fourrier pour me porter une infinité de coups d’abord inutiles, mais dont l’un, m’atteignant enfin, traversa mon bras gauche, dont je sentis avec un plaisir affreux couler le sang tout chaud. Le grenadier russe, redoublant de fureur, me portait encore un coup, lorsque, la force qu’il y mit le faisant trébucher, sa baïonnette s’enfonça dans la cuisse de ma jument, qui, rendue parla douleur à ses instincts féroces, se précipita sur le Russe, et d’une seule bouchée lui arracha avec ses dents, le nez, les lèvres, les paupières, ainsi que toute la peau du visage, et en fit une tête de mort vivante et toute rouge ! C’était horrible à voir ! Puis, se jetant avec furie au milieu des combattants, Lisette, ruant et mordant, renversé tout ce qu’elle rencontre sur son passage ! L’officier ennemi, qui avait si souvent essayé de me frapper, ayant voulu l’arrêter par la bride, elle le saisit par le ventre, et l’élevant avec facilité, elle l’emporta hors de la mêlée, au bas du monticule, où, après lui avoir arraché les entrailles à coups de dents et broyé le corps sous ses pieds, elle le laissa mourant sur la neige ! Reprenant ensuite le chemin par lequel elle était venue, elle se dirigea au triple galop vers le cimetière d’Eylau. Grâce à la selle à la housarde dans laquelle j’étais assis, je me maintins à cheval, mais un nouveau danger m’attendait.
La neige venait de recommencer à tomber, et de gros flocons obscurcissaient le jour, lorsque, arrivé près d’Eylau, je me trouvai en face d’un bataillon de la vieille garde, qui, ne pouvant distinguer au loin, me prit pour un officier ennemi conduisant une charge de cavalerie. Aussitôt le bataillon entier fit feu sur moi. Mon manteau et ma selle furent criblés de balles, mais je ne fus pas blessé, non plus que ma jument, qui, continuant sa course rapide, traversa les trois rangs du bataillon avec la même facilité qu’une couleuvre traverse une haie. Mais ce dernier élan ayant épuisé les forces de Lisette, qui perdait beaucoup de sang, cette pauvre bête s’affaissa tout d’un coup et tomba d’un côté en me faisant rouler de l’autre !… Il me sembla qu’on me berçait doucement. Enfin, je m’évanouis complètement1477.
(Mémoires, chap. XXIV.)
Lamennais
(1782-1854) §
Né en 1782 à Saint-Malo, mort en 1854, l’abbé Hugues-Félicité-Robert de la Mennais, dit Lamennais, qui se fit connaître, par la publication du premier volume de son Essai sur l’indifférence en matière de religion (1817), comme l’un des plus vigoureux et des plus brillants apologistes de la foi catholique, ne tarda pas à inquiéter les évêques et le pape par l’exposition de quelques doctrines plus hardies que sûres. Incapable de se plier sincèrement sous le joug d’une autorité légitime, Lamennais finit par rompre ouvertement avec l’Église. C’est alors qu’il publia plusieurs livres qu’on jugea dangereux, non sans raison, mais dont quelques passages, qui affectent la forme des paraboles évangéliques, sont remplis d’une inexprimable douceur : les Paroles d’un croyant (1834), le Livre du peuple (1857), une Voix de prison (1846). Citons encore de Lamennais, outre L’Esquisse d’une philosophie (1841-1846) et des Lettres, une traduction de l’Imitation de Jésus-Christ (1824) et des Evangiles (1848).
Aux enfants §
Vous êtes à vos parents un gr and sujet de soucis. N’ont-ils pas sans cesse devait les yeux vos besoins de toute sorte, et ne faut-il pas qu’ils fatiguent1478 sans cesse afin d’v subvenir ? Le jour, ils travaillent pour vous ; et la nuit encore, pendant que vous reposez, souvent ils veillent pour n’avoir pas, le lendemain, à vous répondre quand vous leur demanderez du pain : « Attendez, il n’y en a pas ».
Si vous ne pouvez maintenant partager leur tâche, efforcez-vous au moins de la leur rendre moins rude par le soin que vous prendrez de leur complaire et de les aider, selon votre âge, avec une tendresse toute filiale.
Vous manquez d’expérience et de raison : il est donc nécessaire que vous soyez guidés par leur raison et leur expérience, et ainsi, selon l’ordre naturel et la volonté de Dieu, vous devez leur obéir, prêter à leurs conseils, à leurs enseignements, une oreille docile. Les petits même des animaux n’écoutent-ils pas leur père et leur mère, et ne leur obéissent-ils pas à l’instant lorsqu’ils les appellent, ou les reprennent, ou les avertissent de ce qui leur nuirait ? Faites par devoir ce qu’ils font par instinct....
Il vient un temps où la vie décline, où le corps s’affaiblit, les forces s’éteignent ; enfants, vous devez alors à vos vieux parents les soins que vous reçûtes d’eux dans vos premières années. Qui délaisse son père et sa mère en leurs nécessités, qui demeure sec et froid à la vue de leurs souffrances et de leur dénuement, je vous le dis en vérité, son nom est écrit au lèvre du souverain Juge parmi ceux des parricides ’
(Le Livre du peuple, XIL)
Justice et charité §
Ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu’autrui nous fît, voilà la justice.
Faire pour autrui, en toute-rencontre, ce que nous voudrions qu’il fît pour nous, voilà la charité.
Un homme vivait de son labeur, lui, sa femme et ses petits enfants ; et comme il avait une bonne santé, des bras robustes, et qu’il trouvait aisément à s’employer, il pouvait sans trop de peine pourvoir à sa subsistance et à celle des siens.
Mais il arriva qu’une grande gêne étant survenue dans le pays, le travail y fut moins demandé, parce qu’il n’offrait plus de bénéfices à ceux qui le payaient, et en même temps le prix des choses nécessaires à la vie augmenta.
L’homme de labeur et sa famille commencèrent donc à souffrir beaucoup. Après avoir bientôt épuisé ses modiques épargnes, il lui fallut vendre pièce à pièce ses meubles d’abord, puis quelques-uns même de ses vêtements ; et, quand il se fut ainsi dépouillé, il demeura privé de toutes ressources, face à face avec la faim. Et la faim n’était pas entrée seule en son logis : la maladie y était aussi entrée avec elle.
Or cet homme avait deux voisins, l’un plus riche, l’autre moins.
Il s’en alla trouver le premier et il lui dit : « Nous manquons de tout, moi, ma femme et mes enfants ; ayez pitié de nous. »
Le riche lui répondit : « Que puis-je à cela ? Quand vous avez travaillé pour moi, vous ai-je retenu1479 votre salaire, ou en ai-je différé lé payement1480 ? Jamais je ne fis aucun tort ni à vous ni à nul autre : mes mains sont pures de toute iniquité. Votre misère m’afflige, mais chacun doit songer à soi dans ces temps mauvais : qui sait combien ils dureront ? »
Le pauvre père se tut, et, le cœur plein d’angoisse, il s’en retournait lentement chez lui, lorsqu’il rencontra l’autre voisin moins riche.
Celui-ci, le voyant pensif et triste, lui dit : « Qu’avez-vous ? il y a des soucis sur votre front et des larmes dans vos yeux. »
Et le père, d’une voix altérée, lui exposa son infortune.
Quand il eut achevé : « Pourquoi, lui dit l’autre, vous désoler de la sorte ? Ne sommes-nous pas frères ? et comment pourrais-je délaisser mon frère en sa détresse ? Venez, et nous partagerons ce que je tiens de la bonté de Dieu. »
La famille qui souffrait fut ainsi soulagée, jusqu’à ce qu elle pût elle-même pourvoir à ses besoins.
Plusieurs années passèrent, après lesquelles les deux riches comparurent devant le Juge souverain des actions humaines.
Et le Juge dit au premier : « Mon œil t’a suivi sur la terre : tu t’es abstenu de nuire à autrui, de violer son droit ; tu as accompli rigoureusement la loi stricte de justice ; mais en l’accomplissant, tu n’as vécu que pour toi ; ton âme sèche et dure n’a point compris la loi de l’amour. Et maintenant, dans ce monde nouveau où tu entres pauvre et nu, il te sera fait comme tu as fait aux autres. Tu as réservé pour toi seul les biens qui t’avaient été départis ; tu n’en as rien donné à tes frères : il ne te sera rien donné non plus. Tu n’as songé qu’à toi, tu n’as aimé que toi : va, et vis de toi-même. »
Et se tournant vers le second, le Juge lui dit : « Parce que tu n’as point été seulement juste, et que la charité pénétra ton cœur, parce que ta main s’ouvrit pour répandre sur tes frères moins heureux les biens dont tu étais dépositaire, et qu’elle essuya les larmes de ceux qui pleuraient, de plus grands biens te seront donnés. Va, et reçois la récompense de celui qui a pleinement accompli le devoir, la loi de justice ci la loi d’amour1481. »
(Le Livre du peuple, X.)
Guizot
(1787-1874) §
Né à Nîmes en 1787, mort en 1874, François-Pierre-Guillaume Guizot, qui fut célèbre comme professeur, comme homme politique, comme orateur, comme historien, comme critique, comme penseur, a publié, dans les loisirs que lui laissèrent ses fonctions de ministre ou son rôle de chef de parti, un très grand nombre d’ouvrages, parmi lesquels on distingue surtout Corneille et son temps (1813), Histoire de la révolution d’Angleterre (1827), complétée plus tard par d’autres travaux, Histoire générale de la civilisation en Europe (1845), Histoire de la civilisation en France (1845), Méditations sur l’état actuel de la religion chrétienne (1864), et Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps (1858-1868).
Mort de Charles 1er 1482 §
Après quatre heures d’un sommeil profond, Charles sortait de son lit : « J’ai une grande affaire à terminer, dit-il à Herbert1483, il faut que je me lève promptement » ; et il se mit à sa toilette. Herbert troublé le peignait avec moins de soin : « Prenez, je vous prie, lui dit le roi, la même peine qu’à l’ordinaire, quoique ma tête ne doive pas rester longtemps sur mes épaules ; je veux être paré aujourd’hui comme un marié ». En s’habillant, il demanda une chemise de plus : « La saison est si froide, dit-il, que je pourrais trembler ; quelques personnes l’attribueraient peut-être à la peur : je ne veux pas qu’une telle supposition soit possible. » Le jour à peine levé, l’évêque1484 arriva et commença les exercices religieux ; comme il lisait, dans le xxviie chapitre de l’Évangile selon saint Matthieu, le récit de la passion de Jésus-Christ : « Milord, lui demanda le roi, avez-vous choisi ce chapitre comme le plus applicable à ma situation ? — Je prie Votre Majesté de remarquer, répondit l’évêque, que c’est l’Évangile du jour, comme le prouve le calendrier. » Le roi parut profondément touché, et continua ses prières avec un redoublement de ferveur. Vers dix heures, on frappa doucement à la porte de la chambre. Herbert demeurait immobile : un second coup se fit entendre, un peu plus fort, quoique léger encore : « Allez voir qui est là », dit le roi : c’était le colonel Hacker. « Faites-le entrer, dit-il. — Sire, dit le colonel à voix basse et à demi tremblant, voici le moment d’aller à Whitehall1485. Votre Majesté aura encore plus d’une heure pour s’y reposer. — Je pars dans l’instant, répondit Charles ; laissez-moi. » Hacker sortit : le roi se recueillit encore quelques minutes ; puis, prenant l’évêque par la main : « Venez, dit-il, partons. Herbert, ouvrez la porte ; Hacker m’avertit pour la seconde fois » ; et il descendit dans le parc, qu’il devait traverser pour se rendre à Whitehall.
Plusieurs compagnies d’infanterie l’y attendaient, formant une double haie sur son passage : un détachement de hallebardiers marchait en avant, enseignes déployées ; les tambours battaient ; le bruit couvrait toutes les voix. A la droite du roi était l’évêque ; à la gauche, tête nue, le colonel Tomlinson, commandant de la garde, et à qui Charles, touché de ses égards, avait demandé de ne le point quitter jusqu’au dernier moment. Il s’entretint avec lui pendant la route, lui parla de son enterrement, des personnes à qui il désirait que le soin en fut confié, l’air serein, le regard brillant, le pas ferme, marchant même plus vite que la troupe, et s’étonnant de sa lenteur. Un des officiers de service, se flattant sans doute de le troubler, lui demanda s’il n’avait pas concouru, avec le feu duc de Buckingham1486, à la mort du roi son père : « Mon ami, lui répondit Charles avec mépris et douceur, si je n’avais d’autre péché que celui-là, j’en prends Dieu à témoin, je t’assure que je n’aurais pas besoin de lui demander pardon. » Arrivé à Whitehall, il monta légèrement l’escalier, traversa la grande galerie et gagna sa chambre à coucher, où on le laissa seul avec l’évêque, qui s’apprêtait à lui donner la communion. Quelques ministres indépendants1487 vinrent frapper à la porte, disant qu’ils voulaient offrir au roi leurs services : « Le roi est en prières », leur répondit Juxon ; ils insistèrent : « Eh bien ! dit Charles à l’évêque, remerciez-les en mon nom de leur offre ; mais dites-leur franchement qu’après avoir si souvent prié contre moi, et sans aucun sujet, ils ne prieront jamais avec moi pendant mon agonie. Ils peuvent, s’ils veulent, prier pour moi : j’en serai reconnaissant. » Ils se retirèrent : le roi s’agenouilla, reçut la communion des mains de l’évêque, et, se relevant avec vivacité : « Maintenant, dit-il, que ces drôles-là viennent ; je leur ai pardonné du fond du cœur ; je suis prêt à tout ce qui va m’arriver. » On avait préparé son dîner ; il n’en voulait rien prendre : « Sire, lui dit Juxon, Votre Majesté est à jeun depuis longtemps, il fait froid ; peut-être, sur l’échafaud, quelque faiblesse… — Vous avez raison », dit le roi ; et il mangea un morceau de pain et but un verre de vin. Il était une heure : Hacker frappa à la porte. Juxon et Herbert tombèrent à genoux : « Relevez-vous, mon vieil ami », dit le roi à l’évêque en lui tendant la main. Hacker frappa de nouveau ; Charles fit ouvrir la porte : « Marchez, dit-il au colonel, je vous suis ». Il s’avança le long de la salle des banquets, toujours entre deux haies de troupes ; une foule d’hommes et de femmes s’y étaient précipités au péril de leur vie, immobiles derrière la garde, et priant pour le roi à mesure qu’il passait : les soldats, silencieux eux-mêmes, ne les rudoyaient point. A l’extrémité de la salle, une ouverture, pratiquée la veille dans le mur, conduisait de plain-pied à l’échafaud tendu de noir ; deux hommes debout auprès de la hache, tous deux en habits de matelots et masqués. Le roi arriva, la tête haute, promenant de tous côtés ses regards et cherchant le peuple pour lui parler : mais les troupes couvraient seules la place ; nul ne pouvait approcher : il se tourna vers Juxon et Tomlinson ; « Je ne puis guère être entendu que de vous, leur dit-il ; ce sera donc à vous que j’adresserai quelques paroles » ; et il leur adressa, en effet, un petit discours, qu’il avait préparé, grave et calme jusqu’à la froideur, uniquement appliqué à soutenir qu’il avait eu raison, que le mépris des droits du souverain était la vraie cause des malheurs du peuple, que le peuple ne devait avoir aucune part dans le gouvernement, qu’à cette seule condition le royaume retrouverait la paix et ses libertés. Pendant qu’il parlait, quelqu’un toucha à la hache ; il se tourna précipitamment, disant : « Ne gâtez pas la hache, elle me ferait plus de mal ». Et son discours terminé, quelqu’un s’en approchant encore : « Prenez garde à la hache ! prenez garde à la hache ! » répéta-t-il d’un ton d’effroi. Le plus profond silence régnait : il mit sur sa tête un bonnet de soie, et s’adressant à l’exécuteur : « Mes cheveux vous gênent-ils ? — Je prie Votre Majesté de les ranger sous son bonnet », répondit l’homme en s’inclinant. Le roi les rangea avec l’aide de l’évêque : « J’ai pour moi, lui dit-il en prenant ce soin, une bonne cause et un Dieu clément. — Juxon. Oui, Sire, il n’v a plus qu’un pas à franchir ; il est plein de trouble et d’angoisse, mais de peu de durée ; et songez qu’il vous fait faire un grand trajet ; il vous transporte de la terre au ciel. — Le Roi. Je passe d’une couronne corruptible à une couronne incorruptible, où je n’aurai à craindre aucun trouble, aucune espèce de trouble » ; et se tournant vers l’exécuteur : « Mes cheveux sont-ils bien ? » Il ôta son manteau et son Saint-George1488, donna le Saint-George à l’évêque en lui disant : « Souvenez-vous1489 » ; ôta son habit, remit son manteau, et regardant le billot : « Placez-le de manière qu’il soit bien ferme, dit-il à l’exécuteur. — Il est ferme, Sire. — Le Roi. Je ferai une courte prière, et quand j’étendrai les mains, alors… » Il se recueillit, se dit à lui-même quelques mots à voix basse, leva les yeux au ciel, s’agenouilla, posa sa tête sur le billot : l’exécuteur toucha ses cheveux pour les ranger encore sous son bonnet ; le roi crut qu’il allait frapper : « Attendez le signe, lui dit-il. — Je l’attendrai, Sire, avec le bon plaisir de Votre Majesté ». Au bout d’un instant, le roi étendit les mains, l’exécuteur frappa, la tête tomba au premier coup : « Voilà la tête d’un traître ! » dit-il en la montrant au peuple. Un long et sourd gémissement s’éleva autour de Whitehall ; beaucoup de gens se précipitaient autour de l’échafaud pour tremper leur mouchoir dans le sang du roi. Deux corps de cavalerie, s’avançant dans deux directions différentes, dispersèrent lentement la foule. L’échafaud demeuré solitaire, on enleva le corps : il était déjà enfermé dans le cercueil ; Cromwell voulut le voir, le considéra attentivement, et soulevant de ses mains la tête comme pour s’assurer qu’elle était bien séparée du tronc : « C’était là un corps bien constitué, dit-il, et qui promettait une longue vie ».
(Histoire de la Révolution d’Angleterre1490, livre VII.)
Savoir dire non §
Lettre à Mademoiselle Henriette Guizot1491
Londres1492, 1er octobre 1840.
On me dit que tu as été bonne pour les petites Dillon1493. Tu as bien raison de penser aux autres, grands ou petits, et de t’occuper de leurs plaisirs. On ne pense jamais assez aux autres, on n’est jamais assez occupé d’eux. Tu verras, en avançant dans la vie, que le principal défaut, de beaucoup de gens, c’est de ne pas savoir se suffire à eux-mêmes. Ils ont besoin, tantôt qu’on fasse leurs affaires, tantôt qu’on les amuse. Et ils sont très reconnaissants quand on leur rend l’un ou l’autre de ces services. Avec bien peu de chose quelquefois, avec un peu d’activité et de persévérance pour autrui, on se concilie une bienveillance générale, très douce en soi, et qui peut être très utile. Et puis, c’est un vrai devoir d’être bon, aimable, de l’être à tous les moments de la journée. On fait ainsi beaucoup, beaucoup de bien : on établit autour de soi comme une atmosphère suave et douce, qui attire tout le monde et dans laquelle tout le monde aime à se trouver.
Il y a pourtant un autre conseil que je veux te donner en même temps, mon enfant, et qui semble contraire à celui-là. Il faut savoir refuser aux gens, même aux gens qu’on aime, les choses qu’il serait déraisonnable de leur accorder, qui seraient mauvaises en elles-mêmes ou injustes, ou nuisibles pour eux ou pour d’autres. Ce serait charmant de n’avoir jamais qu’à être bon et aimable, qu’à dire oui. Il faut savoir dire non et le dire très décidément. J’ai vu bien du mal produit dans le monde et dans l’intérieur de la famille, parce qu’on ne savait pas dire non, parce qu’on cédait, avec une molle complaisance, à des exigences, à des désirs que pourtant on blâmait. Tu auras à apprendre cette vertu-là, ma chère fille. Pascal, je crois, dit quelque part : « Je n’estime pas un homme qui possède une qualité, s’il ne possède en même temps la qualité contraire. S’il est doux, je veux qu’il soit ferme ; s’il est hardi, qu’il soit prudent1494 », etc.
Pascal a raison. Les mérites qu’il demande sont difficiles. Mais en fait de mérites, mon enfant, la difficulté n’est jamais une raison de renoncer. L’ambition du bien est la seule qui doive être illimitée.
Adieu, ma chère Henriette. Je t’embrasse de toute mon âme. Embrasse les autres pour moi.
(Lettres à sa famille et à ses amis1495.)
Lamartine
(1790-1869) §
Pour la notice, voir page 644.
La mort de Wilberforce1496 §
On a prononcé tout à l’heure un nom, le nom vénéré d’un homme qui passa par les mêmes épreuves que nous1497 et qui en triompha ! car toute vérité a son calvaire, où il lui faut souffrir avant de triompher. Cet homme, c’est l’apôtre de l’abolition du commerce des noirs, c’est Wilberforce !
Lui aussi, lui surtout, il lutta pendant quarante ans pour la réhabilitation de toute une race proscrite… Lui aussi, les hommes qui s’appelaient de son temps les hommes pratiques livrèrent souvent ses intentions, sa conscience, à la dérision des politiques de la Grande-Bretagne. Eh bien ! il ne désespéra pas, et il y eut un jour, un grand jour dans sa vie, un jour pour lequel il sembla avoir vécu tout le nombre de ses longues années ; ce fut le jour où le parlement de son pays vota l’acte d’émancipation1498 ! Comme s’il eût attendu le salaire de sa vie avant de la quitter, il touchait à sa dernière heure, quand ses amis vinrent lui annoncer que l’acte libérateur était voté, et que son idée à lui, son idée bafouée, calomniée, injuriée, déchirée comme le vêtement du martyr pendant un demi-siècle, était devenue une loi de son pays, et bientôt serait infailliblement une loi de l’humanité ! Le saint vieillard, absorbé déjà dans les pensées éternelles, et qui depuis longtemps n’avait pas proféré une parole, parut se ranimer comme une flamme remuée sous la cendre ; il joignit ses mains amaigries par la vieillesse et consumées par le zèle, il les éleva vers le ciel, d’où lui était venu le courage et d’où lui venait enfin la victoire : « Ce que j’ai fait est bien ! je meurs content. » Et son esprit monta peu d’instants après dans l’éternité, emportant avec lui devant Dieu les chaînes brisées d’un million d’hommes !
(Discours sur l’abolition de l’esclavage, 10 mars 1842.)
Départ de Charlotte Corday pour Paris 1499 §
Le 9 juillet, de très bonne heure, elle prit sous son bras un petit paquet de ses vêtements les plus indispensables ; elle embrassa sa tante1500, elle lui dit qu’elle allait dessiner les faneuses dans les prairies voisines. Un carton de dessin à la main, elle sortit pour ne plus rentrer.
Au pied de l’escalier elle rencontra l’enfant d’un pauvre ouvrier, nommé Robert, qui logeait dans la maison, sur la rue. L’enfant jouait habituellement dans la cour. Elle lui donnait quelquefois des images. « Tiens, Robert », lui dit-elle en lui remettant son carton de dessin, dont elle n’avait plus besoin pour lui servir de contenance, « voilà pour toi ; sois bien sage et embrasse-moi ; tu ne me reverras jamais ». Et elle embrassa l’enfant en lui laissant une larme sur la joue. Ce fut sa dernière larme sur le seuil de la maison de sa jeunesse. Elle n’avait plus à donner que son sang.
Son départ, dont on ignorait la cause, fut révélé à ses voisins de la rue Saint-Jean par une circonstance qui achève de peindre la calme sérénité de son âme jusqu’à l’extrémité de sa résolution.
En face de la maison de Mme de Bretteville, de l’autre côté de la rue Saint-Jean, habitait une respectable famille de Caen, nommée Lacouture. Le fils de la maison, passionné pour la musique, consacrait régulièrement chaque jour quelques heures de la matinée à son instrument. Ses fenêtres ouvertes en été laissaient les notes s’évaporer et retentir jusque dans les maisons voisines. Charlotte, comme pour laisser entrer plus librement ces mélodies dans sa chambre, entrouvrait aussi ses abat-jour à l’heure où commençait le concert et s’accoudait quelquefois, la tête à demi cachée dans ses rideaux, sur la margelle de la croisée, écoutant et rêvant aux sons. Le jeune musicien, encouragé par cette apparition de jeune fille attentive, ne manquait pas un jour de s’asseoir devant son clavier à la même heure ; Charlotte, pas un jour d’ouvrir ses volets. Le goût du même art semblait avoir établi une muette intelligence entre ces deux âmes qui ne se connaissaient que dans ce retentissement.
La veille du jour où Charlotte, déjà affermie dans sa résolution, se préparait à partir pour l’accomplir et mourir, le piano se fit entendre à l’heure accoutumée. Charlotte, arrachée sans doute à la fixité de ses pensées par la puissance de l’habitude et par l’attrait de l’art qu’elle aimait, ouvrit sa fenêtre comme à l’ordinaire et parut écouter les notes avec une attention aussi calme et plus rêveuse encore que les autres jours. Cependant elle referma la croisée avec une sorte de précipitation inusitée avant que le musicien eût refermé son clavier, comme si elle eût voulu s’arracher violemment elle-même, dans un adieu pénible, au dernier plaisir qui la captivait.
Le lendemain, le jeune voisin s’étant assis de nouveau devant son instrument, regarda au fond de la cour du Grand-Manoir1501 en face, si les premiers préludes feraient ouvrir les volets de la nièce de Mme de Bretteville. La fenêtre fermée ne s’ouvrit plus ! Ce fut ainsi qu’il apprit le départ de Charlotte. L’instrument résonnait encore ; l’âme de la jeune fille n’écoutait plus que l’orageuse obsession de son idée, l’appel de la mort et les éloges de la postérité.
(Histoire des Girondins, livre XLIV, xv.)
La barque brisée §
Nous nous hâtâmes1502 de descendre pour remercier la pauvre famille de l’hospitalité que nous avions reçue. Nous trouvâmes le pêcheur, la vieille mère, Beppo, Graziella1503 et jusqu’aux petits enfants, qui se disposaient à descendre vers la côte pour visiter la barque abandonnée la veille, et voir si elle était suffisamment amarrée contre le gros temps, car la tempête continuait encore. Nous descendîmes avec eux, le front baissé, timides comme des hôtes qui ont été l’occasion d’un malheur dans une famille et qui ne sont pas sûrs des sentiments qu’on y a pour eux.
Le pêcheur et sa femme nous précédaient de quelques marches ; Graziella, tenant un de ses petits frères par la main et portant l’autre sur le bras, venait après. Nous suivions derrière, en silence. Au dernier détour d’une des rampes, d’où l’on voit les écueils que l’arête d’un rocher nous empêchait d’apercevoir encore, nous entendîmes un cri de douleur s’échapper à la fois de la bouche du pêcheur et de celle de sa femme. Nous les vîmes élever leurs bras nus au ciel, se tordre les mains comme dans les convulsions du désespoir, se frapper du poing le front et les yeux, et s’arracher des touffes de cheveux blancs, que le vent emportait en tournoyant contre les rochers.
Graziella et les petits enfants mêlèrent bientôt leurs voix à ces cris. Tous se précipitèrent comme des insensés en franchissant les derniers degrés de la rampe vers les écueils, s’avancèrent jusque dans les franges d’écume que les vagues immenses chassaient à terre, et tombèrent sur la plage, les uns à genoux, les autres à la renverse, la vieille femme le visage dans ses mains et la tête dans le sable humide.
Nous contemplions cette scène de désespoir du haut du dernier petit promontoire, sans avoir la force d’avancer ni de reculer. La barque, amarrée au rocher, mais qui n’avait point d’ancre à la poupe pour la contenir, avait été soulevée pendant la nuit par les lames, et mise en pièces contre les pointes des écueils qui devaient la protéger. La moitié du pauvre esquif tenait encore par la corde au roc où nous l’avions fixé la veille. Il se débattait avec un bruit sinistre, comme des voix d’homme en perdition qui s’éteignent dans un gémissement rauque et désespéré.
Les autres parties de la coque, la poupe, le mât, les membrures1504, les planches peintes, étaient semées çà et là sur la grève, semblables aux membres des cadavres déchirés par les loups après un combat. Quand nous arrivâmes sur la plage, le vieux pêcheur était occupé à courir d’un de ces débris à l’autre. Il les relevait, il les regardait d’un œil sec, puis il les laissait retomber à ses pieds pour aller plus loin. Graziella pleurait, assise à terre, la tête dans son tablier. Les enfants, leurs jambes nues dans la mer, couraient en criant après les débris des planches, qu’ils s’efforçaient de diriger vers le rivage.
Quant à la vieille femme, elle ne cessait de gémir et de parler en gémissant. Nous ne saisissions que des accents confus et des lambeaux de plaintes qui déchiraient l’air et qui fendaient le cœur : « O mer féroce ! mer sourde ! mer pire que les démons de l’enfer ! mer sans cœur et sans honneur ! criait-elle avec des vocabulaires d’injures, en montrant le poing fermé aux flots, pourquoi ne nous as-tu pas pris nous-mêmes, nous tous, puisque tu nous as pris notre gagne-pain ? Tiens ! tiens ! tiens ! prends-moi du moins en morceaux, puisque tu ne m’as pas prise tout entière. »
Et, en disant ces mots, elle se levait sur son séant, elle jetait, avec des lambeaux de sa robe, des touffes de ses cheveux dans la mer. Elle frappait la vague du geste, elle piétinait dans l’écume ; puis, passant alternativement de la colère à la plainte et des convulsions à l’attendrissement, elle se rasseyait dans le sable, appuyait son front dans ses mains, et regardait en pleurant les planches disjointes battre l’écueil. « Pauvre barque ! criait-elle, comme si ces débris eussent été les membres d’un être chéri à peine privé de sentiment, est-ce là le sort que nous te devions ? Ne devions-nous pas périr avec toi, périr ensemble, comme nous avions vécu ? Là ! en morceaux, en débris, en poussière, criant, morte encore, sur l’écueil où tu nous as appelés toute la nuit, et où nous devions te secourir ! Qu’est-ce que tu penses de nous ? Tu nous avais si bien servis et nous t’avons trahie, abandonnée, perdue ! Perdue là, si près de la maison, à portée de la voix de ton maître ! jetée à la côte comme le cadavre d’un chien fidèle que la vague rejette aux pieds du maître qui l’a noyé ! »
Puis ses larmes étouffaient sa voix ; puis elle reprenait une à une toute l’énumération des qualités de sa barque, et tout l’argent qu’elle leur avait coûté, et tous les souvenirs qui se rattachaient pour elle à ce pauvre débris flottant. « Était-ce pour cela, disait-elle, que nous l’avions fait si bien radouber1505 et si bien peindre après la dernière pêche du thon ? Était-ce pour cela que mon pauvre fils, avant de mourir et de me laisser ses trois enfants sans père ni mère, l’avait bâtie avec tant de soins et d’amour, presque tout entière de ses propres mains ? Quand je venais prendre les paniers dans la cale, je reconnaissais les coups de sa hache dans le bois, et je les baisais en mémoire de lui ! Ce sont les requins et les crabes de la mer qui les baiseront maintenant ! Pendant les soirs d’hiver, il avait sculpté lui-même avec son couteau l’image de saint François sur une planche, et il l’avait fixée à la proue pour la protéger contre le mauvais temps. O saint impitoyable ! Comment est-il montré reconnaissant ? Qu’a-t-il fait de mon fils, de sa femme et de la barque qu’il nous avait laissée après lui pour gagner la vie de ses pauvres enfants ? Comment s’est-il protégé lui-même et où est-elle, son image, jouet des flots ?
— Mère ! mère ! cria un des enfants en ramassant sur la grève, entre deux rochers, un éclat du bateau laissé à sec par une lame, voilà le saint ! » La pauvre femme oublia toute sa colère et tous ses blasphèmes, s’élança, les pieds dans l’eau, vers l’enfant, prit le morceau de planche sculpté par son fils, et le colla sur ses lèvres en le couvrant de larmes. Puis elle alla se rasseoir, et ne dit plus rien.
(Les Confidences livre VII. Graziella ; épisode XV.)
Augustin Thierry
(1795-1856) §
Jacques-Nicolas-Augustin Thierry, né à Bleis en 1795, mort en 1856, a donné, dans son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands (1825), le modèle d’un art nouveau, qui est loin de satisfaire aux exigences de l’érudition moderne, mais qui égale celui des historiens anciens par la vivacité dramatique et le surpasse par l’éclat du coloris et le souci de l’exactitude. Les Récits des temps mérovingiens (1840), écrits selon le même système, sont, en leur genre, des œuvres parfaites, et il faut encore citer d’Augustin Thierry un important Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers Etat (1853), et, outre ses Lettres sur l’histoire de France (1827 et ses Considérations sur l’histoire de France (1840), les beaux morceaux réunis sous le titre de Dix ans d’études historiques (1854).
Naufrage de la « Blanche Nef » §
La flotte fut rassemblée au mois de décembre, dans le port de Barfleur1506. Au moment du départ, un certain Thomas, fils d’Étienne, vint trouver le roi, et, lui offrant un marc d’or, lui parla ainsi : « Étienne, fils d’Érard, mon père, a servi toute sa vie le tien sur mer, et c’est lui qui conduisait le vaisseau sur lequel ton père monta pour aller à la conquête ; seigneur roi, je te supplie de me bailler en fief1507 le même office : j’ai un navire appelé la Blanche Nef et disposé comme il convient. » Le roi répondit qu’il avait choisi le navire sur lequel il voulait passer, mais que, pour faire droit à la requête du fils d’Étienne, il confierait à sa conduite ses deux fils, sa fille et tout leur cortège. Le vaisseau qui devait porter le roi mit le premier à la voile par un vent du sud, au moment où le jour baissait, et le lendemain matin il aborda heureusement en Angleterre ; un peu plus tard, sur le soir, partit l’autre navire ; les matelots qui le conduisaient avaient demandé du vin au départ, et les jeunes passagers leur en avaient fait distribuer avec profusion. Le vaisseau était manœuvré par cinquante rameurs habiles ; Thomas, fils d’Étienne, tenait le gouvernail, et ils naviguaient rapidement par un beau clair de lune, longeant la côte voisine de Barfleur. Les matelots, animés par le vin, faisaient force de rames pour atteindre le vaisseau du roi. Trop occupés de ce désir, ils s’engagèrent imprudemment parmi des rochers à fleur d’eau, dans un lieu alors appelé le Ras de Catte, aujourd’hui Bas de Catteville1508. La Blanche Nef donna contre un écueil, de toute la vitesse de sa course, et s’entr’ouvrit par le flanc gauche : l’équipage poussa un cri de détresse qui fut entendu sur les vaisseaux du roi déjà en pleine mer ; mais personne n’en soupçonna la cause. L’eau entrait en abondance, le navire fut bientôt englouti avec tous les passagers, au nombre de trois cents personnes, parmi lesquelles il y avait dix-huit femmes. Deux hommes seulement se retinrent à la grande vergue1509, qui resta flottante sur l’eau : c’était un boucher de Rouen, nommé Bérauld, et un jeune homme de naissance plus relevée, appelé Godefroi, fils de Gilbert de l’Aigle.
Thomas, le patron de la Blanche Nef, après avoir plongé une fois, revint à la surface de l’eau ; apercevant les têtes des deux hommes qui tenaient la vergue : « Et le fils du roi, leur dit-il, qu’est-il arrivé de lui ? — Il n’a point reparu, ni lui, ni son frère, ni sa sœur, ni personne de leur compagnie. — Malheur à moi ! » s’écria le fils d’Étienne, et il replongea volontairement. Cette nuit de décembre fut extrêmement froide, et le plus délicat des deux hommes qui survivaient, perdant ses forces, lâcha le bois qui le soutenait, et descendit au fond de la mer en recommandant à Dieu son compagnon. Bérauld, le plus pauvre de tous les naufragés, dans son justaucorps1510 de peau de mouton, se soutint à la surface de l’eau : il fut le seul qui vit revenir le jour ; des pêcheurs le recueillirent dans leur barque, il survécut, et c’est de lui qu’on apprit les détails de l’événement.
(Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, livre VII)
Galeswinthé §
Le mariage de Sighebert1511, ses pompes, et surtout l’éclat que lui prêtait le rang de la nouvelle épouse, firent une vive impression sur l’esprit du roi Hilperik. Au milieu des femmes qu’il avait épousées à la manière des anciens chefs germains, sans beaucoup de cérémonie1512, il lui sembla qu’il menait une vie moins noble, moins royale que celle de son jeune frère. Il résolut de prendre, comme lui, une épouse de haute naissance ; et, pour l’imiter en tout point, il fit partir une ambassade, chargée d’aller demander au roi des Goths la main de GalesTinthe, sa fille aînée. Mais cette demande rencontra des obstacles qui ne s’étaient pas présentés pour les envoyés de Sighebert. Les Goths, plus civilisés que les Franks, et surtout plus soumis à la discipline de l’Évangile, disaient hautement que le roi Hilperik menait la vie d’un païen. De son côté, la fille aînée d’Athanaghild, naturellement timide et d’un caractère doux et triste, tremblait à l’idée d’aller si loin et d’appartenir à un pareil homme. Sa mère Goïswinthe, qui l’aimait tendrement, partageait sa répugnance, ses craintes et ses pressentiments de malheur. Le roi était indécis et différait de jour en jour sa réponse définitive. Enfin, pressé par les ambassadeurs, il refusa de rien conclure avec eux, si le roi ne s’engageait par serment à congédier toutes ses femmes et à vivre selon la loi de Dieu avec sa nouvelle épouse. Des courriers partirent pour la Gaule et revinrent, apportant de la part du roi Ililperik une promesse formelle d’abandonner tout ce qu’il avait de reines, pourvu qu’il obtînt une femme digne de lui et fille d’un roi....
A travers tous les incidents de cette longue négociation, Galeswinlhe n’avait cessé d’éprouver une grande répugnance pour l’homme auquel on la destinait et de vagues inquiétudes sur l’avenir. Les promesses faites au nom du roi Hilperik par les ambassadeurs franks n’avaient pu la rassurer. Dès qu’elle apprit que son sort venait d’être fixé d’une manière irrévocable, saisie d’un mouvement de terreur, elle courut vers sa mère, et, jetant ses bras autour d’elle, comme une enfant qui cherche du secours, elle la tint embrassée plus d’une heure en pleurant et sans dire un mot. Les ambassadeurs franks se présentèrent pour saluer la fiancée de leur roi et prendre ses ordres pour le départ ; mais, à la vue de ces deux femmes sanglotant sur le sein l’une de l’autre, et se serrant si étroitement qu’elles paraissaient liées ensemble, tout rudes qu’ils étaient, ils furent émus et n’osèrent parler de voyage. Ils laissèrent passer deux jours, et, le troisième, ils vinrent de nouveau se présenter devant la reine en lui annonçant cette fois qu’ils avaient hâte de partir, lui parlant de l’impatience de leur roi et de la longueur du chemin. La reine pleura, et demanda pour sa fille encore un jour de délai ; mais le lendemain, quand on vint lui dire que tout était prêt pour le départ : « Un seul jour encore, répondit-elle, et je ne demanderai plus rien. Savez-vous que là où vous emmenez ma fille il n’y aura plus de mère pour elle. » Mais tous les retards possibles étaient épuisés ; Athanaghild interposa son autorité de roi et de père ; et, malgré les larmes de la reine, Galeswinthe fut remise entre les mains de ceux qui avaient mission de la conduire auprès de son futur époux1513.
Une longue file de cavaliers, de voitures et de chariots de bagage, traversa les rues de Tolède1514, et se dirigea vers la porte du nord. Le roi suivit à cheval le cortège de sa fille jusqu’à un pont jeté sur le Tage, à quelque distance de la ville ; mais la reine ne put se résoudre à retournerai vite, et voulut aller au-delà. Quittant son propre char, elle s’assit auprès de Galeswinthe, et, d’étape en étape, de journée en journée, elle se laissa entraîner à plus de cent milles1515 de distance. Chaque jour elle disait :
« C’est jusque-là que je veux aller » ; et, parvenue à ce terme, elle passait outre. À l’approche des montagnes, les chemins devinrent difficiles ; elle ne s’en aperçut pas, et voulut encore aller plus loin. Mais comme les gens qui la suivaient, grossissant beaucoup le cortège, augmentaient les embarras et les dangers du voyage, les seigneurs goths résolurent de ne pas permettre que leur reine fît un mille de plus. Il fallut se résigner à une séparation inévitable, et de nouvelles scènes de tendresse, mais plus calmes, eurent lieu entre la mère et la fille. La reine exprima, en paroles douces, sa tristesse et ses craintes maternelles : « Sois heureuse, dit-elle, mais j’ai peur pour toi ; prends garde, ma fille, prends bien garde… » A ces mots, qui s’accordaient trop bien avec ses propres pressentiments, Galeswinthe pleura et répondit : « Dieu le veut, il faut que je me soumette » ; et la triste séparation s’accomplit.
Un partage se fit dans ce nombreux cortège : cavaliers et chariots se divisèrent, les uns continuant à marcher en avant, les autres retournant vers Tolède. Avant de monter sur le char qui devait la ramener en arrière, la reine des Goths s’arrêta au bord de la route et fixant ses yeux vers le chariot de sa fille, elle ne cessa de le regarder debout et immobile, jusqu’à ce qu’il disparût dans l’éloignement et dans les détours du chemin. Galeswinthe, triste, mais résignée, continua sa route vers le nord....
Cependant, Hilperik, fidèle à sa promesse, avait répudié ses femmes. Fredegonde elle-même ne put échapper à cette proscription générale. Elle s’y soumit avec une résignation apparente, avec une bonne grâce qui auraient trompé un homme beaucoup plus fin que le roi Hilperik. Il semblait qu’elle reconnût sincèrement que ce divorce était nécessaire et que son devoir était de céder la place à une reine vraiment digne de ce titre.
Les premiers mois de mariage furent, sinon heureux, du moins paisibles pour la nouvelle reine : douce et patiente, elle supportait avec résignation tout ce qu’il y avait de brusquerie sauvage dans le caractère de son mari. D’ailleurs Hilperik eut quelque temps pour elle une véritable affection : il l’aima d’abord par vanité, joyeux d’avoir en elle une épouse aussi noble que celle de son frère ; puis, lorsqu’il fut un peu blasé sur ce contentement d’amour-propre, il l’aima par avarice, à cause des grandes sommes d’argent et du grand nombre d’objets précieux qu’elle avait apportés. Mais, après s’être complu quelque temps dans le calcul de toutes ces richesses, il cessa d’y trouver du plaisir, et dès lors aucun attrait ne l’attacha plus à Galeswinthe. Ce qu’il y avait en elle de beauté morale, son peu d’orgueil, sa charité envers les pauvres, n’était pas de nature à le charmer....
Galeswinthe pleura d’abord en silence ; puis elle osa se plaindre et dire au roi qu’il n’y avait plus dans sa maison aucun honneur pour elle, mais des injures et des affronts qu’elle ne pouvait supporter. Elle demanda comme une grâce d’être répudiée, et offrit d’abandonner tout ce qu’elle avait apporté avec elle, pourvu seulement qu’il lui fût permis de retourner dans son pays.
L’abandon volontaire d’un riche trésor, le désintéressement par fierté d’âme, étaient des choses incompréhensibles pour le roi Hilperik, et, n’en ayant pas la moindre idée, il ne pouvait y croire. Aussi, malgré leur sincérité, les paroles de la triste Galeswinthe ne lui inspirèrent d’autre sentiment qu’une défiance sombre et la crainte de perdre, par une rupture ouverte, des richesses qu’il s’estimait heureux d’avoir en sa possession. Maîtrisant ses émotions et dissimulant sa pensée avec la ruse du sauvage, il changea tout d’un coup de manières, prit une voix douce et caressante, fit des protestations de repentir et d’amour qui trompèrent la fille de d’Athanaghild. Elle ne parlait plus de séparation, et se flattait d’un retour sincère, lorsqu’une nuit, par l’ordre du roi, un serviteur affidé fut introduit dans sa chambre et l’étrangla pendant qu’elle dormait. En la trouvant morte dans son lit, Hilperik joua la surprise et l’affliction ; il fit même semblant de verser des larmes, et, quelques jours après, il rendit à Fredegonde tous les droits d épouse et de reine.
Ainsi périt cette jeune femme, qu’une sorte de révélation intérieure semblait avertir d’avance du sort qui lui était réservé, figure mélancolique et douce qui traversa la barbarie mérovingienne comme une apparition d’un autre siècle. Malgré l’affaiblissement du sens moral au milieu de crimes et de malheurs sans nombre, il y eut des âmes profondément émues d’une infortune si peu méritée, et leurs sympathies prirent, selon l’esprit du temps, une couleur superstitieuse. On disait qu’une lampe de cristal, suspendue près du tombeau de Galeswintlie, le jour de ses funérailles, s’était détachée subitement, sans que personne y portât la main, et qu’elle était tombée sur le pavé de marbre sans se briser et sans s’éteindre. On assurait, pour compléter le miracle, que les assistants avaient vu le marbre du pavé céder comme une matière molle, et la lampe s’y enfoncer à demi. De semblables récits peuvent nous faire sourire, nous qui les lisons dans de vieux livres, écrits pour les hommes d’un autre âge ; mais, au vie siècle, quand les légendes passaient de bouche en bouche comme l’expression vivante et poétique des sentiments et de la foi populaires, on devenait pensif, et l’on pleurait en les entendant raconter1516.
(Récits des temps mérovingiens, Premier Récit.)
Mignet
(1796-1884) §
Né à Aix en 1796, mort en 1884, François-Auguste Mignet a laissé des ouvrages historiques moins remarquables peut-être par la vivacité du récit que par la justesse de leur pensée qui s’applique à saisir le lien des événements, par la gravité du ton, la précision du style. Citons seulement, avec une rapide Histoire de la Révolution française (1824), divers livres sur l’histoire du xvie siècle, Marie Stuart, Charles-Quint, etc., et des Notices et Mémoires historiques, qui sont restés comme des modèles1517.
Mort de Marie Stuart1518 §
L’échafaud avait été dressé dans la salle basse du château de Fotheringay1519. Il avait deux pieds et demi de hauteur et douze pieds carrés d’étendue ; il était couvert de frise1520 noire d’Angleterre, ainsi que le siège, le coussin et le billot où Marie devait s’asseoir, s’agenouiller et recevoir le coup fatal. Elle prit place sur ce siège lugubre sans changer de couleur et sans rien perdre de sa grâce et de sa majesté accoutumées, ayant à sa droite les comtes (le Shrewsbury et de Kent1521, assis, à sa gauche le shérif1522, debout, en face les deux bourreaux, vêtus de velours noir, à peu de distance, le long du mur, ses serviteurs ; et, dans le reste de la salle, retenus par une barrière que Paulet1523 gardait avec ses soldats, environ deux cents gentlemen1524 et habitants du voisinage, admis dans le château, dont on avait fermé les portes. Robert Beale1525 lut alors la sentence, que Marie écouta en silence, et si profondément recueillie en elle-même, qu’elle semblait étrangère à ce qui se passait.
Lorsque Beale eut achevé de lire, elle fit le signe de la croix… Puis, après quelques paroles données à sa justification, elle se mit à prier. Alors le docteur Fletcher, doyen protestant de Peterborough1526, que les deux comtes avaient amené avec eux, s’approcha d’elle et voulut l’exhorter à mourir. « Madame, lui dit-il, la reine, mon excellente souveraine, m’a envoyé par devers vous… » Marie, l’interrompant à ces mots, lui répondit : « Monsieur le doyen, je suis ferme dans l’ancienne religion catholique romaine, et j’entends verser mon sang pour elle ». Comme le doyen insistait avec un fanatisme indiscret, et l’engageait à renoncer à sa croyance, à se repentir, à ne mettre sa confiance qu’en Jésus-Christ seul, parce que seul il pouvait la sauver, elle le repoussa d’un accent résolu, lui déclara qu’elle ne voulait pas l’entendre, et lui ordonna de se taire. Les comtes de Shrewsbury et de Kent lui dirent alors : « Nous désirons prier pour Votre Grâce, afin que Dieu éclaire votre cœur à votre dernière heure, et que vous mouriez ainsi dans la vraie connaissance de Dieu. — Mylords, répondit Marie, si vous voulez prier pour moi, je vous en remercie, mais je ne saurais m’unir à vos prières, parce que nous ne sommes pas de la même religion. » La lutte entre les deux cultes, qui avait duré toute sa vie, se prolongea jusque sur son échafaud.
Le docteur Fletcher se mit à lire la prière des morts selon le rite anglican, tandis que Marie récitait en latin1527 les psaumes de la pénitence et de la miséricorde, et embrassait avec ferveur son crucifix. « Madame, lui dit rudement le comte de Kent, il vous sert peu d’avoir en la main cette image du Christ, si vous ne l’avez gravée dans le cœur. — Il est malaisé, lui répondit-elle, de l’avoir en la main sans que le cœur en soit touché, et rien ne sied mieux au chrétien qui va mourir que l’image de son Rédempteur. » /
Lorsqu’elle eut achevé à genoux les trois psaumes Miserere mei, Deus, etc. ; In te, Domine, speravi, etc. ; Qui habitat in adjutorio1528, elle s’adressa à Dieu en anglais et le supplia de donner la paix au monde, la vraie religion à l’Angleterre, la constance à tous les persécutés, et de lui accorder à elle-même l’assistance de sa grâce et les clartés de l’Esprit-Saint à cette heure suprême. Elle pria pour le pape, pour l’Église, pour les monarques et les princes catholiques, pour le roi son fils1529, pour la reine d’Angleterre, pour ses ennemis, et, se recommandant elle-même au Sauveur du monde, elle finit par ces paroles : « Comme tes bras, Seigneur Jésus-Christ, étaient étendus sur la croix, reçois-moi de même entre les bras étendus de ta miséricorde ! » Sa piété était si vive, son effusion si touchante, son courage si admirable, qu’elle avait arraché des larmes à presque tous les assistants.
La prière finie, elle se releva. Le terrible moment était arrivé, et le bourreau s’approcha d’elle pour l’aider à se dépouiller d’une partie de ses vêtements ; mais elle l’écarta et dit en souriant qu’elle n’avait jamais eu de pareils valets de chambre. Elle appela Jeanne Kennedy et Élisabeth Curie1530, qui étaient restées pendant tout ce temps à genoux au pied de l’échafaud, et elle commença à se déshabiller avec leur aide, ajoutant qu’elle n’avait pas coutume de le faire devant tant de monde. Les deux désolées jeunes filles lui rendaient ce triste et dernier office en pleurant. Pour arrêter l’explosion de leur douleur, elle mettait son doigt sur leur bouche, et leur rappelait qu’elle avait promis en leur nom qu’elles montreraient plus de force.
« Loin de pleurer, réjouissez-vous, leur disait-elle ; je suis bien heureuse de sortir de ce monde, et pour une aussi bonne cause. » Elle déposa son manteau, ôta son voile et ne conserva qu’une jupe de taffetas velouté rouge. Elle s’assit alors sur son siège et donna sa bénédiction à tous ses serviteurs, qui pleuraient. Le bourreau lui demanda pardon à genoux : elle répondit qu’elle l’accordait à tout le monde. Elle embrassa Elisabeth Curie et Jeanne Kennedy, les bénit en faisant le signe de la croix sur elles, et, après que Jeanne Kennedy lui eut bandé les yeux, elle leur ordonna de s’éloigner, ce qu’elles firent en sanglotant.
En même temps, elle se jeta à genoux d’un grand, courage, et, tenant toujours le crucifix entre ses mains, elle tendit le cou au bourreau. Elle disait à haute voix et avec le sentiment de la plus ardente confiance : « Mon Dieu, j’ai espéré en vous ; je remets mon âme entre vos mains ». Elle croyait qu’on la frapperait comme en France, dans une attitude droite et avec le glaive. Les deux maîtres des hautes œuvres l’avertirent de son erreur, et l’aidèrent à poser sa tête sur le billot, sans qu’elle cessât de prier. L’attendrissement était universel à la vue de cette lamentable infortune, de cet héroïque courage, de cette admirable douceur. Le bourreau lui-même était ému et la frappa d’une main mal assurée. La hache, au lieu d’atteindre le cou, tomba sur le derrière de la tête et la blessa, sans qu’elle fît un mouvement, sans qu’elle proférât une plainte. Au second coup seulement, le bourreau lui abattit la tête, qu’il montra en disant : « Dieu sauve la reine Élisabeth ! — Ainsi périssent tous ses ennemis ! » ajouta le docteur Fletcher. Une seule voix se fit entendre après la sienne, et dit Amen ! c’était celle du sombre comte de Kent1531.
(Histoire de Marie Stuart, chap. xi.)
Alfred De Vigny
(1797-1863) §
Pour la notice, voir page 607.
Prisonnier sur parole §
Jamais aucun homme ne posséda à un plus haut degré que l’amiral Collingwood1532 cette paix intérieure qui naît du sentiment du Devoir sacré, et la modeste insouciance d’un soldat à qui il importe peu que son nom soit célèbre, pourvu que la chose publique prospère… Mais j’étais trop jeune encore pour comprendre tous les mérites de ce caractère, et ce qui me saisit le plus fut l’ambition de tenir, dans mon pays, un rang pareil au sien. Lorsque je voyais les rois du Midi1533 lui demander sa protection, et Napoléon même s’émouvoir de l’espoir que Collingwood était dans les mers de l’Inde, j’en venais jusqu’ a appeler de tous mes vœux l’occasion de m’échapper, et je poussai la hâte de l’ambition que je nourrissais toujours jusqu’ a être près de manquer à ma parole. Oui, j’en vins jusque-là.
Un jour, le vaisseau l’Océan, qui nous portait, vint relâcher à Gibraltar. Je descendis à terre avec l’amiral, et en me promenant seul par la ville, je rencontrai un officier du 7e hussards1534 qui avait été fait prisonnier dans la campagne d’Espagne1535, et conduit à Gibraltar avec quatre de ses camarades. Ils avaient la ville pour prison, mais ils y étaient surveillés de près. J’avais connu cet officier en France. Nous nous retrouvâmes avec plaisir, dans une situation à peu près semblable. Il y avait si longtemps qu’un Français ne m’avait parlé français, que je le trouvai éloquent, quoiqu’il fût parfaitement sot, et au bout d’un quart d’heure nous nous ouvrîmes l’un à l’autre sur notre position. Il me dit tout de suite franchement qu’il allait se sauver avec ses camarades, qu’ils avaient trouvé une occasion excellente, et qu’il ne se le ferait pas dire deux fois pour les suivre. Il m’engagea fort à en faire autant. Je lui répondis qu’il était bien heureux d’être gardé ; mais que moi, qui ne l’étais pas, je ne pouvais pas me sauver sans déshonneur, et que lui, ses compagnons et moi n’étions point dans le même cas. Cela lui parut trop subtil. « Ma foi, je ne suis pas casuiste1536, me dit-il, et, si tu veux, je t’enverrai à un évêque qui t’en dira son opinion. Mais à ta place, je partirais. Je ne vois que deux choses, être libre ou ne pas l’être. Sais-tu bien que ton avancement est perdu, depuis plus de cinq ans que tu traînes dans ce sabot1537 anglais ? Les lieutenants du même temps que toi sont déjà colonels. »
Là-dessus ses compagnons survinrent et m’entraînèrent dans une maison d’assez mauvaise mine, où ils buvaient du vin de Xérès, et là, ils me citèrent tant de capitaines devenus généraux, et de sous-lieutenants vice-rois, que la tête m’en tourna, et je leur promis de me trouver, le surlendemain à minuit, dans le même lieu. Un petit canot devait nous y prendre, loué à d’honnêtes contrebandiers qui nous conduiraient à bord d’un vaisseau français chargé de mener des blessés de notre armée à Toulon. L’invention me parut admirable, et mes bons compagnons m’ayant fait boire force rasades pour calmer les murmures de ma conscience, terminèrent leurs discours par un argument victorieux, jurant sur leur tête qu’on pourrait avoir, à la rigueur, quelques égards pour un honnête homme qui vous avait bien traité, mais que tout les confirmait dans la certitude qu’un Anglais n’était pas un homme.
Je revins assez pensif à bord de l’Océan, et lorsque j’eus dormi, et que je vis clair dans ma position en m’éveillant, je me demandai si mes compatriotes ne s’étaient point moqués de moi. Cependant le désir de la liberté et une ambition toujours poignante et excitée depuis mon enfance me poussaient à l’évasion, malgré la honte que j’éprouvais de fausser mon serment. Je passai un jour entier près de l’amiral, sans oser le regarder en face, et je m’étudiai à le trouver inférieur et d’intelligence étroite. — Je parlai tout haut à table, avec arrogance, de la grandeur de Napoléon ; je m’exaltai, je vantai son génie universel, qui devinait les lois en faisant les codes, et l’avenir en faisant des événements. J’appuyai avec insolence sur la supériorité de ce génie, comparée au médiocre talent des hommes de tactique et de manœuvre. J’espérais être contredit ; mais, contre mon attente, je trouvai dans les officiers anglais plus d’admiration encore pour l’empereur que je ne pouvais en montrer pour leur implacable ennemi. Lord Collingwood surtout, sortant de son silence triste et de ses méditations continuelles, le loua dans des termes si justes, si énergiques, si précis faisant considérer à la fois à ses officiers la grandeur des prévisions de l’empereur, la promptitude magique de son exécution, la fermeté de ses ordres, la certitude de son jugement, sa pénétration dans les négociations, sa justesse d’idées dans les conseils, sa grandeur dans les batailles, son calme dans les dangers, sa constance dans la préparation des entreprises, sa fierté dans l’attitude donnée à la France, et enfin toutes les qualités qui composent le grand homme, que je me demandai ce que l’histoire pourrait jamais ajouter à cet éloge, et je fus atterré, parce que j’avais cherché à m’irriter contre l’amiral, espérant lui entendre proférer des accusations injustes.
J’aurais voulu, méchamment, le mettre dans son tort, et qu’un mot inconsidéré ou insultant de sa part servît de justification à la déloyauté que je méditais. Mais il semblait qu’il prît à tâche, au contraire, de redoubler déboutés, et son empressement faisant supposer aux autres que j’avais quelque nouveau chagrin dont il était juste de me consoler, ils furent tous pour moi plus attentifs et plus indulgents que jamais. J’en pris de l’humeur, et je quittai la table.
L’amiral me conduisit encore à Gibraltar le lendemain, pour mon malheur. Nous y devions passer huit jours. — Le soir de l’évasion arriva. — Ma tête bouillonnait et je délibérais toujours. Je me donnais de spécieux motifs et je m’étourdissais sur leur fausseté ; il se livrait en moi un combat violent ; mais, tandis que mon âme se tordait et se roulait sur elle-même, mon corps, comme s’il eût été arbitre entre l’ambition et l’honneur, suivait, à lui tout seul, le chemin de la fuite. J’avais fait, sans m’en apercevoir moi-même, un paquet de mes hardes, et j’allais me rendre, de la maison de Gibraltar où nous étions, à celle du rendez-vous, lorsque tout à coup je m’arrêtai, et je sentis que tout cela était impossible. — Il y a dans les actions honteuses quelque chose d’empoisonné qui se fait sentir aux lèvres d’un homme de cœur sitôt qu’il touche les bords du vase de perdition. Il ne peut même pas y goûter sans être prêt à en mourir. Quand je vis ce que j’allais faire et que j’allais manquer à ma parole, il me prit une telle épouvante que je crus que j’étais devenu fou. Je courus sur le rivage et m’enfuis de la maison fatale comme d’un hôpital de pestiférés, sans oser me retourner pour la regarder. Je me jetai à la nage, et j’abordai, dans la nuit, l’Océan, notre vaisseau, ma flottante prison. J’y montai avec emportement, me cramponnant à ses câbles ; et quand je fus sur le pont, je saisis le grand mât, je m’y attachai avec passion, comme à un asile qui me garantissait du déshonneur, et, au même instant, le sentiment de la grandeur de mon sacrifice me déchirant le cœur, je tombai à genoux, et, appuyant mon front sur les cercles de fer du grand mât, je me mis à fondre en larmes comme un enfant. — Le capitaine de l’Océan, me voyant dans cet état, me crut ou fit semblant de me croire malade, et me fit porter dans ma chambre. Je le suppliai à grands cris de mettre une sentinelle à ma porte pour m’empêcher de sortir. On m’enferma et je respirai, délivré enfin du supplice d’être mon propre geôlier.
(Servitude et Grandeur militaires1538, livre III, vi)
Thiers
(1797-1877) §
Né à Marseille en 1797, mort en 1877, Louis-Adolphe Thiers, qui fut plusieurs fois ministre sous le règne de Louis-Philippe et président de la République française en 1871, occupe une grande et glorieuse place dans l’histoire politique du xixe siècle. Ses deux œuvres les plus célèbres1539 sont une Histoire de la Révolution française (1823-1827) et surtout une Histoire du Consulat et de l’Empire (1845-1863), vaste composition d’une clarté merveilleuse. Il y faut ajouter quelques ouvrages moins importants et surtout des Discours parlementaires d’une éloquence aussi pleine et aussi pressante qu’aisée, simple, limpide.
Arrivée des français devant Moscou1540 §
L’armée française s’avançait d’un pas rapide vers les hauteurs d’où elle espérait enfin apercevoir la grande ville de Moscou. Si du côté des Russes tout était désolation, tout était joie, orgueil, brillantes illusions du côté des Français. Notre armée exténuée de fatigue, traînant avec elle beaucoup de soldats blessés qui, pouvant marcher, avaient voulu suivre, sentait s’évanouir le sentiment de ses peines à l’approche de la brillante capitale de la Moscovie. Dans ses rangs il y avait une quantité de soldats et d’officiers qui avaient été aux Pyramides, aux bords du Jourdain, à Rome, à Milan, à Madrid, à Vienne, à Berlin, et qui frémissaient d’émotion à l’idée qu’ils allaient aussi visiter Moscou, la plus puissante des métropoles de l’Orient. Sans doute l’espoir d’y trouver le repos, l’abondance, la paix probablement, entrait pour quelque chose dans leur satisfaction ; mais l’imagination, cette dominatrice des hommes, surtout des soldats, l’imagination était fortement ébranlée à la pensée d’entrer dans Moscou, après avoir pénétré dans toutes les autres capitales de l’Europe, Londres, la protégée des mers, seule exceptée. Napoléon, à cheval de bonne heure, était au milieu de ses soldats, qui, à sa vue et à l’approche de Moscou, oubliant bien des jours de mécontentement, poussaient des acclamations pour célébrer sa gloire et la leur. Le temps était beau. On bâtait le pas malgré ta chaleur, pour gravir les hauteurs d’où l’on jouirait enfin de la vue de cette capitale tant annoncée et tant promise....
Enfin, arrivée au sommet d’un coteau, l’armée découvrit tout à coup au-dessous d’elle et à une distancé assez rapprochée une ville immense, brillante de mille couleurs, surmontée d’une foule de dômes dorés resplendissants de lumière, mélange singulier de bois, de lacs, de chaumières, de palais, d’églises, de clochers, ville à la fois gothique et byzantine, réalisant tout ce que les contes orientaux racontent des merveilles de l’Asie. Tandis que les monastères flanqués de tours formaient la ceinture de cette grande cité, au centre s’élevait sur une éminence une forte citadelle, espèce de Capitole, où se voyaient à la fois les temples de la Divinité et les palais des empereurs, où, au-dessus de murailles crénelées, surgissaient des dômes majestueux, portant l’emblème qui représente toute l’histoire de la Russie et toute son ambition, la croix sur le croissant1541 renversé. Cette citadelle, c’était le Kremlin, ancien séjour des czars.
A cet aspect magique, l’imagination, le sentiment de la gloire s’exaltant à la fois, les soldats s’écrièrent tous ensemble : « Moscou ! Moscou ! » Ceux qui étaient restés au pied de la colline se hâtèrent d’accourir ; pour un moment tous les rangs furent confondus, et tout le monde voulut contempler la grande capitale où nous avait conduits une marche si aventureuse. On ne pouvait se rassasier de ce spectacle éblouissant et fait pour éveiller tant de sentiments divers. Napoléon survint à son tour, et, saisi de ce qu’il voyait, lui qui avait, comme les plus vieux soldats de l’armée, visité successivement le Caire, Memphis, le Jourdain, Milan, Vienne, Berlin, Madrid, il ne put se défendre d’une profonde émotion. Arrivé à ce faîte de sa grandeur, après lequel il allait descendre d’un pas si rapide vers l’abîme, il éprouva une sorte d’enivrement, oublia tous les reprochés que son bon sens, seule conscience des conquérants, lui adressait depuis deux mois, et pour un marnent crut encore que c’était une grande et merveilleuse entreprise que la sienne, que c’était une grande et heureuse témérité justifiée par l’événement que d’avoir osé courir de Paris à Smolensk1542, de Smolensk à Moscou ! Certain de sa gloire, il crut encore à son bonheur, et ses lieutenants, émerveillés comme lui, ne se souvenant plus de leurs mécontentements fréquents dans cette campagne, retrouvèrent pour lui ces effusions de la victoire auxquelles ils ne s’étaient pas livrés à la fin de la sanglante journée de Borodino1543. Ce moment de satisfaction, vif et court, fut l’un des plus profondément sentis de sa vie ! Hélas ! il devait être le dernier1544 !...
(Histoire du Consulat et de l’Empire, livre XLIV.)
La Bérézina1545 §
I
Éblé et ses pontonniers §
Le général Eblé partit le 241546 au soir de Lochnitza pour Borisow1547 avec ses quatre cents hommes, suivi de l’habile général Chasseloup1548, qui avait encore quelques sapeurs, mais sans aucun reste de matériel, et qui était digne de s’associer à l’illustre chef de nos pontonniers. On marcha toute la nuit, on atteignit Borisow le 25 à 5 heures du matin, on y laissa une compagnie pour faire les trompeurs apprêts d’un passage au-dessous de cette ville, et on s’engagea ensuite à travers les marécages et les bois pour remonter, par un mouvement à droite, le bord de la rivière jusqu’à Studianka. On n’arriva en cet endroit que dans l’après-midi du 25. Dans son impatience, Napoléon aurait voulu que les ponts fussent établis le 25 au soir. C’était chose impossible, mais ils pouvaient l’être le 26 en travaillant toute la nuit, ce qu’on était bien décidé à faire, quoiqu’on eût marché les deux nuits et les deux journées précédentes. Le général Eblé parla à ses hommes, leur dit que le sort de l’armée était en leurs mains, leur communiqua ses nobles sentiments, et en obtint la promesse du dévouement le plus absolu. Il fallait, par un froid qui était tout à coup redevenu des plus vifs, travailler dans l’eau toute la nuit et toute la journée du lendemain, au milieu d’énormes glaçons, peut-être sous les boulets de l’ennemi, sans une heure de repos, en prenant à peine le temps d’avaler, au lieu de pain, de viande et d’eau-de-vie, un peu de bouillie sans sel. C’était à ce prix que l’armée pouvait être sauvée. Tous ces pontonniers le promirent à leur général, et on va voir comment ils tinrent parole.
N’ayant ni le temps d’abattre des bois ni celui de les débiter, on alla au malheureux village de Studianka, on en démolit les maisons, on en retira les bois qui semblaient propres à l’établissement d’un pont, on forgea1549 les fers nécessaires pour les lier, et avec les uns et les autres on construisit une suite de chevalets1550. A la pointe du jour du 26, on fut prêt à plonger ces chevalets dans l’eau de la Bérézina....
Le projet était de jeter eux ponts à cent toises1551 de distance, l’un à gauche pour les voitures, l’autre à droite pour les piétons et les cavaliers. Cent pontonniers étaient entrés dans l’eau, et s’aidant de petits radeaux qu’on avait construits pour cet usage, avaient commencé à fixer les chevalets. L’eau gelait, et il se formait autour de leurs épaules, de leurs bras, de leurs jambes, des glaçons qui, s’attachant aux chairs, causaient de vives douleurs. Ils souffraient sans se plaindre, sans paraître même affectés, tant leur ardeur était grande. La rivière n’avait en cet endroit qu’une cinquantaine de toises de largeur, et avec vingt-trois chevalets pour chaque pont on réunit les deux bords. Afin de pouvoir transporter plus tôt des troupes sur l’autre rive, on concentra tous ses efforts sur le pont de droite, celui qui était destiné aux piétons et aux cavaliers, et à une heure de l’après-midi il fut praticable....
A quatre heures le second pont fut terminé, et Napoléon1552 s’employa de sa personne à faire défiler sur la rive droite tous ceux qui arrivaient. Quant à lui, il voulut demeurer sur la rive gauche, pour ne passer que des derniers. Le général Eblé, sans prendre lui-même un moment de repos, fit coucher sur la paille une moitié de ses pontonniers, afin qu’ils pussent se relever les uns les autres dans la pénible tâche de garder les ponts, d’en exercer la police, et de les réparer s’il survenait des accidents. Dans cette journée, on fit passer la garde à pied et ce qui restait de la garde à cheval. On commença ensuite le défilé des voitures de l’artillerie. Par malheur le pont de gauche destiné aux voitures chancelait sous le poids énorme des chariots qui se succédaient sans interruption. Pressé comme on l’était, on n’avait pas eu le temps d’équarrir1553 les bois formant le tablier du pont. On s’était servi de simples rondins, qui présentaient une surface inégale, et pour adoucir les ressauts des voitures on avait mis dans les creux de la mousse, du chanvre, du chaume, tout ce qu’on avait pu arracher du village de Studianka. Mais les chevaux enlevaient avec leurs pieds cette espèce de litière, et les ressauts étaient devenus très rudes, les chevalets qui portaient sur les fonds les moins solides avaient fléchi, le tablier avait formé dès lors des ondulations, et à 8 heures du soir trois chevalets s’étaient abîmés avec les voitures qu’ils portaient dans le lit de la Bérézina.
On fut obligé de remettre à l’ouvrage nos héroïques pontonniers, et de les faire entrer dans l’eau, qui était si froide qu’à chaque instant la glace brisée se reformait. Il fallait la rompre à coups de hache, se plonger dans l’eau, et placer de nouveaux chevalets à une profondeur de six à sept pieds1554, quelquefois de huit, dans les endroits où le pont avait fléchi. Elle n’était ailleurs que de quatre à cinq pieds. A onze heures du soir le pont redevint praticable.
Le général Eblé, qui avait eu soin de tenir éveillés une moitié de ses hommes, tandis que l’autre dormait (lui veillant toujours), fit construire des chevalets de rechange afin de parer à tous les accidents. L’événement prouva bientôt la sagesse de cette précaution. A deux heures de la nuit trois chevalets cédèrent encore au pont de gauche, celui des voitures, et par malheur au milieu du courant, là où la rivière avait sept à huit pieds de profondeur. Il fallait de nouveau se mettre au travail, et cette fois exécuter ce difficile ouvrage au milieu des ténèbres. Les pontonniers, grelottant de froid, mourant de faim, n’en pouvaient plus. Le vénérable général Eblé, qui n’avait pas comme eux la jeunesse et l’avantage d’un peu de repos pris, souffrait plus qu’eux, mais il avait la supériorité de son âme, et il la leur communiqua par ses paroles. Il fit appel à leur dévouement, leur montra le désastre assuré de l’armée s’ils ne parvenaient à rétablir le pont, et sa vertu fut écoutée. Ils se mirent à l’œuvre avec un zèle admirable. Le général Lauriston1555, qui avait été envoyé par l’Empereur pour savoir la cause de ce nouvel accident, serrait en versant des larmes la main d’Eblé et lui disait : « De grâce, hâtez-vous, car ces retards nous menacent des plus grands périls ». Sans s’impatienter de ces instances, le vieil Eblé, qui ordinairement avait la rudesse d’une âme forte et fière, lui répondait avec douleur : « Vous voyez ce que nous faisons… » et retournait non pas stimuler ses hommes, qui n’en avaient pas besoin, mais les encourager, les diriger, et quelquefois plonger sa vieillesse dans cette eau glacée que leur jeunesse supportait à peine. A six heures du matin1556, ce second accident fut réparé, et le passage du matériel d’artillerie put recommencer.
II
les retardataires1557 §
Il n’est pas besoin de dire quelle confusion effroyable se produisit alors dans la foule de ceux qui avaient négligé de passer les ponts, ou de ceux qui étaient arrivés trop tard pour en prêter. Les uns et les autres, ignorant que le premier pont était réservé aux piétons et aux cavaliers, le second aux voitures, s’entassaient avec une impatience délirante vers la double issue. Mais les pontonniers placés à la tête de celui de droite étaient obligés de repousser les voitures, et de leur indiquer le pont à gauche, situé à cent toises plus bas. Si ce n’eût été qu’une affaire de consigne, on aurait pu se relâcher ; mais c’était une nécessité absolue, puisque le pont de droite était incapable de porter des voitures. Les malheureux, obligés de rebrousser chemin, ne pouvaient rompre qu’avec la plus grande peine la colonne qui les pressait, et leur effort pour revenir sur leurs pas, opposé à l’effort de ceux qui étaient impatients d’arriver, produisait une lutte épouvantable. Ceux qui réussissaient à s’arracher à ce conflit de deux courants contraires, se rejetant de côté, y trouvaient une autre masse tout aussi serrée, celle qui se dirigeait sur le pont des voitures. La passion de parvenir aux ponts était telle, qu’on avait bientôt fini par s’immobiliser les uns les autres. Les boulets de l’ennemi, tombant au milieu de cette masse compacte, y traçaient d’affreux sillons, et arrachaient des cris de terreur aux pauvres femmes, cantinières ou fugitives, qui étaient sur les voitures avec leurs enfants. On se serrait, on se foulait, on montait sur ceux qui étaient trop faibles pour se soutenir et on les écrasait sous ses pieds. La presse était si grande que les hommes à cheval étaient, eux et leurs montures, en danger d’être étouffés. De temps en temps, des chevaux, devenus furieux, s’élançaient, ruaient, écartaient La foule, et un moment se faisaient un peu de place en renversant quantité de malheureux. Mais bientôt la masse se reformait aussi épaisse, flottant et poussant des cris douloureux sous les boulets : spectacle atroce, bien fait pour rendre odieuse, et à jamais exécrable, cette expédition insensée1558 !
L’excellent général Eblé, dont ce spectacle déchirait le cœur, voulut rétablir un peu d’ordre, mais ce fut en vain. Placé à la tête des ponts, il tâchait de parler à la foule, pour dégager au moins les plus rapprochés, et leur faciliter le moyen de passer, mais ce n’était qu’à coups de baïonnette qu’on parvenait à se faire écouter, et qu’arrachant quelques victimes, femmes, enfants ou blessés, on réussissait à les amener jusqu’à l’entrée du pont. Cette espèce de résistance qu’on s’opposait ainsi les uns aux autres par excès d’ardeur fut cause qu’il ne s’écoula pas la moitié de ceux qui auraient pu profiter des ponts. Beaucoup, de guerre lasse, se jetaient dans l’eau, d’autres y étaient poussés par la foule, essayaient de traverser à la nage, et se noyaient. D’autres, ayant cherché à passer sur la glace, la rompaient par leur poids, flottaient dessus quelque temps, et étaient emportés au loin par le courant. Et cet horrible conflit, après avoir duré toute la journée, loin de diminuer, devenait plus horrible à chaque va-et-vient de la lutte engagée entre Victor et Wittgenstein....
La nuit survenue ramena un peu de calme dans ce lieu de carnage et de confusion… Singulier flux et reflux de la multitude épouvantée ! Tant que le canon avait grondé, tout le monde voulait passer, et, à force de le vouloir, ne le pouvait plus. Quand avec la nuit vint le silence de l’artillerie, on ne songea plus qu’au danger de Se trop presser, danger dont on avait fait dans la journée une cruelle expérience ; on s’éloigna de la scène d’horreur que présentait le lieu du passage, afin, disait-on, de céder le pas aux plus impatients, de manière que la difficulté allait être maintenant de forcer ces malheureux à défiler avant l’incendie des ponts, qu’il fallait absolument détruire le lendemain, si on voulait gagner un peu d’avance sur l’ennemi.
Mais la première chose à faire était de déblayer les avenues des deux ponts de la masse de chevaux et d’hommes morts par le boulet ou par l’étouffement, de voitures brisées, d’embarras de toute espèce. C’était, suivant le langage des pontonniers, une sorte de tranchée à exécuter au milieu des cadavres et des débris de voitures. Le général Eblé, avec ses pontonniers, entreprit cette tâche aussi pénible que douloureuse. On ramassait les cadavres et on les jetait sur le côté, on traînait les voitures jusqu’au pont, et on les précipitait ensuite du tablier dans la rivière. Il restait néanmoins une masse de cadavres dont on n’avait pu délivrer les approches des deux ponts. Il fallait donc cheminer en passant sur ces corps, et au milieu de la chair et du sang.
Le soir, de neuf heures à minuit, le maréchal Victor traversa la Bérézina en se dérobant à l’ennemi, trop fatigué pour songer à nous poursuivre. Il fit écouler son artillerie par le pont de gauche, son infanterie par celui de droite, et sauf les blessés, sauf deux bouches à feu, parvint à transporter tout son monde et son matériel sur la droite de la Bérézina. Le passage opéré, il mit son artillerie en batterie afin de contenir les Russes, et de les empêcher de passer les ponts à notre suite.
Restaient plusieurs milliers de traînards débandés ou fugitifs, qui avaient encore à passer, qui dans la journée le voulaient trop, et qui le soir venu ne le voulaient plus, ou du moins ne le voulaient que le lendemain. Napoléon ayant donné l’ordre de détruire les ponts dès la pointe du jour, fit dire au général Eblé, au maréchal Victor, d’employer tous les moyens de hâter le passage de ces malheureux. Le général Eblé se rendit lui-même à leurs bivouacs, accompagné de plusieurs officiers, et les conjura de traverser la rivière, en leur affirmant qu’on allait détruire les ponts. Mais ce fut en vain. Couchés à terre, sur la paille ou sur des branches d’arbre, autour de grands feux, dévorant quelques lambeaux de cheval, ils craignaient les uns la trop grande affluence surtout pendant la nuit, les autres la perte d’un bivouac assuré pour un bivouac incertain. Or avec le froid qu’il faisait, une nuit sans repos et sans feu, c’était la mort. Le général Eblé fit incendier plusieurs bivouacs pour réveiller ces obstinés, engourdis par le froid et la fatigue ; mais ce fut sans succès. Il fallut donc voir s’écouler toute une nuit sans que l’existence des ponts, qui allait être si courte, fût utile à tant d’infortunés.
Le lendemain 29, à la pointe du jour, le général Eblé avait reçu ordre de détruire les ponts dès sept heures du matin. Mais ce noble cœur, aussi humain qu’intrépide, ne pouvait s’y décider. Il avait fait disposer d’avance sous le tablier les matières incendiaires, pour qu’a la première apparition de l’ennemi on pût mettre le feu, et qu’en attendant les retardataires eussent le temps de passer. Ayant encore été debout cette nuit, qui était la sixième, tandis que ses pontonniers avaient dans chaque journée pris un peu de repos, il était là, s’efforçant d’accélérer le passage, et envoyant dire à ceux qui étaient en retard qu’il fallait se hâter. Mais le jour venu il n’y avait plus à les stimuler, et, convaincus trop tard, ils n’étaient que trop pressés. Toutefois on défilait, mais l’ennemi était sur les hauteurs vis-à-vis. Le général Eblé, qui, d’après les ordres du quartier général, aurait dû avoir détruit les ponts à sept heures au plus tard, différa jusqu’à huit. A huit, les ordres réitérés, la vue de l’ennemi qui approchait, tout lui faisait un devoir de ne plus perdre un instant. Cependant, comme l’artillerie du maréchal Victor était là pour contenir les Russes, il était venu se placer lui-même à la culée des ponts, et retenait la main de ses pontonniers, voulant sauver encore quelques victimes, si c’était possible. En ce moment son âme si bonne, quoique si rude, souffrait cruellement.
Enfin, ayant attendu jusqu’à près de neuf heures, l’ennemi arrivant à pas accélérés, et les ponts ne pouvant plus servir qu’aux Russes si on différait davantage, il se décida, le cœur navré, et en détournant les yeux de cette scène affreuse, à faire mettre le feu. Sur-le-champ des torrents de fumée et de flammes enveloppèrent les deux ponts, et les malheureux qui étaient dessus se précipitèrent pour n’être pas entraînés dans leur chute. Du sein de la foule qui n’avait pas encore passé, un cri de désespoir s’éleva tout à coup : des pleurs, des gestes convulsifs s’apercevaient sur l’autre rive. Des blessés, de pauvres femmes tendaient les bras vers leurs compatriotes, qui s’en allaient, forcés malgré eux de les abandonner. Les uns se jetaient dans l’eau, d’autres s’élançaient sur le pont en flammes, chacun enfin tentait un effort suprême pour échapper à une captivité qui équivalait à la mort. Mais les Cosaques, accourant au galop, et enfonçant leurs lances au milieu de cette foule, tuèrent d’abord quelques-uns de ces infortunés, recueillirent les autres, les poussèrent comme un troupeau vers l’armée russe, puis fondirent sur le butin. On ne sait si ce furent six, sept ou huit mille individus, hommes, femmes, enfants, militaires ou fugitifs, cantiniers ou soldats de l’armée, qui restèrent ainsi dans les mains des Russes.
L’armée se retira profondément affectée de ce spectacle, et personne n’en fut plus affecté que le généreux et intrépide Eblé, qui, en dévouant sa vieillesse au salut de tous, pouvait se dire qu’il était le sauveur de tout ce qui n’avait pas péri ou déposé les armes. Sur les cinquante et quelque mille individus armés ou désarmés qui avaient passé la Bérézina, il n’y en avait pas un seul qui ne lui dût la vie ou la liberté, à lui et à ses pontonniers. Mais ce grand service, la plupart des pontonniers qui avaient travaillé dans l’eau l’avaient déjà payé ou allaient le payer de leur vie ; et le général Eblé lui-même avait contracté une maladie mortelle a laquelle il devait promptement succomber.
(Histoire du Consulat et de l’Empire, livre XLV.)
Michelet
(1798-1874) §
Né à Paris en 1708, mort en 1874, Jules Michelet, qui fut professeur à l’Ecole Normale, à la Sorbonne et au Collège de France, s’est immortalisé par ses œuvres historiques. Histoire romaine (1831), Précis de l’Histoire moderne (1833), Histoire de France (1837-1867), Histoire de la Révolution française (1847-1853). Son génie ardent et passionné, parfois jusqu’à la partialité, s’y reflète dans un style d’une vivacité et d’un coloris incomparables. Michelet ne raconte pas l’histoire des époques écoulées, il les fait revivre. Des mérites analogues recommandent une série d’ouvrages descriptifs dans lesquels l’historien s’est fait naturaliste, en restant un poète épris de la vie et habile à la saisir, l’Oiseau (1856), l’Insecte (1857), la Mer (1861), la Montagne (1868).
La guerre des mercenaires §
Le grand Hamilcar Barca avait laissé le commandement, d’indignation1559. La République était sous l’influence des marchands, des financiers, des percepteurs d’impôts, des administrateurs, des Hannon. Le successeur d’Hamilcar envoyait les mercenaires de Sicile1560 en Afrique, bande par bande, pour donner à la République le temps de les payer et de les licencier. Mais il semblait bien dur aux Carthaginois de mettre encore des fonds dans une affaire qui n’avait rien rapporté. Ils délibéraient toujours, pour ne pas se séparer sitôt de leur argent, et ils délibérèrent tant que l’armée de Sicile se trouva tout entière à Carthage.
Ils auraient bien voulu se débarrasser de cette armée… Mais elle était trop forte pour rien craindre. Les mercenaires se sentaient les maîtres dans Carthage ; ils commençaient à parler haut. Il n’y avait pas à marchander avec des troupes victorieuses, qui n’étaient point responsables de la honteuse issue que leurs patrons avaient donnée à la guerre. Ces hommes de fer, vivant toujours au milieu des camps, où beaucoup d’entre eux étaient nés, se trouvaient transportés dans la riche ville du soleil (Baal)1561, tout éblouissante d luxe et des arts étranges de l’Orient. Là se rencontraient l’étain de la Bretagne, le cuivre de l’Italie, l’argent d’Espagne et l’or d’Ophir1562, l’encens de Saba1563 et l’ambre des mers du Nord, l’hyacinthe et la pourpre de Tyr, l’ébène et l’ivoire de l’Éthiopie, les épices et les perles des Indes, les châles des pays sans nom de l’Asie, cent sortes de meubles précieux mystérieusement enveloppés. La statue du Soleil, toute en or pur, avec les lames d’or qui couvraient son temple, pesait, dit-on, mille talents1564. De terribles désirs s’éveillaient. Déjà divers excès avaient lieu le jour et la nuit. Les Carthaginois tremblants prièrent les chefs des mercenaires de les mener à Sicca1565, en donnant à chaque homme une pièce d’or pour les besoins les plus urgents. L’aveuglement alla au point qu’on les força d’emmener leurs femmes et leurs enfants, qu’on eût pu garder comme otages.
Là, inactifs sur la plage aride, et pleins de l’image de la grande ville, ils se mirent à supputer, à exagérer ce qu’on leur devait, ce qu’on leur avait promis dans les occasions périlleuses. Hannon, qu’on leur envoya d’abord, leur dit humblement que la République ne pouvait leur tenir parole, qu’elle était écrasée d’impôts, que, dans son dénuement, elle leur demandait la remise d’une partie de ce qu’elle leur devait. Alors un tumulte horrible s’élève, et des imprécations en dix langues. Chaque nation de l’armée s’attroupe, puis toutes les nations, Espagnols, Gaulois, Liguriens, Baléares, Grecs métis1566, Italiens déserteurs, Africains surtout, c’était le plus grand nombre. Nul moyen de s’entendre. Hannon leur faisait parler par leurs chefs nationaux ; mais ceux-ci comprenaient mal ou ne voulaient pas comprendre, et rapportaient tout autre chose aux soldats. Ce n’était qu’incertitude, équivoque, défiance et cabale. Pourquoi aussi leur envoyait-on Hannon qui jamais ne les avait vus combattre, et ne savait rien des promesses qu’on leur avait faites ? Ils marchèrent vers Carthage au nombre de vingt mille hommes, et campèrent à Tunis, qui n’en est qu’à quatre ou cinq lieues.
Alors, les Carthaginois épouvantés firent tout pour les radoucir. On leur envoya tous les vivres qu’ils voulurent et au prix qu’ils voulurent. Chaque jour venaient des députés du sénat, pour les prier de demander quelque chose : on avait peur qu’ils ne prissent tout. Leur audace devint sans bornes. Dès qu’on leur eut promis leur solde, ils demandèrent qu’on les indemnisât de leurs chevaux tués, puis ils demandèrent qu’on leur payât les vivres qu’on leur devait au prix exorbitant où ils s’étaient vendus pendant la guerre ; puis ils demandèrent je ne sais combien d’autres choses, et les Carthaginois ne surent plus comment refuser, ni comment accorder.
On leur députa alors Gescon, un de leurs généraux de Sicile, qui avait toujours pris leurs intérêts à cœur. Il arrive à Tunis, bien muni d’argent, les harangue séparément et se dispose à leur payer la solde par nations. Cette satisfaction incomplète eût peut-être tout apaisé, lorsqu’un certain Spendius, Campanien, esclave fugitif de Rome, et craignant d’être rendu à son maître, se mit à dire et à faire tout ce qu’il put pour empêcher l’accommodement. Un Africain, nommé Mathos, se joignit à lui, dans la crainte d’être puni/ comme un des principaux auteurs de l’insurrection. Celui-ci tire à part les Africains, et leur fait entendre qu’une fois les autres nations payées et licenciées, les Carthaginois éclateront contre eux, et les puniront de manière à épouvanter leurs corn-patriotes. Là-dessus s’élèvent des cris ; si quelqu’un veut parler, ils l’accablent de pierres, avant de savoir s’il parlera pour ou contre. C’était encore pis après le repas, et quand ils avaient bu ; au milieu de tant de langues, il n’y avait qu’un mot qu’ils entendissent : Frappe ; et dès que quelqu’un avait dit : Frappe, cela se faisait si vite, qu’il n’y avait pas moyen d’échapper.
Le malheureux Gescon leur tenait tête, au péril de sa vie. Il osa répondre aux Africains, qui lui demandaient les vivres avec hauteur : Allez les demander à Mathos. Alors ils se jettent furieux sur l’argent apporté par Gescon, sur lui, sur ses Carthaginois et ils les chargent de fers.
Toute guerre qui éclatait en Afrique, que l’ennemi fût Agathocle, Régulus1567 ou les mercenaires, réduisait l’empire de Carthage à ses murailles : tant son joug était détesté !… Les Africains se réunirent aux mercenaires jusqu’au nombre de soixante-dix mille. Les femmes mêmes, qui avaient vu tant de fois traîner en prison leurs maris et leurs parents, pour le payement des impôts, firent, dans chaque ville, serment entre elles de ne rien cacher de leurs effets et s’empressèrent de donner pour les troupes tout ce qu’elles avaient de meubles et de parures. Utique et Hippone Zaryte1568, qui d’abord avaient hésité, finirent par massacrer les soldats qu’y tenait Carthage, et les laissèrent sans sépulture. On en fit autant en Sardaigne et en Corse. Hannon, qu’on y envoya, fut saisi par ses troupes, qui le mirent en croix ; un parti des naturels de l’île y appela les Romains. Ceux-ci profitèrent de la détresse de Carthage, lui prirent les deux îles, et la menacèrent, en outre, de la guerre, si elle n’ajoutait au traité stipulé douze cents talents euboïques1569.
Cependant, les Carthaginois étant serrés de près dans leur ville, le parti de Barca, celui de la guerre, reprit le dessus, et Hamilcar eut le commandement des troupes. Ce général habile sut gagner les Numides, dont la cavalerie était si nécessaire dans ce pays de plaines ; ils préférèrent le service plus lucratif de Carthage, et dès lors les vivres commencèrent à manquer aux mercenaires ; la famine allait entraîner la désertion ; l’humanité politique d’Hamilcar à l’égard des prisonniers pouvait l’encourager encore. Les chefs des mercenaires tinrent conseil pour rendre impossible un rapprochement qui les eût perdus ; ils assemblent l’armée, font paraître un prétendu messager de Sardaigne avec une lettre qui les exhortait à observer de près Gescon et les autres prisonniers, à se défier des pratiques secrètes qu’on faisait en faveur des Carthaginois. Spendius, prenant alors la parole, fait remarquer la douceur perfide d’Hamilcar, et le danger de renvoyer Gescon. Il est interrompu par un nouveau messager qui se dit arrivé de Tunis, et qui apporte une lettre dans le sens de la première. Autarite, chef des Gaulois, déclare qu’il n’y a de salut que dans une rupture sans retour avec les Carthaginois ; tous ceux qui parlent autrement sont des traîtres ; il faut, pour s’interdire tout accommodement, tuer Gescon et les prisonniers faits ou à faire… Cet Autarite avait l’avantage de parler phénicien, et de se faire ainsi entendre du plus grand nombre ; car la longueur de la guerre faisait peu à peu du phénicien la langue commune, et les soldats se saluaient ordinairement dans cette langue.
Après Autarite, parlèrent des hommes de chaque nation, qui étaient obligés à Gescon, et qui demandaient qu’on lui fit grâce au moins des supplices. Comme ils parlaient tous ensemble, et chacun dans sa langue, on ne pouvait rien entendre. Mais dès qu’on entrevit ce qu’ils voulaient dire, et que quelqu’un eut crié : « Tue ! tue ! » ces malheureux intercesseurs furent assommés à coups de pierres. On prit alors Gescon et les siens, au nombre de sept cents ; on les mena hors du camp, on leur coupa les mains et les oreilles, on leur cassa les jambes, et on les jeta, encore vivants, dans une fosse. Quand Hamilcar envoya demander au moins les cadavres, les Barbares déclarèrent que tout député serait traité de même, et proclamèrent comme loi que tout prisonnier carthaginois périrait dans les supplices ; que tout allié de Carthage serait renvoyé les mains coupées. Alors commencèrent d’épouvantables représailles. Hamilcar fit jeter aux bêtes tous les prisonniers. Carthage reçut des secours d’Hiéron1570 et même de Rome, qui commençaient à craindre la victoire des mercenaires. Les Barcas et les Hannons, réconciliés par le danger, agirent de concert pour la première fois. Hamilcar, chassant les mercenaires des plaines par sa cavalerie numide, et les poussant dans les montagnes, parvint à enfermer une de leurs deux armées dans le défilé de la hache, où ils ne pouvaient ni fuir ni combattre, et ils se trouvèrent réduits par la famine à l’exécrable nécessité de se manger les uns les autres. Les prisonniers et les esclaves y passèrent d’abord ; mais quand cette ressource manqua, il fallut bien que Spendius, Autarite et les autres chefs, menacés par la multitude, demandassent un sauf-conduit pour aller trouver Hamilcar. Il ne le refusa point, et convint avec eux que, sauf dix hommes à son choix, il renverrait tous les autres, en leur laissant à chacun un habit. Le traité fait, Hamilcar dit aux envoyés : Vous êtes des dix, et il les retint. Les mercenaires étaient si bien enveloppés, que, de quarante mille, il ne s’en sauva pas un seul. L’autre armée ne fut pas plus heureuse ; Hamilcar l’extermina dans une grande bataille, et son chef Mathos, amené dans Carthage, fut livré pour jouet à une lâche populace qui se vengeait de sa peur.
Dans ce monde sanguinaire des successeurs d’Alexandre, dans cet âge de fer, la guerre des mercenaires fit pourtant horreur à tous les peuples, Grecs et Barbares, et on l’appela la guerre inexpiable.
(Histoire romaine1571, livre II, chap. iv.)
L’alouette §
L’oiseau des champs par excellence, l’oiseau du laboureur, c’est l’alouette, sa compagne assidue, qu’il retrouve partout dans son sillon pénible pour l’encourager, le soutenir, lui chanter l’espérance. Espoir, c’est la vieille devise de nos Gaulois, et c’est pour cela qu’ils avaient pris comme oiseau national1572 cet humble oiseau si pauvrement vêtu, mais si riche de cœur et de chant.
Quelle vie précaire, aventurée, au moment où elle couve ! Que de soucis, que d’inquiétudes ! A peine une motte de gazon dérobe au chien, au milan, au faucon, le doux trésor de cette mère. Elle couve à la hâte, elle élève à la hâte la tremblante couvée. Qui ne croirait que cette infortunée participera à la mélancolie de son triste voisin, le lièvre ?
Cet animal est triste et la crainte le ronge1573.
Mais le contraire a lieu par un miracle inattendu de gaieté et d’oubli facile, de légèreté, si l’on veut, et d’insouciance française : l’oiseau national, à peine hors de danger, retrouve toute sa sérénité, son chant, son indomptable joie. Autre merveille : les périls, sa vie précaire, ses épreuves cruelles, n’endurcissent pas son cœur : elle reste bonne autant que gaie, sociable et confiante, offrant un modèle assez rare, parmi les oiseaux, d’amour fraternel ; l’alouette, comme l’hirondelle, au besoin, nourrira ses sœurs....
C’est la fille du jour. Dès qu’il commence, quand l’horizon s’empourpre et que le soleil va paraître, elle part du sillon comme une flèche, porte au ciel l’hymne de joie. Sainte poésie, fraîche comme l’aube, pure et gaie comme un cœur d’enfant ! Cette voix sonore et puissante donne le signal aux moissonneurs. « Il faut partir, dit le père ; n’entendez-vous pas l’alouette ? » Elle les suit, leur dit d’avoir courage ; aux chaudes heures, les invite au sommeil, écarte les insectes. Sur la tête penchée de la jeune fille à demi éveillée, elle verse des torrents d’harmonie....
C’est un bienfait donné au monde que ce chant de lumière, et vous le retrouverez presque en tout pays qu’éclaire le soleil.
(L’Oiseau, deuxième partie : le Chant.)
La première leçon de vol §
Voulez-vous voir deux choses étonnamment analogues ? Regardez d’une part la femme au premier pas de l’enfant, et d’autre part l’hirondelle au premier vol du petit.
C’est la même inquiétude, les mêmes encouragements, les exemples et les avis, la sécurité affectée, au fond la peur, le tremblement… « Rassure-toi… Rien n’est plus facile. » En réalité, les deux mères frémissent intérieurement.
Les leçons sont curieuses. La mère se lève sur ses ailes ; il regarde attentivement et se soulève un peu aussi. Puis, vous la voyez voleter ; il regarde, agite ses ailes… Tout cela va bien encore, cela se fait dans le nid… La difficulté commence pour se hasarder d’en sortir. Elle l’appelle, elle lui montre quelque petit gibier tentant, elle lui promet récompense, elle essaye de l’attirer par l’appât d’un moucheron.
Le petit hésite encore. Et mettez-vous à sa place. Il ne s’agit pas ici de faire un pas dans une chambre, entre la mère et la nourrice, pour tomber sur des coussins. Cette hirondelle d’église, qui professe au haut de sa tour sa première leçon de vol, a peine à enhardir son fils, à s’enhardir peut-être elle-même à ce moment décisif. Tous deux, j’en suis sûr, du regard plus d’une fois mesurent
l’abîme et regardent le pavé… Pour moi, je vous le déclare, le spectacle est grand, émouvant. Il faut qu’il croie sa mère1574, il faut quelle se fie à l’aile du petit si novice encore… Des deux côtés, Dieu exige un acte de foi, de courage. Noble et sublime point de départ !… Mais il a cru, il est lancé, et il ne retombera pas. Tremblant, il nage soutenu du paternel souffle du ciel, des cris rassurants de sa mère… Tout est fini… Désormais il volera indifférent par les vents et par les orages, fort de cette première épreuve où il a volé dans la foi.
(L’Oiseau1575, deuxième partie : Éducation.)
L’armée française a Jemmapes1576 §
L’armée française fut tenue, toute une nuit, au fond d’une plaine humide, et le matin, affaiblie et détrempée, on la mena au combat. Une telle nuit, passée, l’arme au bras, par des troupes si mal habillées pour la saison, dans ces marécages, par des troupes jeunes, nullement habituées ni endurcies, eût amené un triste jour, si cette armée singulière n’eût été réchauffée d’enthousiasme, cuirassée de fanatisme1577, vêtue de sa foi.
Car enfin, ils étaient pieds nus, ou peu s’en fallait, dans l’eau et dans le brouillard que le marécage élève la nuit ; eau dessous et eau dessus. La pleine était coupée de canaux, de flaques d’eau croupissante, et là où l’on se réfugiait, croyant gagner la terre ferme, le sol tremblait sous les pieds. Nul pays n’a été plus changé par l’industrie ; l’exploitation des houillères a donné douze mille âmes au village de Jemmapes ; on a bâti, coupé les bois, séché des marais. Et avec tout cela, aujourd’hui même, le pays au-dessous des pentes est resté, généralement, une prairie très humide.
Du fond de cette prairie, nos soldats, grelottants au froid du matin, purent voir, au couronnement des redoutes, aux maisons crénelées du village, qui semblaient descendre à eux, leurs redoutables ennemis : les hussards impériaux dans leurs belles fourrures, les grenadiers hongrois dans la richesse barbare de leur costume étranger, les dragons autrichiens, majestueusement drapés dans leurs manteaux blancs•
Ce que les nôtres leur enviaient encore davantage, c’était d’avoir déjeuné. Les Autrichiens attendaient, restaurés parfaitement ; Mons1578 était derrière et fournissait tout. Pour les Français, on leur dit que la bataille ne serait pas longue, et qu’il valait mieux déjeuner vainqueurs.
Un Belge, vieillard vénérable du village de Jemmapes, qui, seul de tout le pays, tout le monde étant en fuite, resta et vit la bataille, des hauteurs voisines, nous a dit l’ineffaçable impression qu’il a conservée.
Au moment où nos colonnes se mirent en mouvement, où le brouillard de novembre, commençant à se lever, découvrit l’armée française, un grand concert d’instruments se fit entendre, une musique grave, imposante, remplit la vallée, monta aux collines, une harmonie majestueuse semblait marcher devant la France1579. Les musiques de nos brigades, partant toutes au même signal, ouvraient la bataille par la Marseillaise1580; elles la jouèrent plusieurs fois, et dans les moments d’intervalle, où les rafales effroyables du bruit des canons faisaient quelque trêve, on entendait l’hymne sacré. La rage de l’artillerie ne pouvait étouffer entièrement l’air sublime des guerres fraternelles. Le cœur du jeune homme, saisi de cette douceur inattendue, faillit lui manquer. L’artillerie ne lui faisait rien ; la musique le vainquit. C’était, comment le méconnaître ? c’était l’armée de la Justice, venant rendre au monde ses droits oubliés, la Fraternité elle-même venant délivrer ses ennemis, et, pour leurs boulets, leur offrant les bienfaits de la liberté.
(Histoire de la Révolution française1581, livre VIII, chap. V.)
Souvenirs d’enfance1582 §
La mère de Michelet §
Nous quittâmes la rue Française pour aller demeurer rue des Saints-Pères, au coin de la rue de Verneuil1583. Je me représente encore l’arrivée de notre mince mobilier dans ce local immense, délabré, où nous étions comme perdus, où rien ne fermait, qu’il était impossible de chauffer. Rien de plus affligeant que la pauvreté dans les quartiers riches, où tout vous sert de point de comparaison.
C’est là que nous fûmes accablés de toutes les misères humaines. Celle dont nous souffrîmes le plus, ce fut sans contredit le froid. Des habits légers, et, pour tout feu, une petite chaufferette au milieu de ces halles. Quant à la nourriture, elle était si frugale, que c’était une véritable sensualité pour moi de manger des légumes un peu assaisonnés.
Le croirait-on ? j’en étais venu cependant, à la longue, à tirer quelques plaisirs de l’extrême pénurie où nous vivions. Lorsque, dans nos longues courses, j’avais parcouru avec mon père tous les boulevards, tous les quais, et que nous rentrions à la maison avec quelque argent, la joie que j’éprouvais ne peut être comprise que par celui qui se serait trouvé dans la même gêne. Tout ce que les philosophes disent d’un repas sobre, acheté par la fatigue et amélioré par l’incertitude de l’avenir, je le sentais. D’ailleurs, le présent est tout pour les enfants.
Quand nous avions de quoi dîner, j’étais aussi tranquille que si nous eussions été riches pour toujours....
Celle qui souffrait sans distraction du mauvais état de nos affaires, c’était ma pauvre maman. Et je dois avouer qu’elle ne trouvait en moi que bien peu de consolations. Comme tout enfant unique et gâté, j’étais volontaire, dur même, irritable. A la moindre contradiction je me mettais en colère. Je cherchais des prétextes à la désobéissance et j’affligeais jusqu’aux larmes celle qui n’était déjà que trop accablée du poids de nos malheurs. Bientôt jetais touché de sa peine, mais j’étais trop fier pour revenir, et j’accumulais ainsi des torts graves, qui me laisseront toujours les plus cuisants remords.
Personne n’était plus raisonnable… Quand je l’ai connue, elle était déjà bien triste de nos épreuves, mais ses admirables qualités restaient tout entières. Elles faisaient équilibre à la jeunesse un peu légère de mon père, à ses crédules espérances, à sa sécurité dangereuse.
Au bout de douze ans1584, les chagrins et les privations avaient aigri son caractère. Elle attribuait tous nos malheurs à la négligence de son mari, à ses opérations légèrement entreprises.
Chaque soir, il rapportait les nouvelles du dehors, ma mère les commentait. J entrevoyais bien à ses tristesses qu’il ne la rassurait pas. Alors, craignant d’en avoir trop dit, il eût voulu se reprendre et feindre la sécurité. Avec un certain rire qu’il affectait précisément lorsqu’il avait un souci à cacher, il jetait ce mot optimiste qui lui était familier : « Oh ! n’importe, on s’en tirera ».
De là naissait, entre eux, un débat — passionné du côté de ma mère — sur les craintes, les remèdes possibles ; je ne puis dire les espérances. Tant de fois elles avaient été déçues !… D’un regard profond elle pénétrait l’avenir. Je faisais d’abord semblant de ne rien entendre, de regarder ailleurs ou de jouer avec mon chat ; mais rien ne m’échappait. Mon père écoutait tout avec une bonté, une patience digne d’Épictète1585. Je dois dire qu’à cette époque il me semblait avoir toujours tort dans sa manière, parfois légère, d’envisager nos intérêts. Aujourd’hui, plus juste envers mon père, je crois que sans ce caractère picard1586, cette jeunesse de sang, la tristesse plus naturelle1587 de ma mère, avec qui j’avais bien plus de rapports, m’aurait tué.
(Ma Jeunesse1588, livre I, chap. iii.)
Lacordaire
(1802-1861) §
Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, né en 1802 à Recey-sur-Ource, chef-lieu de canton du département de la Côte-d’Or, mort en 1861, est le plus grand orateur religieux du xixe siècle Ses Conférences de Notre-Dame (1835-1850) excitèrent un enthousiasme que justifiait, sinon la sévérité de la prédication ou la forte précision du style, du moins le vivant intérêt des sujets traités, qui se rattachaient presque tous aux préoccupations contemporaines. Il a prononcé aussi trois oraisons funèbres : la plus belle est celle du général Drouot (1847)1589.
Sentiments du général Drouot a l’égard des pauvres §
Le général Drouot1590 aimait sincèrement les hommes. Né et nourri dans la pauvreté, elle ne lui avait pas été une occasion de jeter des yeux d’envie sur les hauts rangs du monde. Il les acceptait sans colère, sans mépris, sans orgueil, avec une parfaite cordialité. Content de son sort, il n’estimait pas qu’il y en eût de plus heureux, et il a dit quelquefois, dans les ouvertures qu’il faisait de son âme, qu’il devait à Dieu la grâce de n’avoir jamais rien envié. Mais si la pauvreté ne lui avait point appris la haine des riches et des grands, elle lui avait profondément inculqué l’amour des petits. IL redescendait vers eux comme vers sa source, et dès que la fortune commença à lui sourire, il prit la résolution de partager avec les pauvres les bénéfices de sa vie. C’est là le véritable signe de l’amour : quiconque ne partage pas, n’aime pas. Le général Drouot fit son calcul. Il jugea qu’avec une petite maison, un petit jardin, et deux fois douze cents francs de rente, il serait, quoi qu’il advînt, au-dessus de tous ses besoins et de tous ses désirs. Il régla d’après ce point de vue sa dépense et ses économies, et consacra le surplus à des actes ou à des fondations de charité. Toutes les dotations et gratifications qu’il reçut sous l’Empire passèrent à de bonnes œuvres, et il leur affecta constamment son traitement de la Légion d’honneur. Rentré dans la vie privée, son revenu annuel, composé de ses économies, de sa pension de retraite, de son indemnité comme donataire de l’Empire1591 et de son traitement de la Légion d’honneur, finit par s’élever à environ douze mille francs. Il ne s’en réservait pour lui, infirme et aveugle, que deux mille quatre cents : c’était la somme qui lui avait paru dès sa jeunesse pouvoir suffire à toutes les nécessités de son existence et de sa position. Napoléon lui avait laissé deux cent mille francs par son testament ; il n’en reçut que soixante mille, par suite de la réduction des legs, et il les employa au soulagement d’anciens militaires dénués de secours. « Je suis heureux, écrivait-il, mille fois heureux d’avoir pu reconnaître les bienfaits de l’empereur en les répandant sur les soldats qui ont supporté les fatigues de nos longues guerres sans en recevoir la récompense, et surtout sur les braves vétérans de la garde qui ont suivi mon bienfaiteur à l’île d’Elbe1592, et qui lui ont donné tant de preuves de leur amour et de leur dévouement. »
Le général Drouot n’était point marié. Libre ainsi d’entraves, la bonté de son cœur s’exerçait à l’aise à l’égard des siens et des infortunes d’autrui. Il aimait tendrement ses frères et ses neveux, et leur en donna des preuves touchantes jusqu’à la fin de sa vie. Mais cet attachement naturel ne diminuait point ses entrailles pour les malheureux. Il les assistait bien souvent au-delà de ses forces, et il écrivait un jour : « Lorsque mes ressources seront entièrement épuisées, ou bien qu’elles viendront à me manquer, je me présenterai à l’hospice Saint-Julien1593 pour occuper moi-même un des lits que j’y ai fondés en faveur des vieux soldats. Si ce moment arrive, il ne sera certainement pas le moins doux de ma vie. »
Quelques mois avant sa mort, n’ayant plus rien à donner, il se souvint d’un grand uniforme qu’il conservait comme une sorte de relique de ses anciens jours. Il en fit découper et vendre les galons. Un de ses neveux lui en témoigna du regret, disant qu’il aurait eu du plaisir à le transmettre à ses enfants. « Mon neveu, répondit le général, je vous l’aurais donné volontiers ; mais j’aurais craint que vos enfants, en voyant l’uniforme de leur oncle, ne fussent tentés d’oublier une chose qu’ils doivent se rappeler toujours, c’est qu’ils sont les petits-fils d’un boulanger. »
(Éloge funèbre du général Drouot.)
Victor Hugo
(1802-1885) §
Voir la notice, page 677.
Les enseignements de l’évêque §
Dans ces tournées, il1594 était indulgent et doux, et prêchait moins qu’il ne causait. Il n’allait jamais chercher bien loin ses raisonnements et ses modèles. Aux habitants d’un pays il citait l’exemple du pays voisin. Dans les cantons où on était dur pour les nécessiteux, il disait : « Voyez les gens de Briançon. Ils ont donné aux indigents, aux veuves et aux orphelins le droit de faire faucher leurs prairies trois jours avant tous les autres. Ils leur rebâtissent gratuitement leurs maisons quand elles sont en ruine. Aussi est-ce un pays béni de Dieu. Durant tout un siècle de cent ans, il n’y a pas eu un meurtrier. »
Dans les villages âpres au gain et à la moisson, il disait : « Voyez ceux d’Embrun. Si un père de famille, au temps de la récolte, a son fils au service à l’armée et ses filles en service à la ville, et qu’il soit malade et empêché, le curé le recommande au prône ; et le dimanche, après la messe, tous les gens du village, hommes, femmes, enfants, vont dans le champ du pauvre homme lui faire sa moisson, et lui rapportent paille et grain dans son grenier. » Aux familles divisées par des questions d’argent et d’héritage, il disait : « Voyez les montagnards de Devolny, pays si sauvage qu’on n’y entend pas le rossignol une fois en cinquante ans. Eh bien, quand le père meurt dans une famille, les garçons s’en vont chercher fortune, et laissent le bien aux filles, afin qu’elles puissent trouver des maris. » Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il disait : « Voyez ces bons paysans de la vallée de Queyras. Ils sont là trois mille âmes. Mon Dieu ! c’est comme une petite république. On n’y connaît ni le juge, ni l’huissier. Le maire fait tout. Il répartit l’impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend des sentences sans frais ; et on lui obéit, parce que c’est un homme juste parmi des hommes simples. » Aux villages où il ne trouvait pas de maître d’école, il citait encore ceux de Queyras : « Savez-vous comment ils font ? disait-il. Comme un petit pays de douze et quinze feux ne peut pas toujours nourrir un magister, ils ont des maîtres d’école payés par toute la vallée, qui parcourent les villages, passant huit jours dans celui-ci, dix dans celui-là, et enseignent. Ces magisters vont aux foires où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu’ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n’enseignent qu’à lire ont une plume, ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont deux plumes ; ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont trois plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d’être ignorants ! Faites comme les gens de Queyras. »
Il parlait ainsi gravement et paternellement ; à défaut d’exemples il inventait des paraboles1595, allant droit au but, avec peu de phrases et beaucoup d’images, ce qui était Véloquence même de Jésus-Christ, convaincu et persuadant.
Sa conversation était affable et gaie. Il se mettait à la portée des deux vieilles femmes1596 qui passaient leur vie près de lui ; quand il riait, c’était le rire d’un écolier.
Madame Magloire l’appelait volontiers Votre Grandeur. Un jour, il se leva de son fauteuil et alla à sa bibliothèque chercher un livre. Ce livre était sur un des rayons d’en haut. Comme l’évêque était d’assez petite taille, il ne put y atteindre. — Madame Magloire, dit-il, apportez-moi une chaise. Ma Grandeur ne va pas jusqu’à cette planche.
Une de ses parentes éloignées, madame la comtesse de Lô, laissait rarement échapper une occasion d’énumérer en sa présence ce qu’elle appelait « les espérances » de ses trois fds. Elle avait plusieurs ascendants fort vieux et proches de la mort dont ses fds étaient naturellement les héritiers. Le plus jeune des trois avait à recueillir d’une grand’ tante cent bonnes mille livres de rentes ; le deuxième était substitué au titre de duc deN son oncle ; l’aîné devait succéder à la pairie de son aïeul. L’évêque écoutait habituellement en silence ces innocents et pardonnables étalages maternels. Une fois, pourtant, il paraissait plus rêveur que de coutume, tandis que madame de Lô renouvelait le détail de toutes ces successions et de toutes ces « espérances ». Elle s’interrompit avec quelque impatience : « Mon Dieu, mon cousin ! mais à quoi songez-vous donc. — Je songe, dit l’évêque, à quelque chose de singulier qui est, je crois, dans saint Augustin : « Mettez votre « espérance dans celui auquel on ne succède point. »
(Les Misérables, première partie, livre I, chap. iii et iv.)
Alexandre Dumas
(1803-1870) §
Né en 1805 à Villers-Cotterets (Aisne), fils d’un général renommé pour sa bravoure et son habileté et qui, né à Saint-Domingue en 1762, mourut à quarante-cinq ans d’une maladie de langueur, Alexandre Dumas1597 obtint, dès 1829, un succès retentissant en faisant représenter le drame de Henri III et sa cour, auquel succédèrent un grand nombre d’autres pièces, dont quelques-unes sont demeurées célèbres. Non moins fécond comme romancier que comme auteur dramatique, Alexandre Dumas fut peut-être le champion le plus actif de cette école romantique dont Victor Hugo fut le chef le plus autorisé1598. Mais il faut avouer que, s’il a fait preuve d’une richesse d’imagination surprenante, les caractères de ses multiples héros ne sont pas très profondément étudiés et qu’on trouve dans ses œuvres peu de pages d’un style vraiment achevé1599.
Un calligraphe §
Toute mon éducation devait se borner à savoir de latin ce qu’en savait l’abbé Grégoire1600, à étudier mes quatre règles avec M. Oblet1601, et à faire des contres, des feintes et des parades avec le père Mounier1602.
Celui de tous, il faut le dire, qui était le moins bien partagé, c’était Oblet.
J’ai toujours eu pour l’arithmétique une si profonde antipathie, que je n’ai jamais pu dépasser la multiplication. Aujourd’hui, encore, je suis incapable de faire la moindre division1603.
Mais outre une science parfaite de son Barème1604, Oblet avait une magnifique écriture. Il faisait, à main levée, non seulement toutes les lettres de l’alphabet, mais encore des ornements, des cœurs, des rosaces, Adam et Eve, le portrait de Louis XVIII, que sais-je, moi ? des choses merveilleuses.
Ah ! pour la calligraphie, c’était autre chose : j’étais doué ! Quand Oblet venait me donner ma leçon de calcul et que, pour l’acquit de sa conscience, il m’avait fait faire mes trois premières règles — je l’ai dit, jamais je n’ai dépassé la multiplication, — nous prenions de belles feuilles de papier blanc, nous taillions d’avance trois ou quatre plumes en gros, en fin, en moyen, et alors les pleins, les traits et les délié^ allaient leur train.
En trois mois j’avais atteint Oblet, et, si je ne craignais pas de blesser son amour-propre, je dirais que, sur certains points, je l’avais même dépassé.
Ces progrès dans l’écriture faisaient quelque plaisir à ma mère ; mais elle eût mieux aimé le calcul.
« L’écriture, l’écriture ! disait-elle ; le beau mérite de bien écrire ! Tous les imbéciles écrivent bien. Mais vois Bonaparte : tu as vingt lettres de lui adressées à ton père1605; peux-tu en lire une seule ?
— Aussi, madame, répondait gravement Oblet, M. Buonaparté est-il à l’île d’Elbe. »
Oblet, très royaliste, prononçait Buonaparté1606 et traitait l’ex-empereur de monsieur.
« Direz-vous, reprenait ma mère, qu’il soit à l’île d’Elbe pour n’avoir pas su écrire ?
— Pourquoi ne le dirais-je pas ? C’est une thèse à soutenir, madame. On dit que M. Buonaparté a été trahi par ses maréchaux ; moi, je dis : « La Providence a voulu que cet usurpateur ne sût point écrire, que ses ordres fussent illisibles, et que, par conséquent, ils ne pussent être exécutés. » Les maréchaux trahissaient ?… Non, madame ; ils lisaient mal, et faisaient le contraire de ce qui leur était ordonné. De là nos revers, de là nos défaites, de là la prise de Paris, de là l’exil à l’île d’Elbe !
— Mais laissons là Bonaparte, monsieur Oblet.
— C’est vous qui avez mis cet homme sur le tapis, et non pas moi, madame ; moi, je ne parle jamais de cet homme.
— Mais enfin, si Alexandre.....
— Si monsieur votre fils, madame, est un jour empereur des Français, comme il aura, ou plutôt comme il a une magnifique écriture, ses ordres seront littéralement exécutés, ou ses maréchaux ne sauront pas lire. »
Et ma mère, que cette éventualité ne consolait pas de mon inaptitude au calcul, poussait un gros soupir,… et je continuais mes cinq genres d’écriture, mes pleins et mes déliés, mes ornements, mes cœurs et mes rosaces avec Oblet.
(Mes Mémoires, XXXI.)
Mérimée
(1803-1870) §
Né à Paris en 1805, mort en 1870, Prosper Mérimée a atteint la perfection dans le genre secondaire de la nouvelle. La Chronique du règne de Charles IX (1829), Colomba (1840), Mateo Falcone, la Prise de la Redoute, et tant d’autres récits d’étendue variée, mais d’un égal intérêt, sont de véritables chefs-d’œuvre. Mérimée a laissé aussi quelques études d’art et d’archéologie, des récits historiques, exacts et même colorés, mais un peu froids, et des Lettres1607.
La noce espagnole §
On célébrait une noce dans une métairie des environs d’Andujar1608. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis et l’on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison ; chacun était en disposition de bien faire, et les émanations des jasmins et des orangers en fleur se mêlaient agréablement aux parfums plus substantiels s’exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d’un coup parut un homme à cheval, sortant d’un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L’inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main, et conduisit son cheval à l’écurie. On n’attendait personne ; mais, en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D’ailleurs l’étranger, à son habillement, paraissait être un homme d’importance. Le marié se détacha aussitôt pour l’inviter à dîner.
Pendant qu’on se demandait tout bas quel était cet étranger, le notaire d’Àndujar, qui assistait à la noce, était devenu pâle comme la mort. Il essayait de se lever de la chaise qu’il occupait auprès de la mariée ; mais ses genoux pliaient sous lui, et ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Un des convives, soupçonné depuis longtemps de s’occuper de contrebande, s’approcha de la mariée : « C’est José Maria1609, dit-il ; je me trompe fort, ou il vient ici pour faire quelque malheur. C’est au notaire qu’il en veut. Mais que faire ? Le faire échapper ? Impossible ; José Maria l’aurait bientôt rejoint. Arrêter le brigand ? Mais sa bande est sans doute aux environs ; d’ailleurs, il porte des pistolets à sa ceinture et son poignard ne le quitte jamais. — Mais, monsieur le notaire, que lui avez-vous donc fait ?
— Hélas ! rien, absolument rien ! »
Quelqu’un murmura tout bas que le notaire avait dit à son fermier, deux mois auparavant, que, si José Maria venait jamais lui demander â boire, il devrait mettre un gros1610 d’arsenic dans son vin. On délibérait encore sans entamer la olla1611, quand l’inconnu reparut suivi du marié. Plus de doute, c’était José Maria. Il jeta en passant un coup d’œil de tigre au notaire, qui se mit à trembler comme s’il avait eu le frisson de la fièvre ; puis il salua la mariée avec grâce, et lui demanda la permission de danser à sa noce. Elle n’eut garde de refuser ou de lui faire mauvaise mine. José Maria prit aussitôt un tabouret de liège, l’approcha de la table, s’assit sans façon à côté de la mariée, entre elle et le notaire, qui paraissait à tout moment sur le point de s’évanouir, déclara à la jeune femme qu’il la priait de le tenir pour son serviteur ; et qu’il ferait avec joie tout ce qu’elle voudrait bien lui commander.
Alors celle-ci, toute tremblante et se penchant timidement à l’oreille de son terrible voisin :
« Accordez-moi une grâce, dit-elle.
— Mille ! s’écria José Maria.
— Oubliez, je vous en conjure, les mauvais vouloirs que vous avez peut-être apportés ici. Promettez-moi que, pour l’amour de moi, vous pardonnerez à vos ennemis, et qu’il n’y aura pas de scandale à ma noce.
— Notaire ! dit José Maria se tournant vers l’homme de loi tremblant, remerciez madame : sans elle, je vous aurais tué avant que vous eussiez digéré votre dîner. N’ayez plus peur, je ne vous ferai pas de mal. »
Et, lui versant un verre de vin, il ajouta avec un sourire un peu méchant : « Allons, notaire, à ma santé ! ce vin est bon et il n’est pas empoisonné ». Le malheureux notaire croyait avaler un cent d’épingles.
« Allons, enfants ! s’écria le voleur, de la gaieté, vive la mariée ! »
Et, se levant avec vivacité, il courut chercher une guitare et se mit à improviser un couplet en l’honneur des nouveaux époux.
Bref, pendant le reste du dîner et le bal qui le suivit, il se rendit tellement aimable, que les femmes avaient les larmes aux yeux en pensant qu’un aussi charmant garçon finirait peut-être un jour à la potence. Il dansa, il chanta, il se fit tout à tous. Vers minuit, une petite fille de douze ans, à demi vêtue de mauvaises guenilles, s’approcha de José Maria, et lui dit quelques mots dans l’argot des Bohémiens José Maria tressaillit ; il courut à l’écurie, d’où il revint bientôt emmenant son bon cheval. Puis, s’avançant vers la mariée, un bras passé dans la bride :
« Adieu ! dit-il, jamais je n’oublierai les moments que j ai passés auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j’aie vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d’un pauvre diable qui voudrait avoir une mine à vous offrir. » Il lui présenta en même temps une jolie bague.
« José Maria, s’écria la mariée, tant qu’il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. »
Le voleur serra la main à tous les convives, celle même du notaire, puis, sautant lestement en selle, il regagna ses montagnes. Alors seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après arriva un détachement de miquelets1612; mais personne n’avait vu1613 l’homme qu’ils cherchaient.
(Mosaïque. Lettres d’Espagne, III.)
En temps de guerre civile §
« L’Amiral1614 vous a fait pendre ! s’écria Mergy1615; vous êtes bien gaillard pour un pendu.
— Oui, il m’a fait pendre ; mais je ne suis pas rancunier, et buvons à sa santé. »
Avant que Mergy pût renouveler ses questions, le capitaine1616 avait rempli tous les verres, ôté son chapeau et ordonné à ses cavaliers de pousser trois hourras. Les verres vidés et le tumulte apaisé, Mergy reprit :
« Pourquoi donc avez-vous été pendu, capitaine ?
— Pour une bagatelle ; un méchant couvent de Saintonge pillé, puis brûlé par hasard. Cependant l’Amiral, le croiriez-vous, monsieur de Mergy ? l’Amiral s’en fâcha tout de bon ; il me fit arrêter, et, sans plus de cérémonie, son grand prévôt1617 jeta son dévolu sur moi. Alors tous ses gentilshommes et tous les seigneurs qui l’entouraient, jusqu’à M. de Lanoue1618, qui, comme on le sait, n’est pas tendre pour le soldat (car Lanoue, disent-ils, noue et ne dénoue pas), tous les capitaines le prièrent de me pardonner, mais lui refusa tout net. Ventre de loup ! comme il était en colère ! il mâchait son cure-dent, de rage ; et vous savez le proverbe : Dieu nous garde des patenôtres de M. de Montmorency1619 et du cure-dent de M. l’Amiral1620 ! « Dieu m’absolve ! disait-il, il faut tuer la picorée1621 tandis « qu’elle n’est encore que petite fille ; si nous la laissons « devenir grande dame, c’est elle qui nous tuera. » Là-dessus arrive le ministre1622, son livre sous le bras ; on nous mène tous deux sous un certain chêne… il me semble que je le vois encore, avec une branche en avant, qui avait l’air d’avoir poussé là tout exprès ; on m’attache la corde au cou… Toutes les fois que je pense à cette corde-là, mon gosier devient sec comme de l’amadou… Je ne me regardais déjà ni plus ni moins qu’un gland de chêne, quand je m’avisai de dire à l’Amiral :
« Eh ! Monseigneur, est-ce qu’on pend ainsi un homme « qui a commandé les Enfants perdus à Dreux1623 ? » Je le vis cracher son cure-dent, et en prendre un neuf. Je me dis : « Bon ! c’est bon signe. » Il appela le capitaine Cormier, et lui parla bas ; puis il dit au prévôt : « Allons, qu’on « me hisse cet homme. » Et là-dessus il tourne les talons. On me hissa tout de bon ; mais le brave Cormier mit l’épée à la main et coupa aussitôt la corde, de sorte que je tombai de ma branche, rouge comme une écrevisse cuite.
— Je vous félicite, dit Mergy, d’en avoir été quitte à si bon compte.
Il considérait le capitaine avec attention, et semblait éprouver quelque peine à se trouver dans la compagnie d’un homme qui avait mérité justement la potence ; mais, dans ce temps malheureux, les crimes étaient si fréquents qu’on ne pouvait guère les juger avec autant de rigueur qu’on le ferait aujourd’hui. Les cruautés d’un parti autorisaient en quelque sorte les représailles, et les haines de religion étouffaient presque tout sentiment de sympathie nationale.
« L’Amiral fit semblant d’être fort en colère contre Cormier ; mais tout cela était une farce jouée entre eux deux. Pour moi, je fus longtemps à la suite de l’armée1624, n’osant jamais me montrer devant l’Amiral ; enfin, au siège de Longnac1625, il me découvrit dans la tranchée, et il me dit : « Dietrich, mon ami, puisque tu n’es pas « pendu, va te faire arquebuser. » Et il me montrait la brèche ; je compris ce qu’il voulait dire, je montai bravement à l’assaut, et je me présentai à lui le lendemain, dans la grande rue, tenant à la main mon chapeau percé d’une arquebusade : « Monseigneur, lui dis-je, j’ai été « arquebusé comme j’ai été pendu. » Il sourit et me donna sa bourse en disant : « Voilà pour t’avoir un chapeau « neuf. » Depuis ce temps nous avons toujours été bons amis. »
(Chronique du règne de Charles IX1626, I.)
Edgar Quinet
(1803-1875) §
Né à Bourg en 1803, mort en 1875, Edgar Quinet, qui fui professeur de littérature étrangère à la Faculté de Lyon (1839), puis occupa la chaire de langues et littératures de l’Europe méridionale au Collège de France (1842-1846), se distingua, pendant toute sa carrière, par l’ardeur de ses opinions libérales ; député en 1847, représentant du peuple en 1848, il tut exilé en 1852, et passa à l’étranger les dix-huit ans que dura le second empire ; rentré en France en 1870, il fut de nouveau élu député en 1871. Son œuvre est multiple : d’une manière générale, on peut dire qu’il fut surtout préoccupé de chercher dans l’histoire de l’humanité la confirmation de ses théories plus généreuses que précises sur la souveraineté du droit et de la conscience. Son style, toujours chaleureux, parait parfois un peu emphatique : Quinet n’arrive pas, comme Michelet, son ami, à se préserver de la déclamation à force de souplesse dans le sentiment et de pittoresque dans l’expression. Ce fut un citoyen d’un beau caractère, à l’esprit ouvert et curieux, plus qu’un grand penseur et un grand écrivain. Citons, parmi ses livres les plus connus, de vastes poèmes en prose : Ahasvérus (1830), Merlin l’enchanteur (1860) ; d’autres en vers : Napoléon (1835), Prométhée (1838) ; et des œuvres historiques : Marnix de Sainte-Aldegonde, la Révolution1627.
Lutèce §
Un jour (moment immortel !) au lever du soleil, Merlin et Viviane1628 arrivèrent au bord d’un fleuve aux eaux tranquilles, verdâtres, qui serpentait dans un lit embarrassé d’herbes et de jonces, à travers une forêt de chênes, de bouleaux et de hêtres. Les deux rives étaient couvertes d’ombre et de mystère ; le lieu paraissait inhabité, hormis par des hérons immobiles sur la lisière des marécages et par quelques pics-verts1629 qui, debout contre le tronc des vieux chênes, attendaient qu’une voix d’oracle sortît de la moelle des arbres centenaires.
Celui qui a perdu son chemin dans les forêts de l’Amérique, celui-là a rencontré des solitudes aussi profondes, sans pouvoir dire si elles resteront le domaine des bêtes sauvages ou si c’est là le berceau d’un peuple naissant. Ce lieu abritera-t-il un nid d’oiseau, d’insecte, une fourmilière ou un empire ? Qui le sait ? Toute la sagesse humaine ne pourrait décider encore entre l’empire et la fourmi.
Au milieu du fleuve, nos voyageurs aperçoivent une île boisée, plantureuse, bordée de peupliers qui perçaient un épais brouillard ; elle avait la forme allongée d’une barque dont la proue fend lé cours de l’eau. Ils n’y entendirent, en s’approchant, aucun bruit, si ce n’est le gloussement d’une poule et les cris d’une volée de moineaux effrayés qui s’abattaient bruyamment sur un pommier en fleur. A ce bruit, Merlin tourne la tête : la brume, dont la terre était enveloppée, venait de s’éclaircir au premier souffle du jour ; elle laissa voir un petit village de chaumine1630, ramassé au milieu de l’îlot sous le massif frissonnant des aunes. La fumée des cabanes se perdait dans l’air bleu avec la vapeur matinale qu’un beau rayon d’automne achevait de dissiper.
« Quel lieu plaisant ! s’écria l’Enchanteur, et que je voudrais y aborder ! »
Or il y avait justement tout près de là un bûcheron qui venait de couper sa charge de ramée, et il se préparait à entrer dans une barque ; déjà il détachait la corde de chanvre par laquelle elle était liée au rivage.
« Prenez-nous avec vous, cria Merlin.
— Volontiers », dit le paysan.
Merlin et Viviane s’assirent en souriant dans le fond de la barque, sur la ramée amoncelée.
« Quel est ce fleuve ? dit Merlin.
— La Seine.
— Et ce village ?
— Lutèce. »
*
* *
Une enceinte de palissades aiguës pour s’abriter contre la terreur nocturne des forêts inconnues, une tour de bois pour le veilleur dont la trompe a annoncé le lever du jour, quelques cabanes moussues de pêcheurs au large toit, des enclos d’épines, des filets suspendus sous l’auvent prolongé des chaumières, des oies errantes, criardes, sous les pas de Merlin, à travers les places, çà et là une filandière farouche sur son seuil, un enfant suspendu à la mamelle, un pécheur qui tresse sa nasse d’osier, un laboureur qui parque ses deux taureaux demi-domptés dans l’endroit de refuge, une odeur de paille jonchée, d’étables fumantes, de poissons béants au soleil, peut-être aussi de vignes ou de sureau, des aboiements de chiens de bergers, des sonneries de troupeaux, des bruits d’avirons, des cris de bateliers, au loin le hurlement sonore d’un louveteau dans la forêt du Louvre1631, oui, voilà Lutèce !
Merlin, avant d’aborder, contempla à loisir, sur les deux rives, les lieux déserts, la forêt profonde, sacrée, d’où surgissaient alors les cimes ombragées de Montmartre, de Saint-Cloud, du mont Valérien1632, comme les têtes chevelues des noirs bisons s’élèvent par-dessus les pâturages tout humides de l’eau des sources invisibles.
La plaine herbeuse, sorte de savane d’Europe, se déroulait au loin, sans fin, sans bornes, çà et là tachetée d’or, ou éclairée d’un blanc mat par le reflet d’une eau dormante où le soleil plongeait et qu’il illuminait de feux éblouissants sous le feuillage lustré des chênes. Le vent qui passait sur la cime grêle des bouleaux leur arrachait comme un vagissement de nouveau-né. Un seul sentier, à peine tracé, fréquenté par de grandes couleuvres, à la robe d’émeraude, traversait la plaine depuis le village jusqu’à Montmartre. A travers l’épaisseur de l’ombre blanchissaient au loin des mamelons de craie et de plâtre, souillés, éboulés, déchirés par les pluies d’orage, comme des sépulcres entr’ouverts qui vomissent les ossements d’un monde de géants dans le berceau d’un peuple.
À l’endroit où s’élèvent aujourd’hui Saint-Roch, Saint-Merry, Saint-Germain, SainteSulpice1633, tournoyaient dans l’air, d’un vol rapide, effaré, des multitudes d’éperviers, de buses, de milans et même des mouettes, des orfraies égarées qui remontaient alors la Seine : tous ensemble planaient, avec des cris perçants, au-dessus du cadavre de quelque cerf mort de vieillesse, enfoui au plus épais du bois sous les broussailles, et que les loups commençaient à dépecer. Par-dessus cette mer de verdure, la montagne de Geneviève1634, enveloppée elle-même à sa cime d’une guirlande de forêts comme d’une couronne murale, regardait Montmartre et semblait dire : « Le pied de l’homme nous foulera-t-il jamais ? »
(Merlin l’enchanteur, livre II, ch. iv et v.)
La « Marseillaise » §
La véritable réponse au manifeste de Brunswick1635 fut la Marseillaise de Rouget de Lisle1636.
Un chant sortit de toutes les bouches ; on eût pu croire que la nation entière l’avait composé ; car au même moment, il éclata en Alsace, en Provence, dans les villes et dans la plus misérable chaumière. C’était d’abord un élan de confiance magnanime, un mouvement serein, la tranquille assurance du héros qui prend ses armes et s’avance ; l’horizon lumineux de gloire s’ouvre devant lui1637. Soudainement le cœur se gonfle de colère à la pensée de la tyrannie. Un premier cri d’alarme, répété deux fois, signale de loin l’ennemi1638. Tout se tait ; on écoute, et au loin on croit entendre, on entend sur un ton brisé les pas des envahisseurs dans l’ombre ; ils viennent par des chemins cachés, sourds ; le cliquetis des armes les annonce en pleine nuit, et par-dessus ce bruit souterrain, vous discernez la plainte, le gémissement des villes prisonnières. L’incendie rougit les ténèbres1639. Un grand silence succède, pendant lequel résonnent les pas confus d’un peuple qui se lève ; puis ce cri imprévu, gigantesque, qui perce les nues : Aux armes ! Ce cri de la France, prolongé d’échos en échos, immense, surhumain, remplit la terre !… Et, encore une fois, le vaste silence de la terre et du ciel ! et comme un commandement militaire à un peuple de soldats !1640 Alors la marche cadencée, la danse guerrière d’une nation dont tous les pas sont comptés. A la fin, comme un coup de tonnerre, tout se précipite. La victoire a éclaté en même temps que la bataille1641.
(La Révolution, livre XI, iii.)
George Sand
(1804-1876) §
Née en 1804, morte en 1876 au château de Nohant (Indre), Aurore Dupin dame Dudevant, qui s’est fait connaître sous le pseudonyme de George Sand, est un des plus grands écrivains du xixe siècle. Quelques-uns de ses romans sont des chefs-d’œuvre ; citons notamment trois récits champêtres aussi simples que touchants : François le Champi (1844), la Mare au Diable (1846), la Petite Fadette (1848). George Sand s’est aussi essayée au théâtre, quelquefois avec succès. l’Histoire de ma vie et les Lettres d’un voyageur, remplies de ces vivantes descriptions auxquelles l’auteur excelle, complètent son œuvre1642.
Un guet-apens §
Le vieux Tristan de Mauprat, qui habite un château fort en ruines des confins de la Marche et du Berry, est encore, en plein dix-huitième siècle (la scène se passe vers 1770), comme un dernier débris « de cette race de petits tyrans féodaux » que le gouvernement de Louis XIV s’était efforcé par des exécutions exemplaires (voir page 105, note l), de détruire définitivement. — Le récit qu’on va lire est placé, de longues années après les événements, dans la bouche d’un petit-fils de Tristan de Mauprat.
Le vieux Mauprat était un animal perfide et carnassier qui tenait le milieu entre le loup-cervier et le renard. Il avait, avec une élocution abondante et facile, un vernis d’éducation qui aidait en lui à la ruse. Il affectait beaucoup de politesse et ne manquait pas de moyens de persuasion avec les objets de ses vengeances. Il savait les attirer chez lui et leur faire subir des traitements affreux que, faute de témoins, il leur était impossible de prouver en justice. Toutes ses scélératesses portaient un caractère d’habileté si grande, que le pays en fut frappé d’une consternation qui ressemblait presque à du respect. Jamais il ne fut possible de le saisir hors de sa tanière, quoiqu’il en sortît souvent et sans beaucoup de précautions apparentes. C’était un homme qui avait le génie du mal, et ses fils, à défaut de l’affection dont ils étaient incapables, subissaient l’ascendant de sa détestable supériorité, et lui obéissaient avec une discipline et une ponctualité presque fanatiques. Il était leur sauveur dans tous les cas désespérés, et, lorsque l’ennui de la réclusion commençait à planer sous nos voûtes glacées, son esprit, facétieusement féroce, le combattait chez eux par l’attrait de spectacles dignes d’une caverne de voleurs… Tout le pays connaît l’aventure du greffier qu’on laissa entrer avec quatre huissiers, et qu’on reçut avec tous les empressements d’une hospitalité fastueuse. Mon grand-père feignit de consentir de bonne grâce à l’exécution de leur mandat, et les aida poliment à faire l’inventaire de son mobilier, dont la vente était décrétée ; après quoi, le dîner étant servi et les gens du roi1643 attablés, Tristan dit au greffier : « Eh ! mon Dieu, j’oubliais une pauvre haridelle1644 que j’ai à l’écurie. Ce n’est pas grand’chose, mais encore vous pourriez être réprimandé pour l’avoir omise, et, comme je vois que vous êtes un brave homme, je ne veux pas vous induire en erreur. Venez avec moi la voir, ce sera l’affaire d’un instant. »
Le greffier suivit Mauprat sans défiance, et, au moment où ils entraient ensemble dans l’écurie, Mauprat, qui marchait le premier, lui dit d’avancer seulement la tête ; ce que fit le greffier, désireux de montrer beaucoup d’indulgence dans l’exercice de ses fonctions, et de ne point examiner les choses scrupuleusement. Alors Mauprat poussa brusquement la porte et lui serra si fortement le cou entre le battant et la muraille, que le malheureux en perdit la respiration. Tristan, le jugeant assez puni, ouvrit la porte, et, lui demandant pardon de son inadvertance avec beaucoup de civilité, lui offrit son bras pour le reconduire à table, ce que le greffier ne jugea pas à propos de refuser. Mais, aussitôt qu’il fut rentré dans la salle où étaient ses confrères, il se jeta sur une chaise, et, leur montrant sa figure livide et son cou meurtri, il demanda justice contre le guet-apens où l’on venait de l’entraîner. C’est alors que mon grand-père, se livrant à sa fourbe railleuse, joua une scène de comédie d’une audace singulière. Il reprocha gravement au greffier de l’accuser injustement, et, affectant de lui parler toujours avec beaucoup de politesse et de douceur, il prit les autres à témoin de sa conduite, les suppliant de l’excuser si sa position précaire l’empêchait de les mieux recevoir, et leur faisant les honneurs de son dîner d’une manière splendide. Le pauvre greffier n’osa pas insister et fut forcé de dîner, quoique demi-mort. Ses confrères furent si complètement dupes de l’assurance de Mauprat, qu’ils burent et mangèrent gaiement en traitant le greffier de fou et de malhonnête. Ils sortirent de la Roche-Mauprat tout ivres, chantant les louanges du châtelain et raillant le greffier, qui tomba mort sur le seuil de sa maison en descendant de cheval.
(Mauprat, II.)
La prière du soir1645 §
Petit Pierre s’était soulevé et regardait autour de lui d’un air tout pensif.
« Ah ! il n’en fait jamais d’autre quand il entend manger, celui-là, dit Germain : le bruit du canon ne le réveillerait pas, mais, quand on remue lés mâchoires auprès de lui, il ouvre les yeux tout de suite.
— Vous avez dû être comme ça à son âge, dit la petite Marie avec un sourire malin.
— Allons, mon petit Pierre, tu cherches ton ciel de lit ? Il est fait de verdure, ce soir, mon enfant : mais ton père n’en soupe pas moins. Veux-tu souper avec lui ? Je n’ai pas mangé ta part ; je me doutais bien que tu la réclamerais !
— Marie, je veux que tu manges, s’écria le laboureur, je ne mangerai plus. Je suis un vorace, un grossier ; toi, tu te prives pour nous, ce n’est pas juste, j’en ai honte. Tiens, ça m’ôte la faim ; je ne veux pas que mon fils soupe, si tu ne soupes pas.
— Laissez-nous tranquilles, répondit la petite Marie, vous n’avez pas la clef de nos appétits. Le mien est fermé aujourd’hui, mais celui de votre Pierre est ouvert comme celui d’un petit loup. Tenez, voyez comme il s’y prend ! Oh ! ce sera aussi un rude laboureur ! »
En effet, Petit Pierre montra bientôt de qui il était fds, et à peine éveillé, ne comprenant ni où il était, ni comment il y était venu, il se fiait à dévorer. Puis, quand il n’eut plus faim, se trouvant excité comme il arrive aux enfants qui rompent leurs habitudes, il eut plus d’esprit, plus de curiosité et plus de raisonnement qu’à l’ordinaire. Il se fit expliquer où il était, et quand il sut que c’était au milieu d’un bois, il eut un peu peur.
« Y a-t-il de méchantes bêtes dans ce bois ? demanda-t-il à son père.
— Non, fit le père, il n’y en a point. Ne crains rien.
— Tu as donc menti quand tu m’as dit que, si j’allais avec toi dans les grands bois, les loups m’emporteraient ?
— Voyez-vous ce raisonneur ! dit Germain embarrassé.
— Il a raison, reprit la petite Marie, vous lui avez dit cela : il a bonne mémoire, il s’en souvient. Mais apprends, mon petit Pierre, que ton père ne ment jamais. Nous avons passé les grands bois pendant que tu dormais, et nous sommes à présent dans les petits bois, où il n’y a pas de méchantes bêtes.
— Les petits bois sont-ils bien loin des grands ?
— Assez loin ; d’ailleurs les loups ne sortent pas des grands bois. Et puis, s’il en venait ici, ton père les tuerait.
— Et toi aussi, petite Marie ?
— Et nous aussi, car tu nous aiderais bien, mon Pierre ? Tu n’as pas peur, toi ? Tu taperais bien dessus ?
— Oui, oui, dit l’enfant enorgueilli, en prenant une pose héroïque. Nous les tuerions !
— Il n’y a personne comme toi pour parler aux enfants, dit Germain1646 à la petite Marie, et pour leur faire entendre raison. Il est vrai qu’il n’y a pas longtemps que tu étais toi-même un petit enfant, et tu te souviens de ce que te disait ta mère. Je crois bien que plus on est jeune, mieux on s’entend avec ceux qui le sont. J’ai grand’peur qu’une femme de trente ans, qui ne sait pas encore ce que c’est que d’être mère, n’apprenne avec peine à babiller et à raisonner avec des marmots1647.
— Pourquoi donc pas, Germain ? Je ne sais pourquoi vous avez une mauvaise idée touchant cette femme ; vous en reviendrez !
— Au diable la femme ! dit Germain, je voudrais en être revenu1648 pour n’y plus retourner. Qu’ai-je besoin d’une femme que je ne connais pas ?
— Mon petit père, dit l’enfant, pourquoi donc est-ce que tu parles toujours de ta femme aujourd’hui, puisqu’elle est morte ?
— Hélas ! tu ne l’as donc pas oubliée, toi, ta pauvre chère mère ?
— Non, puisque je l’ai vu mettre dans une belle boîte
de bois blanc, et que ma grand’mère m’a conduit auprès pour l’embrasser et lui dire adieu !… Elle était toute blanche et toute froide, et tous les soirs ma tante me fait prier le bon Dieu pour qu’elle aille se réchauffer avec lui dans le ciel. Crois-tu qu’elle y soit à présent ?
— Je l’espère, mon enfant, mais il faut toujours prier, ça fait voir à ta mère que tu l’aimes.
— Je vas1649 dire ma prière, reprit l’enfant, je n’ai pas pensé à la dire ce soir. Mais je ne peux pas la dire tout seul ; j’en oublie toujours un peu. Il faut que la petite Marie m’aide.
— Oui, mon Pierre, je vas t’aider, dit la jeune fille. Viens là, te mettre à genoux sur moi. »
L’enfant s’agenouilla sur la jupe de la jeune fille, joignit ses petites mains, et se mit à réciter sa prière, d’abord avec attention et ferveur, car il savait très bien le commencement ; puis avec plus de lenteur et d’hésitation, et enfin, répétant moi à mot ce que lui dictait la petite Marie, lorsqu’il arriva à cet endroit de son oraison, où le sommeil le gagnant chaque soir, il n’avait jamais pu l’apprendre jusqu’au bout. Cette fois encore, le travail de l’attention et la monotonie de son propre accent produisirent leur effet accoutumé ; il ne prononça plus qu’avec effort les dernières syllabes, et encore après se les être fait répéter trois fois ; sa tête s’appesantit et se pencha sur la poitrine de Marie, ses mains se détendirent, se séparèrent et retombèrent ouvertes sur ses genoux. À la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille, qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s’était laissée aller aussi à une rêverie pieuse, et priait mentalement pour l’âme de Catherine1650.
Germain fut attendri, chercha ce qu’il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu’elle lui inspirait d’estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s’approcha d’elle pour embrasser son fds, qu’elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre.
« Vous l’embrassez trop fort, lui dit Marie en repoussant doucement la tête du laboureur, vous allez le réveiller. Laissez-moi le recoucher, puisque le voilà reparti pour les rêves du paradis. »
L’enfant se laissa coucher, mais, en s’étendant sur la peau de chèvre du bât, il demanda s’il était sur la Grise1651. Puis, ouvrant ses grands yeux bleus, et les tenant fixés vers les branches pendant une minute, il parut rêver tout éveillé, ou être frappé d’une idée qui avait glissé dans son esprit durant le jour et qui s’y formulait à l’approche du sommeil.
« Mon petit père, dit-il, si tu veux me donner une autre mère, je veux que ce soit la petite Marie. »
Et, sans attendre de réponse, il ferma les yeux et s’endormit1652.
(La Mare au Diable, IX.)
Les récits du broyeur de chanvre §
C’est à la fin de septembre, quand les nuits sont encore tièdes, qu’à la pâle clarté de la lune on commence à broyer le chanvre. Dans la journée, le chanvre a été chauffé au four : on l’en retire, le soir, pour le broyer chaud. On se sert pour cela d’une sorte de chevalet surmonté d’un levier en bois, qui, retombant sur des rainures, hache la plante sans la couper. C’est alors qu’on entend la nuit, dans les campagnes, ce bruit sec et saccadé de trois coups frappés rapidement. Puis, un silence se fait ; c’est le mouvement du bras qui retire la poignée de chanvre pour la broyer sur une autre partie de sa longueur. Et les trois coups recommencent ; c’est l’autre bras qui agit sur le levier, et toujours ainsi jusqu’à ce que la lune soit voilée par les premières lueurs de l’aube. Comme ce travail ne dure que quelques jours dans l’année, les chiens ne s’y habituent pas et poussent des hurlements plaintifs vers tous les points de l’horizon.
C’est le temps des bruits insolites et mystérieux dans la campagne. Les grues émigrantes passent dans des régions où, en plein jour, l’œil les distingue à peine1653. La nuit, on les entend seulement ; et ces voix rauques et gémissantes, perdues dans les nuages, semblent l’appel et l’adieu d’âmes tourmentées qui s’efforcent de trouver le chemin du ciel, et qu’une invincible fatalité force à planer non loin de la terre, autour de la demeure des hommes… Dans la nuit sonore, on entend ces clameurs sinistres tournoyer parfois assez longtemps au-dessus des maisons ; et comme on ne peut rien voir, on ressent malgré soi une sorte de crainte et de malaise sympathique1654, jusqu’à ce que cette nuée sanglotante se soit perdue dans l’immensité.
Il y a d’autres bruits encore qui sont propres à ce moment de l’année, et qui se passent principalement dans les vergers. La cueille des fruits n’est pas encore faite, et mille crépitations inusitées font ressembler les arbres à des êtres animés. Une branche grince en se courbant, sous un poids arrivé tout à coup à son dernier degré de développement ; ou bien, une pomme se détache et tombe à vos pieds avec un son mat sur la terre humide. Alors vous entendez fuir, en frôlant les branches et les herbes, un être que vous ne voyez pas : c’est le chien du paysan, ce rôdeur curieux, inquiet, à la fois insolent et poltron qui se glisse partout, qui ne dort jamais, qui cherche toujours on ne sait quoi, qui vous épie, caché dans les broussailles, et prend la fuite au bruit de la pomme tombée, croyant que vous lui lancez une pierre.
C’est durant ces nuits-là, nuits voilées et grisâtres, que le chanvreur1655 raconte ses étranges aventures de follets et de lièvres blancs, d’âmes en peine et de sorciers transformés en loups, de sabbat au carrefour et de chouettes prophétesses au cimetière. Je me souviens d’avoir passé ainsi les premières heures de la nuit autour des broyés en mouvement, dont la percussion impitoyable, interrompant le récit du chanvreur à l’endroit le plus terrible, nous faisait passer un frisson glacé dans les veines. Et souvent aussi le bonhomme continuait à parler en broyant ; et il y avait quatre à cinq mots perdus : mots effrayants, sans doute, que nous n’osions pas lui faire répéter, et dont l’omission ajoutait un mystère plus affreux aux mystères déjà si sombres de son histoire. C’est en vain que les servantes nous avertissaient qu’il était bien tard pour rester dehors, et que l’heure de dormir était depuis longtemps sonnée pour nous ; elles-mêmes mouraient d’envie d’écouter encore ; et avec quelle terreur ensuite nous traversions le hameau pour rentrer chez nous ! comme le porche de l’église nous paraissait profond, et l’ombre des vieux arbres épaisse et noire ! Quant, au cimetière, on ne le voyait point ; on fermait les yeux en le côtoyant.
(La Mare au Diable1656, appendice I).
Sainte-Beuve
(1804-1869) §
Né à Boulogne-sur-Mer en 1804, mort en 1869, Charles-Augustin Sainte-Beuve, après avoir d’abord publié, sous le nom de Joseph Delorme, un recueil de Poésies (1829), qui fut plus tard suivi des Consolations et des Pensées d’août, se lit surtout connaître comme critique. Dès 1828, l’Académie française avait couronné son Tableau de la poésie française au xvie siècle. Son ouvrage sur Port-Royal1657 (1840-1860) et les articles qu’il a réunis sous les noms de Causeries du lundi, Nouveaux Lundis, Portraits littéraires, Portraits contemporains, Portraits de femmes, sont également remarquables par la variété de l’érudition, la finesse de la pensée, la vivacité des peintures, la souplesse du style.
Ce que c’est qu’aimer Molière §
Aimer Molière, j’entends l’aimer sincèrement et de tout son cœur, c’est, savez-vous ? avoir une garantie en soi contre bien des défauts, bien des travers et des vices d’esprit. C’est ne pas aimer d’abord tout ce qui est incompatible avec Molière, tout ce qui lui était contraire en son temps, ce qui lui eût été insupportable du nôtre.
Aimer Molière, c’est être guéri à jamais, je ne parle pas de la basse et infâme hypocrisie, mais du fanatisme, de l’intolérance et de la dureté en ce genre, de ce qui fait anathématiser et maudire....
Aimer Molière, c’est être également à l’abri et à mille lieues de cet autre fanatisme politique, froid, sec et cruel, qui ne rit pas, qui sent son sectaire, qui, sous prétexte de puritanisme1658, trouve moyen de pétrir et de combiner tous les fiels, et d’unir dans une doctrine amère les haines, les rancunes et les jacobinismes1659 de tous les temps, f lest ne pas être moins éloigné, d’autre part, de ces âmes fades et molles qui, en présence du mal, ne savent ni s’indigner, ni haïr1660.
Aimer Molière, c’est être assuré de ne pas aller donner dans l’admiration béate et sans limite pour une Humanité qui s’idolâtre et qui oublie de quelle étoffe elle est faite et qu’elle n’est toujours, quoi qu’elle fasse, que l’humaine et chétive nature. C’est ne pas la mépriser trop pourtant, cette commune humanité dont on rit, dont on est, et dans laquelle on se replonge chaque fois avec lui par une hilarité bienfaisante.
Aimer et chérir Molière, c’est être antipathique à toute manière dans le langage et dans l’expression ; c’est ne pas s’amuser et s’attarder aux grâces mignardes, aux finesses cherchées, aux coups de pinceau léchés, au marivaudage1661 en aucun genre, au style miroitant et artificiel.
Aimer Molière, c’est n’être disposé à aimer ni le faux bel esprit, ni la science pédante ; c’est savoir reconnaître à première vue nos Trissotins et nos Vadius1662 jusque sous leurs airs galants et rajeunis ; c’est ne pas se laisser prendre aujourd’hui plus qu’autrefois à l’éternelle Philaminte, cette précieuse1663 de tous les temps, dont la forme seulement change et dont le plumage se renouvelle sans cesse ; c’est, aimer la santé et le droit sens de l’esprit chez les autres comme pour soi1664.
(Nouveaux Lundis1665, tome V : Molière.)
Ernest Legouvé
(1807-1903) §
Né à Paris en 1807, mort en 1903, Gabriel-Ernest Legouvé, fils du poète Gabriel-Jean-Baptiste Legouvé1666, s’est fait connaître lui-même comme poète, comme romancier, comme auteur dramatique. Mais ce que le public a surtout apprécié en lui, ce sont les mérites du moraliste, de l’éducateur et du causeur ingénieux qui se révèle dans l’Histoire morale de femmes (1847), dans les Pères et les enfants au xixe siècle (1867), dans les Conférences parisiennes (1874), dans l’Art de la lecture (1878), livre charmant qui n’apprend plus seulement à bien lire, mais à bien entendre nos auteurs, dans ses Soixante ans de souvenirs, enfin (1886-1887), tout remplis d’anecdotes piquantes, de récits vivants, de jugements précis et motivés.
Les dames Lemercier §
J’ai eu pour M. Lemercier1667 un sentiment très particulier, un sentiment qu’on n’éprouve peut-être qu’une fois, qu’on n’éprouve guère que dans la jeunesse, qui tient de l’admiration, du respect, de la reconnaissance, mais qui s’en distingue et les dépasse : j’ai eu pour lui un culte ! Certes j’avais beaucoup admiré et aimé Casimir Delavigne1668; mais son âge se rapprochait trop du mien ; son caractère, plein de charme, n’avait pas assez de force, pour que mon admiration, si vive qu’elle fût, allât plus loin qu’une admiration littéraire, et que mon affection très réelle dépassât la sympathie et la reconnaissance. Le culte veut davantage ; il ne va pas sans un léger tremblement devant le Seigneur. J’ai toujours, je ne dirai pas tremblé, mai » tressailli devant M. Lemercier. Rien pourtant de plus affable que son accueil. Il m’avait même admis dans sa famille, et sa femme, sa fille, me montraient la même bienveillance que lui. N’importe ! Sa supériorité m’était toujours présente. Était-ce enthousiasme aveugle pour ses ouvrages ? Non ! J’en voyais les défauts avec regret, en m’en voulant de les voir ; mais je les voyais. Était-ce éblouissement de sa renommée ? Non ! Il n’avait ni le rayonnant éclat des gloires reconnues, ni la popularité bruyante des génies contestés.
A quoi tenait donc mon sentiment ? À lui ! A ce qu’on devinait en lui ! A ce qui émanait de lui ! On sentait — à quoi ? je ne saurais le dire — que, malgré le réel mérite de ses œuvres, ce qu’il était l’emportait beaucoup sur ce qu’il avait fait. Sa personne, ses regards, sa conversation, respiraient je ne sais quelle autorité naturelle, qui est comme l’atmosphère des grands caractères et des grands cœurs. Il m’a fait connaître la sensation délicieuse d’aimer les yeux levés, d’aimer au-dessus de soi. Aussi qu’on juge de ma joie, quand, bien des années plus tard, après sa mort, j’eus l’occasion de prendre fait et cause pour lui. Un homme d’esprit et de talent laissa tomber de sa plume, dans un article du Journal des Débats1669 cette ligne dédaigneuse et méprisante : Ce bon monsieur Lemercier. Un tel terme, appliqué à un tel homme, me révolta comme un blasphème ; et j’adressai au rédacteur une réponse émue, presque indignée. Quinze jours plus tard, je reçus une lettre écrite en caractères tremblés, sur le fort papier d’autrefois, sans enveloppe, fermée d’un simple cachet de cire noire, et qui contenait ces mots : « Je vous remercie pour ma mère et pour moi. Vous êtes de ceux qui se souviennent. Votre réponse à cet article de journal nous a profondément touchées toutes deux. — N. Lemercier. »
Cette signature était celle de Mlle Lemercier. Je courus chez ces dames, que j’avais perdues de vue depuis bien longtemps. Quel changement ! La fille, quand je les avais quittées, avait dix-huit ans, un grand talent de musicienne, une rare distinction d’esprit. La mère, malgré ses quarante ans, me charmait par son élégance, sa bonté, sa finesse ; c’était une véritable lady1670. Leur vie semblait une vie de grande aisance, et, le prestige de M. Lemercier se répandant sur elles, elles étaient restées dans ma mémoire enveloppées d’une sorte d’auréole poétique. J’arrive rue de Grenelle, n°12 ; on me fait monter par un petit escalier assez sombre ; j’entre dans un petit salon fort modeste, et je vois, au coin de la cheminée, le bras soutenu par un mouchoir, la figure pâle et émaciée, une vieille dame en cheveux blancs, qui m’accueille avec un aimable sourire, en me faisant signe qu’elle ne pouvait pas se lever. C’était Mme Lemercier ; elle avait le bras et les deux jambes paralysés. Troublé par cette vue inattendue et douloureuse, je balbutiais à peine quelques vagues paroles, quand la porte latérale du salon s’ouvrit et que je vis entrer une autre femme beaucoup plus jeune et pourtant presque aussi vieille, marchant appuyée sur deux béquilles, vêtue, elle aussi, plus que simplement. C’était Mlle Lemercier. Elle était paralysée comme sa mère ! Rien ne peut exprimer mon émotion. C’était toute ma jeunesse qui se levait devant moi, sous la forme de deux spectres ! Voilà donc ce que trente années avaient fait de ces compagnes de mes vingt-deux ans ! J’avais presque honte de me sentir, de me montrer à elles, en pleine force, en pleine santé. Peu à peu cependant, ces tristesses se dissipèrent. Le passé, se levant de nouveau entre nous, chassa ce sombre présent. La conversation reprit entre elles et moi, comme autrefois, pleine d’effusion et de souvenirs émus, et je leur promis, en les quittant, de payer ma dette de gratitude à M. Lemercier autrement que par quelques lignes de journal. Je me tins parole. Le 25 octobre 1879, le jour de la séance publique de l’Institut, j’allai m’asseoir en costume d’académicien, comme représentant l’Académie française, à la petite tribune circulaire où ont lieu les lectures, et là, à cette même place où M. Lemercier avait si bien fait valoir, en 1829, ma pièce de vers couronnée1671, je lus une étude approfondie sur lui1672, où j’essayai de faire revivre dans son originalité puissante la figure trop oubliée de l’auteur d’Agamemnon et de Pinto1673. Malheureusement aucun de ces chers amis d’autrefois n’était là pour m’entendre ; la mère et la fille avaient disparu toutes deux comme le père ; c’est à leur mémoire seule que s’adressèrent mes paroles ; ma petite couronne d’immortelles ne fut placée que sur un tombeau.
(Soixante Ans de souvenirs1674, Ire partie, chap. iii.)
Alfred de Musset
(1810-1857) §
Pour la Notice, voir page 715.
Oncle et neveu §
Van Buck, Valentin §
Van Buck1675. — Monsieur mon neveu, je vous souhaite le bonjour.
Valentin. — Monsieur mon oncle, votre serviteur.
Van Buck. — Restez assis ; j’ai à vous parler.
Valentin. — Asseyez-vous ; j’ai donc à vous entendre. Veuillez vous mettre dans la bergère1676, et poser là votre chapeau.
Van Buck, s’asseyant. — Monsieur mon neveu, la plus longue patience et la plus robuste obstination doivent, l’une ou l’autre, finir tôt ou tard. Ce qu’on tolère devient intolérable, incorrigible ce qu’on ne corrige pas ; et qui vingt fois a jeté la perche à un fou qui veut se noyer, peut être forcé un jour ou l’autre de l’abandonner ou de périr avec lui.
Valentin. — Oh ! oh ! voilà qui est débuter, et vous avez là des métaphores1677 qui se sont levées de grand matin.
Van Buck. — Monsieur, veuillez garder le silence, et ne pas vous permettre de me plaisanter. C’est vainement que les plus sages conseils, depuis trois ans, tentent de mordre sur vous. Une insouciance ou une fureur aveugle, des résolutions sans effet, mille prétextes inventés à plaisir, une maudite condescendance, tout ce que j’ai pu ou puis faire encore (mais, par ma barbe ! je ne ferai plus rien !)… Où me menez-vous à votre suite ? Vous êtes aussi entêté....
Valentin. — Mon oncle Van Buck, vous êtes en colère.
Van Buck. — Non, monsieur ; n’interrompez pas. Vous êtes aussi obstiné que je me suis, pour mon malheur, montré crédule et patient. Est-il croyable, je vous le demande, qu’un jeune homme de vingt-cinq ans passe son temps comme vous le faites ? De quoi servent mes remontrances ; et quand prendrez-vous un état ? Vous êtes pauvre, puisque au bout du compte vous n’avez de fortune que la mienne ; mais finalement, je ne suis pas moribond, et je digère encore vertement. Que comptez-vous faire d’ici à ma mort ?
Valentin. — Mon oncle Van Buck, vous êtes en colère, et vous allez vous oublier.
Van Buck. — Non, monsieur ; je sais ce que je fais. Si je suis le seul de la famille qui se soit mis dans le commerce, c’est grâce à moi, ne l’oubliez pas, que les débris d’une fortune détruite ont pu encore se relever. Il vous sied bien de sourire quand je parle ! Si je n’avais pas vendu du guingan1678 à Anvers, vous seriez maintenant à l’hôpital avec votre robe de chambre à fleurs. Mais, Dieu merci, vos chiennes de bouillottes1679....
Valentin. — Mon oncle Van Buck, voilà le trivial ; vous changez de ton, vous vous oubliez ; vous aviez mieux débuté que cela.
Van Buck. — Sacrebleu ! tu te moques de moi ? Je ne suis bon apparemment qu’à payer tes lettres de change1680 ? J’en ai reçu une ce matin : soixante louis1681 ! te railles-tu des gens ? il te sied bien de faire le fashionable1682 (que le diable soit des mots anglais !), quant tu ne peux pas payer ton tailleur ! C’est autre chose de descendre d’un beau cheval, pour retrouver au fond d’un hôtel une bonne Famille opulente, ou de sauter à bas d’un carrosse de louage pour grimper deux ou trois étages. Avec tes gilets de satin, tu demandes, en rentrant du bal, ta chandelle à ton portier1683, et il regimbe quand il n’a pas eu ses étrennes. Dieu sait si tu les lui donnes tous les ans ! Lancé dans un monde plus riche que toi, tu puises, chez tes amis, le dédain de toi-même ; tu portes ta barbe en pointe et tes cheveux sur les épaules, comme si tu n’avais pas seulement de quoi acheter un ruban pour te faire une queue1684. Tu écrivailles dans les gazettes ; tu es capable de te faire saint-simonien1685 quand tu n’auras plus ni sou ni maille1686, et cela viendra, je t’en réponds. Va, va ! un écrivain public est plus estimable que toi. Je finirai par te couper les vivres, et tu mourras dans un grenier.
Valentin. — Mon bon oncle Van Buck, je vous respecte et je vous aime. Faites-moi la grâce de m’écouter. Vous avez payé une lettre de change à mon intention. Quand vous êtes venu, j’étais à la fenêtre et je vous ai vu arriver ; vous méditiez un sermon juste aussi long qu’il y a d’ici chez vous. Épargnez, de grâce, vos paroles. Ce que vous pensez, je le sais ; ce que vous faites, je vous en remercie. Que j’aie des dettes et que je ne sois bon à lien, cela se peut ; qu’y voulez-vous faire ? Vous avez soixante mille livres de rente....
Van Buck. — Cinquante.
Valentin. — Soixante, mon oncle ; vous n’avez pas d’enfants, et vous êtes plein de bonté pour moi. Si j’en profite, où est le mal ? Avec soixante bonnes mille livres de rente....
Van Buck. — Cinquante, cinquante ; pas un denier de plus.
Valentin. — Soixante, vous me l’avez dit vous-même.
Van Buck. — Jamais. Où as-tu pris cela ?
Valentin. — Mettons cinquante. Vous êtes jeune, gaillard encore, et bon vivant. Croyez-vous que cela me fâche, et que j’aie soif de votre bien ? Vous ne me faites pas tant d’injure ; et vous savez que les mauvaises têtes n’ont pas toujours les plus mauvais cœurs. Vous me querellez de ma robe de chambre : vous en avez porté bien d’autres. Ma barbe en pointe ne veut pas dire que je sois un saint-simonien : je respecte trop l’héritage1687. Vous vous plaignez de mes gilets : voulez-vous qu’on sorte en chemise ? Vous me dites que je suis pauvre et que mes amis ne le sont pas : tant mieux pour eux, ce n’est pas ma faute. Vous imaginez qu’ils me gâtent et que leur exemple me rend dédaigneux : je ne le suis que de ce qui m’ennuie, et puisque vous payez mes dettes, vous voyez bien que je n’emprunte pas. Vous me reprochez d’aller en fiacre : c’est que je n’ai pas de voiture. Je prends, dites-vous, en rentrant, ma chandelle chez mon portier : c’est pour ne pas monter sans lumière ; à quoi bon se casser le cou ? Vous voudriez me voir un état : faites-moi nommer premier ministre, et vous verrez comme je ferai mon chemin. Mais quand je serai surnuméraire dans l’entresol d’un avoué, je vous demande ce que j’y apprendrai, sinon que tout est vanité. Vous dites que je joue à la bouillotte : c’est que j’y gagne quand j’ai brelan1688; mais soyez sûr que je n’y perds pas plutôt que je me repens de ma sottise. Ce serait, dites-vous, autre chose si je descendais d’un beau cheval pour entrer dans un bon hôtel : je crois bien ! vous en parlez à votre aise. Vous ajoutez que vous êtes fier, quoique vous ayez vendu du guingan ; et plût à Dieu que j’en vendisse ! ce serait la preuve que je pourrais en acheter. Pour ma noblesse, elle m’est aussi chère qu’elle peut vous l’être à vous-même ; mais c’est pourquoi je ne m’attelle pas1689, ni plus que moins les chevaux de pur sang. Tenez ! mon oncle, ou je me trompe, ou vous n’avez pas déjeuné. Vous êtes resté le cœur à jeun sur cette maudite lettre de change ; avalons-la de compagnie : je vais demander le chocolat.
Van Buck. — Quel déjeuner ! Le diable m’emporte ! tu vis comme un prince.
Valentin. — Eh, que voulez-vous ! quand on meurt de faim, il faut bien tâcher de se distraire.
(Comédies et proverbes : Il ne faut jurer de rien, acte I, sc. i.)
Ernest Renan
(1823-1892) §
Né à Tréguier (Côtes-du-Nord) en 1823, mort en 1892, Ernest Renan, après avoir étudié la théologie, renonça à s’engager dans l’Eglise, pour se consacrer surtout à l’étude des langues sémitiques1690 et à celle des origines du christianisme. Mais il n’est presque aucun ordre de connaissances auquel soit resté étranger cet esprit aussi souple qu’étendu. Les différentes études de critique et de philosophie de Renan ne sont pas moins connues et n’ont pas exercé sur la pensée française, à notre époque, une moindre influence que ses travaux historiques. Au reste ses doctrines ont soulevé souvent bien des protestations ; mais adversaires et disciples s’accordent à louer le talent merveilleux d’un écrivain qui n’a peut-être pas d’égal dans la seconde moitié du xixe siècle1691.
Martyrs chrétiens §
Le légat1692 fit donner une de ces fêtes hideuses, consistant en exhibitions de supplices et en combats de bêtes, qui, en dépit du plus humain des empereurs, étaient plus en vogue que jamais. Ces horribles spectacles revenaient à des dates réglées ; mais il n’était pas rare qu’on fît des exécutions extraordinaires, quand on avait des bêtes à montrer au peuple et des malheureux à leur livrer.
La fête se donna probablement dans l’amphithéâtre municipal de la ville de Lyon, c’est-à-dire de la colonie qui s’étageait sur les pentes de Fourvières1693....
Une foule exaspérée couvrait les gradins et appelait les chrétiens à grands cris. Maturus, Sanctus, Blandine el Attale1694 furent choisis pour cette journée. Ils en firent tous les frais ; il n’y eut, ce jour-là, aucun de ces spectacles de gladiateurs, dont la variété avait tant d’attrait pour le peuple.
Maturus et Sanctus traversèrent de nouveau, dans l’amphithéâtre, toute la série des supplices, comme s’ils n’avaient auparavant rien souffert. Les instruments de ces tortures étaient comme échelonnés le long de la spina1695, et faisaient de l’arène une image du Tartare.
Rien ne fut épargné aux victimes. On débuta, selon l’usage, par une procession hideuse, où les condamnés, défilant devant l’escouade des belluaires1696, recevaient de chacun d’eux, sur le dos, d’affreux coups de fouet. Puis on lâcha les bêtes ; c’était le moment le plus émouvant de la journée. Les bêtes ne dévoraient pas tout de suite les victimes ; elles les mordaient, les traînaient ; leurs dents s’enfoncaient dans les chairs nues, y laissaient des traces ensanglantées. A ce moment, les spectateurs devenaient fous de plaisir. Les interpellations s’entrecroisaient sur les gradins de l’amphithéâtre. Ce qui faisait, en effet, l’intérêt du spectacle antique, c’est que le public y intervenait. Comme dans les combats de taureaux en Espagne, l’assistance commandait, réglait les incidents, jugeait des coups, décidait de la mort ou de la vie. L’exaspération contre les chrétiens était telle qu’on réclamait contre eux les supplices les plus terribles. La chaise de fer rougie au feu était peut-être ce que l’art du bourreau avait créé de plus infernal ; Maturus et Sanctus y furent assis. Une repoussante odeur de chair rôtie remplit l’amphithéâtre et ne fit qu’enivrer ces furieux. La fermeté des deux martyrs était admirable. On ne put tirer de Sanctus qu’un seul mot, toujours le même : « Je suis chrétien ! » Les deux martyrs semblaient ne pouvoir mourir : les bêtes, d’un autre côté, paraissaient les éviter ; on fut obligé, pour en finir, de leur donner le coup de grâce, comme on faisait pour les bestiaires et les gladiateurs.
Blandine, pendant tout ce temps, était suspendue à un poteau et exposée aux bêtes, qu’on excitait à la dévorer. Elle ne cessait de prier, les yeux élevés au ciel. Aucune bête, ce jour-là, ne voulut d’elle. Ce pauvre petit corps n’excita, paraît-il, chez les assistants aucune pitié ; mais il prit pour les autres martyrs une signification mystique. Le poteau de Blandine leur parut la croix de Jésus ; le corps de leur amie leur rappela celui du Christ crucifié. La joie de voir ainsi l’image du doux agneau de Dieu les rendait insensibles. Blandine, à partir de ce moment, fut Jésus pour eux : dans les moments d’atroces souffrances, un regard jeté vers leur sœur en croix les remplissait de joie et d’ardeur.
Attale était connu de toute la ville ; aussi la ville l’appela-t-elle à grands cris. On lui fit faire le tour de l’amphithéâtre. Il marchait d’un pas ferme, avec le calme d’une conscience assurée. Le peuple demanda pour lui les plus cruels supplices. Mais le légat impérial, ayant appris qu’il était citoyen romain, fit tout arrêter et ordonna de le ramener à la prison. Ainsi finit la journée, Blandine, attachée à son poteau, attendait toujours vainement la dent de quelque bête. On la détacha et on la ramena au dépôt, pour qu’elle servît une autre fois au divertissement du peuple.
Le cas d’Attale n’était point isolé ; le nombre des accusés croissait chaque jour. Le légat se crut obligé d’écrire à l’empereur, qui, vers le milieu de l’an 177, était, ce semble, à Rome. Il fallut des semaines pour attendre la réponse… Elle arriva enfin. Elle était dure et cruelle. Tous ceux qui persévéraient dans leur confession1697 devaient être mis à mort, tous les renégats relâchés. La grande fête annuelle qui se célébrait à l’autel d’Auguste1698, et où tous les peuples de la Gaule étaient représentés, allait commencer. L’affaire des chrétiens tombait à propos pour en relever l’intérêt et la solennité.
Afin de frapper le peuple, on organisa une sorte d’audience théâtrale où tous les détenus furent pompeusement amenés. On leur demandait simplement s’ils étaient chrétiens. Sur la réponse affirmative, on tranchait la tête à ceux qui paraissaient avoir le droit de cité romaine ; on réservait les autres pour les bêtes ; on fit aussi grâce à plusieurs. Comme il fallait s’y attendre, pas un confesseur ne faiblit....
Le 1er août, au matin, en présence de toute la Gaule réunie dans l’amphithéâtre, l’horrible spectacle recommença. Le peuple tenait beaucoup au supplice d’Attale, qui paraissait, après Pothin1699, le vrai chef du christianisme lyonnais. On ne voit pas comment le légat, qui, une première fois, l’avait arraché aux bêtes à cause de sa qualité de citoyen romain, put le livrer cette fois ; mais le fait est certain ; il est probable que les titres d’Attale à la cité1700 romaine ne furent pas trouvés suffisants.
Attale et Alexandre1701 entrèrent les premiers dans l’arène sablée et soigneusement ratissée. Ils traversèrent en héros tous les supplices dont les appareils étaient dressés. Alexandre ne prononça pas un mot, ne fit pas entendre un cri ; recueilli en lui-même, il s’entretenait avec Dieu. Quand on fit asseoir Attale sur la chaise de fer rougie et que son corps, brûlé de tous côtés, exhala une fumée et une odeur abominables, il dit au peuple en latin : « C’est vous1702 qui êtes des mangeurs d’hommes. Quant à nous, nous ne faisons rien de mal ». On lui demanda : « Quel nom a Dieu ? — Dieu, dit-il, n’a pas de nom comme un homme ». Les deux martyrs reçurent le coup de grâce, après avoir épuisé avec une pleine conscience tout ce que la cruauté romaine avait pu inventer de plus atroce.
Les fêtes durèrent plusieurs jours : chaque jour, les combats de gladiateurs furent relevés par des supplices de chrétiens. Il est probable qu’on introduisait les victimes deux à deux, et que chaque jour vit périr un ou plusieurs couples de martyrs. On plaçait dans l’arène ceux qui étaient jeunes et supposés faibles, pour que la vue du supplice de leurs amis les effrayât. Blandine et un jeune homme de quinze ans, nommé Ponticus, furent réservés pour le dernier jour. Ils furent témoins de toutes les épreuves des autres, et rien ne les ébranla. Chaque jour, on tentait sur eux un effort suprême : on cherchait à les faire jurer par les dieux ; ils s’y refusaient avec dédain. Le peuple, extrêmement irrité, ne voulut écouter aucun sentiment de pitié. On fit épuiser à la pauvre fille et à son jeune ami tout le cycle hideux des supplices de l’arène ; après chaque épreuve, on leur proposait de jurer. Blandine fut sublime. Elle n’avait jamais été mère ; cet enfant torturé à côté d’elle devint son fils, enfanté dans les supplices. Uniquement attentive à lui, elle le suivait à chacune de ses étapes de douleur, pour l’encourager et l’exhorter à persévérer jusqu’à la fin. Les spectateurs voyaient ce manège et en étaient frappés. Ponticus expira après avoir subi toute la série des tourments.
De toute la troupe sainte il ne restait plus que Blandine. Elle triomphait et ruisselait de joie. Elle s’envisageait comme une mère qui a vu proclamer vainqueurs tous ses fils, et les présente au grand Roi pour être couronnés. Cette humble servante s’était montrée l’inspiratrice de l’héroïsme de ses compagnons ; sa parole ardente avait été le stimulant qui maintient les nerfs débiles et les cœurs défaillants. Aussi s’élança-t-elle dans l’âpre carrière de tortures que ses frères avaient parcourue, comme s’il se fût agi d’un festin nuptial. L’issue glorieuse et proche de toutes ces épreuves la faisait sauter de plaisir. D’elle-même, elle alla se placer au bout de l’arène, pour ne perdre aucune des parures que chaque supplice devait graver sur sa chair. Ce fut d’abord une flagellation cruelle qui déchira ses épaules. Puis on l’exposa aux bêtes, qui se contentèrent de la mordre et de la traîner. L’odieuse chaise brûlante ne lui fut pas épargnée. Enfin on l’enferma dans un filet, et on l’exposa à un taureau furieux. Cet animal, la saisissant avec ses cornes, la lança plusieurs fois en l'air et la laissa retomber lourdement. Mais la bienheureuse ne sentait plus rien : elle jouissait déjà de la félicité suprême, perdue qu’elle était dans ses entretiens intérieurs avec le Christ. Il fallut l’achever, comme les autres condamnés. La foule finit par être frappée d’admiration. En s’écoulant, elle ne parlait que de la pauvre esclave. « Vrai, se disaient les Gaulois, jamais, dans nos pays, on n’avait vu une femme tant souffrir1703. »
(Marc-Aurèle et la fin du monde antique, chap. xix.)
Erckmann-Chatrian
(1822-1899) (1826-1890) §
Émile Erckmann, né à Phalsbourg (Meurthe) en 1822, mort en 1899, et Alexandre Chatrian, né dans un hameau du département de la Meuse, à Soldatenthal en 1826, mort en 1890, ont si intimement uni leurs talents, comme ils unissaient leurs noms, qu’il est impossible de distinguer l’apport de chacun dans l’œuvre commune. C’est dans la région rhénane que se passe l’action de presque tous leurs récits. Ils en ont peint les mœurs avec beaucoup de naturel et de bonhomie, soit dans leurs Contes fantastiques (1860), soit dans leurs romans nationaux, le Fou Yégof (1862), Madame Thérèse (1863), L’Histoire d’un conscrit de 1813 (1864), l’Invasion, Waterloo (1865), soit enfin dans des romans intimes, l’Ami Fritz, par exemple, d’où se dégage une morale, sinon très élevée, du moins très pure et très sûre.
Le réveil de la ferme §
Les deux fenêtres de Fritz Kobus1704 s’ouvraient sur le toit du hangar ; il n’avait pas même besoin de se lever pour voir où l’ouvrage en était ; car de son lit il découvrait d’un coup d’œil la rivière, le verger en face et la côte au-dessus. C’était comme fait exprès pour lui.
Au petit jour, quand le coq lançait son cri dans la vallée encore toute grise, et qu’au loin, bien loin, les échos du Bichelberg1705 lui répondaient dans le silence ; quand Mopsel se retournait dans sa niche, après avoir lancé deux ou trois aboiements ; quand la haute grive1706 faisait entendre sa première note dans les bois sonores ; puis, quand tout se taisait de nouveau quelques secondes : que les feuilles se mettaient à frissonner, — sans que l’on ait jamais su pourquoi, et comme pour saluer, elles aussi, le père de la lumière et de la vie, — et qu’une sorte de pâleur s’étendait dans le ciel, alors Kobus s’éveillait ; il avait entendu ces choses avant d’ouvrir les yeux et regardait.
Tout était encore sombre autour de lui, mais en bas, dans l’allée, le garçon de labour marchait d’un pas pesant ; il entrait dans la grange et ouvrait la lucarne du fenil1707, sur l’écurie, pour donner le fourrage aux hêtes. Les chaînes remuaient, les bœufs mugissaient tout bas, comme endormis, les sabots allaient et venaient.
Bientôt après, la mère Orchel1708 descendait dans la cuisine ; Fritz, tout en écoutant la bonne femme allumer du feu et remuer les casseroles, écartait ses rideaux et voyait les petites fenêtres grises se découper en noir sur l’horizon pâle.
Quelquefois un nuage, léger comme un écheveau de pourpre, indiquait que le soleil allait paraître entre les deux côtes en face, dans dix minutes, un quart d’heure.
Mais déjà la ferme était pleine de bruit : dans la cour, le coq, les poules, le chien, tout allait, venait, caquetait aboyait. Dans la cuisine, les casseroles tintaient, le feu pétillait, les portes s’ouvraient et se refermaient. Une lanterne passait dehors sous le hangar. On entendait trotter au loin les ouvriers arrivant du Bichelberg.
Puis, tout à coup tout devenait blanc : c’était lui… le soleil, qui venait enfin de paraître. Il était là, rouge, étincelant comme de l’or. Fritz, le regardant monter entre les deux côtes, pensait : « Dieu est grand ! »
Et plus bas, voyant les ouvriers piocher, traîner la brouette, il se disait : « Ça va bien ! »
(L’Ami Fritz1709, VI.)
Le serment1710 §
« Maintenant, Schmoûle, dit David, tu vas prêter serment sur ce livre, en présence de l’Éternel qui t’écoute ; tu vas jurer qu’il n’a rien été convenu entre Christel et toi, ni pour le délai, ni pour les jours de retard, ni pour le prix de la nourriture des bœufs pendant ces jours. Mais garde-toi de prendre des détours dans ton cœur, pour t’autoriser à jurer si tu n’es pas sûr de la vérité de ton serment ; garde-toi de te dire, par exemple, en toi-même : « Ce Christel m’a fait tort, il m’a causé des pertes, il m’a empêché de gagner dans telle circonstance ». Ou bien : « Il a fait tort à mon père, à mes proches, et je rentre ainsi dans ce qui me serait revenu naturellement ». Ou bien : « Les paroles de notre convention avaient un double sens, il me plaît à moi de les tourner « dans le sens qui me convient ; elles n’étaient pas assez claires, et je puis les nier ». Ou bien : « Ce Christel m’a pris trop cher, ses bœufs valent moins que le prix convenu, et je reste de cette façon dans la vraie justice, qui veut que la marchandise et le prix soient égaux, comme les deux côtés d’une balance ». Ou bien encore : « Aujourd’hui, je n’ai pas la somme entière, plus tard je réparerai le dommage, ou toute autre pensée de ce genre.
« Non, tous ces détours ne trompent point l’œil de L’Eternel ; ce n’est point dans ces pensées, ni dans d’autres semblables que tu dois jurer ; ce n’est pas d’après ton propre esprit, qui peut être entraîné vers le mal par l’intérêt, qu’il faut prêter serment ; ce n’est pas sur ta pensée, c’est sur la mienne qu’il faut te régler ; et tu ne peux rien ajouter ni rien retrancher, par ruse ou autrement, à ce que je pense.
« Donc, moi, David Sichel, j’ai cette pensée simple et claire : — Schmoûle a-t-il promis un florin à Christel pour la nourriture des bœufs qu’il a achetés, et, pour chaque jour de retard après la huitaine, l’a-t-il promis ? S’il ne l’a pas promis à Christel, qu’il pose la main sur le livre de la loi, et qu’il dise : « Je jure non ! je n’ai « rien promis ! » Schmoûle, approche, étends la main, et jure ! »
Mais Schmoûle, levant alors les yeux, dit :
« Trente florins ne sont pas une somme pour prêter un serment pareil. Puisque Christel est sûr que j’ai promis, — moi, je ne me le rappelle pas bien, — je les payerai, et j’espère que nous resterons bons amis. Plus tard, il me fera regagner cela, car ses bœufs sont réellement trop chers. Enfin, ce qui est dû est dû, et jamais Schmoûle ne prêtera serment pour une somme encore dix fois plus forte, à moins d’être tout à fait sûr. »
Alors David, regardant Kobus d’un œil extrêmement fin, répondit :
« Et tu feras bien, Schmoûle ; dans le doute, il vaut mieux s’abstenir. »
(L’Ami Fritz, XIII.)
Edmond About
(1828-1885) §
Né à Dieuze1711 en 1828, mort en 1885, Edmond About alla, au sortir de l’école normale, passer deux ans en Grèce comme élève de l’école d’Athènes (1851-1853). Il en rapporta, outre un mémoire sur l'Ile d’Egine (1854), un récit de voyage spirituel et à demi satirique, dont le succès fut grand et rendit dès lors son nom célèbre, la Grèce contemporaine (1855). C’est encore le souvenir de son séjour en Grèce qui lui inspira la piquante fantaisie du Roi des montagnes (1856). Quelques nouvelles attachantes, d’un style très pur et très vif, augmentèrent sa réputation, Tolla (1855), les Mariages de Paris (1856), Germaine (1857), etc. About s’essaya sans succès au théâtre. Mais, comme polémiste et comme journaliste, il ne laissa personne indifférent et s’attira beaucoup d’applaudissements et beaucoup d’inimitiés. Les funestes événements de 1870-1871 déchirèrent son âme de patriote, et ses derniers ouvrages, Alsace (1872), le Roman d’un brave homme (1880), moins brillants peut-être que ceux de sa jeunesse, mais tout inspirés du souvenir des deuils de la patrie et du sentiment de ses aspirations nouvelles, ne sont pas ceux qui font le moins d’honneur à son caractère.
L’attique au printemps §
C’est au printemps qu’il faut voir l’Attique dans tout son éclat, quand les anémones1712, aussi hautes que les tulipes de nos jardins, confondent et varient leurs brillantes couleurs ; quand les abeilles, descendues de l’Hymette1713, bourdonnent dans les asphodèles1714; quand les grives babillent dans les oliviers ; quand le jeune feuillage n’a pas encore reçu une couche de poussière ; que l’herbe, qui doit disparaître à la fin de mai, s’élève verte et drue partout où elle trouve un peu de terre ; et que les grandes orges, mêlées de fleurs, ondoient sous la brise de la mer. Une lumière blanche et éclatante illumine la terre et fait concevoir à l’imagination cette lumière divine dont les héros sont vêtus dans les champs Élysées1715. L’air est si pur et si transparent qu’il semble qu’on n’ait qu’à étendre la main pour toucher les montagnes les plus éloignées ; il transmet si fidèlement tous les sons, qu’on entend la clochette de troupeaux qui passent à une demi-lieue, et le cri des grands aigles qui se perdent dans l’immensité du ciel.
(La Grèce contemporaine1716, chap. I, ii.)
Le voyage à Saverne1717 §
Au temps où nous allions chez nous en dix heures, sans rencontrer un factionnaire allemand à toutes les gares, cette nuit de voyage était pour moi un plaisir sans fatigue. On s’endormait à Meaux en savourant par avance la joie du lendemain, et, malgré quelques cahots, on ne faisait qu’un somme jusqu’à Nancy. Là on s’éveillait tout exprès pour entendre ce brave accent lorrain, dont j’ai eu tant de peine à me défaire au collège, mais que j’apprécie en connaisseur dans la bouche d’autrui. Dès ce moment, mes yeux ne quittaient plus le paysage, et je ne me lassais point d’admirer la richesse un peu monotone de ce vieux sol lorrain qui m’a nourri.
Je reconnaissais les bons prés, je saluais en ami les fortes terres rouges, terres à blé qu’un attelage de six chevaux n’entame pas toujours sans peine ; j’encourageais du regard les jeunes houblonnières, nouvel espoir de nos pays ; je fronçais le sourcil devant les betteraves à sucre, gros revenu de quelques années avec la ruine au bout1718 ; j’assistais au réveil des troupeaux de moutons dans leurs parcs, et je voyais le berger sortir tout ébaubi de sa maison roulante. Bientôt les deux clochers de Lunéville apparaissaient sur l’horizon ; style bourgeois, lourd, ampoulé, cossu, bonhomme au demeurant : c’est l’architecture des jésuites1719.
Les jardinets soignés, ratissés, taillés, émondés qui entourent la ville, me reportaient à mon enfance. Je n’ai jamais pu voir un potager correct sans penser à mon grand-père, excellent homme et parfait jardinier. La station d’Avricourt1720, où l’on s’arrêtait trois minutes, m’inspirait chaque fois une vive tentation de descendre : Avricourt est la tête d’une petite ligne qui mène à Dieuze1721, mon pays natal. Un jour, je ne sais quand, j’y ai vu un train en partance ; le conducteur criait de ce ton goguenard et cordial qui caractérise l’esprit lorrain : « Allons, les gens de Dieuze, en voiture ! » Je répondis d’instinct, sans songer1722 : « Les gens de Dieuze ? mais j’en suis ! »
On arrivait ensuite à Sarrebourg1723, aujourd’hui Saar-burg, une aimable petite ville, bien gaie, bien riante, et particulièrement française, en dépit de son nom germanique. Nous embarquions une demi-douzaine de marchands de bétail, tous enfants d’Israël, et le train se précipitait vers la grande traversée des Vosges. Six tunnels à la file : que de fois je les ai comptés ! Dès le premier, je me sentais chez moi ; c’était une avant-porte de la maison ; j’étais enfin dans nos montagnes de grès rouge....
Sur les sept heures du matin, sauf accident, le train, l’heureux train du bon temps, débouchait dans la plaine, au-dessous de Saverne, et, deux minutes avant l’arrêt, je voyais sur la gauche, au milieu d’une étroite vallée, un pignon à demi caché dans les arbres : home ! sweet home1724 ! voilà le nid !
Autre temps, autre voyage. Nous traversons1725 la gare de Nancy, qui n’a jamais été si morne, même à quatre heures du matin. Une aurore triste et pluvieuse éclaire insensiblement les campagnes....
Les voyageurs descendent à la station d’Avricourt, comme autrefois à Kehl1726, pour la visite des bagages. La douane allemande est là. Les conducteurs français nous quittent ; on est tenté de leur dire adieu et de leur serrer la main ; ils sont remplacés par des hommes qui ne savent pas un mot de notre langue.
Voilà pourtant le petit chemin de fer qui mène à Dieuze, voilà les belles plaines savamment cultivées et un fort attelage qui prélude aux emblavures1727 d’automne en déchirant la terre rouge. Les petits villages aux murs blancs, aux couvertures de tuile brunie, nous sourient, comme autrefois, derrière leurs vergers. Rien n’est changé que le drapeau ; mais le drapeau, c’est tout pour l’homme qui comprend le saint mot de patrie. Et dire qu’au printemps de 1870, il y a dix-huit mois, les vieilles tirades sur le drapeau nous faisaient sourire ! Ah ! nous sommes mal nés, dans un temps trop serein, trop pacifique et trop confortable1728 surtout ! Il faut réagir maintenant, se refaire le sens moral, et devenir, s’il se peut, d’autres hommes.
(Alsace1729, I : Saverne.)
Pierre Dumont, dit la France1730 §
Il avait été volontaire en 1792, dans sa vingt-deuxième année… Ce n’est pas pour cueillir des lauriers qu’il prit le sac et le fusil, mais pour repousser ce fléau et cette honte abominable qui s’appelle l’invasion. Comme il ne se vantait de rien, sinon d’avoir fait son devoir, et comme il revint se marier sans avoir gagné ou accepté aucun grade, je suis mieux informé de ses dangers et de ses misères que de ses coups d’éclat, s’il en a fait. Mais je crois fermement, sur sa parole, que les armées de la Meuse et du Rhin ont fourni de belles marches sans souliers, et livré de rudes combats le ventre creux. Il racontait avec un mâle plaisir ces actions classiques où la valeur personnelle de l’homme jouait le rôle principal et où les plus savantes combinaisons d’un général en chef étaient bouleversées par une charge à la baïonnette. Mon imagination d’enfant s’allumait aux récits de la délivrance nationale. J’étais bien trop timide et trop respectueux pour aller dire, de but en blanc : Grand-papa racontez-moi donc la guerre ! Mais lorsque par bonheur j’obtenais la permission de passer quelques jour de congé à Launay1731, on me couchait après souper dans un coin du grand lit à colonnes torses, on tirait sur moi les rideaux de toile de Jouy1732; la lampe s’allumait ; ma grand’mère mettait son rouet en mouvement ; mon oncle Joseph, le charron, arrivait, suivi de sa femme ; une demi-douzaine de voisins et de voisines entraient successivement, les femmes avec leur tricot, les hommes avec leurs grands bras pendants et leurs mains lasses ; tout le monde s’asseyait sur les chaises de paille ou sur les bancs de bois poli, et la conversation s’engageait. Après les inévitables propos sur la pluie et le beau temps, choses qui sont d’un intérêt majeur à la campagne, et les mercuriales1733 du marché, et les petits événements de la ville voisine, on abordait des questions plus hautes et d’un intérêt plus général, comme la suppression de la loterie, l’invention des allumettes allemandes, qui devaient remplacer le briquet phosphorique, le retrait des anciennes monnaies, obligation du système métrique, la création des chemins de fer1734, souhaitée par ceux-ci, redoutée par ceux-là, mise en doute par le plus grand nombre. Quelquefois le père Antoine, épicier et cantonnier, tirait de sa poche un journal de la semaine dernière, emprunté à Tunique cabaret du village, et la politique entrait en jeu. Mais soit par un chemin, soit par un autre, mon grand-père arrivait toujours à son thème favori, la glorification de la France et l’exécration de l’étranger. L’étranger, pour lui, se divisait en trois sections également haïssables : l’Allemand, l’Anglais et le Russe. « Tous ces gens-là, disait-il, veulent avoir la France, parce qu’ils ne trouvent chez eux que du sable, de la boue, de la neige et du brouillard, et que la France est le plus beau pays du monde, le plus doux à habiter, le meilleur à cultiver, le plus varié dans ses aspects, le plus riche en produits de toute sorte, et, pour tout dire en un mot, l’enfant gâté de la nature. C’est pourquoi le premier devoir du Français est d’avoir l’œil sur la frontière et de se tenir toujours prêt à défendre le patrimoine national… » Il exprimait avec une émotion poignante ce qu’il avait senti de honte et de colère en apprenant que l’étranger foulait le sol sacré de notre France, et le mouvement spontané qui l’avait fait soldat avec un million de Français, tous patriotes comme lui. Le monde n’a rien connu de plus généreux, de plus désintéressé, de plus grand que cette guerre défensive, telle que je la vois encore à travers mes impressions d’enfant et ses souvenirs de vieillard. J’en rêve encore quelquefois, à mon âge. Mon esprit est hanté de visions à la fois sombres et radieuses, où les soldats français, coude à coude, en bataillon carré, déchirent leurs cartouches avec les dents et repoussent à coups de baïonnette les charges de l’ennemi. Le canon fait un trou, cinq ou six hommes tombent : l’officier, impassible sous ses épaulettes de laine, crie aux autres : Serrez les rangs ! Et le drapeau, ce clocher du régiment, resplendit au milieu de la fumée sous la garde de quelques vieux sous-officiers, résolus à mourir plutôt que de le rendre. Au bout d’une heure ou deux, l’ennemi, repoussé, décimé, découragé, se débande ; on le charge, on le disperse aux cris de : Vive la nation ! vive la République !
Lorsque Pierre Dumont frappait un ennemi de sa main, il ne se privait pas de l’interpeller à la mode des héros d’Homère1735 : « Beau, capitaine, allez voir là-bas si j’y suis ! » Ou bien : « Noble étranger, à l’ombre des bosquets paisibles ! » S’il lardait un simple soldat, c’était en style familier : « Eh ! garçon, cela t’apprendra. Rien de tel ne te fût arrivé si tu avais planté tes choux. » Cette éloquence était dans l’esprit de l’époque, mais quelquefois peut-être ralentissait-elle l’action. Mon grand-père s’en aperçut un jour qu’il croyait bien pourfendre je ne sais quel émigré de l’armée de Condé 1736. « Parricide ! lui criait-il, ton dard ne déchirera pas le sein de notre commune mère ! » Le parricide, un joli freluquet, tout galonné d’or, brandissait une petite épée de cour : il en porta un coup terrible entre les deux poumons de l’orateur, qui resta six mois sur le flanc. Lorsqu’il sortit de l’hôpital, encore mal en point, on lui offrit son congé définitif, qu’il accepta sans se faire prier. La paix de Bâle1737 était signée et le territoire français évacué depuis un bout de temps. Jamais Pierre Dumont n’avait, demandé autre chose, et il se souciait fort peu de promener son sac et son fusil à travers les capitales de l’Europe. Chacun chez soi, telle était sa devise ; ni conquérants ni conquis. Aux camarades qui commençaient à parler de palmes et de gloire, il répondait :
« Que voulez-vous ? je suis un volontaire que trois ans de campagnes n’ont pas rendu troupier. Prouvez-moi donc qu’il est superbe et glorieux d’aller faire chez le voisin ce que nous jugeons tous abominable quand le voisin le fait chez nous ! »
Il rentra au village, épousa Claudine Minot, une amie d’enfance à qui il avait dit : « attends-moi ! » et gagna lestement ses chevrons1738 de père de famille, sans retourner la tête vers ses anciens camarades de lit, qui passaient maréchaux, princes ou rois sous Bonaparte. Mais au commencement de l’année 1814, quand il sut que les étrangers, si longtemps molestés chez eux, revenaient à la charge et envahissaient la France par tous les bouts, le volontaire de 92 se réveilla plus jeune et plus acharné que jamais. Si j’interprète bien ses demi-mots et les reproches discrets de ma grand’mère, il s’échappa la nuit, comme un voleur, laissant sa femme et ses enfants, courut à pied jusqu’au fond de la Champagne et s’engagea dans un régiment où on le fit sergent d’emblée, bien malgré lui, tant les bons sous-officiers étaient devenus rares ! Lui-même n’a jamais compris par quel miracle ou quelle fatalité, après avoir reçu le 27 janvier le galon simple à Saint-Dizier, il se retrouvait dans la même ville le 25 mars avec les épaulettes de capitaine. Il faut dire que dans l’intervalle il avait vu Champaubert, Montmirail et Montereau1739, pris part à vingt combats et assisté à une grande bataille.
Chaque fois que papa Dumont racontait la campagne de France, il y avait toujours un moment où il baissait la voix pour raconter des choses mystérieuses. L’auditoire se serrait autour de lui, et moi, dans le grand lit où je faisais le mort, je tendais tous les ressorts de mon être pour saisir le secret plein d’horreur. Et j’accrochais des lambeaux d’histoire où il était question de villageois à l’affût derrière les haies, de coups de fusil tirés à la brune sur les traînards et les isolés, de cadavres enfouis dans les jardins ou jetés dans les puits. Le digne homme parlait avec effroi de cette campagne sinistre, dont les exploits ressemblent terriblement à des crimes.
« Quant à moi, disait-il, je n’ai fait, commandé ou permis rien de tel ; les Dumont ne confondent pas la guerre avec l’assassinat ; mais il faut passer quelque chose au patriotisme exaspéré, et je ne juge personne. »
Le lendemain de ces veillées, je m’échappais furtivement de ma chambrette, où l’on m’avait porté tout endormi, et l’on me surprenait quelquefois penché sur la margelle d’un puits, cherchant à démêler au fond de l’eau le profil d’un cosaque ou la silhouette d’un pandour1740.
(Le Roman d’un brave homme1741, I.)
Au collège §
C’est au collège seulement1742 que celui qui a le mieux fait son devoir est sûr d’avoir la première place, et personne ne se soucierait de l’obtenir autrement. C’est au collège que tous les Français sont égaux devant la loi ; il n’en va pas toujours ainsi dans le monde. C’est au collège qu’une absurde et touchante fraternité entraîne quelquefois les bons élèves à faire cause commune avec les autres. C’est au collège, enfin, et pas1743 ailleurs, que les coupables se font un point d’honneur de s’accuser eux-mêmes plutôt que de laisser punir un innocent. Dans ce milieu d’une salubrité vraiment rare, ni la fortune, ni les relations1744 ne comptent pour rien. On n’y connaît ni les protections ni les influences1745; l’émulation y est toujours en éveil, mais une émulation honnête et qui ne sort jamais du droit chemin. Non certes que les écoliers soient tous de petits saints : si je vous1746 le disais, je perdrais votre confiance. Mais ils se rectifient les uns les autres, et ils ne pardonnent jamais une faute contre l’honneur. Voilà comment la camaraderie devient une longue épreuve qui nous permet de nous apprécier les uns les autres, de nous améliorer au besoin par un contrôle réciproque et de choisir nos amis pour la vie. Vous le savez, les vieux amis sont meilleurs et plus solides que les neufs, et la grande fabrique des vieux amis, c’est le collège. J’entends encore notre professeur de septième dicter les places de notre première composition au mois d’octobre 1839. Je vois descendre des gradins un gros garçon sanglé dans son habit bleu barbeau1747 à boutons de métal et si myope sous ses énormes lunettes qu’il trébucha deux ou trois fois avant d’atteindre le banc d’honneur. Il était le premier en thème et s’appelait Francisque Sarcey1748. Je n’ai pas besoin de vous dire que depuis ce jour-là il a été le premier en beaucoup d autres choses. Il n’appartenait pas à ma pension ; nous ne mangions donc pas le même pain, si ce n’est une fois par an, à la Saint-Charlemagne. Il prenait ses récréations dans une cour de la rue des Minimes, et moi dans une cour de la rue Culture-Sainte-Catherine1749. Nous n’avions donc pas même l’occasion d’échanger ces bons coups de poing qui rapprochent les camarades, comme on prétend que la guerre rapproche les nations. Cependant, au bout de l’année, nous avions pris mesure de nos caractères respectifs, nous n’avions pas de secrets l’un pour l’autre, et je crois bien qu’il en est encore de même aujourd’hui.
(Discours prononcé à la distribution des prix du lycée Charlemagne, le 5 août 18831750.)
Alphonse Daudet
(1840-1897) §
Né à Nîmes en 1840, mort en 1897, Alphonse Daudet publia d’abord un recueil de poésies et quelques œuvres dramatiques. Son Petit Chose (1868) et ses Lettres de mon moulin (1869) le firent mettre au nombre de nos prosateurs les plus délicats et des peintres les plus exacts et les plus touchants de notre siècle contemporain. Depuis, avec des romans qui ont quelque chose de plus profond et de plus complexe, il est devenu l’ami des grands maîtres d’un genre qui a produit, de notre temps, plusieurs chefs-d’œuvre. Parmi ses Contes, dont beaucoup peuvent passer pour de délicieux modèles, les uns sont tout inspirés des sentiments virils ou douloureux qui ont agité l’âme du patriote ; les autres sont tout remplis de la grâce et du mouvement de l’esprit provençal dans ce qu’il a de plus poétique ou de plus joyeux ; enfin il n’est point de livre qui, de notre temps, ait passé pour une satire plus gaie et plus aimable que les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872).
La blouse §
Ce qui me frappa d’abord, à mon arrivée au collège, c’est que j’étais le seul avec une blouse. A Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouses ; il n’y a que les enfants de la rue, les gones, comme on dit. Moi, j’en avais une, une petite blouse à carreaux qui datait de la fabrique1751 ; j’avais une blouse, j’avais l’air d’un gone… Quand j’entrai dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait : « Tiens ! il a une blouse ! » Le professeur fit la grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d’un air méprisant. Jamais il ne m’appela par mon nom ; il disait toujours : « Eh ! vous là-bas, le petit Chose ! » Je lui avais dit pourtant plus de vingt fois que je m’appelais Daniel Ey-sset-te.
A la fin, mes camarades me surnommèrent « le petit Chose », et le surnom me resta....
Ce n’était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis, qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas ; moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le rance ; les couvertures étaient toujours en lambeaux, quelquefois il manquait des pages. Jacques1752 faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte ; mais il mettait toujours trop de colle, et cela puait. Il m’avait fait aussi un cartable avec une infinité de poches, très commode ; mais toujours trop de colle. Le besoin de coller et de cartonner était devenu chez Jacques une manie comme le besoin de pleurer. Il avait constamment devant le feu un tas de petits pots de colle, et, dès qu’il pouvait s’échapper du magasin un moment, il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps, il portait des paquets en ville, écrivait sous la dictée, allait aux provisions, le commerce enfin. Quant à moi, j’avais compris que lorsqu’on est boursier, qu’on porte une blouse, qu’on s’appelle « le petit Chose », il faut travailler deux fois plus que les autres pour être leur égal, et, ma foi ! le petit Chose se mit à travailler de tout son courage.
Brave petit Chose ! je le vois, en hiver, dans sa chambre sans feu, assis à sa table de travail, les jambes enveloppées d’une couverture.
Au dehors, le givre fouettait les vitres. Dans le magasin, on entendait M. Eyssette qui dictait :
« J’ai reçu votre honorée du 8 courant1753. »
Et la voix de Jacques qui reprenait :
« J’ai reçu votre honorée du 8 courant. »
De temps en temps, la porte de la chambre s’ouvrait doucement : c’était Mme Eyssette qui entrait. Elle s’approchait du petit Chose sur la pointe des pieds. Chut !...
« Tu travailles ? lui disait-elle tout bas.
— Oui, mère.
— Tu n’as pas froid ?
— Oh non ! »
Le petit Chose mentait ; il avait bien froid, au contraire.
Alors Mme Eyssette s’asseyait auprès de lui, avec son tricot, et restait là, de longues heures, comptant ses mailles à voix basse, avec un gros soupir de temps en temps.
Pauvre Mme Eyssette ! elle y pensait toujours à ce cher pays1754 qu’elle n’espérait plus revoir,
(Le Petit Chose1755, première partie, II.)
Les deux Tartarins §
Avec cette rage1756 d’aventure, ce besoin d’émotions fortes, cette folie de voyages, de courses, de diable au vert1757, comment diantre1758 se trouvait-il que Tartarin de Tarascon n’eût jamais quitté Tarascon ?
Car c’est un fait. Jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, l’intrépide Tarasconnais n’avait pas une fois couché hors de sa ville. Il n’avait pas même fait ce fameux voyage à Marseille, que tout bon Provençal se paye à sa majorité. C’est au plus s’il connaissait Beaucaire, et cependant Beaucaire n’est pas bien loin de Tarascon, puisqu’il n’y a que le pont à traverser1759. Malheureusement ce diable de pont a été si souvent emporté par les coups de vent, il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi ! vous comprenez… Tartarin de Tarascon préférait la terre ferme.
C’est qu’il faut bien vous l’avouer : il y avait dans notre héros deux natures très distinctes. « Je sens deux hommes en moi », a dit je ne sais quel Père de l’Église1760. Il l’eût dit vrai de Tartarin, qui portait en lui l’âme de don Quichotte1761, les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose ; mais malheureusement n’avait pas le corps du célèbre hidalgo1762, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps, sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer vingt nuits sans déboucler sa cuirasse et quarante-huit heures avec une poignée de riz… Le corps de Tartarin, au contraire, était un brave homme de corps, très lourd, très sensuel, très douillet, très geignard1763, plein d’appétits bourgeois et d’exigences domestiques, le corps ventru et court sur pattes de l’immortel Sancho Pança1764.
Don Quichotte et Sancho Pança dans le même homme ! Vous comprenez quel mauvais ménage ils y devaient faire ! quel combats ! quels déchirements !… O le beau dialogue à écrire pour Lucien ou pour Saint-Évremont1765, un dialogue entre les deux Tartarins, le Tartarin-Quichotte et le Tartarin-Sancho ! Tartarin-Quichotte s’exaltant aux récits de Gustave Aimard1766 et criant : « Je pars ! » Tartarin-Sancho ne pensant qu’aux rhumatismes et disant : « Je reste ».
Tartarin-Quichotte, très exalté. — Couvre-toi de gloire, Tartarin.
Tartarin-Sancho, très calme. — Tartarin, couvre-toi de flanelle.
Tartarin-Quichotte, de plus en plus exalté. — O les bons rifles1767 à deux coups ! ô les dagues, les lazos, les mocassins1768 !
Tartarin-Sancho, de plus en plus calme. — O les bons gilets tricotés, les bonnes genouillères bien chaudes ! ô les braves casquettes à oreillettes !
Tartarin-Quichotte, hors de lui. — Une hache ! qu’on me donne une hache !
Tartarin-Sancho, sonnant la bonne. — Jeannette, mon chocolat.
Là-dessus Jeannette apparaît avec un excellent chocolat, chaud, moiré, parfumé, et de succulentes grillades à l’anis, qui font rire Tartarin-Sancho en étouffant les cris de Tartarin-Quichotte.
Et voilà comme il se trouvait que Tartarin de Tarascon n’eut jamais quitté Tarascon.
(Tartarin de Tarascon1769, 1er épisode VI.)
Le pape est mort §
J’ai passé mon enfance dans une grande ville de province coupée en deux par une rivière très encombrée, très remuante, où j’ai pris de bonne heure le goût des voyages et la passion de la vie sur l’eau. Il y a surtout un coin de quai, près d’une certaine passerelle Saint-Vincent, auquel je ne pense jamais, même aujourd’hui, sans émotion. Je revois l’écriteau cloué au bout d’une vergue1770 : Cornet, bateaux de louage, le petit escalier qui s’enfonçait dans l’eau, tout glissant et noirci de mouillure, la flottille de petits canots fraîchement peints de couleurs vives, s’alignant au bas de l’échelle, se balançant doucement bord à bord, comme allégés par les jolis noms qu’ils portaient à leur arrière en lettres blanches : l’Oiseau-Mouche, l’Hirondelle.
Puis, parmi les longs avirons reluisants de céruse qui étaient en train de sécher contre le talus, le père Corne ! s’en allant avec son seau à peinture, ses grands pinceaux, sa figure tannée, crevassée, ridée de mille petites fossettes comme la rivière un soir de vent frais… Oh ! ce père Cornet ! Ç’a été le satan de mon enfance, ma passion douloureuse, mon péché, mon remords. M’en a-t-il fait commettre des crimes avec ses canots ! Je manquais l’école, je vendais mes livres. Qu’est-ce que je n’aurais pas vendu pour une après-midi de canotage !
Tous mes cahiers de classe au fond du bateau, la veste à bas, le chapeau en arrière, et dans les cheveux le bon coup d’éventail de la brise d’eau, je tirais ferme sur mes rames, en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d’un vieux loup de mer. Tant que jetais en ville, je tenais le milieu de la rivière, à égale distance des deux rives, où le vieux loup de mer aurait pu être reconnu. Quel triomphe de me mêler à ce grand mouvement de barques, de radeaux, de trains de bois, de mouches1771 à vapeur qui se côtoyaient, s’évitaient, séparés seulement par un mince liséré d’écume ! Il y avait de lourds bateaux qui tournaient pour prendre le courant, et cela en déplaçait une foule d’autres.
Tout à coup les roues d’un vapeur battaient l’eau près de moi ; ou bien une ombre lourde m’arrivait dessus, c’était l’avant d’un bateau de pommes.
« Gare donc, moucheron ! » me criait une voix enrouée ; et je suais, je me débattais, empêtré dans le va-et-vient de cette vie du fleuve que la vie de la rue traversait incessamment par tous ces ponts, toutes ces passerelles qui mettaient des reflets d’omnibus sous la coupe des avirons. Et le courant si dur à la pointe des arches, et les remous, les tourbillons, le fameux trou de la Mort-qui-trompe ! Pensez que ce n’était pas une petite affaire de se guider là dedans avec des bras de douze ans et personne pour tenir la barre.
Quelquefois j’avais la chance de rencontrer la chaîne1772.
Vite je m’accrochais tout au bout de ces longs trains de bateaux qu’elle remorquait, et, les rames immobiles, étendues comme des ailes qui planent, je me laissais aller à cette vitesse silencieuse qui coupait la rivière en longs rubans d’écume et faisait filer des deux côtés les arbres, les maisons du quai. Devant moi, loin, bien loin, j’entendais le battement monotone de l’hélice, un chien qui aboyait sur un des bateaux de la remorque où montait d’une cheminée basse un petit filet de fumée ; et tout cela me donnait l’illusion d’un grand voyage, de la vraie vie de bord.
Malheureusement ces rencontres de la chaîne étaient rares. Le plus souvent il fallait ramer, et ramer aux heures de soleil. Oh ! les pleins midis tombant d’aplomb sur la rivière, il me semble qu’ils me brûlent encore. Tout flambait, tout miroitait. Dans cette atmosphère aveuglante et sonore qui flotte au-dessus des vagues et vibre à tous les mouvements, les courts plongeons de mes rames, les cordes des haleurs soulevées de l’eau toutes ruisselantes faisaient passer des lumières vives d’argent poli. Et je ramais en fermant les yeux. Par moments, à la vigueur de mes efforts, à l’élan de l’eau sous ma barque, je me figurais que j’allais très vite ; mais, en relevant la tête, je voyais toujours le même arbre, le même mur en face de moi sur la rive.
Enfin, à force de fatigues, tout moite et rouge de chaleur, je parvenais à sortir de la ville. Le vacarme des bains froids, des bateaux de blanchisseuses, des pontons d’embarquement diminuait. Les ponts s’espaçaient sur la rive élargie. Quelques jardins de faubourg, une cheminée d’usine, s’y reflétaient de loin en loin. A l’horizon tremblaient des îles vertes. Alors, n’en pouvant plus, je venais me ranger contre la rive, au milieu des roseaux tout bourdonnants ; et là, abasourdi par le soleil, la fatigue, cette chaleur lourde qui montait de l’eau étoilée de larges fleurs jaunes, le vieux loup de mer se mettait à saigner du nez pendant des heures. Jamais mes voyages n’avaient un autre dénouement. Mais que voulez-vous ? Je trouvais cela délicieux.
Le terrible, par exemple, c’était le retour, la rentrée. J’avais beau revenir à toutes rames, j’arrivais toujours trop lard, longtemps après la sortie des classes. L’impression du jour qui tombe, les premiers becs de gaz dans le brouillard, la retraite, tout augmentait mes transes, mon remords. Les gens qui passaient, rentrant chez eux bien tranquilles, me faisaient envie ; et je courais la tête lourde, pleine de soleil et d’eau, avec des ronflements de coquillages au fond des oreilles, et déjà sur la figure le rouge du mensonge que j’allais dire.
Car il en fallait un chaque fois pour faire tête à ce terrible « d’où viens-tu ? » qui m’attendait en travers de la porte. C’est cet interrogatoire de l’arrivée qui m’épouvantait le plus. Je devais répondre là, sur le palier, au pied levé, avoir toujours une histoire prête, quelque chose à dire, et de si étonnant, de si renversant, que la surprise coupât court à toutes les questions. Cela me donnait le temps d’entrer, de reprendre haleine ; et, pour en arriver là, rien ne me coûtait. J’inventais des sinistres, des révolutions, des choses terribles, tout un côté de la ville qui brûlait, le pont du chemin de fer s’écroulant dans la rivière. Mais ce que je trouvai encore de plus fort, le voici :
Ce soir-là, j’arrivai très en retard. Ma mère, qui m’attendait depuis une grande heure, guettait, debout, en haut de l’escalier.
« D’où viens-tu ? » me cria-t-elle.
Dites-moi ce qu’il peut tenir de diableries dans une tête d’enfant. Je n’avais rien trouvé, rien préparé. J’étais venu trop vite… Tout à coup il me passa une idée folle.
Je savais la chère femme très pieuse, catholique enragée comme une Romaine, et je lui répondis dans tout l’essoufflement d’une grande émotion :
« O maman… Si vous saviez !...
— Quoi donc ?… Qu’est-ce qu’il y a encore ?
— Le pape1773 est mort.
— Le pape est mort !… » fit la pauvre mère, et elle s’appuya toute pâle contre la muraille. Je passai vite dans ma chambre, un peu effrayé de mon succès et de l’énormité du mensonge ; pourtant j’eus le courage de le soutenir jusqu’au bout. Je me souviens d’une soirée funèbre et douce ; le père très grave, la mère atterrée. On causait bas autour de la table. Moi, je baissais les yeux ; mais mon escapade s’était si bien perdue dans la désolation générale que personne n’y pensait plus.
Chacun citait à l’envi quelque trait de vertu de ce pauvre Pie IX ; puis, peu à peu, la conversation s’égarait à travers l’histoire des papes. Tante Rose parla de Pie VII1774, qu’elle se souvenait très bien d’avoir vu passer dans le Midi, au fond d’une chaise de poste, entre des gendarmes. On rappela la fameuse scène avec l’empereur : Comediante !... tragediante !… C’était bien la centième fois que je l’entendais raconter, cette terrible scène, toujours avec les mêmes intonations, les mêmes gestes, et ce stéréotypé des traditions de famille qu’on se lègue et qui restent là ! puériles et locales, comme des histoires de couvent.
C’est égal, jamais elle ne m’avait paru si intéressante.
Je l’écoutais avec des soupirs hypocrites, des questions, un air de faux intérêt, et tout le temps je me disais :
« Demain matin, en apprenant que le pape n’est pas mort, ils seront si contents que personne n’aura le courage de me gronder. »
Tout en pensant à cela, mes yeux se fermaient malgré moi, et j’avais des visions de petits bateaux peints en bleu, avec des coins de Saône alourdis par la chaleur, et de grandes pattes d’argyronètes1775 courant dans tous les sens et rayant l’eau vitreuse, comme des pointes de diamant.
(Contes choisis1776, XIX.)
Anatole France
(né en 1844) §
M. Anatole France, né à Paris, s’est illustré comme poète, comme critique, comme historien ; mais ce sont surtout ses romans et ses contes qui ont assuré sa gloire. Son style, à la fois aisé et savant, d’une couleur, d’un souplesse, d’un charme incomparables, sa pensée, délicate, souriante et profonde, font de lui l’un des prosateurs les plus parfaits non seulement de notre époque, mais de toute notre littérature. Nous nous bornerons à rappeler ici, avec l’Etui de nacre (1892), le plus célèbre de ses recueils de contes, les deux premiers en date de ses chefs-d’œuvre, le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut (1885), et le Livre de mon ami (1885).
Souvenirs d’enfance §
I
L’orgueil puni §
Si l’on mettait à se cacher autant de soin qu’on en met d’ordinaire à se montrer, on éviterait bien des peines. J’en1777 fis de bonne heure une première expérience.
C’était un jour de pluie. J’avais reçu en cadeau tout un attirail de postillon, casquette, fouet, guides et grelots. Il y avait beaucoup de grelots. J’attelai ; c’est moi que j’attelai à moi-même, car j’étais tout ensemble le postillon, les chevaux et la voiture. Mon parcours s’étendait de la cuisine à la salle à manger par un couloir. Cette salle à manger me représentait très bien une place de village. Le buffet d’acajou où je relayais me semblait sans difficulté l’auberge du Cheval-Blanc. Le couloir m’était une grande route avec ses perspectives changeantes et ses rencontres imprévues. Confiné dans un petit espace sombre, je jouissais d’un vaste horizon et j’éprouvais, entre des murs connus, ces surprises qui font le charme des voyages. C’est que j’étais alors un grand magicien. J’évoquais pour mon amusement des êtres aimables et je disposais à souhait de la nature. J’ai eu, depuis, le malheur de perdre ce don précieux. J’en jouissais abondamment dans ce jour de pluie où je fus postillon.
Cette jouissance aurait dû suffire à mon contentement : mais est-on jamais content ? L’envie me vint de surprendre, d’éblouir, d’étonner des spectateurs. Ma casquette de velours et mes grelots ne m’étaient plus de rien si personne ne les admirait. Comme j’entendais mon père et ma mère causer dans la chambre voisine, j’y entrai avec un grand fracas. Mon père m’examina pendant quelques instants ; puis il haussa les épaules et dit :
« Cet enfant ne sait que faire ici. Il faut le mettre en pension.
— Il est encore bien petit, dit ma mère.
— Eh bien, dit mon père, on le mettra avec les petits. »
Je n’entendis que trop bien ces paroles ; celles qui suivirent m’échappèrent en partie, et, si je peux les rapporter exactement, c’est qu’elles m’ont été répétées plusieurs fois depuis.
Mon père ajouta :
« Cet enfant, qui n’a ni frères ni sœurs, développe ici, dans l’isolement, un goût de rêverie qui lui sera nuisible par la suite. La solitude exalte son imagination et j’ai observé que déjà sa tète était pleine de chimères. Les enfants de son âge qu’il fréquentera à l’école lui donneront l’expérience du monde. Il apprendra d’eux ce que sont les hommes ; il ne peut l’apprendre de vous et de moi, qui lui apparaissons comme des génies tutélaires. Ses camarades se comporteront avec lui comme des égaux qu’il faut tantôt plaindre et défendre, tantôt persuader ou combattre. Il fera avec eux l’apprentissage de la vie sociale....
— Vous avez raison, mon ami, répondit ma mère, j’irai dès demain à la recherche d’une bonne pension pour notre enfant. »
A la suite de cette conversation, Mme Noziére est allée trouver une vieille demoiselle qui tient une petite école, Mlle Lefort.
II
La première journée d’école §
Mlle Lefort, qui tenait dans le faubourg Saint-Germain1778, une pension pour des enfants en bas âge, consentit à me recevoir de dix heures à midi et de deux heures à quatre. Je m’étais fait par avance une idée affreuse de cette pension, et, quand ma bonne m’y traîna pour la première fois, je me jugeai perdu.
Aussi je fus extrêmement surpris, en entrant, de voir dans une grande chambre cinq ou six petites filles et une douzaine de petits garçons qui riaient, faisaient des grimaces et donnaient toute sorte de signes de leur insouciance et de leur espièglerie. Je les jugeai bien endurcis.
Je vis, par contre, que Mlle Lefort était profondément triste. Ses yeux bleus étaient humides et ses lèvres entrouvertes.
De pâles boucles à l’anglaise pendaient le long de ses joues, comme au bord des eaux les branches mélancoliques des saules. Elle regardait sans voir et semblait perdue dans un rêve.
La douceur de cette demoiselle affligée et la gaieté des enfants m’inspirèrent de la confiance ; à la pensée que j’allais partager le sort de plusieurs petites filles, peu à peu, toutes mes craintes s’évanouirent.
Mlle Lefort, m’avant donné une ardoise avec un crayon, me fit asseoir à côté d’un garçon de mon âge qui avait les yeux vifs et l’air fin.
« Je m’appelle Fontanet, me dit-il, et toi ? »
Puis il me demanda ce que faisait mon père. Je lui dis qu’il était médecin.
« Le mien est avocat, répondit Fontanet ; c’est mieux.
— Pourquoi ?
— Tu ne vois pas que c’est plus joli d’être avocat ?
— Non.
— Alors c’est que tu es bête. »
Fontanet avait l’esprit fertile. Il me conseilla d’élever des vers à soie et me montra une belle table de Pythagore qu’il avait faite lui-même. J’admirai Pythagore et Fontanet. Moi, je ne savais que des fables.
En partant, je reçus de Mlle Lefort un bon point dont je ne pus parvenir à découvrir l’usage. Ma mère m’expliqua que n’avoir point d’utilité était le propre des honneurs. Elle me demanda ensuite ce que j’avais fait dans cette première journée. Je lui répondis que j’avais regardé Mlle Lefort.
Elle se moqua de moi, mais j’avais dit la vérité. J’ai été enclin de tout temps à prendre la vie comme un spectacle… Je suis né spectateur et je conserverai, je crois, toute ma vie cette ingénuité des badauds de la grande ville, que tout amuse et qui gardent dans l’âge de l’ambition la curiosité désintéressée des petits enfants....
Je continuai donc à regarder ma maîtresse et, me confirmant dans l’idée qu’elle était triste, je demandai à Fontanet d’où venait cette tristesse. Sans rien affirmer de positif, Fontanet l’attribuait au remords et croyait bien se rappeler qu’elle fut subitement imprimée sur les traits de Mlle Lefort, au jour, déjà ancien, où cette personne lui confisqua sans nul droit une toupie de buis et commit presque aussitôt un nouvel attentat ; car, pour étouffer les plaintes de celui qu’elle avait spolié, elle lui enfonça le bonnet d’âne sur la tête.
Fontanet concevait qu’une âme souillée de ces actes eût perdu à jamais la joie et le repos ; mais les raisons de Fontanet ne me suffisaient pas et j’en cherchais d’autres.
Il était difficile, à vrai dire, de chercher quelque chose dans la classe de Mlle Lefort, à cause du tumulte qui y régnait sans cesse. Les élèves s’y livraient de grands combats ! devant Mlle Lefort, visible, mais absente. Nous nous jetions les uns aux autres tant de catéchismes et de croûtes de pain, que l’air en était obscurci et qu’un crépitement continu remplissait la salle. Seuls, les plus jeunes enfants, les pieds dans les mains et la langue tirée hors la bouche, regardaient le plafond avec un sourire pacifique.
Soudain Mlle Lefort, entrant dans la mêlée d’un air de somnambule, punissait quelque innocent ; puis elle rentrait dans sa tristesse comme dans une tour.
La vraie cause de l’attitude de Mlle Lefort, c’est qu’elle était poète, poète élégiaque : elle faisait même écrire en dictée à ses petits écoliers ses larmoyantes élégies. Au bout de quelque temps, les parents de Pierre Nozière et ceux de Fontanet, trouvant cette pédagogie insuffisante, retirent les deux enfants. Nous allons les retrouver un peu plus tard, vers l’époque où ils commencent à étudier le latin.
III
Teutobochus §
Il ne me paraît pas possible qu’on puisse avoir l’esprit tout à fait commun, si l’on fut élevé sur les quais de Paris, en face du Louvre et des Tuileries, près du palais Mazarin1779, devant la glorieuse rivière de Seine, qui coule entre les tours, les tourelles et les flèches du vieux Paris. Là, de la rue Guénégaud à la rue du Bac1780, les boutiques des libraires, des antiquaires et des marchands d’estampes étalent à profusion les plus belles formes de l’art et les plus curieux témoignages du passé. Chaque vitrine est, dans sa grâce bizarre et son pêle-mêle amusant, une séduction pour les yeux et pour l’esprit. Le passant qui sait voir en emporte toujours quelque idée, comme l’oiseau s’envole avec une paille pour son nid....
Au temps de mon enfance, bien plus encore qu’à présent, ce marché de la curiosité était abondamment fourni de meubles anciens, d’estampes anciennes, de vieux tableaux et de vieux livres, de crédences1781 sculptées, de potiches à fleurs, d’émaux, de faïences décorées, d’orfrois1782, d’étoffes brochées, de tapisseries à personnages, de livres à figures et d’éditions princeps1783 reliées en maroquin. Ces aimables choses étaient déjà familières à Fontanet et à moi, quand nous avions encore des grands cols brodés, des culottes courtes et des mollets nus.
Fontanet demeurait au coin de la rue Bonaparte1784, où son père avait son cabinet d’avocat. L’appartement de mes parents touchait à une des ailes de l’hôtel de Chimay1785. Nous étions, Fontanet et moi, voisins et amis. En allant ensemble, les jours de congé, jouer aux Tuileries, nous passions par ce docte quai Voltaire, et, là, cheminant, un cerceau à la main et une balle dans la poche, nous regardions aux boutiques tout comme les vieux messieurs, et nous nous faisions à notre façon des idées sur toutes ces choses étranges, venues du passé, du mystérieux passé.
Eh oui ! nous flânions, nous bouquinions1786, nous examinions des images.
Cela nous intéressait beaucoup. Mais Fontanet, je dois le dire, n’avait pas comme moi le respect de toutes les vieilleries. Il riait des antiques plats à barbe et des saints évêques dont le nez était cassé. Fontanet était dès lors l’homme de progrès que vous avez entendu à la tribune de la Chambre1787. Ses irrévérences me faisaient frémir. Je n’aimais point qu’il appelât têtes de pipe les portraits bizarres des ancêtres. J’étais conservateur. Il m’en est resté quelque chose, et toute ma philosophie m’a laissé l’ami des vieux arbres et des curés de campagne.
Je me distinguais encore de Fontanet par un penchant à admirer ce que je ne comprenais pas. J’adorais les grimoires1788 ; et tout, ou peu s’en faut, m’était grimoire. Fontanet, au contraire, ne prenait plaisir à examiner un objet qu’autant qu’il en concevait l’usage. Il disait : « Tu vois, il y a une charnière, cela s’ouvre. Il y a une vis, cela se démonte. » Fontanet était un esprit juste. Je dois ajouter qu’il était capable d’enthousiasme en regardant des tableaux de batailles. Le Passage de la Bérézina1789 lui donnait de l’émotion. La boutique de l’armurier nous intéressait l’un et l’autre. Quand nous voyions, au milieu des lances, des targes1790, des cuirasses et des rondaches1791, M. Petit-Prêtre, revêtu d’un tablier de serge verte, s’en aller, boitant comme Vulcain, prendre au fond de batelier une antique épée qu’il posait ensuite sur son établi et qu’il serrait dans un étau de fer pour nettoyer la lame et réparer la poignée, nous avions la certitude d’assister à un grand spectacle ; M. Petit-Prêtre nous apparaissait haut de cent coudées. Nous restions muets, collés à la vitre. Les yeux noirs de Fontanet brillaient et toute sa figure brune et fine s’animait.
Le soir, ce souvenir nous exaltait beaucoup, et mille projets enthousiastes germaient dans nos têtes.
Fontanet me dit une fois :
« Si, avec du carton et le papier couleur d’argent qui enveloppe le chocolat, nous faisions des armes semblables à celles de Petit-Prêtre !… »
L’idée était belle. Mais nous ne parvînmes pas à la réaliser convenablement. Je fis un casque, que Fontanet prit pour un bonnet de magicien.
Alors je dis :
« Si nous fondions un musée !… »
Excellente pensée ! Mais nous n’avions pour le moment à mettre dans ce musée qu’un demi-cent de billes et une douzaine de toupies.
C’est à ce coup que Fontanet eut une troisième conception. Il s’écria :
« Composons une Histoire de France, avec tous les détails, en cinquante volumes. »
Cette proposition m’enchanta, et je l’accueillis avec des battements de mains et des cris de joie. Nous convînmes que nous commencerions le lendemain matin, malgré une page du De Viris1792 que nous avions à apprendre.
— Tous les détails ! répéta Fontanet, Il faut mettre tous les détails !
C’est bien ainsi que je l’entendais. Tous les détails !
On nous envoya coucher. Mais je restai bien un quart d’heure dans mon lit sans dormir, tant j’étais agité par la pensée sublime d’une Histoire de France en cinquante volumes, avec tous les détails.
Nous la commençâmes, cette histoire. Je ne sais, ma foi, plus pourquoi nous la commençâmes par le roi Teutobochus1793. Mais telle était l’exigence de notre plan. Notre premier chapitre nous mit en présence du roi Teutobochus, qui était haut de trente pieds1794, comme on put s’en assurer en mesurant ses ossements retrouvés par hasard. Dès le premier pas, affronter un tel géant ! La rencontre était terrible. Fontanet lui-même en fut étonné.
« Il faut sauter par-dessus Teutobochus, » me dit-il.
Je n’osai point.
L’Histoire de France en cinquante volumes s’arrêta à Teutobochus.
Que de fois, hélas ! j’ai recommencé dans ma vie cette aventure du livre et du géant ! Que de fois, sur le point de commencer une grande œuvre ou de conduire une vaste entreprise, je fus arrêté net par un Teutobochus nommé vulgairement sort, hasard, nécessité ! J’ai pris le parti de remercier et de bénir tous ces Teutobochus qui, me barrant les chemins hasardeux de la gloire, m’ont laissé à mes deux fidèles gardiennes, l’obscurité et la médiocrité. Elles me sont douces toutes deux et m’aiment. Il faut bien que je le leur rende !
Quant à Fontanet, mon subtil ami Fontanet, avocat, conseiller général, administrateur de diverses compagnies, député, c’est merveille de le voir se jouer et courir entre les jambes de tous les Teutobochus de la vie publique, contre lesquels, à sa place, je me serais mille fois cassé le nez.
(Le Livre de mon ami : Nouvelles Amours, IV, V, VI.)
Pierre Loti
(né en 1850) §
Pierre Loti est le pseudonyme d’un officier de notre marine, M. Julien Viaud. Né à Rochefort en 1850, il a d’abord, par son talent très personnel, renouvelé, dans des récits dont l’action se passe en Orient, l’art de la description dont tant de grands maîtres cependant avaient, au xixe siècle, déjà donné des modèles. Mais ses romans les plus célèbres et le plus justement admirés sont ceux dans lesquels il a peint avec beaucoup d’exactitude et d’émotion, nous les montrant tour à tour dans des paysages et des milieux divers, ces marins bretons qu’il connaît bien pour avoir vécu de leur vie, Mon frère Yves (1883) et surtout Pêcheur d’Islande (1886). Des mérites analogues enfin ont assuré le succès d’un livre également renommé, dont l’action se passe au pays basque, Ramuntcho (1897).
Scène de tempête §
En mer, mai 1877.
Depuis deux jours, la grande voix sinistre1795 gémissait autour de nous. Le ciel était très noir ; il était comme dans ce tableau où le Poussin a voulu peindre le déluge1796; seulement toutes les nuées remuaient, tourmentées par un vent qui faisait peur.
Et cette grande voix s’enflait toujours, se faisait profonde, incessante : c’était comme une fureur qui s’exaspérait. Nous nous heurtions dans notre marche à d’énormes masses d’eau, qui s’enroulaient en volutes à crêtes blanches et qui passaient avec des airs de se poursuivre ; elles se ruaient sur nous de toutes leurs forces : alors c’étaient des secousses terribles et de grands bruits sourds.
Quelquefois la Médée1797 se cabrait, leur montait dessus1798, comme prise, elle aussi, de fureur contre elles. Et puis elle retombait toujours, la tête en avant, dans des creux traîtres qui étaient derrière ; elle touchait le fond de ces espèces de vallées qu’on voyait s’ouvrir rapides, entre de hautes parois d’eau ; et on avait hâte de remonter encore, de sortir d’entre ces parois courbes, luisantes, verdâtres, prêtes à se refermer.
Une pluie glacée rayait l’air en longues flèches blanches, fouettait, cuisait comme des coups de lanières. Nous nous étions rapprochés du nord, en nous élevant le long de la côte chinoise, et ce froid inattendu nous saisissait.
En haut, dans la mâture, on essayait de serrer les huniers1799, déjà au bas ris1800; la cape1801 était déjà dure à tenir, et maintenant il fallait, coûte que coûte, marcher droit contre le vent, à cause des terres douteuses qui pouvaient être là, derrière nous.
Il y avait deux heures que les gabiers1802 étaient à ce travail, aveuglés, cinglés, brûlés par tout ce qui leur tombait dessus1803, gerbes d’écume lancées de la mer, pluie et grêle lancées du ciel ; essayant avec leurs mains crispées de froid qui saignaient, de crocher1804 dans cette toile rude et mouillée qui ballonnait sous le vent furieux.
Mais on ne se voyait plus, on ne s’entendait plus.
On en aurait eu assez rien que de se tenir1805 pour n’être pas emporté, rien que de se cramponner à toutes ces choses remuantes, mouillées, glissantes d’eau ; — et il fallait encore travailler en l’air sur ces vergues qui se secouaient, qui avaient des mouvements brusques, désordonnés, comme les derniers battements d’ailes d’un grand oiseau blessé qui râle.
Des cris d’angoisse venaient de là-haut, de cette espèce de grappe humaine suspendue. Cris d’hommes, cris rauques, plus sinistres que ceux des femmes, parce qu’on est moins habitué à les entendre ; cris d’horrible douleur : une main prise quelque part, des doigts accrochés, qui se dépouillaient de leur chair ou s’arrachaient ; — ou bien un malheureux, moins fort que les autres, crispé de froid, qui sentait qu’il né se tenait plus, que le vertige venait, qu’il allait lâcher et tomber. Et les autres, par pitié l’attachaient, pour essayer de l’affaler1806 jusqu’en bas.
… Il y avait deux heures que cela durait ; ils étaient épuisés ; ils ne pouvaient plus.
Alors on les fit descendre, pour envoyer à leur place ceux de bâbord1807, qui étaient plus reposés et qui avaient moins froid.
… Ils descendirent, blêmes, mouillés, l’eau glacée leur ruisselant dans la poitrine et dans le dos, les mains sanglantes, les ongles décollés, les dents qui claquaient.
Depuis deux jours on vivait dans l’eau, on avait à peine mangé, à peine dormi, et la force des hommes diminuait.
C’est cette longue attente, cette longue fatigue dans le froid humide qui sont les vraies horreurs de la mer. Souvent les pauvres mourants, avant de rendre leur dernier cri, leur dernier hoquet d’agonie, sont restés des jours et des nuits, trempés, salis, couverts d’une couche boueuse de sueur froide et de sel, d’un enduit de mort.
… Le grand bruit augmentait toujours. Il y avait des moments où cela sifflait aigre et strident1808, comme dans un paroxysme d’exaspération méchante ; et puis d’autres où cela devenait grave, caverneux, puissant comme des sons immenses de cataclysme. Et on sautait toujours d’une lame à l’autre, et, à part la mer qui gardait encore sa mauvaise blancheur de bave et d’écume, tout devenait plus noir. Un crépuscule glacial tombait sur nous ; derrière ces rideaux sombres, derrière toutes ces masses d’eau qui étaient dans le ciel/ le soleil venait de disparaître, parce que c’était l’heure ; il nous abandonnait, et il allait falloir se débrouiller dans la nuit….
… Yves1809 était monté avec les bâbordais1810 dans ce désarroi de la mâture, et alors je regardais en haut, aveuglé moi aussi, ne percevant plus que par instants la grappe humaine en l’air.
Et tout à coup, dans une plus grande secousse, la silhouette de cette grappe se rompit brusquement, changea de forme ; deux corps s’en détachèrent et tombèrent les bras écartés dans les volutes mugissantes de la mer, tandis qu’un autre s’aplatit sur le pont, sans cri, comme serait tombé un homme déjà mort.
— Encore le marchepied1811 cassé ! dit le maître de quart1812, en frappant du pied avec rage. Du filin pourri1813 qu’ils nous ont donné dans ce sale port de Brest ! Le grand Kerboul, à la mer. Le second1814, qui est-ce ?
D’autres, raccrochés par les mains à des cordages, un instant balancés dans le vide, remontaient maintenant, à la force des poignets, en se dépêchant, — très vite comme des singes.
Je reconnus Yves, un de ceux qui grimpaient, — et alors je repris ma respiration que l’angoisse avait coupée.
Ceux qui étaient à la mer, on jeta bien des bouées pour eux, — mais à quoi bon ? — On aimait encore mieux ne plus les voir reparaître, car alors, à cause de ce danger de tomber en travers à la lame1815, on n’aurait pas pu s’arrêter pour les reprendre, et il aurait fallu avoir ce courage horrible de les abandonner. Seulement on fit l’appel de ceux qui restaient, pour savoir le nom du second qu’on avait perdu : c’était un petit novice1816 très sage, que sa mère, une veuve déjà âgée, était venue recommander au maître1817 avant le départ de France.
L’autre, celui qui s’était écrasé sur le pont, on le descendit tant bien que mal, à quatre, en le faisant encore tomber en route ; on le porta dans l’infirmerie, qui était devenue un cloaque immonde, où bouillonnaient deux pieds1818 d’eau boueuse et noire, avec des fioles brisées, des odeurs de tous les remèdes répandus. Pas même un endroit où le laisser finir en paix ; la mer n’avait seulement pas de pitié pour ce mourant, elle continuait de le faire danser, de le sauter de plus belle. Il avait retrouvé une espèce de son de la gorge, un râlement qui sortait encore, perdu dans tous les grands bruits des choses. On aurait peut-être pu le secourir, prolonger son agonie, avec un peu de calme. Mais il mourut là assez vite, entre les mains d’infirmiers devenus stupides de peur, qui voulaient le faire manger.
Huit heures du soir. — A ce moment, la charge du quart1819 était lourde, et c’était à mon tour de la prendre.
On se tenait comme on pouvait. On ne voyait plus rien. On était au milieu de tant de bruit, que la voix des hommes semblait n’avoir plus aucun son ; les sifflets d’argent1820, forcés à pleine poitrine, perçaient mieux, comme des chants flûtés de tout petits oiseaux.
On entendait des coups terribles frappés contre les murailles du navire comme par des béliers énormes. Toujours les grands trous qui se creusaient, tout béants, partout ; on s’y sentait, jeté tête baissée, dans la nuit profonde. Et puis une force vous heurtait d’une poussée brutale, vous relançait très haut en l’air, et toute la Médée vibrait, en ressautant, comme un monstrueux tambour. Alors, on avait beau se cramponner, on se sentait rebondir, et vite on se recramponnait1821 plus fort, en fermant la bouche et les yeux, parce qu’on devinait d’instinct, sans voir, que c’était le moment où une épaisse masse d’eau allait balayer l’air et peut-être vous balayer aussi.
Toujours cela recommençait, ces chutes en avant, et puis ces sauts avec l’affreux bruit de tambour.
Et, après chacun de ces chocs, il y avait encore les ruissellements de l’eau qui retombait de partout, et mille objets qui se brisaient, mille cassons1822 qui roulaient dans l’obscurité, tout cela prolongeant en queue sinistre beffroi du premier grand bruit.
Et les gabiers, et mon pauvre Yves, que faisaient-ils là-haut ? Les mâts, les vergues, on les apercevait par instants, dans le noir, en silhouettes, quand on pouvait encore regarder à travers cette douleur cuisante que causait la grêle ; on apercevait ces formes de grandes croix à deux étages comme les croix russes, agitées dans l’ombre avec des mouvements de détresse, des gestes fous.
— Faites-les descendre, me dit le commandant, qui préférait le danger de ce hunier non serré à la peur de perdre encore des hommes.
Je le donnai vite avec joie, cet ordre-là. Mais Yves, d’en haut, me répondit, à l’aide de son sifflet, que c’était presque fini ; plus que la jarretière du point1823, qui était cassée, à remplacer par un bout1824 quelconque, et puis ils allaient tous descendre, ayant serré leur voile, achevé leur ouvrage.
Après, quand ils furent tous en bas et au complet, je respirai mieux. Plus d’hommes en l’air, plus rien à faire là-haut, plus qu’à attendre. Oh ! alors, je trouvai qu’il faisait presque beau, qu’on était presque bien sur cette passerelle, à présent qu’on m’avait enlevé le poids si lourd de cette inquiétude.
(Mon frère Yves, XXVII)
POÉSIE
Mellin de Saint-Gelais
(1487-1558) §
Mellin de Saint-Gelais, fils ou neveu du poète Octavien de Saint-Gelais (1466-1502), est né à Angoulême en 1487 et mort en 1558. Poète léger, en faveur à la cour, disciple de Marot1825, dont il est loin d’avoir le naturel, il essaya, mais en vain, dans les dernières années de sa vie, de lutter contre l’influence de Ronsard et de son école1826, puis se laissa sagement réconcilier avec ses jeunes vainqueurs. Le triomphe de l’école nouvelle était dès lors définitif.
D’un charlatan §
Un charlatan disait en plein marché
Qu’il montrerait le diable à tout le monde ;
Si1827 n’y eut nul, tant fût-il empêché1828,
Qui ne courût pour voir l’esprit immonde1829.
Lors une bourse assez large et profonde
Il leur déploie, et leur dit : « Gens de bien,
Ouvrez vos yeux ! Voyez ! Y a-t-il rien ?
— Non, dit quelqu’un des plus près regardants1830.
— Et c’est, dit-il, le diable, oyez-vous bien1831,
Ouvrir sa bourse et ne rien voir dedans. »
(Œuvres poétiques, édit. Prosper Blanchemain. Tome I, p. 227.)
La vraie grandeur §
La liberté, cher ami des Essars1832,
Par le dehors1833 ne se doit demander ;
Fût-on vainqueur autant que les Césars,
Cela ne peut l’homme recommander,
Si à soi-même il ne sait commander ;
Et1834 qui le fait est franc et plus que roi.
Mais le commun1835 n’entend point cette loi,
Car chacun vise aux biens et aux grand’sommes1836.
Si est-ce plus être maistre de soi1837,
Que commander au demeurant des hommes1838.
(Œuvres poétiques, édit. Prosper Blanchemain, tome II, p. 228.)
Clément Marot
(1495-1544) §
Fils du poète Jehan des Mares, dit Marot, de Caen (1463-1523), Clément Marot naquit à Cahors en 1495. Quoique attaché au service de François Ier, il fut plusieurs fois accusé d’hérésie et emprisonné ou forcé de s’exiler. En 1543 notamment, il dut s’enfuir à Genève, puis en Italie, et mourut à Turin en 1544. Il a laissé, outre une traduction des Psaumes, que les Réformés adoptèrent pour leurs offices, et d’autres poésies variées, des épitres et des épigrammes pleines de naturel et d’esprit.
De l’arrivée de Monseigneur D’alençon1839 en Hainaut (1521). §
Devers Hainaut, sur les fins1840 de Champagne,
Est arrivé le bon duc d’Alençon,
Avec honneur, qui toujours l’accompagne
Comme le sien propre et vrai écusson.
Là peut-on voir, sur la grand’1841 plaine unie,
Des bons soudards son enseigne munie,
Prêts d’employer leur bras fulminatoire1842
A repousser dedans leur territoire
Lourds Hainuyers1843, gent rustique et brutale
Voulant marcher, sans raison péremptoire,
Sur les climats de France occidentale1844.
Prenez haut cœur, doncque, France et Bretagne1845,
Car, si en camp tenez fière façon,
Fondre verrez devant vous Allemagne,
Comme au soleil blanche neige et glaçon.
Fifres, tabours1846, sonnez en harmonie ;
Aventuriers1847, que la pique on manie
Pour les choquer et mettre en accessoire1848 ;
Car, déjà sont au royal possessoire1849.
Mais, comme crois, Destinée1850 fatale
Veut ruiner leur outrageuse gloire
Sur les climats de France occidentale.
Doncque, piétons marchant sur la campagne,
Foudroyez tout, sans rien prendre à rançon.
Preux chevaliers, puisqu’honneur on y gagne,
Vos ennemis poussez hors de l’arçon.
Faites rougir du sang de Germanie
Les clairs ruisseaux dont la France est garnie :
Si1851 seront mis vos hauts noms en histoire.
Frappez donc tant de main gladiatoire1852
Qu’après leur mort et défaite totale
Vous rapportiez la palme de victoire
Sur les climats de France occidentale.
Envoi 1853
Princes remplis de haut los1854 méritoire,
Faisons-les tous, si vous me voulez croire,
Aller humer leur cervoise et godale1855 ;
Car de nos vins ont grand désir de boire
Sur les climats de France occidentale.
(Ballades, IX.)
Le lion et le rat1856 §
… Je te veux dire une belle fable,
C’est à savoir du lion et du rat.
Cestui1857 lion, plus fort qu’un vieil verrat1858,
Vit une fois que le rat ne savait
Sortir d’un lieu, pour autant qu’il1859 avait
Mangé le lard et la chair toute crue1860,
Mais ce lion, qui jamais ne fut grue1861,
Trouva moyen et manière et matière,
D’1862 ongles et dents, de rompre la ratière,
Dont maître rat échappe vitement :
Puis mit à terre un genoü gentiment,
Et, en ôtant son bonnet de la tête,
À mercié1863 mille fois la grand’bête1864,
Jurant le dieu des souris et des rats
Qu’il lui rendrait. Maintenant tu verras
Le bon du conte. Il advint d’aventure
Que le lion pour chercher sa pâture
Saillit dehors1865 sa caverne et son siège1866 ;
Dont1867, par malheur, se trouva pris au piège,
Et fut lié contre un ferme poteau.
Adonc1868 le rat, sans serpe ne couteau,
Y arriva joyeux et ébaudi1869,
Et du lion, pour vrai, ne s’est gaudi1870 :
Mais dépita1871 chats, chates et chatons,
Et prisa fort rats, rates et ratons,
Dont1872 il avait trouvé temps favorable
Pour secourir le lion secourable ;
Auquel a dit : « Tais-toi, lion lié,
Par moi seras maintenant délié :
Tu le vaux bien, car le cœur joli as ;
Bien y parut quand tu me délias.
Secouru m’as fort lionneusement,
Or secouru seras rateusement1873 ».
Lors le lion ses deux grands yeux vêtit1874,
Et vers le rat les tourna un petit1875
En lui disant : « O pauvre verminière1876
Tu n’as sur toi instrument ne manière,
Tu n’as couteau, serpe ne serpillon,
Qui sût couper corde ne cordillon,
Pour me jeter de cette étroite voie1877 ;
Va te cacher, que le chat ne te voie.
— Sire lion, dit le fils de souris,
De ton propos certes je me souris1878 :
J’ai des couteaux assez, ne te soucie,
De bel os blanc, plus tranchants qu’une scie :
Leur gaine c’est ma gencive et ma bouche :
Bien couperont la corde qui te touche
De si très près1879, car j’y mettrai bon ordre. »
Lors sire rat va commencer à mordre
Ce gros lien : vrai est qu’il y songea1880
Assez longtemps ; mais il le vous rongea
Souvent, et tant, qu’à la parfin1881 tout rompt,
Et le lion de s’en aller fut prompt,
Disant en soi : « Nul plaisir1882 en efïet
Ne se perd point, quelque part où soit fait1883. »
(Epîtres, XI.)
Au roi François Ier pour lui demander de le délivrer de prison1884 §
Roi des Français, plein de toutes bontés,
Quinze jours a1885, je les ai bien comptés,
Et dès demain seront justement seize,
Que je fus fait confrère au diocèse
De saint Marry en l’église Saint-Pris1886 :
Si1887 vous dirai comment je fus surpris,
Et me déplaît qu’il faut que je le die1888.
Trois grands pendards vinrent à l’étourdie
En ce palais me dire en désarroi1889 :
« Nous vous faisons prisonnier par1890 le Roi. »
Incontinent qui fut bien étonné ?
Ce fut Marot, plus que s’il eût tonné1891.
Puis m’ont montré un parchemin écrit,
Où n’y avait seul mot de Jésus-Christ ;
Il ne parlait tout que de plaiderie,
De conseillers et d’emprisonnerie1892.
« Vous souvient-il, ce1893 me dirent-ils lors,
Que vous étiez l’autre jour là dehors
Qu’on recourut1894 un certain prisonnier
Entre nos mains ? » Et moi de le nier :
Car soyez sûr, si j’eusse dit oui1895,
Que le plus sourd d’entre eux m’eût bien ouï :
Et, d’autre part, j’eusse publiquement
Été menteur : car pourquoi et comment
Eussé-je pu un autre recourir,
Quand je n’ai su moi-même secourir ?
Pour faire court1896, je ne sus tant prêcher,
Que ces paillards1897 me voulsissent1898 lâcher.
Sur mes deux bras ils ont la main posée1899
Et m’ont mené ainsi qu’une épousée,
Non pas ainsi, mais plus raide un petit1900,
Et toutefois j’ai plus grand appétit1901
De pardonner à leur folle fureur,
Qu’à celle-là de mon beau procureur1902 ;
Que male mort1903 les deux jambes lui casse !
Il a bien pris1904 de moi une bécasse,
Une perdrix et un levraut aussi :
Et toutefois je suis encore ici.
Encor je crois, si j’en envoyais plus1905,
Qu’il le prendrait : car ils ont tant de glus
Dedans leurs mains, ces faiseurs de pipée1906,
Que toute chose où touchent est grippée1907.
Mais, pour venir au point de ma sortie,
Tant doucement j’ai chanté ma partie1908,
Que nous avons bien accordé ensemble ;
Si1909 que n’ai plus affaire, ce me semble,
Sinon à vous1910. La partie1911 est bien forte ;
Mais le droit point où je me reconforte1912,
Vous n’entendez procès, non plus que moi :
Ne plaidons point, ce n’est que tout émoi1913.
Je vous en crois, si je vous ai méfait1914.
Encor posé le cas que l’eusse fait1915,
Au pis aller n’y cherrait1916 qu’une amende.
Prenez le cas1917 que je vous la demande.
Je prends le cas que vous me la donnez :
Et si plaideurs furent oncq1918 étonnés
Mieux que ceux-ci, je veux qu’on me délivre
Et que soudain en ma place on les livre.
Si1919 vous suppli, Sire, mander par lettre
Qu’en liberté vos gens me vueillent mettre :
Et, si je sors, j’espère qu’à grand’peine1920
M’y reverront, si on ne m’y ramène ;
Très humblement requérant1921 votre grâce
De pardonner à ma trop grande audace
D’avoir empris1922 ce sot écrit vous faire,
Et m’excuser si pour le mien affaire1923
Je ne suis point vers vous allé parler ;
Je n’ai pas eu le loisir d’y aller1924.
(Épîtres, XXVII.)
Du Bellay
(1522-1560) §
Joachim du Bellay est né à Liré, dans l’Anjou1925, en 1522, et il est mort en 1560, après avoir séjourné quelques années en Italie, auprès de son oncle le cardinal Jean du Bellay. Ami de Ronsard, il conçut avec lui le dessein de réformer la poésie française. Il révéla au public les théories de l’école nouvelle, de la Pléiade1926, dans un écrit en prose, Défense et illustration de la langue française. Il a publié plusieurs recueils de vers, les Antiquités de Rome, les Regrets, les Jeux rustiques, etc., dans lesquels il y a plus que de la grâce, et qui sont assez souvent inspirés par un sentiment profond de mélancolie.
Épitaphe d’un chat §
Maintenant le vivre1927 me fâche,
Et afin, Magny1928, que tu saches
Pourquoi je suis tant éperdu,
Ce n’est pas pour avoir perdu
Mes anneaux, mon argent, ma bourse ;
Et pourquoi est-ce donc ? pour ce1929
Que j’ai perdu, depuis trois jours,
Mon bien, mon plaisir, mes amours :
Eh quoi ! ô souvenance grève1930 !
A peu1931 que le cœur ne me crève
Quand j’en parle ou quand j’en écris :
C’est Belaud, mon petit chat gris :
Belaud, qui fut par aventure1932
Le plus bel œuvre que nature
Fit onc1933 en matière de chats :
C’était Belaud la mort aux rats,
Belaud, dont la beauté fut telle
Qu’elle est digne d’être immortelle.
Donques1934 Belaud, premièrement,
Ne fut pas gris entièrement,
Ni tel qu’en France on les voit naître,
Mais tel qu’à Borne on les voit être1935,
Couvert d’un poil gris argentin,
Bas et poli comme satin,
Couché par ondes1936 sur l’échine,
Et blanc dessus comme une hermine.
Petit museau, petites dents,
Yeux qui n’étaient point trop ardents,
Mais desquels la prunelle perse1937
Imitait la couleur diverse
Qu’on voit en cet arc1938 pluvieux
Qui se courbe en travers des cieux.
La tête à la taille pareille,
Le col grasset, courte l’oreille,
Et, dessous un nez ebenin1939,
Un petit mufle lionnin1940,
Autour duquel était plantée
Une barbelette1941 argentée,
Armant d’un petit poil folet
Son musequin damoiselet1942.
Jambe grêle, petite patte,
Plus qu’une moufle1943 délicate,
Sinon alors qu’il dégainait
Cela, dont il égratignait :
La gorge douillette et mignonne,
La queue1944 longue à la guenonne1945,
Mouchetée diversement
D’un naturel bigarrement :
Le flanc haussé1946, le ventre large,
Bien retroussé1947 dessous sa charge,
Et le dos moyennement long,
Vray Sourian1948, s’il en fut onc1949.
Tel fut Belaud, la gente1950 bête
Qui, des pieds jusques à la tête,
De telle beauté fut pourvu,
Que son pareil on n’a point vu1951.
(Divers Jeux rustiques.)
L’Homme heureux de son sort §
O qu’heureux est celui qui peut passer son âge1952
Entre pareils à soi, et qui, sans fiction,
Sans crainte, sans envie, et sans ambition,
Règne paisiblement en son pauvre ménage !
Le misérable soin d’acquérir davantage
Ne tyrannise point sa libre affection,
Et son plus grand désir, désir sans passion,
Ne s’étend plus avant que son propre héritage.
Il ne s’empêche1953 point des affaires d’autrui,
Son principal espoir ne dépend que de lui,
Il est sa cour, son roi, sa faveur et son maître.
Il ne mange son bien en pays étranger,
Il ne met pour autrui sa personne en danger,
Et plus riche qu’il est ne voudrait jamais être1954.
(Les Regrets, xxxviii).
Ronsard
(1524-1585) §
Pierre de Ronsard, né en 1524 près de Vendôme, mort en 1585, est le plus illustre des poètes qui, rompant avec les traditions du moyen âge et s’inspirant surtout des souvenirs de l’antiquité, dont la Renaissance venait de révéler le génie, tentèrent de renouveler la poésie française et formèrent la célèbre école de la Pléiade1955. Il a laissé, outre les quatre premiers chants d’une épopée, la Franciade, consacrée à célébrer un certain Francus, fils d’Hector, prétendu fondateur de la nation française, des poésies diverses, odes, sonnets, discours, élégies, dont quelques-unes sont pleines de grâce ou d’énergie. Trop loué par ses contemporains, Ronsard a été trop déprécié par les auteurs du xviie et du xviiie siècle ; le xixe l’a définitivement réhabilité.
Les faiseurs de protestations §
Mais d’où vient cela, mon Odet1956 ?
Si de fortune1957 par la rue
Quelque courtisan je salue
Ou de la voix ou du bonnet,
Ou d’un clin d’œil tant seulement,
De la tête, ou d’un autre geste,
Soudain par serment il proteste
Qu’il est à mon commandement.
Soit qu’il me treuve1958 chez le roi,
Soit qu’il en sorte ou qu’il y vienne,
Il met sa main dedans la mienne,
Et jure qu’il est tout à moi....
Mais quand un affaire de soin1959
Me presse à lui faire requête,
Tout soudain il tourne la tête,
Et me délaisse à mon besoin ;
Et si je veux ou l’aborder
Ou l’accoster en quelque sorte,
Mon courtisan passe une porte,
Et ne daigne me regarder ;
Et plus je ne lui suis connu,
Ni mes vers ni ma poésie,
Non plus qu’un étranger d’Asie
Ou quelqu’un d’Afrique venu.
(Odes, livre III, xxiv.)
La fuite du temps §
Quand je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendomois,
Plein de pensées1960 vagabondes,
Plein d’un remords et d’un souci,
Aux rochers je me plains ainsi,
Aux bois, aux antres et aux ondes :
Rochers, bien que soyez âgés1961
De trois mille ans, vous ne changez
Jamais ni d’état ni de forme ;
Mais toujours ma jeunesse fuit,
Et la vieillesse qui me suit
De jeune en vieillard me transforme.
Bois, bien que perdiez tous les ans
En hiver vos cheveux mouvants
L’an d’après qui se renouvelle
Renouvelle aussi votre chef1962 ;
Mais le mien ne peut derechef
Ravoir sa perruque1963 nouvelle.
Antres, je me suis vu chez vous
Avoir jadis verts1964 les genoux,
Le corps habile et la main bonne ;
Mais ores1965 j’ai le corps plus dur,
Et les genoux, que n’est le mur
Qui froidement vous environne.
Ondes, sans fin vous promenez1966,
Et vous menez et ramenez
Vos flots d’un cours1967 qui ne séjourne ;
Et moi, sans faire long séjour,
Je m’en vais de nuit et de jour,
Au lieu d’où plus on ne retourne....
(Odes, livre IV, ix.)
Institution1968 pour l’adolescence du roi Charles IX
Fragments §
Sire, ce n’est pas tout que d’être roi de France,
Il faut que la vertu honore votre enfance ;
Car un roi sans vertu porte le sceptre en vain,
Et lui sert1969 d’un fardeau qui lui charge la main.
Pour ce1970 on dit que Thétis, la femme de Pélée,
Après avoir la peau de son enfant brûlée1971
Pour le rendre immortel, le prit en son giron
Et, de nuit, l’emporta dans l’antre de Chiron,
Chiron, noble Centaure, afin de lui apprendre
Les plus rares vertus dès sa jeunesse tendre
Et de science et d’art son Achille honorer1972 ;
Un roi pour être grand ne doit rien ignorer.
Il ne doit seulement savoir l’art de la guerre,
De garder les cités, ou les ruer1973 par terre,
De piquer les chevaux, ou contre son harnois
Recevoir mille coups de lances aux tournois ;
De savoir comme il faut dresser une embuscade,
Ou donner une cargue1974, ou une camisade,
Se ranger en bataille, et sous les étendards
Mettre par artifice1975 en ordre les soudards1976.
Les rois les plus brutaux telles choses n’ignorent,
Et par leur sang versé leurs couronnes honorent ;
Tout ainsi que lions qui s’estiment alors
De tous les animaux être vus les plus forts.
Quand leur gueule dévore un cerf au grand corsage1977
Et ont rempli les champs de meurtre et de carnage.
Mais les princes chrétiens n’estiment leur vertu
Procéder ni de sang ni de glaive pointu,
Ni de harnois ferrés qui les peuples étonnent,
Mais par les beaux métiers1978 que les Muses nous donnent.
Quand les Muses, qui sont filles de Jupiter,
Dont les rois sont issus1979, les rois1980 daignent hanter,
Elles les font marcher en toute révérence1981,
Loin de leur majesté bannissant l’ignorance,
Et, tout remplis de grâce et de divinité,
Les font parmi le peuple ordonner équité1982....
Il faut premièrement apprendre à craindre Dieu,
Dont vous êtes l’image, et porter au milieu
De votre cœur, son nom et sa sainte parole,
Comme le seul secours dont1983 l’homme se console.
Après, si vous voulez en terre prospérer,
Vous devez votre mère1984 humblement honorer,
La craindre et la servir, qui seulement de mère
Ne vous sert pas ici, mais de garde et de père...,
Commencez donc ainsi1985. Puis sitôt que par l’âge
Vous serez homme fait de corps et de courage,
Il faudra de vous-même apprendre à commander,
A ouïr vos sujets, les voir et demander1986,
Les connaître par nom et leur faire justice,
Honorer la vertu et corriger le vice.
Malheureux sont les rois qui fondent leur appui
Sur l’aide d’un commis1987, qui par les yeux d’autrui
Voient1988 l’état du peuple, et oyent par l’oreille
D’un flatteur mensonger1989 qui leur conte merveille.
Tel roi ne règne pas, ou bien il règne en peur,
D’autant qu’il ne sait rien, d’offenser un trompeur.
Mais, Sire, ou je m’abuse en voyant votre grace1990,
Ou vous tiendrez d’un roi la légitime place ;
Vous ferez votre charge, et, comme un prince doux.
Audience et faveur vous donnerez à tous.
Votre palais royal connaîtrez en présence1991,
Et ne commettrez point une petite1992 offense.
Si un pilote faut1993 tant soit peu sur la mer,
Il fera dessous1994 l’eau sa navire1995 abîmer ;
Ainsi, faillant un roi tant soit peu, la province1996
Se perd : car volontiers le peuple suit son prince.
Aussi1997, pour être roi, vous ne devez penser
Vouloir, comme un tyran, vos sujets offenser.
Car, comme notre corps, votre corps est de boue ;
Des petits et des grands la fortune se joue ;
Tous ces règnes mondains se font et se défont,
Au gré de la fortune ils viennent et s’en vont,
Et ne durent non plus qu’une flamme allumée,
Qui soudain est éprise1998 et soudain consumée.
Or, Sire, imitez Dieu, lequel vous a donné
Le sceptre, et vous a fait un grand roi couronné
Faites miséricorde à celui qui supplie,
Punissez l’orgueilleux qui s’arme en sa folie,
Ne poussez par faveur un homme en dignité,
Mais choisissez celui qui l’a bien mérité....
Ne pillez vos sujets par rançons ni par tailles1999,
Ne prenez2000 sans raison ni guerres, ni batailles ;
Gardez le vôtre2001 propre et vos biens amassés,
Car, pour vivre content, vous en avez assez.
S’il vous plaît vous garder sans archers de la garde,
Il faut que d’un bon œil le peuple vous regarde,
Qu’il vous aime sans crainte ; ainsi les puissants rois
Ont gardé leur empire, et non par le harnois2002.
Comme le corps royal ayez l’âme royale ;
Tirez le peuple à vous d’une main libérale,
Et pensez que le mal le plus pernicieux,
C’est un prince sordide et avaricieux.
Ayez autour de vous des personnes notables,
Et les oyez parler volontiers à vos tables ;
Soyez leur auditeur, comme fut votre aïeul,
Ce grand François2003, qui vit encores2004 au cercueil2005
Soyez, comme un bon prince, amoureux de la gloire,
Et faites que de vous se remplisse une histoire
Digne de votre nom, vous faisant immortel
Comme Charles le Grand, ou bien Charles Martel.
Ne souffrez que les grands blessent le populaire ;
Ne souffrez que le peuple au grand puisse déplaire.
Gouvernez votre argent par sagesse et raison :
Le prince qui ne peut gouverner sa maison,
Sa femme, ses enfants, et son bien domestique,
Ne saurait gouverner une grand2006 république.
Pensez longtemps devant que faire aucuns édits ;
Mais, sitôt qu’ils seront devant le peuple dits,
Qu’ils soient pour tout jamais d’invincible puissance :
Car autrement vos lois sentiraient leur enfance.
Ne vous montrez jamais pompeusement vêtu :
L’habillement des rois est la seule vertu.
Que votre corps reluise en vertus glorieuses,
Et non pas vos habits de perles précieuses.
D’amis plus que d’argent montrez-vous désireux
Les princes sans amis sont toujours malheureux.
Aimez les gens de bien, ayant toujours envie
De ressembler à ceux qui sont de bonne vie.
Punissez les malins2007 et les séditieux ;
Ne soyez pas chagrin, dépit2008, ni furieux,
Mais honnête et gaillard, portant sur le visage
De votre gentille2009 âme un gentil témoignage.
Or, Sire, pour autant que2010 nul n’a le pouvoir
De châtier les rois qui font mal leur devoir2011,
Punissez-vous vous-même afin que la justice
De Dieu, qui est plus grand, vos fautes ne punisse,
Je dis ce puissant Dieu dont l’empire est sans bout2012,
Qui, de son trône assis, en la terre voit tout,
Et fait à un chacun ses justices égales,
Autant aux laboureurs qu’aux personnes royales ;
Lequel je supplierai vous tenir en sa loi,
Et vous aimer autant qu’il fit David, son roi2013,
Et rendre, comme à lui, votre sceptre tranquille.
Car, sans l’aide de Dieu, la force est inutile.
(Discours.)
J.-A. de Baïf
(1532-1589) §
Fils du savant Lazare de Baïf, qui fut ambassadeur de François Ier à Venise, né lui-même dans cette ville en 1532, mort en 1589, Jean-Antoine de Baïf, qui connut Ronsard au collège Coqueret, à Paris2014, fut, sinon le plus remarquable, du moins le plus aventureux des membres de la Pléiade2015. Il tenta de réformer à la fois la langue, la versification et l’orthographe françaises. Il a publié un grand nombre de poésies diverses, remarquables surtout par leur variété, et dont quelques-unes ont du charme.
La marmotte et le hérisson2016 §
Le hérisson était en peine
Où se loger ; la marmoteine2017
Il pria le vouloir loger.
Ce fut aux mois de la froidure,
L’hiver, quand la saison est dure.
Elle accorda le héberger2018 :
Ainsi le mène en sa tanière,
Où l’hôte nouveau ne fut guère
Que son hôtesse2019 ne fâchât2020,
Avecque2021 son écharde droite2022 ;
Car la place fut si étroite
Qu’il fallait que l’on se touchât.
La marmotte pria son hôte,
Le lendemain matin, qu’il s’ôte2023
De son logis. Le hérisson,
Qui trouve la maison fournie
De ce qu’il faut, très bien lui nie2024
Et lui chante une autre chanson :
« Si quelqu’un en ce lieu s’offense,
Qu’il s’en aille, je l’en dispense2025 ;
Quant à moi je ne bougerai.
Si loger en ce lieu c’est peine,
Tu peux déloger, marmoteine ;
De l’hiver n’en délogerai. »
(Les Mimes2026, livre III.)
Malherbe
(1555-1628) §
Né à Caen en 1555, mort en 1628, François de Malherbe, qui commença assez tard à se livrer à la poésie, tient une grande place dans l’histoire de notre littérature. Car il travailla à ruiner, non sans quelque injustice, la gloire de Ronsard et de ses disciples, dont la poésie ne lui paraissait ni assez simple ni assez naturelle, et établit à son tour des règles de langage et de versification que nul, durant deux siècles, n’a enfreintes après lui. Malherbe ne s’est exercé que dans le genre lyrique : parmi ses Stances et ses Odes, qui célèbrent en général des héros ou des événements contemporains, mais qui ne sont pas toutes d’un égal mérite, quelques-unes sont remarquables non seulement par l’harmonieuse régularité des mètres et des strophes, mais encore par l’ampleur des tours, la vigueur du sentiment, la richesse et la netteté des images. Il a laissé, en outre, des lettres et quelques traductions.
Stances
Consolation A M. Du Périer2027
(vers 1600) §
Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,
Et les tristes discours
Que te met en l’esprit l’amitié2028 paternelle
L’augmenteront toujours ?
Le malheur de ta fille au tombeau descendue,
Par un commun2029 trépas,
Est-ce quelque dédale2030, où ta raison perdue
Ne se retrouve pas ?
Je sais de quels appas son enfance était pleine,
Et n’ai pas entrepris,
Injurieux ami2031, de soulager ta peine
Avecque son mépris2032.
Mais elle était du monde, où les plus belles choses
Ont le pire destin ;
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L’espace d’un matin2033.
Puis, quand ainsi serait que2034, selon ta prière,
Elle aurait obtenu
D’avoir en cheveux blancs terminé sa carrière,
Qu’en fût-il advenu ?
Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste
Elle eût eu plus d’accueil,
Ou qu’elle eût moins senti la poussière funeste
Et les vers du cercueil.
Non, non, mon Du Périer, aussitôt que la Parque
Ote l’âme du corps,
L’âge s’évanouit au deçà de la barque2035,
Et ne suit point les morts....
La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ;
On a beau la prier :
La cruelle qu’elle est se bouche les oreilles,
Et nous laisse crier.
Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre,
Est sujet à ses lois ;
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre2036
N’en défend point nos rois.
De murmurer contre elle et perdre patience,
Il est mal à propos ;
Vouloir ce que Dieu veut est la seule science
Qui nous met en repos2037.
(Poésies, XI.)
Stances sur la mort d’un ami. §
L’Orne comme autrefois nous reverrait2038 encore,
Ravis de ces pensers que le vulgaire ignore,
Égarer à l’écart nos pas et nos discours ;
Et, couchés sur les fleurs, comme étoiles semées,
Rendre en si doux ébat les heures consumées2039,
Que les soleils2040 nous seraient courts.
Mais, ô loi rigoureuse à la race des hommes !
C’est un point arrêté, que tout ce que nous sommes,
Issus de pères rois et de pères bergers,
La Parque2041 également sous la tombe nous serre ;
Et les mieux établis aux repos2042 de la terre
N’y sont qu’hôtes et passagers.
Tout ce que la grandeur a de vains équipages,
D’habillements de pourpre et de suite de pages,
Quand le terme est échu n’allonge point nos jours :
Il faut aller tout nus où le destin commande ;
Et de toutes douleurs la douleur la plus grande,
C’est qu’il faut laisser nos amours2043.
(Poésies, XIV : Aux ombres de Damon.)
Sur le règne de Henri IV §
La terreur de son nom rendra nos villes fortes :
On n’en gardera plus ni les murs ni les portes ;
Les veilles cesseront au sommet de nos tours ;
Le fer mieux employé cultivera la terre,
Et le peuple qui tremble aux frayeurs de la guerre,
Si ce n’est pour danser, n’orra2044 plus de tambours.
Loin des mœurs de son siècle il bannira les vices,
L’oisive nonchalance et les molles délices,
Qui nous avaient portés jusqu’aux derniers2045 hasards ;
Les vertus reviendront de palmes couronnées,
Et ses justes faveurs aux mérites données
Feront ressusciter l’excellence des arts.
La foi de ses aïeux2046, ton2047 amour et ta crainte,
Dont il porte dans l’âme une éternelle empreinte,
D’actes de piété ne pourront l’assouvir2048 ;
Il étendra ta gloire autant que sa puissance,
Et n’ayant rien si cher que ton obéissance,
Où tu le fais régner, il te fera servir2049.
Tu nous rendras alors nos douces destinées ;
Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années,
Qui pour les plus heureux n’ont produit que des pleurs2050.
Toute sorte de biens comblera nos familles,
La moisson de nos champs lassera les faucilles,
Et les fruits passeront2051 la promesse des fleurs....
Quand un roi fainéant2052, la vergogne2053 des princes,
Laissant à ses flatteurs le soin de ses provinces2054,
Entre les voluptés indignement s’endort,
Quoi que l’on dissimule2055, on n’en2056 fait point d’estime ;
Et, si la vérité se peut dire sans crime,
C’est avecque2057 plaisir qu’on survit à sa mort.
Mais, ce roi, des bons rois l’éternel exemplaire2058,
Qui de notre salut est l’ange tutélaire,
L’infaillible refuge et l’assuré secours,
Son extrême douceur ayant dompté l’envie,
De quels jours assez longs peut-il borner sa vie,
Que notre affection ne les juge trop courts ?...
Qu’il vive donc, Seigneur, et qu’il nous fasse vivre !
Que de toutes ces peurs nos âmes il délivre,
Et, rendant l’univers de son heur2059 étonné,
Ajoute chaque jour quelque nouvelle marque
Au nom qu’il s’est acquis du plus rare monarque
Que ta bonté propice ait jamais couronné.
Cependant son dauphin2060, d’une vitesse prompte,
Des ans de sa jeunesse accomplira le compte ;
Et, suivant de l’honneur les aimables appas,
De faits si renommés ourdira son histoire,
Que ceux qui, dedans l’ombre2061 éternellement noire2062,
Ignorent le soleil, ne l’ignoreront pas.
Par sa fatale main2063, qui vengera nos pertes2064,
L’Espagne pleurera ses provinces désertes,
Ses châteaux abattus et ses camps déconfits2065,
Et si de nos discords2066 l’infâme vitupère2067
À pu la dérober aux victoires du père,
Nous la verrons captive aux triomphes du fils2068
(Poésies, XVIII : Prière pour le roi Henri le Grand, allant en Limousin2069.)
Racan
(1589-1670) §
Né en 1589 en Touraine, mort en 1670, Honorât de Bueil, marquis de Racan, est le plus célèbre et le plus remarquable des poètes disciples de Malherbe. Rien ne serait plus profitable que de comparer quelqu’une de ses pièces, d’une versification si douce et, en général, si correcte, d’une langue si aisée, et déjà si moderne, avec les poésies des auteurs qui ont précédé immédiatement Malherbe, pour se rendre compte de l’importance des réformes de ce dernier. Racan a laissé une œuvre de longue haleine, les Bergeries, pastorale2070 en cinq actes (publiée en 1625), et des poésies diverses, particulièrement des Odes, des Stances, et une traduction ou plutôt une paraphrase en vers des Psaumes.
La retraite §
Stances.
Tircis2071, il faut penser à faire la retraite2072 :
La course de nos jours est plus qu’à demi faite.
L’âge insensiblement nous conduit à la mort.
Nous avons assez vu sur la mer de ce monde
Errer au gré des vents notre nef vagabonde :
Il est temps de jouir des délices du port.
Le bien de la fortune est un bien périssable :
Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable.
Plus on est élevé, plus on court de dangers :
Les grands pins sont en butte aux coups de la tempête,
Et la rage des vents brise plutôt le faîte
Des maisons de nos rois que des toits des bergers2073.
O bienheureux celui qui peut de sa mémoire
Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire,
Dont l’inutile soin2074 traverse nos plaisirs,
Et qui, loin retiré de la foule importune,
Vivant dans sa maison, content de sa fortune,
A selon son pouvoir mesuré ses désirs !
Il laboure le champ que labourait son père ;
Il ne s’informe point de ce qu’on délibère
Dans ces graves conseils2075 d’affaires accablés.
Il voit sans intérêt la mer grosse d’orages,
Et n’observe des vents les sinistres présages
Que pour le soin qu’il a du salut de ses blés.
Roi de ses passions2076, il a ce qu’il désire :
Son fertile domaine est son petit empire ;
Sa cabane est son Louvre et son Fontainebleau2077 ;
Ses champs et ses jardins sont autant de provinces2078 ;
Et, sans porter envie à la pompe des princes,
Se contente chez lui de les2079 voir en tableau.
Il voit de toutes parts combler d’heur2080 sa famille,
La javelle2081 à plein poing tomber sous la faucille,
Le vendangeur ployer sous le faix des paniers ;
Et semble2082 qu’à l’envi les fertiles montagnes,
Les humides vallons et les grasses campagnes
S’efforcent à remplir sa cave et ses greniers...,
Il soupire2083 en repos l’ennui de sa vieillesse
Dans ce même foyer où sa tendre jeunesse
À vu dans le berceau ses bras emmaillotés :
Il tient par les moissons registre des années2084,
Et voit de temps en temps leurs courses enchaînées
Vieillir2085 avecque lui les bois qu’il a plantés.
Il ne va point fouiller aux terres inconnues,
A la merci des vents et des ondes chenues2086,
Ce que Nature avare a caché de trésors,
Et ne recherche point, pour honorer sa vie,
De plus illustre mort, ni plus digne d’envie,
Que de mourir au2087 lit où ses pères sont morts.
S’il ne possède point ces maisons magnifiques2088,
Ces tours, ces chapiteaux, ces superbes portiques,
Où la magnificence étale ses attraits :
Il jouit des beautés qu’ont les saisons nouvelles ;
Il voit de la verdure et des fleurs naturelles,
Qu’en ces riches lambris l’on ne voit qu’en portraits2089.
Crois-moi, retirons-nous hors de la multitude,
Et vivons désormais loin de la servitude
De ces palais dorés où tout le monde accourt :
Sous un chêne élevé les arbrisseaux s’ennuient,
Et devant le soleil tous les astres s’enfuient,
De peur d’être obligés de lui faire la cour.
Après qu’on a suivi sans aucune assurance2090
Cette vaine faveur qui nous paît2091 d’espérance,
L’envie en un moment tous nos desseins détruit2092.
Ce2093 n’est qu’une fumée ; il n’est rien de si frêle ;
Sa plus belle moisson est sujette à la grêle,
Et souvent elle n’a que des fleurs pour du fruit.
Agréables déserts, séjour de l’innocence,
Où, loin des vanités, de la magnificence,
Commence mon repos et finit mon tourment,
Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude2094,
Si vous fûtes témoins de mon inquiétude,
Soyez-le désormais de mon contentement.
(Œuvres, édit. Tenant de Latour, t. I, p. 196).
Corneille
(1606-1684) §
Né à Rouen en 1606, mort en 1684, Pierre Corneille fit représenter sa première pièce de théâtre, la comédie de Mélite, en 1629. Sa tragédie du Cid (1636) obtint un succès que la jalousie du cardinal de Richelieu et les cabales de ses rivaux lurent impuissantes à enrayer, et qui se justifiait d’ailleurs, sinon par la nouveauté du sujet, emprunté à l’espagnol, comme celui d’un grand nombre de pièces françaises à cette époque, du moins par le naturel admirable et jusqu’alors inconnu avec lequel Corneille y peignait la passion luttant contre les sentiments héroïques dans l’âme de ses personnages. C’est par le même mérite que brillent surtout les tragédies d’Horace, de Cinna, de Polyeucte, représentées de 1640 à 1643. Les tragédies qui suivirent furent plus faibles : il faut cependant citer parmi elles Pompée (1643), Rodogune (vers 1644), Nicomède (1651), Sertorius (1662), ainsi que la comédie du Menteur (vers 1643) et la comédie héroïque de Don Sanche d’Aragon (1650). La plus importante des œuvres de Corneille après ses œuvres dramatiques est une traduction en vers de l’Imitation de Jésus-Christ, dont on peut citer quelques beaux passages2095.
Nicomède §
Prusias, Nicomède, Flaminius2096. §
Flaminius.
Sur le point de partir, Rome, Seigneur, me mande
Que je vous fasse encor pour elle une demande.
Elle a nourri vingt ans un prince, votre fils ;
Et vous pouvez juger les soins qu’elle en a pris
Par les hautes vertus et les illustres marques
Qui font briller en lui le sang de vos monarques.
Surtout il est instruit en Part de bien régner :
C’est à vous de le croire, et de le témoigner.
Si vous faites état de cette nourriture2097,
Donnez ordre qu’il règne : elle vous en conjure ;
Et vous offenseriez l’estime qu’elle en2098 fait,
Si vous le laissiez vivre et mourir en sujet.
Faites donc aujourd’hui que je lui puisse dire
Où vous lui destinez un souverain empire.
Prusias.
Les soins qu’ont pris de lui le peuple et le sénat
Ne trouveront en moi jamais un père ingrat :
Je crois que pour régner il en2099 a les mérites,
Et n’en veux point douter après ce que vous dites ;
Mais vous voyez, Seigneur, le Prince son aîné,
Dont le bras généreux trois fois m’a couronné ;
Il ne fait que sortir encor d’une victoire ;
Et pour tant de hauts faits je lui dois quelque gloire :
Souffrez qu’il ait l’honneur de répondre pour moi.
Nicomède.
Seigneur, c’est à vous seul de faire Attale roi.
Prusias.
C’est votre intérêt seul que sa demande2100 touche.
Nicomède.
Le vôtre toutefois m’ouvrira seul la bouche2101.
De quoi se mêle Rome, et d’où prend le sénat,
Vous vivant, vous régnant, ce droit sur vos États ?
Vivez, régnez, Seigneur, jusqu’à la sépulture,
Et laissez faire après, ou Rome, ou la nature.
Prusias.
Pour de pareils amis il faut se faire effort.
Nicomède.
Qui partage vos biens aspire à votre mort ;
Et de pareils amis, en bonne politique,...
Prusias.
Ah ! ne me brouillez point avec la République :
Portez plus de respect à de tels alliés.
Nicomède.
Je ne puis voir sous eux les rois humiliés ;
Et quel que soit ce fils que Rome vous renvoie,
Seigneur, je lui2102 rendrais son présent avec joie.
S’il est si bien instruit en l’art de commander,
C’est un rare trésor qu’elle devrait garder,
Et conserver chez soi sa chère nourriture2103,
Ou pour le consulat, ou pour la dictature.
Flaminius.
Seigneur, dans ce discours qui nous traite si mal,
Vous voyez un effet des leçons d’Annibal ;
Ce perfide ennemi de la grandeur romaine
N’en a mis en son cœur que mépris et que haine.
Nicomède.
Non, mais il m’a surtout laissé ferme en ce point,
D’estimer beaucoup Rome, et ne la craindre point.
On me croit son disciple, et je le tiens à gloire ;
Et quand Flaminius attaque sa mémoire,
Il doit savoir qu’un jour il me fera raison
D’avoir réduit mon maître au secours du poison2104,
Et n’oublier jamais qu’autrefois ce grand homme
Commença par son père à triompher de Rome2105.
Flaminius.
Ah ! c’est trop m’outrager !
Nicomède.
N’outragez plus les morts.
Prusias.
Et vous, ne cherchez point à former de discords2106 :
Parlez, et nettement, sur ce qu’il me propose.
Nicomède.
Eh bien ! s’il est besoin de répondre autre chose,
Attale doit régner, Rome l’a résolu ;
Et puisqu’elle a partout un pouvoir absolu,
C’est aux rois d’obéir alors qu’elle commande.
Attale a le cœur grand, l’esprit grand, l’âme grande,
Et toutes les grandeurs dont se fait un grand roi ;
Mais c’est trop que d’en croire un Romain sur sa foi.
Par quelque grand effet voyons s’il en2107 est digne,
S’il a cette vertu, cette valeur insigne :
Donnez-lui votre armée, et voyons ces grands coups ;
Qu’il en fasse pour lui ce que j’ai fait pour vous ;
Qu’il règne avec éclat sur sa propre conquête,
Et que de sa victoire il couronne sa tête.
Je lui prête mon bras, et veux dès maintenant,
S’il daigne s’en servir, être son lieutenant.
L’exemple des Romains m’autorise à le faire :
Le fameux Scipion le fut bien de son frère2108,
Et lorsque Antiochus fut par eux détrôné,
Sous les lois du plus jeune on vit marcher l’aîné
Les bords de l’Hellespont, ceux de la mer Égée,
Les restes de l’Asie à nos côtés rangée,
Offrent une matière à son ambition....
Flaminius.
Rome prend tout ce reste en sa protection ;
Et vous n’y pouvez plus étendre vos conquêtes,
Sans attirer sur vous d’effroyables tempêtes.
Nicomède.
J’ignore sur ce point les volontés du Roi ;
Mais peut-être qu’un jour je dépendrai de moi,
Et nous verrons alors l’effet de ces menaces ;
Vous pouvez cependant faire munir ces places,
Préparer un obstacle à mes nouveaux desseins,
Disposer de bonne heure un secours de Romains ;
Et si Flaminius en est le capitaine,
Nous pourrons lui trouver un lac de Trasimène2109.
Prusias.
Prince, vous abusez trop tôt de ma bonté :
Le rang d’ambassadeur doit être respecté ;
Et l’honneur souverain qu’ici je vous défère....
Nicomède.
Ou laissez-moi parler, Sire, ou faites-moi taire.
Je ne sais pas répondre autrement pour un roi
A qui dessus2110 son trône on veut faire la loi.
Prusias.
Vous m’offensez moi-même en parlant de la sorte,
Et vous devez dompter l’ardeur qui vous emporte.
Nicomède.
Quoi ! je verrai, Seigneur, qu’on borne vos États,
Qu’au milieu de ma course on m’arrête le bras,
Que de vous menacer on a même l’audace,
Et je ne rendrai point menace pour menace !
Et je remercierai qui me dit hautement
Qu’il ne m’est plus permis de vaincre impunément !
prusias, à Flaminius.
Seigneur, vous pardonnez aux chaleurs de son âge ;
Le temps et la raison pourront le rendre sage.
Nicomède.
La raison et le temps m’ouvrent assez les yeux,
Et l’âge ne fera que me les ouvrir mieux.
Si j’avais jusqu’ici vécu comme ce frère,
Avec une vertu qui fût imaginaire
(Car je l’appelle ainsi quand elle est sans effets ;
Et l’admiration de tant d’hommes parfaits
Dont il a vu dans Rome éclater le mérite,
N’est pas grande vertu si l’on ne les imite) ;
Si j’avais donc vécu dans ce même repos
Qu’il2111 a vécu dans Rome auprès de ses héros,
Elle2112 me laisserait la Bithynie entière,
Telle que de tout temps l’aîné la tient d’un père,
Et s’empresserait moins à le faire régner,
Si vos armes sous moi n’avaient su rien gagner.
Mais parce qu’elle voit avec la Bithynie
Par trois sceptres conquis trop de puissance unie,
Il faut la diviser ; et dans ce beau projet,
Ce prince est trop bien né pour vivre mon sujet2113 !
Puisqu’il peut la servir à me faire descendre,
Il a plus de vertu que n’en eut Alexandre ;
Et je lui dois quitter2114, pour le mettre en mon rang,
Le bien de mes aïeux, ou le prix de mon sang2115.
Grâces aux immortels, l’effort de mon courage
Et ma grandeur future ont mis Rome en ombrage :
Vous pouvez l’en guérir, Seigneur, et promptement ;
Mais n’exigez d’un fils aucun consentement :
Le maître qui prit soin d’instruire ma jeunesse
Ne m’a jamais appris à faire une bassesse.
(Nicomède, acte II, scène iii.)
Paris §
Dorante, Cliton2116. §
Dorante.
A la fin j’ai quitté la robe pour l’épée2117 :
L’attente où j’ai vécu n’a point été trompée ;
Mon père a consenti que je suive2118 mon choix,
Et j’ai fait banqueroute2119 à ce fatras de lois.
Mais puisque nous voici dedans les Tuileries2120,
Le pays du beau monde et des galanteries,
Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier ?
Ne vois-tu rien en moi qui sente l’écolier ?
Comme il est malaisé qu’aux royaumes du Code2121
On apprenne à se faire un visage à la mode,
J’ai lieu d’appréhender....
Cliton.
Ne craignez rien pour vous :
Vous ferez en une heure ici mille jaloux....
Dorante.
A ne rien déguiser, Cliton, je te confesse
Qu’à Poitiers j’ai vécu comme vit la jeunesse ;
J’étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers2122 ;
Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers.
Le climat différent veut une autre méthode ;
Ce qu’on admire ailleurs est ici hors de mode :
La diverse façon de parler et d’agir
Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir.
Chez les provinciaux on prend ce qu’on rencontre ;
Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre2123.
Mais il faut à Paris bien d’autres qualités :
On ne s’éblouit point de ces fausses clartés ;
Et tant d’honnêtes gens2124, que l’on y voit ensemble,
Font qu’on est mal reçu, si l’on ne leur ressemble.
Cliton.
Connaissez mieux Paris, puisque vous en parlez.
Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés ;
L’effet n’y répond pas toujours à l’apparence :
On s’y laisse duper autant qu’en lieu de France ;
Et parmi tant d’esprits plus polis et meilleurs,
Il y croît des badauds autant et plus qu’ailleurs.
Dans la confusion que ce grand monde apporte,
Il y vient de tous lieux des gens de toute sorte ;
Et dans toute la France il est fort peu d’endroits
Dont il n’ait le rebut aussi bien que le choix.
Comme on s’y connaît mal, chacun s’y fait de mise2125.
Et vaut communément autant comme il se prise2126.
(Le Menteur, acte I, scène i.)
Une sérénade2127 §
Dorante.
Comme à mes chers amis, je vous veux tout conter2128.
J’avais pris cinq bateaux pour mieux tout ajuster ;
Les quatre2129 contenaient quatre chœurs de musique,
Capables de charmer le plus mélancolique.
Au premier, violons ; en l’autre, luths et voix ;
Des flûtes au troisième ; au dernier, des hautbois,
Qui tour à tour dans l’air poussaient des harmonies
Dont on pouvait nommer les douceurs infinies2130.
Le cinquième était grand, tapissé tout exprès
De rameaux enlacés pour conserver le frais,
Dont chaque extrémité portait un doux mélange
De bouquets de jasmin, de grenade et d’orange2131.
Je fis de ce bateau la salle du festin :
Là je menai l’objet2132 qui fait seul mon destin ;
De cinq autres beautés la sienne fut suivie,
Et la collation fut aussitôt servie.
Je ne vous dirai point les différents apprêts,
Le nom de chaque plat, le rang de chaque mets ;
Vous saurez seulement qu’en ce lieu de délices
On servit douze plats et qu’on fit six services,
Cependant que2133 les eaux, les rochers et les airs
Répondaient aux accents de nos quatre concerts2134.
Après qu’on eut mangé, mille et mille fusées,
S’élançant vers les cieux, ou droites ou croisées,
Firent un nouveau jour, d’où tant de serpenteaux2135
D’un déluge de flamme attaquèrent les eaux,
Qu’on crut que, pour leur faire une plus rude guerre,
Tout l’élément du feu tombait du ciel en terre.
Après ce passe-temps, on dansa jusqu’au jour,
Dont le soleil jaloux avança le retour.
(Le Menteur, acte I, sc. v.)
Le père2136 du menteur §
Géronte2137, Dorante. §
Géronte.
Êtes-vous gentilhomme2138 ?
Dorante.
Ah ! rencontre fâcheuse ! Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse2139.
Géronte.
Croyez-vous qu’il suffit d’être sorti de moi ?
Dorante.
Avec toute la France aisément je le croi2140.
Géronte.
Et ne savez-vous pas, avec toute la France,
D’où ce titre d’honneur a tiré sa naissance,
Et que la vertu seule a mis en ce haut rang
Ceux qui l’ont jusqu’à moi fait passer dans leur sang ?
Dorante.
J’ignorerais un point que n’ignore personne,
Que la vertu l’acquiert, comme le sang le donne ?
Géronte.
Où le sang a manqué, si la vertu l’acquiert,
Où le sang l’a donné, le vice aussi le perd.
Ce qui naît d’un moyen périt par son contraire :
Tout ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ;
Et, dans la lâcheté du vice où je te voi2141,
Tu n’es plus gentilhomme, étant sorti de moi.
Dorante.
Moi ?
Géronte.
Laisse-moi parler, toi de qui l’imposture
Souille honteusement ce don de la nature :
Qui se dit gentilhomme et ment comme tu fais,
Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais.
Est-il vice plus bas, est-il tache plus noire,
Plus indigne d’un homme élevé pour la gloire ?
Est-il quelque faiblesse, est-il quelque action
Dont un cœur vraiment noble ait plus d’aversion,
Puisqu’un seul démenti lui porte une infamie
Qu’il ne peut effacer s’il n’expose sa vie,
Et si dedans2142 le sang il ne lave l’affront
Qu’un si honteux outrage imprime sur son front ?...
Car de quel air enfin faut-il que je confesse
Que ton effronterie a surpris2143 ma vieillesse,
Qu’un homme de mon âge a cru légèrement
Ce qu’un homme du tien débite impudemment ?
Tu me fais donc servir de fable et de risée,
Passer pour esprit faible et pour cervelle usée !...
Ce grand excès d’amour que je t’ai témoigné
N’a point touché ton cœur, ou ne l’a point gagné2144.
Ingrat, tu m’as payé d’une impudente feinte,
Et tu n’as eu pour moi respect, amour, ni crainte.
Va, je te désavoue.
(Le Menteur, acte V, sc. iii.)
Invocation §
Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute :
Je dis ton serviteur, car enfin je le suis ;
Je le suis, je veux l’être, et marcher dans ta route
Et les jours et les nuits.
Remplis-moi d’un esprit qui me fasse comprendre
Ce qu’ordonnent de moi tes saintes volontés,
Et réduis mes désirs au seul désir d’entendre
Tes hautes vérités.
Je ne veux ni Moïse à2145 m’enseigner tes voies,
Ni quelque autre prophète à m’expliquer tes lois ;
C’est toi qui les instruis, c’est toi qui les envoies,
Dont je cherche la voix.
Comme c’est de toi seul qu’ils ont tous ces lumières,
Dont la grâce par eux éclaire notre foi,
Tu peux bien sans eux tous me les donner entières,
Mais eux tous rien sans toi....
Silence donc, Moïse ; et toi, parle en sa place,
Éternelle, immuable, immense vérité ;
Parle, que je ne2146 meure enfoncé dans la glace
De ma stérilité.
C’est mourir en effet, qu’à ta faveur céleste
Ne rendre point pour fruit des désirs plus ardents ;
Et l’avis du dehors n’a rien que de funeste,
S’il le échauffe au dedans.
Cet avis écouté seulement par caprice,
Connu sans être aimé, cru sans être observé,
C’est ce qui vraiment tue, et sur quoi ta justice
Condamne un réprouvé !
Parle donc, ô mon Dieu ! ton serviteur fidèle
Pour écouter ta voix réunit tous ses sens,
Et trouve les douceurs de la vie éternelle
En ses divins accents.
Parle, pour consoler mon âme inquiétée ;
Parle pour la conduire à quelque amendement ;
Parle, afin que ta gloire ainsi plus exaltée
Croisse éternellement
(Imitation de Jésus-Christ2147 liv. III, chap. ii.)
La Fontaine
(1621-1695) §
Né en 1621 à Château-Thierry, mort à Paris en 1695, Jean de La Fontaine, qui a laissé de petits poèmes, des comédies, des poésies diverses, des lettres, est surtout connu par ses douze livres de Fables. Les sujets de ces fables sont le plus souvent empruntés aux fabulistes anciens, notamment à Esope et à Phèdre2148; mais en mettant en scène, en peignant, en faisant voir ce que les autres se bornent à raconter, en animant tous ces petits drames d’un sentiment tour à tour joyeux, louchant, majestueux ou mélancolique, et toujours personnel, La Fontaine a fait preuve d’une originalité inimitable que nul n’a jamais méconnue et qui non seulement lui assure le premier rang parmi les fabulistes, mais nous permet encore de le mettre au nombre des plus grands poètes de tous les temps et de tous les pays.
L’hirondelle et les petits oiseaux §
Une hirondelle en ses voyages
Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu
Peut avoir beaucoup retenu.
Celle-ci prévoyait jusqu’aux moindres orages,
Et devant qu’ils2149 fussent éclos,
Les annonçait aux matelots.
Il arriva qu’au temps que la chanvre2150 se sème,
Elle vit un manant2151 en couvrir maints sillons.
« Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons :
Je vous plains ; car, pour moi, dans ce péril extrême,
Je saurai m’éloigner, ou vivre en quelque coin.
Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?
Un jour viendra, qui n’est pas loin,
Que ce qu’elle répand sera votre ruine.
De là naîtront engins à vous envelopper2152,
Et lacets pour vous attraper,
Enfin mainte et mainte machine
Qui causera dans la saison
Votre mort ou votre prison :
Gare la cage ou le chaudron !
C’est pourquoi, leur dit l’hirondelle,
Mangez ce grain ; et croyez-moi. »
Les oiseaux se moquèrent d’elle :
Ils trouvaient aux champs trop de quoi2153.
Quand la chènevière2154 fut verte,
L’hirondelle leur dit : « Arrachez brin à brin
Ce qu’a produit ce maudit grain,
Ou soyez sûrs de votre perte.
— Prophète de malheur, babillarde, dit-on.
Le bel emploi que tu nous donnes !
Il nous faudrait mille personnes
Pour éplucher tout ce canton. »
La chanvre étant tout à fait crue.
L’hirondelle ajouta : « Ceci ne va pas bien ;
Mauvaise graine est tôt venue.
Mais, puisque jusqu’ici l’on ne m’a crue en rien,
Dès que vous verrez que la terre
Sera couverte, et qu’à leurs blés
Les gens n’étant plus occupés
Feront aux oisillons la guerre ;
Quand reginglettes2155 et réseaux
Attraperont petits oiseaux,
Ne volez plus de place en place,
Demeurez au logis, ou changez de climat :
Imitez le canard, la grue et la bécasse.
Mais vous n’êtes pas en état
De passer, comme nous, les déserts et les ondes,
Ni d’aller chercher d’autres mondes ;
C’est pourquoi vous n’avez qu’un parti qui soit sûr ;
C’est de vous renfermer aux trous de quelque mur. »
Les oisillons, las de l’entendre,
Se mirent à jaser aussi confusément
Que faisaient les Troyens, quand la pauvre Cassandre2156
Ouvrait la bouche seulement.
Il en prit2157 aux uns comme aux autres :
Maint oisillon se vit esclave retenu.
Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les nôtres,
Et ne croyons le mal que quand il est venu.
(Fables, livre I, fable viii.)
L’ours et les deux compagnons §
Deux compagnons, pressés d’argent,
A leur voisin fourreur vendirent
La peau d’un ours encor vivant,
Mais qu’ils tueraient bientôt, du moins à ce qu’ils dirent.
C’était le roi des ours, au compte de ces gens.
Le marchand à sa peau2158 devait faire fortune ;
Elle garantirait des froids les plus cuisants ;
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu’une
Dindenaut2159 prisait moins ses moutons que leur ours :
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S’offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,
Trouvent l’Ours qui s’avance et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappés comme d’un coup de foudre.
Le marché ne tint pas ; il fallut le résoudre2160 :
D’intérêts contre l’Ours on n’en dit pas un mot2161.
Lun des deux compagnons grimpe au faîte d un arbre ;
L’autre, plus froid que n’est un marbre,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent2162,
Ayant quelque part ouï dire
Que l’ours s’acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.
Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau :
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie ;
Et, de peur de supercherie,
Le tourne, le retourne, approche son museau ;
Flaire aux passages de l’haleine2163.
« C’est, dit-il, un cadavre ; ôtons-nous, car il sent2164. »
A ces mots, l’Ours s’en va dans la forêt prochaine.
L’un de nos deux marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon, lui dit que c’est merveille
Qu’il n’ait eu seulement que la peur pour tout mal.
« Eh bien ! ajouta-t-il, la peau de l’animal ?
Mais que t’a-t-il dit à l’oreille ?
Car il s’approchait de bien près,
Te retournant avec sa serre2165 ?
— Il m’a dit qu’il ne faut jamais
Vendre la peau de l’ours qu’on ne l’ait mis par terre2166. »
(Fables, livre V, fable xx.)
La laitière et le pot au lait §
Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre2167 à la ville.
Légère et court vêtue2168, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple et souliers plats2169.
Notre laitière ainsi troussée2170
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait ; en employait l’argent,
Achetait un cent d’œufs, faisait triple couvée2171 :
La chose allait à bien par son soin diligent.
« Il m’est, disait-elle, facile
D’élever des poulets autour de ma maison ;
Le renard sera bien habile
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;
Il était, quand je l’eus2172, de grosseur raisonnable :
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? »
Perrette là-dessus saute aussi, transportée :
Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame2173 de ces biens, quittant d’un œil marri2174
Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari,
En grand danger d’être battue.
Le récit en farce en fut fait2175 ;
On l’appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne2176 ;
Qui ne fait châteaux en Espagne2177 ?...
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi ;
Je m’écarte2178, je vais détrôner le sophi2179 ;
On m’élit roi, mon peuple m’aime2180 ;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant :
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même ?
Je suis gros Jean comme devant2181.
(Fables, livre VII, fable x.)
Le meunier, son fils et l’âne §
L’invention des arts étant un droit d’aînesse,
Nous devons l’apologue à l’ancienne Grèce2182 ;
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.
La feinte2183 est un pays plein de terres désertes ;
Tous les jours nos auteurs y font des découvertes ;
Je t’en2184 veux dire un trait assez bien inventé :
Autrefois à Racan Malherbe2185 l’a conté.
Ces deux rivaux d’Horace2186, héritiers de sa lyre,
Disciples d’Apollon, nos maîtres, pour mieux dire,
Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins
(Comme ils se confiaient leurs pensers et leurs soins),
Racan commence ainsi : « Dites-moi, je vous prie,
Vous qui devez savoir les choses de la vie,
Qui par tous ses degrés avez déjà passé,
Et que rien ne doit fuir2187 en cet âge avancé,
A quoi me résoudrai-je ? II est temps que j’y pense.
Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance
Dois-je dans la province établir mon séjour,
Prendre emploi dans l’armée, ou bien charge à la cour ?
Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes :
La guerre a ses douceurs, l’hymen a ses alarmes.
Si je savais mon goût, je saurais où buter2188 ;
Mais j’ai les miens2189, la cour, le peuple à contenter. »
Malherbe là-dessus : « Contenter tout le monde !
Écoutez ce récit avant que je réponde.
J’ai lu dans quelque endroit2190 qu’un meunier et son fils,
L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,
Mais garçon de quinze ans, si j’ai bonne mémoire,
Allaient vendre leur âne, un certain jour de foire.
Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,
On lui lia les pieds, on vous le suspendit ;
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre
Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre !
Le premier qui les vit de rire s’éclata2191 :
« Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ?
« Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense. »
Le meunier, à ces mots, connaît2192 son ignorance ;
Il met sur pieds sa bête, et la fait détaler.
Lane, qui goûtait fort l’autre façon d’aller,
Se plaint en son patois. Le meunier n’en a cure2193;
Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure2194
Passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut.
Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :
« Oh là ! oh ! descendez, que l’on ne vous le dise2195,
« Jeune homme, qui menez laquais à barbe grise !
« C’était à vous de suivre, au vieillard de monter.
— « Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. »
L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte,
Quand trois filles passant, l’une dit : « C’est grand’honte
« Qu’il faille voir ainsi clocher2196 ce jeune fils,
« Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis,
« Fait le veau sur son âne, et pense être bien sage.
— « Il n’est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge2197 ;
« Passez votre chemin, la fille, et m’en croyez. »
Après maints quolibets coup sur coup renvoyés,
L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.
Au bout de trente pas, une troisième troupe
Trouve encore à gloser. L’un dit : « Ces gens sont fous !
« Le baudet n’en peut plus ; il mourra sous leurs coups.
« Hé quoi ? charger ainsi cette pauvre bourrique2198 !
« N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?
« Sans doute qu’à la foire ils vont vendre sa peau.
— « Parbleu2199 ! dit le meunier, est bien fou du cerveau
« Qui prétend contenter tout le monde et son père.
« Essayons toutefois si par quelque manière
« Nous en viendrons à bout. » Ils descendent tous deux
L’âne se prélassant2200 marche seul devant eux.
Un quidam2201 les rencontre, et dit : « Est-ce la mode
« Que baudet aille à l’aise, et meunier s’incommode ?
« Qui de l’âne ou du maître est fait pour se lasser ?
« Je conseille à ces gens de le faire enchâsser2202.
« Ils usent leurs souliers, et conservent leur âne.
« Nicolas, au rebours ; car, quand il va voir Jeanne,
« Il monte sur sa bête ; et la chanson le dit2203.
« Beau trio de baudets ! » Le meunier repartit :
« Je suis âne, il est vrai, j’en conviens, je l’avoue ;
« Mais que dorénavant on me blâme, on me loue,
« Qu’on dise quelque chose ou qu’on ne dise rien,
« J’en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien.
Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince2204 ;
Allez, venez, courez ; demeurez en province ;
Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement :
Les gens en parleront, n’en doutez nullement. »
(Fables, livre III, fable i.)
Le vieillard et les trois jeunes hommes §
Un octogénaire plantait.
« Passe encor de bâtir ; mais planter à cet âge ! »
Disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage ;
Assurément il radotait.
« Car, au nom des dieux, je vous prie,
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ?
Autant qu’un patriarche il vous faudrait vieillir.
A quoi bon charger votre vie
Des soins d’un avenir qui n’est pas fait pour vous ?
Ne songez désormais qu’à vos erreurs passées ;
Quittez le long espoir et les vastes pensées ;
Tout cela ne convient qu’à nous.
— Il2205 ne convient pas à vous-mêmes,
Repartit le vieillard. Tout établissement2206
Vient tard et dure peu. La main des Parques2207 blêmes
De vos jours et des miens se joue également.
Nos termes2208 sont pareils par leur courte durée.
Qui de nous des clartés de la voûte azurée
Doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment
Qui vous puisse assurer d’un second seulement ?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage :
Eh bien ! défendez-vous au sage
De se donner des soins pour le plaisir d’autrui ?
Cela même est un fruit que je goûte aujourd’hui :
J’en puis jouir demain, et quelques jours encore ;
Je puis enfin compter l’aurore
Plus d’une fois sur vos tombeaux. »
Le vieillard eut raison : l’un des trois jouvenceaux
Se noya dès le port, allant à l’Amérique2209 ;
L’autre, afin de monter aux grandes dignités,
Dans les emplois de Mars2210 servant la République2211
Par un coup imprévu vit ses jours emportés ;
Le troisième tomba d’un arbre
Que lui-même il voulut enter2212,
Et, pleurés du vieillard2213, il grava sur leur marbre
Ce que je viens de raconter.
(Fables, livre XI, fable viii.)
Épitaphe d’un paresseux §
Jean s’en alla comme il était venu,
Mangea le fonds2214 avec le revenu,
Tint les trésors2215 chose peu nécessaire.
Quant à son temps, bien le sut dispenser2216 ;
Deux parts en fit, dont il soûlait2217 passer
L’une à dormir, et l’autre à ne rien faire.
Molière
(1622-1673) §
Pour la Notice, voir page 55.
Un fâcheux2218 §
Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né,
Pour être de fâcheux toujours assassiné !
Il semble que partout le sort me les adresse,
Et j’en vois chaque jour quelque nouvelle espèce ;
Mais il n’est rien d’égal au fâcheux d’aujourd’hui :
J’ai cru n’être jamais débarrassé de lui,
Et cent fois j’ai maudit cette innocente envie
Qui m’a pris à dîné2219 de voir la comédie,
Où, pensant m’égayer, j’ai misérablement
Trouvé de mes péchés le rude châtiment.
Il faut que je te2220 fasse un récit de l’affaire,
Car je m’en sens encor tout ému de colère.
J’étais sur le théâtre2221, en humeur d’écouter
La pièce, qu’à plusieurs j’avais ouï2222 vanter ;
Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence,
Lorsque d’un air bruyant et plein d’extravagance,
Un homme à grands canons2223 est entré brusquement,
En criant : « Holà ! ho ! un siège promptement ! »
Et, de son grand fracas surprenant l’assemblée,
Dans le plus bel endroit a la pièce troublée2224.
« Hé ! mon Dieu ! nos Français, si souvent redressés,
Ne prendront-ils jamais un air de gens sensés,
Ai-je dit, et faut-il sur nos défauts extrêmes
Qu’en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes,
Et confirmions ainsi par des éclats de fous
Ce que chez nos voisins on dit partout de nous ? »
Tandis que là-dessus je haussais les épaules,
Les acteurs ont voulu continuer leurs rôles ;
Mais l’homme pour s’asseoir a fait nouveau fracas,
Et, traversant encor le théâtre à grands pas,
Bien que dans les côtés il pût être à son aise,
Au milieu du devant il a planté sa chaise,
Et, de son large dos morguant2225 les spectateurs,
Aux trois quarts du parterre a caché les acteurs.
Un bruit s’est élevé, dont un autre eût eu honte ;
Mais lui, ferme et constant, n’en a fait aucun compte,
Et se serait tenu comme il s’était posé,
Si, pour mon infortune, il ne m’eût avisé.
« Ha ! marquis, m’a-t-il dit, prenant près de moi place,
Comment te portes-tu ? Souffre que je t’embrasse2226. »
Au visage sur l’heure un rouge m’est monté
Que l’on me vît connu d’un pareil éventé2227.
Je l’étais peu pourtant ; mais on en voit paraître,
De ces gens qui de rien2228 veulent fort vous connaître,
Dont il faut au salut2229 les baisers essuyer,
Et qui sont familiers jusqu’à vous tutoyer.
Il m’a fait à l’abord cent questions frivoles,
Plus haut que les acteurs élevant ses paroles.
Chacun le maudissait ; et moi, pour l’arrêter :
« Je serais, ai-je dit, bien aise d’écouter.
— Tu n’as point vu ceci, marquis ? Ah ! Dieu me damne2230,
Je le trouve assez drôle, et je n’y suis pas âne ;
Je sais par quelles lois2231 un ouvrage est parfait,
Et Corneille2232 me vient lire tout ce qu’il fait. »
Là-dessus de la pièce il m’a fait un sommaire,
Scène à scène averti de ce qui s’allait faire ;
Et jusques à des vers qu’il en savait par cœur,
Il me les récitait2233 tout haut avant l’acteur.
J’avais beau m’en défendre, il a poussé sa chance2234,
Et s’est devers la fin levé longtemps d’avance ;
Car les gens du bel air, pour agir galamment,
Se gardent bien surtout d’ouïr le dénouement.
Je rendais grâce au Ciel, et croyais de justice2235
Qu’avec la comédie eût fini mon supplice ;
Mais, comme si c’en eût été trop bon marché2236,
Sur nouveaux frais2237 mon homme à moi s’est attaché,
M’a conté ses exploits, ses vertus non communes,
Parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes,
Et de ce qu’à la cour il avait de faveur,
Disant qu’à m’y servir il s’offrait de grand cœur.
Je le remerciais doucement de la tête,
Minutant2238 à tous coups quelque retraite honnête ;
Mais lui, pour le quitter me voyant ébranlé :
« Sortons, ce m’a-t-il dit2239, le monde est écoulé ; »
Et, sortis2240 de ce lieu, me la donnant plus sèche2241 :
« Marquis, allons au Cours2242 faire voir ma galèche2243 ;
Elle est bien entendue, et plus d’un duc et pair2244
En fait à mon faiseur faire une du même air. »
Moi de lui rendre grâce, et, pour mieux m’en défendre.
De dire que j’avais certain repas à. rendre.
« Ah ! parbleu ! j’en veux être, étant de tes amis,
Et manque au maréchal, à qui j’avais promis.
— De la chère, ai-je fait2245, la dose est trop peu forte
Pour oser y prier des gens de votre sorte2246.
— Non, m’a-t-il répondu, je suis sans compliment2247,
Et j’y vais pour causer avec toi seulement ;
Je suis des grands repas fatigué, je te jure.
— Mais si l’on vous attend, ai-je dit, c’est injure....
— Tu te moques, marquis : nous nous connaissons tous,
Et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. »
Je pestais contre moi, l’âme triste et confuse
Du funeste succès2248 qu’avait eu mon excuse,
Et ne savais à quoi je devais recourir
Pour sortir d’une peine à me faire2249 mourir,
Lorsqu’un carrosse fait de superbe manière,
Et comblé de laquais et devant et derrière,
S’est avec un grand bruit devant nous arrêté,
D’où sautant un jeune homme2250 amplement ajusté,
Mon importun et lui courant à l’embrassade
Ont surpris les passants de leur brusque incartade2251 ;
Et tandis que tous deux étaient précipités
Dans les convulsions de leurs civilités2252,
Je me suis doucement esquivé sans rien dire,
Non sans avoir longtemps gémi d’un tel martyre,
Et maudit ce fâcheux, dont le zèle obstiné
M’ôtait au rendez-vous qui m’est ici donné.
(Les Fâcheux, acte I, sc. i.)
Sosie §
I
Sosie2253 §
Qui va là ? Heu ? Ma peur, à chaque pas, s’accroît2254.
Messieurs, ami de tout le monde2255.
Ah ! quelle audace sans seconde2256
De marcher à l’heure qu’il est !
Que mon maître, couvert de gloire,
Me joue ici d’un vilain tour2257 !
Quoi ! si pour son prochain il avait quelque amour,
M’aurait-il fait partir par une nuit si noire ?
Et, pour me renvoyer annoncer son retour
Et le détail de sa victoire,
Ne pouvait-il pas bien attendre qu’il fût jour ?
Sosie, à quelle servitude
Tes jours sont-ils assujettis !
Notre sort est beaucoup plus rude
Chez les grands que chez les petits,
Ils veulent que pour eux tout soit, dans la nature,
Obligé de s’immoler.
Jour et nuit, grêle, vent, péril, chaleur, froidure,
Dès qu’ils parlent, il faut voler.
Vingt ans d’assidu service
N’en obtiennent rien pour nous ;
Le moindre petit caprice
Nous attire leur courroux.
Cependant notre âme insensée
S’acharne au vain honneur de demeurer près d’eux,
Et s’y veut contenter de la fausse pensée
Qu’ont tous les autres gens, que nous sommes heureux.
Vers la retraite en vain la raison nous appelle ;
En vain notre dépit quelquefois y consent :
Leur vue a sur notre zèle Un ascendant trop puissant,
Et la moindre faveur d’un coup d’œil caressant
Nous rengage de plus belle2258.
Mais enfin, dans l’obscurité,
Je vois notre maison, et ma frayeur s’évade.
Il me faudrait, pour l’ambassade,
Quelque discours prémédité.
Je dois aux yeux d’Alcmène un portrait militaire
Du grand combat qui met nos ennemis à bas ;
Mais comment diantre2259 le faire,
Si je ne m’y trouvai pas ?
N’importe, parlons-en et d’estoc et de taille2260,
Comme oculaire témoin.
Combien de gens font-ils des récits de bataille
Dont ils se sont tenus loin ?
Pour jouer mon rôle sans peine Je le veux un peu repasser.
Voici la chambre où j’entre en courrier que l’on mène2261,
Et cette lanterne est Alcmène,
A qui je me dois adresser.
« Madame, Amphitryon, mon maître et votre époux…
(Bon ! beau début !) l’esprit toujours plein de vos charmes,
M’a voulu choisir entre tous
Pour vous donner avis du succès de ses armes
Et du désir qu’il a de se voir près de vous. »
« Ha ! vraiment, mon pauvre Sosie,
A te revoir j’ai de la joie au cœur. »
« Madame, ce m’est trop d’honneur,
Et mon destin doit faire énvie. »
(Bien répondu !) « Comment se porte Amphitryon ? »
« Madame, en homme de courage2262,
Dans les occasions où la gloire l’engage. »
(Fort bien ! belle conception !)
« Quand viendra-t-il, par son retour charmant,
Rendre mon âme satisfaite ? »
« Le plus tôt qu’il pourra, madame, assurément,
« Mais bien plus tard que son cœur ne souhaite. »
(Ah2263 !) « Mais quel est l’état où la guerre l’a mis ?
Que dit-il ? que fait-il ? Contente un peu mon âme. »
« Il dit moins qu’il ne fait, madame,
Et fait trembler les ennemis. »
(Peste ! où prend mon esprit toutes ces gentillesses ?)
« Que font les révoltés ? dis-moi, quel est leur sort ? »
« Ils n’ont pu résister, madame, à notre effort ;
Nous les avons taillés en pièces,
Mis Ptérélas, leur chef, à mort,
Pris Télèbe2264 d’assaut ; et déjà dans le port
Tout retentit de nos prouesses. »
« Ah ! quel succès ! ô dieux ! Qui l’eût pu jamais croire ?
Raconte-moi, Sosie, un tel événement. »
« Je le veux bien, madame ; et, sans m’enfler de gloire,
Du détail de cette victoire Je puis parler très savamment.
Figurez-vous donc que Télèbe,
Madame, est de ce côté :
C’est une ville, en vérité,
Aussi grande quasi2265 que Thèbe.
La rivière est comme là,
Ici nos gens se campèrent2266 ;
Et l’espace que voilà,
Nos ennemis l’occupèrent :
Sur un haut2267, vers cet endroit,
Était leur infanterie ;
Et plus bas, du côté droit,
Était la cavalerie.
Après avoir aux dieux adressé les prières,
Tous les ordres donnés, on donne le signal.
Les ennemis, pensant nous tailler des croupières2268,
Firent trois pelotons de leurs gens à cheval ;
Mais leur chaleur par nous fut bientôt réprimée,
Et vous allez voir comme quoi.
Voilà notre avant-garde à bien faire animée ;
Là, les archers de Créon, notre roi ;
Et voici le corps d’armée,
Qui d’abord… Attendez : le corps d’armée a peur. »
J’entends quelque bruit, ce me semble.
II
Sosie, Mercure2269. §
Mercure.
Sous ce minois2270 qui lui ressemble,
Chassons de ces lieux ce causeur....
Qui va là ?
Sosie.
Moi.
Mercure.
Qui, moi ?
Sosie.
Moi. Courage, Sosie !
Mercure.
Quel est ton sort, dis-moi ?
Sosie.
D’être homme, et de parler.
Es-tu maître ou valet ?
Sosie.
Comme il me prend envie
Mercure.
Où s’adressent2271 tes pas ?
Sosie.
Où j’ai dessein d’aller.
Mercure.
Ah ! ceci me déplaît.
Sosie.
J’en ai l’âme ravie.
Mercure.
Résolument, par force ou par amour,
Je veux savoir de toi, traître,
Ce que tu fais, d’où tu viens avant jour2272,
Où tu vas, à qui tu peux être.
Sosie.
Je fais le bien et le mal tour à tour ;
Je viens de là, vais là ; j’appartiens à mon maître.
Mercure.
Tu montres de l’esprit, et je te vois en train
De trancher avec moi de l’homme d’importance2273,
me prend un désir, pour faire connaissance,
De te donner un soufflet de ma main.
Sosie.
À moi-même ?
Mercure.
À toi-même : et t’en voilà certain.
Sosie.
Ah ! ah ! c’est tout de bon !
Mercure.
Non : ce n’est que pour rire,
Et répondre à tes quolibets.
Sosie.
Tudieu ! l’ami, sans vous rien dire,
Comme vous baillez2274 des soufflets !
Mercure.
Ce sont là de mes : moindres coups,
De petits soufflets ordinaires.
Sosie.
Si j étais aussi prompt que vous,
Nous ferions de belles affaires.
Mercure.
Tout cela n’est encor rien.
Nous verrons bien autre chose ;
Pour y faire quelque pause2275,
Poursuivons notre entretien.
Sosie.
Je quitte la partie2276.
Mercure.
Où vas -tu ?
Sosie.
Que t’importe ?
Mercure.
Je veux savoir où tu vas.
Sosie.
Me faire ouvrir cette porte.
Pourquoi retiens-tu mes pas ?
Mercure.
Si jusqu’à l’approcher tu pousses ton audace,
Je fais sur toi pleuvoir un orage de coups.
Sosie.
Quoi ? tu veux, par ta menace,
M’empêcher d’entrer chez nous ?
Mercure.
Comment chez nous ?
Sosie.
Oui, chez nous.
Mercure.
O le traître !
Tu te dis de cette maison ?
Sosie.
Fort bien. Amphitryon n’en est-il pas le maître ?
Mercure.
Hé bien ! que fait cette raison ?
Sosie.
Je suis son valet.
Mercure.
Toi ?
Sosie.
Moi.
Mercure.
Son valet ?
Sosie.
Sans doute.
Mercure.
Valet d’Amphitryon ?
Sosie.
D’Amphitryon, de lui.
mercure.
Ton nom est ?
Sosie.
Sosie.
Mercure.
Heu ? comment ?
Sosie.
Sosie.
Mercure.
Écoute :
Sais-tu que de ma main je t’assomme aujourd’hui ?
Sosie.
Pourquoi ? De quelle rage est ton âme saisie ?
Mercure.
Qui te donne, dis-moi, cette témérité,
De prendre le nom de Sosie ?
Sosie.
Moi je ne le prends point, je l’ai toujours porté.
Mercure.
O le mensonge horrible ! et l’impudence extrême !
Tu m’oses soutenir que Sosie eû ton nom ?
Sosie.
Fort bien : je le soutiens, par la grande raison
Qu’ainsi l’a fait des dieux la puissance suprême,
Et qu’il n’est pas en moi de pouvoir dire non,
Et d’être un autre que moi-même.
Mercure.
Mille coups de bâton doivent être le prix
D’une pareille effronterie.
Sosie.
Justice, citoyens ! Au secours ! je vous prie.
Mercure.
Comment, bourreau, tu fais des cris ?
Sosie.
De mille coups tu me meurtris,
Et tu ne veux pas que je crie ?
Mercure.
C’est ainsi que mon bras....
Sosie.
L’action2277 ne vaut rien :
Tu triomphes de l’avantage
Que te donne sur moi mon manque de courage ;
Et ce n’est pas en user bien,
C’est pure fanfaronnerie2278
De vouloir profiter de la poltronnerie
De ceux qu’attaque notre bras.
Battre un homme à jeu sûr n’est pas d’une belle âme ;
Et le cœur est digne de blâme
Contre les gens qui n’en ont pas2279.
Mercure.
Hé bien ! es-tu Sosie à présent ? qu’en dis-tu ?
Sosie.
Tes coups n’ont point en moi fait de métamorphose ;
Et tout le changement que je trouve à la chose,
C’est d’être Sosie2280 battu.
Mercure.
Encor ? Cent autres coups pour cette autre impudence.
Sosie.
De grâce, fais trêve à tes coups.
Mercure.
Fais donc trêve à ton insolence.
Sosie.
Tout ce qu’il te plaira ; je garde le silence :
La dispute est par trop inégale entre nous.
Mercure
Es-tu Sosie encor ? dis, traître !
Sosie.
Hélas ! je suis ce que tu veux ;
Dispose de mon sort tout au gré de tes vœux :
Ton bras t’en a fait le maître.
mercure.
Ton nom était Sosie, à ce que tu disais ?
Sosie.
Il est vrai, jusqu’ici j’ai cru la chose claire ;
Mais ton bâton, sur cette affaire,
M’a fait voir que je m’abusais.
mercure.
C’est moi qui suis Sosie, et tout Thèbes l’avoue :
Amphitryon jamais n’en eut d’autre que moi.
Sosie.
Toi, Sosie ?
mercure.
Oui, Sosie ; et si quelqu’un s’y joue,
Il peut bien prendre garde à soi2281.
Sosie.
Ciel ! me faut-il ainsi renoncer à moi même,
Et par un imposteur me voir voler mon nom !
Que son bonheur est extrême,
De ce que je suis poltron !
Sans cela par la mort... !
mercure.
Entre tes dents, je pense,
Tu murmures je ne sais quoi ?
Sosie.
Non. Mais, au nom des dieux, donne-moi la licence
De parler un moment à toi.
mercure.
Parle.
Sosie.
Mais promets-moi, de grâce,
Que les coups n’en seront point.
Signons une trêve.
Mercure.
Passe ;
Va, je t’accorde ce point.
Sosie.
Qui te jette, dis-moi, dans cette fantaisie ?
Que te reviendra-t-il de m’enlever mon nom ?
Et peux-tu faire enfin, quand tu serais démon,
Que je ne sois pas moi ? que je ne sois Sosie ?
Mercure.
Comment ! tu peux...
Sosie.
Ah ! tout doux :
Nous avons fait trêve aux coups.
Mercure.
Quoi ? pendard, imposteur, coquin....
Sosie.
Pour des injures, Dis-m’en tant que tu voudras :
Ce sont légères blessures,
Et je ne m’en fâche pas.
Mercure.
Tu te dis Sosie ?
Sosie.
Oui, quelque conte frivole2282....
Mercure.
Sus2283, je romps notre trêve et reprends ma parole.
Sosie.
N’importe, je ne puis m’anéantir pour toi,
Et souffrir un discours si loin de l’apparence.
Etre ce que je suis est-il en ta puissance ?
Et puis-je cesser d’être moi ?
S’avisa-t-on jamais d’une chose pareille ?
Et peut-on démentir cent indices pressants ?
Rêvé-je ? est-ce que je sommeille ?
Ai-je l’esprit troublé par des transports puissants ?
Ne sens-je pas bien que je veille ?
Ne suis-je pas dans mon bon sens ?
Mon maître Amphitryon ne m’a-t-il pas commis2284
A venir en ces lieux vers Alcméne sa femme ?
Ne lui2285 dois-je pas faire, en lui vantant sa flamme,
Un récit de ses faits contre nos ennemis ?
Ne suis-je pas du port arrivé tout à l’heure ?
Ne tiens-je pas une lanterne en main ?
Ne te trouvé-je pas devant notre demeure ?
Ne t’y parlé-je pas d’un esprit tout humain ?
Ne te tiens-tu pas fort de ma poltronnerie
Pour m’empêcher d’entrer chez nous ?
N’as-tu pas sur mon dos exercé ta furie ?
Ne m’as-tu pas roué de coups ?
Ah ! tout cela n’est que trop véritable,
Et plût au Ciel le fût-il moins !
Cesse donc d’insulter au sort d’un misérable,
Et laisse à mon devoir s’acquitter de ses soins2286.
mercure.
Arrête, ou sur ton dos le moindre pas attire
Un assommant éclat de mon juste courroux.
Tout ce que tu viens de dire Est à moi hormis les coups.
C’est moi qu’Amphitryon députe vers Alcméne,
Et qui du port Persique2287 arrive de ce pas ;
Moi qui viens annoncer la valeur de son bras
Qui nous fait remporter une victoire pleine,
Et de nos ennemis a mis le chef à bas ;
C’est moi qui suis Sosie enfin, de certitude2288,
Fils de Dave, honnête berger ;
Frère d’Arpage2289 mort en pays étranger ;
Mari de Cléanthis la prude2290,
Dont l’humeur me fait enrager ;
Qui dans Thèbe2291 ai reçu mille coups d’étrivière,
Sans en avoir jamais dit rien,
Et jadis en public fus marqué par derrière2292,
Pour être trop homme de bien.
Sosie.
Il a raison. A moins d’être Sosie,
On ne peut pas savoir tout ce qu’il dit ;
Et dans l’étonnement dont mon âme est saisie,
Je commence, à mon tour, à le croire un petit2293
En effet, maintenant que je le considère,
Je vois qu’il a de moi taille, mine, action2294.
Faisons-lui quelque question,
Afin d’éclaircir ce mystère.
Parmi tout le butin fait sur nos ennemis,
Qu’est-ce qu’Amphitryon obtient pour son partage ?
Mercure.
Cinq fort gros diamants, en nœud proprement mis,
Dont leur chef se parait comme d’un rare ouvrage.
Sosie.
A qui destine-t-il un si riche présent ?
Mercure.
À sa femme ; et sur elle il le veut voir paraître.
Sosie.
Mais où, pour l’apporter, est-il mis à présent ?
Mercure.
Dans un coffret, scellé des armes de mon maître.
Sosie.
Il ne ment pas d’un mot à chaque repartie,
Et de moi je commence à douter tout de bon.
Piles de moi, par la force, il est déjà Sosie ;
Il pourrait bien encor l’être par la raison.
Pourtant, quand je me tâte, et que je me rappelle,
Il me semble que je suis moi.
Où puis-je rencontrer quelque clarté fidèle,
Pour démêler ce que je voi2295 ?
Ce que j’ai fait tout seul, et que n’a vu personne,
A moins d’être moi-même, on ne le peut savoir.
Par cette question il faut que je l’étonne2296 :
C’est de quoi le confondre, et nous allons le voir.
Lorsqu’on était aux mains, que fis-tu dans nos tentes,
Où tu courus seul te fourrer ?
Mercure.
D’un jambon....
Sosie.
L’y voilà !
Mercure
Que j’allai déterrer,
Je coupai bravement deux tranches succulentes,
Dont je sus fort bien me bourrer ;
Et joignant à cela d’un vin que l’on ménage,
Et dont, avant le goût, les yeux se contentaient2297,
Je pris un peu de courage,
Pour nos gens qui se battaient.
Sosie.
Cette preuve sans pareille,
En sa faveur conclut bien ;
Et l’on n’y peut dire rien,
S’il n’était dans la bouteille2298.
Je ne saurais nier, aux preuves qu’on m’expose,
Que tu ne sois Sosie, et j’y donne ma voix.
Mais si tu l’es, dis-moi qui tu veux que je sois ?
Car encor faut-il bien que je sois quelque chose.
Mercure.
Quand je ne serai plus Sosie,
Sois-le, j’en demeure d’accord ;
Mais tant que je le suis, je te garantis mort,
Si tu prends cette fantaisie.
(Amphitryon2299, acte I, sc. ii.)
Les portraits §
Célimène, Acaste, Clitandre, Éliante, Philinte2300, Clitandre. §
Parbleu ! je viens du Louvre, où Cléonte, au levé2301,
Madame, a bien paru ridicule achevé.
N’a-t-il point quelque ami qui pût, sur ses manières,
D’un charitable avis lui prêter les lumières ?
Célimène.
Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort ;
Partout il porte un air qui saute aux yeux d’abord2302 ;
Et lorsqu’on le revoit après un peu d’absence,
On le retrouve encor plus plein d’extravagance.
Acaste.
Parbleu ! s’il faut parler de gens extravagants,
Je viens d’en essuyer un des plus fatigants :
Damon, le raisonneur, qui m’a, ne vous déplaise,
Une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise.
Célimène.
C’est un parleur étrange, et qui trouve toujours
L’art de ne vous rien dire avec de grands discours ;
Dans les propos qu’il tient, on ne voit jamais goutte,
Et ce n’est que du bruit que tout ce qu’on écoute.
Éliante, à Philinte.
Ce début n’est pas mal ; et contre le prochain
La conversation prend un assez bon train.
Clitandre.
Timante encor, Madame, est un bon caractère.
Célimène.
C’est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup d’œil égaré,
Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.
Tout ce qu’il vous débite en grimaces abonde ;
A force de façons, il assomme le monde ;
Sans cesse il a, tout bas, pour rompre l’entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n’est rien ;
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bonjour, il dit tout à l’oreille.
Acaste.
Et Géralde, Madame ?
Célimène.
O l’ennuyeux conteur !
Jamais on le voit sortir du grand seigneur2303 ;
Dans le brillant commerce2304 il se mêle sans cesse,
Et ne cite jamais que duc, prince ou princesse :
La qualité l’entête2305 ; et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d’équipage et de chiens ;
Il tutaye2306 en parlant ceux du plus haut étage ;
Et le nom de Monsieur est chez lui hors d’usage.
Clitandre.
On dit qu’avec Bélise il est du dernier bien.
Célimène.
Le pauvre esprit de femme, et le sec entretien !
Lorsqu’elle vient me voir, je souffre le martyre :
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire,
Et la stérilité de son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain, pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs2307 vous prenez l’assistance :
Le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud
Sont des fonds qu’avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable,
Traîne en une longueur encore épouvantable ;
Et l’on demande l’heure, et l’on bâille vingt fois,
Qu’elle grouille2308 aussi peu qu’une pièce de bois.
Acaste.
Que vous semble d’Adraste ?
Célimène.
Ah ! quel orgueil extrême !
C’est un homme gonflé de l’amour de soi-même2309.
Son mérite jamais n’est content de la cour :
Contre elle il fait métier de pester chaque jour,
Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice2310,
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.
Clitandre.
Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd’hui
Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui ?
Célimène.
Que de son cuisinier il s’est fait un mérite,
Et que c’est à sa table à qui2311 l’on rend visite.
Éliante.
Il prend soin d’y servir des mets fort délicats.
Célimène.
Oui ; mais je voudrais bien qu’il ne s’y servît pas :
C’est un fort méchant plat que sa sotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu’il donne.
Philinte.
On fait assez de cas de son oncle Damis :
Qu’en dites-vous, Madame ?
Célimène.
Il est de mes amis2312.
Philinte.
Je le trouve honnête homme2313 et d’un air assez sage.
Célimène.
Oui ; mais il veut avoir trop d’esprit, dont j’enrage2314 ;
Il est guindé2315 sans cesse ; et dans tous ses propos,
On voit qu’il se travaille à dire de bons mots.
Depuis que dans la tête il s’est mis d’être habile2316,
Rien ne touche son goût, tant il est difficile ;
Il veut voir des défauts à tout ce qu’on écrit,
Et pense que louer n’est pas d’un bel esprit,
Que c’est être savant que trouver à redire,
Qu’il n’appartient qu’aux sots d’admirer et de rire,
Et qu’en n’approuvant rien des ouvrages du temps,
Il se met au-dessus de tous les autres gens ;
Aux conversations même il trouve à reprendre :
Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre ;
Et les deux bras croisés, du haut de son esprit
Il regarde en pitié tout ce que chacun dit.
Acaste.
Dieu me damne, voilà son portrait véritable.
Clitandre.
Pour bien peindre les gens vous êtes admirable.
(Le Misanthrope, acte II, sc. iv.)
Trissotin §
Clitandre, Henriette. §
Je respecte beaucoup Madame votre mère2317 ;
Mais je ne puis du tout approuver sa chimère,
Et me rendre l’écho des choses qu’elle dit,
Aux encens qu’elle donne2318 à son héros d’esprit.
Son Monsieur Trissotin me chagrine, m’assomme,
Et j’enrage de voir qu’elle estime un tel homme,
Qu’elle nous mette au rang des grands et beaux esprits,
Un benêt dont partout on siffle les écrits,
Un pédant dont on voit la plume libérale2319
D’officieux2320 papiers fournir toute la halle.
Henriette.
Ses écrits, ses discours, tout m’en semble ennuyeux,
Et je me trouve assez votre goût et vos yeux ;
Mais, comme sur ma mère il a grande puissance,
Vous devez vous forcer à quelque complaisance2321....
Clitandre.
Oui, vous avez raison ; mais Monsieur Trissotin
M’inspire au fond de l’âme un dominant chagrin.
Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages,
A me déshonorer en prisant2322 ses ouvrages ;
C’est par eux qu’à mes yeux il a d’abord paru,
Et je le connaissais avant que l’avoir vu2323.
Je vis, dans le fatras des écrits qu’il nous donne,
Ce qu’étale en tous lieux sa pédante personne
La constante hauteur de sa présomption,
Cette intrépidité de bonne opinion,
Cet indolent état de confiance extrême
Qui le rend en tout temps si content de soi-même2324,
Qui fait qu’à son mérite incessamment il rit,
Qu’il se sait si bon gré de tout ce qu’il écrit,
Et qu’il ne voudrait pas changer sa renommée
Contre tous les honneurs d’un général d’armée.
Henriette.
C’est avoir de bons yeux que de voir tout cela.
Clitandre.
Jusques à sa figure encor la chose alla2325,
Et je vis par les vers qu’à, la tête il nous jette,
De quel air il fallait que fût fait le poète ;
Et j’en avais si bien deviné tous les traits,
Que rencontrant un homme un jour dans le Palais2326,
Je gageai que c’était Trissotin en personne,
Et je vis qu’en effet la gageure était bonne.
(Les Femmes savantes, acte I, sc.iii.)
Les deux pédants §
Trissotin, Vadius, Les Femmes Savantes. §
Vadius.
Le défaut des auteurs, dans leurs productions,
C’est d’en tyranniser les conversations,
D’être au Palais2327, au Cours2328, aux ruelles2329, aux tables,
De leurs vers fatigants lecteurs infatigables.
Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens
Qu’un auteur qui partout va gueuser2330 des encens,
Qui des premiers venus saisissant les oreilles,
En fait le plus souvent les martyrs de ses veilles2331.
On ne m’a jamais vu ce fol entêtement ;
Et d’un Grec là-dessus je suis le sentiment,
Qui, par un dogme exprès, défend à tous ses sages
L’indigne empressement de lire leurs ouvrages.
Voici de petits vers2332 pour de jeunes amants,
Sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments.
Trissotin.
Vos vers ont des beautés que n’ont point tous les autres.
Vadius.
Les Grâces et Vénus2333 règnent dans tous les vôtres.
Trissotin.
Vous avez le tour libre, et le beau choix des mots.
Vadius.
On voit partout chez vous l’ithos et le pathos2334.
Trissotin.
Nous avons vu de vous des églogues d’un style
Qui passe2335 en doux attraits Théocrite et Virgile2336.
Vadius.
Vos odes ont un air noble, galant et doux,
Qui laisse de bien loin votre Horace après vous.
Trissotin.
Est-il rien d’amoureux comme vos chansonnettes ?
Vadius.
Peut-on voir rien d’égal aux sonnets2337 que vous faites ?
Trissotin.
Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux2338 ?
Vadius.
Rien de si plein d’esprit que tous vos madrigaux2339 ?
Trissotin.
Aux ballades2340 surtout vous êtes admirable.
Vadius.
Et dans les bouts-rimés2341 je vous trouve adorable.
Trissotin.
Si la France pouvait connaître votre prix,
Vadius.
Si le siècle rendait justice aux beaux esprits,
Trissotin.
En carrosse doré vous iriez par les rues.
Vadius.
On verrait le public vous dresser des statues.
Hom ! C’est une ballade, et je veux que tout net
Vous m’en....
Trissotin.
Avez-vous vu certain petit sonnet
Sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ?
Vadius.
Oui, hier il me fut lu dans une compagnie.
Trissotin.
Vous en savez l’auteur ?
Vadius.
Non ; mais je sais fort bien
Qu’à ne le point flatter son sonnet ne vaut rien.
Trissotin.
Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.
Vadius.
Cela n’empêche pas qu’il ne soit misérable ;
Et, si vous l’avez vu, vous serez de mon goût.
Trissotin.
Je sais que là-dessus je n’en suis point du tout,
Et que d’un tel sonnet peu de gens sont capables.
Vadius.
Me préserve le Ciel d’en faire-de semblables !
Trissotin.
Je soutiens qu’on ne peut en faire de meilleur :
Et ma grande raison, c’est que j’en suis l’auteur.
Vadius.
Vous !
Trissotin.
Moi.
Vadius.
Je ne sais donc comment se fit l’affaire.
Trissotin.
C’est qu’on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire.
Vadius.
Il faut qu’en écoutant j’aie eu l’esprit distrait,
Ou bien que le lecteur m’ait gâté le sonnet.
Mais laissons ce discours et voyons ma ballade.
Trissotin.
La ballade, à mon goût, est une chose fade.
Ce n’en est plus la mode ; elle sent son vieux temps.
Vadius.
La ballade pourtant charme beaucoup de gens.
Trissotin.
Cela n’empêche pas qu’elle ne me déplaise.
Vadius.
Elle n’en reste pas pour cela plus mauvaise.
Trissotin.
Elle a pour les pédants de merveilleux appas.
Vadius.
Cependant nous voyons qu’elle ne vous plaît pas.
Trissotin.
Vous donnez sottement vos qualités aux autres.
Vadius.
Fort impertinemment2342 vous me jetez les vôtres.
Trissotin.
Allez, petit grimaud2343, barbouilleur de papier.
Vadius.
Allez, rimeur de balle2344, opprobre du métier.
Trissotin.
Allez, fripier d’écrits2345, impudent plagiaire.
Vadius.
Allez, cuistre2346....
Philaminte2347.
Eh ! Messieurs, que prétendez-vous faire !
Trissotin.
Va, va restituer tous les honteux larcins
Que réclament sur toi les Grecs et les Latins.
Vadius,
Va, va-t’en faire amende honorable au Parnasse
D’avoir fait à tes vers estropier Horace2348.
Trissotin.
Sou viens-toi de ton livre et de son peu de bruit.
Vadius.
Et toi, de ton libraire à l’hôpital réduit.
Trissotin.
Ma gloire est établie ; en vain tu la déchires.
Vadius.
Oui, oui, je te renvoie à l’auteur des Satires2349.
Trissotin.
Je t’y renvoie aussi.
Vadius.
J’ai le contentement
Qu’on voit qu’il m’a traité plus honorablement2350 :
Il me donne, en passant, une atteinte légère,
Parmi plusieurs auteurs qu’au Palais on révère ;
Mais jamais, dans ses vers, il ne te laisse en prix,
Et l’on t’y voit partout être en butte à ses traits
Trissotin.
C’est par là que j’y tiens un rang plus honorable.
Il te met dans la foule, ainsi qu’un misérable ;
Il croit que c’est assez d’un coup pour t’accabler,
Et ne t’a jamais fait l’honneur de redoubler ;
Mais il m’attaque à part, comme un noble adversaire
Sur qui tout son effort lui semble nécessaire ;
Et ses coups contre moi redoublés en tous lieux
Montrent qu’il ne se croit jamais victorieux.
Vadius.
Ma plume t’apprendra quel homme je puis être.
Trissotin.
Et la mienne saura te faire voir ton maître.
Vadius.
Je te défie en vers, prose, grec, et latin.
Trissotin.
Hé bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin2351.
(Les Femmes savantes, acte III, sc. iii.)
Le poète a sa muse en l’envoyant vers le roi travestie en marquis2352 §
Vous savez ce qu’il faut pour paraître marquis ;
N’oubliez rien de l’air ni des habits :
Arborez un chapeau chargé de trente plumes
Sur une perruque de prix :
Que le rabat2353 soit des plus grands volumes,
Et le pourpoint2354 des plus petits ;
Mais surtout je vous recommande
Le manteau, d’un ruban sur le dos retroussé :
La galanterie en est grande ;
Et parmi les marquis de la plus haute bande2355
C’est pour être placé.
Avec vos brillantes hardes
Et votre ajustement,
Faites tout le trajet de la salle des gardes2356
Et, vous peignant galamment,
Portez de tous côtés vos regards brusquement ;
Et ceux que vous pourrez connaître,
Ne manquez pas, d’un haut ton,
De les saluer par leur nom,
De quelque rang qu’ils puissent être.
Cette familiarité
Donne à quiconque en use un air de qualité.
Grattez du peigne à la porte2357
De la chambre du roi ;
Ou si, comme je prévoi2358,
La presse s’y trouve forte,
Montrez de loin votre chapeau,
Ou montez sur quelque chose
Pour faire voir votre museau ;
Et criez, sans aucune pause,
D’un ton rien moins que naturel :
« Monsieur l’huissier, pour le marquis un tel2359. »
Jetez-vous dans la foule, et tranchez du notable ;
Coudoyez un chacun, point du tout de quartier ;
Pressez, poussez, faites le diable
Pour vous mettre le premier ;
Et quand même l’huissier,
À vos désirs inexorable,
Vous trouverait en face un marquis repoussable2360,
Ne démordez point pour cela ;
Tenez toujours ferme là ;
À déboucher la porte, il irait trop du vôtre2361 ;
Faites qu’aucun n’y puisse pénétrer,
Et qu’on soit obligé de vous laisser entrer,
Pour faire entrer quelque autre.
Quand vous serez entré2362, ne vous relâchez pas :
Pour assiéger la chaise2363, il faut d’autres combats.
Tâchez d’en être des plus proches
En y gagnant le terrain pas à pas ;
Et si des assiégeants le prévenant amas
En bouche toutes les approches,
Prenez le parti doucement
D’attendre le prince au passage :
Il connaîtra votre visage
Malgré votre déguisement ;
Et lors, sans tarder davantage,
Faites-lui votre compliment.
(Remercîment au roi.)
Boileau
(1636-1711) §
Nicolas Boileau Despréaux est né à Paris en 1636 et mort en 1711. Dès son début dans la littérature il eut le mérite de combattre les mauvais écrivains qui se trouvaient en possession de la faveur publique, et de reconnaître le génie de Molière et surtout de Racine, qui pendant toute sa carrière dut beaucoup à son amitié et à ses conseils ; il a écrit douze Satires et douze Epîtres (1660-1705), un poème héroï-comique, le Lutrin (1672-1683), et surtout un Art poétique en quatre chants (1674) dans lequel il expose avec méthode les principes littéraires qu’il avait défendus dans ses satires. Esprit solide plutôt que brillant, Boileau doit être également respecté pour son talent de poète, la sûreté de son goût et de sa doctrine, et la noblesse de son caractère : sa vie est remplie des traits les plus honorables. Louis XIV, qui l’estimait beaucoup, intervint de sa personne pour le faire admettre à l’Académie (1685), et, peu de temps après, le nomma, avec Racine, son historiographe. Outre ses poésies, Boileau a laissé quelques opuscules en prose, presque tous relatifs à la littérature, et des lettres dont quelques-unes sont adressées à Racine, et le plus grand nombre à Brossette (1671-1743), son ami, qui se fit, après sa mort, l’éditeur de ses œuvres.
La modération dans les désirs §
L’argent, l’argent, dit-on ; sans lui tout est stérile ;
La vertu sans l’argent n’est qu’un meuble inutile.
L’argent en honnête homme érige un scélérat ;
L’argent seul au palais peut faire un magistrat2364.
Qu’importe qu’en tous lieux on me traite d’infâme ?
Dit ce fourbe sans foi, sans honneur et sans âme ;
Dans mon coffre tout plein de rares qualités,
J’ai cent mille vertus en louis bien comptés.
Est-il quelque talent que l’argent ne me donne ?
C’est ainsi qu’en son cœur ce financier raisonne.
Mais pour moi, que l’éclat ne saurait décevoir2365,
Qui mets au rang des biens l’esprit et le savoir,
J’estime autant Patru2366, même dans l’indigence,
Qu’un commis2367 engraissé des malheurs de la France.
Non que je sois du goût de ce sage insensé2368
Qui, d’un argent commode esclave embarrassé2369,
Jeta tout dans la mer pour crier : « Je suis libre ».
De la droite raison je sens mieux l’équilibre ;
Mais je tiens qu’ici-bas, sans faire tant d’apprêts,
La vertu se contente et vit à peu de frais.
Pourquoi donc s’égarer en des projets si vagues2370 ?
Ce que j’avance ici, crois-moi, cher Guilleragues2371,
Ton ami dès l’enfance ainsi l’a pratiqué.
Mon père2372, soixante ans au travail appliqué,
En mourant me laissa, pour rouler2373 et pour vivre,
Un revenu léger, et son exemple à suivre.
Mais bientôt amoureux d’un plus noble métier,
Fils, frère, oncle, cousin, beau-frère de greffier,
Pouvant charger mon bras d’une utile liasse2374,
J’allai, loin du Palais2375, errer sur le Parnasse2376.
La famille en pâlit, et vit en frémissant
Dans la poudre2377 du greffe un poète naissant :
On vit avec horreur une muse effrénée
Dormir chez un greffier la grasse matinée.
Dès lors à la richesse il fallut renoncer :
Ne pouvant l’acquérir, j’appris à m’en passer ;
Et surtout redoutant2378 la basse servitude,
La libre vérité fut toute mon étude.
Dans ce métier funeste à qui veut s’enrichir,
Qui l’eût cru que, pour moi, le sort dût se fléchir ?
Mais du plus grand des rois2379 la bonté sans limite,
Toujours prête à courir au-devant du mérite,
Crut voir dans ma franchise un mérite inconnu,
Et d’abord2380 de ses dons enfla mon revenu.
La brigue ni l’envie à mon bonheur contraires,
Ni les cris douloureux de mes vains adversaires,
Ne purent dans leur course arrêter ses bienfaits.
C’en est trop : mon bonheur a passé mes souhaits.
Qu’à son gré désormais la fortune me joue ;
On me verra dormir au branle de sa roue2381.
(Épitres, V.)
Les plaisirs de la campagne §
Épître A M. De Lamoignon2382 §
Oui, Lamoignon, je fuis les chagrins de la ville,
Et contre eux la campagne est mon unique asile.
Du lieu qui m’y retient veux-tu voir le tableau ?
C’est un petit village ou plutôt un hameau2383,
Bâti sur le penchant d’un long rang de collines,
D’où l’œil s’égare au loin dans les plaines voisines.
La Seine au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt îles s’élever,
Qui, partageant son cours en diverses manières,
D’une rivière seule y forment vingt rivières.
Tous ses bords sont couverts de saules non plantés2384
Et de noyers souvent du passant insultés.
Le village au-dessus forme un amphithéâtre :
L’habitant ne connaît ni la chaux ni le plâtre ;
Et dans le roc, qui cède et se coupe aisément,
Chacun sait de sa main creuser son logement2385.
La maison du seigneur, seule un peu plus ornée,
Se présente au dehors de murs environnée.
Le soleil en naissant la regarde d’abord,
Et le mont la défend des outrages du nord.
C’est là, cher Lamoignon, que mon esprit tranquille
Met à profit les jours que la Parque me file2386.
Ici, dans un vallon bornant tous mes désirs,
J’achète à peu de frais de solides plaisirs.
Tantôt, un livre en main, errant dans les prairies,
J’occupe ma raison d’utiles rêveries ;
Tantôt, cherchant la fin d’un vers que je construi2387,
Je trouve au coin d’un bois le mot qui m’avait fui ;
Quelquefois, aux appas2388 d’un hameçon perfide,
J’amorce en badinant le poisson trop avide ;
Ou, d’un plomb qui suit l’œil et part avec l’éclair,
Je vais faire la guerre aux habitants de l’air.
Une table au retour, propre et non magnifique,
Nous présente un repas agréable et rustique.
Là, sans s’assujettir aux dogmes de Broussain2389,
Tout ce qu’on boit est bon, tout ce qu’on mange est sain ;
La maison le fournit, la fermière l’ordonne,
Et mieux que Bergerat2390 l’appétit l’assaisonne.
O fortuné séjour ! ô champs aimés des cieux !
Que, pour jamais foulant vos prés délicieux,
Ne puis-je ici fixer ma course vagabonde,
Et, connu de vous seuls, oublier tout le monde2391 !
(Épîtres, VI.)
A son jardinier §
Antoine, tu crois donc de nous deux, je le voi2392,
Que le plus occupé dans ce jardin c’est toi ?
Oh ! que tu changerais d’avis et de langage
Si deux jours seulement, libre du jardinage,
Tout à coup devenu poète et bel esprit,
Tu t’allais engager à polir un écrit
Qui dît, sans s’avilir, les plus petites choses ;
Fît, des plus secs chardons, des œillets et des roses ;
Et sût même aux discours de la rusticité
Donner de l’élégance et de la dignité !...
Bientôt de ce travail revenu sec et pâle,
Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle,
Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau :
« J’aime mieux mettre encor cent arpents2393 au niveau
Que d’aller follement, égaré dans les nues,
Me lasser à chercher des visions cornues,
Et, pour lier des mots si mal s’entr’accordants,
Prendre dans ce jardin la lune avec les dents. »
Approche donc, et viens ; qu’un paresseux t’apprenne,
Antoine, ce que c’est que fatigue et que peine.
L’homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,
Est, dans le repos même, au travail condamné.
La fatigue l’y suit. C’est en vain qu’aux poètes
Les neuf trompeuses Sœurs2394 dans leurs douces retraites
Promettent du repos sous leurs ombrages frais ;
Dans ces tranquilles bois pour eux plantés exprès,
La cadence aussitôt, la rime, la césure,
La riche expression, la nombreuse2395 mesure,
Sorcières dont l’amour sait d’abord les charmer,
De fatigues sans fin viennent les consumer.
Sans cesse poursuivant ces fugitives fées2396,
On voit sous les lauriers haleter les Orphées2397.
Leur esprit toutefois se plaît dans son tourment,
Et se fait de sa peine un noble amusement.
Mais je ne trouve point de fatigue si rude
Que l’ennuyeux loisir d’un mortel sans étude2398,
Qui, jamais ne sortant de sa stupidité2399,
Soutient, dans les langueurs de son oisiveté,
D’une lâche indolence esclave volontaire,
Le pénible fardeau de n’avoir rien à faire.
Vainement offusqué de ses pensers épais,
Loin du trouble et du bruit il croit trouver la paix.
Dans le calme odieux de sa sombre paresse,
Tous les honteux plaisirs, enfants de la mollesse,
Sur leurs pas, sans tarder, amènent les remords,
Et bientôt avec eux tous les fléaux du corps,
La pierre, là colique et les gouttes cruelles ;
Guénaud, Rainssant, Brayer2400, presque aussi tristes quelles,
Chez l’indigne mortel courent tous s’assembler,
De travaux douloureux le viennent accabler ;
Sur le duvet d’un lit, théâtre de ses gênes2401,
Lui font scier des rocs, lui font fendre des chênes2402,
Et le mettent au point d’envier2403 ton emploi.
Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi,
Que la pauvreté mâle, active et vigilante
Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente
Que la richesse oisive au sein des voluptés.
Je te vais sur cela prouver deux vérités :
L’une, que le travail, aux hommes nécessaire,
Fait leur félicité plutôt que leur misère ;
Et l’autre, qu’il n’est point de coupable en repos.
C’est ce qu’il faut ici montrer en peu de mots.
Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône2404,
Que ta bouche déjà s’ouvre large d’une aune2405,
Et que, les yeux fermés, tu baisses le menton.
Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon.
Aussi bien j’aperçois ces melons qui t’attendent,
Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent
S’il est fête au village, et pour quel saint nouveau2406
On les laisse aujourd’hui si longtemps manquer d’eau,
(Epîtres, XI)
Racine
(1639-1699) §
Né en 1639 à la Ferté-Milon, mort en 1699, Jean Racine peut être considéré comme le plus parfait de nos auteurs tragiques. Il fit représenter en 1664 sa première tragédie, la Thébaïde ou les Frères ennemis, et, en 1665, la seconde, Alexandre. Son premier chef-d’œuvre, Andromaque, est de 1667. Puis viennent l’amusante comédie des Plaideurs (1668) et six tragédies : Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie en Aulide (1674), Phèdre (1677). A cette époque, lassé des attaques de ses adversaires et de plus en plus préoccupé de son salut et de ce qu’il devait à Dieu, se consacrant aussi aux devoirs nouveaux que lui créait son mariage (1672), il renonce au théâtre. Ce n’est qu’à la prière de Mme de Maintenon qu’il composa plus tard pour les jeunes filles de Saint-Cyr Esther (1689) et Athalie (1691). Il a laissé, outre ses tragédies, des opuscules en prose, des lettres et quelques poésies diverses, notamment des cantiques et des épigrammes.
Prière d’Andromaque à Pyrrhus2407 §
Seigneur, voyez l’état où2408 vous me réduisez.
J’ai vu mon père mort, et nos murs embrasés ;
J’ai vu trancher les jours de ma famille entière,
Et mon époux sanglant traîné sur la poussière,
Son fils seul avec moi réservé pour les fers.
Mais que ne peut un fils ? Je respire, je sers2409.
J’ai fait plus : je me suis quelquefois consolée
Qu’ici, plutôt qu’ailleurs, le sort m’eût exilée ;
Qu’heureux dans son malheur le fils de tant de rois,
Puisqu’il devait servir, fût tombé sous vos lois.
J’ai cru que sa prison deviendrait son asile.
Jadis Priam soumis fut respecté d’Achille2410 :
J’attendais de son fils encor plus de bonté.
Pardonne, cher Hector, à ma crédulité2411.
Je n’ai pu soupçonner ton ennemi d’un crime ;
Malgré lui-même enfin je l’ai cru magnanime.
Ah ! s’il l’était assez pour nous laisser du moins
Au tombeau qu’à ta cendre ont élevé mes soins2412,
Et que, finissant là sa haine et nos misères,
Il ne séparât point des dépouilles si chères !
(Andromaque, acte III, sc. iv.)
Les souvenirs d’Andromaque §
Pyrrhus, répondant à la prière d’Andromaque (voir pages 572-573), lui a, pour la dernière fois, demandé de l’épouser : c’est à cette condition seule qu’il sauvera Astyanax (voir page 572, note l). Céphise, confidente d’Andromaque, lui a conseillé d’accepter et elle a fait valoir les sentiments de Pyrrhus, qui, pour Andromaque, oublie et sa naissance et ses exploits. Andromaque lui répond d’un mot :
Dois-je les oublier, s’il ne s’en souvient plus ?
Puis, développant sa pensée :
Dois-je oublier Hector privé de funérailles,
Et traîné sans honneur autour de nos murailles2413 ?
Dois-je oublier son père, à mes pieds renversé »
Ensanglantant l’autel qu’il tenait embrassé ?
Songe, songe, Céphise2414, à cette nuit cruelle2415
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ;
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage,
Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants.
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue :
Voilà comme Pyrrhus vint s’offrir à ma vue ;
Voilà par quels exploits il sut se couronner ;
Enfin voilà l’époux que tu me veux donner2416.
(.Andromaque, acte III, sc. viii.)
Andromaque confie son fils à Céphise2417 §
Je confie à tes soins mon unique trésor :
Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d’Hector.
De l’espoir des Troyens seule dépositaire,
Songe à combien de rois tu deviens nécessaire.
Veille auprès de Pyrrhus ; fais-lui garder sa foi :
S’il le faut, je consens qu’on lui parle de moi.
Fais-lui valoir l’hymen où je me suis rangée2418;
Dis-lui qu’avant ma mort je lui fus engagée,
Que ses ressentiments doivent être effacés,
Qu’en lui laissant mon fils, c’est l’estimer assez.
Fais connaître à mon fils les héros de sa race ;
Autant que tu pourras, conduis-le sur leur trace.
Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté,
Plutôt ce qu’ils ont fait que ce qu’ils ont été ;
Parle-lui tous les jours des vertus de son père ;
Et quelquefois aussi parle-lui de sa mère.
Mais qu’il ne songe plus, Céphise, à nous venger :
Nous lui laissons un maître, il le doit ménager.
Qu’il ait de ses aïeux un souvenir modeste :
Il est du sang d’Hector, mais il en est le reste2419;
Et pour ce reste enfin j’ai moi-même en un jour
Sacrifié mon sang, ma haine et mon amour.
(Andromaque, acte IV, sc. i.)
Burrhus à Néron méditant de faire assassiner Britannicus2420 §
Burrhus
De votre bouche, ô ciel ! puis-je rapprendre ?
Vous-même, sans frémir, avez-vous pu l’entendre ?
Songez-vous dans quel sang vous allez vous baigner ?
Néron dans tous les cœurs est-il las de régner ?
Que dira-t-on de vous ? quelle est votre pensée ?
Néron
Quoi ! toujours enchaîné de ma gloire passée,
J’aurai devant les yeux je ne sais quel amour
Que le hasard nous donne et nous ôte en un jour2421 ?
Soumis à tous leurs vœux, à mes désirs contraire,
Suis-je leur empereur seulement pour leur plaire ?
Burrhus
Et ne suffit-il pas, seigneur, à vos souhaits
Que le bonheur public soit un de vos bienfaits ?
C’est à vous à choisir, vous êtes encor maître.
Vertueux jusqu’ici, vous pouvez toujours l’être :
Le chemin est tracé, rien ne vous retient plus,
Vous n’avez qu’à marcher de vertus en vertus.
Mais si de vos flatteurs vous suivez la maxime,
Il vous faudra, seigneur, courir de crime en crime,
Soutenir vos rigueurs par d’autres cruautés,
Et laver dans le sang vos bras ensanglantés.
Britannicus mourant excitera le zèle
De ses amis, tout prêts à prendre sa querelle.
Ces vengeurs trouveront de nouveaux défenseurs,
Qui, même après leur mort, auront des successeurs
Vous allumez un feu qui ne pourra s’éteindre.
Craint de tout l’univers, il vous faudra tout craindre,
Toujours punir, toujours trembler dans vos projets,
Et pour vos ennemis compter tous vos sujets.
Ali ! de vos premiers ans l’heureuse expérience
Vous fait-elle, seigneur, haïr votre innocence ?
Songez-vous au bonheur qui les a signalés ?
Dans quel repos, ô ciel ! les avez-vous coulés !
Quel plaisir de penser et de dire en vous-même :
« Partout en ce moment, on me bénit, on m’aime :
On ne voit point le peuple à mon nom s’alarmer ;
Le ciel dans tous leurs pleurs ne m’entend point nommer ;
Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage ;
Je vois voler partout les cœurs à mon passage ! »
Tels étaient vos plaisirs. Quel changement, ô dieux !
Le sang le plus abject vous était précieux :
Un jour, il m’en souvient, le sénat équitable
Vous pressait de souscrire à la mort d’un coupable :
Vous résistiez, seigneur, à leur sévérité ;
Votre cœur s’accusait de trop de cruauté ;
Et, plaignant les malheurs attachés à l’empire,
« Je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas écrire2422. »
Non, ou vous me croirez, ou bien de ce malheur
Ma mort m’épargnera la vue et la douleur ;
On ne me verra point survivre à votre gloire.
Si vous allez commettre une action si noire,
(Se jetant aux pieds de Néron.)
Me voilà prêt, seigneur : avant que de partir.
Faites percer ce cœur qui n’y peut consentir.
(Britannicus, acte III, sc. iv.)
Les projets de Mithridate2423 §
Approchez, mes enfants. Enfin l’heure est venue
Qu’il faut que mon secret éclate à votre vue.
A mes nobles projets je vois tout conspirer ;
Il ne me reste plus qu’à vous les déclarer.
Je fuis : ainsi le veut la fortune ennemie.
Mais vous savez trop bien l’histoire de ma vie
Pour croire que longtemps, soigneux de me cacher,
J’attende en ces déserts qu’on me vienne chercher.
La guerre a ses faveurs, ainsi que ses disgrâces.
Déjà plus d’une fois, retournant sur mes traces,
Tandis que l’ennemi, par ma fuite trompé,
Tenait après son char un vain peuple occupé2424,
Et gravant en airain2425 ses frêles avantages,
De mes États conquis enchaînait les images,
Le Bosphore m’a vu, par de nouveaux apprêts,
Ramener la terreur du fond de ses marais,
Et chassant les Romains de l’Asie étonnée,
Renverser en un jour l’ouvrage d’une année.
D’autres temps, d’autres soins. L’Orient accablé
Ne peut plus soutenir leur effort redoublé.
Il voit plus que jamais ses campagnes couvertes
De Romains que la guerre enrichit de nos pertes
Des biens des nations ravisseurs altérés,
Le bruit de nos trésors les a tous attirés :
Ils y courent en foule ; et jaloux l’un de l’autre,
Désertent leur pays pour inonder le nôtre.
Moi seul je leur résiste. Ou lassés, ou soumis,
Ma funeste amitié pèse à tous mes amis :
Chacun à ce fardeau veut dérober sa tête.
Le grand nom de Pompée assure sa conquête2426 ;
C’est l’effroi de l’Asie ; et loin de l’y chercher,
C’est à Rome, mes fils, que je prétends marcher.
Ce dessein vous surprend ; et vous croyez peut-être
Que le seul désespoir aujourd’hui le fait naître.
J’excuse votre erreur ; et pour être approuvés,
De semblables projets veulent être achevés.
Ne vous figurez point que de cette contrée
Par d’éternels remparts Rome soit séparée.
Je sais tous les chemins par où je dois passer ;
Et si la mort bientôt ne me vient traverser,
Sans reculer plus loin l’effet2427 de ma parole,
Je vous rends dans trois mois au pied du Capitole.
Doutez-vous que l’Euxin ne me porte en deux jours
Aux lieux où le Danube y vient finir son cours ?
Que du Scythe avec moi l’alliance jurée
De l’Europe en ces lieux ne me livre l’entrée ?
Recueilli2428 dans leurs ports, accru de leurs soldats,
Nous verrons notre camp grossir à chaque pas.
Daces, Pannoniens2429, la fière Germanie,
Tous n’attendent qu’un chef contre la tyrannie.
Vous avez vu l’Espagne2430, et surtout les Gaulois,
Contre ces mêmes murs qu’ils ont pris autrefois
Exciter ma vengeance, et jusque dans la Grèce,
Par des ambassadeurs accuser ma paresse.
Ils savent que sur eux prêt à se déborder2431,
Ce torrent, s’il m’entraîne, ira tout inonder ;
Et vous les verrez tous, prévenant son ravage,
Guider dans l’Italie et suivre mon passage.
C’est là qu’en arrivant, plus qu’en tout le chemin,
Vous trouverez partout l’horreur du nom romain,
Et la triste Italie encor toute fumante
Des feux qu’a rallumés sa liberté mourante2432.
Non, Princes, ce n’est point au bout de l’univers
Que Rome fait sentir tout le poids de ses fers ;
Et de près inspirant les haines les plus fortes,
Tes plus grands ennemis, Rome, sont à tes portes.
Ah ! s’ils ont pu choisir pour leur libérateur
Spartacus2433, un esclave, un vil gladiateur,
S’ils suivent au combat des brigands qui les vengent,
De quelle noble ardeur pensez-vous qu’ils se rangent
Sous les drapeaux d’un roi longtemps victorieux,
Qui voit jusqu’à Cyrus remonter ses aïeux2434 ?
Que dis-je ? En quel état croyez-vous la surprendre ?
Vide2435 de légions qui la puissent défendre,
Tandis que tout s’occupe à me persécuter,
Leurs femmes, leurs enfants pourront-ils m’arrêter ?
Marchons ; et dans son sein rejetons cette guerre
Que sa fureur envoie aux deux bouts de la terre.
Attaquons dans leurs murs ces conquérants si fiers ;
Qu’ils tremblent, à leur tour, pour leurs propres foyers2436.
Annibal l’a prédit, croyons-en ce grand homme,
Jamais on ne vaincra les Romains que dans Rome2437.
Noyons-la dans son sang justement répandu.
Brûlons ce Capitole où j’étais attendu2438,
Détruisons ses honneurs, et faisons disparaître
La honte de cent rois, et la mienne peut-être ;
Et la flamme à la main effaçons tous ces noms
Que Rome y consacrait à d’éternels affronts.
Voilà l’ambition dont mon âme est saisie.
Ne croyez point pourtant qu’éloigné de l’Asie
J’en laisse les Romains tranquilles possesseurs.
Je sais où je lui dois trouver des défenseurs.
Je veux que d’ennemis partout enveloppée,
Rome rappelle en vain le secours de Pompée.
Le Parthe, des Romains comme moi la terreur,
Consent de succéder à2439 ma juste fureur ;
Prêt d’unir avec moi sa haine et sa famille,
Il me demande un fils pour époux à sa fille.
Cet honneur vous regarde, et j’ai fait choix de vous,
Pharnace : allez, soyez ce bienheureux époux.
Demain, sans différer, je prétends que l’Aurore
Découvre mes vaisseaux déjà loin du Bosphore.
Vous que rien n’y retient, partez dès ce moment,
Et méritez mon choix par votre empressement.
Achevez cet hymen ; et repassant l’Euphrate2440,
Faites voir à l’Asie un autre Mithridate.
Que nos tyrans communs en pâlissent d’effroi,
Et que le bruit à Rome en vienne jusqu’à moi.
(Mithridate, acte III, sc. i.)
Regnard
(1655-1709) §
Né à Paris en 1655, mort en 1709, Jean-François Regnard parcourut la moitié de l’Europe de 1675 à 1683, et fut même quelque temps esclave à Alger. Il a laissé, outre le récit de ses voyages et des poésies diverses, des comédies bien moins profondes que celles de Molière, mais pleines de mouvement et de gaieté ; les principales sont le Joueur (1696), le Distrait (1697), les Folies amoureuses (1704) et le Légataire universel (1708).
Le Joueur §
Hector2441.
Le voici. Ses malheurs sur sont front sont écrits ;
Il a tout le visage et l’air d’un premier pris2442 !
Valère.
Non, l’enfer en courroux et toutes ses furies
N’ont jamais exercé de telles barbaries.
Je te loue, ô destin, de tes coups redoublés2443 !
Je n’ai plus rien à perdre et tes vœux sont comblés.
Pour assouvir encor la fureur qui t’anime,
Tu ne peux rien sur moi : cherche une autre victime.
hector, à part.
Il est sec2444.
Valère.
De serpents mon cœur est dévoré :
Tout semble en un moment contre moi conjuré.
(Il prend Hector à la cravate.)
Parle. As-tu jamais vu le sort et son caprice
Accabler un mortel avec plus d’injustice,
Le mieux assassiner ? Perdre tous les partis2445.
Vingt fois le coupe-gorge2446, et toujours premier pris !
Réponds-moi donc, bourreau !
Hector.
Mais ce n’est pas ma faute.
Valère.
As-tu vu, de tes jours, trahison aussi haute ?
Sort cruel, ta malice a bien su triompher,
Et tu ne me flattais que pour mieux m’étouffer2447 !
Dans l’état où je suis, je puis tout entreprendre ;
Confus, désespéré, je suis prêt à me pendre.
Hector.
Heureusement pour vous, vous n’avez pas un sou
Dont vous puissiez, monsieur, acheter un licou.
Voudriez-vous souper ?
Valère.
Que la foudre t’écrase !
Ah ! charmante Angélique, en l’ardeur qui m’embrase,
À vos seules bontés je veux avoir recours :
Je n’aimerai que vous ; m’aimeriez-vous toujours ?
Mon cœur, dans les transports de sa fureur extrême,
N’est point si malheureux, puisque enfin il vous aime2448.
hector, à part.
Notre bourse est à fond, et, par un sort nouveau,
Notre amour recommence à revenir sur l’eau.
Valère.
Calmons le désespoir où la fureur me livre.
Approche ce fauteuil.
(Hector approche un fauteuil.)
Va me chercher un livre.
Hector.
Quel livre voulez-vous lire en votre chagrin ?
Valère.
Celui qui te viendra le premier sous la main ;
Il m’importe peu : prends dans ma bibliothèque.
hector sort, et rentre tenant un livre.
Voilà Sénèque2449.
Valère.
Lis.
Hector.
Que je lise Sénèque ?
Valère.
Oui. Ne sais-tu pas lire ?
Hector.
Hé ! vous n’y pensez pas :
Je n’ai lu, de mes jours, que dans des almanachs.
Valère.
Ouvre et lis au hasard.
Hector.
Je vais le mettre en pièces.
Valère.
Lis donc.
Hector lit.
« Chapitre six. Du mépris des richesses.
« La fortune offre aux yeux des brillants mensongers ;
« Tous les biens d’ici-bas sont faux et passagers ;
« Leur possession trouble, et leur perte est légère :
« Le sage gagne assez lorsqu’il peut s’en défaire. »
Lorsque Sénèque fit ce chapitre éloquent,
Il avait comme vous perdu tout son argent....
Valère.
De mon sort désormais2450 vous serez seule arbitre,
Adorable Angélique !… Achève ton chapitre.
Hector.
« Que faut-il… »
Valère.
Je bénis le sort et ses revers,
Puisque un heureux malheur me rengage en vos fers.
Finis donc.
Hector.
« Que faut-il à la nature humaine ?
« Moins on a de richesse, et moins on a de peine.
« C’est posséder les biens que savoir s’en passer. »
Que ce mot est bien dit ! et que c’est bien penser !
Ce Sénèque, monsieur, est un excellent homme.
Etait-il de Paris ?
Valère.
Non, il était de Rome2451.
Dix fois à carte triple2452 être pris le premier !
Hector.
Ah ! monsieur, nous mourrons un jour sur un fumier.
Valère.
Il faut que de ces maux enfin je me délivre ;
J’ai cent moyens tout prêts pour m’empêcher de vivre,
La rivière, le feu, le poison et le fer.
Hector.
Si vous vouliez, monsieur, chanter un petit air ?
Votre maître h chanter est ici : la musique
Peut-être calmerait cette humeur frénétique.
Valère.
Que je chante !
Hector.
Monsieur....
Valère.
Que je chante, bourreau !
Je veux me poignarder ; la vie est un fardeau,
Qui pour moi désormais devient insupportable.
Hector.
Vous la trouviez pourtant tantôt bien agréable :
Qu’un joueur est heureux ! sa poche est un trésor,
Sous ses heureuses mains le cuivre devient or,
Disiez-vous2453.
Valère
Ah ! Je sens redoubler ma colère.
Hector.
Monsieur, contraignez-vous : j’aperçois votre père.
(Le Joueurt acte IV, sc. xiii.)
A mauvais maitre, servante rusée §
Lisette.
Comment ici, monsieur, voulez-vous qu’on repose ?
Chez vous toute la nuit, on n’entend autre chose
Qu’aller, venir, monter, fermer, descendre, ouvrir,
Crier, tousser, cracher, éternuer, courir.
Lorsque, par grand hasard, quelquefois je sommeille,
Un bruit affreux de clés en sursaut me réveille.
Je veux me rendormir, mais point : un juif errant2454,
Qui fait du mal d’autrui son plaisir le plus grand,
Un lutin2455, que l’enfer a vomi sur la terre
Pour faire aux gens dormants une éternelle guerre,
Commence son vacarme, et nous lutine tous.
Albert.
Et quel est ce lutin et ce juif errant ?
Lisette.
Vous.
Albert.
Moi ?
Lisette.
Oui, vous. Je croyais que ces brusques manières
Venaient de quelque esprit2456 qui voulait des prières ;
Et, pour mieux m’éclaircir, dans ce fâcheux état,
Si c’était âme ou corps qui faisait ce sabbat2457,
Je mis, un certain soir, à travers la montée2458.
Une corde aux deux bouts fortement arrêtée :
Cela fit tout l’effet que j’avais espéré.
Sitôt que pour dormir chacun fut retiré,
En personne d’esprit, sans bruit et sans chandelle,
J’allai dans certain coin me mettre en sentinelle :
Je n’y fus pas longtemps, qu’aussitôt patatras !
Avec un fort grand bruit, voilà l’esprit à bas :
Ses deux jambes à faux dans la corde arrêtées
Lui font, avec le nez, mesurer les montées.
Soudain j’entends crier : « A l’aide ! je suis mort ! »
A ces cris redoublés, et dont je riais fort,
J’accours et je vous vois étendu sur la place,
Avec une apostrophe2459 au milieu de la face ;
Et votre nez cassé me fit voir par écrit
Que vous étiez un corps et non pas un esprit.
Albert.
Ah, malheureuse engeance ! apanage du diable2460 !
C’est toi qui m’as joué ce tour abominable :
Tu voulais me tuer avec ce trait maudit ?
Lisette.
Non : c’était seulement pour attraper l’esprit.
Albert.
Je ne sais maintenant qui retient mon courage,
Que, de vingt coups de poing au milieu du visage…
Qu’on sorte de ce pas.
Lisette, feignant de pleurer.
Juste ciel ! quel arrêt !
Monsieur.
Albert.
Non ; dénichons au plus tôt, s’il vous plaît.
lisette, riant.
Ah ! par ma foi, vous nous la donnez bonne2461,
De croire qu’en quittant votre triste personne.
Le moindre déplaisir puisse saisir mon cœur.
Un écolier qui sort d’avec son précepteur,
Un héritier qui voit un oncle rendre l’âme,
Un époux, quand il suit le convoi de sa femme2462.
N’ont pas le demi-quart tant de plaisir que j’ai
En recevant de vous ce bienheureux congé.
Albert.
De sortir de chez moi tu peux être ravie ?
Lisette.
C’est le plus grand plaisir que j ’aurai de ma vie.
Albert.
Oui ! puisqu’il est ainsi, je change de désir,
Et je ne prétends pas te donner ce plaisir :
Tu resteras ici pour faire pénitence.
Allons ! sans raisonner, qu’on rentre en diligence.
(Les Folies amoureuses, acte I, sc. ii.)
J.-B. Rousseau
(1670-1741) §
Né en 1670, à Paris, Jean-Baptiste Rousseau, qui a laissé de médiocres comédies, des allégories, des épîtres et d’assez bonnes épigrammes, a dû surtout à ses œuvres lyriques, odes et cantates, une renommée qui ne s’est pas soutenue ; il manque en effet de sincérité, d’originalité et de chaleur ; mais, de Malherbe à André Chénier, nul n’a mieux manié les différents rythmes de la versification française classique. Sa vanité et son humeur satirique et mordante avaient attiré bien des ennemis à Rousseau, qui, à la suite d’un procès en diffamation, fut condamné à l’exil (1712) ; il mourut à Bruxelles (1741).
Sur l’aveuglement des hommes2463 §
Qu’aux accents de ma voix la terre se réveille !
Rois, soyez attentifs ; peuples, ouvrez l’oreille2464 !
Que l’univers se taise, et m’écoute parler.
Mes chants vont seconder les accords de ma lyre :
L’Esprit saint me pénètre, il m’échauffe, il m’inspire
Les grandes vérités que je vais révéler.
L’homme en sa propre force a mis sa confiance ;
Ivre2465 de ses grandeurs et de son opulence,
L’éclat de sa fortune enfle sa vanité ;
Mais, ô moment terrible, ô jour épouvantable,
Où la mort saisira ce fortuné coupable,
Tout chargé des liens de son iniquité !
Que deviendront alors, répondez, grands du monde,
Que deviendront ces biens où2466 votre espoir se fonde,
Et dont vous étalez l’orgueilleuse moisson ?
Sujets, amis, parents, tout deviendra stérile ;
Et, dans ce jour fatal, l’homme à l’homme inutile
Ne paiera point à Dieu le prix de sa rançon.
Vous avez vu tomber les plus illustres têtes ;
Et vous pourriez encore, insensés que vous êtes,
Ignorer le tribut que l’on doit à la mort !
Non, non, tout doit franchir ce terrible passage.
Le riche et l’indigent, l’imprudent et le sage,
Sujets à même loi, subissent même sort.
D’avides étrangers, transportés d’allégresse,
Engloutissent déjà toute cette richesse,
Ces terres, ces palais, de vos noms ennoblis.
Et que vous reste-t-il en ces moments suprêmes ?
Un sépulcre funèbre, où vos noms, où vous-mêmes
Dans l’éternelle nuit serez ensevelis.
Les hommes éblouis de leurs honneurs frivoles,
Et de leurs vains flatteurs écoutant les paroles,
Ont de ces vérités perdu le souvenir.
Pareils aux animaux farouches et stupides,
Les lois de leur instinct sont leurs uniques guides,
Et pour eux le présent paraît sans avenir.
Un précipice affreux devant eux se présente ;
Mais toujours leur raison, soumise et complaisante,
Au devant de leurs yeux met un voile imposteur.
Sous leurs pas cependant s’ouvrent les noirs abîmes
Où la cruelle mort, les prenant pour victimes,
Frappe ces vils troupeaux dont elle est le pasteur.
Là s’anéantiront ces titres magnifiques2467,
Ces pouvoirs usurpés, ces ressorts politiques2468,
Dont le juste autrefois sentit le poids fatal :
Ce qui fit leur bonheur deviendra leur torture ;
Et Dieu, de sa justice apaisant le murmure,
Livrera ces méchants au pouvoir infernal.
Justes, ne craignez point le vain pouvoir des hommes.
Quelque élevés qu’ils soient, ils sont ce que nous sommes2469,
Si vous êtes mortels, ils le sont comme vous.
Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères,
Il faut mêler sa cendre aux cendres de ses pères,
Et c’est le même Dieu qui nous jugera tous.
(Odes, livre I, ode iii.)
Louis Racine
(1692-1763) §
Né à Paris en 1692, mort en 1763, Louis Racine, le dernier des fils du grand poète, mérite de ne pas être tout à fait oublié. Il a laissé deux poèmes d’inspiration janséniste2470, la Grâce, en quatre chants, et la Religion, en six, « ouvrage, dit Voltaire, qui estimait l’auteur, trop didactique et trop monotone, mais rempli de beaux détails ». Il a encore publié des poésies diverses, quelques opuscules en prose, des Mémoires sur la vie de Jean Racine et une traduction de ce Paradis perdu de Milton que son père et Boileau n’avaient pas connu et qui commençait à trouver en France un public pour l’admirer2471.
L’existence de dieu prouvée par les merveilles de la nature §
Oui, c’est un Dieu caché2472 que le Dieu qu’il faut croire2473 ;
Mais, tout caché qu’il est, pour révéler sa gloire
Quels témoins éclatants devant moi rassemblés !
Répondez, cieux et mers ; et vous, terre, parlez.
Quel bras peut vous suspendre, innombrables étoiles ?
Nuit brillante, dis-nous qui t’a donné tes voiles ?
O cieux, que de grandeur, et quelle majesté !
J’y reconnais un maître à qui rien n’a coûté,
Et qui dans nos déserts a semé la lumière2474,
Ainsi que dans nos champs il sème la poussière.
Toi qu’annonce l’aurore, admirable flambeau,
Astre toujours le même, astre toujours nouveau,
Par quel ordre, ô soleil, viens-tu, du sein de l’onde,
Nous rendre les rayons de la clarté féconde ?
Tous les jours je t’attends, tu reviens tous les jours :
Est-ce moi qui t’appelle et qui règle ton cours ?
Et toi dont le courroux veut engloutir la terre,
Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre ?
Pour forcer ta prison tu fais de vains efforts :
La rage de tes flots expire sur tes bords2475...
La voix de l’univers à ce Dieu me rappelle2476;
La terre le publie : « Est-ce moi, me dit-elle,
Est-ce moi qui produis mes riches ornements ?
C’est celui dont la main posa mes fondements.
Si je sers tes besoins, c’est lui qui me l’ordonne ;
Les présents qu’il me fait, c’est à toi qu’il les donne ;
Je me pare des fleurs qui tombent de sa main ;
Il ne fait que l’ouvrir, et m’en remplit le sein. »
(La Religion, chant Ier.)
Voltaire
(1694-1778) §
Pour la notice, voir page 178.
Discours de potier de Blancménil aux états généraux tenus par la ligue à Paris2477 §
« Vous destinez, dit-il, Mayenne2478 au rang suprême :
Je conçois votre erreur, je l’excuse moi-même,
Mayenne a des vertus qu’on ne peut trop chérir ;
Et je le choisirais si je pouvait choisir.
Mais nous avons nos lois, et ce héros insigne,
S’il prétend à l’empire, en est dès lors indigne. »
Comme il disait ces mots, Mayenne entre soudain
Avec tout l’appareil qui suit un souverain.
Potier le voit entrer sans changer de visage :
« Oui, prince, poursuit-il d’un ton plein de courage,
Je vous estime assez pour oser contre vous
Vous adresser ma voix pour la France et pour nous.
En vain nous prétendons le droit2479 d’élire un maître :
La France a des Bourbons ; et Dieu vous a fait naître
Près de l’auguste rang qu’ils doivent occuper,
Pour soutenir leur trône, et non pour l’usurper.
Guise, du sein des morts, n’a plus rien à prétendre ;
Le sang d’un souverain2480 doit suffire à sa cendre :
S’il mourut par un crime, un crime l’a vengé.
Changez avec l’État, que le ciel a changé :
Périsse avec Valois votre juste colère !
Bourbon n’a point versé le sang de votre frère.
Le ciel, le juste ciel, qui vous chérit tous deux,
Pour vous rendre ennemis vous fit trop vertueux.
Mais j’entends le murmure et la clameur publique ;
J’entends ces noms affreux de relaps, d’hérétique :
Je vois d’un zèle faux nos prêtres emportés,
Qui, le fer à la main… Malheureux, arrêtez !
Quelle loi, quel exemple, ou plutôt quelle rage
Peut à l’oint du Seigneur2481 arracher votre hommage ?
Le fils de saint Louis, parjure à ses serments,
Vient-il de ses autels briser les fondements !
Aux pieds de nos autels, il demande à s’instruire ;
Il aime, il suit les lois dont vous bravez l’empire2482…
Comme un roi, comme un père, il vient vous gouverner ;
Et, plus chrétien que vous, il vient vous pardonner,
Tout est libre avec lui ; lui seul ne peut-il l’être ?
Quel droit vous a rendus juges de notre maître ?
Infidèles pasteurs, indignes citoyens,
Que vous ressemblez mal à ces premiers chrétiens,
Qui, bravant tous ces dieux de métal ou de plâtre,
Marchaient sans murmurer sous un maître idolâtre,
Expiraient sans se plaindre, et, sur les échafauds,
Sanglants, percés de coups, bénissaient leurs bourreaux2483 !
Eux seuls étaient chrétiens, je n’en connais point d’autres ;
Ils mouraient pour leurs rois, vous massacrez les vôtres :
Et Dieu, que vous peignez implacable et jaloux,
S’il aime à se venger, barbares, c’est de vous. »
(La Henriade, chant vi.)
Zaïre2484 §
Zaïre, Lusignan. §
Lusignan.
Je vous revois enfin, chère et triste famille,
Mon fils, digne héritier..., vous2485..., hélas ! vous, ma fille,
Dissipez mes soupçons, ôtez-moi cette horreur,
Ce trouble qui m’accable au comble du bonheur.
Toi qui seul as conduit sa fortune et la mienne,
Mon Dieu qui me la rends, me la rends-tu chrétienne ?
Tu pleures, malheureuse, et tu baisses les yeux !
Tu te tais ! je t’entends ! O crime ! O justes cieux !
Zaïre.
Je ne puis vous tromper : sous les lois d’Orosmane…
Punissez votre fille… elle était musulmane.
Lusignan.
Que la foudre en éclats ne tombe que sur moi !
Ah ! mon fils, à ces mots j’eusse expiré sans toi2486.
Mon Dieu ! j’ai combattu soixante ans pour ta gloire ;
J’ai vu tomber ton temple et périr ta mémoire ;
Dans un cachot affreux abandonné vingt ans,
Mes larmes t’imploraient pour mes tristes enfants :
Et lorsque ma famille est par toi réunie,
Quand je trouve une fille, elle est ton ennemie !
Je suis bien malheureux… C’est ton père, c’est moi,
C’est ma seule prison qui t’a ravi ta foi2487.
Ma fille, tendre objet de mes dernières peines,
Songe au moins, songe au sang qui coule dans tes veines ;
C’est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi ;
C’est le sang des héros, défenseurs de ma loi ;
C’est le sang des martyrs. O fille encore trop chère,
Connais-tu ton destin ? Sais-tu quelle est ta mère ?
Sais-tu bien qu’à l’instant que son flanc mit au jour
Ce triste et dernier fruit d’un malheureux amour,
Je la vis massacrer par la main forcenée,
Par la main des brigands à qui tu t’es donnée !
Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux,
T’ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieux ;
Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes,
Pour toi, pour l’univers, est mort en ces lieux mêmes2488,
En ces lieux où mon bras le servit tant de fois,
En ces lieux où son sang te parle par ma voix.
Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres :
Tout annonce le Dieu qu’ont vengé tes ancêtres.
Tourne les yeux : sa tombe est près de ce palais ;
C’est ici la montagne où, lavant nos forfaits,
Il voulut expirer sous les coups de l’impie ;
C’est là que de sa tombe il rappela sa vie :
Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu,
Tu n y peux faire un pas, sans y trouver ton Dieu ;
Et tu n’y peux rester sans renier ton père,
Ton honneur qui te parle, et ton Dieu qui t’éclaire.
Je te vois dans mes bras et pleurer et frémir ;
Sur ton front pâlissant Dieu met le repentir :
Je vois la vérité dans ton cœur descendue ;
Je retrouve ma fille après l’avoir perdue ;
Et je reprends ma gloire et ma félicité
En dérobant mon sang à l’infidélité.
(Zaïre, acte II, sc. iii.)
Mérope2489 §
Polyphonte, Mérope, Isménie, Égisthe. §
Polyphonte.
De cet égarement, sortirez-vous enfin ?
De votre fils, madame, est-ce ici l’assassin ?
mérobe.
Mon fils, de tant de rois le déplorable reste,
Mon fils, enveloppé dans un piège funeste,
Sous les coups d’un barbare....
Isménie.
O ciel ! que faites-vous2490 ?
Polyphonie.
Quoi ! vos regards sur lui se tournent sans courroux ?
Vous tremblez à sa vue, et vos yeux s’attendrissent ?
Vous voulez me cacher les pleurs qui les remplissent ?
Mérope.
Je ne les cache point, ils paraissent assez ;
La cause en est trop juste, et vous la connaissez2491.
Polyphonte.
Pour en tarir la source, il est temps qu’il expire.
Qu’on l’immole, soldats !
Mérope, s’avançant.
Cruel ! qu’osez-vous dire ?
Égisthe.
Quoi ! de pitié pour moi tous vos sens sont saisis !
Polyphonte.
Qu’il meure !
Mérope.
Il est....
Polyphonte.
Frappez.
Mérope, se jetant entre Égisthe et les soldats.
Barbare ! il est mon fils.
Égisthe.
Moi ! votre fils ?
Mérope, en l’embrassant.
Tu l’es : et ce ciel que j’atteste,
Ce ciel qui t’a formé dans un sein si funeste,
Et qui trop tard, hélas ! a dessillé mes veux.
Te remet dans mes bras pour nous perdre tous deux.
Égisthe.
Quel miracle, grands dieux, que je ne puis comprendre !
Polyphonte.
Une telle imposture a de quoi me surprendre !
Vous, sa mère ? Qui ? vous, qui demandiez sa mort ?
Égisthe.
Ah ! si je meurs son fils, je rends grâce à mon sort.
Mérope.
Je suis sa mère. Hélas ! mon amour m’a trahie.
Oui, tu tiens dans tes mains le secret de ma vie ;
Tu tiens le fils des dieux2492 enchaîné devant toi.
L’héritier de Cresphonte, et ton maître et ton roi...
Polyphonte.
Que prétendez-vous dire ? Et sur quelles alarmes... ?
Égisthe.
Va, je me crois son fils ; mes preuves sont ses larmes,
Mes sentiments, mon cœur par la gloire animé,
Mon bras, qui t’eût puni s’il n’était désarmé.
Polyphonte.
Ta rage auparavant sera seule punie.
C’est trop.
Mérope, se jetant à ses genoux.
Commencez donc par m’arracher la vie ;
Ayez pitié des pleurs dont mes yeux sont noyés.
Que vous faut-il de plus ? Mérope est à vos pieds ;
Mérope les embrasse, et craint votre colère.
A cet effort affreux jugez si je suis mère,
Jugez de mes tourments : ma détestable erreur,
Ce matin, de mon fils allait percer le cœur.
Je pleure à vos genoux mon crime involontaire.
Cruel ! vous qui vouliez lui tenir lieu de père2493,
Qui deviez protéger ses jours infortunés,
Le voilà devant vous, et vous l’assassinez !
Son père est mort, hélas ! par un crime funeste2494;
Sauvez le fils : je puis oublier tout le reste ;
Sauvez le sang des dieux et de vos souverains ;
Il est seul, sans défense, il est entre vos mains.
Qu’il vive, et c’est assez. Heureuse en mes misères,
Lui seul il me rendra mon époux et ses frères.
Vous voyez avec moi ses aïeux à genoux,
Votre roi dans les fers.
Égisthe.
O reine ! levez-vous
Et daignez me prouver que Cresphonte est mon père,
En cessant d’avilir et sa veuve et ma mère....
Ne faites rien d’indigne et de vous et de moi :
Si je suis votre fils, je sais mourir en roi.
(Mérope, acte IV, sc. ii.)
L’aigle et le serpent §
Tel on voit cet oiseau qui porte le tonnerre,
Blessé par un serpent élancé de la terre :
Il s’envola, il entraîne au séjour azuré
L’ennemi tortueux dont il est entouré.
Le sang tombe des airs. Il déchire et dévore
Le reptile acharné qui le combat encore ;
Il le perce ; il le tient sous ses ongles vainqueurs ;
Par cent coups redoublés il venge ses douleurs.
Le monstre, en expirant, se débat, se replie ;
Il exhale en poison les restes de sa vie,
Et l’aigle, tout sanglant, fier et victorieux,
Le rejette en fureur, et plane au haut des cieux2495.
(Préface de la tragédie de Catilina.)
Dénouement d’Alzire2496 §
Alvarez, Gusman, Zamore, Alzire, Montèze. §
Zamore.
Cruels, sauvez Alzire, et pressez mon supplice.
Alzire.
Non, qu’une affreuse mort tous trois2497 nous réunisse.
Alvarez.
Mon fils mourant, mon fils, ô comble de douleur !
Zamore, à Gusman.
Tu veux donc jusqu’au bout consommer ta fureur ?
Viens, vois couler mon sang, puisque ta vis encore :
Viens apprendre à mourir en regardant Zamore.
Gusman.
Il est d’autres vertus que je veux t’enseigner :
Je dois un autre exemple, et je viens le donner.
(A Alvarez.)
Le ciel, qui veut ma mort, et qui l’a suspendue,
Mon père, en ce moment m’amène à votre vue.
Mon âme fugitive, et prête à me quitter,
S’arrête devant vous,… mais pour vous imiter.
Je meurs ; le voile tombe, un nouveau jour m’éclaire ;
Je ne me suis connu qu’au bout de ma carrière.
J’ai fait, jusqu’au moment qui me plonge au cercueil,
Gémir l’humanité du poids de mon orgueil.
Le ciel venge la terre : il est juste ; et ma vie
Ne peut payer le sang dont ma main s’est rougie.
Le bonheur m’aveugla, la mort m’a détrompé :
Je pardonne à la main par qui Dieu m’a frappé.
J’étais maître en ces lieux ; seul j’y commande encore :
Seul je puis faire grâce, et la fais à Zamore.
Vis, superbe2498 ennemi, sois libre, et te souvien2499
Quel fut et le devoir et la mort d’un chrétien.
(A Montèze qui se jette à ses pieds.)
Montèze, Américains, qui fûtes mes victimes,
Songez que ma clémence a surpassé mes crimes.
Instruisez l’Amérique ; apprenez à ses rois
Que les chrétiens sont nés pour leur donner des lois.
(A Zamore.)
Des dieux que nous servons connais la différence :
Les tiens t’ont commandé le meurtre et la vengeance ;
Et le mien, quand ton bras vient de m’assassiner.
M’ordonne de te plaindre et de te pardonner2500.
Alvarez.
Ah ! mon fils, tes vertus égalent ton courage.
Alzire.
Quel changement, grand Dieu ! quel étonnant langage !
Zamore.
Quoi ! tu veux me forcer moi-même au repentir !
Gusman.
Je veux plus, je te veux forcer à me chérir.
Alzire n’a vécu que trop infortunée,
Et par mes cruautés, et par mon hyménée ;
Que ma mourante main la remette en tes bras :
Vivez sans me haïr, gouvernez vos États ;
Et, de vos murs détruits rétablissant la gloire,
De mon nom, s’il se peut, bénissez la mémoire.
(A Alvarez.)
Daignez servir de père à ces époux heureux :
Que du ciel, par vos soins, le jour luise sur eux !
Aux clartés des chrétiens si son âme est ouverte,
Zamore est votre fils, et répare ma perte.
Zamore.
Je demeure immobile, égaré, confondu.
Quoi donc ! les vrais chrétiens auraient tant de vertu !
Ah ! la loi qui t’oblige à cet effort suprême,
Je commence à le croire, est la loi d’un Dieu même.
J’ai connu l’amitié, la constance, la foi ;
Mais tant de grandeur d’âme est au-dessus de moi ;
Tant de vertu m’accable, et son charme m’attire.
Honteux d’être vengé, je t’aime et je t’admire.
(Il se jette à ses pieds.)
Alzire.
Seigneur, en rougissant, je tombe à vos genoux.
Alzire, en ce moment, voudrait mourir pour vous.
Entre Zamore et vous mon âme déchirée
Succombe au repentir dont elle est dévorée.
Je me sens trop coupable ; et mes tristes erreurs....
Gusman.
Tout vous est pardonné, puisque je vois vos pleurs.
Pour la dernière fois approchez-vous, mon père ;
Vivez longtemps heureux ; qu’Alzire vous soit chère !
Zamore, sois chrétien ; je suis content ; je meurs.
alvarez, à Montèze.
Je vois le doigt de Dieu marqué dans nos malheurs.
Mon cœur désespéré se soumet, s’abandonne
Aux volontés d’un Dieu qui frappe et qui pardonne.
(Alzire, ou les Américains, acte V, sc. vii)
La vie mondaine §
A Paris, au milieu du XVIIIe siècle2501, §
Après dîné2502, l’indolente Glycère
Sort pour sortir, sans avoir rien à faire ;
On a conduit son insipidité
Au fond d’un char2503, où montant de côté,
Son corps pressé gémit sous les barrières
D’un lourd panier2504 qui flotte aux deux portières2505.
Chez son amie au grand trot elle va,
Monte avec joie, et s’en repent déjà,
L’embrasse et bâille, et puis lui dit : « Madame,
J’apporte ici tout l’ennui de mon âme :
Joignez un peu votre inutilité
A ce fardeau de mon oisiveté. »
Si ce ne sont ses paroles expresses,
C’en est le sens. Quelques feintes caresses,
Quelques propos sur le jeu, sur le temps,
Sur un sermon, sur le prix des rubans
Ont épuisé leurs âmes excédées :
Elles chantaient déjà, faute d’idées,
Quand dans la chambre un fat en manteau noir,
Qui se rengorge et se lorgne au miroir,
Entre et se met à jaser, sûr de plaire.
Un officier arrive, et le fait taire,
Prend la parole, et conte longuement
Ce qu’à Plaisance2506 eût fait son régiment,
Si par malheur on n’eût pas fait retraite.
Il vous2507 le mène au col de la Boquette2508,
A Nice, au Var, à Digne2509 il le conduit ;
Nul ne l’écoute, et le cruel poursuit....
D’autres oiseaux de différent plumage,
Divers de goût, d’instinct et de ramage,
En sautillant, font entendre à la fois
Le gazouillis de leurs confuses voix ;
Et, dans les cris de la folle cohue,
La médisance est à peine entendue.
Ce chamaillis de cent propos croisés
Ressemble aux vents l’un à l’autre opposés.
Un profond calme, un stupide silence,
Succède au bruit de leur impertinence2510 ;
Chacun redoute un honnête entretien :
On veut penser et l’on ne pense rien.
O roi David2511, ô ressource assurée,
Viens ranimer leur langueur désœuvrée !
Grand roi David, c’est toi dont les sixains2512
Fixent l’esprit et le goût des humains2513,
Sur un tapis dès qu’on te voit paraître.
Noble, bourgeois, clerc, prélat, petit-maitre,
Femme surtout, chacun met son espoir
Dans tes cartons peints de rouge et de noir :
Leur âme vide est du moins amusée2514
Par l’avarice en plaisir déguisée2515.
De ces exploits le beau monde occupé
Quitte à la fin le jeu pour le soupé2516 ;
Chaque convive en liberté déploie
A son voisin son insipide joie....
Ciel ! quels propos ! Ce pédant du palais2517
Blâme la guerre et se plaint de la paix.
Ce vieux Crésus, en sablant2518 du champagne,
Gémit des maux que soutire la campagne,
Et, cousu d’or, dans le luxe plongé,
Plaint le pays de tailles2519 surchargé....
De froids bons mots, des équivoques fades,
Des quolibets et des turlupinades2520,
Un rire faux que l’on prend pour gaîté
Font le brillant de la société.
C’est donc ainsi, troupe absurde et frivole,
Que nous usons de ce temps qui s’envole ;
C’est donc ainsi que nous perdons des jours
Longs pour les sots, pour qui pense si courts !
(Épîtrelxxiv, à Mme Denis, nièce de l’auteur.)
Écouchard Le Brun
(1729-1807) §
Ponce-Denis Écouchard Le Brun, né à Paris en 1729, mort en 1807, fut appelé par ses contemporains, qui le considéraient comme un maître de la poésie lyrique, Le Brun-Pindare2521. Ses Odes sont cependant bien emphatiques et bien peu originales ; la postérité les a presque toutes oubliées, ainsi que ses Elégies, ses Epîtres et ses deux poèmes, l’un les Veillées du Parnasse, qui n’est guère constitué que par une série d’épisodes, l’autre la Nature, d’un dessein plus haut et plus intéressant ; mais parmi ses très nombreuses Epigrammes, quelques-unes peuvent passer pour des modèles du genre.
Sur le vaisseau « le vengeur2522 » §
Trahi par le sort infidèle,
Comme un lion pressé de nombreux léopards,
Seul au milieu de tous, sa fureur étincelle ;
Il les combat de toutes parts.
L’airain2523 lui déclare la guerre.
Le fer, fonde, la flamme entourent ses héros.
Sans doute, ils triomphaient ! mais leur dernier tonnerre
Vient de s’éteindre sous les flots.
Captifs !… la vie est un outrage !
Ils préfèrent le gouffre à ce bienfait honteux.
L’Anglais, en frémissant, admire leur courage !
Albion2524 pâlit devant eux.
Plus fiers d’une mort infaillible2525,
Sans peur, sans désespoir, calmes dans les combats,
De ces républicains l’âme n’est plus sensible
Qu’à l’ivresse d’un beau trépas.
Près de se voir réduits en poudre,
Ils défendent leurs bords enflammés et sanglants.
Voyez-les défier et la vague et la foudre
Sous des mâts rompus et brûlants.
Voyez ce drapeau tricolore,
Qu’élève en périssant leur courage indompté.
Sous le flot qui les couvre, entendez-vous encore
Ce cri : « Vive la liberté ! »
Ce cri !… c’est en vain qu’il expire,
Étouffé par la mort et par les flots jaloux ;
Sans cesse il revivra répété par ma lyre :
Siècles, il planera sur vous !
Et vous, héros de Salamine2526,
Dont Téthys vante encore les exploits glorieux,
Non, vous n’égalez pas cette auguste ruine,
Ce naufrage victorieux !
(Odes, livre IV, 23.)
Epigrammes §
I §
On vient de me voler. — Que je plains ton malheur !
— Tous mes vers manuscrits. — Que je plains le voleur !
II §
Églé, belle et poète, a deux petits travers :
Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers.
III §
Un malheureux au monde n’avait rien,
Hors un barbet, compagnon de misère,
Et qui mangeait le rien du pauvre hère2527.
Quelqu’un lui dit : « Que fais-tu de ce chien,
Toi qui n’as pas même le nécessaire ?
Plus à propos serait de t’en défaire. »
Le malheureux à ce mot soupira :
Delille
(1738-1813) §
Né en 1738 en Auvergne, mort en 1813, Jacques Delille s’acquit une grande réputation par sa traduction en vers des Géorgiques de Virgile (1769) et par ses poèmes didactiques, les Jardins (1782), l’Homme des champs (1800), la Pitié (1803), l’Imagination (1801), les Trois Règnes de la nature (1809), la Conversation (1812). C’était un poète ingénieux et spirituel, mais dont l’art a manqué de naturel et de variété ; un de ses procédés les plus fréquents et les plus justement décriés consiste à remplacer le mot propre et familier par une périphrase élégante et pompeuse ou subtile : il est vrai que presque tous les poètes de la fin du xviiie siècle et surtout les poètes descriptifs ont abusé, comme lui, de cette manière d’écrire.
L’automne §
Voyez les bois surtout lorsque la pâle automne2530,
Près de la voir flétrie, embellit sa couronne.
Que de variété ! que de pompe et d’éclat !
Le pourpre, l’oranger, l’opale, l’incarnat,
De leurs riches couleurs étalent l’abondance.
Hélas ! tout cet éclat marque leur décadence.
Tel est le sort commun. Bientôt les aquilons
Des dépouilles des bois vont joncher les vallons :
De moment en moment, la feuille sur la terre,
En tombant, interrompt le rêveur solitaire.
Mais ces ruines même ont pour moi des attraits.
Là, si mon cœur nourrit quelques profonds regrets,
Si quelque souvenir vient rouvrir ma blessure,
J’aime à mêler mon deuil au deuil de la nature2531.
De ces bois desséchés, de ces rameaux flétris,
Seul, errant, je me plais à fouler les débris.
Ils sont passés les jours d’ivresse et de folie !
Viens, je me livre à toi, tendre mélancolie ;
Viens, non le front chargé de nuages affreux,
Dont marche enveloppé le chagrin ténébreux,
Mais l’œil demi-voilé, mais telle qu’en automne
A travers des vapeurs un jour plus doux rayonne :
Viens, le regard pensif, le front calme, et les yeux
Tout prêts à s’humecter de pleurs délicieux.
(Les Jardins, chant II.)
Soirée d’hiver §
Le ciel devient-il sombre ? Eh bien ! dans ce salon,
Près d’un chêne brûlant j’insulte à l’aquilon ;
Dans cette chaude enceinte, avec goût éclairée,
Mille heureux passe-temps abrègent la soirée.
J’entends ce jeu bruyant où, le cornet en main,
L’adroit joueur calcule un hasard incertain2532.
Chacun sur le damier fixe d’un œil avide
Les cases, les couleurs, et le plein et le vide.
Les disques noirs et blancs volent du blanc au noir ;
Leur pile croît, décroît. Par la crainte et l’espoir
Battu, chassé, repris, de sa prison sonore2533
Le dé, non sans fracas, part, rentre, part encore ;
Il court, roule, s’abat : le nombre a prononcé.
Plus loin, dans ses calculs gravement enfoncé,
Un couple sérieux, qu’avec fureur possède
L’amour du jeu rêveur qu’inventa Palamède2534
Sur des carrés égaux, différents de couleur,
Combattant sans danger, mais non pas sans chaleur,
Par cent détours savants conduit à la victoire
Ses bataillons d’ébène et ses soldats d’ivoire.
Longtemps des camps rivaux le succès est égal ;
Enfin l’heureux vainqueur donne l’échec2535 fatal,
Se lève, et du vaincu proclame la défaite ;
L’autre reste atterré dans sa douleur muette,
Et, du terrible mat à regret convaincu,
Regarde encor longtemps le coup qui l’a vaincu.
Ailleurs c’est le piquet des graves douairières,
Le loto du grand oncle et le whist des grands-pères.
Là, sur un tapis vert, un essaim étourdi
Pousse contre l’ivoire un ivoire arrondi2536...,
Mais le souper2537 s’annonce, et l’heure de la table
Réunit tous les cœurs : un flacon délectable
Verse avec son nectar les aimables propos,
Et, comme son bouchon, fait partir les bons mots.
On se lève, on reprend sa lecture ordinaire.
On relit tout Racine, on choisit dans Voltaire.
Tantôt un bon roman charme le coin du feu ;
Hélas ! et quelquefois un bel esprit du lieu
Tire un traître papier ; il lit, l’ennui circule :
L’un admire en bâillant l’assommant opuscule,
Et d’un sommeil bien franc l’autre dormant tout haut,
Aux battements de mains se réveille en sursaut.
On rit ; on se remet de la triste lecture.
On tourne un madrigal, on conte une aventure ;
Le lendemain promet des plaisirs non moins doux,
Et la gaieté revient exacte au rendez-vous.
(L’Homme des champs, chant I.)
Gilbert
(1751-1780) §
Né en 1751 en Lorraine, mort en 4780, Gilbert a peu produit dans sa vie si courte2538; mais ses deux satires, le Dix-Huitième siècle (1775) et Mon Apologie (1778), encore que déclamatoires, et surtout son Ode imitée de plusieurs psaumes sont demeurées célèbres.
Ode imitée de plusieurs psaumes2539 §
J’ai révélé mon cœur au Dieu de l’innocence ;
Il a vu mes pleurs pénitents ;
Il guérit mes remords, il m’arme de constance2540 :
Les malheureux sont ses enfants.
Mes ennemis riant ont dit dans leur colère :
« Qu’il meure, et sa gloire avec lui ! »
Mais à mon cœur calmé le Seigneur dit en père :
« Leur haine sera ton appui.
À tes plus chers amis ils ont prêté leur rage ;
Tout trompe ta simplicité ;
Celui que tu nourris court vendre ton image,
Noire de sa méchanceté2541.
Mais Dieu t’entend gémir, Dieu, vers qui te ramène
Un vrai remords, né des douleurs ;
Dieu, qui pardonne enfin à la nature humaine
D’être faible dans les malheurs.
J’éveillerai pour toi la pitié, la justice
De l’incorruptible avenir.
Eux-mêmes épureront, par leur long artifice,
Ton honneur, qu’ils pensent ternir2542. »
Soyez béni, mon Dieu, vous qui daignez me rendre
L’innocence et son noble orgueil ;
Vous qui, pour protéger le repos de ma cendre,
Veillerez près de mon cercueil.
Au banquet de la vie, infortuné convive,
J’apparus un jour, et je meurs ;
Je meurs, et sur la tombe où lentement j’arrive
Nul ne viendra verser des pleurs.
Salut, champs que j’aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exil des bois !
Ciel, pavillon de l’homme, admirable nature,
Salut pour la dernière fois2543 !
Ah ! puissent voir longtemps votre beauté sacrée
Tant d’amis sourds à mes adieux !
Qu’ils meurent pleins de jours ! que leur mort soit pleurée !
Qu’un ami leur ferme les yeux !
Florian
(1755-1794) §
Né à Sauve2544, en Languedoc, en 1755, mort à Sceaux en 1794, Jean-Pierre Claris de Florian, qui fut page, officier, puis gentilhomme ordinaire du duc de Penthièvre2545, a écrit des romans pastoraux, Galatée, Estelle, des romans poétiques, Numa Pompilius, Gonzalve de Cordoue, de petites comédies, à la fois gaies et touchantes, dans lesquelles il renouvelle le type d’Arlequin, le valet bouffon de la comédie italienne, des contes en vers et en prose, des poésies diverses, enfin et surtout des Fables, dont la versification, le style et la composition laissent souvent à dire, mais qui sont pour la plupart délicates et touchantes ou finement satiriques.
L’hermine, le castor et le sanglier §
Une hermine2546, un castor, un jeune sanglier,
Cadets de leur famille, et partant2547 sans fortune,
Dans l’espoir d’en acquérir une,
Quittèrent leur foret, leur étang, leur hallier2548.
Après un long voyage, après mainte aventure,
Ils arrivent dans un pays
Où s’offrent à leurs yeux ravis
Tous les trésors de la nature,
Des prés, des eaux, des bois, des vergers pleins de fruits.
Nos pèlerins, voyant cette terre chérie,
Éprouvent les mêmes transports
Qu’Énée et ses Troyens en découvrant les bords
Du royaume de Lavinie2549.
Mais ce riche pays était de toutes parts
Entouré d’un marais de bourbe,
Où des serpents et des lézards
Se jouait l’effroyable tourbe.
Il fallait le passer, et nos trois voyageurs
S’arrêtent sur le bord, étonnés et rêveurs.
L’hermine la première avance un peu la patte ;
Elle la retire aussitôt ;
En arrière elle fait un saut,
En disant : « Mes amis, fuyons en toute hâte2550;
Ce lieu, tout beau qu’il est, ne peut nous convenir ;
Pour arriver là-bas il faudrait se salir ;
Et moi je suis si délicate,
Qu’une tache me fait mourir.
— Ma sœur, dit le castor, un peu de patience ;
On peut, sans se tacher, quelquefois réussir ;
Il faut alors du temps et de l’intelligence :
Nous avons tout cela. Pour moi, qui suis maçon,
Je vais en quinze jours vous bâtir un beau pont,
Sur lequel nous pourrons, sans craindre les morsures
De ces vilains serpents, sans gâter nos fourrures,
Arriver au milieu de ce charmant vallon.
— Quinze jours ! ce terme est bien long,
Répond le sanglier : moi, j’y serai plus vite ;
Vous allez voir comment. » En prononçant ces mots,
Le voilà qui se précipite
Au plus fort du bourbier, s’y plonge jusqu’au dos,
À travers les serpents, les lézards, les crapauds,
Marche, pousse à son but, arrive plein de boue ;
Et là, tandis qu’il se secoue,
Jetant à ses amis un regard de dédain :
« Apprenez, leur dit-il, comme on fait son chemin. »
(Fables, livre III, fable xiii.)
L’aveugle et le paralytique §
Aidons-nous mutuellement,
La charge des malheurs en sera plus légère ;
Le bien que l’on fait à son frère
Pour le mal que l’on souffre est un soulagement.
Confucius2551 l’a dit ; suivons tous sa doctrine.
Pour la persuader aux peuples de la Chine,
Il leur contait le irait suivant :
Dans une ville de l’Asie Il existait deux malheureux,
L’un perclus, l’autre aveugle, et pauvres tous les deux.
Ils demandaient au Ciel de terminer leur vie ;
Mais leurs vœux étaient superflus :
Ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique,
Couché sur un grabat, dans la place publique,
Souffrait sans être plaint : il en souffrait bien plus.
L’aveugle, à qui tout pouvait nuire,
Était sans guide, sans soutien,
Sans avoir même un pauvre chien
Pour l’aimer et pour le conduire.
Un certain jour il arriva
Que l’aveugle, à tâtons, au détour d’une rue,
Près du malade se trouva ;
Il entendit ses cris, son âme en fut émue ;
Il n’est tels que les malheureux
Pour se plaindre les uns les autres :
« J’ai mes maux, lui dit-il, et vous avez les vôtres ;
Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux.
— Hélas ! dit le perclus, vous ignorez, mon frère,
Que je ne puis faire un seul pas ;
Vous-même vous n’y voyez pas.
À quoi nous servirait d’unir notre misère ?
— A quoi ? répond l’aveugle ; écoutez : à nous deux
Nous possédons le bien à chacun nécessaire :
J’ai des jambes, et vous des yeux.
Moi, je vais vous porter ; vous, vous serez mon guide :
Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés ;
Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez.
Ainsi, sans que jamais notre amitié décide
Qui de nous deux remplit le plus utile emploi,
Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. »
(Fables, livre I, fable 20.)
Le singe qui montre la lanterne magique §
Messieurs les beaux esprits2552, dont la prose et les vers
Sont d’un style pompeux et toujours admirable,
Mais que l’on n’entend point2553, écoutez cette fable
Et tâchez de devenir clairs.
Un homme qui montrait la lanterne magique2554
Avait un singe, dont les tours
Attiraient chez lui grand concours2555.
Jacqueau, c’était son nom, sur la corde élastique
Dansait et voltigeait au mieux,
Puis faisait le saut périlleux,
Et puis sur un cordon, sans que rien le soutienne,
Le corps droit, fixe, d’aplomb,
Notre Jacqueau fait tout du long
L’exercice à la prussienne2556.
Un jour qu’au cabaret son maître était resté
(C’était, je pense, un jour de fête),
Notre singe en liberté
Veut faire un coup de sa tête :
Il s’en va rassembler les divers animaux
Qu’il peut rencontrer dans la ville :
Chiens, chats, poulets, dindons, pourceaux,
Arrivent bientôt à la file.
« Entrez, entrez, messieurs, criait notre Jacqueau ;
C’est ici, c’est ici qu’un spectacle nouveau
Vous charmera gratis. Oui, messieurs, à la porte
On ne prend point d’argent ; je fais tout pour l’honneur. »
A ces mots, chaque spectateur
Va se placer et l’on apporte
La lanterne magique ; on ferme les volets,
Et, par un discours fait exprès,
Jacqueau prépare l’auditoire.
Ce morceau vraiment oratoire
Fit bâiller ; mais on applaudit.
Content de son succès, notre singe saisit
Un verre peint qu’il met dans sa lanterne,
Il sait comment on le gouverne
Et crie en le poussant ; « Est-il rien de pareil ?
Messieurs, vous voyez le soleil,
Ses rayons et toute sa gloire.
Voici présentement la lune ; et puis l’histoire
D’Adam, d’Ève et des animaux.
Voyez, Messieurs, comme ils sont beaux !
Voyez la naissance du monde !
Voyez… » Les spectateurs, dans une nuit profonde,
Écarquillaient leurs yeux et ne pouvaient rien voir :
L’appartement, le mur, tout était noir.
« Ma foi, disait un chat de toutes les merveilles
Dont il étourdit nos oreilles,
Le fait est que je ne vois rien.
— Ni moi non plus, disait un chien.
— Moi, disait un dindon, je vois bien quelque chose,
Mais je ne sais pour quelle cause
Je ne distingue pas très bien. »
Pendant tous ces discours, le Cicéron2557 moderne
Parlait éloquemment et ne se lassait point.
Il n’avait oublié qu’un point ;
C’était d’éclairer sa lanterne !
(Fables, livre II, fable 7.)
Le voyage §
Partir avant le jour, à tâtons, sans voir goutte,
Sans songer seulement à demander sa route,
Aller de chute en chute, et, se traînant ainsi,
Faire un tiers de chemin jusqu’à près de midi ;
Voir sur sa tête alors amasser les nuages,
Dans un sable mouvant précipiter ses pas,
Courir en essuyant orages sur orages,
Vers un but incertain où l’on n’arrive pas ;
Détrompé vers le soir, chercher une retraite,
Arriver haletant, se coucher, s’endormir ;
On appelle cela naître, vivre et mourir :
La volonté de Dieu soit faite !
(Fables, livre IV, fable 21.)
Le lapin et la sarcelle §
Unis dès leurs jeunes ans
D’une amitié fraternelle,
Un lapin, une sarcelle
Vivaient heureux et contents.
Le terrier du lapin était sur la lisière
D’un parc bordé d’une rivière.
Soir et matin, nos bons amis,
Profitant de ce voisinage,
Tantôt au bord de l’eau, tantôt sous le feuillage,
L’un chez l’autre étaient réunis.
Là, prenant leurs repas, se contant des nouvelles,
Ils n’en trouvaient point de si belles
Que de se répéter qu’ils s’aimeraient toujours.
Ce sujet revenait sans cesse en leurs discours.
Tout était en commun, amour, chagrin, souffrance
Ce qui manquait à l’un, l’autre le regrettait ;
Si l’un avait du mal, son ami le sentait ;
Si d’un bien, au contraire, il goûtait l’espérance,
Tous deux en jouissaient d’avance.
Tel était leur destin, lorsqu’un jour, jour affreux !
Le lapin, pour dîner venant chez la sarcelle,
Ne la retrouve plus. Inquiet, il l’appelle :
Personne ne répond à ses cris douloureux.
Le lapin, de frayeur l’âme toute saisie,
Va, vient, fait mille tours, cherche dans les roseaux
S’incline par-dessus les flots,
Et voudrait s’y plonger pour trouver son amie.
« Hélas ! s’écriait-il, m’entends-tu ? réponds-moi,
Ma sœur, ma compagne chérie,
Ne prolonge pas mon effroi ;
Encor quelques moments, c’en est fait de ma vie :
J’aime mieux expirer que de trembler pour toi. »
Disant ces mots, il court, il pleure,
Et, s’avançant le long de l’eau,
Arrive enfin près du château
Où le seigneur du lieu demeure.
Là notre désolé lapin
Se trouve au milieu d’un parterre,
Et voit une grande volière,
Où mille oiseaux divers volaient sur un bassin.
L’amitié donne du courage :
Notre ami, sans rien craindre, approche du grillage,
Regarde, et reconnaît… (ô tendresse ! ô bonheur !)
La sarcelle. Aussitôt il pousse un cri de joie,
Et, sans perdre de temps à consoler sa sœur,
De ses quatre pieds il s’emploie
A creuser un secret chemin
Pour joindre son amie, et, par ce souterrain,
Le lapin tout à coup entre dans la volière
Comme un mineur qui prend une place de guerre.
Les oiseaux effrayés se pressent en fuyant.
Lui court à la sarcelle ; il l’entraîne à l’instant
Dans son obscur sentier, la conduit sous la terre,
Et, la rendant au jour, il est prêt à mourir
De plaisir.
Quel moment pour tous deux ! Que ne sais-je le peindra
Comme je saurais le sentir !
Nos bons amis croyaient n’avoir plus rien à craindre !
Ils n’étaient pas au bout. Le maître du jardin,
En voyant le dégât commis dans sa volière,
Jure d’exterminer jusqu’au dernier lapin :
« Mes fusils ! mes furets2558 ! » criait-il en colère.
Aussitôt fusils et furets Sont tout prêts.
Les gardes et les chiens vont dans les jeunes tailles,
Fouillant les terriers, les broussailles ;
Tout lapin qui paraît trouve un alfreux trépas :
Les rivages du Styx sont bordés de leurs mânes2559 :
Dans le funeste jour de Cannes2560
On mit moins de Romains à bas.
La nuit vient : tant de sang n’a point éteint la rage
Du seigneur, qui remet au lendemain matin
La fin de l’horrible carnage.
Pendant ce temps, notre lapin,
Tapi sous des roseaux auprès de la sarcelle,
Attendait, en tremblant, la mort,
Mais conjurait sa sœur de fuir à l’autre bord,
Pour ne pas mourir devant elle.
« Je ne te quitte point, lui répondait l’oiseau :
Nous séparer serait la mort la plus cruelle.
Ali ! si tu pouvais passer l’eau !
Pourquoi pas ? Attends-moi… » La sarcelle le quitte,
Et revient traînant un vieux nid
Laissé par des canards : elle l’emplit bien vite
De feuilles de roseaux, les presse, les unit
Des pieds, du bec ; en forme un batelet capable
De supporter un lourd fardeau ;
Puis elle attache à ce vaisseau
Un brin de jonc, qui servira de câble.
Cela fait, et le bâtiment
Mis à l’eau, le lapin entre tout doucement
Dans le léger esquif2561, s’assied sur son derrière,
Tandis que devant lui la sarcelle nageant
Tire le brin de jonc, et s’en va dirigeant
Cette nef à son cœur si chère.
On aborde, on débarque, et jugez du plaisir !
Non loin du port on va choisir
Un asile où, coulant des jours dignes d envie,
Nos bons amis, libres, heureux,
Aimèrent d’autant plus la vie,
Qu’ils se la devaient tous les deux.
(Fables, livre IV, fable 13.)
André Chénier
(1762-1794) §
Né à Constantinople en 1762 d’un père français et d’une mère grecque, André-Marie de Chénier, qui fut amené tout jeune en France et y fit de brillantes études, s’engagea d’abord, à vingt ans, dans un régiment, puis, devenu malade, quitta le service, et voyagea en Suisse et en Italie, revint en 1785 à Paris, où, sans rien publier, il sut faire apprécier son génie d’une société d’élite, et repartit pour Londres, comme secrétaire particulier de notre ambassadeur, en 1787. Il ne rentra définitivement à Paris qu’en 1791 ; mais dès 1789, dès le début de la Révolution, il s’était mêlé avec ardeur aux discussions politiques, et avait commencé à défendre, dans plusieurs journaux, les idées modérées et libérales, avec une verve et une éloquence passionnées. Arrêté le 17 ventôse an II (7 mars 1794) en vertu de la terrible loi des suspects, il fut traduit devant le Tribunal révolutionnaire, condamné à mort et exécuté le 7 thermidor (25 juillet). Il avait écrit, pendant sa captivité, quelques poésies politiques d’une extrême violence. Ses autres œuvres comprennent des pièces antiques, où l’on retrouve tout le charme vivant des plus délicates inventions du génie grec, des fragments de poèmes pastoraux, didactiques, épiques, dramatiques, des hymnes et des odes, des épîtres et des élégies. André Chénier, malgré son amour pour cette antiquité, qu’il a si souvent imitée, mais toujours d’une manière si originale, a été regardé, non sans raison, comme un précurseur par les poètes du xixe siècle, qui ont surtout goûté son vivant pittoresque et les hardiesses heureuses de sa versification, et il convient en effet de voir en lui non seulement le plus grand poète du xviiie siècle, mais l’un des plus grands poètes de la France2562.
La jeune Tarentine §
Pleurez, doux alcyons2563 ! ô vous, oiseaux sacrés,
Oiseaux chers à Téthys2564, doux alcyons, pleurez !
Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarenline !
Un vaisseau la portait aux bords de Camarine2565 !
Là, l’hymen, les chansons, les flûtes lentement
Devaient la reconduire au seuil de son amant.
Une clef vigilante a, pour cette journée,
Sous le cèdre2566 enfermé sa robe d’hyménée
Et l’or dont au festin ses bras seront parés,
Et pour ses blonds cheveux les parfums préparés.
Mais, seule sur la proue, invoquant les étoiles,
Le vent impétueux qui soufflait dans ses voiles
L’enveloppe : étonnée et loin des matelots,
Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots.
Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine !
Son beau corps a roulé sous la vague marine.
Téthys, les yeux en pleurs, dans le creux d’un rocher,
Aux monstres dévorants eut soin de le cacher.
Par son ordre bientôt les belles Néréides2567
S’élèvent au-dessus des demeures humides,
Le poussent au rivage, et dans ce monument2568
L’ont au cap du Zéphyr2569 déposé mollement ;
Et de loin, à grands cris appelant leurs compagnes,
Et les nymphes des bois, des sources, des montagnes,
Toutes, frappant leur sein et traînant un long deuil,
Répétèrent « hélas ! » autour de son cercueil :
« Hélas ! chez ton amant tu n’es point ramenée,
Tu n’as point revêtu la robe d’hyménée,
L’or autour de ton bras n’a point serré de nœuds,
Et le bandeau d’hymen n’orna point tes cheveux. »
(Bucoliques : Idylles marines, iv.)
A l’hirondelle §
Fille de Pandion2570 ô jeune Athénienne,
La cigale est ta proie, hirondelle inhumaine,
Et nourrit tes petits qui, débiles encor,
Nus, tremblants, dans les airs n’osent prendre l’essor.
Tu voles ; comme toi la cigale a des ailes.
Tu chantes ; elle chante. A vos chansons fidèles
Le moissonneur s’égaye, et l’automne orageux
En des climats lointains vous chasse toutes deux.
Oses-tu donc porter, dans ta cruelle joie,
A ton nid sans pitié cette innocente proie ?
Et faut-il voir périr un chanteur sans appui
Sous la morsure, hélas ! d’un chanteur comme lui ?
(Id., Détails et choses de la vie rustique, viii, 14.)
A la France §
France ! ô belle contrée, ô terre généreuse,
Que les dieux complaisants formaient pour être heureuse,
Tu ne sens point du Nord les glaçantes horreurs2571 ;
Le Midi de ses feux t’épargne les fureurs ;
Tes arbres innocents n’ont point d’ombres mortelles ;
Ni des poisons épars dans tes herbes nouvelles
Ne trompent une main crédule2572 ; ni tes bois
Des tigres frémissants ne redoutent la voix ;
Ni les vastes serpents ne traînent sur tes plantes,
En longs cercles hideux, leurs écailles sonnantes ;
Les chênes, les sapins et les ormes épais
En utiles rameaux ombragent tes sommets ;
Et de Beaune et d’Aï2573 les rives fortunées,
Et la riche Aquitaine, et les hauts Pyrénées2574
Sous leurs bruyants pressoirs font couler en ruisseaux
Des vins délicieux mûris sur leurs coteaux.
La Provence odorante, et de Zéphyre2575 aimée,
Respire sur les mers une haleine embaumée,
Au bord des flots couvrant, délicieux trésor,
L’orange et le citron de leur tunique d’or,
Et plus loin, au penchant des collines pierreuses,
Forme la grasse olive aux liqueurs savoureuses,
Et ces réseaux légers, diaphanes habits,
Où la fraîche grenade enferme ses rubis2576.
Sur tes rochers touffus, la chèvre se hérisse2577;
Tes prés enflent de lait la féconde génisse,
Et tu vois tes brebis, sur le jeune gazon,
Épaissir le tissu de leur blanche toison2578.
Dans les fertiles champs voisins de la Touraine,
Dans ceux où l’Océan boit l’urne de la Seine,
S’élèvent pour le frein des coursiers belliqueux.
Ajoutez cet amas de fleuves tortueux :
L’indomptable Garonne aux vagues insensées,
Le Rhône impétueux, fils des Alpes glacées,
La Seine au flot royal, la Loire dans son sein
Incertaine, et la Saône, et mille autres enfin
Qui nourrissent partout, sur tes nobles rivages,
Fleurs, moissons et vergers, et bois, et pâturages,
Rampent au pied des murs d’opulentes cités,
Sous les arches de pierre à grand bruit emportés2579.
(Hymnes, II.)
La liberté §
Le Chevrier.
Berger, quel es-tu donc ? qui t’agite ? et quels dieux
De noirs cheveux épars enveloppent tes yeux ?
Le Berger.
Blond pasteur de chevreaux, oui, tu veux me l’apprendre
Oui, ton front est plus beau2580, ton regard est plus tendre
Le Chevrier.
Quoi ! tu sors de ces monts où tu n’as vu que toi,
Et qu’on n’approche pas sans peine et sans effroi ?
Le Berger.
Tu te plais mieux sans doute aux bois, à la prairie ;
Tu le peux. Assieds-toi parmi l’herbe fleurie ;
Moi, sous un antre aride, en cet affreux séjour,
Je me plais sur le roc à voir passer le jour.
Le Chevrier.
Mais Cérès2581 a maudit cette terre âpre et dure ;
Un noir torrent pierreux y roule une onde impure ;
Tous ces rocs, calcinés sous un soleil rongeur,
Brûlent, et font hâter les pas du voyageur.
Point de fleurs, point de fruits, nul ombrage fertile
N’y donne au rossignol un balsamique2582 asile.
Quelque olivier au loin, maigre fécondité,
Y rampe, et fait mieux voir leur triste nudité.
Comment as-tu donc su d’herbes accoutumées.
Nourrir dans ce désert tes brebis affamées ?
Le Berger.
Que m’importe ? est-ce à moi qu’appartient ce troupeau
Je suis esclave.
Le Chevrier.
Au moins un rustique pipeau
A-t-il chassé l’ennui de ton rocher sauvage.
Tiens, veux-tu cette flûte ? Elle fut mon ouvrage ?
Prends ; sur ce huis fertile en agréables sons,
Tu pourras des oiseaux imiter les chansons.
Le Berger.
Non, garde tes présents. Les oiseaux des ténèbres,
La chouette et l’orfraie, et leurs accents funèbres,
Voilà les seuls chanteurs que je veuille écouter,
Voilà quelles chansons je voudrais imiter,
Ta flûte sous mes pieds serait bientôt brisée !
Je hais tous vos plaisirs. Les fleurs et la rosée,
Et de vos rossignols les soupirs caressants,
Bien ne plaît à mon cœur, rien ne flatte mes sens ;
Je suis esclave.
Le Chevrier.
Hélas ! que je te trouve à plaindre !
Oui, l’esclavage est dur : oui, tout mortel doit craindre
De servir, de plier sous une injuste loi,
De vivre pour autrui, de n’avoir rien à soi.
Protégez-moi toujours, ô Liberté chérie !
O mère des vertus, mère de la patrie !
Le Berger.
Va, patrie et vertu ne sont que de vains noms.
Toutefois, tes discours sont pour moi des affronts ;
Ton prétendu bonheur et m’afflige et me brave ;
Comme moi, je voudrais que tu fusses esclave.
Le Chevrier.
Et moi, je te voudrais libre, heureux comme moi2583,
Mais les dieux n’ont-ils point de remède pour toi ?
Il est des baumes doux, des lustrations2584 pures,
Qui peuvent de notre âme assoupir les blessures,
Et de magiques chants qui tarissent les pleurs.
Le Berger.
Il n’en est point ; il n’est pour moi que des douleurs.
Mon sort est de servir, il faut qu’il s’accomplisse.
Mais j’ai ce chien aussi qui tremble à mon service ;
C’est mon esclave aussi. Mon désespoir muet
Ne peut rendre qu’à lui tous les maux qu’on me fait.
Le Chevrier.
La terre, notre mère, et sa douce richesse,
Ne peut-elle du moins égayer ta tristesse ?
Vois combien elle est belle, et vois l’été vermeil,
Prodigue de trésors, brillants fils du soleil,
Qui vient, fertile amant d’une heureuse culture,
Varier du printemps l’uniforme verdure.
Vois l’abricot naissant, sous les yeux d’un beau ciel,
Arrondir son fruit doux et blond comme le miel ;
Vois la pourpre des fleurs dont le pécher se pare
Nous annoncer l’éclat des fruits qu’il nous prépare ;
Au bord de ces prés verts regarde ces guérets,
De qui les blés touffus, jaunissantes forêts,
Du joyeux moissonneur attendent la faucille.
D’agrestes déités quelle noble famille !
La Récolte et la Paix, aux yeux purs et sereins,
Les épis sur le front, les épis dans les mains,
Qui viennent, sur les pas de la belle Espérance,
Verser la corne d’or où fleurit l’abondance !
Le Berger.
Sans doute qu’à tes yeux elles montrent leurs pas.
Moi, j’ai des yeux d’esclave, et je ne les vois pas.
Je n’y vois qu’un sol dur, laborieux, servile,
Que j’ai, non pas pour moi, contraint d’être fertile ;
Où sous un ciel brûlant je moissonne le grain
Qui va nourrir un autre et me laisse ma faim.
Voilà quelle est la terre. Elle n’est point ma mère :
Elle est pour moi marâtre ; et la nature entière
Est plus nue à mes yeux, plus horrible à mon cœur,
Que ce vallon de mort qui te fait tant d’horreur.
Le Chevrier.
Le soin de tes brebis, leur voix douce et paisible
N’ont-ils donc rien qui plaise à ton âme insensible ?
N’aimes-tu point à voir les jeux de tes agneaux ?
Moi, je me plais auprès de mes jeunes chevreaux ;
Je m’occupe à leurs jeux, j’aime leur voix bêlante ;
Et quand sur la rosée et sur l’herbe brillante
Vers leur mère en criant je les vois accourir,
Je bondis avec eux de joie et de plaisir.
Ils sont à toi ; mais moi, j’eus une autre fortune !
Ceux-ci de mes tourments sont la cause importune.
Deux fois, avec ennui, promenés chaque jour,
Un maître soupçonneux nous attend au retour.
Rien ne le satisfait : ils ont trop peu de laine2585 ;
Ou bien ils sont mourants ; ils se traînent à peine ;
En un mot, tout est mal. Si le loup quelquefois
En saisit un, l’emporte, et s’enfuit dans les bois,
C’est ma faute ; il fallait braver ses dents avides.
Je dois rendre les loups innocents et timides.
Et puis, menaces, cris, injure, emportements
Et lâches cruautés qu’il nomme châtiments.
Le Chevrier.
Toujours à l’innocent les dieux sont favorables :
Pourquoi fuir leur présence, appui des misérables ?
Autour de leurs autels, parés de nos festons,
Que ne viens-tu danser, offrir de simples dons,
Du chaume, quelques fleurs, et, par ces sacrifices,
Te rendre Jupiter et les nymphes propices ?
Le Berger.
Non : les danses, les jeux, les plaisirs des bergers,
Sont à mon triste cœur des plaisirs étrangers.
Que parles-tu de dieux, de nymphes et d’offrandes ?
Moi, je n’ai pour les dieux, ni chaume ni guirlandes :
Je les crains, car j’ai vu leur foudre et leurs éclairs ;
Je ne les aime pas, ils m’ont donné des fers....
O juste Némésis2586 ! si jamais je puis être,
Le plus fort à mon tour, si je puis me voir maître,
Je serai dur, méchant, intraitable, sans foi,
Sanguinaire, cruel, comme on l’est avec moi.
Le Chevrier.
Et moi, c’est vous qu’ici pour témoin, j’en appelle,
Dieux ! de mes serviteurs la cohorte fidèle
Me trouvera toujours humain, compatissant,
A leurs justes désirs facile et complaisant,
Afin qu’ils soient heureux et qu’ils aiment leur maître,
Et bénissent en paix l’instant qui les vit naître.
Le Berger.
Et moi, je le maudis, cet instant douloureux
Qui me donna le jour pour être malheureux ;
Pour agir quand un autre exige, veut, ordonne ;
Pour n’avoir rien à moi, pour ne plaire à personne ;
Pour endurer la faim, quand ma peine et mon deuil
Engraissent d’un tyran l’insolence et l’orgueil.
Le Chevrier.
Berger infortuné ! ta plaintive détresse
De ton cœur dans le mien fait passer la tristesse.
Vois cette chèvre mère et ces chevreaux, tous deux
Aussi blancs que le lait qu’elle garde pour eux ;
Qu’ils aillent avec toi, je te les abandonne.
Adieu. Puisse du moins ce peu que je te donne
De ta triste mémoire effacer tes malheurs,
Et, soigné par tes mains, distraire tes douleurs !
Le Berger.
Oui, donne et sois maudit ; car, si j’étais plus sage,
Ces dons sont pour mon cœur d’un sinistre présage.
De mon despote avare ils choqueront les yeux,
Il ne croit pas qu’on donne ; il est fourbe, envieux ;
Il dira que chez lui j’ai volé le salaire
Dont j’aurai pu payer les chevreaux et la mère,
Et, d’un si beau prétexte ardent à se servir,
C’est à moi que lui-même il viendra les ravir.
(Bucoliques : Les esclaves et les mendiants, I.)
La jeune captive §
« L’épi naissant mûrit, de la faux respecté ;
Sans crainte du pressoir, le pampre, tout l’été,
Boit les doux présents de l’aurore :
Et moi, comme lui belle, et jeune comme lui,
Quoi que l’heure présente ait de trouble et d’ennui,
Je ne veux point mourir encore.
Qu’un stoïque2587 aux yeux secs vole embrasser la mort :
Moi, je pleure et j’espère ; au noir souffle du Nord
Je plie et relève ma tête.
S’il est des jours amers, il en est de si doux !
Hélas ! quel miel jamais n’a laissé de dégoûts ?
Quelle mer n’a point de tempête ?
L’illusion féconde habite dans mon sein.
D’une prison sur moi les murs pèsent en vain,
J’ai les ailes de l’espérance :
Échappée aux réseaux de^ l’oiseleur cruel,
Plus vive, plus heureuse, aux campagnes du ciel
Philomèle2588 chante et s’élance.
Est-ce à moi de mourir ? Tranquille je m’endors,
Et tranquille je veille, et ma veille aux remords
Ni mon sommeil ne sont en proie.
Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux ;
Sur des fronts abattus mon aspect, dans ces lieux2589,
Ranime presque de la joie.
Mon beau voyage encore est si loin de sa fin !
Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin
J’ai passé les premiers à peine.
Au banquet de la vie à peine commencé,
Un instant seulement mes lèvres ont pressé
La coupe en mes mains encor pleine.
Je ne suis qu’au printemps, je veux voir la moisson ;
Et, comme le soleil, de saison en saison,
Je veux achever mon année.
Brillante sur ma tige et l’honneur du jardin,
Je n’ai vu luire encore que les feux du matin :
Je veux achever ma journée.
O mort ! tu peux attendre ; éloigne, éloigne-toi !
Va consoler les cœurs que la honte, l’effroi,
Le pâle désespoir dévore.
Pour moi Palès2590 encore a des asiles verts,
Les Amours des baisers, les Muses des concerts.
Je ne veux pas mourir encore. »
Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S’éveillait, écoutant ces plaintes, cette voix,
Ces vœux d’une jeune captive ;
Et, secouant le faix de mes jours languissants,
Aux douces lois des vers je pliais les accents
De sa bouche aimable et naïve.
Ces chants, de ma prison témoins harmonieux,
Feront à quelque amant des loisirs studieux
Chercher quelle fut cette belle2591 :
La grâce décorait son front et ses discours,
Et, comme elle, craindront de voir finir leurs jours
Ceux qui les passeront près d’elle2592.
(Dernières Poésies.)
Béranger
(1780-1857) §
Né à Paris en 1780, mort en 1857, Jean-Pierre de Béranger, après s’être essayé sans succès dans divers genres, commença, vers 1802, à écrire des chansons, et peu à peu parvint à la célébrité et à la gloire. Ses recueils de 1815, de 1821, 1825, 1828, 1833 sont remarquables tout d’abord par l’extrême variété du ton des chansons qu’ils renferment. Mais celles qui eurent alors le plus de succès, ce sont les chansons politiques. Le parti libéral accueillit avec enthousiasme ces petites pièces qui, grâce à la musique, s’imposaient à toutes les mémoires. Aujourd’hui le style en semble souvent démodé ; il en reste cependant un grand nombre qui paraissent encore charmantes, tant la composition en est ingénieuse et le ton ému ou malicieux.
Le Roi d’Yvetot §
Il était un roi d’Yvetot2593
Peu connu dans l’histoire,
Se levant tard, se couchant tôt,
Dormant fort bien sans gloire,
Et couronné par Jeanneton2594
D’un simple bonnet de colon,
Dit-on
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.
Il faisait ses quatre repas
Dans son palais de chaume,
Et sur un âne, pas à pas,
Parcourait son royaume.
Joyeux, simple et croyant le bien,
Pour toute garde il n’avait rien
Qu’un chien.
Oh ! oh ! oh ! oh ! etc.
Il n’avait de goût onéreux
Qu’une soif un peu vive ;
Mais, en rendant son peuple heureux,
Il faut bien qu’un roi vive.
Lui-même à table et sans suppôt2595,
Sur chaque muid levait un pot2596
D’impôt.
Oh ! oh ! oh ! oh ! etc.
Il n’agrandit point ses États,
Fut un voisin commode,
Et, modèle des potentats,
Prit le plaisir pour code.
Ce n’est que lorsqu’il expira
Que le peuple qui l’enterra
Pleura.
Oh ! oh ! oh ! oh ! etc.
On conserve encor le portrait
De ce digne et bon prince ;
C’est l’enseigne d’un cabaret
Fameux dans la province.
Les jours de fête, bien souvent,
La foule s’écrie en buvant
Devant :
Oh ! oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah.
Quel bon petit roi c’était là !
La, la.
(Chansons.)
Mon habit §
Sois-moi fidèle, ô pauvre habit que j’aime !
Ensemble nous devenons vieux.
Depuis dix ans, je te brosse moi-même,
Et Socrate2597 n’eût pas fait mieux.
Quand le sort à ta mince étoffe
Livrerait de nouveaux combats,
Imite-moi, résiste en philosophe :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.
Je me souviens, car j’ai bonne mémoire,
Du premier jour où je te mis.
C’était ma fête, et, pour comble de gloire,
Tu fus chanté par mes amis.
Ton indigence, qui m’honore,
Ne m’a point banni de leurs bras.
Tous ils sont prêts à nous fêter encore :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas....
T’ai-je imprégné de flots de musc et d’ambre2598
Qu’un fat exhale en se mirant ?
M’a-t-on jamais vu dans une antichambre
T’exposer au mépris d’un grand ?
Pour des rubans2599, la France entière
Fut en proie à de longs débats.
La fleur des champs brille à ta boutonnière :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.
Ne crains plus tant ces jours de courses vaine
Où notre destin fut pareil :
Ces jours mêlés de plaisirs et de peines,
Mêlés de pluie et de soleil.
Je dois bientôt, il me le semble,
Mettre pour jamais habit bas2600.
Attends un peu ; nous finirons ensemble :
Mon vieil ami, ne nous séparons pas.
(Chansons.)
Lamartine
(1790-1869) §
Né à Mâcon en 1790, mort en 1869, Alphonse-Marie-Louis Prat de Lamartine conquit du premier coup la gloire par la publication des Premières Méditations poétiques, recueil aussi remarquable par la sincérité et l’élévation des sentiments qui en animent toutes les pièces, que par l’harmonieuse perfection des vers (1820). Les Nouvelles Méditations (1823) ne sont pas indignes des premières ; il y a peut-être quelque chose de plus profond et de plus pénétrant encore dans les Harmonies poétiques et religieuses (1830). La plupart des pièces qui composent les Recueillements poétiques (1839) sont d’un moindre intérêt. Les petits poèmes : la Mort de Socrate (1823), le Dernier Chant de Childe-Harold (1823), les compositions plus vastes de Jocelyn (1836) et de la Chute d’un ange (1838) se font estimer en plusieurs de leurs épisodes par les mêmes mérites que les poésies lyriques de Lamartine, l’ampleur du sentiment, la noble aisance de la versification ; l’invention de la fable et des caractères dans les deux dernières œuvres est médiocre, et il faut reconnaître en général que le génie de ce grand poète a quelque peu manqué de variété. — Les meilleurs ouvrages en prose de Lamartine sont, avec le Voyage en Orient (1835) et l’Histoire des Girondins (1847), livres d’un poète plus que d’un géographe ou d’un historien scrupuleux, les Confidences (1847) et les aimables récits de Geneviève (1850) et du Tailleur de pierres de Saint-Point (1851)2601.
L’automne §
Salut, bois couronnés d’un reste de verdure.
Feuillages jaunissants sur les gazons épars ;
Salut, derniers beaux jours ! le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards2602.
Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire ;
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois.
Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
A ses regards voilés je trouve plus d’attraits ;
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais.
Ainsi prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie
Je contemple ces biens dont je n’ai pas joui.
Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau !
L’air est si parfumé ! La lumière est si pure !
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau !
Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel !
Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu !
Peut-être, dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu !
La fleur tombe en livrant son parfum au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux :
Moi, je meurs ; et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.
(Premières Méditations poétiques, xxxv.)
L’hymne de la nuit
§
Fragment. §
O nuits, déroulez en silence
Les pages du livre des cieux ;
Astres, gravitez en cadence
Dans vos sentiers harmonieux2603
Durant ces heures solennelles ;
Aquilons, repliez vos ailes ;
Terre, assoupissez vos échos ;
Étends tes vagues sur les plages,
O mer ! et berce les images
Du Dieu qui t’a donné tes flots.
Savez-vous son nom ? La nature
Réunit en vain ses cent voix ;
L’étoile à l’étoile murmure :
« Quel Dieu nous imposa nos lois ? »
La vague à la vague demande :
« Quel est celui qui nous gourmande ? »
La foudre dit à l’aquilon :
« Sais-tu comment ton Dieu se nomme ?
Mais les astres, la terre et l’homme
Ne peuvent achever son nom.
Que tes temples, Seigneur, sont étroits pour mon âme !
Tombez, murs impuissants, tombez !
Laissez-moi voir ce ciel que vous me dérobez !
Architecte divin, tes dômes sont de flamme !
Que tes temples, Seigneur, sont étroits pour mon âme !
Tombez, murs impuissants, tombez !
Voilà le temple où tu résides !
Sous la voûte du firmament
Tu ranimes ces feux rapides
Par leur éternel mouvement2604 ;
Tous ces enfants de ta parole,
Balancés sur leur double pôle,
Nagent au sein de ta clarté,
Et, des cieux où leurs feux pâlissent2605,
Sur notre globe ils réfléchissent
Des feux à toi-même empruntés....
Mais moi, pour te loüer,
Dieu des Soleils, qui suis-je ?
Atome dans l’immensité,
Minute dans l’éternité,
Ombre qui passe et qui n’a plus été,
Peux-tu m’entendre sans prodige ?
Ah ! le prodige est ta bonté !
Je ne suis rien, Seigneur, mais ta soif me dévore ;
L’homme est néant, mon Dieu, mais ce néant t’adore,
Il s’élève par son amour2606 ;
Tu ne peux mépriser l’insecte qui t’honore,
Tu ne peux repousser cette voix qui t’implore,
Et qui vers ton divin séjour,
Quand l’ombre s’évapore,
S’élève avec l’aurore,
Le soir gémit encore,
Renaît avec le jour.
Qui, dans ces champs d’azur que ta splendeur inonde,
Où ton tonnerre gronde,
Où tu veilles sur moi,
Ces accents, ces soupirs animés par la foi,
Vont chercher d’astre en astre un Dieu qui me réponde,
Et d’échos en échos, comme des voix sur l’onde,
Roulant de monde en monde,
Retentir jusqu’à toi !
(Harmonies poétiques et religieuses, livre I, ii.)
Souvenirs d’enfance §
Voilà le banc rustique où s’asseyait mon père ;
La salle où résonnait sa voix mâle et sévère,
Quand les pasteurs assis sur les socs renversés
Lui comptaient les sillons par chaque heure tracés ;
Ou qu’encor palpitant des scènes de sa gloire,
De l’échafaud des rois il nous disait l’histoire2607,
Et, plein du grand combat qu’il avait combattu,
En racontant sa vie enseignait la vertu.
Voilà la place vide où ma mère à toute heure,
Au plus léger soupir sortait de sa demeure,
Et, nous faisant porter ou la laine ou le pain,
Vêtissait2608 l’indigence ou nourrissait la faim.
Voilà les toits de chaume où sa main attentive
Versait sur la blessure ou le miel ou l’olive2609,
Ouvrait, près du chevet des vieillards expirants,
Ce livre2610 où l’espérance est permise aux mourants ;
Recueillait leurs soupirs sur leur bouche oppressée,
Faisait tourner vers Dieu leur dernière pensée,
Et, tenant par la main les plus jeunes de nous,
A la veuve, à l’enfant, qui tombaient à genoux,
Disait, en essuyant les pleurs de leurs paupières :
« Je vous donne un peu d’or, rendez-leur vos prières ! »
Voilà le seuil à l’ombre où son pied nous berçait,
La branche du figuier que sa main abaissait.
Voici l’étroit sentier où, quand l’airain sonore2611
Dans le temple lointain vibrait avec l’aurore,
Nous montions sur sa trace à l’autel du Seigneur
Offrir deux purs encens, innocence et bonheur !
C’est ici que sa voix pieuse et solennelle
Nous expliquait un Dieu que nous sentions en elle,
Et nous montrant l’épi dans son germe enfermé,
La grappe distillant son breuvage embaumé,
La génisse en lait pur changeant le suc des plantes,
Le rocher qui s’entr’ouvre aux sources ruisselantes2612,
La laine des brebis, dérobée aux rameaux2613,
Servant à tapisser le doux nid des oiseaux,
Et le soleil exact à ses douze demeures2614
Partageant aux climats les saisons et les heures,
Et ces astres des nuits que Dieu seul peut compter,
Mondes où la pensée ose à peine monter,
Nous enseignait la foi par la reconnaissance,
Et faisait admirer à notre simple enfance
Comment l’astre et l’insecte invisible à nos yeux
Avaient, ainsi que nous, leur père dans les cieux !
(Harmonies poétiques et religieuses, livre III, ii.)
Pensée des morts2615 §
Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon ;
Voilà le vent qui s’élève
Et gémit dans le vallon ;
Voilà l’errante hirondelle
Qui rase du bout de l’aile
L’eau dormante des marais ;
Voilà l’enfant des chaumières
Qui glane sur les bruyères
Le bois tombé des forets.
C’est la saison où tout tombe
Aux coups redoublés des vents ;
Un vent qui vient de la tombe
Moissonne aussi les vivants :
Ils tombent alors par mille,
Comme la plume inutile
Que l’aigle abandonne aux airs,
Lorsque des plumés nouvelles
Viennent réchauffer ses ailes
À l’approche des hivers.
C’est alors que ma paupière
Vous vit pâlir et mourir,
Tendres fruits qu’à la lumière
Dieu n’a pas laissés mûrir !
Quoique jeune sur la terre,
Je suis déjà solitaire
Parmi ceux de ma saison ;
Et quand je dis en moi-même :
« Où sont ceux que ton cœur aime ? »
Je regarde le gazon.
Leur tombe est sur la colline,
Mon pied la sait : la voilà !
Mais leur essence divine,
Mais eux, Seigneur, sont-ils là ?
Jusqu’à l’indien rivage
Le ramier porte un message
Qu’il rapporte à nos climats ;
La voile passe et repasse :
Mais de son étroit espace
Leur âme ne revient pas2616.
Ah ! quand les vents de l’automne
Sifflent dans les rameaux morts,
Quand le brin d’herbe frissonne,
Quand le pin rend ses accords,
Quand la cloche des ténèbres
Balance ses glas funèbres,
La nuit, à travers les bois,
A chaque vent qui s’élève,
A chaque flot sur la grève,
Je dis : « N’es-tu pas leur voix ? »
Du moins si leur voix si pure
Est trop vague pour nos sens,
Leur âme en secret murmure
De plus intimes accents ;
Au fond des cœurs qui sommeillent,
Leurs souvenirs qui s’éveillent
Se pressent de tous côtés,
Comme d’arides feuillages
Que rapportent les orages
Au tronc qui les a portés.
C’est une mère ravie
A ses enfants dispersés,
Qui leur tend, de l’autre vie,
Ces bras qui les ont bercés ;
Des baisers sont sur sa bouche ;
Sur ce sein qui fut leur couche
Son cœur les rappelle à soi ;
Des pleurs voilent son sourire
Et son regard semble dire :
« Vous aime-t-on comme moi ? »
C’est une jeune fiancée
Qui, le front ceint du bandeau,
N’emporta qu’une pensée
De sa jeunesse au tombeau !
Triste, hélas ! dans le ciel même,
Pour revoir celui qu’elle aime
Elle revient sur ses pas,
Elle lui dit : « Ma tombe est verte !
Sur cette terre déserte
Qu’attends-tu ? je n’y suis pas ! »
L’enfant dont la mort cruelle
Vient de vider le berceau,
Qui tomba de la mamelle
Au lit glacé du tombeau ;
Tous ceux enfin dont la vie,
Un jour ou l’autre ravie,
Emporte une part de nous,
Murmurent sous la poussière :
« Vous qui voyez la lumière,
De nous vous souvenez-vous ?
Ah ! vous pleurer est le bonheur suprême2617,
Mânes chéris de2618 quiconque a des pleurs !
Vous oublier, c’est s’oublier soi-même ;
N’êtes-vous pas un débris de nos cœurs ?
Dieu de pardon ! Leur Dieu ! Dieu de leurs pères !
Toi que leur bouche a si souvent nommé,
Entends pour eux les larmes de leurs frères !
Prions pour eux, nous qu’ils ont tant aimé2619 !
Étends sur eux la main de ta clémence !
Ils ont péché ; mais le ciel est un don !
Ils ont souffert ; c’est une autre innocence !
Ils ont aimé ; c’est le sceau du pardon !
(Harmonies poétiques et religieuses, livre III, 1.)
Dieu imprimant aux mondes leurs mouvements2620 §
Ces sphères, dont l’éther est le bouillonnement,
Ont emprunté de Dieu leur premier mouvement.
Avez-vous calculé parfois dans vos pensées
La force de ce bras qui les a balancées ?
Vous ramassez souvent dans la fronde ou la main
La noix du vieux noyer, le caillou du chemin ;
Imprimant votre effort au poignet qui les lance,
Vous mesurez, enfants2621, la force à la distance :
L’une tombe à vos pieds, l’autre vole à cent pas,
Et vous dites : « Ce bras est plus fort que mon bras ».
Eh bien ! si par leurs jets vous comparez vos frondes.
Qu’est-ce donc que la main qui, lançant tous ces mondes
Ces mondes dont l’esprit ne peut porter le poids,
Comme le jardinier qui sème aux champs ses pois,
Les fait fendre le vide et tourner sur eux-mêmes2622
Par l’élan primitif sorti du bras suprême,
Aller et revenir, descendre et remonter
Pendant des temps sans fin que lui seul peut compter,
De l’espace et du poids et des siècles se joue,
Et fait qu’au firmament ces mille chars sans roue
Sont portés sans ornière2623 et tournent sans essieu ?
Courbons-nous, mes enfants, c’est la force de Dieu !
(Jocelyn, IXe époque.)
La puissance de dieu s’étend sur les plus humbles §
Ne dites pas, enfants, comme d’autres ont dit :
« Dieu ne me connaît pas, car je suis trop petit ;
Dans sa création ma faiblesse me noie ;
Il voit trop d’univers pour que son œil me voie. »
L’aigle de la montagne un jour dit au soleil :
« Pourquoi luire plus bas que ce sommet vermeil ?
A quoi sert d’éclairer ces prés, ces gorges sombres,
« Pourquoi luire plus bas que ce sommet vermeil ?
A quoi sert d’éclairer ces prés, ces gorges sombres,
De salir tes rayons sur l’herbe dans ces ombres ?
La mousse imperceptible est indigne de toi !...
— Oiseau, dit le soleil, viens et monte avec moi !… »
L’aigle, avec le rayon, s’élevant dans la nue,
Vit la montagne fondre et baisser à sa vue,
Et, quand il eut atteint son horizon nouveau,
A son œil confondu tout parut de niveau.
« Eh bien ! dit le soleil, tu vois, oiseau superbe2624,
Si pour moi la montagne est plus haute que l’herbe.
Rien n’est grand ni petit devant mes yeux géants ;
La goutte d’eau me peint comme les océans ;
De tout ce qui me voit je suis l’astre et la vie ;
Comme le cèdre altier l’herbe me glorifie ;
J’y2625 chauffe la fourmi, des nuits j’y bois les pleurs,
Mon rayon s’y parfume en traînant sur les fleurs !
Et c’est ainsi que Dieu, qui seül est sa mesure2626,
D’un œil pour tous égal voit toute sa nature2627 !… »
(Jocelyn, IXe époque.)
Dans le désert2628 §
Quand la barre de feu fendit le firmament,
Ils furent éveillés par le gazouillement
Des enfants assoupis : Gédar soudain se lève ;
Il promène d’en haut ses regards sur la grève.
Trois fois d’une voix forte il appelle Stagyr :
De chaque pli du sable il croit le voir surgir ;
Mais sa voix, du désert seulement entendue,
Expire sans réponse, et meurt dans l’étendue..,
Son esprit est frappé d’une horrible lueur ;
Son front se couvre à froid d’une moite sueur ;
Il tourne sous l’assaut de confuses idées.
Son pied heurte en marchant les deux outres vidées,
Dont le sable stérile avait bu toute l’eau,
Et qui portaient aux flancs l’empreinte du couteau !
A ce témoin parlant de tant de perfidie,
Comme d’un coup mortel son âme est engourdie....
Il cherche à retrouver dans le sable mouvant
La route de Stagyr ; mais les ailes du vent
Qui se lève au matin sur les vagues arides
De l’océan de poudre2629 ont nivelé les rides
Et du guide infidèle enseveli les pas.
Le pied du passereau ne s’y connaîtrait pas2630.
Il revient épuisé de sa course inutile.
Daïdha, se collant à l’arène2631 stérile,
A la place où de l’eau le sol était imbu,
Cherchait à retrouver fonde qu’il avait bu,
Mordait le sable sec d’une lèvre farouche ;
Approchant les enfants, leur y collait la bouche,
Espérant que le sol, de leur soif attendri,
Ne refuserait pas de la rendre à leur cri....
Mais remettant au ciel un cœur transi de doute
Pour qu’un guide invisible illuminât leur route,
Cédar prit un enfant sur chacun de ses bras,
Et marcha sans savoir où le menaient ses pas.
Daïdha, regardant l’horizon et sa brume,
Le désert qui poudroie ou le brouillard qui fume,
Montrant avec un cri son espoir de la main2632,
Le faisait revenir cent fois sur son Chemin2633,
Voyait dans les vapeurs, de son regard de mère,
Surgir à l’horizon chimère sur chimère.
A tous les buts changés leur force succombait ;
Sur chacun de leurs pas le doute retombait ;
Sans cesse un repentir ramenait en arrière
Leurs pieds, dont les erreurs centuplaient la Carrière ;
Puis, saisis tout à coup d’un nouveau repentir,
On les voyait s’asseoir, se lever, repartir.
Le soleil cependant, suspendu dans sa voûte,
Marquait de leur sueur les haltes de leur route....
Les étoiles du ciel commençaient de jaillir,
La nuit dans ses terreurs vint les ensevelir ;
D’une étreinte mortelle, assis, ils s’embrassèrent,
Comme deux naufragés, et muets s’affaissèrent.
Nul n’osait de sa voix faire entendre le son ;
Leurs cœurs ne se parlaient que par leur seul frisson :
En proférant le mot qu’il eût fallu répondre,
Ils craignaient de sentir tout leur courage fondre
Chacun d’eux dévorait ce que l’autre pensait.
Des enfants sur leurs bras le cri s’affaiblissait,
Leur cœür les réchauffait entre leurs deux poitrines ;
A peine entendait-on le vent de leurs narines ;
Comme la poule encor couve mort son poussin,
La mère réchauffait ces deux corps dans son sein.
Oh ! durant cette longue et suprême insomnie,
Combien le sable but de gouttes d’agonie !
La brise du matin les rafraîchit un peu,
Le soleil nu monta comme un charbon de feu ;
L’aube, qui se jouait splendide sur leur tête,
Teignit le firmament de sa couleur de fête.
Cette gaieté semblait une insulte des cieux.
Pour y chercher secours, ils levèrent les yeux :
Une cigogne, seule, à l’aile diaprée,
Sans doute, hélas ! aussi de sa route égarée,
Comme une longue flèche à la fin de son vol,
Fendait l’air résonnant à quelques pieds du sol,
Dans ses deux pattes d’or, emportant avec elle
Un de ses chers petits à l’ombre sous son aile.
L’oiseau, comme étonné de l’aspect des humains,
S’approcha d’eux ; Cédar éleva les deux mains
Comme pour arrêter cet ami dans sa course,
Et conjurer l’oiseau de lui montrer la source.
Le fort vent de son vol effleura ses cheveux ;
Mais l’oiseau s’éloigna sans entendre ses vœux.
Ils suivirent longtemps de colline en colline
Son vol bas, jusqu’au bord où l’horizon décline,
Et marchèrent plus seuls quand l’oiseau disparut.
Le matin de ce jour, un des jumeaux mourut ;
L’autre mourut le soir. Faux sourire de joie
Qui finit en sanglots et qu’une larme noie !
Cédar n’entendit pas mourir leurs souffles sourds :
Seulement il sentit leurs corps froids et plus lourds,
Et leurs têtes, pendant du bras qui les supporte,
Battirent sur son cœur comme une chose morte.
Son œil pétrifié sans pleurs les regarda,
Et, de son bras droit libre enlaçant Daïdha,
Il s’enfuit emportant ses fils morts et sa femme,
Comme un spectre emportant les trois parts de son âme
Ou comme la victime échappée au boucher
Qui traîne dans son sang les lambeaux de sa chair.
(La Chute d’un ange, quinzième vision.)
Casimir Delavigne
(1793-1843) §
Né au Havre en 1793, mort en 1843, Jean-François-Casimir Delavigne se fit d’abord connaître par quelques pièces de poésie que lui inspirèrent les malheurs récents de la patrie (1818). Puis il donna plusieurs comédies et tragédies, représentées presque toutes avec succès : l’École des vieillards (1823), Don Juan d’Autriche (1835), comédies ; les Vêpres siciliennes (1819), le Paria (1821), Marino Faliero (1829), Louis XI (1832), les Enfants d’Édouard (1833), tragédies, dans la plupart desquelles l’auteur cherchait à concilier, en les tempérant, les hardiesses de l’école romantique2634 avec les traditions du théâtre classique. Esprit modéré autant que généreux, Casimir Delavigne ne peut être mis au même rang que les trois plus grands poètes du xixe siècle ; mais on trouverait, dans ses différents recueils de poésies, quelques pièces touchantes, et, dans ses œuvres dramatiques, des scènes pathétiques, pleines de mouvement, plus oratoires peut-être que poétiques, mais souvent soutenues par une versification forte et sans négligence.
La fille du Cid §
Le Cid, Elvire, sa fille. §
« A nous, Campéador2635, m’avait écrit le roi,
Voici les Sarrasins. » Pas un real2636 chez moi
Pour équiper ma bande et la conduire en plaine !
Alors de mon manoir la douce châtelaine2637,
Qui voyait mon souci, te mit sur mes genoux,
Me quitta ; puis revint en m’offrant ses bijoux ;
Je crois l’entendre encor : « Tiens, mon Cid, va les vendre ;
Le Sarrasin, dit-elle, est là pour me les rendre ».
A quoi je répondis : « Chimène, mes amours,
Il te rendra ton bien avant qu’il soit dix jours ».
J’emportais les brillants ; mais est-il femme ou fille
Qui se puisse tenir d’admirer ce qui brille ?
Non : les vouloir, les prendre, et ne plus les lâcher,
C’est ce que fit Elvire ; et j’eus beau me fâcher :
Dans son courroux d’enfant qui la rendait plus belle,
Tenant toujours sa proie, elle osa, la rebelle,
Lever, pour la défendre, en lionne qu’elle est,
Ses deux petits poings nus contre mon gantelet.
Elvire.
Vous l’avez ôté, Cid ?
Le Cid.
Oui, mais je fis en sorte,
Elvire, que ta main ne fût pas la plus forte.
Tu te pris à pleurer, et tout gonflés, tes yeux
Faisaient à ce trésor de si tristes adieux,
Que je sentis mon cœur s’amollir de tendresse ;
La pitié l’emporta. Jamais, c’est ma faiblesse,
Aux larmes d’un enfant je n’ai su résister ;
Et je dis à Chimène : « Il faut la contenter ».
Qui sourit ? ce fut toi : j’avais mis bas les armes ;
Sourire plus charmant, lorsqu’il fit sous tes larmes
Rayonner de plaisir ton visage vermeil,
Qu’à travers une pluie un éclair de soleil !
Et folle et radieuse, ivre de ta victoire,
Tu vins du bout du doigt tirer ma barbe noire,
Toi qui tremblais alors, peureuse, en la baisant ;
Mais tu n’en as plus peur : elle est blanche à présent.
(La Fille du Cid, acte I, sc. iv.)
Louis XI et Saint François De Paule2638 §
Louis.
Nous voilà sans témoins.
François De Paule.
Que voulez-vous de moi ?
Louis, prosterné.
Je tremble à vos genoux d’espérance et d’effroi.
François De Paule.
Relevez-vous, mon fils !
Louis.
J’y reste pour attendre
La faveur qui sur moi de vos mains ya descendre,
Et veux, courbant mon front à la terre attaché
Baiser jusqu’à la place où vos pas ont touché.
François De Paule.
Devant sa créature, en me rendant hommage,
Ne prosternez pas Dieu dans sa royale image2639.
Prince, relevez-vous.
Louis, debout.
J’espère un lien si grand !
Comment m’abaisser trop, saint homme, en l’implorant ?
François De Paule.
Que puis-je ?
louis.
Tout, mon père ; oui, tout vous est possible ;
Vous réchauffez d’un souffle une chair insensible.
François De Paule.
Moi !
Louis.
Vous dites aux morts : Sortez de vos tombeaux !
Ils sortent.
François De Paule.
Qui ? moi !
Louis.
Vous dites à nos maux :
Guérissez !...
François De Paule.
Moi, mon fils !
Louis.
Soudain nos maux guérissent.
Que votre voix l’ordonne, et les cieux s’éclaircissent ;
Le vent gronde ou s’apaise à son commandement ;
La foudre qui tombait remonte au firmament.
O vous, qui dans les airs retenez la rosée,
Ou versez sa fraîcheur à la plante épuisée,
Faites d’un corps vieilli reverdir la vigueur ;
Voyez, je suis mourant : ranimez ma langueur :
Tendez vers moi les bras ; touchez ces traits livides,
Et vos mains, en passant, vont effacer mes rides.
François De Paule.
Que me demandez-vous, mon fils ? Vous m’étonnez.
Suis-je l’égal de Dieu ? C’est vous qui m’apprenez
Que je vais par le monde en rendant des oracles,
Et qu’en ouvrant mes mains je sème les miracles.
Louis.
Au moins dix ans, mon père ! accordez-moi dix ans,
Et je vous comblerai d’honneurs et de présents.
Tenez, de tous les saints je porte ici les restes2640 :
Si j’obtiens ces… vingt ans par vos secours célestes,
Rome, qui peut presser les rangs des bienheureux2641,
Près d’eux vous placera, que dis-je ? au dessus d’eux.
Je veux sous votre nom fonder des basiliques,
Je veux de jaspe et d’or surcharger vos reliques ;
Mais vingt ans, c’est trop peu pour tant d’or et d’encens.
Non : un miracle entier ! De mes jours renaissants
Que la clarté sitôt ne me soit pas ravie ;
Un miracle ! la vie ! ah ! prolongez ma vie !
François De Paule.
Dieu n’a pas mis son œuvre au pouvoir d’un mortel.
Vous seul, quand tout périt, vous seriez éternel !
Roi, Dieu ne le veut pas, sa faible créature
Ne peut changer pour vous l’ordre de la nature.
Ce qui grandit décroît, ce qui naît se détruit,
L’homme avec son ouvrage, et l’arbre avec son fruit.
Tout produit pour le temps : c’est la loi de ce monde,
Et pour l’éternité la mort seule est féconde.
Louis.
Je me lasse à la fin : moine, fais ton devoir ;
Exerce en ma faveur ton merveilleux pouvoir,
Ou j’aurai, s’il le faut, recours à la contrainte.
Je suis roi : sur mon front j’ai reçu l’huile sainte2642....
Ah ! pardon ! mais aux rois, mais aux fronts couronnés
Ne devez-vous pas plus qu’à ces infortunés,
Ces affligés obscurs, que, sans votre prière,
Dieu n’eût pas de si haut cherchés dans la poussière.
François De Paule.
Les rois et les sujets sont égaux devant lui :
Comme à tous ses enfants il vous doit son appui ;
Mais ces secours divins que votre voix réclame,
Plus juste envers vous-même, invoquez-les pour lame.
(Louis XI, acte IV, scène vi.)
Adieu §
Adieu, Madeleine2643 chérie,
Qui te réfléchis dans les eaux,
Comme une fleur de la prairie
Se mire au cristal des ruisseaux.
Ta colline, où j’ai vu paraître
Un beau jour qui s’est éclipsé,
J’ai rêvé que j’en étais maître ;
Adieu ! ce doux rêve est passé.
Assis sur la rive opposée,
Je te vois, lorsque le soleil
Sur tes gazons boit la rosée,
Sourire encore à ton réveil,
Et d’un brouillard pâle entourée,
Quand le jour meurt avec le bruit,
Blanchir comme une ombre adorée,
Qui vous apparaît dans la nuit.
Doux trésors de ma moisson mûre,
De vos épis un autre est roi ;
Tilleuls dont j’aimais le murmure,
Vous n’aurez plus d’ombre pour moi.
Ton coq peut tourner à sa guise,
Clocher, que je fuis sans retour ;
Ce n’est plus à moi que la brise
Lui dit d’annoncer un beau jour2644.
Cette fenêtre était la tienne,
Hirondelle, qui vins loger
Bien des printemps dans ma persienne,
Où je n’osais te déranger.
Dès que la feuille était fanée,
Tu partais la première, et moi,
Avant toi je pars cette année ;
Mais reviendrai-je comme toi ?
Qu’ils soient l’amour d’un autre maître,
Ces pêchers dont j’ouvris les bras2645 !
Leurs fruits verts, je les ai vus naître ;
Rougir, je ne les verrai pas.
J’ai vu des bosquets que je quitte
Sous l’été les roses mourir2646 ;
J’y vois planter la marguerite :
Je ne l’y verrai pas fleurir.
Ainsi tout passe, et l’on décaisse
Les lieux où l’on s’est répété :
« Ici luira sur ma vieillesse
L’azur de mon dernier été. »
Heureux, quand on les abandonne,
Si l’on part en se comptant tous,
Si l’on part sans laisser personne
Sous l’herbe qui n’est plus à vous !
Adieu, mystérieux ombrage,
Sombre fraîcheur, calme inspirant ;
Mère de Dieu, de qui l’image
Consacre ce vieux tronc mourant,
Où, quand son heure est arrivée,
Le passereau, loin des larcins,
Vient cacher sa jeune couvée
Dans les plis de tes voiles saints.
Adieu, chapelle qui protège
Le pauvre contre ses douleurs ;
Avenue où, foulant la neige2647
De mes acacias en fleurs,
Lorsque le vent l’avait semée
Du haut de ses rameaux tremblants,
Je suivais quelque trace aimée,
Empreinte sur ses flocons blancs.
Adieu, flots, dont le cours tranquille,
Couvert de berceaux verdoyants,
A ma nacelle d’île en île,
Ouvrait mille sentiers fuyants,
Quand, rêveuse, elle allait sans guide
Me perdre, en suivant vos détours,
Dans l’ombre d’un dédale humide,
Où je me retrouvais toujours.
Adieu, chers témoins de ma peine,
Forêt, jardin, flots que j’aimais !
Adieu ! ma fraîche Madeleine !
Madeleine, adieu pour jamais !
Je pars, il le faut, et je cède ;
Mais le cœur me saigne en partant.
Qu’un plus riche qui te possède
Soit heureux où nous l’étions tant !
(Derniers Chants.)
Alfred De Vigny
(1797-1863) §
Alfred-Victor de Vigny, né à Loches, mort à Paris, servit comme officier avant de se consacrer entièrement aux lettres. Il publia son premier recueil de poésies en 1822, puis en fondit une partie dans ses Poèmes antiques et modernes (1826), qu’il enrichit de quelques pièces dans l’édition définitive de 1837. Après sa mort ont été recueillis, sous le titre des Destinées, onze petits poèmes dont plusieurs avaient été publiés isolément et dont le plus ancien remonte à 1839. Son œuvre poétique est donc de peu d’étendue : encore plusieurs des pièces qui le composent sont-elles assez médiocres. Mais d’autres sont remarquables par la couleur et par le sentiment, et il en est quelques-unes, les plus célèbres, les plus caractéristiques, qui égalent ce que la poésie philosophique a jamais produit de plus original et de plus saisissant. Au théâtre, Alfred de Vigny a donné une traduction de l’Othello de Shakespeare (1829) et deux drames, la Maréchale d’Ancre (1830) et Chatterton (1835), et nous avons encore de lui un roman historique, Cinq-Mars (1826), et deux recueils de récits dominés par une idée morale sur le rôle et le caractère du poète et du soldat, Stello (1832) et Servitude et grandeur militaire (1835)2648.
La frégate « La Sérieuse » à la bataille d’Aboukir2649 §
Récit du capitaine. §
Trois vaisseaux de haut bord combattre une frégate2650 !
Est-ce l’art d’un marin ? le trait d’un amiral ?
Un écumeur de mer, un forban, un pirate,
N’eut pas agi si mal !
N’importe ! elle bondit, dans son repos troublée ;
Elle tourna trois fois jetant vingt-quatre éclairs2651,
Et rendit tous les coups dont elle était criblée,
Feux pour feux, fers pour fers.
Ses boulets enchaînés fauchaient des mâts énormes,
Faisaient voler le sang, la poudre et le goudron,
S’enfonçaient dans les bois, comme au cœur des grands ormes
Le coin du bûcheron.
Un brouillard de fumée où la flamme étincelle
L’entourait ; mais, le corps brûlé, noir, écharpé,
Elle tournait, roulait et se tordait sous elle,
Comme un serpent coupé.
Le soleil s’éclipsa dans l’air plein de bitume.
Ce jour entier passa dans le feu, dans le bruit ;
Et, lorsque la nuit vint, sous cette ardente brume
On ne vit pas la nuit.
Nous étions enfermés comme dans un orage :
Des deux flottes2652 au loin le canon s’y2653 mêlait ;
On tirait en aveugle à travers le nuage :
Toute la mer brûlait.
Mais, quand le jour revint, chacun connut son œuvre.
Les trois vaisseaux flottaient démâtés, et si las,
Qu’ils n’avaient plus de force assez pour la manœuvre ;
Mais ma frégate, hélas !
Elle ne voulait plus obéira son maître2654 ;
Mutilée, impuissante, elle allait au hasard ;
Sans gouvernail, sans mât, on n’eût pu reconnaître
La merveille de l’art !
Engloutie à demi, son large pont à peine,
S’affaissant par degrés, se montrait sur les flots,
Et là ne restaient plus, avec moi capitaine,
Que douze matelots.
Je les fis mettre en mer à bord d’une chaloupe,
Hors de notre eau tournante et de son tourbillon ;
Et je revins tout seul me coucher sur la poupe
Au pied du pavillon.
J’aperçus des Anglais les figures livides,
Faisant pour s’approcher un inutile effort
Sur leurs vaisseaux flottants comme des tonneaux vides,
Vaincus par notre mort.
La Sérieuse alors semblait à l’agonie,
L’eau dans ses cavités bouillonnait sourdement ;
Elle, comme voyant sa carrière finie,
Gémit profondément.
Je me sentis pleurer et ce fut un prodige,
Un mouvement honteux ; mais bientôt l’étouffant :
« Nous nous sommes conduits comme il fallait, lui dis-je ;
Adieu donc, mon enfant2655 ! »
Elle plonge d’abord sa poupe et puis sa proue ;
Mon pavillon noyé se montrait en dessous ;
Puis elle s’enfonça tournant comme une roue,
Et la mer vint sur nous.
(Poésies. Livre moderne : la Frégate la Sérieuse, XVI.)
La fille de Jephté §
Tous les guerriers d’Ammon2656 sont détruits, et leur terre
Du Seigneur notre Dieu reste la tributaire.
Israël est vainqueur, et par ses cris perçants
Reconnaît du Très-Haut les secours tout-puissants.
A l’hymne universel que le désert répète
Se mêle en longs éclats le son de la trompette,
Et l’armée, en marchant vers les tours de Maspha2657,
Leur raconte de loin que Jephté triompha.
Le peuple tout entier tressaille de la fête.
Mais le sombre vainqueur marche en baissant la tête ;
Sourd à ce bruit de gloire, et seul, silencieux,
Tout à coup, il s’arrête, il a fermé ses yeux.
Il a fermé ses yeux2658, car au loin, de la ville,
Les vierges, en chantant, d’un pas lent et tranquille
Venaient ; il entrevoit le chœur religieux :
C’est pourquoi, plein de crainte, il a fermé ses yeux.
Il entend le concert qui s’approche et l’honore ;
La harpe harmonieuse et le tambour sonore,
Et la lyre aux dix voix, et le kinnor léger,
Et les sons argentins du nébel étranger2659,
Puis, de plus près, les chants, leurs paroles pieuses,
Et les pas mesurés en des danses joyeuses,
Et, par des bruits flatteurs, les mains frappant les mains,
Et de rameaux fleuris parfumant les chemins.
Ses genoux ont tremblé sous le poids de ses armes ;
Sa paupière s’entr’ouvre à ses premières larmes2660 ;
C’est que, parmi les voix, le père a reconnu
La voix la plus aimée2661 à ce chant ingénu :
« O vierges d’Israël ! ma couronne s’apprête
La première à parer les cheveux de sa tête ;
C’est mon père, et jamais un autre enfant que moi
N’augmenta la famille heureuse sous sa loi2662. »
Et ses bras à Jephté donnés avec tendresse,
Suspendant à son col leur pieuse caresse :
« Mon père, embrassez-moi ! D’où naissent vos retards ?
Je ne vois que vos pleurs et non pas vos regards.
« Je n’ai point oublié l’encens du sacrifice :
J’offrais pour vous hier la naissante génisse.
Qui peut vous affliger ? Le Seigneur n’a-t-il pas
Renversé les cités au seul bruit de vos pas ?
« — C’est vous, hélas ! c’est vous, ma fille bien-aimée ?
Dit le père en rouvrant sa paupière enflammée.
Faut-il que ce soit vous ! ô douleur des douleurs !
Que vos embrassements feront couler de pleurs !
« Seigneur, vous êtes bien le Dieu de la vengeance ;
En échange du crime il vous faut l’innocence.
C’est la vapeur du sang qui plaît au Dieu jaloux2663 !
Je lui dois une hostie, ô ma fille ! et c’est vous !
« — Moi ? » dit-elle. Et ses veux se remplirent de larmes.
Elle était jeune et belle, et la vie a des Charmes.
Puis elle répondit : « Oh ! si votre serment
Dispose de mes jours, permettez seulement
« Qu’emmenant avec moi les vierges mes compagnes,
J’aille, deux mois entiers, sur le haut des montagnes,
Pour la dernière fois, errante en liberté,
Pleurer sur ma jeunesse et ma virginité. »
Après ces mots, l’armée assise tout entière
Gémit, et sur son Iront répandit la poussière ;
Jephté sous un manteau tenait ses pleurs voilés ;
Mais, parmi les sanglots, on entendit : « Allez ! »
Elle inclina la tête et partit. Ses compagnes,
Comme nous la pleurons, pleuraient sur les montagnes,
Puis elle vint s’offrir au couteau paternel.
— Voilà ce qu’ont chanté les filles d’Israël.
(Poésies : Livre antique.)
Le Cor §
I §
J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois,
Soit qu’il chante les pleurs de la biche aux abois,
Ou l’adieu du chasseur que l’écho faible accueille,
Et que le vent du Nord porte de feuille en feuille.
Que de fois, seul dans l’ombre à minuit demeuré,
J’ai souri de l’entendre et plus souvent pleuré !
Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques
Qui précédaient la mort des paladins2664 antiques.
O montagnes d’azur ! ô pays adoré,
Rocs de la Frazona, cirque du Marboré2665,
Cascades qui tombez des neiges entraînées,
Sources, gaves2666, ruisseaux, torrents des Pyrénées ;
Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons,
Dont le front est de glace et les pieds de gazons !
C’est là qu’il faut s’asseoir2667, c’est là qu’il faut entendre
Les airs lointains d’un cor mélancolique et tendre.
Souvent un voyageur, lorsque l’air est sans bruit,
De cette voix d’airain fait retentir la nuit ;
A ses chants cadencés autour de lui se mêle
L’harmonieux grelot du jeune agneau qui bêle.
Une biche attentive, au lieu de se cacher,
Se suspend immobile au sommet du rocher,
Et la cascade unit, dans une chute immense,
Son éternelle plainte aux chants de la romance.
Ames des chevaliers, revenez-vous encor ?
Est-ce vous qui parlez avec la voix du cor ?
Roncevaux ! Roncevaux2668 ! dans ta sombre vallée
L’ombre du grand Roland n’est donc pas consolée ?
II §
Tous les preux2669 étaient morts ; mais aucun n’avait fui,
Il reste seul debout, Olivier2670 près de lui ;
L’Afrique2671 sur les monts l’entoure, et tremble encore.
« Roland, tu vas mourir, rends-toi, criait le More ;
Tous tes pairs2672 sont couchés dans les eaux du torrent.
Il rugit comme un tigre et dit : « Si je me rends,
Africains, ce sera lorsque les Pyrénées
Sur l’onde avec leurs corps rouleront entraînées. »
« — Rends-toi donc, répond-il, ou meurs, car les voilà. »
Et du plus haut des monts un grand rocher roula :
Il bondit, il roula jusqu’au fond de l’abîme,
Et de ses pins, dans l’onde, il vint briser la cime.
« Merci, cria Roland : tu m’as fait un chemin. »
Et jusqu’au pied des monts le roulant d’une main,
Sur le roc affermi comme un géant s’élance,
Et, prête à fuir, l’armée à ce seul pas balance.
III §
Tranquilles cependant, Charlemagne et ses preux
Descendaient la montagne, et se parlaient entre eux.
A l’horizon déjà, par leurs eaux signalées,
De Luz et d’Argelès2673 se montraient les vallées....
Roland gardait les monts : tous passaient sans effroi.
Assis nonchalamment sur un noir palefroi2674
Qui marchait revêtu de housses violettes,
Turpin2675 disait, tenant les saintes amulettes2676 :
« Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu ;
Suspendez votre marche : il ne faut tenter Dieu.
Par monsieur2677 saint Denis, certes ce sont des âmes
Qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flammes.
Deux éclairs ont relui, puis deux autres encor. »
Ici l’on entendit le son lointain du cor.
L’empereur étonné, se jetant en arrière,
Suspend du destrier2678 la marche aventurière.
« Entendez-vous ? dit-il. — Oui, ce sont des pasteurs
Rappelant les troupeaux épars sur les hauteurs,
Répondit l’archevêque, ou la voix étouffée
Du nain vert Obéron2679 qui parle avec sa fée. »
Et l’empereur poursuit ; mais son front soucieux
Est plus sombre et plus noir que l’orage des cieux :
Il craint la trahison, et, tandis qu’il y songe,
Le cor éclate et meurt, renaît et se prolonge.
« Malheur ! c’est mon neveu ! malheur ! car si Roland
Appelle à son secours, ce doit être en mourant.
Arrière, chevaliers, repassons la montagne !
Tremble encor sous nos pieds, sol trompeur de l’Espagne ! »
IV §
Sur le plus haut des monts s’arrêtent les chevaux ;
L’écume les blanchit ; sous leurs pieds, Roncevaux
Des feux mourants du jour à peine se colore.
A l’horizon lointain fuit l’étendard du More.
« Turpin, n’as-tu rien vu dans le fond du terrent ?
— J’y vois deux chevaliers, l’un mort, l’autre expirant ;
Tous deux sont écrasés sous une roche noire ;
Le plus fort, dans sa main, élève un cor d’ivoire2680.
Son âme en s’exhalant nous appela deux fois. »
Dieu ! que le son du cor est triste au fond des bois !
(Poésies : Livre moderne)
Victor Hugo
(1802-1885) §
Né à Besançon le 26 février 1802, mort à Paris le 22 mai 1885, Victor Hugo publia un premier recueil d’Odes en 1822, un second, puis un troisième (Odes et Ballades) en 1824 et en 1826, et, en 1827, le drame de Cromwell. On le regarda dès lors comme le chef d’une école nouvelle, l’école romantique, qui prétendait renouveler la poésie et le théâtre français en rompant avec les traditions et les règles de notre littérature classique. Le succès de ses drames, Hernani (1830), Marion de Lorme (1831), le Roi s’amuse (1832), Ruy Blas (1838), les Burgraves (1843), etc., ne fut jamais incontesté. Mais nul poète lyrique ne s’est élevé plus haut, n’a fait preuve d’un talent plus souple, plus varié, d’une imagination plus riche, que Victor Hugo dans les Orientales (1828), et surtout dans les Feuilles d’automne (1831), les Chants du crépuscule (1835), les Voix intérieures (1837), les Rayons et les Ombres (1840), les Contemplations (1856) ; et la poésie épique, dans les temps modernes, en France, n’a rien produit de comparable à la suite des pièces héroïques qui composent la Légende des siècles (1859-1876-1883). Victor Hugo a aussi écrit plusieurs ouvrages en prose, notamment un récit de voyage, le Rhin (1842), et des romans, dont les deux (principaux sont Notre-Dame de Paris (1831) et les Misérables2681 (1862).
Pour les pauvres §
Donnez, riches : l’aumône est sœur de la prière :
Hélas ! quand un vieillard, sur votre seuil de pierre,
Tout roidi par l’hiver, en vain tombe à genoux ;
Quand les petits enfants, les mains de froid rougies,
Ramassent sous vos pieds les miettes des orgies,
La face du Seigneur se détourne de vous.
Donnez ! afin que Dieu, qui dote les familles,
Donne à vos fils la force, et la grâce à vos filles ;
Afin que votre vigne ait toujours un doux fruit ;
Afin qu’un blé plus mûr fasse plier vos granges ;
Afin d’être meilleurs ; afin de voir les anges
Passer dans vos rêves la nuit !
Donnez ! il vient un jour où la terre nous laisse ;
Vos aumônes là-haut vous font une richesse.
Donnez ! afin qu’on dise : « Il a pitié de nous ! »
Afin que l’indigent que glacent les tempêtes,
Que le pauvre, qui souffre à côté de vos fêtes,
Au seuil de vos palais fixe un œil moins jaloux.
Donnez ! pour être aimés du Dieu qui se fit homme,
Pour que le méchant même en s’inclinant vous nomme.
Pour que votre foyer soit calme et fraternel ;
Donnez ! afin qu’un jour, à votre heure dernière,
Contre tous vos péchés vous ayez la prière
D’un mendiant puissant au ciel2682 !
(Les Feuilles d’automne, XXXII.)
Après la mort du père §
Notre ami
Ne reverra jamais son vieux père endormi !
Hélas ! il a perdu cette sainte défense
Qui protège la vie encore après l’enfance,
Ce pilote prudent, qui, pour dompter le flot,
Prête une expérience au jeune matelot !
Plus de père pour lui ! plus rien qu’une mémoire !
Plus d’auguste vieillesse à couronner de gloire !
Plus de récits guerriers ! plus de beaux cheveux blancs
A faire caresser par les petits enfants !
Hélas ! il a perdu la moitié de sa vie,
L’orgueil de faire voir à la foule ravie
Son père, un vétéran, un général ancien2683 !
Ce foyer où l’on est plus à l’aise qu’au sien,
Et le seuil paternel qui tressaille de joie
Quand du fils qui revient le chien fidèle aboie !
Le grand arbre est tombé ! Resté seul au vallon,
L’arbuste est désormais à nu sous l’aquilon.
Quand l’aïeul disparaît du sein de la famille,
Tout le groupe orphelin, mère, enfant, jeune fille2684,
Se rallie inquiet autour du père seul,
Que ne dépasse plus le front blanc de l’aïeul,
C’est son tour maintenant. Du soleil, de la pluie,
On s’abrite à son ombre, à sa tige on s’appuie.
C’est, à lui de veiller, d’enseigner, de souffrir,
De travailler pour tous, d’agir et de mourir !
Voilà que va bientôt sur sa tête vieillie
Descendre la sagesse austère et recueillie ;
Voilà que ses beaux ans s’envolent tour à tour,
Emportant l’un sa joie et l’autre son amour,
Ses songes de grandeur et de gloire ingénue,
Et que pour travailler son âme reste nue2685,
Laissant là l’espérance et les rêves dorés,
Ainsi que la glaneuse, alors que dans les prés
Elle marche, d’épis emplissant sa corbeille,
Quitte son vêtement de fête de la veille :
Mais, le soir, la glaneuse aux branches d’un buisson
Reprendra ses atours, et, chantant sa chanson,
S’en reviendra parée, et belle, et consolée ;
Tandis que cette vie, âpre et morne vallée,
N’a point de buisson vert où l’on retrouve un jour
L’espoir, l’illusion, l’innocence et l’amour !
Il continuera donc sa tâche commencée,
Tandis que sa famille, autour de lui pressée,
Sur son front, où des ans s’imprimera le cours,
Verra tomber sans cesse et s’amasser toujours,
Comme les feuilles d’arbre au vent de la tempête,
Cette neige des jours qui blanchit notre tête !
(Les Feuilles d’automne, II : à M. Louis B2686.)
Hymne §
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ;
Et, comme ferait une mère,
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !
A ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !
C’est pour ces morts, dont l’ombre est ici2687 bienvenue,
Que le haut Panthéon élève dans la nue,
Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours,
La reine de nos Tyrs et de nos Babylones2688,
Cette couronne de colonnes2689
Que le soleil levant redore tous les jours !
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts !
A ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple !
Et qui mourront comme ils sont morts !
Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;
Chaque jour pour eux seuls se levant2690 plus fidèle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !
Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martyrs, aux vaillants ! aux forts !
A ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !
(Les Chants du crépuscule, III.)
La fleur et la papillon §
La pauvre fleur disait au papillon céleste :
— Ne fuis pas !
Vois comme nos destins sont différents. Je reste,
Tu t’en vas2691 !
Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes
Et loin d’eux,
Et nous nous ressemblons, et l’on dit que nous sommes
Fleurs tous deux !
Mais hélas ! l’air t’emporte et la terre m’enchaîne.
Sort cruel !
Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine
Dans le ciel !
Mais non, tu vas trop loin ! Parmi des fleurs sans nombre
Vous fuyez,
Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre
A mes pieds.
Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t’en vas encore
Luire ailleurs.
Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore
Toute en pleurs !
Oh ! pour que notre amour coule des jours fidèles,
O mon roi,
Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes
Comme à toi !
(Les Chants du crépuscule, xvii.)
Souvenir2692 §
O souvenirs ! printemps ! aurore !
Doux rayon triste et réchauffant !
— Lorsqu’elle était petite encore,
Que sa sœur2693 était tout enfant2694… —
Connaissez-vous, sur la colline
Qui joint Montlignon à Saint-Leu2695,
Une terrasse qui s’incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu ?
C’est là que nous vivions. — Pénètre,
Mon cœur, dans ce passé charmant ! —
Je l’entendais sous ma fenêtre
Jouer le matin doucement.
Elle courait dans la rosée,
Sans bruit, de peur de m’éveiller ;
Moi, je n’ouvrais pas ma croisée,
De peur de la faire envoler.
Ses frères2696 riaient… — Aube pure !
Tout chantait sous ces frais berceaux,
Ma famille avec la nature,
Mes enfants avec les oiseaux !
Je toussais, on devenait brave.
Elle montait à petits pas,
Et me disait d’un air très grave :
« J’ai laissé les enfants en bas. »
Qu’elle fût bien ou mal coiffée,
Que mon cœur fût triste ou joyeux,
Je l’admirais. C’était ma fée,
Et le doux astre de mes yeux !
Nous jouions toute la journée.
O jeux charmants ! chers entretiens !
Le soir, comme elle était l’aînée,
Elle me disait : « Père, viens !
Nous allons t’apporter ta chaise.
Conte-nous une histoire, dis ! »
Et je voyais rayonner d’aise
Tous ces regards du paradis.
Alors, prodiguant les carnages,
J’inventais un conte profond,
Dont je trouvais les personnages
Parmi les ombres du plafond.
Toujours ces quatre douces têtes
Riaient, comme à cet âge on rit,
De voir d’affreux géants très bêtes
Vaincus par des nains pleins d’esprit.
J’étais l’Arioste et l’Homère2697
D’un poème éclos d’un seul jet ;
Pendant que je parlais, leur mère
Les regardait rire et songeait.
Leur aïeul, qui lisait dans l’ombre,
Sur eux parfois levait les yeux ;
Et moi, par la fenêtre sombre,
J’entrevoyais un coin des cieux !
(Les Contemplations, livre IV, ix.)
La source et l’océan §
La source tombait du rocher
Goutte à goutte à la mer affreuse.
L’océan, fatal au nocher,
Lui dit : « Que me veux-tu, pleureuse ?
Je suis la tempête et l’effroi ;
Je finis où le ciel commence :
Est-ce que j’ai besoin de toi,
Petite, moi qui suis l’immense ? »
La source dit au gouffre amer :
« Je te donne, sans bruit ni gloire,
Ce qui te manque, ô vaste mer !
Une goutte d’eau qu’on peut boire2698. »
(Les Contemplations, livre V, iv.)
Les soldats de la République §
O soldats de l’an deux2699 ! ô guerres ! épopées !
Contre les rois tirant ensemble leurs épées,
Prussiens, Autrichiens,
Contre toutes les Tyrs et toutes les Sodomes2700,
Contre le czar du nord2701, contre ce chasseur d’hommes,
Suivi de tous ses chiens,
Contre toute l’Europe avec ses capitaines,
Avec ses fantassins couvrant au loin les plaines,
Avec ses cavaliers,
Tout entière debout comme une hydre vivante,
Ils chantaient, ils allaient, l’âme sans épouvante
Et les pieds sans bouliers !
Au levant, au couchant, partout, au sud, au pôle,
Avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule,
Passant torrents et monts,
Sans repos, sans sommeil, coudes percés, sans vivres,
Ils allaient, fiers, joyeux, et soufflant dans des cuivres,
Ainsi que des démons !
La liberté sublime emplissait leurs pensées.
Flottes prises d’assaut, frontières effacées
Sous leur pas souverain,
O France, tous les jours c’était quelque prodige,
Chocs, rencontres, combats, et Joubert sur l’Adige,
Et Marceau sur le Rhin2702 !
On battait l’avant-garde, on culbutait le centre ;
Dans la pluie et la neige et de l’eau jusqu’au ventre,
On allait : en avant !
Et l’un offrait la paix, et l’autre ouvrait ses portes.
Et les trônes, roulant comme des feuilles mortes,
Se dispersaient au vent !
Oh ! que vous étiez grands au milieu des mêlées,
Soldats ! l’œil plein d’éclairs, faces échevelées,
Dans le noir tourbillon,
Ils rayonnaient, debout, ardents, dressant la tête,
Et comme les lions aspirent la tempête
Quand souffle l’aquilon,
Eux, dans l’emportement de leurs luttes épiques,
Ivres, ils savouraient tous les bruits héroïques,
Le fer heurtant le fer,
La Marseillaise2703 ailée et volant dans les balles,
Les tambours, les obus, les bombes, les cymbales,
Et ton rire, ô Kléber2704 !
La Révolution leur criait : « Volontaires,
Mourez pour délivrer tous les peuples, vos frères ! »
Contents, ils disaient : oui.
« Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes ! »
Et l’on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes
Sur le monde ébloui !
La tristesse et la peur leur étaient inconnues ;
Ils eussent, sans nul doute, escaladé les nues,
Si ces audacieux,
En retournant les yeux dans leur course olympique,
Avaient vu derrière eux la grande République
Montrant du doigt les cieux !
(Les Châtiments, livre II, vii : à l’Obéissance passive)
Jéricho2705 §
Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée.
Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée,
Suivi des siens, marchait, et, prophète irrité,
Sonnait de la trompette autour de la cité,
Au premier tour qu’il fit le roi se mit à rire ;
Au second tour, riant toujours, il lui fit dire :
« Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ? »
A la troisième fois l’arche allait en avant,
Puis les trompettes, puis toute l’armée en marche ;
Et les petits enfants venaient cracher sur l’arche,
Et, soufflant dans leur trompe, imitaient le clairon.
Au quatrième tour, bravant les fils d’Aaron2706,
Entre les vieux créneaux tout brunis par la rouille,
Les femmes s’asseyaient en filant leur quenouille,
Et se moquaient, jetant des pierres aux Hébreux ;
A la cinquième fois, sur ces murs ténébreux,
Aveugles et boiteux vinrent, et leurs huées
Raillaient le noir clairon sonnant sons les nuées ;
À la sixième fois, sur sa tour de granit,
Si haute qu’au sommet l’aigle faisait son nid,
Si dure que l’éclair l’eût en vain foudroyée,
Le roi revint, riant à gorge déployée,
Et cria : « Ces Hébreux sont bons musiciens » ;
Autour du roi joyeux riaient tous les anciens2707,
Qui le soir sont assis au temple et délibèrent.
A la septième fois, les murailles tombèrent2708.
(Les Châtiments, livre VII, i.)
Après la bataille §
Mon père, ce héros au sourire si doux2709,
Suivi d’un seul housard2710 qu’il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit.
C’était un Espagnol de l’armée en déroute,
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié,
Et qui disait : « A boire, à boire par pitié ! »
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit : « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ».
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de Maure,
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant : « Caramba2711 ! »
Le coup passa si près que le chapeau tomba,
Et que le cheval fit un écart en arrière.
« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père.
(La Légende des siècles, première série, XIII, 1.)
Les pauvres gens §
Fragments §
Il est nuit. La Cabane est pauvre, mais bien close.
Le logis est plein d’ombre, et l’on sent quelque chose
Qui rayonne à travers ce crépuscule obscur.
Des filets de pécheur sont accrochés au mur.
Au fond, dans l’encoignure où quelque humble vaisselle
Aux planches d’un bahut vaguement étincelle,
On distingue un grand lit aux longs rideaux tombants.
Tout près, un matelas s’étend sur de vieux bancs,
Et cinq petits enfants, nid d’âmes, y sommeillent.
La haute cheminée où quelques flammes veillent
Rougit le plafond sombre, et, le front sur le lit,
Une femme à genoux prie, et songe, et pâlit.
C’est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d’écume,
Au ciel, aux vents, aux rocs, à la nuit, à la brume,
Le sinistre océan jette son noir sanglot.
L’homme est en mer. Depuis l’enfance matelot,
Il livre au hasard sombre une rude bataille.
Pluie ou bourrasque, il faut qu’il sorte, il faut qu’il aille ;
Car les petits enfants ont faim. Il part le soir,
Quand l’eau profonde monte aux marches du musoir2712.
Il gouverne à lui seul sa barque à quatre voiles.
La femme est au logis, cousant les vieilles toiles,
Remmaillant les filets, préparant l’hameçon,
Surveillant l’âtre où bout la soupe de poisson,
Puis priant Dieu sitôt que les cinq enfants dorment.
Lui, seul, battu des flots qui toujours se reforment,
Il s’en va dans l’abîme et s’en va dans la nuit.
Dur labeur ! tout est noir, tout est froid ; rien ne luit....
—
Elle prend sa lanterne et sa cape. — C’est l’heure
D’aller voir s’il revient, si la mer est meilleure,
S’il fait jour, si la flamme2713 est au mât du signal.
Allons ! — Et la voilà qui part. L’air matinal
Ne souffle pas encore. Rien. Pas de ligne blanche
Dans l’espace où le flot des ténèbres s’épanche.
Il pleut. Rien n’est plus noir que la pluie au matin ;
On dirait que le jour tremble et doute, incertain,
Et qu’ainsi que l’enfant l’aube pleure de naître.
Elle va, l’on ne voit luire aucune fenêtre.
Tout à coup, à ses yeux qui cherchent le chemin,
Avec je ne sais quoi de lugubre et d’humain
Une sombre masure apparaît décrépite ;
Ni lumière, ni feu ; la porte au vent palpite ;
Sur les murs vermoulus branle un toit hasardeux ;
La bise sur ce toit tord des chaumes hideux,
Jaunes, sales, pareils aux grosses eaux d’un fleuve.
« Tiens ! je ne pensais plus à cette pauvre veuve,
Dit-elle ; mon mari, l’autre jour, la trouva
« Malade et seule ; il faut voir comment elle va. »
Elle frappe à la porte, elle écoute ; personne
Ne répond. Et Jeannie au vent de mer frissonne :
« Malade ! Et ses enfants ! comme c’est mal nourri !
Elle n’en a que deux, mais elle est sans mari. »
Puis elle frappe encore. « Hé ! voisine ! » Elle appelle,
Et la maison se tait toujours. « Ah ! Dieu ! dit-elle.
Comme elle dort, qu’il faut2714 l’appeler si longtemps ! »
La porte, cette fois, comme si, par instants,
Les objets étaient pris d’une pitié suprême,
Morne, tourna dans l’ombre et s’ouvrit d’elle-même.
Elle entra. Sa lanterne éclaira le dedans
Du noir logis muet au bord des flots grondants.
L’eau tombait du plafond comme des trous d’un crible.
Au fond était couchée une forme terrible ;
Une femme immobile et renversée, ayant
Les pieds nus, le regard obscur, l’air effrayant ;
Un cadavre ; — autrefois, mère joyeuse et forte ; —
Le spectre échevelé de la misère morte ;
Ce qui reste du pauvre après un long combat.
Elle laissait, parmi la paille du grabat,
Son bras livide et froid et sa main déjà verte
Pendre, et l’horreur sortait de cette bouche ouverte
D’où l’âme en s’enfuyant, sinistre, avait jeté
Ce grand cri de la mort qu’entend l’éternité !
Près du lit où gisait la mère de famille,
Deux tout petits enfants, le garçon et la fille,
Dans le même berceau souriaient endormis.
La mère, se sentant mourir, leur avait mis
Sa mante sur les pieds et sur le corps sa robe,
Afin que, dans cette ombre où la mort nous dérobe,
Ils ne sentissent plus la tiédeur qui décroît,
Et pour qu’ils eussent chaud pendant qu’elle aurait froid....
_
Qu’est-ce donc que Jeannie a fait chez cette morte ?
Sous sa cape aux longs plis qu’est-ce donc qu’elle emporte ?
Qu’est-ce donc que Jeannie emporte en s’en allant ?
Pourquoi son cœur bat-il ? Pourquoi son pas tremblant
Se hâte-t-il ainsi ? D’où vient qu’en la ruelle
Elle court, sans oser regarder derrière elle ?
Qu’est-ce donc qu’elle cache, avec un air troublé,
Dans l’ombre, sur son lit ? Qu’a-t-elle donc volé ?
_
Quand elle fut rentrée au logis, la falaise
Blanchissait ; près du lit elle prit une chaise
Et s’assit toute pâle ; on eût dit qu’elle avait
Un remords, et son front tomba sur le chevet,
Et, par instants, à mots entrecoupés, sa bouche
Parlait pendant qu’au loin grondait la ruer farouche.
« Mon pauvre homme ! ah ! mon Dieu ! que va-t-il dire ? il a
Déjà tant de souci ! Qu’est-ce que j’ai fait là ?
Cinq enfants sur les bras ! ce père qui travaille !
Il n’avait pas assez de peine ; il faut que j’aille
Lui donner celle-là de plus. — C’est lui ? — Non. Rien.
— J’ai mal fait. — S’il me bat, je dirai : Tu fais bien.
— Est-ce lui ? — Non. — Tant mieux. — La porte bouge comme2715
Si l’on entrait. Mais non. — Voilà-t-il pas, pauvre homme,
Que j’ai peur de le voir rentrer, moi, maintenant ! »
Puis elle demeura pensive et frissonnant,
S’enfonçant par degrés dans son angoisse intime,
Perdue en son souci comme dans un abîme,
N’entendant même plus les bruits extérieurs,
Les cormorans, qui vont comme de noirs crieurs,
Et l’onde et la marée et le vent en colère.
La porte tout à coup s’ouvrit, bruyante et claire,
Et lit dans la cabane entrer un rayon blanc ;
Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant,
Joyeux, parut au seuil, et dit : « C’est la marine2716 !
« C’est toi ! » cria Jeannie, et contre sa poitrine
Elle prit son mari, le prit éperdument,
Et lui baisa sa veste avec emportement.
Tandis que le marin disait : « Me voici, femme ! »
Et montrait sur son front qu’éclairait l’âtre en flamme
Son cœur bon et content que Jeannie éclairait.
« Je suis volé, dit-il ; la mer, c’est la forêt.
— Quel temps a-t-il fait ? - Dur. — Et la pêche ? — Mauvaise.
Mais, vois-tu, je t’embrasse et me voilà bien aise.
Je n’ai rien pris du tout. J’ai troué mon filet.
Le diable était caché dans le vent qui soufflait.
Quelle nuit ! Un moment, dans tout ce tintamarre,
J’ai cru que le bateau se couchait, et l’amarre
A cassé. Qu’as-tu fait, toi, pendant ce temps-là ? »
Jeannie eut un frisson dans l’ombre et se troubla.
« Moi ? dit-elle. Ah ! mon Dieu ! rien, comme à l’ordinaire,
J’ai cousu. J’écoutais la mer comme un tonnerre,
J’avais peur. — Oui, l’hiver est dur, mais c’est égal. »
Alors, tremblante ainsi que ceux qui font le mal,
Elle dit : « A propos, notre voisine est morte.
C’est hier qu’elle a dû mourir, enfin, n’importe,
Dans la soirée, après que vous fûtes partis.
Elle laisse ses deux enfants, qui sont petits.
L’un s’appelle Guillaume et l’autre Madeleine ;
L’un qui ne marche pas, l’autre qui parle à peine.
La pauvre bonne femme était dans le besoin. »
L’homme prit un air grave, et, jetant dans un coin
Son bonnet de forçat mouillé par la tempête :
« Diable ! diable ! dit-il, en se grattant la tête,
Nous avions cinq enfants, cela va faire sept.
Déjà, dans la saison mauvaise, on se passait
De souper quelquefois. Comment allons-nous faire ?
Bah ! tant pis ! ce n’est pas ma faute. C’est l’affaire
Du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds.
Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons ?
C’est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes.
Il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études.
Si petits ! on ne peut leur dire : Travaillez.
Femme, va les chercher. S’ils se sont réveillés,
Ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte.
C’est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte ;
Ouvrons aux deux enfants. Nous les mêlerons tous,
Cela nous grimpera le soir sur les genoux.
Ils vivront, ils seront frère et sœur des cinq autres.
Quand il verra qu’il faut nourrir avec les nôtres
Cette petite fille et ce petit garçon,
Le bon Dieu nous fera prendre plus de poisson.
Moi, je boirai de l’eau, je ferai double tâche,
C’est dit. Va les chercher. Mais qu’as-tu ? Ça te fâche ?
D’ordinaire, tu cours plus vite que cela.
— Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux, les voilà !
(La Légende des siècles, première série, XIII, 3.)
Le bon chevalier Roland §
Les dix infants d’Asturie, parmi lesquels Don Santos Pacheco le Hardi, Froïla,
Qui, si l’on veut Satan, peut dire : « Me voilà ! »
et Rostabat le Géant, sont réunis et délibèrent sur les moyens de faire disparaître Nuño, le petit roi de Galice, le fils du feu roi, leur frère, qui vient de mourir et dont ils veulent se partager l’héritage. Tout d’un coup un cavalier passe près d’eux et aperçoit l’enfant qu’ils ont enlevé. C’est Roland, le neveu de Charlemagne, et, comme il est dangereux de se brouiller avec lui, l’un des dix frères lui a proposé, s’il voulait s’associer à eux, de lui laisser une belle part de butin. Le chevalier prend alors la parole.
… « Avez-vous fait ce rêve ? » dit Roland2717.
Et présentant au roi son beau destrier2718 blanc :
« Tiens, roi ! pars au galop, hâte-toi, cours, regagne
Ta ville, et saute au fleuve et passe la montagne,
Va ! » L‘enfant-roi bondit en selle éperdument,
Et le voilà qui fuit sous le clair firmament,
À travers monts et vaux, pâle, à bride abattue.
« Çà, le premier qui monte à cheval, je le tue »,
Dit Roland.
Les infants se regardaient entre eux,
Stupéfaits. Et Roland : « Il serait désastreux
Qu’un de vous poursuivît cette proie échappée :
Je ferais deux morceaux de lui d’un coup d’épée,
Comme le Duero coupe Léon2719 en deux. »
Et, pendant qu’il parlait, à son bras hasardeux
La grande Durandal2720 brillait toute joyeuse.
Roland s’adosse au tronc robuste d’une yeuse,
Criant : « Défiez-vous de l’épée. Elle mord.
— Quand tu serais femelle ayant pour nom la Mort,
J’irais ! J’égorgerai Nuño dans la campagne ! »
Dit Pacheco, sautant sur son genet2721 d’Espagne.
Roland monte au rocher qui barre le chemin.
L’infant pique des deux2722 une dague à la main,
Une autre entre les dents, prêté à la repartie ;
Qui donc l’empêcherait de franchir la sortie ?
Ses poignets sont crispés d’avance du plaisir
D’atteindre le fuyard et de le ressaisir,
Et de sentir trembler sous l’ongle inexorable
Toute la pauvre chair de l’enfant misérable.
Il vient, et sur Roland il jette un long lacet ;
Roland, surpris, recule, et Pacheco passait....
Mais le grand paladin se roidit2723, et l’assomme
D’un coup prodigieux qui fendit en deux l’homme
Et tua le cheval, et si surnaturel
Qu’il creva le chanfrein et troua le girel2724.
« Qu’est-ce que j’avais dit ? lit Roland. Qu’on soit sage.
Reprit-il ; renoncez à forcer le passage ;
Si l’un de vous, bravant Durandal à mon poing,
A le cerveau heurté de folie à ce point,
Je lui ferai descendre au talon sa fêlure2725 ;
Voyez. » Don Froïla, caressant l’encolure
De son large cheval au mufle de taureau,
Crie : « Allons ! — Pas un pas de plus, caballero2726 ! »
Dit Roland. Et l’infant répond d’un coup de lance ;
Roland, atteint, chancelle, et Froïla s’élance ;
Mais Durandal se dresse, et jette Froïla
Sur Pacheco, dont l’âme en ce moment hurla2727.
Froïla tombe, étreint par l’angoisse dernière ;
Son casque, dont l’épée a brisé la charnière,
S’ouvre, et montre sa bouche où l’écume apparaît,
Bave épaisse et sanglante ! Ainsi, dans la forêt,
La sève en mai, gonflantes aubépines blanches,
S’enfle et sort en salive à la pointe des branches.
« Vengeance ! mort ! rugit Rostabat le Géant ;
Nous sommes cent contre un. Tuons ce mécréant2728
— Infants ! cria Roland, la chose est difficile ;
Car Roland n’est pas un. J’arrive de Sicile,
D’Arabie et d’Égypte, et tout ce que je sais,
C’est que des peuples noirs devant moi sont passés ;
Je crois avoir plané dans le ciel solitaire ;
Il m’a semblé parfois que je quittais la terre
Et l’homme, et que le dos monstrueux des griffons
M’emportait au milieu des nuages profonds ;
Mais, n’importe, j’arrive, et votre audace est rare,
Et j’en ris. Prenez garde à vous, car je déclare,
Infants, que j’ai toujours senti Dieu près de moi.
Vous êtes cent contre un ! Pardieu ! le bel effroi !
Fils, cent maravédis valent-ils une piastre2729 ?
Cent lampions sont-ils plus farouches qu’un astre ?
Combien de poux faut-il pour manger un lion ?
Vous êtes peu nombreux pour la rébellion
Et pour l’encombrement du chemin, quand je passe.
Arrière ! » Rostabat le Géant, tête basse,
Crachant les grognements rauques d’un sanglier,
Lourd colosse, fondit sur le bon chevalier,
Avec le bruit d’un mur énorme qui s’écroule :
Près de lui, s’avançant comme une sombre foule,
Les sept autres infants, avec leurs intendants,
Marchent, et derrière eux viennent, grinçant des dents,
Les cent coupe jarrets à faces renégates2730,
Coiffés de monteras et chaussés d’alpargates2731,
Demi-cercle féroce, agile, étincelant ;
Et tous font converger leurs piques sur Roland.
L’infant, monstre de cœur, est monstre de stature ;
Le rocher de Roland lui vient à la ceinture ;
Leurs fronts sont de niveau dans ces puissants combats,
Le preux étant en haut et le géant en bas.
Rostabat prend pour fronde, ayant Roland pour cible,
Un noir grappin qui semble une araignée horrible,
Masse affreuse oscillant au bout d’un long anneau :
Il lance sur Roland cet arrache-créneau ;
Roland l’esquive, et dit au géant : « Bête brute ! »
Le grappin égratigne un rocher dans sa chute,
Et le géant bondit, deux haches aux deux poings.
Le colosse et le preux, terribles, se sont joints.
« O Durandal, ayant coupé Dol2732 en Bretagne,
Tu peux bien me trancher encor cette montagne »,
Dit Roland, assenant l’estoc2733 sur Rostabat.
Comme sur ses deux pieds de devant l’ours s’abat,
Il tombe ; la bruyère écrasée est remplie
De cette monstrueuse et vaste panoplie ;
Relevée en tombant, sa chemise d’acier
Laisse nu son poitrail de prince carnassier,
Cadavre au ventre horrible, aux hideuses mamelles,
Et l’on voit le dessous de ses noires semelles.
Les sept princes vivants regardent les trois morts.
Et, pendant ce temps-là, lâchant rênes et mors,
Le pauvre enfant sauvé fuyait vers Compostelle.
Durandal brille et fait refluer devant elle
Les assaillants poussant des souffles d’aquilon ;
Toujours droit sur le roc qui ferme le vallon,
Roland crie au troupeau qui sur lui se resserre.
« Du renfort vous serait peut-être nécessaire.
Envoyez-en chercher. A quoi bon se presser ?
J’attendrai jusqu’au soir avant de commencer. »
(La Légende des siècles, première série, V : les Chevaliers errants, I : le Petit Roi de Galice, vii, viii.)
La fiancée d’Harou §
Harou.
… Mam’selle Lison..,.
Lison.
Dites Lisa.
Harou.
Lisa,
Vous êtes vertueuse et c’est pour ça....
Lison.
Pour ça
Que quoi ?
Harou.
Que je vous aime et que je vous épouse
Vous avez du bonheur, hein ? Plus d’une est jalouse
Vous sentez bien que moi, qui suis un gros fermier
Ayant acquêts et baux francs de droit coutumier2734,
C’est à qui m’aura. Vous, vous êtes sans famille.
Être madame Harou, quel sort pour une fille !
Avoir six cents arpents de blé, trois cents de foin !
Et dire, en regardant tout le pays très loin :
« C’est à moi ! » Voyez-vous, vous êtes orpheline ;
Pas un brin d’herbe n’est à vous sur la colline,
Et vous êtes sans dot comme la fleur des Champs.
Cela n’amuse pas les gens qui sont méchants
De voir que je vous prends pour femme. Ça les fâche :
Vous n’étiez qu’une pauvre ouvrière à la tâche,
Seule, et dont les parents sont morts sur des grabats,
Gagnant dix sous par jour à ravauder des bas.
Vous allez devenir bourgeoise, et cette chambre,
Où vous gelez, pas vrai2735, dès le mois de novembre,
Vous l’allez changer contre un bon logis, ma foi,
Où vous serez chez vous, bien qu’en étant chez moi,
Et d’où vous pourrez voir la mare avec les vignes,
Et des canards si gros qu’on les prend pour des cygnes.
Ah ! les commères font du train ! Moi, bon luron2736,
Tout ce tas d’oiseaux noirs qui bat de l’aileron,
Parce qu’elles voudraient être ce que vous êtes,
Me font rire. Piaillez, mesdames les chouettes !
Quand demain, bras dessus dessous, nous passerons,
Cela fera sortir du trou leurs gros yeux ronds ;
Ça sera farce2737. Et vous, vous prendrez un air crâne,
Vous direz : « Ma maison, mon champ, mon pré, mon âne ».
Et puis du cidre ! et puis du pain, plein le buffet !
Moi, j’ai de l’amitié pour vous. C’est ce qui fait
Que j’épouse. Sur vous, du reste, rien à dire.
Vous n’avez qu’un défaut, c’est que vous savez lire.
Moi pas2738. Ah ! par exemple, il faudra travailler ; —
Étant maîtresse, on est servante ; — s’éveiller
Au chant du coq, couper le seigle ou la fougère,
Être bonne faucheuse et bonne ménagère,
Manier gentiment la fourche à tour de bras,
Laver les murs, laver les lits, laver les draps,
Donner à boire aux gars ayant au dos leurs pioches,
Blanchir2739 l’âtre, écumer le pot, moucher des mioches,
Porter, si le chemin est long et raboteux,
Ses souliers à la main, les pieds s’usant moins qu’eux,
Et vivre ainsi pieds nus et riche, heureuse en somme
D’être une brave femme et d’avoir un brave homme.
Nos bans sont publiés. Je vous ai fait cadeau
Du parapluie, afin que, s’il tombe trop d’eau,
On ne s’en serve point, parce qu’il est en soie,
Et nous nous marions tantôt. Vive la joie !
(Les Quatre Vents de l’esprit. — Le Livre dramatique : Les Deux Trouvailles de Gallus, II, i, 1)
Brizeux
(1803-1858) §
Né à Lorient en 1803, mort en 1858, Julien-Auguste-Pélage Brizeux est le chantre de la Bretagne : c’est elle qu’il célèbre surtout, avec les joies et les souvenirs de son enfance, dans son délicieux recueil de Marie (1831), dans ceux de la Fleur d’Or (1841), de Primel et Nola (1852), dans les Histoires poétiques (1851), enfin dans son épopée rustique les Bretons (1846). Il a même composé des poésies en langue armoricaine, réunies sous le titre de la Harpe d’Armorique ou Telen Arvor.
Pendant les vacances §
La veillée au foyer §
Quelle joie en rentrant, mais calme et sans délire,
Quand, debout sur la porte et tâchant de sourire,
Une mère inquiète est là qui vous attend,
Vous baise sur le front, et pour vous à l’instant
Presse les serviteurs, quand le foyer pétille,
Et que nul n’est absent du repas de famille !
Monotone la veille, et vide, la maison
S’anime : un rayon d’or luit sur chaque cloison ;
Le couvert s’élargit ; comme des fruits d’automne,
D’enfants beaux et vermeils la table se couronne,
Et puis mille babils, mille gais entretiens,
Un fou rire, et souvent de longs pleurs pour des riens.
Mais plus tard, lorsqu’on touche aux soirs gris de septembre
En cercle réunis dans la plus grande chambre,
C’est alors qu’il est doux de veiller au foyer !
On roule près du feu la table de noyer,
On s’assied ; chacun prend son cahier, son volume ;
Grand silence ! on n’entend que le bruit de la plume,
Le feuillet qui se tourne, ou le châtaignier vert
Qui craque, et l’on se croit au milieu de l’hiver.
Les yeux sur ses enfants, et rêveuse, la mère
Sur leur sort à venir invente une chimère,
Songe à l’époux absent depuis la fin du jour,
Et prend garde que rien ne manque à son retour.
L’aïeule cependant sur sa chaise se penche,
Et devant le Seigneur courbe sa tête blanche.
Écoutez-la, Seigneur, et pour elle, et pour nous !
Cette femme, ô mon Dieu, qui vous prie à genoux,
Ne la repoussez pas ! Soixante ans à la gêne,
Et toujours courageuse elle a porté sa chaîne :
Une heure de repos2740 avant le grand sommeil !
Avant le jour sans fin, quelques jours au soleil !
(Marie : le Mois d’août.)
__
La mort de Louise2741 §
Quand Louise mourut à sa quinzième année,
Fleur des bois par la pluie et le vent moissonnée,
Un cortège nombreux ne suivit pas son deuil ;
Un seul prêtre en priant conduisit le cercueil ;
Puis venait un enfant qui d’espace en espace,
Aux saintes oraisons répondait à voix basse ;
Car Louise était pauvre, et jusqu’en son trépas
Le riche a des honneurs que le pauvre n’a pas :
La simple croix de buis, un vieux drap mortuaire,
Furent les seuls apprêts de son lit funéraire ;
Et quand le fossoyeur, soulevant son beau corps,
Du village natal l’emporta chez les morts,
A peine si la cloche avertit la contrée
Que sa plus douce vierge en était retirée.
Elle mourut ainsi. — Par les taillis couverts,
Les vallons embaumés, les genêts, les blés verts,
Le convoi descendit au lever de l’aurore :
Avec toute sa pompe Avril venait d’éclore,
Et couvrait en passant d’une neige de fleurs
Ce cercueil virginal, et le baignait de pleurs ;
L’aubépine avait pris sa robe rose et blanche ;
Un bourgeon étoilé tremblait à chaque branche ;
Ce n’étaient que parfums et concerts infinis :
Tous les oiseaux chantaient sur le bord de leurs nids.
(Marie : la Chaîne d’or.)
Auguste Barbier
(1805-1882) §
Né à Paris en 1805, mort en 1882, Henri-Auguste Barbier a publié plusieurs recueils de vers et quelques récits en prose. Mais on peut dire qu’il doit toute sa renommée à un recueil de satires sociales et politiques, les Iambes2742 qui fut publié après la révolution de juillet 1830, et à deux poèmes ou plutôt deux suites de poésies dans lesquelles il déplore avec beaucoup de grandeur et de pathétique l’abaissement politique de l’Italie et la misère du peuple en Angleterre, il Pianto2743 (1832) et Lazare (1833).
Les belles collines d’Irlande §
Le jour où j’ai quitté le sol de mes aïeux,
La verdoyante Erin2744 et ses belles collines,
Ah ! pour moi ce jour-là fut des plus malheureux.
Là les vents embaumés inondent les poitrines ;
Tout est si beau, si doux, les sentiers, les ruisseaux,
Les eaux que les rochers distillent aux prairies,
Et la rosée en perle attachée aux rameaux,
O terre de mon cœur, ô collines chéries,
Et pourtant, pauvres gens, pêle-mêle et nu-pieds,
Sur le pont des vaisseaux près de mettre à la voile,
Hommes, femmes, enfants, nous allons par milliers
Chercher aux cieux lointains une meilleure étoile ;
La famine nous ronge au milieu de nos champs,
Et pour nous les cités regorgent de misère ;
Nos corps nus et glacés n’ont pour tous vêtements
Que les haillons troués de la riche Angleterre.
Pourquoi d’autres que nous mangent-ils les moissons
Que nos bras en sueur semèrent dans nos plaines ?
Pourquoi d’autres ont-ils pour habits les toisons
Dont nos lacs ont lavé les magnifiques laines ?
Pourquoi ne pouvons-nous rester au même coin,
Et, tous enfants, puiser à la même mamelle ?
Pourquoi les moins heureux s’en vont-ils le plus loin,
Et pourquoi quittons-nous la terre maternelle ?...
Bienheureux les troupeaux2745 qui paissent, vagabonds,
Les pâtures de trèfle en nos fraîches vallées !
Heureux les chers oiseaux qui chantent leurs chansons
Dans les bois frissonnants où passent leurs volées !
Oh ! les vents sont bien doux clans nos prés murmurants,
Et les meules de foin ont des odeurs divines ;
L’oseille et le cresson garnissent les courants
De tous vos clairs ruisseaux, ô mes belles collines !
(Lazare2746.)
Les mineurs de Newcastle2747 §
Que d’autres sur les monts boivent à gorge pleine
Des vents impétueux la bienfaisante haleine,
Et s’inondent le front d’un air suave et pur ;
Que d’autres, emportés par des voiles légères,
Passent comme les vents sur les ondes amères,
Et sillonnent sans fin leur magnifique azur ;
Que d’autres, chaque jour, emplissent leur paupière
Des rayons colorés de la chaude lumière,
Et contemplent le ciel dans ses feux les plus beaux ;
Que d’autres, près d’un toit festonné de verdure,
Travaillent tout le jour au sein de la nature,
Et s’endorment le soir au doux chant des oiseaux :
Ils ont reçu du ciel un regard favorable.
Ils sont nés, ces mortels, sous une étoile aimable2748
Et sous le signe heureux d’un mois splendide et chaud,
Et la main du Seigneur, qui sur terre dispense
La peine et le plaisir, la mort et l’existence,
Leur a fait large part et donné le bon lot.
Quant à nous, prisonniers comme de vils esclaves,
Nous sommes pour la vie enfermés dans des caves,
Non pour avoir des lois souillé la majesté,
Mais parce que, du jour où nous vînmes au monde,
La misère au cœur dur, notre nourrice immonde,
Nous marqua pour la peine et pour l’obscurité.
Nous sommes les mineurs de la riche Angleterre ;
Nous vivons, comme taupe, à six cents pieds sous terre,
Et là, le fer en main, tristement nous fouillons,
Nous arrachons la houille à la terre fangeuse ;
La nuit couvre nos reins de sa mante brumeuse,
Et la mort, vieux hibou, vole autour de nos fronts.
Malheur à l’apprenti qui, dans un jour d’ivresse,
Pose un pied chancelant sur la pierre traîtresse !
Au plus creux de l’abîme il roule pour toujours.
Malheur au pauvre vieux dont la jambe est inerte,
Lorsque l’onde, en courroux de se voir découverte,
Envahit tout le gouffre2749 ! Il périt sans secours.
Malheur à l’imprudent, malheur au téméraire
Qui descend sans avoir la lampe salutaire
Qu’un ami des humains fit pour le noir mineur2750 !
Car le mauvais esprit qui dans l’ombre le guette,
La bleuâtre vapeur, sur lui soudain se jette,
Et l’étend sur le sol, sans pouls et sans chaleur.
Malheur, malheur à tous ! car même sans reproche2751,
Lorsque chacun de nous fait sa tâche, une roche
Se détache souvent au bruit seul du marteau ;
Et plus d’un qui rêvait dans le fond de son âme
Aux cheveux blonds d’un fils, à l’œil bleu de sa femme,
Trouve au ventre du gouffre un éternel tombeau.
Et cependant c’est nous, pauvres ombres muettes,
Qui faisons circuler au-dessus de nos têtes
Le mouvement humain avec tant de fracas ;
C’est avec le trésor qu’au risque de la vie
Nous tirons de la terre, ô puissante industrie !
Que nous mettons en jeu tes gigantesques bras.
C’est la houille qui fait bouillonner les chaudières,
Rugir les hauts fourneaux tout chargés de matières,
Et rouler sur le fer l’impétueux wagon ;
C’est la houille qui fait par tous les coins du monde,
Sur le sein écumant de la vague profonde,
Bondir en souverains les vaisseaux d’Albion2752.
O Dieu ! Dieu tout-puissant ! pour les plus justes causes
Nous ne demandons pas le tumulte des choses
Et le renversement de l’ordre d’ici-bas ;
Nous ne te prions pas de nous mettre à la place
Des hommes de savoir et des hommes de race,
Et de remplir nos mains de l’or des potentats ;
Ce dont nous te prions, enfants de la misère,
C’est d’amollir le cœur des puissants de la terre,
Et d’en faire pour nous un plus solide appui ;
C’est de leur rappeler sans cesse, par exemple,
Qu’en laissant2753 dépérir les fondements du temple,
Le monument s’écroule et tout tombe avec lui.
(Lazare.)
Hégésippe Moreau
(1810-1838) §
Hégésippe Moreau est né à Paris en 1810 et mort en 1838. Sa destinée fut vraiment digne de pitié. Apprenti chez un imprimeur de Provins, mais sentant s’éveiller son talent poétique, il vient à Paris, où la misère et la maladie le forcent d’entrer à l’hôpital, retourne à Provins, puis rentre de nouveau à Paris, un an après, et commence à peine à sortir de l’obscurité, sinon de la gêne, quand il lui faut reprendre son lit d’hôpital, cette fois pour ne plus le quitter. Quelques pièces d’un charme exquis ont fait vivre son nom. Outre ses poésies, réunies en un recueil intitulé le Myosotis, Hégésippe Moreau a écrit quelques aimables nouvelles en prose.
La fermière §
Amour à la fermière ! elle est
Si gentille et si douce !
C’est l’oiseau des bois qui se plaît
Loin du bruit, dans ta mousse ;
Vieux vagabond qui tends la main,
Enfant pauvre et sans mère,
Puissiez-vous trouver en chemin
La ferme et la fermière.
De l’escabeau vide au foyer
Là le pauvre s’empare,
Et le grand bahut de noyer
Pour lui n’est point avare ;
C’est là qu’un jour je vins m’asseoir,
Les pieds blancs de poussière ;
Un jour,… puis en marche ! et bonsoir
La ferme et la fermière !
Mon seul beau jour a dû finir,
Finir dès son aurore ;
Mais pour moi ce doux souvenir
Est du bonheur encore :
En fermant les yeux, je revois
L’enclos plein de lumière,
La haie en fleurs, le petit bois,
La ferme et la fermière !
Si Dieu, comme notre curé
Au prône le répète,
Paie un bienfait (même égaré),
Ah ! qu’il songe à ma dette !
Qu’il prodigue au vallon ses fleurs,
La joie à la chaumière,
Et garde des vents et des pleurs
La ferme et la fermière !
Chaque hiver, qu’un groupe d’enfants
A son fuseau sourie,
Comme les anges aux fils blancs
De la vierge Marie !
Que tous, par la main, pas à pas,
Guidant un petit frère,
Réjouissent de leurs ébats
La ferme et la fermière !
envoi 2754
Ma chansonnette, prends ton vol !
Tu n’es qu’un faible hommage ;
Mais qu’en avril le rossignol
Chante et la dédommage ;
Qu’effrayé par ses chants d’amour,
L’oiseau du cimetière,
Longtemps, longtemps se taise pour
La ferme et la fermière2755 !
(Le Myosotis.)
Sur la mort d’une cousine de sept ans §
Hélas ! si j’avais su, lorsque ma voix qui prêche
T’ennuyait de leçons, que sur toi, rose et fraîche,
Le noir oiseau des morts planait inaperçu ;
Que la fièvre guettait sa proie, et que la porte
Où tu jouais hier te verrait passer morte....
Hélas ! si j’avais su !...
Je t’aurais fait, enfant, l’existence bien douce ;
Sous chacun de tes pas j’aurais mis de la mousse ;
Tes ris auraient sonné chacun de tes instants ;
Et j’aurais fait tenir dans ta petite vie
Un trésor de bonheur immense… à faire envie
Aux heureux de cent ans !
Loin des bancs où pâlit l’enfance prisonnière,
Nous aurions fait tous deux l’école buissonnière
Dans les bois pleins de chants, de parfum et d’amour ;
J’aurais vidé leurs nids pour emplir ta corbeille ;
Et je t’aurais donné plus de fleurs qu’une abeille
N’en peut voir en un jour.
Puis, quand le vieux Janvier, les épaules drapées
D’un long manteau de neige et suivi de poupées,
De magots, de pantins, minuit sonnant accourt ;
Au milieu des cadeaux qui pleuvent pour étrenne,
Je t’aurais fait asseoir comme une jeune reine
Au milieu de sa cour.
Mais je ne savais pas… et je prêchais encore :
Sûr de ton avenir, je le pressais d’éclore,
Quand tout à coup, pleurant un long espoir déçu,
De tes petites mains je vis tomber le livre ;
Tu cessas à la fois de m’entendre et de vivre...
Hélas ! si j’avais su !
(Le Myosotis.)
Alfred de Musset
(1810-1857) §
Né à Paris en 1810, mort en 1857, Louis-Charles-Alfred de Musset est un des plus grands poètes du xixe siècle. En 1830 il publia ses Contes d’Espagne et d’Italie, d’allure spirituellement provocante, et composés tout à fait dans la manière de l’école romantique2756. Sa verve est déjà plus réglée dans le recueil qu’il publia deux ans plus tard et dans les deux pièces, suivies du poème de Namouna, qui composent le Spectacle dans un fauteuil. Mais c’est dans ses Poésies nouvelles (1835-1840) que se trouvent ses plus belles inspirations, les Nuits, l’Ode à la Malibran, l’Espoir en Dieu. Comme prosateur, Musset a laissé des Comédies et Proverbes, œuvres pleines à la fois de fantaisie et de sensibilité, un roman, la Confession d’un enfant du siècle (1836), des Contes et Nouvelles, et diverses études d’art et de littérature.
A un ami §
Dans mes jours de malheur2757, Alfred, seul entre mille,
Tu m’es resté fidèle où tant d’autres m’ont fui,
Le bonheur m’a prêté plus d’un lien fragile ;
Mais c’est l’adversité qui m’a fait un ami.
C’est ainsi que les fleurs sur les coteaux fertiles
Étalent au soleil leur vulgaire trésor ;
Mais c’est au sein des nuits, sous des rochers stériles,
Que fouille le mineur qui cherche un rayon d’or.
C’est ainsi que les mers, calmes et sans orages,
Peuvent d’un flot d’azur bercer le voyageur,
Mais c’est le vent du nord, c’est le vent des naufrages
Qui jette sur la rive une perle au pêcheur.
Maintenant Dieu me garde ! Où vais-je ? Eh ! que m’importe ?
Quels que soient mes destins, je dis comme Byron2758 :
« L’Océan peut gronder, il faudra qu’il me porte ».
Si mon coursier s’abat, j’y mettrai l’éperon.
Mais du moins j’aurai pu, frère, quoi qu’il m’arrive,
De mon cachet de deuil sceller notre amitié,
Et, que demain je meure ou que demain je vive,
Pendant que mon cœur bat, t’en donner la moitié.
(Premières Poésies.)
La chaumière frappée de la foudre §
Lorsque le laboureur, regagnant sa chaumière,
Trouve le soir son champ rasé par le tonnerre,
Il croit d’abord qu’un rêve a fasciné ses yeux,
Et, doutant de lui-même, interroge les cieux.
Partout la nuit est sombre, et la terre enflammée.
Il cherche autour de lui la place accoutumée
Où sa femme l’attend sur le seuil entr’ouvert ;
Il voit un peu de cendre au milieu d’un désert.
Ses enfants demi-nus sortent de la bruyère,
Et viennent lui conter comme leur pauvre mère
Est morte sous le chaume avec des cris affreux ;
Mais maintenant au loin tout est silencieux.
Le misérable écoute et comprend sa ruine,
Il serre, désolé, ses fils sur sa poitrine ;
Il ne lui reste plus, s’il ne tend pas la main,
Que la faim pour ce soir et la mort pour demain.
Pas un sanglot ne sort de sa gorge oppressée ;
Muet et chancelant, sans force et sans pensée,
Il s’assoit à l’écart, les yeux sur l’horizon,
Et, regardant2759 s’enfuir sa moisson consumée,
Dans les noirs tourbillons de l’épaisse fumée
L’ivresse du malheur emporte sa raison.
(Poésies nouvelles : Lettre à Lamartine.)
La Fontaine §
C’est avec celui-là qu’il est bon de veiller ;
Ouvrez-le sur votre oreiller,
Vous verrez se lever l’aurore2760 !
Molière l’a prédit2761, et j’en suis convaincu :
Bien des choses auront vécu,
Quand nos enfants liront encore
Ce que le bonhomme a conté,
Fleur de sagesse et de gaîté.
Mais quoi ! la mode vient et tue un vieil usage2762 ;
On n’en veut plus, du sobre et franc langage
Dont il enseignait la douceur,
Le seul français et qui vienne du cœur ;
Car n’en déplaise à l’Italie2763,
La Fontaine, sachez-le bien,
En prenant tout, n’imita rien.
Il est sorti du sol de la patrie,
Le vert laurier qui couvre son tombeau ;
Comme l’antique, il est nouveau2764.
(Poésies nouvelles : Sylvia.)
Le joueur et l’enfant §
Me voici donc à Bade2765 ; et vous pensez sans doute,
Puisque j’ai commencé par vous parler du jeu,
Que j’eus pour premier soin d’y perdre quelque peu.
Vous ne vous trompez pas, je vous en fais l’aveu2766.
De même que, pour mettre une armée en déroute,
Il ne faut qu’un poltron qui lui montre la route,
De même, dans ma bourse, il ne faut qu’un écu
Qui tourne les talons, et le reste est perdu.
Tout ce que je possède a quelque ressemblance
Aux moutons de Panurge : au premier qui commence,
Voilà Panurge à sec et son troupeau tondu2767.
Hélas ! le premier pas se fait sans qu’on y pense.
Ma poche est comme une île escarpée et sans bords,
On n’y saurait rentrer quand on est en dehors2768.
Au moindre fil cassé, l’écheveau se dévide :
Entraînement funeste et d’autant plus perfide,
Que j’eus dans tous les temps la sainte horreur du vide2769,
Et qu’après le combat je rêve à tous mes morts.
Un soir, venant de perdre une bataille honnête,
Je n’avais plus à moi qu’un grand mal à la tête....
Une bonne passa, qui tenait un enfant.
Je crus m’apercevoir que le pauvre innocent
Avait dans ses grands yeux quelque mélancolie.
Ayant toujours aimé cet âge à la folie,
Et ne pouvant souffrir de le voir maltraité,
Je fus à la rencontre, et m’enquis de la bonne2770
Quel motif de colère ou de sévérité
Avait du chérubin dérobé la gaieté.
« Quoi qu’il ait fait, d’abord, je veux qu’on lui pardonne,
Lui dis-je, et ce qu’il veut, je veux qu’on le lui donne. »
(C’est mon opinion de gâter les enfants.)
Le marmot là-dessus, m’accueillant d’un sourire,
D’abord à me répondre hésita quelque temps ;
Puis il tendit la main et finit par me dire :
« Qu’il n’avait pas de quoi donner aux mendiants. »
Le ton dont il le dit, je ne peux pas l’écrire ;
Mais vous savez, lecteur, que j’étais ruiné ;
J’avais encor, je crois, deux écus dans ma bourse ;
C’était, en vérité, mon unique ressource,
La seule goutte d’eau qui restât dans la source,
Le seul verre de vin pour mon prochain dîné ;
Je les tirai bien vite, et je les lui donnai !
Il les prit sans façon, et s’en fut2771 de la sorte.
A quelques jours de là, comme j’étais au lit,
La Fortune en passant vint frapper à ma porte.
Je reçus de Paris une somme assez forte,
Et très heureusement il me vint à l’esprit
De payer l’hôtelier qui m’avait fait crédit2772.
(Poésies nouvelles : Une bonne fortune.)
Les paysans aux jeux de Bade §
L’abreuvoir est public, et qui veut vient y boire.
J’ai vu les paysans, fils de la Foret-Noire,
Leurs bâtons à la main, entrer dans ce réduit ;
Je les ai vus penchés sur la bille d’ivoire2773,
Ayant à travers champs couru toute la nuit,
Fuyards désespérés de quelque honnête lit ;
Je les ai vus, debout, sous la lampe enfumée,
Avec leur veste rouge et leurs souliers boueux,
Tournant leurs grands chapeaux entre leurs doigts calleux,
Poser sous les râteaux2774 la sueur d’une année,
Et là, muets d’horreur devant la Destinée,
Suivre des yeux leur pain qui courait devant eux !
Dirai-je qu’ils perdaient ? Hélas ! ce n’était guères.
C’était bien vite fait de leur vider les mains.
Ils regardaient alors toutes ces étrangères,
Cet or, ces voluptés, ces belles passagères,
Tout ce monde enchanté de la saison des bains,
Qui s’en va sans poser le pied sur les chemins2775.
Ils couraient, ils partaient, tout ivres de lumière,
Et la nuit sur leurs yeux posait son noir bandeau.
Ces mains vides, ces mains qui labourent la terre,
Il fallait les étendre, en rentrant au hameau,
Pour trouver à tâtons les murs de la chaumière,
L’aïeule au coin du feu, les enfants au berceau.
(Poésies nouvelles : Une bonne fortune.)
Plein d’orgueil et d’envie §
Les Chasseurs, Frank. §
Le Chœur.
Diane a protégé notre course lointaine.
Chargés d’un lourd butin, nous marchions avec peine ;
Amis, reposons-nous ; — déjà, le verre en main,
Nos frères sous ce toit commencent leur festin.
Frank.
Moi, je n’ai rien tué ; — la ronce et la bruyère
Ont déchiré mes mains ; — mon chien, sur la poussière
À léché dans mon sang la trace de mes pas.
Le Chœur.
Ami, les jours entre eux ne se ressemblent pas.
Approche, et viens grossir notre joyeuse troupe.
L’amitié, camarade, est semblable à la coupe
Qui passe, au coin du feu, de la main à la main,
L’un y boit son bonheur, et l’autre sa misère ;
Le ciel a mis l’oubli pour tous au fond du verre ;
Je suis heureux ce soir, tu le seras demain.
Frank.
Mes malheurs sont à moi, je ne prends pas les vôtres.
Je ne sais pas encor vivre aux dépens des autres ;
J’attendrai pour cela qu’on m’ait coupé les mains.
Je ne ferai jamais qu’un maigre parasite ;
Car ce n’est, qu’un long jeûne et qu’une faim maudite
Qui me feront courir à l’odeur des festins.
Je tire mieux que vous, et j’ai meilleure vue.
Pourquoi ne vois-je rien ? voilà la question.
Suis-je un épouvantail ? — ou bien l’occasion,
La perfide déesse, est-elle devenue
Si boiteuse et si chauve, à force de courir,
Qu’on ne puisse à la nuque une fois la saisir2776 ?
J’ai cherché comme vous le chevreuil dans la plaine, —
Mon voisin l’a tué, mais je ne l’ai pas vu.
Le Chœur.
Et si c’est ton voisin, pourquoi le maudis-tu ?
C’est la communauté qui fait la force humaine.
Frank, n’irrite pas Dieu, — le roseau doit plier.
L’homme sans patience est la lampe sans huile,
Et l’orgueil en colère est mauvais conseiller.
Frank.
Votre communauté me soulève la bile.
Je n’en suis pas encore à mendier mon pain.
Mordieu ! voilà de l’or, messieurs, j’ai de quoi vivre.
S’il plaît à l’ennemi des hommes2777 de me suivre2778,
Il peut s’attendre encore à faire du chemin2779....
Le Chœur.
Frank, une ambition terrible te dévore.
Ta pauvreté superbe2780 elle-même s’abhorre ;
Tu te hais, vagabond, dans ton orgueil de roi,
Et tu hais ton voisin d’être semblable à toi.
Parle, aimes-tu ton père ? aimes-tu ta patrie ?
Au souffle du matin sens-tu ton cœur frémir,
Et t’agenouilles-tu lorsque tu vas dormir ?
De quel sang es-tu fait, pour marcher dans la vie
Comme un homme de bronze, et pour que l’amitié,
L’amour, la confiance et la douce pitié
Viennent toujours glisser sur ton être insensible,
Comme des gouttes d’eau sur un marbre poli ?
Ah ! celui-là vit mal qui ne vit que pour lui.
L’âme, rayon du ciel, prisonnière invisible,
Souffre dans son cachot2781 de sanglantes douleurs.
Du fond de son exil elle cherche ses sœurs2782,
Et les pleurs et les chants sont les voix éternelles
De ces filles de Dieu qui s’appellent entre elles.
Frank.
Chantez donc, et pleurez, si c’est votre souci.
Ma malédiction n’est pas bien redoutable ;
Telle qu’elle est pourtant je vous la donne ici.
Nous allons boire un toast, en nous mettant à table,
Et je vais le porter :
(Prenant un verre)
Malheur aux nouveau-nés !
Maudit soit le travail ! maudite l’espérance !
Malheur au coin de terre où germe la semence,
Où tombe la sueur de deux bras décharnés !
Maudits soient les liens du sang et de la vie !
Maudites la famille et la société !
Malheur à la maison, malheur à la cité,
Et malédiction sur la mère patrie !
un autre chœur, sortant d’une maison.
Qui parle ainsi ? qui vient jeter sur notre toit,
A cette heure de nuit, ces clameurs monstrueuses,
Et nous sonner ainsi les trompettes hideuses2783
Des malédictions ? — Frank, réponds, est-ce toi ?
Ce n’est pas d’aujourd’hui que je connais ta vie.
Tu le es qu’un paresseux, plein d’orgueil et d’envie.
Mais de quel droit viens-tu troubler des gens de bien ?
Tu hais notre métier, Judas ? et nous, le tien.
Que ne vas-tu courir et tenter la fortune,
Si le toit de ton père est trop bas pour ton front ?
Ton orgueil est scellé comme un cercueil de plomb.
Tu crois punir le ciel en lui gardant rancune ;
Et tout ce que tu peux, c’est de roidir2784 tes bras
Pour blasphémer un Dieu qui ne t’aperçoit pas.
Travailles-tu pour vivre et pour t’aider toi-même ?
Ne te souviens-tu pas que l’ange du blasphème
Est de tous les déchus le plus audacieux,
Et qu’avant de maudire il est tombé des cieux ?
(Premières Poésies : la Coupe et les lèvres, acte I, sc. i.)
Le Comte Irus §
irus2785, à sa toilette.
Lequel de vous, marauds, m’a posé ma perruque ?
Outre que les rubans me font mal à la nuque,
Je suis couvert de poudre, et j’en ai plein les yeux.
Quinola.
Ce n’est pas moi.
Spadille.
Ni moi.
Quinola.
Moi, je tenais la queue.
Spadille.
Moi, monsieur, je peignais.
Irus.
Vous mentez tous les deux.
Allons, mon habit rose et ma culotte bleue.
Hum ! Hum ! Diable de poudre ! — Hatsch ! je suis aveuglé.
(Il éternue.)
Quinola, ouvrant une armoire.
Monsieur, vous ne sauriez mettre votre culotte.
La lampe était auprès : toute l’huile a coulé.
spadille, ouvrant une autre armoire.
Monsieur, votre habit rose est tout rempli de crotte ;
Quand je l’ai déployé, le chat était dessus.
Irus.
Ciel ! de cette façon voir tous mes plans déçus !
Écoutez, mes amis ; il me vient une idée :
Quelle heure est-il ?
Spadille.
Monsieur, l’horloge est arrêtée.
Irus.
A-t-on sonné déjà deux coups pour le dîné ?
Quinola.
Non, l’on n’a pas sonné.
Spadille.
Si, si, l’on a sonné.
Irus.
Je tremble à chaque instant que le nouveau convive
Qui doit venir dîner ne paraisse et n’arrive.
Spadille.
Il faut vous mettre en vert.
Quinola.
Il faut vous mettre en gris.
Irus.
Dans quel mois sommes-nous ?
Spadille.
Nous sommes en novembre.
Quinola.
En août ! en août2786 !
Irus.
Mettez ces deux habits.
Vous vous promènerez ensuite par la chambre,
Pour que je voie un peu l’effet que je ferai.
(Les valets obéissent.)
Spadille.
Moi, j’ai l’air d’un marquis.
Quinola.
Moi, j’ai l’air d’un ministre.
irus, les regardant.
Spadille a l’air d’une oie, et Quinola d’un cuistre.
Je ne sais pas à quoi je me déciderai.
laerte, entrant.
Et vous, vous avez l’air, mon neveu, d’une bête.
N’êtes-vous pas honteux de vous poudrer la tête,
Et de perdre à courir dans votre cabinet
Plus de temps qu’il n’en faut pour écrire un sonnet2787 ?
Allons, venez dîner ; votre assiette s’ennuie.
Irus.
Vous ne voudriez pas, au prix de votre vie,
Me traîner au salon, sans rouge et demi-nu ?
Quel habit faut-il mettre ?
Laerte.
Eh ! le premier venu.
Allons, écoutez-moi. Vous trouverez à table
Le nouvel arrivé ; c’est un jeune homme aimable,
Qui vient pour épouser un de mes chers enfants2788.
Jetez, au nom de Dieu, vos regards triomphants
Sur un autre que lui2789 ; ne cherchez pas à plaire,
Et n’avalez pas tout2790 comme à votre ordinaire.
Il est simple et timide, et de bonne façon ;
Enfin, c’est ce qu’on nomme un honnête garçon.
Tâchez, si vous trouvez ses manières communes,
De ne point décocher, en prenant du tabac,
Votre charmant sourire et vos mots d’almanach2791.
Tarissez, s’il se peut, sur vos bonnes fortunes.
Ne vous inondez pas de vos flacons damnés ;
Qu’on puisse vous parler sans se boucher le nez.
Vos gants blancs sont de trop ; on dîne les mains nues.
Irus.
Je suis presque tenté, pour cadrer à vos vues,
D’ôter mon habit vert, et de me mettre en noir.
Laerte.
Non, de par tous les saints, non, je vous remercie.
La peste soit de vous ! Qui diantre se soucie,
Si votre habit est vert, de s’en apercevoir ?
Irus.
Puis-je savoir au moins le nom de ce jeune homme ?
Laerte.
Qu’est-ce que ça vous fait ? C’est Silvio qu’il se nomme.
Irus.
Silvio ! ce n’est pas mal… Silvio ! ce nom est bien. Irus,… Irus,… Silvio,… mais j’aime mieux le mien.
(Premières poésies : A quoi rêvent les jeunes filles, acte I, sc. ii.)
Théophile Gautier
(1811-1872) §
Né à Tarbes en 1811, mort en 1872, Théophile Gautier, l’un des plus fervents adeptes des théories romantiques, a publié plusieurs recueils de Poésies, notamment celui qu’il a intitulé Emaux et Camées (1852), qui se recommandent surtout par les mérites d’une versification achevée, l’emploi savant des rythmes, la richesse et le piquant des rimes. Comme prosateur, Gautier a laissé plusieurs recueils d’articles de critique, des récits de voyages en Espagne, en Russie, en Italie, en Orient, et des romans, dont les plus célèbres sont le Roman de la Momie et le Capitaine Fracasse (1863)2792.
Premier sourire du printemps §
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.
Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement, lorsque tout dort,
Il repasse des collerettes,
Et ciselle des boutons-d’or.
Dans le verger et dans la vigne,
Il s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne
Poudrer à frimas2793 l’amandier.
La nature au lit se repose ;
Lui descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.
Tout en composant des solfèges,
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
Il sème aux prés les perce-neiges2794
Et les violettes aux bois.
Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.
Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
Il met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.
Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
Il dit : « Printemps, tu peux venir ! »
(Émaux et Camées.)
Ce que disent les hirondelles §
Chanson d’automne §
Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis ;
Soir et matin la brise est fraîche :
Hélas ! les beaux jours sont finis !
On voit s ouvrir ces fleurs que garde
Le jardin pour dernier trésor ;
Le dahlia met sa cocarde
Et le souci sa toque d’or.
La pluie au jardin fait des bulles ;
Les hirondelles sur le toit
Tiennent des conciliabules :
Voici l’hiver, voici le froid !
Elles s’assemblent par centaines,
Se concertant pour le départ.
L’une dit : « Oh ! que dans Athènes
« Il fait bon sur le vieux rempart !
« Tous les ans j’y vais, et je niche
« Aux métopes du Parthénon2795 ;
« Mon nid bouche dans la corniche
« Le trou d’un boulet de canon2796. »
L’autre : « J’ai ma petite chambre
« A Smyrne, au plafond d’un café.
« Les Hadjis2797 comptent leurs grains d’ambre2798
« Sur le seuil, d’un rayon chauffé.
« J’entre et je sors, accoutumée
« Aux blondes vapeurs des chibouchs2799 »
« Et, parmi des flots de fumée,
« Je rase turbans et tarbouchs2800. »
Celle-ci : « J’habite un triglyphe2801,
« Au fronton d’un temple, à Balbek2802 ;
« Je m’y suspends avec ma griffe
« Sur mes petits au large bec. »
Celle-là : « Voici mon adresse :
« Rhodes, palais des Chevaliers2803 ;
« Chaque hiver ma tente s’y dresse
« Au chapiteau des noirs piliers. »
La cinquième : « Je ferai halte,
« Car l’âge m’alourdit un peu,
« Aux blanches terrasses de Malte,
« Entre l’eau bleue et le ciel bleu. »
La sixième : « Qu’on est à l’aise
« Au Caire, en haut des minarets2804 !
« J’empâte un ornement de glaise2805,
« Et mes quartiers d’hiver sont prêts. »
« A la seconde cataracte2806,
« Fait la dernière, j’ai mon nid.
« J’en ai noté la place exacte
« Dans le pschent2807 d’un roi de granit. »
Toutes : Demain, combien de lieues
« Auront filé sous notre essaim,
« Plaines brunes, pics blancs, mers bleues,
« Brodant d’écume leur bassin ! »
Avec cris et battements d’ailes,
Sur la moulure aux bords étroits,
Ainsi jasent les hirondelles,
Voyant venir la rouille aux bois.
Je comprends tout ce qu’elles disent,
Car le poète est un oiseau ;
Mais, captifs, ses élans se brisent
Contre un invisible réseau !
Des ailes ! Des ailes ! Des ailes !
Comme dans le chant de Ruckert2808,
Pour voler là-bas, avec elles,
Au soleil d’or, au printemps vert !
(Émaux et Camées.)
Noël §
Le ciel est noir, la terre est blanche ;
Cloches, carillonnez gaîment.
Jésus est né ; la Vierge penche
Sur lui son visage charmant.
Pas de courtines2809 festonnées
Pour préserver l’enfant du froid ;
Rien que les toiles d’araignées
Qui pendent des poutres du toit.
Il tremble sur la paille fraîche,
Ce cher petit enfant Jésus,
Et, pour réchauffer dans sa crèche,
L’âne et le bœuf soufflent dessus.
La neige au chaume coud ses franges ;
Mais sur le toit s’ouvre le ciel,
Et, tout en blanc, le chœur des anges
Chante aux bergers : « Noël ! Noël !2810 »
(Émaux et Camées.)
Le bédouin et la mer §
Pour la première fois, voyant la mer à Bône,
Un Bédouin du désert, venu d’El-Kantara,
Comparait cet azur à l’immensité jaune,
Que piquent de points blancs Tuggurt et Biskara2811,
Et disait, étonné, devant l’humide plaine :
« Cet espace sans borne, est-ce un Sahara bleu,
Plongé, comme l’on fait d’un vêtement de laine,
Dans la cuve du ciel par un teinturier dieu ? »
Puis, s’approchant du bord, où, lasses de leurs luttes,
Les vagues, retombant sur le sable poli,
Comme un chapiteau grec contournaient leurs volutes2812
Et d’un feston d’argent s’ourlaient à chaque pli
« C’est de l’eau ! cria-t-il, qui jamais l’eût pu croire ?
Ici, là-bas, plus loin, de l’eau, toujours, encor !
Toutes les soifs du monde y trouveraient à boire
Sans rien diminuer du transparent trésor ;
« Quand même le chameau, tendant son col d’autruche,
La cavale, dans l’auge enfonçant ses naseaux,
Et la vierge noyant les flancs blonds de sa cruche,
Puiseraient à la fois au saphir2813 de ses eaux ! »
Et le Bédouin, ravi, voulut tremper sa lèvre
Dans le cristal salé de la coupe des mers :
« C’était trop beau, dit-il ; d’un tel bien Dieu nous sèvre2814,
Et ces flots sont trop purs pour n’être pas amers !2815 »
(Poésies nouvelles.)
De Laprade
(1812-1883) §
Né à Montbrison en 1812, mort en 1883, Pierre-Victor Richard de Laprade a publié plusieurs poèmes et recueils de poésies : Psyché (1841), Odes et poèmes (1844), Poèmes évangéliques (1852), les Symphonies (1855), Idylles héroïques (1858), Pernette (1868), Harmodius, tragédie (1870), Poèmes civiques (1873), le Livre d’un père (1876), qui sont tous remarquables par l’élévation de la pensée, tous inspirés par les plus nobles sentiments, l’amour de Dieu, de la liberté, de la patrie, de la famille. Au reste, Laprade ne se préoccupe guère des images éclatantes ou des jeux amusants de la rime ; sa versification est en général austère, et l’allure en est grave, froide parfois, même lorsque le poète sourit ou qu’une forte passion l’anime2816.
Pernette2817 §
I
pernette et les enfants du village §
Elle aimait entre tous, de son amour de mère,
Ceux dont l’âme innocente attend une lumière.
Les petits révoltés, les rôdeurs de buissons
Préféraient à leurs jeux ses charmantes leçons.
Les marmots hérissés ayant horreur du livre,
Quand elle ouvrait le sien, quittaient tout pour la suivre.
Dans nos rudes hameaux faits pour la liberté,
Où jamais magister ne s’était implanté,
Son foyer souriant fut la première école ;
Elle y prenait l’enfance au miel de sa parole ;
Et par elle, aujourd’hui, du maître à l’ouvrier,
Tous, en ces champs heureux, savent lire et prier.
Elle excitait d’un mot chez ses petits convives
Les curiosités de leurs âmes naïves ;
Et son heureux savoir, saine et douce liqueur,
Nourrissait la raison en égayant le cœur.
C’était là son grand art : la lettre inanimée
Vivait, riait, chantait sous son aiguille aimée ;
Et, tout à coup, l’image, en saisissant les yeux,
Répandait sa clarté sur le livre ennuyeux.
Elle égayait ainsi la lecture morose ;
L’épine sous ses doigts s’envolait de la rose2818.
C’était près d’elle à qui se ferait écolier ;
Tout enfant chérissait son toit hospitalier.
Plus de grossiers ébats, de rixes, de maraude.
Oh ! les bons jours d’hiver dans la salle bien chaude,
À chanter doucement les antiques noëls,
A se faire conter des contes éternels,
A s’empresser autour du vieux livre d’images,
A changer mille fois de plaisirs et d’ouvrages,
À mêler la prière entre les jeux divers,
Et même à réciter des fables et des vers !
Puis on posait cahier, tricot, livre, au plus vite :
Les châtaignes fumaient dans l’immense marmite,
Les branches de raisins s’abaissaient du plafond,
La corbeille de noix se vidait jusqu’au fond,
Et les pommes d’api, fraîches comme l’aurore,
Roulaient et bondissaient sur la table sonore.
(Pernette, épilogue.)
II
les funérailles §
Jamais aucune mort, dans toute la contrée,
Ne retentit plus vite2819 et ne fut tant pleurée.
Des bourgs les plus lointains et de chaque maison
Une foule accourut malgré l’âpre saison.
Tout ce peuple savait, aussi bien que moi-même,
Le lieu marqué par elle à son repos suprême2820.
Partis devant2821 le jour, afin que tout fût prêt,
Là-haut des laboureurs, au bord de la forêt,
A grands efforts creusant la terre glaciale,
Ouvraient sous les sapins la fosse nuptiale.
Le clocher tant aimé sonnait le dernier glas.
Nous montions ; sous nos pieds craquait le dur verglas.
Au loin sur les coteaux tapissés par la neige,
Lentement serpentait le funèbre cortège.
Les bois ainsi que nous restaient silencieux.
Un crêpe de brouillards s’étendait sur les cieux.
De l’endroit solennel nous étions déjà proche ;
On entendait encore un peu la triste cloche ;
Quoique sur les hauteurs, l’air s’était attiédi,
Et le vent préludait au calme de midi....
Le prêtre seul parla durant la sépulture ;
Tout se taisait, la foule et la pâle nature.
Et la terre natale, enfin, selon leur vœu,
Se ferma sur leurs corps2822 pour les garder à Dieu.
(Pernette, épilogue.)
La guerre §
Exhortation aux mères §
Ah ! quand le citoyen d’une cité sans maîtres2823
Doit sauver les lois en mourant ;
S’il s’agit de garder la terre des ancêtres
Vierge des pas2824 d’un conquérant ;
Quand, la liberté sainte aux flots des mercenaires2825,
Opposant ses trois cents soldats2826,
On suit, sous le drapeau des hardis volontaires,
Non Xerxès mais Léonidas2827 ;
Lorsque vos fils, armés pour les droits de leurs villes,
Vont teindre d’un sang généreux
Les sentiers de l’Argonne2828 ou ceux des Thermopyles,
Mères, ne pleurez pas sur eux.
Au dernier qui vous reste attachez, pour qu’il parte,
Ses éperons de chevalier,
Et, dans un fier adieu, dites-lui, comme à Sparte :
« Avec ou sur ton bouclier2829 ! »
(Poèmes civiques, XII.)
Morts pour la patrie2830 §
Quand viendra votre tour d’entrer dans la carrière,
Jeunes gens qu’on prépare à de mâles travaux,
Si, parmi vos aînés dont la patrie est fière,
Vous prenez un modèle et cherchez des rivaux,
Ni l’or, ni le pouvoir, ni la gloire elle-même,
Ne vous désigneront les plus grands, les meilleurs.
N’ayez pas le succès pour idéal suprême :
Levez plus haut votre âme et regardez ailleurs.
La vertu difficile est le but de la vie2831 ;
Des héros de tout temps, amis, vous l’apprendrez :
Pour être ambitieux d’un sort digne d’envie2832,
Lisez ces noms obscurs et désormais sacrés !
Ils rentreront, demain2833, dans le silence et l’ombre ;
Mais sur ces humbles murs vous viendrez les revoir.
Bienheureux ces martyrs oubliés dans le nombre :
Ils ont plus que la gloire, ils ont fait leur devoir !
Leur nom n’est pas signé sur quelque œuvre éphémère2834 ;
Nul titre étincelant ne luit sur leur tombeau ;
Mais, soldats, ils sont morts pour la France, leur mère :
Honneur à la vertu, le génie est moins beau.
Ils sont morts écrasés par les destins contraires ;
Mais ne parlons pas d’eux, amis, en gémissant :
A ces nobles vaincus, vous leurs fils, ou leurs frères,
Ne donnez pas de pleurs ; vous leur devez du sang !
Ils ont fait leur devoir et vous ferez le vôtre ;
Vous le ferez, amis, avec plus de bonheur.
Votre combat sera plus vaillant que le nôtre ;
Nous avons eu le deuil, et vous aurez l’honneur.
Prononcez mieux que nous2835 ce saint nom : la Patrie !
Osez enfin tout haut vous proclamer Français.
Soyez digne de vaincre, ô jeunesse aguerrie !
Faites votre devoir : Dieu fera le succès.
(Le Livre d’un père.)
A un grave écolier. §
Monsieur l’écolier sérieux,
Vous m’aimez encor, je l’espère ?
Levez un moment vos grands yeux ;
Fermons ce gros livre ennuyeux,
Et souriez à votre père.
Il est beau d’être un raisonneur,
De tout lire et de tout entendre,
De remporter les prix d’honneur !...
C’est, je crois, un plus grand bonheur
D’être un enfant aimant et tendre.
Lorsqu’on a fait tout son devoir,
Que la main est lasse d’écrire,
Quand le père est rentré, le soir,
Avec les sœurs il faut savoir
Jouer, causer,… même un peu rire.
Vous verrez chez les vieux auteurs,
Expliqués au long dans vos classes,
Que la muse à ses sénateurs2836
Ordonne, en quittant les hauteurs,
D’aller sacrifier aux Grâces2837.
Autres temps, autres conseillers !
Dans le savant siècle où nous sommes,
On voit déjà les écoliers,
Avec l’algèbre familiers,
Aussi maussades que les hommes.
Chez moi qu’il n’en soit pas ainsi ;
Contre les pédants je réclame.
Je suis poète, Dieu merci !
Et j’ai pour principal souci,
Mes enfants, de vous faire une âme.
Avant de savoir l’allemand,
La physique et le latin même,
Aimez ! c’est le commencement :
Aimez sans honte et vaillamment,
Aimez tous ceux qu’il faut qu’on aime.
Mais il est trop peu généreux
D’aimer tout bas et bouche close.
A ceux que l’on veut rendre heureux,
Des souhaits que l’on fait pour eux
Il faut dire au moins quelque chose.
Les vrais bons cœurs sont transparents ;
On y voit toute leur tendresse.
Ah ! chers petits indifférents,
Gâtez un peu vos vieux parents ;
Leur bonheur est dans vos caresses !
C’est beaucoup d’avoir la bonté ;
Montrez-la bien, qu’on en jouisse !
Il faut que, dès avant l’été,
En fleurs de grâce et de gaîté
Votre bon cœur s’épanouisse.
Voyez ! dans le meilleur terrain,
Parmi les blés hauts et superbes,
C’est Dieu qui mêla, de sa main,
Le bluet d’azur au bon grain,
Le pavot rouge à l’or des gerbes.
Vous, ainsi, savants, mais joyeux.
Charmez la maison paternelle.
Quand on a le sourire aux yeux,
A la lèvre un mot gracieux,
La vertu même en est plus belle.
(Le Livre d’un père.)
Autran
(1813-1877) §
Né en 1813 à Marseille, mort en 1877, Joseph Autran se fit d’abord connaître par un poème sur la Mer (1835) ; un autre poème, Milianah (1840), célébrait les exploits de l’armée française conquérant l’Algérie ; la Fille d’Eschyle, étude antique en cinq actes (1848), mit le sceau à sa renommée. Ses premières œuvres sont entrées depuis dans la composition de recueils plus amples, les Poèmes de la mer, la Flûte et le Tambour, auxquels il faut ajouter, entre autres publications, la Vie rurale (1856) et un volume de Sonnets capricieux. La versification d’Autran est à la fois aisée et harmonieuse ; sa langue est pure et précise ; mais la pensée et le sentiment, toujours sincères, et souvent délicats, manquent un peu, chez lui, de force et d’originalité2838.
Les chèvres §
La verte Normandie a sur ses promontoires
De grands bœufs accroupis sur leurs épais genoux,
Des bœufs au manteau blanc semé de taches noires,
Des bœufs aux flancs dorés, marqués de signes roux.
Aux heures de la trêve et du sommeil des vagues,
Paisiblement couchés dans le souple gazon,
Ils rêvent en silence, et laissent leurs yeux vagues
D’un regard nonchalant se perdre à l’horizon.
A quoi songent ainsi, dans leur calme attitude,
Ces anciens du troupeau, semblables à des dieux2839 ?
Est-ce au maître inconnu de cette solitude ?
Est-ce à l’immensité de la mer et des cieux ?
Quand ils errent, le soir, au sommet des rivages,
Quand leur front vers les eaux se tourne pesamment,
L’Océan, qui déferle2840 à ces côtes sauvages,
Mêle sa voix profonde à leur mugissement.
Quand l’ouragan d’été, sous les falaises mornes,
Entre-choque les flots à travers les récifs,
Eux aussi, furieux, souvent croisent leurs cornes,
Et, d’un effort jaloux, heurtent leurs fronts massifs.
Or, si la Normandie a les bœufs, la Provence
Garde aux flancs de ses monts les chèvres en troupeaux,
Les chèvres dont le pied, libre et hardi, s’avance,
Et dont l’humeur sans frein ne veut pas de repos.
La montagne au soleil, où croissent pêle-mêle
Cytise et romarin, lavande et serpolet2841,
Enfle de mille sucs leur bleuâtre mamelle ;
On boit fous ses parfums quand on boit de leur lait.
Tandis qu’assis au pied de quelque térébinthe2842,
Le pâtre insoucieux chante un air des vieux jours,
Elles, dont le collier par intervalle tinte,
Vont et viennent sans cesse et font mille détours.
En vain le mistral2843 souffle et chiffonne leur soie2844 :
Leur bande au pâturage erre des jours entiers.
Je ne sais quel esprit de conquête et de joie
Les anime à gravir les plus âpres sentiers.
Ton gouffre les appelle, ô Méditerranée !
Qu’un brin de mousse y croisse, une touffe de thym,
C’est là qu’elles iront, troupe désordonnée,
Que le péril attire autant que le butin.
Dans les escarpements entrecoupés d’yeuses2845
Elles vont jusqu’au soir, égarant leurs ébats ;
Ou bien, le cou tendu, s’arrêtent, curieuses,
Pour voir la folle mer qui se brise là-bas !
(La Vie rurale, livre I : Pendant que la terre est en fleurs, xxiii.)
Eschyle vaincu2846 §
Eschyle2847.
C’en est fait ! tu n’es plus, ô ma gloire effacée !
Soixante ans d’une vie à t’accroître passée,
Soixante ans de labeurs et d’austères ennuis,
Prolongés sans repos sous la lampe des nuits,
Soixante ans de succès parvenus jusqu’au faîte,
Tout s’est évanoui dans une heure de fête ;
Tout a jonché le sol, comme un temple divin
Qui tomba sous la foudre et que l’œil cherche en vain.
Quel était, malheureux, ton rêve, ton délire,
Lorsque sur un tombeau tu voulais faire écrire :
« L’athlète qui dort là ne fut jamais vaincu2848 ! »
Ah ! je le sentais bien que j avais trop vécu !
Meganire.
Vous l’entendez, amis ! est-ce à tort que je pleure ?
eschyle, toujours absorbé.
Dieux qui m’avez trahi, j’ai trop vécu d’une heure ;
Pourquoi dérobiez-vous, dans un péril récent2849,
A la main des bourreaux le front de l’innocent ?
Que n’a-t-elle, à propos, fermé là mon histoire ?
Ou plutôt, dans un jour doré par la victoire,
Aux champs de Marathon2850 que ne fus-je compté
Parmi ceux qui sont morts en criant : « Liberté ! »
Le ciel voyait ma gloire avec un œil d’envie2851 ;
Le ciel n’a prolongé ma déplorable vie
Que pour mieux avilir, à mes derniers instants,
Un nom dont la splendeur l’offusqua trop longtemps.
O malheur ! ô revers dont mon orgueil s’indigne !
Encor, si j’avais eu quelque rival insigne,
Seulement Pratinas, Chœrile ou Phrynicus2852,
Lutteurs que mon génie a tant de fois vaincus !
Mais non, un inconnu fut mon vainqueur superbe :
Le géant fut dompté par un lutteur imberbe ;
Le colosse orgueilleux, douze fois triomphant,
A dû courber le front sous le pied d’un enfant !...
Cet enfant, je le hais ! — Devant l’Aréopage
Sa parole pour moi du salut fut le gage2853 ;
Que m’importe ! Pourquoi vint-il me secourir ?
Ne valait-il pas mieux qu’il me laissât mourir !
Je hais ce conquérant qui m’a pris mon royaume,
Par lui, je ne suis plus qu’une ombre, qu’un fantôme,
Quelque chose de moins. De mes concitoyens
J’évite les regards ; — je voudrais fuir les miens.
D’un si honteux revers que pensera la Grèce ?
Qu’en diras-tu, ma fille, ô ma seule tendresse,
Quand je reparaîtrai devant tes yeux surpris,
Vaincu, baissant le front sous mes lauriers flétris ?
meganire, se précipitant vers lui.
O mon père ! à vos pieds votre fille inclinée
Dira que tout revers tient à la destinée ;
Qu’en vain l’aveugle sort vous trahit en ce jour,
Et que votre malheur fait croître mon amour.
(La Fille d’Eschyle, acte IV, sc. iv.)
Réhabilitation de la fourmi2854 §
Le ciel obscurci, la bise venue,
La cigale, ayant chanté tout l’été,
Alla demander quelque charité
Chez une fourmi qu’elle avait connue :
« J’ai grand faim, dit-elle, et me voilà nue… »
La fourmi n’est pas ce qu’on a conté,
Et, quoique vivant de paille menue,
Elle a dans le cœur beaucoup de bonté.
« Mangez, lui dit-elle, ouvrez mon armoire.
Je m’ennuie un peu sous la terre noire,
Dans ces trous obscurs où je vis sans feu.
« Mangez et chantez, aimable personne !
Vos chants me feront revoir le ciel bleu,
Et me rendront plus que je ne vous donne ! »
(Sonnets capricieux, VI : Histoires et contes, xvi.)
Ponsard
(1814-1867) §
Né en 1814 à Vienne (Isère), mort en 1867, François Ponsard a fait représenter avec un succès retentissant une tragédie, Lucrèce (1843), et une comédie, l’Honneur et l’Argent (1853). Ses autres œuvres furent moins heureuses, malgré les beaux vers qui n’y manquent point et le souffle généreux qui les anime, Agnès de Méranie (1846), Charlotte Corday (1850), Galilée (1867), drames, la Bourse (1856), le Lion amoureux (1866), comédies. Signalons encore un petit poème, Homère (1852), d’où l’auteur tira le sujet d’une tragédie avec chœurs qui ne réussit pas, Ulysse. En général, on est en droit de reprocher à ce poète son style un peu prosaïque et ce qu’il y a de trop superficiel dans la peinture de ses personnages2855.
Rêverie de Charlotte Corday2856 §
Le soleil disparaît dans sa couche embrasée ;
L’azur du ciel a pris une teinte rosée ;
Après les feux du jour, qui brûlaient le faucheur.
Voici le crépuscule apportant la fraîcheur.
— Que la soirée est belle, et comme on se sent vivre !
L’herbe coupée exhale un parfum qui m’enivre ;
Ces dernières lueurs, qui flottent au couchant,
Donnent à la campagne un aspect plus touchant ;
Et mon esprit ému suit le jour qui s’achève,
Par-delà l’horizon, dans le pays du rêve....
Oh ! quand donc aurez-vous votre accomplissement,
Rêves qui m’agitez, rêves de dévouement ?
Dois-je perdre en soupirs cette force de vie
Qui par des actions voudrait être assouvie ?
Ne puis-je concentrer dans un noble dessein
Ces stériles désirs qui me gonflent le sein ?
Et toi, mon compagnon, toi l’écrivain que j’aime,
Jean-Jacques2857 ! bien souvent tu l’as connu, toi-même,
Ce profond sentiment, triste et délicieux,
Qui devant l’infini met des pleurs dans nos yeux.
Toi seul tu comprenais la nature, ô mon maître !
Seul tu glorifiais dignement le Grand Être.
C’est que tu regardais l’œuvre du Créateur
De l’œil d’un homme libre, adorant son auteur.
Celui qui n’a pas su haïr la servitude,
Celui-là ne peut pas t’aimer - ô solitude !
(Charlotte Corday, acte II, sc. ii)
Lucrèce §
Quand mon mari2858 combat en bon soldat de Rome,
Je dois agir en femme ainsi qu’il fait en homme.
Nourrice, nous avons tous les deux notre emploi :
Lui, les armes en main, doit défendre son roi ;
Il doit montrer l’exemple aux soldats qu’il commande ;
Mon devoir est égal, si ma tâche est moins grande.
Moi, je commande ici, comme lui dans son camp,
Et ma vertu doit être au niveau de mon rang.
La vertu que choisit la mère de famille,
C’est d’être la première à manier l’aiguille,
La plus industrieuse à filer la toison,
A préparer l’habit propre à chaque saison,
Afin qu’en revenant au foyer domestique,
Le guerrier puisse mettre une blanche tunique2859,
Et rendre grâce aux dieux de trouver sur le seuil
Une femme soigneuse et qui lui fasse accueil....
Tu me presses en vain2860; je veux rester fidèle,
Par mon aïeule instruite, aux mœurs que je tiens d’elle.
Les femmes de son temps mettaient tout leur souci
A surveiller l’ouvrage, à mériter ainsi
Qu’on lût sur leur tombeau, digne d’une Romaine :
« Elle vécut chez elle et fila de la laine ».
Les doigts laborieux rendent l’esprit plus fort,
Tandis que la vertu dans les loisirs s’endort.
Celle qui prend en main l’aiguille de Minerve2861,
Minerve, applaudissant, l’appuie et la préserve.
Le travail, il est vrai, peut ternir ma beauté,
Mais rien ne ternira mon honneur respecté ;
Et, si je dois choisir, injure pour injure,
La ride au front sied mieux qu’au nom la flétrissure.
— C’est assez : le temps passe à tenir ces propos ;
Quand la langue se meut, la main reste en repos.
Poursuivons notre tâche. — Allons !
(Lucrèce, acte I, sc. i.)
Les « montagnards » jugés par une « ci-devant2862 » §
Pour la première fois je me trouvais en face
D’un de ces destructeurs terribles de ma race :
Oppressée, en entrant, par une anxiété
Où l’effroi se mêlait de curiosité,
J’ai senti par degrés tomber l’horreur profonde
Qu’inspire un montagnard à ceux de notre monde.
Je me disais qu’il faut que ces hommes, au fond,
Soient convaincus et forts pour faire ce qu’ils font ;
Qu’avoir bouleversé le passé dans sa base,
Des rangs, des lois, des mœurs, avoir fait table rase2863,
Sur le sol déblayé fonder leurs nouveaux droits,
Aborder toute idée et la tourner en lois2864 ;
Au milieu des clameurs, des complots, des tempêtes,
Tenir tête à l’Europe et marcher aux conquêtes,
C’est une œuvre inouïe, et que ces gens mal nés
Surpassent en vigueur nos amis blasonnés2865.
Non, m’en garde le ciel ! que j’absolve leurs crimes,
Moi, leur victime, et fille et femme des victimes ;
Mais il faut avouer qu’on les poussait à bout ;
Nous les méprisions trop ; et moi-même, après tout,
Je sens que si le ciel m’eût fait naître en roture,
J’aurais mal enduré l’injustice et l’injure ;
J’aurais haï, comme eux, une inégalité
Contre qui tout cœur fier doit être révolté ;
J’aurais, dans mon élan vers les nobles carrières,
Fût-ce à coup de tonnerre, écrasé les barrières,
Et me serais fait place en ce monde insolent
Ouvert au privilège et clos pour le talent.
(Le Lion amoureux, acte II, sc. ii.)
La convention §
En 1794, dans la période qui suit la chute de Robespierre et la révolution du 9 Thermidor (27 juillet). Dans le salon de Mme Tallien, femme de l’un des chefs du parti victorieux, un général du parti des Montagnards (voir page 752, note 4), vient d’entendre des muscadins (voir ci-dessous, note 1) bafouer la Révolution et se promettre contre elle des vengeances prochaines. Il répond indigné.
Savez-vous, muscadins, vous qui fouettez les femmes2866,
Ce qu’ont fait, l’an dernier, ces Montagnards infâmes2867 ?
Il fallait affronter bien d’autres gens que vous ;
L’Europe se ruait tout entière sur nous ;
Ils ont fait se dresser, juste au mois où nous sommes2868,
Quatorze corps d’armée et douze cent mille hommes,
Qui, la pique à la main, en haillons, sans souliers,
Ont repoussé l’assaut de dix rois alliés2869.
Ces héros, muscadins, bravant les carabines,
Battaient des Prussiens et non des Jacobines ;
Ces nobles va-nu-pieds, agioteurs repus2870,
S’élançaient vers la gloire et non vers les écus ;
Ces Français, émigrés2871, défendaient la patrie
Par vous et l’étranger envahie et meurtrie.
Est-ce un souffle puissant qui pousse ces vainqueurs,
Et court en un instant dans des milliers de cœurs ?
À lutter contre lui vous sentez-vous de taille,
Et ne seriez-vous pas tous broyés comme paille ?
— Allez ! assaillez-nous d’injures ; évoquez
Le souvenir d’excès par vous seuls provoqués ;
Vous qu’un rugissement faisait rentrer sous terre,
Agacez aujourd’hui le lion débonnaire ;
La Convention peut, comme l’ancien Romain2872,
Sur l’autel attesté posant sa forte main,
Répondre fièrement, alors qu’on l’injurie :
« Je jure que, tel jour, j’ai sauvé la patrie ! »
(Le Lion amoureux, acte II, sc. v.)
Leconte De Lisle
(1818-1894) §
Né en 1818 à Saint-Paul (île de la Réunion), mort en 1894, Leconte de Lisle a publié, outre des traductions d’Horace et des grands poètes de la Grèce, dans lesquelles il s’est attaché à rendre non seulement les idées, mais l’exacte physionomie de l’original, des poésies qui ont été réunies sous les titres de Poèmes antiques (1853), Poèmes barbares (1862), Poèmes tragiques (1883). Tous ces recueils sont empreints d’une philosophie amère et hautaine, qui se dissimule sous une sorte d’impassibilité affectée ; mais nul poète n’est plus remarquable que Leconte de Lisle par la splendeur des rythmes et la précision pittoresque de l’expression2873.
La jeunesse2874 §
Bienheureuse l’austère et la rude jeunesse
Qui rend un culte chaste à l’antique vertu !
Mieux qu’un guerrier de fer et d’airain revêtu,
Le jeune homme au cœur pur2875 marche dans la sagesse.
Le myrte efféminé n’orne point ses cheveux ;
Il n’a point effeuillé la rose ionienne2876 ;
Mais sa bouche est sincère et sa face est sereine,
Et la lance d’Arès2877 charge son bras nerveux.
En de mâles travaux ainsi coule sa vie.
Si parfois l’étranger l’accueille à son foyer,
Il n’outragera point l’autel hospitalier
Et respecte le seuil où l’hôte le convie.
Puis les rapides ans inclinent sa fierté ;
Mais la vieillesse auguste ennoblit le visage !
Et qui vécut ainsi, peut mourir : il fut sage,
Et demeure en exemple à la postérité.
(Poèmes antiques : Hélène, iv.)
La chasse de l’aigle §
L’aigle noir aux yeux d’or, prince du ciel mongol,
Ouvre, dès le premier rayon de l’aube claire,
Ses ailes comme un large et sombre parasol.
Un instant immobile, il plane, épie et flaire.
Là-bas, au flanc du roc crevassé, ses aiglons
Érigent, affamés, leurs cous au bord de l’aire.
Par la steppe2878 sans fin, coteau, plaine et vallons.
L’œil luisant à travers l’épais crin qui l’obstrue,
Pâturent, çà et là, des hardes d’étalons2879.
L’un d’eux parfois hennit vers l’aube, l’autre rue ;
Ou quelque autre, tordant la queue, allègrement,
Pris de vertige, court dans l’herbe jaune et drue.
La lumière, en un frais et vif pétillement,
Croît, s’élance par jet, s’échappe par fusée,
Et l’orbe du soleil émerge au firmament.
A l’horizon subtil2880 où bleuit la rosée,
Morne dans l’air brillant, l’aigle darde, anxieux,
Sa prunelle infaillible et de faim aiguisée.
Mais il n’aperçoit rien qui vole par les cieux,
Rien qui surgisse au loin dans la steppe aurorale2881,
Cerf ni daim, ni gazelle aux bonds capricieux.
Il fait claquer son bec avec un âpre râle ;
D’un coup d’aile irrité, pour mieux voir de plus haut,
Il s’enlève, descend et remonte en spirale.
L’heure passe, l’air brûle. Il a faim. A défaut
De gazelle ou de daim, sa proie accoutumée,
C’est de la chair, vivante ou morte, qu’il lui faut.
Or, dans sa robe blanche et rose, une fumée
Autour2882 de ses naseaux roses et palpitants,
Un étalon conduit la hennissante armée.
Quand il jette un appel vers les cieux éclatants,
La harde, qui tressaille à sa voix fière et brève,
Accourt, l’oreille droite et les longs crins flottants.
L’aigle tombe sur lui comme un sinistre rêve,
S’attache au col troué par ses ongles de fer
Et plonge son bec courbe au fond des yeux qu’il crève.
Cabré, de ses deux pieds convulsifs battant l’air,
Et comme empanaché de la bête vorace,
L’étalon fuit dans l’ombre ardente de l’enfer.
Le ventre contre l’herbe, il fuit, et, sur sa trace,
Ruisselle de l’orbite excave2883 un flux sanglant ;
Il fuit, et son bourreau le mange et le harasse2884.
L’agonie en sueur fait haleter son flanc,
Il renâcle2885, et secoue, enivré de démence,
Cette grande aile ouverte et ce bec aveuglant.
Il franchit, furieux, la solitude immense,
S’arrête brusquement, sur ses jarrets ployé,
S’abat et se relève et toujours recommence.
Puis, rompu de l’effort en vain multiplié,
L’écume aux dents, tirant sa langue blême et rêche,
Par la steppe natale il tombe foudroyé.
Là, ses os blanchiront au soleil qui les sèche ;
Et le sombre chasseur des plaines, l’aigle noir,
Retourne au nid avec un lambeau de chair fraîche.
Ses petits affamés seront repus ce soir2886.
(Poèmes tragiques.)
André Lemoyne
(1822-1907) §
Né à Saint-Jean-d’Angely, André Lemoyne, dont les premiers vers parurent en 1856, a publié, depuis, plusieurs recueils, où le penseur et le patriote se révèlent plus d’une fois ; mais c’est surtout comme peintre de la nature et particulièrement des paysages normands qu’il a mérité une place parmi les meilleurs poètes de la seconde moitié du xixe siècle, parmi les plus simples, les plus sobres et les plus sincères2887.
Grèves normandes §
Ce soir, la pleine lune éclate notre monde.
De l’abîme des flots elle sort large et ronde.
Presque au ras de la mer, elle est rouge d’abord.
Mais son orbe jaunit, et la grande marée,
Dans son rayonnement, monte en houle dorée,
Et roule ses lueurs jusqu’aux grèves du bord.
On voit comme en plein jour, sur la courbe des plages,
Les dernières maisons des bourgs et des villages,
Villages de marins et de pêcheurs normands.
Les enfants sont couchés dans le charme des rêves :
Ce long bruit cadencé du flot qui bat ses grèves
Semble un chant de berceuse aux chers petits dormants.
Un vent tout parfumé m’apporte des prairies,
Où les reines-des-prés2888 restent longtemps fleuries,
Quelque chose à la fois de suave et d’amer ;
Tandis qu’un grand troupeau, débouchant des vallées,
Mêle une odeur d’étable aux effluves salées
Qui montent, jour et nuit, des embruns2889 de la mer.
J’aime à vous retrouver, grèves de Normandie,
Où travaille une race âpre au gain, mais hardie,
Fille des conquérants qui vinrent les premiers,
Sous les pommiers en fleurs que le roi Charlemagne
Avait plantés pour eux en revenant d’Espagne2890,
Se faire un paradis au pays des pommiers.
(Paysages de mer et fleurs des prés.)
Bateaux chalands2891 §
Ces longs bateaux chalands, ces grosses barques neuves
Peintes en marron clair, la croix blanche à l’avant,
Qui reviennent du Nord et descendent nos fleuves,
S’en vont au fil des eaux sans mettre voile au vent.
A leur coque2892, toujours lisse et bien goudronnée,
On aime à reconnaître un ménage flamand,
Dans son nid à fleur d’eau tranquille maisonnée,
Le jour au grand soleil, la nuit en paix dormant.
En relief sur le pont, la cabine du maître,
Coquette et toute blanche… Elle est juste au milieu,
Comme autrefois dans l’arche… Et, par chaque fenêtre,
Au calme intérieur descend un rayon bleu.
Des brassières d’enfant, de petites vareuses
Sèchent au soleil clair, tout près du grand filet,
Et la mère, berçant de ses deux mains heureuses
Un gros joufflu qui rit, l’abreuve de son lait.
Des plants de réséda parfument la cabine,
Et de petits rosiers, parfois même des lis.
On y voit s’enrouler la rouge capucine
Aux clochettes d’azur des hauts volubilis.
Là, quelques prisonniers, éclos sur le rivage,
Des bouvreuils à gros becs ou des merles siffleurs,
En oiseaux bien appris agréant l’esclavage,
Paraissent oublier leur cage dans les fleurs.
Et plus d’une hirondelle à bon droit curieuse,
D’une aile indépendante, en pleine liberté,
Passe comme une folle et sauvage rieuse,
En frôlant de son vol tout ce monde enchanté.
On voyage à travers les campagnes fleuries,
En écoutant parfois, dans un si long parcours,
Les bœufs des grands vergers, les coqs des métairies
Ou le grave angélus enroué des vieux bourgs.
Les yeux suivent longtemps ces barques fortunées,
Riches de beaux enfants, et de fleurs et d’oiseaux,
Qui vont avec lenteur, à petites journées,
Vrais paradis flottants sur le miroir des eaux.
Mais sur les eaux la Mort nous prend comme sur terre
D’un seul coup… Le patron, qui n’a pas ses trente ans,
Va chercher, comme tous, la clé du grand mystère....
Il tombe en plein bonheur… Il a fini son temps.
Songeant à ses petits, c’est alors que la veuve,
En essuyant ses pleurs, prend d’un geste viril
Le haut commandement du maître sur le fleuve
(Si le cœur lui manquait, l’homme, que dirait-il ?)
Et, refoulant en elle une sombre pensée,
Elle rit aux enfants sans quitter son travail,
Sur le fond clair du ciel, tout en noir, adossée
A la barre du large et puissant gouvernail.
(Oiseaux chanteurs.)
Eugène Manuel
(1823-1901) §
Né à Paris en 1823, mort en 1901, Eugène Manuel a publié, outre deux drames en un acte et en vers, d’un sentiment très élevé et très touchant, les Ouvriers, dont le succès fut éclatant (1870), et l’Absent (1873), quatre recueils de poésies, Pages intimes (1866), Poèmes populaires (1871), Pendant la guerre (1872), En voyage (1882). Toutes les pièces qui les composent sont animées de ces tendres et généreuses passions, l’amour de la famille, l’amour des humbles, l’amour de la patrie. Aussi, peu d’œuvres poétiques sont-elles et resteront-elles plus populaires que tant d’émouvants récits, le Rosier, la Robe, la Chanteuse, la Visite au fort, où les délicats remarquent encore, après l’habileté de la composition et la sincérité du sentiment, la fine précision du style, la simplicité savante de la versification2893.
Le rosier §
Il a vécu sur un tombeau,
Le rosier fleuri que j’arrose :
Le mystère du froid caveau
S’épanouit dans chaque rose !
Sur le tombeau d’un pauvre enfant,
D’un pauvre enfant qui fut mon frère !
Il avait ses fleurs à tout vent,
Et ses racines dans la bière.
Un simple marbre a tout couvert ;
Le buis n’y vient plus en bordure ;
Le thuya, l’arbre toujours vert,
N’ombrage plus la sépulture ;
Le deuil a parfois son dédain :
On a proscrit tout ce qui tombe,
Et j’ai planté dans mon jardin
L’humble rosier, fils de la tombe !
Parmi les autres confondu,
Nul regard ne peut le connaître :
Dans la corbeille il est perdu ;
Seul je le vois de ma fenêtre.
Et j’hésite en le comparant :
Mêmes parfums et même tige ;
Sur sa corolle, indifférent,
Le papillon plane et voltige ;
Son feuillage est aussi léger,
Sa fleur n’est pas plus tôt flétrie :
Rien ne trahit pour l’étranger
La première et sombre patrie !
Mais souvent, au déclin du jour,
Quand la foi rêve, ou bien le doute,
Seul, je m’approche avec amour,
Je l’interroge et je l’écoute ;
Alors je le vois frissonner
Au souvenir que je réveille :
Chaque rameau semble incliner
Vers ma lèvre sa fleur vermeille ;
Il me parle du cher blondin
Endormi dans la paix profonde,
Et fait passer dans mon jardin
Comme un souffle de l’autre monde !
(Pages intimes, VIII.)
La chanteuse §
La pauvre enfant, le long des pelouses du bois,
Mendiait : elle avait des larmes véritables ;
Et, d’un air humble et doux, joignant ses petits doigts,
Elle courait après les âmes charitables.
De longs cheveux touffus chargeaient son front halé ;
Ses talons étaient gris de poussière, et sa robe
N’était qu’un vieux jupon à sa taille enroulé,
Où la nudité maigre à peine se dérobe !
Elle allait aux passants, les suivait pas à pas,
Et disait, sans changer un mot, la même histoire,
De celles qu’on écoute et que l’on ne croit pas :
Car notre conscience aurait trop peur d’y croire !
Elle voulait un sou, du pain, — rien qu’un morceau !
Elle avait, je ne sais dans quelle horrible rue,
Des parents sans travail, des frères au berceau,
La famille du pauvre, à peine secourue !
Puis, qu’on donnât ou non, elle essuyait ses pleurs,
Et s’en retournait vite aux gazons pleins de mousses,
S’amusait d’un insecte, épluchait quelques fleurs,
Des taillis printaniers brisait les jeunes pousses,
Et chantait ! — Le soleil riait dans sa chanson !
C’était quelque lambeau des refrains populaires,
Et, pareille au linot, de buisson en buisson,
Elle lançait au ciel ses notes les plus claires.
O souffle des beaux jours ! mystérieux pouvoir
D’un rayon de soleil et d’une fleur éclose !
Ivresse d’écouter, de sentir et de voir !
Enchantement divin qui sort de toute chose !
L’enfant, au renouveau, peut-il gémir longtemps ?
Le brin d’herbe l’amuse et la feuille l’attire !
Sait-on combien de pleurs peut sécher un printemps,
Et le peu dont le pauvre a besoin pour sourire ?
Je la regardais vivre et l’entendais de loin.
Comme un fardeau que pose un porteur qui s’arrête,
Elle allégeait son cœur, se croyant sans témoin,
Et les senteurs d’avril lui montaient à la tête !
Puis, bientôt s’éveillant, prise d’un souvenir,
Elle accostait encor les passants, triste et lente ;
Son visage à l’instant savait se rembrunir,
Et sa voix se traînait et larmoyait dolente.
Mais quand elle arriva vers moi, tendant la main,
Avec ses yeux mouillés et son air de détresse :
« Non ! lui dis-je. Va-t’en ! et passe ton chemin !
Je te suivais : il faut, pour tromper, plus d’adresse,
Tes parents t’ont montré cette douleur qui ment !
Tu pleures maintenant : tu chantais tout à l’heure ! »
L’enfant leva les yeux et me dit simplement :
« C’est pour moi que je chante, et pour eux que je pleure. »
(Poèmes populaires, III.)
Printemps §
Champs et forêts, le sol tressaille ;
Tout dit : « Le printemps est venu ! »
Et sous la terre qui s’émaille
Circule un fluide inconnu.
« C’est le printemps ! » dit chaque germe
En s’agitant dans sa prison,
D’où bientôt perce, droite et ferme,
La tige, — arbre, plante ou gazon.
« C’est le printemps ! se dit la mousse.
Pour tous les rêveurs assoupis
Rendons notre couche plus douce,
Epaississons nos verts tapis ! »
Chaque fleur prend part à la fête.
La nature éclate à la fois :
La fougère dresse sa tête,
Comme une crosse, dans les bois ;
Relevant sa coiffe dorée,
Le genêt dit : « C’est le printemps ! »
La sauge vers la centaurée2894
S’incline et lui dit : « Je l’entends ! »
Les muguets aux mille clochettes
Carillonnent pour son retour,
Et les fraisiers dans leurs cachettes
Ont des frémissements d’amour ;
Le cytise mêle aux broussailles
Ses grappes d’or ; le vieux buisson
Se fait beau pour les fiançailles
De l’églantine et du pinson ;
Entre les feuilles desséchées,
La pervenche ouvre un œil d’azur ;
Les joubarbes2895 se sont penchées
Pour le voir, au rebord du mur.
La clématite qui s’enroule
Et les liserons familiers
Sur les saules grimpent en foule,
Comme une bande d’écoliers.
Près des fossés, les pâquerettes
Disent entre elles : « Le voici ! »
— « Oublions nos peines secrètes,
Et soyons gai ! » dit le souci.
Les renoncules étonnées
Entr’ouvrent leurs calices d’or
Et leurs corolles satinées,
Où la coccinelle s’endort.
Dans son réduit, la violette
N’a point ces habits de gala2896 ;
Mais elle ouvre sa cassolette2897,
Et son parfum dit : « Je suis là ! »
Et dans le feuillage, dans l’herbe,
Sur les chemins, dans les forêts.
Au sillon qui promet la gerbe,
Dans le noir limon des marais,
Sur les fumiers et dans les sables,
Sur le terreau des maraîchers,
Comme aux sources intarissables
Qui mouillent le flanc des rochers ;
A la margelle des puits sombres,
Aux toits que la pluie a lavés,
Parmi le fouillis des décombres,
Entre les fentes des pavés ;
Tout vit, tout pousse, tout verdoie,
Tout se renouvelle en tout lieu ;
Pour remettre la terre en joie,
Il suffit d’un souffle de Dieu ;
Et, pris d’une gaîté pareille,
Le poète, las des hivers,
Dit : « Quelque chose en moi s’éveille :
C’est le printemps ! — faisons des vers2898. »
(En voyage, III.)
Chanson de mort2899 §
Mon père, où donc vas-tu ? — Je vais
Demander une arme et me battre !
— Non, père ! autrefois, tu servais :
À notre tour les temps mauvais !
Nous sommes trois. — Nous serons quatre !
— Le jeune est mort : voici sa croix2900,
Retourne au logis, pauvre père !
La nuit vient, les matins sont froids
Nous le vengerons, je l’espère !
Nous sommes deux. — Nous serons trois !
— Père, le sort nous est funeste,
Et ces combats sont hasardeux :
Un autre est mort. Mais, je l’atteste,
Tous seront vengés : car je reste !
Il suffit d’un. — Nous serons deux !
Mes trois fils sont là, sous la terre,
Sans avoir eu même un linceul.
A toi ce sacrifice austère,
Patrie ! et moi vieux volontaire,
Pour les venger, je serai seul !
(Pendant la guerre, x.)
Le codicille2901 de Maitre Moser §
« Eh bien, maître Moser, on ne va donc pas mieux ?… »
Le vieillard reconnut les voix, ouvrit les yeux,
Et sourit, Il voyait ses amis du village,
Ceux que le sol avait enchaînés, ceux que l’âge
Avait soumis de force au major allemand2902,
Mais qu’on savait toujours Français — mentalement.
Ils venaient partager une suprême étreinte
Avec l’aîné d’entre eux, une âme droite et sainte,
— Un homme enfin, — le seul de son nom qui restât,
Son dernier fils, sous Metz2903, étant mort en soldat.
— « Bon ! dit-il, vous voulez que ce vieux corps guérisse ?
Depuis mil huit cent trois, je n’ai plus de nourrice,
Et j’ai, depuis dix ans, connu de tels chagrins,
Que ce n’est pas l’adieu ni la mort que je crains !
Soyez les bienvenus. Causons. J’en ai la force :
Il coule un peu de sève encore sous l’écorce.
Ne pouvant plus agir, je puis du moins parler,
Et régler le départ avant de m’en aller. »
Redressé dans son lit et reprenant haleine,
Il leur tendit les mains sous son tricot de laine,
Et dit : « Vous êtes tous ici des amis sûrs ?
On peut parler d’espoir sans redouter les murs ?
En fait de testament, chacun sa manière ;
Je veux vous confier ma volonté dernière :
Puis-je compter sur vous ? » Tous, d’un geste empressé,
— Comme autant de soldats, autour d’un chef blessé,
Recueillent gravement les ordres de sa bouche, —
Ils en firent serment, groupés près de sa couche.
D’ailleurs, ce n’était pas encor pour aujourd’hui ;
La récolte d’automne avait besoin de lui ;
Il vivrait ! Le vieillard triste hocha la tête :
« Pour les choses d’argent la paperasse est prête ;
Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Mes neveux
Sont en France : ils auront mon bien. — Si tu le veux,
Moser, — nos bras sont forts et nos volontés promptes, —
Nous soignerons tes champs, nous réglerons tes comptes ;
Puis, nous te bâtirons une tombe à ton gré :
On y lira pourquoi tu n’as pas émigré2904,
Après tes enfants morts et l’Alsace perdue,
Et la France par toi jusqu’au bout défendue.
Sont-ce là tes désirs ?… — Non, mes amis, merci !
De ces misères-là n’ayez point de souci.
Je veux être couché dans un coin : de la terre,
Et rien de plus ; mon nom tracé, sans commentaire ;
Pas de fleurs sur le sol qui doit me recouvrir :
Le tombeau des vaincus n’est pas fait pour fleurir !… »
« Mais voici… — reprit-il, se faisant violence
Pour maîtriser son cœur, dans le profond silence : —
Plus d’un me survivra parmi vous, et longtemps ;
Il en est qui vivront cinq ans, dix ans, vingt ans,
Et plus ! Ceux-là verront la fin de ce martyre,
Ce que vous savez bien, ce qu’on ne peut pas dire,
Ce que nous rêvons tous dans nos nuits sans sommeil ;
Ils verront, un matin, se lever ce soleil,
Et des Vosges au Rhin resplendir sa lumière !
Or, écoutez-moi bien. Je veux que vers la pierre
Sous laquelle bientôt vous coucherez mon corps,
Ceux que je vois ici, ceux qui vivront alors,
Quels que soient la saison, le temps, le jour et l’heure
Sans tarder un moment, laissant là leur demeure,
Accourent haletants ; puis l’aîné d’entre vous,
— Peut-être il sera seul ! — se mettant à genoux,
Sur mon petit tombeau se penchera, s’il m’aime :
Et, des lèvres pressant la terre à l’endroit même
Où posera ma tête, et m’appelant trois fois :
« Moser ! » de tout son cœur, de sa plus forte voix,
Sans me raconter rien, et sans phrase banale,
Sans comment ni pourquoi sur la crise finale,
Soulevant d’un seul cri le poids qui m’étouffait,
Me dira simplement : « Moser ! Moser ! c’est fait ! »
(Après la guerre, XXV.)
Le retour de Morin §
L’ouvrier Morin a autrefois abandonné sa femme Jeanne, après l’avoir frappée d’un coup de couteau, dans une heure d’ivresse. Revenu au bien après une vie d’épreuves, bienfaiteur lui-même d’enfants orphelins qu’il a adoptés, le hasard l’a ramené au bout de vingt ans, en présence de sa femme et de son fils Marcel. Il fait l’aveu de son crime, demande l’oubli et réclame sa place au foyer.
Morin.
Oui, je reprends mes droits, et c’est assez d’aveux !
Je veux ma place ici ! je veux mon fils ! je veux....
Marcel, qui a gardé jusque-là le silence.
Non, monsieur ! — car enfin, tout cela me regarde ! —
Va, ne crains rien, maman, je suis là, je te garde !
Monsieur, ma mère est veuve et je suis orphelin.
D’un passé douloureux notre cœur est trop plein...
Elle ne vous connaît que par deux ans de honte,
Et de vingt ans de pleurs ne vous doit aucun compte.
Quant à moi, je n’ai pas à chercher mon devoir :
Je n’ai qu‘à regarder ses yeux pour le savoir !
Elle seule a rempli dignement cette tâche
D’un dévouement obscur, d’un labeur sans relâche.
Ah ! pauvre mère ! plus j’y songe, maintenant,
Toi, jeune et belle encore, au travail t’obstinant,
Plus tu me parais sainte, héroïque, adorable,
D’être si vertueuse étant si misérable !...
Et moi, j’aurais été l’affreux petit bandit
Qui, du bouge au ruisseau, pâle, maigre, grandit ;
J’aurais eu les instincts que l’exemple motive,
Avec une prison pour toute perspective !
Depuis longtemps déjà ces périls sont passés ;
Ma mère a fait de moi ce que vous connaissez.
Si le mal fût venu, vous étiez le coupable ;
Je voudrais l’oublier, je m’en sens incapable ;
Je n’ai jamais connu qu’elle, je lui dois tout.
Vous étiez mort pour moi, soyez-le jusqu’au bout !
Morin.
Jeanne, faites-le taire : il passe la mesure.
Trouvez-vous qu’il me rende assez votre blessure ?
— Eh ! bien, oui, vous avez raison, je dois partir,
Et je reviens trop tard avec mon repentir.
Va-t’en, vieux criminel qu’on ne veut pas entendre,
Et qui n’as même plus le droit de te défendre !
Tout à l’heure, j’étais un brave homme, on m’aimait ;
Je ne sais de quels noms votre fils me nommait ;
J’étais une belle âme, un protecteur céleste ;
On m’appelait sauveur, n’est-ce pas, et le reste !
Et comme maintenant vous savez le passé,
De tous ces beaux discours vous n’avez rien laissé !
Vous ne demandez pas d’où vient cet homme honnête,
Sous combien de remords il a courbé la tête ;
Comment, par quels efforts, de quels maux abreuvé,
Il a conquis la place où vous l’avez trouvé ;
Comment il est monté de si bas à l’estime,
Ce qu’il s’est imposé pour expier son crime,
Et comment cet ivrogne affreux, cet assassin,
Était à son retour un cœur loyal et sain !
Vous le prenez bien haut, jeune homme ! la morale
Doit parler autrement, pour être libérale !
Marcel.
Mais...
Morin.
N’interrompez pas… J’admire, en vérité,
Aux bouches de vingt ans cette sévérité !
Ah ! vous voilà bien fier, pour être un jeune sage :
Vous n’avez point passé par mon apprentissage.
Votre mère, autrefois, vous expliquait le bien :
La mienne me battait et ne m’apprenait rien !
Enfant, ai-je entendu quelque bonne parole ?
Je n’ai jamais connu le chemin de l’école ;
Je lis, c’est tout au plus ; j’écris tout juste assez
Pour inscrire mes gains près de mes déboursés.
J’ai traîné dans la boue une enfance indocile,
Et le cabaret fut mon premier domicile !
A qui n’a pas lutté la vertu coûte peu,
Jeune homme ! Il faut avoir été sans feu ni lieu,
Avoir eu des passants les réponses bourrues,
Avoir dormi la nuit sur le pavé des rues,
Et s’être demandé, quand on n’a plus le sou,
Si l’on ne fera pas, le soir, un mauvais coup !
Voilà, pour parler haut, d’assez rudes épreuves
Qui mettraient à l’essai vos vertus toutes neuves.
Et comment ai-je fait ? Qui m’a sauvegardé ?
J’allais tomber plus bas… Quelle main m’a guidé ?
Aucune !… Je n’avais contre la défaillance
Qu’une obscure lueur, ma seule conscience.
De tout secours humain j’étais déshérité,
Et c’est moi seul enfin qui me suis racheté !...
Marcel fait un mouvement vers lui.
Mais l’expiation n’est pas assez complète.
Adieu, Jeanne, je pars : vous serez satisfaite.
Adieu ! j’ai vécu seul, mon plus dur châtiment
Sera de rester seul jusqu’au dernier moment.
Je ne mérite pas la joie inespérée
De mourir près de vous d’une mort honorée !...
Il s’apprête à partir, et s’appuie sur la table, en proie à une vive émotion.
Marcel, regardant sa mère d’un air suppliant.
Mère, je suis vaincu, je ne puis résister...
Jeanne.
Marcel !
Marcel.
Oh ! laisse-moi lui dire de rester !
Mère, reviens à toi, parle-lui donc, c’est l’heure !
Ah ! que nous sommes durs ! regarde, écoute : il pleure !
(Les Ouvriers, sc. vii.)
Henri de Bornier
(1825-1901) §
Henri de Bornier, né à Lunel (Hérault) en 1825, mort en 1901, publia en 1845 un premier recueil de vers, les Premières Feuilles, auquel se sont ajoutés depuis des poésies diverses et quelques courts poèmes ; il s’est aussi fait connaître comme critique et comme romancier. Mais c’est surtout comme auteur dramatique qu’il est célèbre : sans parler d’œuvres moins importantes, comédies, à-propos, le succès de sa Fille de Roland (1875) a rendu sa popularité au genre le plus noble, et malheureusement le plus délaissé à notre époque, de notre littérature dramatique, le grand drame historique en vers ; le souvenir ineffaçable de la guerre de 1870-1871 n’a d’ailleurs pas peu contribué à assurer la sympathie du public français à une œuvre moitié légendaire, moitié symbolique, dans laquelle il trouvait, avec l’écho de ses sentiments les plus profonds, un héroïque encouragement à l’espérance. Les autres drames de Henri de Bornier, moins attachants peut-être, ne sont pas d’une inspiration moins élevée : les Noces d’Attila (1881), l’Apôtre, Mahomet (1889), France… d’abord (1899).
Dénouement de « la fille de Roland » §
Gérald, Charlemagne, Berthe, Le duc Nayme, Richard, Hardré, Geoffroy2905 Et Autres Seigneurs. §
Charlemagne, au fond, entouré de tous les seigneurs.
Dieu vient de te frapper dans ta noble espérance !
À ta gloire, Gérald, il manquait la souffrance !
— Barons, ducs, chevaliers, vous tous qui m’entourez,
Si ma justice a pu faillir, vous jugerez !
Je savais tout hier2906 ; sans haine ou complaisance,
J’ai dû mettre le crime et la gloire en présence ;
Mais j’eus tort en voulant qu’après ce long oubli,
Ce secret dans mon sein restât enseveli ;
Car un roi doit à tous, quoi qu’on puisse prétendre,
Dire la vérité comme il devrait l’entendre !
J’eus tort, l’événement me le prouve trop bien !
Donnez donc votre avis, même contre le mien.
Autrefois, en un jour douloureux pour moi-même,
J’assemblai mes seigneurs en tribunal suprême,
Et c’est dans ce conseil que ma voix proclama
L’union d’Eginhard et de ma fille Emma2907.
Ce qu’ils furent jadis, vous le serez sans doute,
Bons et droits justiciers ! Parlez, je vous écoute.
LE duc nayme, descendant vers Gérald.
Gérald, le lendemain de Roncevaux, tandis
Que nous luttions depuis la veille un contre dix,
Je fus blessé, vaincu, par Danabeis le More2908 ;
(Montrant son front.)
La cicatrice est là : tu peux la voir encore.
Honneur à toi, Gérald ! Ton triomphe d’hier
A racheté l’honneur de ton père. — Sois fier,
Car devant toi, héros que la faveur divine
Nous a donné, moi, prince et vieillard, je m’incline !
hardré, descendant vers Gérald.
Honneur à toi, Gérald ! — Messire2909 chevalier,
Je suis le dernier fils du baron Angelier,
Au champ de Roncevaux mort pour la foi chrétienne :
Permets qu’en ce moment ma main serre la tienne !
Geoffroy, descendant vers Gérald avec son jeune frère.
Le soir à Roncevaux, l’archevêque Turpin2910,
Tandis que la bataille arrivait à sa fin,
Tomba près de Roland. Roland, cachant ses larmes,
Alla chercher les corps de ses compagnons d’armes ;
Aux pieds de l’archevêque il étendit les morts,
Le duc Sanche, Anséis, et bien d’autres ! Alors
L’archevêque, au Seigneur offrant cette hécatombe,
Bénit tous ces martyrs ; puis lui-même succombe.
— Hugon et moi, Gérald, nous sommes les neveux
De Turpin ; nous serons tes frères, si tu veux.
richard, allant à pas lents vers Gérald.
Sire Gérald, pardon !… moi, vieil homme de guerre,
Je vous dirais trop mal… mes larmes, ce n’est guère ;
Mais laissez-moi pleurer, eh baisant à genoux
Cette main qui vengea mon Roland… et nous tous !
charlemagne, du haut de son trône.
Le soir de Roncevaux, sous l’ombre des grands arbres,
Aux coups dont son épée avait taillé les marbres2911,
Je reconnus Roland ; je le pris dans mes bras,
Jurant de le pleurer tous mes jours d’ici-bas ;
Puis, dans l’herbe du val, de sang toute trempée.
Autour du héros mort je cherchai son épée :
Je ne la trouvai point, et ce fut un grand deuil.
Car il avait toujours témoigné cet orgueil,
De vouloir au tombeau dormir à côté d’elle ;
Il fallut la laisser aux mains de l’infidèle,
— C’est grâce à toi, Gérald, que, dans un jour plus beau,
Le glaive saint ira le rejoindre au tombeau !
Sois donc glorifié, vengeur de la patrie ;
Sois fier dans la douleur, dans ton âme meurtrie,
Et prends ta place, ainsi que je l’avais promis,
Sur les marches du trône, à côté de mes fils !
Le Duc Nayme.
Sois fier, Gérald !
Tous Les Seigneurs.
Sois fier !
charlemagne.
Et toi, Berthe, ma fille,
Toi qui maintiens si haut l’honneur de la famille,
Parle : il faut que chacun soit juge et soit témoin ;
Parle à ton tour.
Berthe.
Eh quoi, sire, en est-il besoin ?
Un mot suffit : l’autel est prêt, et je suis prête.
Allons, Gérald, allons ! — Pourquoi baisser la tête ?
(Gérald reste immobile.)
Pourquoi détournes-tu les yeux, Gérald ? Pourquoi
Ce silence obstiné ? Douterais-tu de moi ?
Veux-tu que je le dise à haute voix encore ?
(A tous les assistants.)
J’aime sire Gérald, autant que je l’honore ;
Je l’aime maintenant d’un cœur plus attendri,
Car ce qui l’a frappé ne l’a pas amoindri ;
Son honneur reste pur dans la cruelle épreuve,
Et la source n’a pas empoisonné le fleuve.
Je lui donnai mon âme, ici comme à Montblois2912,
Pour sa jeune vertu, pour ses nouveaux exploits,
Et je ne saurais pas de trahison plus noire
D’aimer moins son affront que je n’aimais sa gloire.
— Viens maintenant, Gérald !
Charlemagne.
Viens, Gérald, et reçois
La main que t’offre Berthe une seconde fois.
Gérald.
Sire, je vous bénis dans mon Ame confuse,
Mais, ce dernier bienfait, sire, je le refuse.
Berthe.
Dieu ! Gérald !
Gérald.
Laissez-moi m’expliquer devant vous,
Devant l’Empereur, Berthe, ainsi que devant tous.
Oui, sire, ce bienfait, cette faveur insigne,
C’est en les refusant que j’en puis être digne.
J’entends là cette voix qui ne saurait mentir :
Je suis le fils du crime, et non du repentir !
Afin qu’aux yeux de tous la leçon soit plus haute,
Je veux que le malheur soit plus grand que la faute ;
Et le père sera d’autant mieux pardonné
Que le fils innocent se sera condamné !
Sans cela l’on dirait, en citant mon exemple,
Que l’expiation ne fut pas assez ample ;
Et j’aime mieux briser mon cœur en ce moment
Que d’être un jour témoin de votre étonnement !
Oui, vous-mêmes, vous tous qui plaignez mes souffrances,
Vous qui me consolez dans mes horribles transes,
Peut-être cet élan de vos cœurs généreux
S’arrêterait bientôt à me voir plus heureux !
Mon père s’exilait2913 : nous partirons ensemble ;
Il sied que le destin jusqu’au bout nous rassemble.
— Que mon malheur du moins serve à tous de leçon,
Pour mieux vaincre à jamais l’esprit de trahison.
Songez à vos enfants ! Songez que d’un tel crime
Votre race serait l’éternelle victime,
Et que tous les remords, tous les pleurs d’ici-bas,
Toutes les eaux du ciel ne l’effaceraient pas !
Berthe.
Tu veux partir, Gérald ?
Gérald.
Oui, Berthe.
Berthe.
Ah ! si tu m’aimes,
Ne sois pas seul, Gérald, si cruel pour nous-mêmes !… Regarde l’avenir.
Gérald.
Je vois trop le passé !
Berthe.
Eh bien, si pour toi seul il n’est pas effacé,
S’il ne te suffit pas que l’Empereur pardonne,
S’il faut que la mort parle et que le ciel ordonne,
Eh bien, Gérald, au nom de mon père....
Gérald.
Plus bas.
Le mien pourrait entendre !
Berthe.
(Tombant dans les bras de ses suivantes).
Ah ! plus d’espoir, hélas !
gérald, allant vers Charlemagne.
Sire, devant ses pleurs, venez à ma défense !
Je ne peux rien céder contre ma conscience ;
Tout espoir me rendrait à moi-même odieux :
La fille de Roland au fils de… Justes dieux !
Non, jamais ! Sa pitié ne voit que mon martyre
Aujourd’hui… Mais demain ! Vous m’avez compris, sire.
Charlemagne.
C’est vrai, Gérald ! Ton roi, ton juge et ton seigneur,
Ne te saurait blâmer pour cet excès d’honneur ;
Mais, comme roi, voici ma sentence dernière :
Hier, pour délivrer Durandal prisonnière,
Je t’ai prêté Joyeuse2914. — Aujourd’hui, je fais mieux, :
Il faut à ton courage un prix plus glorieux :
Je veux que Durandal désormais t’appartienne,
Car la main de Roland la mettait dans la tienne.
La noble épée a soif du sang de l’étranger :
Toi, son libérateur, mène-la se venger ;
Et quand vous aurez fait ce qu’il faut faire encore,
Quand vous aurez chassé du couchant à l’aurore
Nos derniers ennemis, comme un troupeau tremblant,
Tu la rapporteras au tombeau de Roland !
Gérald.
Oui, sire, à son tombeau, là-bas ! en Aquitaine !
Et puis j’irai chercher une mort plus lointaine !
Berthe.
Et si la mort te fuit, Gérald ?
Gerald.
Je marcherai
Si loin et d’un tel pas, que je la trouverai !
Berthe, après un long silence.
Eh bien… je me soumets : qui t’aime te ressemble.
Dieu lit nos cœurs pareils : que Dieu seul les rassemble !
— Adieu, Gérald !
Charlemagne.
Barons, princes, inclinez-vous
Devant celui qui part : il est plus grand que nous !
(La Fille de Roland2915, acte IV, sc. iii.)
André Theuriet
(1833-1907) §
Né à Marly (Seine-et-Oise), mais élevé en Lorraine, André Theuriet a su peindre avec un rare bonheur, dans ses œuvres en prose et en vers, les aspects, les charmes, les senteurs de la forêt et ce calme apparent de la vie de province, qui recouvre parfois tant de drames intimes, aux péripéties aussi simples que douloureuses. Quelques-uns de ces récits en prose, les Souffrances de Claude Blouet (1870), la touchante histoire de Bigarreau (1884) sont de vrais chefs-d’œuvre, et plusieurs des pièces de ses recueils de vers, le Chemin des Bois (1867), le Bleu et le Noir (1874), sont rapidement devenues et sont demeurées célèbres2916.
La chanson du Vannier §
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Brins d’osier, vous serez le lit frêle où la mère
Berce un petit enfant aux sons d’un vieux couplet :
L’enfant, la lèvre encor toute blanche de lait,
S’endort en souriant dans sa couche légère.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Vous serez le panier plein de fraises vermeilles
Que les filles s’en vont cueillir dans les taillis ;
Elles rentrent le soir, rieuses, au logis,
Et l’odeur des fruits mûrs s’exhale des corbeilles.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Vous serez le grand van ou la fermière alerte
Fait bondir le froment qu’ont battu les fléaux2917,
Tandis qu’à ses côtés des bandes de moineaux
Se disputent les grains dont la terre est couverte.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Lorsque s’empourpreront les vignes à l’automne,
Lorsque les vendangeurs descendront des coteaux,
Brins d’osier, vous lierez les cercles des tonneaux
Ou le vin doux2918 rougit les douves2919 et bouillonne.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Brins d’osier, vous serez la cage où l’oiseau chante,
Et la nasse perfide au milieu des roseaux,
Où la truite, qui monte et file entre deux eaux,
S’enfonce, et tout à coup se débat frémissante.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
Et vous serez aussi, brins d’osier, l’humble claie
Où, quand le vieux vannier tombe et meurt, on l’étend,
Tout prêt pour le cercueil. — Son convoi se répand,
Le soir, dans les sentiers, où verdit l’oseraie2920.
Brins d’osier, brins d’osier,
Courbez-vous, assouplis sous les doigts du vannier.
(Le Chemin des bois : En forêt.)
Les confitures §
A la Saint-Jean d’été les groseilles sont mûres.
Dans le jardin vêtu de ses plus beaux habits,
Près des grands lis, on voit pendre sous les ramures
Leurs grappes couleur d’ambre ou couleur de rubis.
Voici l’heure. Déjà dans l’ombreuse cuisine
Les pains du sucre blanc, coiffés de papier bleu,
Garnissent le dressoir où la rouge bassine
Reflète les lueurs du réchaud tout en feu.
On apporte les fruits à pleines panerées,
Et leur parfum discret embaume le palier ;
Les ciseaux sont à l’œuvre et les grappes lustrées
Tombent comme les grains défilés d’un collier.
Doigts d’enfants, séparez, sans meurtrir la groseille,
Les pépins de la pulpe2921 entrouverte à demi !
La grave ménagère2922, attentive, surveille
Ce travail délicat d’abeille ou de fourmi.
Vous êtes son chef-d’œuvre, exquises confitures !
Dès que l’été fleurit les liserons2923 du seuil,
Après les longs travaux, lessives et coutures,
Vous êtes son plaisir, son luxe et son orgueil.
Que le monde ait la fièvre et que sa turbulence
Gronde ou s’apaise au loin, la tranquille maison
Toujours, à la Saint-Jean, voit les plats de faïence
Se remplir de fruits mûrs et prêts pour la cuisson.
Le clair sirop frissonne et bout ; l’air se parfume
D’une odeur framboisée… Enfants, spatule2924 en main,
Enlevez doucement la savoureuse écume
Qui perle et mousse au bord des bassines d’airain.
Voici l’œuvre2925 achevé. La grave ménagère
Contemple fièrement les godets de cristal
Où la groseille brille, aussi fraîche et légère
Que lorsqu’elle pendait au groseillier natal.
Les grappes maintenant bravent l’hiver… Comme elles,
La ménagère échappe aux menaces du temps ;
La paix du cœur se lit dans ses calmes prunelles,
Et son front reste lisse et pur comme à vingt ans2926.
(Le Bleu et le Noir : Intérieurs et paysages.)
Sully Prudhomme
(1839-1907) §
Né à Paris, Sully Prudhomme donna en 1866 un premier recueil, Stances et Poèmes, où le public admira, traduits dans une langue d’une rare précision, des sentiments d’une extrême délicatesse ou des pensées très élevées et très originales. Ses autres recueils, les Epreuves (1866), les Solitudes (1869), Croquis italiens (1872), les Vaines tendresses (1875), le Prisme (1886), sont remarquables par les mêmes mérites. Mais plus le poète avançait dans sa carrière, plus se manifestait sa prédilection pour les hautes spéculations de la philosophie. Elle lui a inspiré, outre quelques pièces admirables et une traduction du premier livre de Lucrèce2927, ses deux poèmes les plus étendus, la Justice (1878) et le Bonheur (1888)2928.
Le gué §
Ils tombent épuisés, la bataille était rude.
Près d’un fleuve, au hasard, sur le dos, sur le flanc,
Ils gisent, engourdis par tant de lassitude
Qu’ils sont bien, dans la boue et dans leur propre sang.
Leurs grandes faux2929 sont là, luisantes d’un feu rouge,
En plein midi. Le chef est un vieux paysan,
Il veille. Or, il croit voir un pli du sol qui bouge....
Les Russes ! Il tressaille et crie : « Allez-vous-en ! »
Il les pousse du pied. — « Ho ! mes fils, qu’on se lève ! »
Et chacun, se dressant d’un effort fatigué,
Le corps plein de sommeil et l’esprit plein de rêve,
Tâte l’onde et s’y traîne à la faveur d’un gué.
De peur que derrière eux leur trace découverte
N’indique le passage au bourreau qui les suit,
Et qu’ainsi leur salut ne devienne leur perte,
Ils souffrent sans gémir et se hâtent sans bruit.
Hélas ! plus d’un s’affaisse et roule à la dérive ;
Mais tous, même les morts, ont fui jusqu’au dernier.
Le chef, demeuré seul, songe à quitter la rive :
C’est trop tard ! une main le retient prisonnier.
« Vieux ! sais-tu si le fleuve est guéable où nous sommes ?
Misérable, réponds ; vivre ou mourir, choisis.
— Il a bien douze pieds. — Voyons », dirent ces hommes,
En le poussant à l’eau sous l’œil2930 noir des fusils :
L’eau ne lui va qu’aux reins, tant la terre est voisine,
Mais il se baisse un peu sous l’onde à chaque pas ;
Il plonge lentement jusques à la poitrine,
Car les pâles blessés vont lentement là-bas....
La bouche close, il sent monter à son oreille
Un lugubre murmure, un murmure de flux ;
Le front blanc d’une écume à ses cheveux pareille,
Il est sur ses genoux. Rien ne surnage plus.
Du reste de son souffle il vit une seconde,
Et les fusils couchés se sont relevés droits :
Alors, ô foi sublime ! un bras qui sort de l’onde
Ébauche dans l’air vide un grand signe de croix.
J’admirais le soldat qui dans la mort s’élance
Fier, debout, plein du bruit des clairons éclatants :
De quelle race es-tu ? toi qui, seul, en silence,
Te baisses pour mourir et sais mourir longtemps ?
(Poèmes.)
Le long du quai §
Le long du quai les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux
Que la main des femmes balance.
Mais viendra le jour des adieux ;
Car il faut que les femmes pleurent
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent.
Et ce jour-là les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l’âme des lointains berceaux.
(Stances :Mélanges.)
Un songe §
Le laboureur m’a dit en songe : « Fais ton pain :
Je ne te nourris pas ; gratte la terre et sème. »
Le tisserand ma dit : « Fais tes habits toi-même. »
Et le maçon m’a dit : « Prends la truelle en main. »
Et seul, abandonné de tout le genre humain,
Dont je traînais partout l’implacable anathème,
Quand j’implorais du ciel une pitié suprême,
Je trouvais des lions debout dans mon chemin.
J’ouvris les yeux, doutant si l’aube était réelle :
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle,
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.
Je connus mon bonheur, et qu’au monde où nous sommes
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes ;
Et depuis ce jour-là je les ai tous aimés.
(Les Épreuves : Action.)
Le dernier adieu §
Quand l’être cher vient d’expirer,
On sent obscurément la perte,
On ne peut pas encore pleurer :
La mort présente déconcerte ;
Et ni le lugubre drap noir,
Ni le Dies iræ farouche,
Ne donnent forme au désespoir :
La stupeur clôt l’âme et la bouche.
Incrédule à son propre deuil,
On regarde au fond de la tombe,
Sans rien comprendre à ce cercueil
Sonnant sous la terre qui tombe.
C’est aux premiers regards portés
En famille, autour de la table,
Sur les sièges plus écartés,
Que se fait l’adieu véritable.
(Les Solitudes).
François Coppée
(1842-1908) §
Né à Paris, François Coppée a publié, outre des contes et des nouvelles, plusieurs recueils de poésies, et fait représenter des drames et des comédies en vers. Quoique l’œuvre de ce poète délicat soit très varié, c’est par tout ce qu’il y a de poésie discrète dans la vie des humbles qu’il a surtout été séduit ; le petit poème la Grève des Forgerons (1869), les recueils les Humbles (1872), Promenades et Intérieurs (1872), Contes en vers (1880), témoignent d’une même préoccupation, de l’intérêt que prend le poète non seulement aux douleurs et aux joies des petits et des faibles, mais aux lieux mêmes où leur vie s’écoule. Parmi ses pièces de théâtre mentionnons seulement, après le Passant (1869), fantaisie délicieuse et dont le succès fut retentissant, deux comédies en un acte, pleines de charme et de sensibilité, le Luthier de Crémone (1877) et le Trésor (1878), et trois drames héroïques, Severo Torelli (1883), les Jacobites (1885), Pour la couronne2931 (1895).
A une pièce d’or §
Fragment §
D’une somme hier dissipée
Il me reste une pièce encor.
Elle est brillante et bien frappée ;
C’est un vieux napoléon d’or.
Pièce d’or, reine des monnaies,
Que tant de mains voudraient saisir,
Rien pourtant de ce que tu paies
Ne vaut la peine d’un désir !
Crésus2932 passe l’hiver à Nice,
Court les eaux thermales, l’été.
Mais perd-il son teint de jaunisse ?...
On n’achète pas la santé.
Ce mets exquis qu’un gourmand touche
En brouet noir se convertit ;
Un goût de cendre est dans sa bouche2933....
On n’achète pas l’appétit.
Vois ce lâche au cœur plein de rage,
Ce difforme au front attristé....
Tient-on boutique de courage ?
Est-il un marchand de beauté ?
Pour tout l’or de Californie,
Nul n’acquiert le laurier fatal2934
Planant sur l’homme de génie,
Qui meurt, obscur, à l’hôpital ;
Et les sacs d’écus qu’on entasse
Ne sauraient payer les vingt ans
Du joyeux vagabond qui passe,
Une fleurette entre les dents !
Malgré vos duretés, ô riches,
Je me sens pour vous indulgent,
Quand je songe aux bonheurs postiches
Qu’on vous donne pour votre argent !
On étouffe au théâtre, on crève ;
La Patti2935 va donner le sol....
Dans le bois où la lune rêve,
J’écoute un divin rossignol.
Payez très cher la courbature,
La gastrite et ce qui s’ensuit....
Elle est à vil prix, la nature ;
Le soleil couchant est gratuit !
Pièce d’or aux doigts du poète,
Je sens, quand j’y réfléchis bien,
Que pour moi tu n’étais pas faite :
Ce que j’aime ne coûte rien....
(Les Paroles sincères.)
L’angelus §
Si le son de la cloche est triste, il l’est bien plus
L’hiver, quand vient la nuit, et quand c’est l’Angélus
Qui sonne lourdement au clocher du village,
Rythmé par les sanglots de la mer sur la plage.
Dans les cœurs son écho lugubre retentit :
Celle qui reste songe à celui qui partit
Sur sa barque, parmi la brume et la tempête,
Se demandant, au bruit du rouet qui s’arrête,
Si là-bas, dans les flots, son homme, le marin,
À, comme elle, entendu les coups du grave airain,
Et si, malgré la lame affreuse qui grommelle,
Il s’est bien souvenu de se signer2936 comme elle.
(Poèmes modernes : Angélus, II.)
Le Magyar2937 §
lstvan Benko2938, magnat2939 de la steppe2940 hongroise,
Le même qui portait au pouce une turquoise2941
Qui pâlissait, dit-on, quand le Turc arrivait2942,
Prodigua follement tout le bien qu’il avait.
Ce seigneur fut vraiment magnifique2943; et l’on conte
Que, dans un bal champêtre, un jour, le riche comte
Vint, parmi ses vassaux, en superbes habits,
Couvert de diamants, de saphirs, de rubis
Et de lourds sequins d’or, qu’il avait, par caprice,
Mal attachés exprès au drap de sa pelisse,
Afin que, tout le temps qu’il serait à danser,
Ils tombassent par terre et qu’on pût ramasser.
Certes, les pauvres gens ne s’en firent pas faute.
Mais, quand ce fut fini, leur noble et puissant hôte
Alla droit vers un vieux qui, resté dans son coin,
S’était croisé les bras en regardant de loin,
Vrai Magyar, en manteau de laine aux larges manches,
En talpack2944 noir, et dont les deux moustaches blanches
Tombaient sévèrement sous un nez de vautour.
« Je voudrais te donner quelque chose à ton tour,
Père, lui dit le comte Istvan avec malice ;
Mais je n’ai plus un seul sequin sur ma pelisse.
Dis-moi : Pourquoi n’as-tu voulu rien ramasser ? »
Le vieillard répondit : « Il fallait se baisser. »
(Les Récits et les Elégies.)
François Fabié
(né en 1846) §
M. François Fabié, est né à Durenque (Aveyron) en 1846. Universitaire distingué, il s’est placé tout à fait au premier rang parmi les poètes, nombreux à notre époque, qui ont puisé leur inspiration dans les souvenirs du sol natal : il restera comme le chantre classique du Rouergue2945, qu’il a célébré dans deux recueils de vers vigoureux, sincèrement rustiques, animés d’un sentiment simple et profond, la Poésie des Bêtes (1886), le Clocher (1887)2946.
Le poète à son père §
C’est à toi que je veux offrir mes premiers vers,
Père ! J’en ai cueilli les strophes un peu rudes
Là-haut, dans ton Rouergue aux âpres solitudes,
Parmi les bois touffus et les genêts amers.
Tu ne les liras point, je le sais, ô mon père !
Car tu ne sais pas lire, hélas ! et toi qui fis
Tant d’efforts pour donner des maîtres à ton fils,
On ne te mit jamais à l’école primaire ;
Car, petit-fils d’un serf2947 et fils d’un artisan,
Dès que ton pauvre bras fut tout juste assez ferme
Pour pousser sur ses gonds le portail d’une ferme,
Tu tombas dans les mains d’un âpre paysan,
Qui, t’ayant confié cent brebis et vingt chèvres,
Du matin jusqu’au soir, et tous les jours de l’an,
T’envoya promener ce long troupeau bêlant
Par les ajoncs fleuris où sont tapis les lièvres....
Tu chantais, tu sifflais pourtant, pauvre petit !
Tu prenais aux lacets des perdreaux et des grives,
Et le soir, au souper, tes blanches incisives
Mordaient dans le pain noir d’un joyeux appétit.
C’est qu’une bonne fée, à travers les bruyères,
T’apportant en cadeau quelque rêve vermeil,
Venait te visiter souvent dans ton sommeil,
Et mettre du sourire au coin de tes paupières.
Mais depuis ces beaux jours, hélas ! que de jours sombres,
Que de chagrins cuisants, que de labeurs romains !
Que de manches de hache usés entre tes mains !
Que de soupirs éteints par le bois dans ses ombres !
Que de nuits sans sommeil lorsque les grandes eaux
S’engouffraient au ravin, pendant les mois d’automne !
Elles nous endormaient à leur voix monotone,
Mais tu tremblais pour ton moulin et nos berceaux.
Que de chocs meurtriers, que d’horribles blessures,
Dans cette lutte avec la matière, où souvent
Le bois se révoltait comme un être vivant,
Et rendait à ton corps morsures pour morsures !
Un vieux chêne noueux et dur comme le fer
Repoussait tout à coup, en grinçant, ta cognée,
Qui dans ton pied faisait une large saignée
Et mêlait aux copeaux des morceaux de ta chair.
La scie aux dents d’acier, la meule aux dents de pierre,
Déchiraient tour à tour ton corps endolori,
Sans jamais à ta lèvre arracher un seul cri,
Sans jamais d’une larme amollir ta paupière.
Oui, vingt fois je t’ai vu, stoïque2948 travailleur,
De quelque grand combat corps à corps contre un arbre
Revenir, le front pâle et froid comme le marbre,
Vaincu, saignant, mais fier et narguant la douleur !
Un jour même, — chacun pleurait près de ta couche.
Et nous, tes chers petits, t’appelions anxieux, —
Tu nous fis tout à coup quelque conte joyeux,
Et le rire soudain revint sur chaque bouche.
Car tu naquis conteur, comme nos bons aïeux !
Et nul ne t’égalait pour la verve caustique2949
Et l’entrain et le sel, — non pas le sel attique2950,
Mais le vieux sel gaulois, qui peut-être vaut mieux.
Aussi, lorsque Noël ramenait les veillées,
Si, tout en arrosant de vin bleu nos marrons,
Tu faisais un récit émaillé de jurons,
Les rires éclatants s’élevaient par volées.
C’est que, comme un ressort que nul choc n’a brisé,
La nature avait mis en toi sa gaîté franche,
Et tu te redressais toujours, comme la branche
Se redresse au soleil quand l’orage a passé.
L’âge même, sous qui le plus fort tremble et ploie,
A beau blanchir ta tête et te courber les reins,
Il ne peut t’arracher tout à fait tes refrains,
Et s’il te prend la force, il te laisse la joie.
Et tu vois arriver, sans regrets et sans peur,
— Comme un bon ouvrier ayant fini sa tâche, —
La mort, qui de tes mains fera tomber la hache
Et de son grand sommeil te paiera ton labeur.
Eh bien ! avant le jour — lointain encor, j’espère ! —
Où, jetant ta cognée et te croisant les bras,
Les yeux clos à jamais, tu te reposeras
Sous l’herbe haute et drue où repose ton père,
J’ai voulu de mes vers réunir les meilleurs,
Ceux qui gardent l’odeur de tes bruyères roses,
De tes genêts dorés et de tes houx moroses,
Et t’offrir ce bouquet de rimes et de fleurs.
Puis, un soir, je viendrai peut-être, à la veillée,
Te lire mon recueil ; et, si mes vers sont bons,
Tu songeras, les yeux fixés sur les charbons,
À ta fière jeunesse en mon livre effeuillée....
Et, si je vois alors cette larme captive,
Que jamais la douleur n’a pu faire couler,
Au bord de tes cils gris apparaître, trembler,
Glisser entre tes doigts et s’y perdre furtive,
Je dirai que mes vers sont clairs, simples et francs,
Que ma muse au besoin sait être familière,
Puisque, pareil à la servante de Molière2951.
Toi qui n’étudias jamais, tu me comprends ;
Je dirai que c’est là mon destin et ma tâche,
De chanter la forêt qui nous a tous nourris,
Et de me souvenir, chaque fois que j’écris,
Que ma plume rustique est fille de ta hache.
(La Poésie des Bêtes.)
Les genêts §
Fragment §
Vous en souvenez-vous, genêts de mon pays,
Des petits écoliers aux cheveux en broussailles
Qui s’enfonçaient sous vos rameaux comme des cailles,
Troublant dans leur sommeil les lapins ébahis ?
Comme l’herbe était fraîche à l’abri de vos tiges !
Comme on s’y trouvait bien, sur le dos allongé,
Dans le thym, qui faisait, aux sauges mélangé,
Un parfum enivrant à donner des vertiges !
Et quelle émotion lorsqu’un léger frou-frou
Annonçait la fauvette apportant la pâture,
Et qu’en bien l’épiant on trouvait d’aventure
Son nid plein d’oiseaux nus2952 et qui tendaient le cou !
Quel bonheur, quand le givre avait garni de perles
Vos fins rameaux émus qui sifflaient dans le vent,
— Précoces braconniers, — de revenir souvent
Tendre en vos corridors des lacets pour les merles !
Mais il fallut quitter les genêts et les monts,
S’en aller au collège étudier des livres,
Et sentir, loin de l’air natal qui vous rend ivres,
S’engourdir ses jarrets et siffler ses poumons ;
Passer de longs hivers, dans des salles bien closes,
A regarder la neige à travers les carreaux,
Éternuant dans des auteurs petits et gros,
Et soupirant après les oiseaux et les roses,
Et, l’été, se haussant sur son banc d’écolier,
Comme un forçat qui, tout en ramant, tend sa chaîne,
Pour sentir si le vent de la lande prochaine
Ne vous apporte pas le parfum familier....
Enfin, la grille s’ouvre ! On retourne au village ;
Ainsi que les genêts, notre âme est tout en fleurs,
Et dans les houx, remplis de vieux merles siffleurs,
On sent un air plus pur qui vous souffle au visage....
(Le Clocher.)
Jean Aicard
(né en 1848) §
Né à Toulon, poète, auteur dramatique, romancier et conteur, M. Jean Aicard s’est distingué dans des genres et des sujets très divers. Mais il semble que son inspiration ne le serve jamais mieux que lorsqu’elle le ramène vers son pays natal : il est, parmi nos poètes contemporains, le chantre de la Provence. Il est également l’un de ceux qui ont su le mieux, avec le plus de charme et de justesse, exprimer la poésie de l’enfance : ses Poèmes de Provence (1874) et sa Chanson de l’Enfant (1876) furent, dès leur apparition, couronnés par l’Académie française, ainsi que son poème de Miette et Noré (1880) et son Lamartine (1883). Comme auteur dramatique, M. Jean Aicard, entre autres œuvres, a fait représenter deux drames en vers qui restent au répertoire du Théâtre-Français, un Othello (1879), adapté de Shakespeare, et une sorte de tragédie bourgeoise, le Père Lebonnard (1887).
Souvenirs d’enfance §
i
La fin du monde §
Sur les bancs de l’école un bruit avait couru :
« Demain la fin du monde ! » Et moi qui l’avais cru,
Lorsque tinta la cloche, à l’heure où de l’école
La troupe des enfants avec des cris s’envole,
Je m’en allai muet, triste vers la maison,
Sans rien voir, ni le jour montant sur l’horizon,
Ni le sentier menu qu’une fourmi traverse,
Ni là-bas, au tournant du vieux mur, sous la herse2953,
Le creux où l’eau s’amasse attirant les oiseaux,
Ni les rubans jaunis et bruyants des roseaux
Que dans son vol strident frôle la libellule,
Rien de ce qui s’émeut quand vient le crépuscule.
« Nous allons tous mourir ! on l’a dit. C’est demain ! »
Je répétais ces mots tout le long du chemin ;
J’en tirais clairement toutes les conséquences,
Je pensais : « Tous mourir ! Et si près des vacances !
En été ! Quand les blés sont mûrs, bons à couper !
Vienne donc la moisson2954, le soir après souper
Nous n’irons pas sur l’aire, où les pailles sont molles,
Courir et nous pousser avec des cabrioles,
Et nous asseoir ensuite en écoutant les vieux
Quand la lune est tout près de terre, au bas des cieux !2955 »
Puis, songeant à l’école, à l’air grave du maître :
« Encor si cette fin du monde pouvait être
Un jeudi ! Mais aller à l’école en prison,
Pour mourir ! et peut-être en disant ma leçon ! »
Ainsi je raisonnais d’une façon profonde,
Et je rêvai, la nuit, de cette fin du monde !
« Si grand-père voulait, me dis-je à mon réveil,
Il ne m’enverrait pas en classe un jour pareil !
Si j’osais lui parler du malheur qui s’approche ! »
Pourquoi n’osai-je pas, quand d’un ton de reproche
Il vint me dire : « Jean, que fait-on ce matin ?
Travaille, si tu veux qu’on te mette au latin !
A l’école !… » — Il faut partir, coûte que coûte ;
Je partis, mais le cœur me défaillit en route.
« Je veux mourir ici : je n’irai pas plus loin ! »
C’est pourquoi je m’assis dans un grand tas de foin,
Où je fondis en pleurs ! « Plus de jeux dans les herbes,
Plus de rires le soir sur les meules de gerbes !
Adieu le ciel, l’enclos, mon grand-père et mon chien !… »
Quand tout à coup l’aïeul apparaissant : « Eh bien !
Que fait-on là ? » J’entends sa voix douce et qui gronde.
« Oh ! lui dis-je en pleurant, j’attends la fin du monde ! »
Et comme il souriait, d’un grand air de raison
J’ajoutai : « J’ai voulu mourir à la maison ! »
O temps ! ô souvenirs ! émotion première !
Comme je vous aimais déjà, fleurs et lumière !
Collines, bois sacrés, bon soleil réchauffant,
Oh ! je t’aimais déjà, Nature, tout enfant ;
Mais j’ignorais alors, tremblant que tu ne meures,
Que c’est nous qui passons devant toi qui demeures.
II
le mal du pays §
« On sait mieux le français au pays de la neige :
Éloignons cet enfant de nous, se dirent-ils ;
Il faut que les garçons apprennent les exils. »
Et l’on m’envoya loin, à Mâcon, au collège2956.
Oh ! comme je pleurais là-bas, pauvre petit !
Mes compagnons de classe en ont gardé mémoire,
Et ceux qui m’ont revu m’en ont redit l’histoire :
Plus de gaietés d’enfant, de jeux ni d’appétit.
Et mes grands yeux, encore agrandis parla fièvre,
Poursuivaient fixement le songe du retour ;
Je mourais d’un regret de soleil et d’amour ;
Les lettres du pays ne quittaient plus ma lèvre.
Pourtant les bois sont beaux où l’on allait courir :
Mais est-ce la beauté que, si petit, l’on aime ?
Et je me repliais, frissonnant, sur moi-même,
Comme un oiseau blessé se blottit pour mourir.
Voulant m’ôter du cœur la Provence lointaine,
Des mères par pitié m’embrassaient quelquefois....
Leur baiser m’était doux, mais j’entendais leur voix :
Quel accent étranger m’eût guéri de ma peine ?
O seuils hospitaliers, merci !… Je me souviens !
Je vis alors Saint-Point2957 (où la Muse en deuil pleure) ;
J’entendis, essuyant mes larmes pour une heure,
Lamartine indulgent me parler de ses chiens.
Mais ni le châtelain, dont je savais la gloire,
Ni les dames m’offrant les gâteaux et le miel,
Ni tant d’amis nouveaux n’effacèrent ton ciel,
Provence, de mon cœur tout plein de ta mémoire.
Le soleil n’avait pas de ces rayons joyeux
Qui semblent souhaiter à tous la bienvenue ;
Je vis qu’assombrissant leur figure inconnue
Les choses m’accueillaient avec de mauvais yeux ;
Oui, là je me sentais indifférent aux choses,
Car elles ont des yeux qui s’animent parfois ;
Et c’est ce qui fait peur aux enfants dans les bois :
Ils devinent dans tout des paupières écloses.
Chez nous, je ne craignais ni le roc endormi,
Ni l’antre plein d’échos, ni la falaise amère ;
La terre, m’accueillant comme une bonne mère
Disait aux bois émus : « C’est le petit ami ! »
La nature m’aimait là-bas, m’ayant vu naître,
Car les faibles sont siens, des nids jusqu’aux berceaux.
Elle me supportait comme un de ses oiseaux ;
Mais la nature, ici, ne pouvait me connaître.
Et même, à la cité, toits aigus des maisons,
Pavé sombre et murs noirs, rien n’avait de tendresse.
Je tournais mes regards vers le Midi sans cesse,
Mais la pluie à longs traits barrait les horizons.
Oh ! pensais-je, palmiers, aloès, plantes grasses !
Quand vous verrai-je encor, doux hiver, âpre été,
Murs tout blancs de poussière ardente et de clarté.
Et vous, toits du pays, faits comme des terrasses ?
« Ah ! rien ne m’aime ici ! je suis comme perdu ! »
Si ce cri m’échappait, on me fermait la bouche ;
Mais les soirs, grelottant dans mon étroite couche,
Je me livrais sans fin au regret défendu.
Je voyais tour à tour les départs, l’arrivée,
Et toujours mon grand-père était devant mes yeux,
Assis près du portail, prolongeant les adieux,
Me saluant au loin de sa canne levée.
Il fallut m’emporter en Provence, un beau jour,
Ce rêve intérieur m’ayant consumé l’âme....
Le soleil ralluma ma vie avec sa flamme ;
O souvenir sacré, ce moment du retour !
J’avançais, et les pins, les collines natales,
Vite me racontaient tout mon petit passé ;
« J’avais fait une chute au bord de ce fossé ;
Là, j’avais pris un nid, et plus loin des cigales. »
Au fils devenu grand, longtemps abandonné,
La mère conte ainsi son enfance première :
Un amour maternel était dans la lumière,
Quand je revis enfin la terre où je suis né.
(La chanson de l’enfant2958, seconde partie : Impressions d’enfant, Souvenirs.)
En Provence, le soir §
Quand le jour a chauffé la terre comme braise
Et qu’elle exhale encor des vapeurs de fournaise,
Bien que le soleil soit derrière l’horizon,
Alors j’aime écouter, du seuil de la maison,
La cigale, au sommet d’une tige menue,
Qui s’attarde à chanter, la nuit presque venue,
Parce que l’air est chaud et lui fait oublier
Que le soleil ardent a cessé de briller.
Mais le paysan dit qu’elle chante à cette heure,
Lorsque, née au matin, il est temps qu’elle meure :
La mourante, fixant vers l’occident ses yeux,
Au soleil disparu prolonge ses adieux,
Et, plus mélodieuse en sa chanson dernière,
Meurt avec le suprême adieu de la lumière.
(Poèmes de Provence2959, les Cigales, XIII.)
Jean Richepin
(né en 1849) §
Né à Médéah, en Algérie, M. Jean Richepin, dont les premières œuvres ont été publiées dès 1872, s’est surtout fait connaître, quatre ans plus tard, par sa Chanson des Gueux, qui, malgré d’étranges hardiesses, séduisit les lettrés par quelques pièces exquises et par l’effort souvent heureux qu’elle révélait pour enchâsser dans une forme très artistique le vocabulaire du peuple. Le poète y chantait la misère, pitoyable ou gouailleuse, les joies, parfois sinistres, des déshérités, des déclassés, des vagabonds des champs et de la ville. Les œuvres qui ont suivi, plus virulentes d’abord, plus assagies ensuite, montrent, en somme, M. Richepin fidèle au même idéal : une espèce de dédain forcené du bourgeois, qui n’exclut pas une certaine douceur chaleureuse dans la peinture de la vie des simples et des humbles. Au service de ces sentiments, le poète met, d’ailleurs, une langue très riche, très colorée, avec une versification d’une souplesse et d’une abondance merveilleuses. Ces mérites paraissent peut-être plus éclatants encore dans les œuvres dramatiques de M. Richepin, parmi lesquelles nous rappellerons les jolies comédies de Monsieur Scapin (1886) et du Flibustier (1888) et le drame du Chemineau (1897)2960.
Premier départ §
Quand s’entr’ouvrent les yeux des marguerites blanches,
Quand la feuille en tremblant palpite au bout des branches,
Quand les lapins frileux commencent, le matin,
À sortir du terrier pour courir dans le thym,
Quand les premiers oiseaux, chantant leurs chansonnettes,
Font dans le ciel plus pur vibrer leurs voix plus nettes,
A l’époque où le monde heureux se rajeunit,
Les petits mendiants doivent quitter leur nid.
Ils sortent de la hutte où, comme des marmottes,
Ils ont dormi l’hiver auprès d’un feu de mottes,
Cependant que la mère attisait le brasier
Et tressait en chantant des corbillons d’osier.
C’est en vendant ces blancs hochets aux verts losanges
Qu’ils vont gagner leur pain, les pauvres petits anges.
Le père est mort depuis quatre mois. La maison
Est trop chère à louer, et pour cette raison
La mère chez autrui va devenir servante.
On se retrouvera pour la saison suivante,
Quand on aura gagné quelque argent cet été.
En attendant chacun s’en va de son côté.
Les petits prennent leur baluchon2961 sur l’épaule
Et mettent leurs sabots au bout garni de tôle ;
Et quand la mère, avec des sanglots dans la voix,
A baisé le dernier une dernière fois,
Ils partent, se tenant par la main, d’un air grave.
L’aîné siffle un refrain pour paraître plus brave ;
Mais il sent de gros pleurs lui rouler dans les yeux.
Il ne pleurera pas, car c’est lui le plus vieux,
Car le long des chemins voici qu’ils sont en marche,
Et l’enfant de douze ans devient un patriarche.
(La Chanson des Gueux. Gueux des champs : l’Odyssée du vagabond, I.)
Le vieux marin §
Le vieux marin Legoëz (la scène est à Saint-Malo, à la fin du xviie siècle, et la large fenêtre du logis donne sur la pleine mer) a attendu pendant quinze ans le retour de son petit-fils Pierre, parti comme mousse, quand il en avait dix. Un jour quelqu’un s’est présenté chez lui, un marin, qui venait de la part de Pierre apporter de ses nouvelles à sa famille : mais le vieux grand-père ne l’a pas laissé parler et a cru tout de suite reconnaître en lui son petit-fils lui-même ; et, par une sorte de piété filiale mal entendue, Marie-Anne et Janik, la bru et la petite-fille de Legoëz, la tante et la cousine de Pierre, ont supplié le jeune homme de ne pas le détromper. — Cependant, un peu plus tard, Pierre est revenu et Legoëz, plein de fureur, a chassé l’ « intrus », Jacquemin, malgré son évidente honnêteté, malgré l’amour partagé qu’il ressent pour Janik, faisant retomber sur le malheureux jeune homme la responsabilité d’une méprise dont il n’est pas coupable. — Mais, chose étrange, Jacquemin était un marin selon le cœur de Legoëz ; Pierre est un brave lui aussi, et qui revient riche au pays ; mais il a perdu le goût de la mer, c’est un « terrien », et Legoëz n’en peut cacher sa déception. — Au moment où s’engage le dialogue qu’on va lire, Legoëz, malgré son petit-fils, sa bru et sa petite-fille, qui tous prennent le parti de Jacquemin, vient de maudire celui-ci une fois de plus.
Legoëz, Pierre, son petit-fils, Marie-Anne, bru de Legoëz et tante de Pierre, Janik, fille de Marie-Anne.
Legoëz
Eh bien ! J’ai tort. Parlons d’autre chose, en effet.
Tiens, redis nous plutôt, toi. comment il se fait
Que tu cherchas fortune aux mines du Mexique,
Et que, parti marin, tu nous reviens… cacique2962 ?
Pierre
Je voguais sur un bout d’aviron2963, quand passa
Ce navire anglais.
Legoëz
Hon ! Je n’aime pas bien ça,
Anglais2964 !
Pierre
Il m’a sauvé la vie.
Legoëz
Oui, je l’accorde.
N’importe ! Ces Anglais, gens de sac et de corde.
Pierre
Enfin, Anglais ou non, ils m’avaient repêché.
C’étaient des chercheur d’or. Avec eux j’ai cherché.
Une vie à mon gré, vaillante, aventureuse,
Libre surtout. Je n’en sais pas de plus heureuse.
Un pays ! Du nouveau partout, à chaque pas !
Et des rochers ! Un sol...
Legoëz
Il ne me plairait pas.
Des rochers ! Des rochers ! Se peut-il qu’on préfère
Des rochers
(Montrant la mer). à ça ?
Pierre
Mais...
Legoëz
L’eau, voilà mon affaire.
Et tes montagnes, peuh !
Pierre
Avec des mines d’or.
Marie-Anne
C’est là que vous avez découvert le trésor ?
Pierre
Oh ! découvert ! après quatre ans de dure peine.
Marie-Anne
N’empêche ! Trente sacs pleins d’or, c’est une aubaine.
N’est-ce pas, Janik ?
janik, d’un air indiffèrent2965.
Oui,
Legoëz
Sans doute ; mais aussi,
Les gagner en fouillant sous la terre, merci !
Sale métier !
Pierre
On n’est pas toujours sous la terre.
On vit moins en mineur, là-bas, qu’en militaire.
Chasse, bataille, course à travers monts et vaux !
Legoëz
Ça t’amuse donc, toi, de monter des chevaux ?
Pierre
Mais oui.
Legoëz
Moi, j’aimais mieux chevaucher sur les vagues.
Pierre
Chacun son goût, grand-père, et le mien...
Legoëz
Tu divagues.
On ne compare pas le sol avec le flot,
Et jamais cavalier ne valut matelot.
Pierre
Je ne dis pas ; mais quand vous verrez cette terre,
Son beau ciel, la prairie immense et solitaire,
Et les vierges forêts qui descendent des monts,
Et l’air libre qu’on y respire à pleins poumons,
Et l’espace sans borne ouvert devant la marche,
Quand vous y régnerez comme un roi patriarche.
Peut-être cependant trouverez-vous aussi
Qu’on y peut vivre à l’aise et même mieux qu’ici.
Legoëz
Mieux qu’ici !… Tu l’entends, Janik ?
Janik
J’entends, grand-père.
legoëz, à Pierre.
Et tu veux nous mener là-bas ?
Pierre
Mais, je l’espère.
Legoëz
Diable ! à cet espoir-là je n’avais pas songé.
Pierre
Le voyage... ?
Legoëz
Oh ! cela n’est rien. J’ai voyagé.
Tu penses bien qu’après trente ans de cabotage2966,
Ce bout de traversée, et même davantage,
Ne me fait pas peur. Mais...
Pierre
Quoi ?
Legoëz
Ton diantre de coin2967,
Est-ce que c’est tout près de la mer ?
Pierre
Non.
Legoëz
Bien loin ?
Pierre
Vingt jours.
Legoëz
Oh ! oh ! Plus loin qu’aucun bourg de Bretagne.
Alors, même du plus fin haut2968 de la montagne,
On ne la voit pas ?
Pierre
Qui ?
Legoëz
La mer.
Pierre
Non.
Legoëz
Triste endroit !
Hein, Janik ?
Janik
Certe.
Legoëz
Et quand il vente du noroît2969,
Et que le plein du flot vient des côtes anglaises,
On ne l’entend jamais saborder2970 les falaises ?
Pierre
Mais non.
Legoëz
Et quand, avec ses pavillons flottants,
Rentre au port un bateau parti depuis longtemps,
On ne va pas au quai tout en joyeux tapage
Voir si l’on reconnaît son gas2971 dans l’équipage ?
Pierre
Non, bien sûr.
janik, regardant le ciel et comme se parlant à elle-même.
Et le soir, quand le soleil descend,
Où donc, te mires-tu, beau nuage, en passant,
Goëland2972 fatigué qui sur l’onde sommeilles,
Berçant ton ventre d’or et tes ailes vermeilles ?
pierre, un peu ironique.
Mais, cousine, pour vos beaux nuages errants,
Permettez, nous avons de grands fleuves, si grands
Qu’on ne distingue rien de l’une à l’autre rive.
Legoëz
Les fleuves ! Oui, je sais. Ça coule à la dérive.
Sans doute, c’est de l’eau ; de l’eau qui marche ; mais
Elle s’en va toujours et ne revient jamais.
Ce n’est pas comme ici. La marée est fidèle.
Elle a beau s’en aller au diable, on est sûr d’elle.
Au revoir ! Au revoir ! dit-elle en se sauvant.
Car elle parle. Car c’est quelqu’un de vivant.
Et tout ce qu’elle crie, et tout ce qu’elle chante,
La mer, selon qu’elle est d’humeur douce ou méchante !
Et tous les souvenirs des amis d’autrefois,
Dont la voix de ses flots a l’air d’être la voix !
Et les beaux jours vécus sur elle à pleines voiles !
Et les nuits où l’on croit cingler vers les étoiles !
Ah ! mon Pierre, mon gas, tout ça, ce n’est donc rien !
Maudit soit le pays qui t’a rendu terrien !
Il peut être plein d’or ; je n’en ai pas envie.
Certes, je n’irai pas y terminer ma vie.
Pour moi, tout vent qui vient de terre est mauvais vent.
Un vrai marin, ça meurt sur la mer,
(Montrant la fenêtre.) ou devant2973.
(Le flibustier, acte III, sc. i.)
Maurice Bouchor
(né en 1855) §
M. Maurice Bouchor n’avait pas vingt ans quand il se fit connaître par un recueil de vers d’une verve copieuse et juvénile, les Chansons joyeuses (1874). Ceux qui suivirent, l’Aurore (1888), les Symboles surtout (1888-1895) sont d’une inspiration plus profonde et plus grave. En même temps le poète, sous le nom de Mystères, donnait quatre petites pièces, Tobie (1887), Noël (1890), la Légende de Sainte Cécile (1892), les Mystères d’Eleusis (1894), d’une originalité exquise et où s’unissent la fantaisie la plus gracieuse, l’émotion la plus délicate et souvent la pensée la plus généreuse ou la plus philosophique. Depuis, on peut dire que le poète, chez M. Maurice Bouchor a aspiré à se confondre de plus en plus avec le citoyen et l’homme d’action : il s’est voué tout entier à la cause de l’éducation populaire et toutes ses publications, ses œuvres personnelles comme ses éditions fragmentaires des grands classiques, témoignent du souci de collaborer efficacement au progrès social par l’art et par la poésie.
Entrée en forêt §
Le bois antique et jeune encore
Dans sa beauté calme apparaît,
Empourpré de lueurs d’aurore :
Salut, chênes de la forêt !
Vous vivez entre deux abîmes,
Plongeant du pied sous le sol dur
Et portant vos têtes sublimes
Au cœur de l’immortel azur.
Vous avez la grâce et la force :
Car les oiseaux vous font chanter
Et sur votre rugueuse écorce
L’effort du temps vient avorter.
Enfin, malgré la bise noire,
L’hiver rude, le torride été,
Vous portez fièrement la gloire
De votre verte éternité !
Librement mon cœur se dilate
Et s’épanouit au soleil,
O fraîcheur du matin vermeil,
O splendeur du soir écarlate,
O tranquillité des midis,
Là-bas dans les forêts prochaines,
O doux sommeil au pied des chêne ;
Sur des lits de mousse attiédis !
Enfin la vie heureuse et douce
Va me bercer entre ses bras,
Tandis que moi, franc d’embarras,
J’écouterai l’herbe qui pousse.
Je pourrai donc, libre et rêvant,
Etre joyeusement poète !
Avec le cri de l’alouette
Tous mes vers s’en iront au vent,
Au vent frais qui, sous les ramures,
S’en va mêlant parmi les fleurs
La chanson des oiseaux siffleurs
Et le parfum des fraises mûres.
(Les Chansons joyeuses2974. Dans la forêt.)
Un « débat » du vieux temps2975 §
L’eau et le vin §
Le Vin
Ah ! te voilà, commère l’Eau !
Toujours en mouvement… Fleuve aux rapides ondes
Ou modeste petit ruisseau,
Que tu babilles, que tu grondes,
Sans cesse à travers champs, folle, tu vagabondes !
l’eau
Moi ? Non pas. Quelquefois, beau lac aux eaux profondes
Je reflète l’azur, les monts, le soir vermeil ;
Ou, paresseux étang, je rêve en plein soleil
Parmi les nénuphars aux larges feuilles rondes.
Le Vin
Fort bien : mais tu jaillis en source dans les bois ;
Tu soulèves, torrent, tes vagues furibondes
Tout en faisant la grosse voix ;
Cascade, tu bondis la tête la première
Dans un abîme… Ah ! ma commère,
Tu t’agites beaucoup. Quoi ! toujours du nouveau ?
Voir du pays, c’est donc si beau ?
En attendant le jour de gloire
Où, faisant mon éloge, un gourmet va me boire,
Moi, je reste dans mon tonneau.
l’eau.
Mon compère le Vin nous en conte de fortes.
Il est vrai que, depuis six mois,
Tu vis tranquillement dans ta maison de bois,
Comme ferait un bon bourgeois ;
Mais ce n’est pas ainsi, Vin, que tu te comportes,
Quand le sabot d’un gai luron2976
Vient d’écraser la grappe aux premiers jours d’automne.
Tu palpites, alors ; tu frémis dans la tonne ;
Tu fais rire le vigneron
Par le bouillonnement de tes ondes vermeilles....
Rendre sage le vin nouveau ?
Diable ! c’est peu commode. Il jaillit du tonneau,
S’échappe en sifflant des bouteilles,
Jette en l’air les bouchons, fait les cent coups, enfin !
Le vin.
Il faut bien, comme on dit, que jeunesse se passe.
L’eau.
Soit. Te voici calmé, mon compère le Vin ;
Mais reconnais de bonne grâce
Qu’une dangereuse fureur
Se cache sous ton air paisible.
C’est en vain que tu fais l’aimable et le rieur.
Dans la cervelle du buveur
Tu seras gai, d’abord ; puis tu seras terrible.
Tu le rendras brutal, maussade, querelleur.
Après quelques heures d’ivresse
Tu l’enseveliras dans un pesant sommeil ;
Il sera morne à son réveil ;
Et, tout le jour, honteux de voir le clair soleil
Cheminer avec allégresse,
Il croupira dans la paresse !
Le vin.
C’est tout ? Allons, tant mieux. Quel gracieux tableau
Tu nous fais là, commère l’Eau !
Je suis donc bien méchant, moi, fils des bonnes vignes ?
Tes propos sont désobligeants....
Écoute bien. Beaucoup de gens
Boivent du vin, c’est vrai ; mais tous n’en sont pas dignes.
Est-ce ma faute, à moi, s’ils manquent de raison
Et passent la juste mesure ?
Je fais du bien, la chose est sûre ;
Mais remède mal pris se transforme en poison.
Le sang généreux de la grappe
Rend dispos le gaillard qui sait en bien user.
Est-ce que l’on va m’accuser
De la sottise humaine ? Ah ! mais non ! Je les frappe,
Tu le sais bien, et sans pitié,
Ceux qui font trop souvent la fête.
Malheur à l’imprudent qui veut me tenir tête !
Il sera bientôt châtié.
Je le ravalerai, moi, plus bas que la bête ;
Il peut se le tenir pour dit....
Toi, c’est différent, ma commère.
Quand tu répands la mort, le deuil et la misère,
Tous ignorent pourquoi ; rien ne vous avertit.
Dans les ténèbres de la nuit
Ton flot, tout à coup, retentit
Sous les voûtes des ponts ; parfois il les emporte ;
Plus haute, plus large, plus forte,
Tu bondis à travers les champs,
Qu’épouvantent soudain tes formidables crues ;
Tu renverses les murs, tu mugis dans les rues,
Noyant partout bêtes et gens....
Voilà de beaux exploits, dont tu peux être fière.
Dis, qu’en penses-tu, ma commère ?
L’eau.
Dame ! on n’est point parfait. J’ai mes jours de colère ;
Le meilleur est parfois mauvais...
Mais que sont, après tout, mes plus cruels ravages
Près de mes immenses bienfaits ?
Si j’ai, de temps en temps, quelques fureurs sauvages,
Je suis bonne presque toujours.
L’homme a soin de bâtir les villes sur mon cours.
Je chante sous les ponts en caressant leurs arches,
Quand mon flot roule calme et plein ;
Je fais joyeusement tourner plus d’un moulin,
Et, comme l’a dit un malin,
Je suis un grand chemin qui marche2977.
En miroitant sous le ciel clair
Je porte les vaisseaux jusqu’à la vaste mer.
Je reverdis les bois ; j’arrose les prairies ;
Mes rives sont gaîment fleuries.
Je suis fraîche même l’été ;
Je verse la richesse et la fécondité....
Pour me donner, enfin, un nom bien mérité,
C’est moi qui suis la Propreté.
Tu ne diras pas non : quand tu rougis les nappes,
Quand, par malice, tu t’échappes
Sur un gilet tout neuf qui te semble trop beau,
Quand tu salis un frais corsage,
Qui répare le mal que tu fis au passage ?
C’est l’Eau, mon compère : c’est l’Eau !
Le vin.
Ce que tu dis n’est pas si bête.
En somme tu parais honnête,
Et, j’en tombe d’accord, l’Eau peut avoir du bon.
Mais crois-tu que le vigneron,
Dont la vie est une bataille,
Dépense follement sa peine et sa sueur ?
Infatigable travailleur,
Sans repos il laboure et taille,
Luttant contre le sol et contre les fléaux,
La tardive gelée, et la grêle, et les pluies
(Car, souvent, c’est toi qui l’ennuies),
L’invisible rongeur, cause de tant de maux2978,
Et les impertinents oiseaux....
Eh bien ! s’il prend peines sur peines.
Crois-moi, c’est que le fruit de son travail est bon.
Petit vin de pays ou crû de grand renom,
J’active2979 le sang dans les veines ;
Je rends force et courage aux travailleurs lassés ;
Je mets un peu de rose à de trop pâles joues....
Commère, il faut que tu l’avoues,
Tu n’émoustilles2980 pas assez,
Lorsque l’on est en fête et qu’il est bon de rire2981.
Grâce à moi les yeux vont briller
Et les langues se délier.
On me verse gaîment ; on me flaire ; on admire
Mon flot brillant ou velouté ;
Puis, dès que l’on m’a dégusté,
Chacun se sent meilleur, tendre, — humain, pour tout dire :
Car mon nom est Fraternité !
L’eau.
Allons, je te rends mon estime.
Puisque t’aimer est légitime,
Soyons amis.
Le vin.
Bravo ! Haïr ne sert de rien ;
Mieux vaut nous marier, commère. Que t’en semble ?
L’eau.
Comment ? nous marier ensemble ?
Le Vin.
Oui ; tous les deux.
L’eau.
Ma fois, compère, je veux bien.
Je n’aurais pas eu cette idée ;
Mais, si cela te plaît, c’est chose décidée.
Le Vin.
Pour qu’ils nous fêtent par leurs chants,
Prévenons les oiseaux de tout le voisinage.
l’eau.
Marions-nous, compère, et faisons bon ménage !
Soyons l’un pour l’autre indulgents....
Le Vin.
Source claire des bois et sang des grappes mures,
Marions-nous, commère, avec de gais murmures,
Pans le verre des braves gens !
(Poèmes et récits, d’après de vieilles chansons de France2982.)